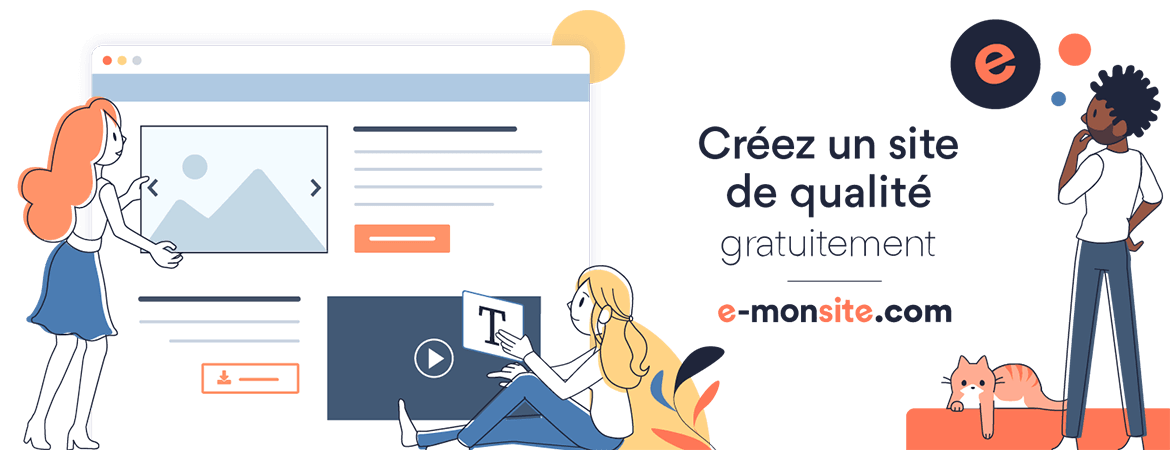Articles de hervegautier
-
la lucarne
- Par hervegautier
- Le 19/03/2023
- Dans José Saramago
- 0 commentaire
N°1726 – Mars 2023
La lucarne – José Saramago – Seuil.
Traduit du portugais par Geneviève Leibrich.
Ce roman écrit entre 1940 et 1950, qui est le deuxième d’un jeune auteur alors inconnu, fut refusé par l’éditeur portugais à qui il avait été envoyé et qui ne prit même pas la peine de lui répondre. On imagine la frustration de ce jeune homme qui avait mis dans cet ouvrage tous ses espoirs et aussi sans doute pas mal d’illusions. Ce ne fut qu’en 1989 que ce même éditeur, prétextant un déménagement et la découverte fortuite de ce manuscrit, en proposa l’édition, ce qui fut refusé par l’auteur qui maintint sa décision jusqu’à sa mort. L’ouvrage ne fut publié qu’à titre posthume, mettant notre auteur, toutes choses égales par ailleurs, dans la même posture que Fernando Pessoa, son illustre prédécesseur, qui confia une partie de son œuvre à une vielle malle avant son décès. Il n’est pas inutile de préciser que José Saramago (1922-2010) avait entre-temps acquis une vraie notoriété et fut plus tard, en 1998, couronné par le Prix Nobel de littérature. Cela n’est pas sans rappeler la mésaventure littéraire de Marcel Proust qui vit son roman « Du coté de Chez Swan » refusé par Gallimard mais obtint l’année suivante, en 1919, le Prix Goncourt pour « A l’ombre des jeunes filles en fleurs », deuxième tome de « A la recherche du temps perdu ». La même péripétie est arrivée à Mathias Enard pour « Boussole » qui reçut le Goncourt en 2015 ! Tout cela n’est pas sans poser question sur la fonction d’éditeur dont le rôle principal est la découverte de talents ! Ça n’a pourtant pas été simple pour Saramago, né dans un milieu quasi analphabète et qui dû très tôt exercer des métiers ingrats avant de voir son talent reconnu.
Ce roman se passe dans un immeuble de Lisbonne où vivent six couples avec ou sans enfants où chacun connaît son voisin, lui parle, l’observe, le juge, se limitant à des rapports de voisinage sans plus. L’auteur commence par les présenter pour ensuite décliner leur histoire personnelle alternativement au cours des chapitres suivants et ainsi affiner chaque portrait. Dans ce microcosme Saramago observe les familles, jeunes et vieilles, qui connaissent des difficultés financières, recherchent le bonheur mais aussi qui sont minés par le malheur, l’envie, la crainte du quand dira-ton, le désir sexuel et la frustration qui va avec, la jalousie, l’autoritarisme, la critique, les adultères, les bassesses, la morale, l’hypocrisie, les haines ordinaires, communes à tous. Il complète le tableau en évoquant une jeune femme entretenue par un homme plus vieux et plus riche et la tromperie qui va avec, la fin d’une idylle et la naissance d’une autre, le désamour entre parents et enfants, le vice et la délation, l’usure du couple et avec lui tous les regrets que suscite cet amour qui, bien entendu, ne rime jamais avec toujours... Il y a ce jeune homme qui se pose des questions sur lui-même et sur sa vie future et qui doit bien avoir quelques ressemblances avec l’auteur ! Chacun rêve d’une vie meilleure, fait ce qu’il peut pour échapper à son quotidien par la lecture ou la musique mais il n’y a rien là d’extraordinaire puisque cette recherche nous est commune à tous dans cette comédie humaine.
A travers cette lucarne, l’auteur nous donne à voir la photographie d’une société en raccourci, qui se bat au quotidien contre la misère, les ennuis quotidiens, quelque chose de très semblable à toutes les sociétés humaines populaires et désargentées. Pour cela il se fait un peu voyeur, indiscret et curieux, nous détaillant par le menu ce qui fait la vie de chacun, jusque dans les détails les plus anodins voire des plus intimes d’un couple. Il s’ensuit une série de réflexions pertinentes sur l‘espèce humaine, ses secrets et ses fantasmes, le sens de la vie et de la solitude qui nous est commune à tous. Pour autant tout cela baigne dans une sorte d’ambiance de suspicion et de retenue, de secrets qui est due à la dictature de Salazar à moins que cela ne soit la marque de la « saudade », cette nostalgie où se conjugue le passé et le présent, mâtinée du désir de ce qui manque et de l’espoir de le trouver un jour, une sorte de mal de vivre, un état d’esprit si propre à l’âme lusitanienne et dont l’homme de Lettres portugais ne peut manquer de se faire l’écho.
-
Les Feuillets poétiques et Littéraires
- Par hervegautier
- Le 17/03/2023
- Dans MARJAN
- 0 commentaire
N°1727 – Mars 2023
Les Feuillets poétiques et Littéraires – Marjan.
Je reprends ici une études qui date de nombreuses années à propos des Feuillets poétiques et Littéraires fondés par Marjan (1918-1998).
...Puis rapidement les choses se précisèrent. Son métier de typographe à l'imprimerie l'amena rapidement à fonder sa propre revue. Ce furent Les Feuillets Poétiques et Littéraires (FPL) qui virent le jour en juillet 1935. Marcel Auger avait 17 ans. Pendant 50 ans, cette revue qui en fait était plutôt une collection rayonna sur le monde poétique et littéraire français et publia des centaines de poètes. Il en était à la fois l'animateur, l'homme de peine (puisqu'il les composait lui-même à l'imprimerie surtout au début) et surtout le commanditaire. Marjan a toujours répugné à demander de l'argent (Marjan ne rimait pas avec argent). Chacun donnait ce qu'il voulait selon son bon cœur ou son appréciation ce qui lui a fait dire non sans humour "qu'il avait laissé des plumes pour celles des autres". Qu'importe, il vivait cela comme une sorte de passion personnelle avec l'écriture. Je me souviens qu'il me disait ne pas vouloir tenir de comptabilité... par peur de ne plus pouvoir dormir la nuit!
Les FPL étaient originaux à plus d'un titre. Il ne publiait que des poèmes mais cela se faisait sans exclusion ni censure. Tout au plus fallait-il qu'ils présentent un minimum de qualité littéraire. La périodicité n'était pas régulière mais surtout se mêlaient dans chaque numéro des textes d'auteurs connus et d'autres méconnus et souvent même des poètes locaux ou régionaux. Marjan tenait beaucoup à ce voisinage qui était à ses yeux une des raisons d'être de sa publication. Citer toutes les grandes signatures qui ont honoré les FPL n'est pas possible mais me reviennent en mémoire les noms d'Hervé Bazin, Eugène Guillevic, Pierre Mac Orlan, Jean Cocteau, Maurice Carême, Paul Fort... Ces grands noms qui souvent étaient des amis personnels lui offraient un poème parfois inédit ce qui ajoutait à l'importance des FPL. L'invité d'honneur avait sa photographie au sommaire de chaque numéro et le classement des participants se faisait par ordre alphabétique. Cette collection publiait également des recueils individuels consacrés à un seul poète.
Il y eut bien entendu une interruption pendant la guerre avec destruction de certaines archives et des premières séries mais jusqu'au n°142 qui marqua la fin de cette collection en 1986 il resta fidèle à la présentation sous forme de travail d'imprimerie de ces feuillets.
Je dois noter que si la parution était irrégulière, la sortie de chaque numéro n'en était pas moins saluée comme un événement et circulait dans le monde entier. Je me souviens d'avoir lu des lettres de félicitations (et pas seulement de ses amis) pour la qualité des textes publiés.
J'ai déjà dit son aversion pour ce qui touchait à l'argent. Il a toujours déclaré que la poésie ne se monnayait pas, qu'elle devait se partager, se donner ce qui à ses yeux la rendait d'autant plus appréciable. Je me souviens que lorsqu'il toucha de rares droits d'auteur, il en fut presque étonné.
Les FPL ne fonctionnaient pas par abonnement, ne bénéficiaient d'aucune subvention ni d'aucune réduction postale. Il est clair qu'une revue qui ne vit que grâce aux cotisations de ses abonnés est tenue de publier ces derniers quand ils proposent un texte. Pour l'animateur qui est souvent aussi le trésorier, refuser c'est se condamner à se priver de la participation financière de l'adhérent éconduit. Accepter c'est assurer la survie de sa revue même s'il doit pour cela sacrifier la qualité de sa publication et parfois perdre un peu de son âme. Pour Marjan, le prix à payer était lourd mais chacun participait. Il a quand même fini par abandonner! Il n'empêche, grâce à eux et d'ailleurs à tout ce qu'il a pu écrire par la suite il a noué correspondance et amitié avec de nombreuses personnes et singulièrement avec des grandes signatures de la littérature de son temps.
Dans le même temps, notre homme, débordant d'activité avait également fondé La Revue des Jeunes dont il était l'unique journaliste mais aussi en supplément des FPL les Feuillets Tribunes et la Circulaire bibliographique. Il convient également de noter qu'il participait activement à l'Académie du Marais, au Comité de la Tribune des Jeunes, à l'Affiche de Poésie, Actuelles Poétiques, Actuelles du Terroir, Poètes du Bas-Poitou, Main dans la Main, Prise de sang, Carnets Poétiques, qui étaient des réseaux d'édition.
Il n'était pas peu fier d'être le secrétaire perpétuel de l'Académie des XIII qu'il fonda en 1954 avec son cousin Gil Roc et cette mention figurait jusque sur sa carte de visite personnelle. Cette docte assemblée, dissoute en 1986 décernait chaque année son prix à l'auteur d'un ouvrage spirituel ou pour l'ensemble de son oeuvre. A ce propos je me souviens qu'en tant que secrétaire perpétuel il dut écarter (avec malice) un ouvrage présenté... par un ecclésiastique. Celui-ci avait mal interprété le sens du mot spirituel! La devise de cette académie était 'humour et poésie". Le prix consistait en une douzaine de bouteilles de Bordeaux d'un grand cru ce qui avait fait dire à Roland Bacri, journaliste au "Canard Enchaîné" et également membre de cette académie qu'il s'agissait « d'un prix de boissons ». Ils étaient 13 mais avaient de l'esprit comme 40!
Ils étaient effectivement 13 dans cette académie dont l'acte de naissance officiel paraît au Journal Officiel du 24 août 1954 n°3393. Outre Marjan et Gil Roc y figuraient également Marie-Louise Perot, Max d'Arthez, Pierre Autize, Pons-Desalberes, Bon Harvest, Lucienne Jouan, Paul Baudenon, Tristan Maya, Jules Mougin, Jean l'Anselme, Roland Bacri, Gérard de Lacaze-Duthiers, Paul Reboux, Louis Chazai et Jean Valrey.
On retrouvait aussi Marjan au sein du Jury du Grand Prix de l'Humour Noir où il fut accueilli pendant
15 ans par Tristan Maya.
Quand il décida de mettre un terme au FPL, il dut ressentir comme un vide car l'année précédente (1985), il entama la publication de deux collections, Le Bouc des Deux-Sèvres et Poètes du Pays Niortais et des Environs. Il ne devait pas au départ penser au succès qui vint cependant rapidement puisque les premiers numéros du Bouc n'étaient même pas numérotés. Le premier était ouvert à tous et le second se consacrait plus volontiers aux auteurs régionaux. On retrouve ici l'esprit qui animait les FPL. Il s'agissait non plus d'un recueil de plusieurs pages mais d'une feuille 21/29,7 dactylographiée ou composée par collage recto-verso, photocopiée et surtout gratuite qui circulait dans la correspondance privée de Marjan. Ils étaient collectifs et accueillaient plusieurs poètes ou bien "spéciaux" et ne donnait l'hospitalité qu'à un seul auteur. Ils étaient, suivant son expression "Hors commerce-hors de prix". Là non plus pas d'exclusion. Il publia plus largement qu'auparavant d'autant plus que le coût était moindre que pour les FPL et les autres publications. On y retrouva la mélancolie, l'humour, la dérision, le sérieux aussi et la poésie la plus classique voisinait avec la plus libérée. Le nombre de poètes publiés étaient ici beaucoup plus important qu'auparavant.
Si les FPL recueillirent beaucoup d'éloges, le Bouc des Deux-Sèvres et dans une moindre mesure Poètes du Pays Niortais révélèrent très tôt nombre de détracteurs. Il faut bien admettre que la présentation sous forme de photocopie n'incitait guère à la lecture. Marjan laissait aux auteurs le soin de réaliser leur propre maquette ce qui n'était pas toujours une réussite. Lui se contentait de diffuser ces numéros sans souvent intervenir ni dans le choix ni dans la présentation des textes. On lui a reproché aussi, et je crois qu'il l'avait admis parfois de publier pour publier ou augmenter la collection en laissant un nécessaire choix de côté. Tout cela tranchait beaucoup sur la qualité des FPL dont le Bouc et Poètes du Pays Niortais étaient les héritiers naturels. A cette époque j'ai eu le sentiment qu'il recherchait une sorte de performance, gratuite par ailleurs ou plus exactement génératrice de frais pour lui puisqu'il supportait souvent les coûts postaux. Son slogan était que ces publications étaient "Hors commerce-hors de prix". Parfois ses correspondants lui faisaient parvenir des timbres, mais c'était rare. A cette époque il publiait parfois plus d'un numéro par semaine déclarant à qui voulait l'entendre "qu'il était pris dans un engrenage" signifiant par-là qu'il était victime de son succès.
A sa mort le Bouc totalisait 424 numéros et Poètes du Pays Niortais 103 .
-
La sanction
- Par hervegautier
- Le 14/03/2023
- Dans Trevanian
- 0 commentaire
N°1725 – Mars 2023
La sanction – Trevanian – Gallmeister.
Traduit de l’américain par Jean Rosenthal.
Jonathan Hemlock est un alpiniste chevronné et célèbre, bel homme, célèbre professeur dans une université américaine et spécialiste des Impressionnistes français qu’il collectionne à grands frais, mais cela c’est pour la couverture ; en réalité c’est un tueur à gages au service de l’organisation sécrète CII (Central Intelligence Institute) et il doit, un peu contraint à cause de son impérieux besoin d’argent, accepter d’infliger une « sanction », c’est à dire un meurtre , à l’ennemi en représailles à l’assassinat d’un des agents de l’institut. Il apprend que cela doit avoir lieu dans le cadre d’une ascension très médiatisée dans les Alpes suisses de la face nord de l’Eiger, voie demeurée inviolée. Il s’intègre donc à ce groupe sans savoir qui des trois hommes qui le composent il doit exécuter ; il ne le saura qu’au dernier moment, situation d’autant plus délicate pour lui que la victime potentielle peut aussi devenir son assassin et que sa mission doit évidemment demeurer secrète pour tous. Même s’il a vieilli et que ses réflexes de sa jeunesse se sont émoussés, Jonathan reste un montagnard passionné pour qui cette escalade est un défi personnel , d’autant que la météo est ici particulièrement capricieuse et le danger constant. Il ne connaît guère les membres de l’expédition mais ils ont tous une idée précise pour la réaliser, sous les yeux curieux d’une faune avide de sensations fortes, les « oiseaux de l’Eiger », journalistes, riches curieux, acteurs désireux d’être vus… Au passage l’auteur se livre à une étude pertinente sur l’espèce humaine et ses comportements. C’est donc une histoire haletante, bien écrite et agréable à lire, entre roman d’espionnage et thriller où Jonathan a tout d’un agent secret, séducteur, prompt à la bagarre, toujours en éveil et efficace qui ne peut croiser une jolie femme, mariée ou non, sans la mettre dans son lit, ce qui risque de compromettre cette mission.
De « La sanction » on a tiré un film en 1975.
De l’auteur on ne sait pas grand-chose si ce n’est qu’il s’agirait de Rodney Whiteker (1931-2005) et qu’il usait souvent de pseudonymes pour écrire ses nombreux romans, qu’il aurait vécu au pays basque français, que ses livres ont pour la plupart été des succès de librairies et traduits dans de nombreuses langues. Il a toujours refusé les interviews filmées et les photos pour préserver son anonymat. Ce détail assez original me paraît importante à l’heure où chacun recherche, par des moyens pas toujours honnêtes, à se faire connaître du grand public. J’avais déjà fait cette remarque à propos d’Elena Ferrante, la talentueuse auteure de « L’amica geniale », (« l’amie prodigieuse » en français) qui cultive également le mystère autour de sa personne.
-
Le livre de la pitié et de la mort
- Par hervegautier
- Le 06/03/2023
- Dans Pierre LOTI
- 0 commentaire
N°1724 – Mars 2023
Le livre de la pitié et de la mort – Pierre Loti – Petite bibliothèque Payot.
C’est un recueil de onze nouvelles paru en 1891 alors que Pierre Loti, âgé de 41 ans, vient d’être élu à l’Académie française dont il est le plus jeune membre. Il y compile des souvenirs et des réflexions personnels sur son passage sur terre et sur la mort. C’est un ouvrage émouvant où l’auteur évoque pudiquement le souvenir d’êtres chers ou inconnus, qu’ils soient humains ou animaux. C’est une réflexion sur la vie et sur le trépas, une occasion de nous rappeler que la lecture n’est pas seulement un loisir mais que la littérature est aussi une évocation voire une interprétation du monde réel où le lecteur peut se retrouver mais que pour l’auteur qui s’attache à cette tache c’est un véritable défi. Il s’agit donc de textes autobiographiques dont le thème central est la mort et les rituels qui l’entourent. Très tôt confronté à la disparition de son frère Gustave, au souvenir des défunts de sa parentèle, des visages happés par l’oubli, des corps qui ont été vivants et beaux et qui sont devenus des ombres, de la poussière, Loti n’a jamais oublié sa condition de simple mortel parce que, au-delà de l’écrivain il y avait l’homme, celui qui accompagna la longue agonie de sa chère tante Claire au cœur de cet hiver charentais.
Loti est un romancier injustement oublié qui a été l’incarnation de son temps et a marqué de la plus belle des manières son passage sur terre en y laissant une trace exceptionnelle. Il se livre ici à une somme de remarques sur ce que les vivants ont tous en commun, la mort et la souffrance, et il exprime la pitié qu’on ressent au contact de cet aspect de la condition humaine, ce qu’il éprouve au spectacle de deux époux japonais, vieux, malades et mendiants, qui luttent dérisoirement, avec tout la richesse de leur amour, pour leur vie misérable, pour les veuves et les orphelins de marins pêcheurs péris en mer, les naufrages sont si fréquents à son époque, et le désarroi ressenti face à l’inexorable fin des hommes. Nous autres occidentaux, faisons semblant d’ignorer que la vie est une chose fragile, que nous n’en sommes que les usufruitiers et qu’elle peut nous être enlevée sans préavis. Quand il évoquent les enfants scrofuleux de l’hôpital de Pen-Bron, torturés leur vie durant par le mal de Pott, il exprime sa pitié pour leurs douleurs et souhaitent que ses contemporains en prennent eux aussi conscience. Le simple fait d’abattre un bœuf à bord du bâtiment qu’il commande, pour la simple subsistance de l’équipage, le bouleverse. Quand il nous parle du quotidien de ses deux chattes, Moumoutte Blanche et Moumoutte Chinoise, toutes deux dotées d’une carte de visite comme les humains, arrivées dans sa vie par hasard et vivant dans sa maison de Rochefort quand il courrait les mers, c’est pour mieux évoquer leur envol au paradis des chats. Elles étaient confiées aux bons soins charentais de sa mère et de sa tante Claire qui furent aussi happées par la camarde. Qu’est ce que la vie en effet, une parenthèse qui s’inscrit dans l’écume du temps entre deux extrémités, la naissance et la mort. Rien de plus !
Sous ce titre quelque peu sinistre, Loti qui était un être à la fois fantasque, révolté, controversé, curieux du monde et des arcanes de l’esprit, se révèle tourmenté par la condition humaine. Certes, il est un écrivain du XIX° siècle qui s’exprime comme on le faisait à son époque, sa langue est bien différente de celle d’aujourd’hui mais je la comprends et l’apprécie, j’aime sa subtile écriture aux couleurs et aux rythmes changeants et l’émotion qui s’en dégage
-
Si ce livre pouvait me rapprocher de toi
- Par hervegautier
- Le 04/03/2023
- Dans Jean-Paul Dubois
- 0 commentaire
N°1723 – Mars 2023
Si ce livre pouvait me rapprocher de toi – Jean-Paul Dubois – Éditions de l’olivier.
Paul Permüller, 46 ans, est un écrivain plein de doutes et qui exerce sans conviction des petits boulots. Après son divorce et désespéramment seul, il décide de reprendre sa vie en mains et de partir pour le Québec où son père allait deux fois par an pour pêcher le brochet sur un lac où il s’est noyé. Il est accueilli à Montréal par un ami de son père qui lui révèle laborieusement un secret auquel il n’était pas préparé.
J’apprécie les romans de Jean Paul Dubois et le film de Philippe Lioret (2016) qui s’en inspire sans pour autant en être une adaptation m’a paru être parfaitement être dans l’ambiance que tisse à chaque occasion cet auteur.
-
le livre des soeurs
- Par hervegautier
- Le 02/03/2023
- Dans Amélie Nothomb
- 0 commentaire
N°1722 – Mars 2023
Le livres des sœurs– Amélie Nothomb – Albin Michel.
Les deux sœurs c’est Tristane et Leaticia, quatre ans et demi de différence entre elles. Leurs parents Nora et Florent vivent le parfait amour depuis leur rencontre mais n’éprouvent pas le besoin de le couronner par la naissance d’un enfant. Pourtant Tristane naît, plus par convenance que par réel désir des époux. Plus tard Laeticia voit le jour et leur deux filles éprouvent l’une pour l’autre un attachement très fort.
Nora qui exerce le métier de comptable a une sœur, Bobette, célibataire, qui passe le plus clair de son temps à fumer devant la télévision et à boire de la bière, quand elle ne fait pas des enfants... avec des hommes différents. Ces deux sœurs ne s’apprécient guère et pourtant Bobette nous est présentée comme une mère démissionnaire, quelqu’un de définitivement perdu, de suicidaire et elle transmet son attirance vers la mort à sa fille Cosette. On peut penser un moment que ce sont ces deux jeunes femmes qui vont faire l’objet de ce livre mais en réalité, Amélie Nothomb se penche plus volontiers sur le cas de Leatitia et de Tristane qui, même si elles sont inséparables, si elles sont liées par un amour fusionnel, abordent l’existence chacune à sa façon, d’une manière optimiste pour la première dont le prénom évoque la joie et d’une manière plus triste pour la seconde dont le sien suscite la morosité. Nora lui a un jour collé l’étiquette de « petite fille terne » qu’elle traînera toute sa vie comme une obsession qui sonne comme une interdiction d’être elle-même. Nora ira même jusqu’à la culpabiliser. Cette forme de rejet, cette faille, ce traumatisme issu de l’enfance qui font d’elle un être transparent est d’autant plus fort qu’il est crée par les parents qui son censés protéger leurs enfants sans la moindre différence et les préparer à leur future vie. A cause de cela, elle passera involontairement à côté du bonheur. Gaston Bachelard nous rappelle qu’on ne guérit jamais de son enfance. Pire peut-être, l’amour de Nora et de Florent, fait qu’ils négligent complètement leurs enfants. Même si cela peut paraître exceptionnel et presque irréel, on peut facilement admettre que la fondation d’une famille avec enfants n’efface en rien la volonté des parents qui bien souvent poursuivent leurs projets personnels sans penser à ceux qu’ils peuvent laisser en chemin. L’image traditionnelle de la mère protectrice reste un mythe de nos jours. Nora, laisse au début à Tristane la charge de s’occuper de sa sœur, ce qui est souvent le cas des aînées et les prépare à leurs futures maternités. Ce qui est plus contestable en revanche c’est qu’elle fasse une différence entre ses deux filles, à l’évidence elle favorise Leatitia et cantonne sciemment Tristane dans la tristesse, freinant son développement, même si Florent lui exprime ses félicitations. Les mères abusives et destructrices, cela existe, la littérature en est pleine, même si, face à cette faute maternelle, Tristane n’éprouve que de l’amour et de l’indulgence ! Un tel régime ne peut qu’être néfaste à cette fille aînée qui développe une atmosphère de solitude avec un pseudo dialogue avec sa cousine morte et une correspondance constante avec sa sœur.
Ce roman est présenté comme non autobiographique, C’est à tout le moins ce que j’ai entendu dans les différentes interviews. Je ne suis pas spécialiste de la vie de l’auteure mais cette affirmation, un peu trop répétée me paraît sonner faux. L’amour de la musique rock développé par Laetitia et celui de la littérature chez Tristane me paraissent bien correspondre à Amélie Nothomb. Un dédoublement de l’auteure en quelque sorte et chacune des deux sœurs cultive sa passion, poursuit son propre rêve. De toute manière nous savons bien que, nonobstant la fiction, il y a toujours un peu de l’écrivain dans ses personnages et il n’y a rien là d’extraordinaire et surtout d’inavouable. J’arrêterai cependant ici, s’agissant de ce roman, la portée de cette remarque. D’autre part, l’amour fou de Nora et de Florent me paraît un peu artificiel et même égoïste, l’épilogue semble le montrer, même si la différence faite entre deux enfants , elle, ne l’est pas. J’ai cependant bien aimé l’analyse qui est faite de la situation d’infériorité artificielle de Tristane
J’ai l’habitude de lire la 4° de couverture avant d’entamer ma lecture d’un roman. Ici c’est plus que laconique « Les mots ont le pouvoir qu’on leur donne ». On n’attend pas autre chose de la part d’un écrivain !
De cette auteure dont je n’ai pas toujours aimé les romans, je retiens le premier « Stupeur et tremblements » et le précédent « Premier sang ». Ce livre, le 31°, m’interpelle à titre personnel, il est bien écrit et , au-delà de l’amour fusionnel entre ces deux sœurs et même entre un homme et une femme, ce que je retiens c’est le personnage de la mère qui va à l’encontre de la traditionnelle image qu’on en donne. Elle me paraît juste précisément parce qu’elle est à l’opposé de ce qui est communément admis.
-
L'arbre de colère
- Par hervegautier
- Le 27/02/2023
- Dans Guillaume Aubin
- 0 commentaire
N°1721 – Février 2023
L’arbre de colère – Guillaume Aubin – la Contre-Allée.
Fille-Rousse. une jeune amérindienne de la tribu des « Longues-Tresses » est née dans la violence, tirée du ventre de sa mère mourante par un guerrier de celle des «Yeux-Rouges ». Les deux peuplades sont en guerre pour le Qaa, une plante hallucinogène qui donne la vie mais aussi la mort, qui favorise la communication avec les esprits, l’eau, la montagne, la forêt. La fillette grandit parmi son nouveau clan, dans un environnement fait à la fois de nature sauvage et de brutalité et rapidement le chamane puis chef la considèrent comme une « Peau-mêlée », un garçon dans le corps d’une fille, ce qui lui vaut d’être éduquée comme un futur guerrier et elle attire sur elle admiration, méfiance et rejet de la part de la communauté du fait de ses origines. Elle devra donc batailler pour ce faire une place dans ce microcosme entre recherche de la liberté et solitude dans une société en principe basée sur la solidarité. C’est aussi une réflexion sur la recherche d’une place à la fois sexuelle et sociale, dans une société traditionnellement patriarcale où le rôle de la femme est limité aux fonctions maternelles et aux tâches ménagères autant que la reconnaissance d’une différence. Elle ira jusqu’à briser le tabou ancestral pour obtenir vengeance et peut-être l‘acceptation de sa propre nature.
Dès les premiers lignes, le texte est emprunt de violence ordinaire, meurtres, viols, rapts de femmes pour assurer le renouvellement, ce qui fait le quotidien de ces clans du nord Canada en perpétuelle lutte entre eux. Plus tard, intégrée dans sa nouvelle tribu Fille-Rousse doit se battre contre les garçons pour leur imposer sa présence jusque dans les traditionnels rituels de passage vers l’âge adulte.
Les mots sont crus, les descriptions sont réalistes, à la fois violentes et poétiques, bien dans l’idée de cet univers dépaysant où l’auteur entend plonger son lecteur. Pour autant, si elle s’impose comme un homme et guerrier dans sa tribu, c’est en femme et en prostituée qu’elle aborde les pêcheurs de morue sur la côte pour la survie de sa tribu.
J’ai poursuivi ma lecture jusqu’à la fin sans vraiment entrer dans l’univers créatif de l’auteur.
-
Ceci n'est pas un fait divers
- Par hervegautier
- Le 24/02/2023
- Dans Philippe Besson
- 0 commentaire
N°1720 – Février 2023
Ceci n’est pas un fait divers – Philippe Besson – Juillard.
Qu’est ce qu’un fait divers ? C’est un type d’évènement qui n’est classable dans aucune catégorie qui habituellement compose l’actualité. Ainsi « les faits divers » forment-t-ils eux-mêmes pour la presse une rubrique à part qui regroupe des circonstances particulières n’ayant aucun lien entre elles ce qui ne signifie pas qu’elles sont sans importance. Ici, les faits sont brutaux, ce n’est pas un crime passionnel jadis absout par la justice, il s’agit du meurtre d’une femme par son mari en présence de leur fille Lea, 13 ans. C’est elle qui annonce par téléphone la nouvelle à son frère, 19 ans, danseur à l’Opéra de Paris. Quant au père, il a disparu. S’ensuit une enquête où les détails horribles ne nous sont pas épargnés, ce qui le transforme moins en roman policier qu’en un dossier d’analyse psychologique pour tenter d’expliquer l’inexplicable.
Aujourd’hui, on ne peut pas consulter les médias sans apprendre ce genre catastrophe qui en devient presque banale, les statistiques en font foi et on a même crée un mot nouveau pour cela : féminicide. Et cela ne sera jamais un fait divers. Ce roman est basé sur un fait réel et Philippe Besson se l’est approprié sur la demande d’un de ses lecteurs à qui il laisse la parole. L’auteur quitte donc son registre habituel où il nous faisait partager ses états d’âme souvent intimes (pas tout à fait cependant) pour nous parler d’autres gens. Au-delà de l’histoire, toujours racontée avec la même écriture à la fois simple, économe en mots et juste, Philippe Besson met en lumière moult questions. Les êtres choisissent naturellement de se rapprocher entre eux pour faire obstacle à la solitude. Cela donne des couples qui, lorsqu’ils sont mal assortis, traînent derrière eux le malheur comme une destiné. Ils sont condamnés à voir le bonheur de loin, chez les autres et à souffrir de cette injustice. C’est sur ce terrain que croissent des frustrations qu’on garde souvent enfouies en soi par pudeur ou pour ne pas traumatiser ses proches. Quand on est jeune et qu’on rencontre l’amour qui n’est souvent qu’une attirance physique passagère, on fait semblant de croire à l’avenir qu’on habille de projets et de fantasmes. On tente même de forcer le destin en fondant une famille. Souvent, cela ne dure guère et s’use sous le coups du quotidien et l’idée qu’on se faisait du bonheur s’érode peu à peu pour souvent disparaître définitivement. Puis viennent les hasards qui ne font pas toujours bien les choses et on se sent rejoint par le malheur, celui d’être né sous une mauvaise étoile, qui s’accroche à vous comme un cancer et vous dévore de l’intérieur, rendant vain votre combat contre cette adversité. On fait la constatation que l’amour, s’il a existé, s’est dissout, le couple choisit de se séparer, souvent dans les premières années de vie commune, comme c’est le cas actuellement et ce sont les enfants qui en pâtissent. Parfois on compose, on patiente, on se fait une raison, on se drogue, on va voir ailleurs, on fait durer le couple par hypocrisie, pour des raisons sociales, financières ou religieuses, l’espoir d’un impossible changement, de la survenue hypothétique d’un accident ou de la maladie. La violence s’invite parfois comme dans cette sordide histoire.
Ici Léa incarne ces enfants qui, trop souvent ignorés, sentent les choses, veulent les faire changer, sont témoins et donc presque complices, mais qui ne peuvent rien faire face aux secrets, aux silences, aux manipulations des adultes, à part générer contre eux-mêmes cette colère et cette détestable culpabilité qu’ils traîneront toute leur vie. Chacun des deux enfants s’interrogent, se critiquent, s’accusent, se souviennent de l’incompréhension voire de l’animosité de leur père, de sa duplicité, se raccrochent aux souvenirs apaisants tissés avec leur mère, mais la réalité l’emporte avec les exigences de la procédure, les obligations de l’enquête, les réalités administratives, les rituels, les remises en cause de chacun pour son avenir et ses ambitions, l’acceptation des échecs qu’on voulait éviter, le procès à venir, l’impossible travail de deuil...
Une autre idée s’impose à moi, celle de l’utilité de la littérature bien différente de celle de vendre des livres puisque notre société apprécie bien souvent ses membres à l’aune d’un critère comptable. Elle classe bien souvent les écrivains dans une élite intellectuelle qui les éloigne du quotidien. Parmi les nombreux rôles qu’on peut lui assigner, celui d’être le miroir de notre société ne me paraît pas être le moins important. Pour l’écrivain, donner la parole à ceux qui ne veulent ou ne peuvent la prendre, mettre des mots sur leurs souffrances secrètes, formuler simplement les choses qui les bouleversent, donner à voir une facette non idyllique de la condition humaine dans laquelle d’autres pourront se reconnaître et peut-être y puiser du réconfort, tout cela me paraît essentiel.
Philippe Besson s’empare de ce type de fait de société avec beaucoup d’humilité.
-
Ce que faisait ma grand-mère à moitié nue sur le bureau du Général
- Par hervegautier
- Le 23/02/2023
- Dans Christophe Donner
- 0 commentaire
N°1719 – Février 2023
Ce que faisait ma grand-mère à moitié nue sur le bureau du Général – Christophe Donner – Grasset.
Ce titre quelque peu racoleur est sans doute de nature à décider les plus sceptiques. Quant au Général, malgré le fait que nous ayons de plus en plus d’officiers étoilés, il ne peut s’agir que de de Gaulle puisque dans la mémoire collective des Français il n’y en aura jamais qu’un seul dont on prend même la précaution d’enrichir son grade d’une majuscule. Pourtant cela colle mal avec l’image qu’a laissé de lui « l’homme du 18 juin » qu’on imagine assez mal en Don Juan, mais on ne sait jamais !
J’ai été un peu perdu au début avec ce roman qui est la suite d’un ouvrage précédent que je n’ai pas lu, avec ces histoires entrecroisées d’oligarque russe qui a fait fortune grâce à la cryptomonnaie et qui achète à l’auteur le roman qu’il est en train d’écrire sur sa famille et plus spécialement sur la figure du docteur Henri Gosset, son arrière-grand-père qui soigna le fils révolté du royaliste Léon Daudet, un des fondateurs de l’Action française qui faillit faire basculer la France dans le fascisme et sur cette partie de la vie du jeune officier de Gaulle qui croisa pour la première fois le déjà vieux Pétain au début du XX° siècle. Cela sent le drame œdipien de la lutte à mort du fils contre le père sans qu’on sache très bien parfois qui veut tuer l’autre. Mais la grand-mère dans tout cela et la raison de sa posture qu’on imagine au service d’une ambition précise que la morale d’aujourd’hui semble vouloir hypocritement bannir des relations hommes-femmes pourtant immuables ? Qui était-elle? C’est Denise, dite Amin, quant aux véritables raisons, peut-être pas forcément historiques de sa présence sur le bureau du général, elles sont assez surprenantes. Que m’étais-je imaginé ?
Tout cela m’a paru intéressant sur le plan historique, mais quand même bien confus et surtout romancé. J’ai appris des choses sur les relations entre de Gaulle et Pétain, les postures déférentes mais fermes du jeune capitaine conscient de sa valeur et suffisantes et hiérarchiques du vieux maréchal avide d’honneurs. On sait comment tout cela va se terminer. Il est souvent question de l’auteur et surtout de Léon Daudet, le fils du célèbre écrivain, politicien ambitieux et surtout de sa famille, de son fils Philippe, adolescent perturbé, fugueur et anarchiste et de son projet un peu fou, pourtant réalisé. Une véritable saga avec des morts, et pas seulement à cause de la guerre, des adultères, des ambitions politiques, des démêlés judiciaires...
C’est étonnant, écrit sur le mode jubilatoire, et il faut attendre les dernière pages pour connaître la raison de la présence incongrue de cette femme sur un meuble quasiment historique. Finalement j’ai bien aimé et cela m’a donné en tout cas l’envie de découvrir cet auteur prolifique.
-
La vie suspendue
- Par hervegautier
- Le 22/02/2023
- Dans Baptiste Ledan
- 0 commentaire
N°1718 – Février 2023
La vie suspendue – Baptiste Ledan- Éditions Intervalles.
Depuis la mort de son épouse et de ses deux enfants, Tomas Fischer est seul au monde, sa vie n’a plus de sens et il aspire à quitter sa ville et ses souvenirs pour s’installer dans une cité-état érigée en république indépendante, lointaine et isolée, pleine d’interdits, de codes et de choses étranges, Lasciate, qu’on peut traduire de l’italien par oubliée ou abandonnée. Après quelques jours dans sa nouvelle résidence qui n’a pourtant aucun attrait tant elle est quelconque, grise, désespérante, il éprouve le besoin de s’y installer définitivement, mais sa vie ici ne peut être que clandestine parce que les étrangers y sont indésirables. Il s’ingénie donc à y devenir invisible dans une cité vouée à l’immortalité grâce à une immunisation, lui le mortel parmi les immortels, mais une opportunité s’offre à lui qu’il saisit spontanément autant par volonté de rendre service que de consolider son nouveau statut. Il se rend donc indispensable, ce qui lui vaut l’estime de tous et une bonne situation financière dans cette ville de l’éternelle jeunesse où la mort est l’exception et l’éternité la règle générale, mais où il choisit volontairement de me pas profiter de l’opportunité offerte à tous. Il trouvera l’amour, se mariera, fera sa vie, vieillira et mourra comme un humain ordinaire, ce qui ne sera pas sans l’amener à s’interroger sur cette société lascebberote et sur lui-même, sur ses contradictions existentielles, sur ses choix, sa culpabilité.
C’est une fiction dans laquelle je suis entré de plain-pied et où, toutes choses égales par ailleurs, je me suis trouvé nombre d’affinités personnelles, malgré le fait que je ne perdais pas de vue que ce microcosme citadin n’existait évidemment pas, que la situation décrite étaient pleine d’extravagances et de paradoxes. Au fil des pages, je me suis installé dans cette contradiction tout en me disant que si l’histoire racontée était imaginaire, la vie des habitants de Lasciate avec leurs phobies, leurs fantasmes, leurs hypocrisies, leurs mensonges et leur désespoir n’était peut-être pas si différente de la nôtre et cela méritait réflexion. L’immortalité est un fantasme distillé par certaines religions qui imaginent un mode meilleur que le nôtre pour nous aider à accepter cette vallée de larmes qu’est notre parcours terrestre. Nous autres, pauvres mortels, nous vivons en faisant semblant d’oublier que nous ne sommes que les usufruitiers de notre vie et qu’elle peut nous être enlevée sans préavis, que la mort n’est que son terme, qu’elle en fait donc simplement partie, mais cet aspect des choses, à travers la maladie et les accidents, les suicides, est aussi présent dans ce microcosme lascebberote qui connaît aussi la lassitude de vivre. A l’issue de sa vie choisie entre liberté et destiné, Tomas, malgré les obstacles qui se dressent devant lui, ouvre volontairement ses bras à la camarde comme un dernier sommeil, comme une parenthèse enfin refermée sur un cheminement terrestre parfois hasardeux, comme une délivrance qui tient à la fois de la fascination et du mystère, accepte pour lui le néant tout en confiant son exemple aux vivants qui jugeront ses choix et ses actions, les rejetteront ou les respecteront d’autant plus aisément qu’eux sont éternels. Sa attirance pour les cimetières me paraît significative. En effet, les traces qu’il laisse après lui, son exemple parfois cahoteux, des milliers de mots écrits par lui, inspirés par sa vie transitoire, ses réflexions, ses états d’âme, confiés au fragile support du papier et légués post mortem aux vivants qui le suivent et à leur appréciation, existent néanmoins. Ils en sont désormais les maîtres et son immortalité à lui dépend d’eux. Je choisis d’y voir quelque chose qui ressemble à des remarques personnelles de l’auteur sur le fait d’écrire et surtout ce qui reste de nous-même après notre mort.
Avec de courts chapitres dont le titre est emprunté à des œuvres d’autres écrivains, Baptiste Ledan, dans ce qui est son premier roman, balade son lecteur, avec son écriture fluide et agréable à lire, dans une fable un peu folle mais qui n’est pas sans rappeler, avec humour et réflexion, notre condition humaine, la vanité des choses. Cela tient de la science-fiction et de la métaphysique mais me paraît être un miroir assez fidèle de notre société qui se referme sur elle-même et qui refuse la différence.
Le livre refermé, l’acceptation de la mort par Tomas, son refus volontaire d’une éternelle jeunesse tout en cherchant une autre forme d’immortalité ramènent les choses à leur vraie dimension, interrogent sur nous-mêmes, sur notre démarche, sur ce qui reste de nous.
-
Knulp
- Par hervegautier
- Le 16/02/2023
- Dans Hermann Hesse
- 0 commentaire
N°1717 – Février 2023
KNULP – Hermann Hesse – Calmann-Lévy
Traduit de l’allemand par Hervé du Cheyron de Beaumont.
Knulp est un vagabond, un homme libre mais correct , poète, un peu profiteur, instruit, sans attache mais peu respectueux des conventions sociales, un peu séducteur aussi. A sa sortie de l’hôpital il trouve refuge chez son ami, le tanneur Rothfuss qui l’invite à s’installer chez lui pour quelques temps. L’épouse de son hôte ne lui déplaît pas et cette attirance est partagée. Un autre épisode de la vie de Knulp évoque, à travers un témoignage d’un autre vagabond, la fuite du temps, l’amour, la politique, la vanité des choses, les remords, la solitude, la trahison, l’amitié, la mort… Dans la troisième partie il est atteint de tuberculose et va mourir. Il avait été un brillant élément et ceux qui le rencontrent et se souviennent de lui, évoquent ce qu’il aurait pu être au lieu de privilégier l’errance et le dilettantisme.
Petit roman paru en 1915 qui se lit rapidement et se caractérise par le romantisme. Il se décline en trois moments qui sont, sous la plume de Hesse un hymne à la liberté. Sentant sa fin Knulp entame avec Dieu un dialogue qui ressemble au jugement dernier, où il se justifie de ses fautes, ressasse ses blessures intimes, entre liberté et destiné, dans une sorte de bilan, ce qui correspond à une des obsessions religieuses de Hesse (1877-1962).
-
Pierre Loti - Le pèlerin de la planète- Alain Quella-Villéger
- Par hervegautier
- Le 13/02/2023
- Dans Pierre LOTI
- 0 commentaire
N°1716 – Février 2023
Pierre Loti – Le pèlerin de la planète- Alain Quella-Villéger- Éditions Auberon.
Si le festival « Étonnants voyageurs » de Saint-Malo avait existé, Pierre Loti (1850-1923) en aurait sûrement été l’invité. Cet écrivain-voyageur, officier de marine à la longue carrière à la mer, humaniste, écrivain malheureusement oublié de nos jours, a connu de son vivant à la fois la consécration, la contestation, l’admiration, l’incompréhension et le mépris, ce qui est l’apanage des des êtres d’exception qui ne laissent pas leurs contemporains indifférents. Si sa jeunesse rochefortaise fut protestante, scolairement discrète même en narration, bouleversée par la mort de proches, modeste financièrement, valétudinaire, il devait porter en lui cet appétit de curiosités, de découvertes et de grands espaces que la mer lui a permis d’assouvir. Ses années de carrière militaire ont satisfait son goût des voyages (« Homme libre, toujours tu chériras la mer » écrivait Baudelaire) et développé son envie de témoigner par écrit de ses découvertes du monde sur lequel il portait un regard à la fois curieux et critique. En même temps qu’il dénonçait ce qui le révoltait, il menait, malgré son mariage, sa recherche des femmes, de leur compagnie voire de leur complicité mondaine, de leur beauté, de leur amour, entre scandales, échecs, remords et désespoir.
Écrivain du XIX° siècle, il y a chez lui cette dimension romantique et exotique, cette exploration du moi jusqu’au solipsisme, cette fascination de l’inconnu, cette recherche de Dieu, cette volonté d’être lui-même, entre marginalité affirmée et volonté d’inscrire sa vie dans un contexte officiel de reconnaissance « Académique » et de carrière professionnelle, avec obéissance hiérarchique et obligation de réserve, et cette aptitude à témoigner avec cette qualité de style qui personnellement m’a toujours passionné. Être libre, engagé, patriote jusque dans la guerre, mélancolique, tourmenté par la fuite du temps, par la mort, par une sorte de quête constante mais fervente et peut-être inassouvie, il a puisé dans cet itinéraire secret les sources de son talent (n’a t-il pas avoué « Mon mal j’enchante » ?)et a marqué son passage sur terre de la plus belle des manières.
La précision, la pertinence et la qualité documentaire de cet ouvrage d’Alain Quella-Villéger, éminent spécialiste de Loti que sa seule naissance à Rochefort ne suffit pas à expliquer, donne à voir un écrivain d’exception qui a si bien servi notre belle langue française.
-
Les désenchantées
- Par hervegautier
- Le 11/02/2023
- Dans Pierre LOTI
- 0 commentaire
N°1715 – Février 2023
Les désenchantées – Pierre Loti – Éditions safrat.
André Lhéry, romancier célèbre et diplomate résidant pour l'heure au pays basque reçoit une lettre de Djénane, une jeune femme turque qui l'admire et qui ose s'adresser à lui avant son mariage. Le seul nom d’Istanbul réveille en lui non seulement la fascination de l'Orient où il a été en poste mais surtout le souvenir d'un amour vieux de quinze ans. Il lui répond et bien entendu la rencontre dans cette ville. Avec deux autres de ses compagnes ottomanes cultivées et francophones, "trois petits fantômes noirs", elles le convainquent d’écrire un roman pour parler de leur condition de vie, contraintes à une existence cloîtrée dans un harem et astreintes à des mariages arrangés conclus sans leur consentement. Ces rencontres amicales se déroulent dans un contexte dangereux, souvent dans un cimetière ou une maison secrète d'autant plus que Djénane tombe amoureuse d'André .
Ce fut un immense succès à sa parution, en juillet 1906. Pour autant et sans vouloir donner dans le jeu de mots, Loti ne fut-il pas lui aussi "désenchanté"?
Comme le reste de son œuvre romanesque, ce roman, qui est aussi le dernier de Pierre Loti, est indissociable de sa vie. Il est personnellement turcophile et turcophone et en sa qualité de commandant d'un bâtiment français et membre d' Académie française, son séjour à Constantinople à partir de 1903, dans un contexte diplomatique difficile, est remarqué par les autorités. A partir de 1904 il reçoit une lettre d'une jeune turque qui va se marier et qui signe Djénane. Elle est accompagnée de deux autres femmes, Zeyneb et Meleck, et sollicite une rencontre en faisant référence à Aziyadé, une jeune femme que Loti a aimée lors d'un précédent voyage à Istanbul. Elle sera suivie d'autres aussi mystérieuses que dangereuses dans des endroits comme des cimetières ou des maisons retirées. A cette époque, l'écrivain est en pleine gloire et il saisit cette occasion pour confier à ses lecteurs, dans ce roman cependant un peu long, son sentiment sur la mélancolie, la fuite du temps, sur la vie et sur la mort (à travers celles de Djénane et de Mélek) tout en dénonçant les conditions de vie de ces femmes recluses, enfermées dans des harems, contraintes de se voiler et victimes de mariages arrangés conclus sans leur consentement. Il saluera plus tard l'action de Mustapha Kemal en faveur de l'émancipation de la Turquie sans en voir cependant les effets puisqu'il mourut en 1923 et on peut imaginer ce que serait sa réaction aujourd'hui face à certains pays musulmans qui bafouent les droits et la personne de la femme, la considérant comme une simple chose domestique.
On sait l'importance des femmes dans la démarche littéraire de Pierre Loti. Non seulement ses premiers romans sont dédiés à des femmes, à Sarah Bernard qu'il fréquentait et à Juliette Adam qui fut sa "protectrice littéraire" notamment, mais elles sont importantes dans sa vie et sont aussi les personnages principaux de ses romans, qu'elles lui inspirent de la passion comme dans "Le mariage de Loti" ou un certain ennui comme dans "Madame Chrysanthème". Parfois dans sa vie personnelle, elles ont laissé la marque d’un échec. L'écrivain voit-il dans cette lettre l'occasion d'une aventure supplémentaire dans un Orient qui le fascine malgré le souffle de l'occident qui brouille un peu sa vision idyllique des choses dans le contexte d'une ville pleine pour lui de souvenirs amoureux? A la fin de sa mission, obéissant aux ordres de sa hiérarchie Loti quitte Istanbul avec seulement l'espoir que les choses changent pour elles tout en étant sans doute conscient que ce roman, s’attaquant à un des fondements de la société turque, ne pouvait que choquer les autorités ottomanes. D'autre part, il apparut évident que si Melek et Zeyneg étaient d'authentiques turques, Djénane était française nourrissant ainsi une mystification de l’auteur. En fut-il réellement conscient en écrivant son roman et est-ce pour cela que, dans l'avant-propos il prend soin de préciser que cette histoire "est entièrement imaginée"? Fantaisie d'écrivain ou volonté de relativiser les choses?
Certes, de son vivant, Pierre Loti connut la consécration. Écrivain du XIX° siècle, il est aujourd’hui injustement oublié malgré l'empreinte qu'il a laissée dans la littérature. Soyons justes, le nom et l’œuvre de la plupart des actuels "immortels" sont pratiquement inconnus du grand public. L'appartenance à cette prestigieuse assemblée est largement supplantée par la notoriété dispensée par les manifestations "culturelles" dédiées auxquelles la télévision et les réseaux sociaux servent de caisse de résonance.
Son style est toujours somptueux surtout dans les descriptions, entrecoupées de lettres de ces trois femmes. C'est pour moi, comme à chaque fois, un réel plaisir de le lire.
-
matelot
- Par hervegautier
- Le 05/02/2023
- Dans Pierre LOTI
- 0 commentaire
N°1714 – Février 2023
Matelot – Pierre Loti – Éditions Calman-Lévy.
Ce n'est pas le roman le plus connu de Pierre Loti, tant s'en faut. C'est néanmoins le troisième roman de la trilogie "maritime" de l'auteur après "pêcheur d'Islande" et "Mon frère Yves". Il a été publié en avril 1892 chez l'éditeur Lemerre (il le sera chez Calman-Lévy en 1898) c'est à dire l'année de sa réception à l'Académie française dont il devint le plus jeune membre. Il évoque la vie difficile de Jean Berny qui vit pauvrement avec sa mère, veuve, et son grand-père dans le sud de la France. Cette famille a été reniée puis abandonnée par les autres membres plus riche de cette parentèle. Il a des rêves de voyages et de réussite sociale mais il est recalé à l’École Navale ce qui le détermine à s'engager comme simple matelot dans la marine marchande et accomplir les tâches les plus ingrates et dures avec l’espoir de devenir capitaine au long cours. Son engagement et son service militaire, toujours comme matelot (puis quartier-maître) l'amènent certes à voyager sur les mers du globe, mais des revers de fortune de la famille et des amours contrariées le font partir pour l’Extrême-Orient d’où il ne reviendra pas vivant.
C'est un roman et donc une fiction mais il y a de nombreuses références biographiques et psychologiques à l’auteur. Il décrit avec précisions la vie à bord, dure et dangereuse, des hommes d’équipage chargés des manœuvres des grands voiliers. Il évoque les espoirs et les déceptions de Jean face à l’avenir. Julien Viaud que sa famille destinait à l’école polytechnique, mais qui dût renoncer à cette ambition, dût lui aussi nourrir les même sentiments de frustration. Les souffrances de Jean puis sa mort et l’immersion de son corps dans la mer, selon la tradition maritime, rappellent la disparition en 1865 de Gustave, chirurgien de marine, frère aîné du jeune Julien qui a douloureusement vécu cette épreuve. Malgré sa douleur, la mère de Jean Berny se soumet à la volonté de Dieu, accepte son destin tragique de deuil, ce qui n’est pas sans rappeler la dimension religieuse de Loti. La famille Viaud a également connu la gêne à cause des difficultés de son père, accusé à tort de malversation.
Il n’y fait pas allusion ici, mais on sait que Loti, bien qu'officier, ne dédaignait pas de s'habiller en simple matelot pour se mêler aux hommes d'équipage et fréquenter avec eux les bouges du port. Certes Loti était fantasque, original, controversé même, mais cette attitude n'avait peut-être rien d'extravagant. En effet, il s'était lié d'amitié avec Yves Kermadec, celui qu'il appelle "Mon frère Yves", avec qui il s'était embarqué parfois et qui apparaît en effet dans "Madame Chrysanthème". C’était un matelot(devenu quartier-maître) frustre, primaire, et qui s'enivrait volontiers et devenait violent, tout le contraire de Loti, cultivé, raffiné et déjà homme de plume célèbre. C'est que Loti avait promis à la mère de Jean de veiller sur lui et de le protéger. Il fut même le parrain de son fils. On n'a pas manqué, surtout depuis la publication de "Mon frère Yves" en 1883, de souligner la relation ambiguë que Loti entretenait avec lui. Elle peut peut-être s'expliquer ainsi.
Dans la forme, Loti adopte celle du roman classique alors que certaines de ses œuvres antérieures étaient écrites sous celle d'une sorte de livre de bord ou de journal intime, partagé en paragraphes indépendants numérotés et parfois datés. Ce roman, pourtant pas le plus connu de Loti, est évidemment écrit avec le talent qu’on lui connaît et m’a, comme à chaque fois, procuré un moment exceptionnel de lecture. L’ensemble de son œuvre lui a valu, de son vivant, notoriété et consécration, mais malheureusement aujourd’hui il est injustement oublié.
-
La cloche de détresse
- Par hervegautier
- Le 03/02/2023
- Dans Sylvia Plath
- 0 commentaire
N°1713 – Février 2023
La cloche de détresse – Sylvia Plath – Gallimard.
Traduit de l’anglais par Michel Persitz.
Après avoir lu le roman de Coline Pierré « Pourquoi pas la vie » consacré à Sylvia Plath (1932-1963), j’ai eu envie d’en savoir davantage sur cette poétesse et romancière américaine qui s’est suicidée à 30 ans. Elle est surtout connue internationalement pour ses poèmes et ce livre, d’inspiration autobiographique comme beaucoup de ses textes, est son unique roman.
Sa courte vie a été marquée par la dépression, la désespérance et l’influence étouffante et néfaste de son mari, le poète Ted Hughes. avec qui elle resta mariée sept années. La plus grande partie de son œuvre fut publiée après sa mort par son ex-mari qui était également son exécuteur testamentaire et ses poèmes, dont certains étaient prémonitoires, lui ont valu, à titre posthume, le Prix Pulizer de poésie en 1982. Sa vie et son suicide ont fait d’elle, de la part des féministes, la figure emblématique de la femme étouffée par une société dominée par les hommes.
Ce roman dont le titre lui-même est révélateur, a été publié en 1963, un mois avant sa mort, sous le pseudonyme de Victoria Lucas, puis à nouveau republié après son suicide. Il révèle la dépression et la bipolarité dont souffrait Sylvia Plath. La narratrice, Esther Greenwood, 19 ans, est lauréate d’un concours de poésie ce qui l’amène à passer un été à New York et à goûter à la vie mondaine qu’elle refuse, l’année de l’exécution des époux Rosemberg. Elle se lie d’amitié avec Dooren, bien différente d’elle mais à qui elle veut ressembler malgré le mépris qu’elle lui inspire. Elle prend peu à peu conscience de son inutilité, ce qui ne l’encourage pas à aimer sa vie. La perte de sa virginité l’obsède en même temps qu’elle refuse la chasteté imposée aux jeunes filles avant le mariage alors que les hommes pouvaient mener une vie sexuelle débridée. Après son séjour new-yorkais qui l’a quelque peu déçue, elle rentre chez ses parents mais la mort de son père la plonge dans une profonde dépression que des soins, notamment des électrochocs, ne parviennent pas à guérir. Elle se révolte contre la société qui l’entoure et on la sent prise dans le maelstrom de la dépression entre manque de sommeil, dépendance aux médicaments, état d’abattement, solitude, enfermement et paranoïa (une cloche de verre). Elle veut sortir de l’univers psychiatrique où elle s’enfonce cependant de jour en jour. La perte de sa virginité qui correspondait à ses aspirations vers l’indépendance et la liberté se termine mal, à l’image de sa vie et sonne comme un échec.
C’est évidemment une critique de cette société américaine des années 50, paradoxalement enviée par le reste du monde mais où elle ressent une impression d’étouffement. C’est donc un roman qui, par delà l’histoire, résume bien ce qu’a été la vie de son auteure, pleine de révoltes et d’espoirs dans la vie mais bousculée et engluée dans la dépression jusqu’à sa triste fin. Autant de jalons de son parcours inspiré par son attirance vers la mort. Une lecture éprouvante.
-
L' autre moitié du monde
- Par hervegautier
- Le 02/02/2023
- Dans Laurine Roux
- 0 commentaire
N°1712– Février 2023
L’autre moitié du monde – Laurine Roux - Les éditions du sonneur.
Le lieu, l’Ebre qui fut le décor d’une mémorable bataille de la guerre civile espagnole où plus exactement son delta où des paysans dociles et illettrés travaillent, pour un salaire de misère, « de sol a sol » c’est à dire du lever ou coucher du soleil, pour des grands propriétaires terriens qui les considèrent comme « leurs gens » et disposent de leurs vies, avec la protection de la Garde Civile et la bénédiction de l’Église catholique.
Ce roman évoque en trois parties l’histoire de vengeances : Que vaut la vie d’une jeune paysanne dans cette Espagne rurale, archaïque et pauvre de 1930 ? Alejendra, la fille de Rita est retrouvée pendue après avoir été violentée. Pilar, la cuisinière de la Marquise, symbole de cette exploitation, subit le même sort et on pense à Carlos, le fils chéri de l’aristocrate qui se croit tout permis et qui se sait à l’abri de toute poursuite. Toya, la fille un peu sauvage de Pilar et de Juan, amoureuse des anguilles et des oiseaux qui peuplent le delta, incarnera cette revanche.
La deuxième république est proclamée et, même si elle tarde à mettre en place les réformes, ces paysans se révoltent, décrètent la grève générale, veulent que leur esclavage prenne fin, que la terre qu’ils travaillent depuis des siècles leur appartienne enfin. Face à cette société ultra conservatrice et malgré la fuite du roi, le clergé et l’armée, veillent et veulent que les choses restent figées. De chaque côté, les troubles qui iront en s’amplifiant provoqueront la sanglante Guerre Civile espagnole qui instaurera une dictature de quarante ans, bouleversera le monde et le précipitera dans la guerre mondiale.
Sous l’influence de José, un jeune avocat et d’Horacio, l’instituteur, on met en place une société égalitaire au service du peuple et tous les espoirs sont permis. Quelques notes de piano jouées par Horacio, quelques mots de Frederico Garcia Lorca, le célèbre poète assassiné et enterré dans cette terre d’Espagne devenue un immense charnier, seront pour Toya une révélation bouleversante. La jeune femme, amoureuse, sera le témoin de ces violences dont Antoine de Saint Exupéry, alors jeune reporter, dira, refusant la vision manichéenne de ce qu’il voit : « Ici on fusille comme on déboise ». En effet cette idée utopique mais exaltante pour ces paysans du delta est bousculée par les combats fratricides au nom d’un idéal politique qui oppose les Espagnols entre eux. Malheureusement la république est minée par des luttes internes et sa défaite ouvrira la voie au fascisme de Franco et à ses dérives.
La fille que Toya mettra au monde lui sera enlevée et sera confiée à une famille franquiste sans descendance. Elle sait que son enfant va vivre ailleurs et qu’elle ne le reverra jamais.
La deuxième partie fait un bon dans le temps et, à l’occasion d’une future soutenance de thèse sur les écosystèmes, Luz, une jeune étudiante venue de Barcelone, rencontrera à l’occasion de ses recherches universitaires une vieille femme qui lui racontera ce qui s’est passé ici quelques années auparavant. Dans la troisième partie, Toya qui a vieilli trop vite et qui est désormais seule, a survécu à toutes ces atrocités, à tout ce sang, elle a vengé sa mère et se souvient de tous ces fantômes qui ont traversé son existence et qui ainsi continueront à vivre à travers elle. La vie qu’elle a donnée mais qu’on lui a volée, fait d’elle l’autre moitié de ce monde ensanglanté. Luz, qui, à l’occasion d’une hospitalisation de sa mère découvrira qu’elle n’a aucun lien de filiation avec elle et qu’on lui a caché ses origines, lui rendra un dernier hommage en l’ensevelissant dans la terre du delta. Ainsi Toya est comme ces oiseaux migrateurs et de ces anguilles qu’elle aimait tant et qui reviennent toujours à l’endroit où ils sont nés. La mort n’altérera pas cette image, comme elle n’estompera pas les visages de tous ceux qui ont été assassinés pour la liberté sur cette terre de Catalogne vouée depuis toujours à la révolte et à la liberté et dont Luz devient, un peu par hasard, l’héritière.
Ce roman qui mêle la fiction à l’Histoire est bouleversant par le style, les images poétiques qu’il distille et les évènements qu’il réveille.
-
L' autre moitié du monde
- Par hervegautier
- Le 02/02/2023
- 0 commentaire
N°1712– Février 2023
L’autre moitié du monde – Laurine Roux - Les éditions du sonneur.
Le lieu, l’Ebre qui fut le décor d’une mémorable bataille de la guerre civile espagnole où plus exactement son delta où des paysans dociles et illettrés travaillent, pour un salaire de misère, « de sol a sol » c’est à dire du lever ou coucher du soleil, pour des grands propriétaires terriens qui les considèrent comme « leurs gens » et disposent de leurs vies, avec la protection de la Garde Civile et la bénédiction de l’Église catholique.
Ce roman évoque en trois parties l’histoire de vengeances : Que vaut la vie d’une jeune paysanne dans cette Espagne rurale, archaïque et pauvre de 1930 ? Alejendra, la fille de Rita est retrouvée pendue après avoir été violentée. Pilar, la cuisinière de la Marquise, symbole de cette exploitation, subit le même sort et on pense à Carlos, le fils chéri de l’aristocrate qui se croit tout permis et qui se sait à l’abri de toute poursuite. Toya, la fille un peu sauvage de Pilar et de Juan, amoureuse des anguilles et des oiseaux qui peuplent le delta, incarnera cette revanche.
La deuxième république est proclamée et, même si elle tarde à mettre en place les réformes, ces paysans se révoltent, décrètent la grève générale, veulent que leur esclavage prenne fin, que la terre qu’ils travaillent depuis des siècles leur appartienne enfin. Face à cette société ultra conservatrice et malgré la fuite du roi, le clergé et l’armée, veillent et veulent que les choses restent figées. De chaque côté, les troubles qui iront en s’amplifiant provoqueront la sanglante Guerre Civile espagnole qui instaurera une dictature de quarante ans, bouleversera le monde et le précipitera dans la guerre mondiale.
Sous l’influence de José, un jeune avocat et d’Horacio, l’instituteur, on met en place une société égalitaire au service du peuple et tous les espoirs sont permis. Quelques notes de piano jouées par Horacio, quelques mots de Frederico Garcia Lorca, le célèbre poète assassiné et enterré dans cette terre d’Espagne devenue un immense charnier, seront pour Toya une révélation bouleversante. La jeune femme, amoureuse, sera le témoin de ces violences dont Antoine de Saint Exupéry, alors jeune reporter, dira, refusant la vision manichéenne de ce qu’il voit : « Ici on fusille comme on déboise ». En effet cette idée utopique mais exaltante pour ces paysans du delta est bousculée par les combats fratricides au nom d’un idéal politique qui oppose les Espagnols entre eux. Malheureusement la république est minée par des luttes internes et sa défaite ouvrira la voie au fascisme de Franco et à ses dérives.
La fille que Toya mettra au monde lui sera enlevée et sera confiée à une famille franquiste sans descendance. Elle sait que son enfant va vivre ailleurs et qu’elle ne le reverra jamais.
La deuxième partie fait un bon dans le temps et, à l’occasion d’une future soutenance de thèse sur les écosystèmes, Luz, une jeune étudiante venue de Barcelone, rencontrera à l’occasion de ses recherches universitaires une vieille femme qui lui racontera ce qui s’est passé ici quelques années auparavant. Dans la troisième partie, Toya qui a vieilli trop vite et qui est désormais seule, a survécu à toutes ces atrocités, à tout ce sang, elle a vengé sa mère et se souvient de tous ces fantômes qui ont traversé son existence et qui ainsi continueront à vivre à travers elle. La vie qu’elle a donnée mais qu’on lui a volée, fait d’elle l’autre moitié de ce monde ensanglanté. Luz, qui, à l’occasion d’une hospitalisation de sa mère découvrira qu’elle n’a aucun lien de filiation avec elle et qu’on lui a caché ses origines, lui rendra un dernier hommage en l’ensevelissant dans la terre du delta. Ainsi Toya est comme ces oiseaux migrateurs et de ces anguilles qu’elle aimait tant et qui reviennent toujours à l’endroit où ils sont nés. La mort n’altérera pas cette image, comme elle n’estompera pas les visages de tous ceux qui ont été assassinés pour la liberté sur cette terre de Catalogne vouée depuis toujours à la révolte et à la liberté et dont Luz devient, un peu par hasard, l’héritière.
Ce roman qui mêle la fiction à l’Histoire est bouleversant par le style, les images poétiques qu’il distille et les évènements qu’il réveille.
-
Madame Chrysanthème
- Par hervegautier
- Le 28/01/2023
- Dans Pierre LOTI
- 0 commentaire
N°1711– Janvier 2023
Madame Chrysanthème – Pierre Loti – Éditions Calman-Lévy.
Comme beaucoup d’autres romans de Pierre Loti," Madame Chrysanthème" est lié à une affectation militaire de l’écrivain voyageur. En 1885, il part pour l’extrême-Orient et en juillet il séjourne à Nagasaky. En novembre 1887 son roman est publié aux éditions du Figaro (il le sera en 1893 chez Calman-Lévy). Comme certains précédents il est dédié à une femme, ici à Mme la duchesse de Richelieu comme « Pêcheur d’Islande » l’a été à Mme Adam et« Le mariage de Loti » à Mme Sarah Bernardt. Comme souvent, même si ici l’amour n’est pas vraiment au rendez-vous, il est lié à un épisode amoureux comme ce fut le cas dans les deux romans mentionnés ci-dessus, même si les aventures féminines n’ont pas toujours été heureuses pour lui.
Dès son arrivée au Japon, en juillet 1885, Loti épouse par contrat d'un mois renouvelable une jeune japonaise de 18 ans(lui en a 35 ans), Okané-San, baptisée "Madame Chrysanthème". Il quittera Nagasaki en août de la même année. Ce "mariage" temporaire qui correspondait à une sorte de coutume assez courante au Japon mais évidemment coûteuse pour l'étranger de passage, était enregistré par la police, se concluait avec un intermédiaire avec l'accord des parents, généralement pauvres, de la jeune fille, ce qui peut paraître assez inattendu et correspond à une forme de prostitution honorable mais n'empêchera pas Okané-San d'épouser plus tard un Japonais. Il forme ensemble un couple bizarre, elle résignée mais pleine d’attentions pour lui et lui qui semble s’ennuyer dans cette relation « pour rire » qu’il vit par convenance ou opportunité pour mieux s’intégrer à ce pays. Il s’ennuie tellement qu’il évoque son enfance avec nostalgie, fait déjà une sorte de bilan de sa vie en songeant à la mort. Marin, Loti illustrait un peu l'expression facile: "une femme dans chaque port", même si la passion qu’il a décrite lors des romans « exotiques » précédents n’existe pas ici. Il considère cette jeune fille comme « décorative » et regarde la femme japonaises comme « un mystérieux petit bibelot d’étagère ». Je n'ai pas ressenti la fièvre romantique qui fut celle de Loti pour Aziyadé notamment. Le marin qu’il est vit cette période d’escale comme une expérience folklorique, une sorte d’antidote à un potentiel ennui , une relation convenue, présentée comme platonique. Il joue même ce jeu en faisant semblant de s’intégrer à cette nouvelle « famille » que lui confère son pseudo mariage avec cette jeune fille, au départ fantasmée dans l'esprit de Loti comme l'était sans doute ces contrées lointaines, mais cela ne devient rapidement pour lui qu'une étape dans sa vie d'écrivain voyageur. Ses adieux seront moins déchirants que lors de ses précédentes escales. Une vraie attirance existe, cependant pleine de retenue, entre la jeune fille et un matelot, Yves, que Loti appelle son frère et qui le suit partout. Loti quant à lui, se mariera officiellement en France le 20 octobre 1886 avec Blanche Franc de Ferrière, un mariage arrangé avec une protestante bordelaise de 27 ans, fille d'un important viticulteur. Leur union fut conventionnelle et n'entrava ni la carrière ni les frasques de l'écrivain.
Le voyageur attentif qu’il est porte sur le pays qui l’entoure et dont il connaît la langue, le regard d’un ethnologue et d’un érudit, note les différences qui existent entre sa visions des choses et la perception déformée qu’on peut en avoir dans les salons parisiens. Ce pays qui s'ouvrait au monde après des siècles d'autarcie, était pour un occidental une vraie découverte et Loti s’en montre curieux, se transformant en spectateur fidèle des paysages qu’il décrits merveilleusement autant qu’en témoin des us et coutumes, du mode de vie des habitants, du décor domestique qui l’entoure, des croyances religieuses. Comme c’est souvent le cas dans nombre de ses romans, Loti, le protestant, accorde beaucoup d’importance à Dieu ou aux dieux vénérés localement et aux rituels religieux des pays où il séjourne. Il est cependant difficile de ne pas y voir un soupçon de complexe de supériorité de sa part et même d’une certaine condescendance, voire de moquerie, à l'image de cette relation forcément temporaire qu'il abandonnera sans regret.
Loti fera reviendra au Japon et complétera sa démarche littéraire par « Japonaiseries d’automne »(1889) et « La troisième jeunesse de Mme Prune »(1905) complétant ainsi sa vision ethnographique du pays .
Sur la forme, il n'est plus question du récit d'un officier de la marine anglaise comme dans "Aziyadé" ou "Le mariage de Loti" qui étaient rédigés sous la forme d'un journal entrecoupé de correspondances. Il s'agit bien ici d’un récit, parfois daté, mais exempt de missives. D’autres œuvres, comme "Pêcheur d'Islande", seront présentées comme des romans classiques. Loti se met lui-même en scène, jusqu’au solipsisme, en une œuvre autobiographique. Il le dit lui-même dans sa présentation à la duchesse de Richelieu « Bien que le rôle le plus long soit en apparence à madame Chrysanthème, il est bien certain que les trois principaux personnages sont Moi, le Japon et l’Effet que ce pays m’a produit ».
Comme toujours, le texte est magnifique. Ce roman connut un immense succès et contribua à la renommée de son auteur pourtant controversé mais qui sera, après une première tentative malheureuse, élu en avril 1892, à l'Académie française dont il sera le plus jeune membre. Le roman sera même adapté au théâtre sous la forme d'un opéra.
Pour autant cet écrivain est actuellement injustement oublié. Sa maison de Rochefort est à nouveau ouverte au public après des années de restauration et cela peut-être l’occasion le redécouvrir cet homme complexe, contesté mais talentueux qui servit si bien notre belle langue française.
-
Autopsies
- Par hervegautier
- Le 21/01/2023
- Dans Michel Sapanet
- 0 commentaire
N°1709– Janvier 2023
Autopsies – Michel Sapanet - Plon.
Sous ce titre peu engageant, le docteur Sapanet énumère les affaires où la perspicacité du médecin légiste a permis de requalifier un accident en meurtre ou inversement. Son travail est donc essentiel puisqu’il concourt à la manifestation de la vérité et donc à une meilleure justice. Il doit procéder aux premières constations qui éventuellement mettront en route la machine judiciaire, faire parler les plus petits indices et les corps désormais sans vie, déterminer l’heure de la mort, ce qui n’est pas aisé, analyser le sang et les traces d’ADN … De tout cela dépendent l’efficacité de l’enquête, la pertinence des investigations des policiers et contribue à forger « l’intime conviction » des jurés d’assises si toutefois la mort qu’il vient de constater est assez suspecte et inexpliquée pour faire naître un « obstacle médico-légal » au permis d’inhumer.
L’autopsie est une violence faite au corps même si elle est effectuée post mortem et l’auteur considère que les cadavres qu’il doit faire parler dans le silence de l’institut médico-légal sont aussi ses « patients » dans la mesure où, peu de temps avant de se trouver sur cette table de dissection, ils étaient des êtres qui vivaient et aimaient. Au moins ces derniers ne se plaindront pas comme c’est devenu de plus en plus le cas pour la médecine des vivants et si la pénurie actuelle de médecins se fait sentir, on ne se bouscule pas non plus dans la spécialité de médecine légale. En outre la disponibilité est aussi une caractéristique de la profession puisqu’il faut répondre « aux sollicitations souvent nocturnes des procureurs pour une levée de corps » et que les légistes sont à leurs ordres en ce qui concerne les autopsies. Les praticiens qui sont aussi des experts sont également confrontés dans les prétoires aux magistrats, aux avocats... et à leurs questions. Les jugements et autres arrêts en dépendent.
Le travail du légiste est d’être en quasi permanence confronté à la mort, dans son cas souvent violente. Cela nous rappelle une évidence, non seulement qu’elle est la fin de la vie, que dès lors que nous naissons nous sommes condamnés à mourir mais aussi que notre vie est unique, précaire, fragile et que, contrairement à une idée reçue, nous n’en sommes pas les propriétaires mais les simples usufruitiers, c’est à dire qu’elle peut nous être enlevée sans préavis et dans des circonstances que nous ne pouvons, dans la presque totalité des cas, pas prévoir. Une autre évidence aussi, que l’homme est capable du pire comme du meilleur, mais bien souvent du pire et que ce pire s’exerce fréquemment sur ses proches qu’il est censé aimer et protéger ou sur les plus vulnérables et que sa capacité de nuisance, distribuant autour de lui la souffrance et la mort, est bien supérieure à celle qu’il a de faire le bien. Cela confirme ma certitude que l’espèce humaine n’est pas décidément fréquentable, et nous en faisons tous partie !
Ce sont des chroniques comme l’indique le sous-titre, ce qui donne à penser que le lecteur va être confronté à une froide évocation de la douleur et surtout de la violence qui caractérise l’espèce humaine, Que nenni, cela se lit comme un roman, avec des précisions documentaires très pointues où se révèle le pédagogue, normal, en plus d’être médecin légiste il est aussi maître de conférence à la faculté de médecine de Poitiers. Cela nous rappelle que la belle région Poitou-Charente, caractérisée entre autre par son art de vivre, n’est pas épargnée par le crime (pourquoi le serait-elle ?) . Il raconte avec talent des histoires où il est intervenu et y ajoute des remarques pertinentes, quelques pointes d’humour et, c’est original, des recettes de cuisine. C’est même plein de renseignements pour qui se pique d’écrire des romans policiers ou a des velléités de se débarrasser de son prochain en évitant les tribunaux. Oui mais voilà, le légiste veille et chaque détail compte, même si l’autopsie n’est pas, souvent pour des raisons budgétaires, un point de passage obligé. Quand il subsiste un doute, il met un point d’honneur à prononcer pour lui-même et pour les enquêteurs la traditionnelle phrase : « L’autopsie le dira ! » car il y a toujours une explication, même si elle est inattendue et il ne faut jamais s’en tenir aux évidences.
Pour autant l’auteur note que l’imagerie médicale faisant d’énormes progrès, l’autopsie virtuelle( la virtopsie) qui n’en est qu’à ses début pourra à terme prendre le pas sur l’ouverture d’un corps dans la mesure où elle n’est pas destructrice.
Le docteur Sapanet réussit à transformer ce qui au départ pouvait être rébarbatif compte tenu du sujet, en un agréable moment. J’ai appris beaucoup de choses intéressantes dans cet ouvrage, c’est bien écrit et j’ai même beaucoup souri lors de ma lecture.
-
Celle qui parle
- Par hervegautier
- Le 20/01/2023
- Dans Alicia Jaraba
- 0 commentaire
N°1708– Janvier 2023
Celle qui parle – Alicia Jaraba – Grand angle.
Cette histoire romancée est inspirée par une femme réelle du XVI° siècle, mais mal connue, « la Malinche », rebaptisée dans cet ouvrage Malinalli, Malintzin ou Doňa Marina par les Espagnols, fille d’un cacique déchu, devenue esclave, c’est un personnage controversé dans le Mexique d’aujourd’hui qui voit en elle soit le symbole de la traîtrise puisqu’elle a préféré collaborer avec les Espagnols dans la conquête de son propre pays, soit celui de la victime consentante, soit le mère du peuple mexicain, bref une figure à la fois symbolique et légendaire.
Ce qui n’est pas encore le Mexique est habité par différentes tribus qui se font des guerres sanglantes et qui parlent différents dialectes. La Malinche, douée pour les langues, a servi de traductrice aux Espagnols qui se sont imposés en jouant sur ces rivalités. Elle aurait même eu un rôle de conseil grâce à sa connaissance des mentalités locales. Elle est présentée comme une jeune femme qui prend la parole pour sortir de la condition d’esclave où l’avait mise les luttes ethniques. Elle est donc « celle qui parle », c’est à dire la traductrice mais aussi celle qui refuse sa condition de femme destinée à satisfaire les hommes et à faire des enfants. C’est un parti pris de l’auteure qui est respectable. Cette jeune fille a été la maîtresse de Cortès, un capitaine espagnol pauvre venu ici conquérir des territoires et faire fortune. Elle lui a même donné un fils.
Le livre refermé je me dis que cet épisode ne correspond pas exactement a ce que nous savons sur la conquête du Mexique, surtout si on se réfère à la fresque de Diego Rivera au Palais National de Mexico qui montre la violence qui a présidé à cette conquête. Cette violence est seulement évoquée brièvement par le massacre de la ville de Cholula. Cet ouvrage met en scène un prêtre au rôle ambigu, paisible et un peu bizarre qui semble rendre aussi un culte à Tlăloc, le dieu de la pluie. Le rôle de l’Église catholique a été bien différent puisque sa mission visait surtout à évangéliser ces peuples. Elle a accompagné et même béni les atrocités commises, les exterminations et la disparition de leur civilisation.
Les couleurs chaudes et le graphisme sont expressifs, quoique un peu sombres sur certaines planches.
-
Aziyadé
- Par hervegautier
- Le 17/01/2023
- Dans Pierre LOTI
- 0 commentaire
N°1705 – Janvier 2023
AZIYADE– Pierre Loti - Calman-Lévy.
Il s’agit du premier roman de Pierre Loti paru sans nom d’auteur en 1879 après pas mal péripéties. Il fait suite à un séjour de Julien Viaud, jeune enseigne de vaisseaux de 27 ans, au large des côtes turques et à Constantinople après l’assassinat des consuls de France et d’Allemagne. C’est une histoire d’amour entre un lieutenant de marine anglais, Loti, et une belle jeune femme circassienne de harem, Hakidjé, rebaptisée Aziyadé, rencontrée à Salonique dont il tombe éperdument amoureux. Il porte un nom bien peu britannique, le même avec lequel sera baptisé un autre lieutenant de la marine anglaise Harry Grant dans son roman suivant « Le mariage de Loti ». Quand il est à terre, il s’installe dans un quartier d‘Istanbul, y vit comme un authentique Turc, parlant la langue en oubliant autant que possible la marine. Il semble bien accepté par la population du quartier. Il a à son service deux Turcs, Samuel un jeune garçon pauvre mais débrouillard et Akmet qui se révèle être un collaborateur précieux. Entre deux périodes de solitude et d’ennui ou il se décrit lui-même comme un jeune homme amer et malheureux, il y retrouve une Aziyadé amoureuse et Loti devient alors transformé, ébloui par l’Orient (et par Aziyadé !), ses mystères et ses secrets. Il vit avec elle et ensemble ils profitent de l’instant d’autant plus intensément que, aussi bien lui qu’elle, savent que leur rêve d’amour prendra fin avec son départ inévitable. C’est un marin en escale ; comme il le ferra dans « Le mariage de Loti » il part quand son bâtiment appareille, abandonnant son amour. Quand il reviendra à Constantinople, en 1887, il apprendra la mort d’Akmet et d’Aziyadé dont il dérobera la stèle funéraire et l’installera dans sa maison de Rochefort pour être plus près d’elle. On dit aussi qu’il conserva toute sa vie une bague que lui offrit Aziyadé ainsi qu’il en fait le serment dans ce roman.
C’est aussi l’histoire d’un amour romantique impossible qui met en danger la vie de Loti et d’Aziyadé. De cet épisode est né un roman qui marque certes son attachement à une femme aimée mais consacre aussi son appétit de vivre d’autres amours, son aspiration vers un idéal et peut-être aussi illustre sa difficulté à se fixer. Comme il le fera dans son roman suivant, « Le mariage de Loti » l’histoire qu’il raconte est déclinée sous forme d’un journal intime et d’un échange de correspondances notamment avec son ami Plumkett. Loti y détaille ce qu’est la vie à Constantinople, les us et coutumes turques, la psychologies des femmes jusque dans la séduction, les bouleversements politiques d’un empire ottoman déclinant. Dans son roman, l’officier reviendra en Turquie après son départ de Stamboul, ne reverra pas Akmet, parti pour la guerre et retrouvera la tombe d’Aziyadé, morte de chagrin. Il intégrera l’armée turque, changera son nom mais pas de religion et mourra lors d’une bataille en Arménie, désespéré par la disparition de son amour.
Dans la forme comme dans le fond, son roman est loin de ce qui se faisait à son époque, dominée par Zola et le « naturalisme », qui s’attachait à décrire la société de son temps. Son discours de réception à l’Académie Française du 8 avril 1892 en témoigne. Ce roman est certes un document ethnographique important ce qui le rapprocherait un peu de ce mouvement caractérisé par le réalisme, en même temps qu’un témoignage autobiographique étalé sur deux années, mais sa description de la société turque paraît un peu superficielle et chacun des livres de cet écrivain-voyageur devient non seulement le décor d’une intrigue sentimentale, souvent exotique et attachée «aux grands espaces », mais révèle chez lui sa volonté d’échapper à la réalité pour se réfugier dans une sorte d’idéal. Loti fait montre, comme les naturalistes, d’une riche documentation dans ses écrits mais la mélancolie n’est pas non plus absente de son propos ; il s’agit donc d’un témoignage subjectif.
Même s’il a été un écrivain à succès durant sa vie, ce premier roman, malgré ses descriptions somptueuses, ne connut qu’un succès relatif. Pierre Loti qui écrit fort bien a toujours pour moi cet attrait littéraire qui ne s’est jamais démenti et je déplore qu’il soit aujourd’hui si injustement oublié.
-
Satchmo
- Par hervegautier
- Le 15/01/2023
- Dans Léo Heitz
- 0 commentaire
N°1707– Janvier 2023
Satchmo - Leo Heitz – Jungle RamDam.
Derrière ce nom un peu bizarre qui n’est en fait qu’un surnom, se cache un petit garçon noir, amoureux du jazz et du chant qui deviendra Louis Armstrong;Nous sommes au début du XX° siècle dans un quartier pouilleux de la Nouvelle-Orléans... Il prend conscience que cette musique essentiellement noire qui est née de l’esclavage et la religion chrétienne est désormais jouée avec succès par les blancs du nord des États-Unis et cela le révolte. Son histoire débute plutôt mal, son père est déjà parti vers d’autres aventures, sa mère est une prostituée et il tâte de la maison de correction où il trouve dans l’étude de la trompette un manière d’évasion. Tout cela n’a pas été aussi simple, il a fallu ramer et ramer encore, il a eu de a chance, a peut-être rencontré Al Capone (renommé Al Ratone) à Chicago, pourquoi pas ?
On a l’impression d’après le titre que c’est une biographie d’Armstrong que nous allons lire ; c’est en partie vrai mais en réalité c’est une fiction violente, par ailleurs parfaitement acceptable, qui tourne autour de la volonté de Louis d’arracher sa mère à la prostitution.
Ce n’est pas une histoire drôle, la vie l’est rarement, le graphisme est assez brut et les couleurs sombres, noir, marron et sépia, sont là pour accentuer cette certitude. Mais pourquoi leur avoir fait à tous des têtes de rats ?
-
Caravage
- Par hervegautier
- Le 14/01/2023
- Dans Michele Placido
- 0 commentaire
N°1706– Janvier 2023
Caravage – Un film de Michele Placido .
"L'ombra di Caravaggio"est un film franco-italien sorti en 2022. Il retrace les dernières années de la courte vie du célèbre peintre italien Michelangelo Merisi, dit Le Caravage (1571-1610) dont le talent révolutionna la peinture sous le nom de "caravagisme", s'appropriant et améliorant la technique du "clair-obscur" qui fut ensuite développée par d'autres artistes notamment Rembrandt.
Malgré des débuts difficiles, il étudie, dans l'atelier d'un peintre milanais puis à Rome, les techniques picturales de son temps notamment centrées sur les natures mortes et les portraits, le nouveau regard qu’il porta sur la peinture il valut un grand succès de son vivant, notamment à Rome. En 1606, un duel où il blesse mortellement son adversaire l'oblige à quitter les états pontificaux pour vivre en exil à Naples, à Malte et en Sicile. Pendant cette période et malgré sa réputation sulfureuse, ses peintures ont pour but de racheter cette faute et d'obtenir le pardon du pape. A cette époque un peintre dépendait de riches collectionneurs et commanditaires et les autorités religieuses contrôlaient les images destinées au public. On devait à l'époque en effet représenter des scènes bibliques ou illustrer l’Évangile. Le Caravage, sous l'influence de celui qui deviendra Saint Philippe Neri, fondateur des Oratoriens, et sous la protection à Naples de Costanza Colonna, pratique cet exercice mais pour représenter les saints il prend pour modèles des indigents, des voleurs et des prostituées, c'est à dire tout simplement la vie, ce que ne peut tolérer l’Église malgré l'intérêt que certains prélats portent à son style. Le film de Placido insiste tout particulièrement sur cet aspect de la démarche du Caravage. Le peintre est notamment sous la protection du Pape Paul V et de son neveu le cardinal del Monte et après moult mésaventures violentes il trouve la mort sur une plage de Toscane dans des circonstances restées mystérieuses.
Il semblerait que le Caravage ait obtenu la grâce papale mais dans ce film Michele Placido fit intervenir un personnage fictif, " l'Ombre "(Louis Garrel), chargé par le pape d'instruire le procès qui fait suite à l'assassinat d'un jeune noble pour lequel Le Caravage est condamné à mort. Cet inquisiteur, tout entier sous l'influence des dogmes catholiques de la contre-réforme cherche par tous les moyens, jusques et y compris la ruse, à traduire le peintre devant le tribunal de l'Inquisition. Que Merisi ait croisé le dominicain Giordano Bruno (1548-1600) en prison n'est pas établi, mais après tout pourquoi pas puisqu'ils étaient contemporains et le moine a été incarcéré à Rome avant sa condamnation au bûcher pour apostasie et la conduite scandaleuse du peintre le jetait souvent dans les geôles papales.
La distribution est exceptionnelle, Michele Placido incarne le cardinal del Monte, Ricardo Scamarcio, montre une ressemblance étonnante avec le peintre à tout le moins si on peut en juger d'après le portrait qu'à fait de lui Ottavio Leoni. Isabelle Huppert est rayonnante dans le rôle de la marquise Costanza Colonna protectrice du peintre et Louis Garrel incarne à merveille le personnage de « l’Ombre » qui joue sur les vices du peintre, sur son talent et donc sur sa vie.
C’est un excellent film dont chaque scène est montrée comme un tableau, servi par une distribution prestigieuse qui se penche sur les démêlés du Caravage avec l’Église toute puissante à cette époque, intolérante aussi, se recroquevillant sur des dogmes surannés en contradiction avec l’Évangile dont pourtant les prélats se recommandaient. C'est donc un hommage à un grand peintre qui a connu une longue période d’oubli et aussi une création que j'ai personnellement trouvée convaincante.
-
Le mariage de Loti
- Par hervegautier
- Le 11/01/2023
- Dans Pierre LOTI
- 0 commentaire
N°1704 – Janvier 2023
Le mariage de Loti – Pierre Loti - Calman-Lévy.
Il s’agit d’un roman paru en 1882 et qui relate un épisode de la vie de deux midshipmen anglais, Plumkett et Harry Grant. Lors d’une escale à Tahiti, ce dernier s’éprend d’une jeune et belle vahiné, Rarahu qui lui donne le surnom de Loti du nom d’une fleur locale et qu’il épouse à la mode polynésienne. A son départ, sur l’ordre de ses supérieurs, l’officier promet de revenir mais poursuit sa carrière et sa vie de marin.
En réalité c’est une sorte de journal tenu par Loti-Grant, une œuvre assurément autobiographique où le jeune lieutenant de vaisseaux Julien Viaud accoste à Tahiti où il entretient une relation passionnée avec une vahiné. Dans un courrier adressé à sa sœur, Harry Grant fait allusion à son frère qui a vécu ici et qui est mort. Julien Viaud avait lui aussi un frère aîné, Gustave, chirurgien de marine, mort en mer. Il y a bien d’autres références à la vie de celui qui deviendra Pierre Loti. L’épisode de Tahiti donnera ce roman qui, comme beaucoup d’autres, est inspiré de la passion qu’il nourrissait pour les femmes et leur beauté.
C’est évidemment un merveilleux roman plein de belles descriptions, écrit dans une langue élégante, poétique comme Pierre Loti l’a toujours fait mais c’est également un document ethnographique, sociologique, géographique, économique, linguistique d’importance qui explore également les coutumes, les légendes et l’histoire de ce pays comme le voyageur qu’il était ne manquait jamais de noter les caractéristiques des pays qu’il traversait ou visitait ; il s’immergeait dans la culture locale. Pour autant il sent bien que cet univers paradisiaque est menacé de disparition par une certaine forme de colonisation et de civilisation qui seront destructrices pour cette contrée.
C’est aussi un roman d’amour qui lie Harry à Rarahu, cet amour, d’ailleurs évoqué en termes quasi platoniques, est authentique mais temporaire pour le marin qui quittera un jour cette île et cette « petite femme ». On a même l’impression que cette escale dure un temps infini alors que celle-ci est forcément courte et que Grant-Loti ne fait rien d’autre que de vivre à terre avec Rarahu alors qu’il doit aussi assurer son service d’officier à bord. La vie dans ces contrées nous est présentée comme quelque chose d’ idyllique et tout y parait facile. On sent l’écrivain Pierre Loti emporté par l’histoire qu’il nous raconte et par sa fascination pour cette île qu’il décrit admirablement. Peut-on lui en faire grief ? Comme souvent dans ses romans les personnages sont à la fin quelque peu désenchantés.
La trace du passage de Loti à Papeete n’est pas effacée, en témoigne notamment un buste, un lieu « le bain Loti », une avenue à son nom. Il ne fut d’ailleurs pas le seul officier de marine à être séduit par les paysages de Polynésie, ce fut le cas de Victor Ségalen, médecin militaire, sans parler du peintre Gaugin.
On peut reprocher beaucoup de choses à Loti, ses prises de positions, ses attitudes parfois étranges, ses écrits qu’on peut toujours interpréter avec nos yeux d’aujourd’hui, même s’il s’agit effectivement d’un écrivain de la fin du XIX° siècle, il reste un grand auteur français , malheureusement un peu oublié, qui a rendu hommage par son talent à notre belle langue française.
-
Il n'y a pas d'arc en ciel au paradis
- Par hervegautier
- Le 04/01/2023
- Dans Nétonon Noël Ndjékéry.
- 0 commentaire
N°1702 – Janvier 2023
Il n’y a pas d’arc en ciel au paradis – Nétonon Noël Ndjékéry. - Helice Helas Editeur.
A travers l’errance de Tomasta Mansour, un esclave eunuque en fuite qui se fait passer aux yeux des populations rencontrées pour un dignitaire religieux et belle et blanche Yasmina, fugitive elle aussi, échappée d’un harem, l’errance de ce couple hétéroclite croise la route de Zeïtoun, jeune esclave fuyant les trafiquants esclavagistes arabes. Des rives de la Mer Rouge au lac Tchad, le voyage de ce désormais trio à travers le désert comme à travers le temps où l’Histoire se mêle à la fiction, entre colonisation française et trafic d’êtres humains a quelque chose d’initiatique. Ce long voyage se transforme en une lutte pour la vie entre la mystification religieuse, la soif omniprésente et la constante volonté de ne pas revenir à l’état d’esclavage en tombant entre les mains des négriers arabes.
Dans l’évocation de son parcours se mêlent le merveilleux de la fable, le réalisme du témoignage, la magie et les légendes de l’Afrique, la tradition, l’occulte et les mythes. Cette île qui dérive au milieu du lac Tchad fait figure de terre d’où l’esclavage est absent et où règne la paix la liberté et la tolérance , mais cette fable quelque peu utopique s’arrête cependant brutalement quand les querelles de territoires prennent le dessus et que l’instabilité politique s’installe. La traditionnelle tranquillité de ce lieu insulaire est même bousculée par l’émergence de la foi islamique et avec elle de l’instauration d’un califat terroriste et confessionnel qui entend asservir au nom du Coran et de ses promesses ce peuple qui ne demandait qu’à vivre en paix. C’est l’image de ces pays jadis colonisés qui aujourd’hui peinent a trouver une indépendance et un ordre public et sont la proie de toutes les manipulations politiques et religieuses qui les asservissent toujours autant.
Cette saga africaine qui est agréablement et poétiquement écrite fait voyager le lecteur dans le temps et dans l’espace. L’épilogue quant à lui m’évoque les malheureux massacres perpétrés au nom de l’enseignement tronqué d’une religion qui se veut celle de la paix autant que les promesses illusoires de son enseignement.
-
Pourquoi pas la vie
- Par hervegautier
- Le 16/12/2022
- Dans Coline Pierré
- 0 commentaire
N°1701 – Décembre 2022
Pourquoi pas la vie – Coline Pierré - L’iconoclaste.
Sylvia Plath(1932-1963), poétesse et romancière américaine dépressive et mère de deux enfants se suicide en cet hiver anglais de 1963. Jusque là sa vie, une sorte de château de cartes dans un courant d’air, s’est déroulée dans le chaos et la dépression puis, après son mariage, dans l’ombre d’un mari célèbre, volage et également poète, Ted Hughes, qui lui a toujours volé la vedette et qui a fait prévaloir sa carrière littéraire sur celle de son épouse. Il y a des précédents célèbres où la vie commune et fusionnelle de deux artistes a conduit à des échecs retentissants et, se sentant trahie par l’adultère de son mari, elle choisit la mort par suicide.
A partir de ce fait Coline Pierré choisit de s’approprier cette histoire, de donner à cette femme un destin différent en interrompant sa marche vers la mort grâce à la fiction du roman et de lui donner l’occasion d’une revanche. Après tout et nonobstant l’aphorisme de Bossuet sur cette démarche où il voit un dérèglement de l’esprit, la littérature permet ce parcours dans l’irréel et on peut aisément être tenté de refaire le monde tant celui-ci est déprimant, absurde, injuste... Après la courte de vie de Sylvia (31 ans), évoquée dans un de ses romans a été torturée par la dépression et les soins qu’à l’époque on y réservait.
Nous ne sommes donc pas dans une biographie mais dans une authentique uchronie. Sylvia est donc sauvée in extremis et , grâce à ses amis (ies) différents d’elles, à ses jeunes enfants, elle divorce, reprend goût à la vie, à l’écriture, à l’indépendance face aux hommes dans une sorte de renaissance où elle abandonne le rôle traditionnel dévolu aux femmes à cette époque, bref, fait prévaloir la vie sur la mort. C’est elle qui décide d’aller mieux dans le tourbillon des Sixties, les débuts des Beatles et la culture Pop, de se détacher complètement de sa vie d’avant, de devenir écrivain(e) malgré toute les contingences et les doutes personnels que cela implique. Elle a été certes une poétesse précoce, son talent est reconnu, son suicide manqué lui a conféré une sorte d’aura, elle devient l’archétype du génie féminin engagé mais tout cela n’est pas suffisant pour lui faire oublier sa vie d’avant et les souvenirs l’assaillent.
La démarche de Coline Pierré se déroule à l’envers du traditionnel roman qui raconte au passé une histoire qui a déjà eu lieu. Elle est en cela originale et le style agréable de l’auteure réussit à nous faire oublier ce qui s’est vraiment passé pour Sylvia et on en vient à imaginer qu’elle aurait pu avoir la vie qu’elle lui prête avec ses évolutions et ses sentiments. Pourquoi pas après tout ! Eh bien moi, n’en déplaise à Bossuet, j’ai choisi de l’accompagner dans cette nouvelle vie, de l’imaginer publiant avec succès ses œuvres inédites, avec une vie créatrice trépidante, des amis, des amants, en cheminant doucement vers la mort, entourée des siens. Je l’imagine surtout vivant et affirmant son engagement féministe et créatif face aux hommes.
Je remarque que, sans connaître le milieu littéraire anglo-américain de l’époque, la poésie semble y avoir eu plus de crédit qu’en France où elle n’est acceptée (parfois) que dans la chanson. La véritable Sylvia Path a connu une certaine notoriété littéraire mais a surtout obtenu le prestigieux prix Pulitzer dans la catégorie poésie, en 1982, soit 19 ans après sa mort et ce grâce en partie à son ex-mari qui, sans doute culpabilisé par le suicide de son ex-épouse, favorisa l’édition partielle de ses œuvres.
J’ai lu ce roman dans le cadre de ma participation à un jury. Je ne connaissais pas l’œuvre de Sylvia Plath mais, après avoir refermé ce livre j’ai eu envie d’en savoir davantage sur cette auteure dont je reparlerai sans doute dans cette chronique.
-
Paris-Briançon
- Par hervegautier
- Le 12/12/2022
- Dans Philippe Besson
- 0 commentaire
N°1700 – Décembre 2022
PARIS – BRIANÇON - Philippe Besson – Juillard.
J’ai assez pris le train durant ma jeunesse, michelines omnibus aux couleurs délavées et qui s’arrêtaient à toutes les gares de la campagne ou trains de nuit aux compartiments bondés et pleins de militaires rejoignant leur caserne, pour ne pas être tenté de monter dans celui-là aussi. Cela n’avait pourtant à l’époque rien à voir avec le mythique Orient-Express et tous ses fantasmes et je passais souvent la totalité du voyage dans le couloir ou dans les soufflets et même si aujourd’hui ce sont des trains-couchettes, principalement à destination du sud de la France, je me suis dit que cela me rajeunirait. J’ai toujours été attiré par les trains parce que j’en ai été longtemps le client assidu et que l’espace de quelques heures on se retrouve en promiscuité avec des gens qu’on ne connaît pas, avec qui on peut lier conversation pour ensuite ne plus jamais les croiser. Pendant ces entretiens improvisés, dans le huis-clos des compartiments, on pratique la philosophie du café du commerce, on raconte souvent sa vie en une sorte de confession, les questions se font parfois indiscrètes, les réponse aussi, on refait le monde, on parle de la météo, de la politique, à en oublier le sommeil, d’autant plus facilement qu’on a affaire à un inconnu. J’ai toujours été attiré par cette ambiance propres aux trains.
Philippe Bessons plante ici le décor, des personnes, jeunes ou vieux, d’horizons professionnels différents et aux motivations diverses d’être ici, vont se rencontrer pour un voyage ferroviaire nocturne de plus de douze heures. Souvent ils ne se connaissaient pas auparavant et vont se découvrir. Au début on a l’impression d’être dans l’ambiance traditionnelle des romans de l’auteur avec son lot de rencontres masculines dictées par la chance comme il les affectionne, telle celle d’Alexis et de Victor dans la torpeur d’un long trajet. Leur rencontre éphémère que rien ne laissait prévoir révèle autant une découverte mutuelle que la certitude de devoir vivre avec ce secret. Rien ne devait se passer, tous devaient arriver à Briançon sans encombre et reprendre le cours de leur vie après cet intermède nocturne, la routine… Puis c’est l’accident brutal et avec lui la mort. Elle fait partie de la vie, en est simplement la fin et on oublie un peu vite que nous n’en sommes que les usufruitiers, que nous sommes mortels, qu’elle peut nous être enlevée sans préavis et surtout au moment où nous y attendons le moins, même si nous menons notre existence en faisant semblant de l’oublier. On songe au thème de la fatalité, du hasard malheureux, d’un enchaînement d’évènements évoquant la fragilité de notre vie, la certitude que nous ne sommes que de passage, qu’un rien peut soudain faire changer radicalement les choses, que se trouver « au mauvais endroit au mauvais moment » peut être fatal, que ceux qu’on a aimés ou simplement appréciés l’espace d’un instant peuvent simplement basculer de l’autre côté et qu’on ne les reverra plus jamais, que la quasi totalité d’entre nous ne laissera de son passage sur terre qu’un nom sur une pierre tombale...
Face à cela s’est installé cette habitude qui s’est ancrée dans notre quotidien, ce « droit à l’information » quelque peu dérisoire au regard de l’horreur et à la souffrance d’autrui, faisant de chacun d’entre nous de véritables voyeurs demandeurs d’images, qu’elles viennent des réseaux sociaux ou de la télévision. De tels événements qui émaillent notre quotidien révèle la cruauté de notre existence mais aussi sa futilité.
Les trains de nuit que j’ai connus n’ont plus rien de commun avec les intercités actuels, évidemment plus confortables mais j’ai retrouvé avec plaisir le style de Philippe Besson et les personnages attachants qu’il nous donne à voir. Cela m’évoque cette parole d’Apollinaire « crains qu’un train ne t’émeuve pas ».
-
la femme gelée
- Par hervegautier
- Le 08/12/2022
- Dans Annie ERNAUX
- 0 commentaire
N°1699 – Décembre 2022
La femme gelée - Annie Ernaux – Gallimard.
St Thomas d’Aquin conseillait qu’on se méfiât de l’homme d’un seul livre. Même si cet aphorisme de ce docteur de l’Église est discutable, il reste que, s’il est un auteur qui a mis son autobiographie au service de son œuvre romanesque en en faisant le thème central et exclusif, c’est bien Annie Ernaux. Elle incarne à mes yeux, et ce sans aucune critique de ma part, le solipsisme de l’écrivain. Je remarque que le jury suédois semble apprécier les écrivains français qui explorent leur mémoire personnelle dans leur œuvre puisqu’il a déjà distingué en 2014 Patrick Modiano qui a fait la même démarche créative.
Dans ce roman, le troisième de cette auteure, publié en 1981, elle se représente en jeune fille qui a vécu une enfance heureuse au sein d’une famille modeste de petits commerçants normands mais compréhensive et qui souhaitait surtout qu’elle ait une vie meilleure que la leur. Elle était un peu leur revanche à eux (surtout à sa mère) et faire des études, devenir quelqu’un, avoir des connaissances et un bon métier lui permettra d’échapper au pouvoir des hommes. Dans les années 60 c’était en effet le destin de la femme que de rester à la maison, se charger des taches ménagères, d’élever ses enfants et de dépendre de son mari comme ce fut le cas de sa mère. C’est aussi l’époque où l’ascenseur social fonctionne encore et il est communément admis qu’un « bagage »(comme on disait à l’époque) ouvrait les portes de l’emploi. Elle fait donc des études universitaires, rencontre un étudiant et l’épouse. C’est aussi l’époque où les esprits s’ouvrent et les mentalités évoluent grâce à de grandes vois féminines et elle imagine que les choses vont évoluer vite et entretient l’illusion de l’égalité des sexes.
Elle parle librement de ses années d’enfance, de ses interrogations de fille face à la transformation de son corps, aux craintes instillées par la religion et sa morale, à la peur d’un avenir traditionnellement tracé, son goût pour les livres sans images et son envie diffuse d’en écrire elle aussi, plus tard. Puis viennent les années d’adolescence avec ses doutes ses espoirs, les études, un métier d’enseignant, le mariage puis la maternité, l’installation dans la vie, une sorte de routine incontournable pour une femme
J’aime bien lire Annie Ernaux, mais là, je me suis un peu ennuyé.
-
Ultramarins
- Par hervegautier
- Le 05/12/2022
- Dans Mariette Navarro
- 0 commentaire
N°1698 – Décembre 2022
Ultramarins - Mariette Navarro – Quidam éditeur.
Elle est commandante d’un porte-containers, pour un voyage entre la métropole et la Guadeloupe, seule femme responsable du navire au milieu de tant d’hommes. Lors d’une traversée qui s’annonçait facile, elle autorise, ce qui ne se fait jamais sur un bateau de commerce à cause notamment des délais de transport et du règlement, une baignade de l’équipage, officiers compris, en en plein Atlantique. Étonnée elle-même de sa décision, elle reste à bord pendant cette heure de liberté octroyée, elle observe leur nudité qui abolit un temps les obligations de la navigation, la hiérarchie, la discipline nécessaire, les conventions sociales… Elle réfléchit aussi sur elle-même, sur son enfance terrestre, son attirance irrésistible vers la mer, comme un sacerdoce, sur son impossibilité de vivre comme les autres femmes ordinaires, sur son célibat, sur l’ivresse et la solitude du commandement, sur sa maîtrise des choses de la mer, sur ses certitudes, sur ses folies éphémères abandonnées, sur la mort qu’elle souhaite pour elle.
Ce moment festif passé, matérialisé seulement par un trou de rayon sur la carte marine, tout rentre dans le rituel des codes du bord, chacun reprend sa place, du pont aux coursives, à la salle des machines et elle se met à s’intéresser à chacun d’eux, à son leurs origines, leur parcours, leurs motivations et durant cette attention étonnante le cargo s’enfonce dans une brume épaisse et inattendue, sorte d’anomalie météorologique qui fait songer au mystère du « triangle des Bermudes ». avec zones de silence-radio, de déréglemente des instruments de bord, d’anomalies météo, comme si le bateau était devenu un vaisseau fantôme, libre de sa vitesse et de sa position. Puis, comme si la folie passagère de cette baignade devenait une évidence, la commandante entre dans une sorte de démence où elle se met à croire à un passager clandestin, s’intéresse à un jeune matelot, pense à son père, ancien commandant mort et se met à consigner sur le livre de bord son intention de ne plus respecter les procédures et de mettre fin à sa carrière pourtant jusque là irréprochable.
Ce livre qui est un premier roman intense et bien écrit, débute par une longue méditation sur la traditionnelle citation apocryphe attribuée à Aristote « Il y a trois sortes d’hommes, les vivants, les morts et les marins », et plus particulièrement une réflexion sur la qualité d’hommes de mer, ces êtres qui sont perpétuellement en partance, habités, entre deux embarquements par l’angoisse et la nécessité des départs, le vertige du danger et de la mort, incapables de se fixer. Comme eux tous ceux aussi qui ont des « semelles de vents » et qui sont rejetés par la terre, sans roulis ni tangage...
Nous sommes dans une fiction, une fable, née d’une résidence d’auteurs à bord d’un cargo où l’extraordinaire est permis avec son pesant d’imaginaire, de mystères et de dangers, une expérience qui pour un terrien a quelque chose d’exceptionnel et dans laquelle je suis entré par goût de l’aventure. C’est aussi cette tentation de la folie qui nous guette et nous envoûte un temps dans chacune de nos vies.
-
La gardienne de Mona Lisa
- Par hervegautier
- Le 01/12/2022
- Dans Peter May
- 0 commentaire
N°1697 – Décembre 2022
La gardienne de Mona Lisa – Peter May – Éditions du Rouerge.
Nous sommes en pleine pandémie de covid et Enzo Mac Leod, sorte de Hercule Poitot écossais qui a choisi Cahors comme lieu de retraite familiale se retrouve malgré lui face à une nouvelle enquête. A Carennac, un petit village voisin, on vient dé découvrir la squelette d'un officier allemand enterré depuis la fin de la deuxième guerre mondiale et c'est à l'invitation de sa vielle amie Magali Blanc, médecin légiste, qu'il s'y rend. En arrivant sur les lieux il se trouve confronté au meurtre sordide d’Émile Narcisse, un fameux critique d'art international et le capitaine Arnault de la gendarmerie nationale lui demande sa collaboration dans la découverte du coupable. Flatté par tant de reconnaissance, il s'empresse d'accepter malgré les affres de l’accouchement de sa fille. Le voilà donc confronté à deux enquêtes qui à priori n'ont rien à voir l'une avec l'autre et que tant d’années séparent, mais ce n'est évidemment pas pour lui déplaire. A priori seulement puisqu'il va être obligé de remonter le temps, d'explorer la période de la Deuxième guerre mondiale en France et le déménagement du musée du Louvre pour éviter que les œuvres de l'exceptionnel musée ne tombent entre les mains d'Herman Goering qui était également connu pour être un collectionneur mais aussi un pilleur d’œuvres d'art. Les intentions d'Hitler étant également de s’approprier la Joconde, une lutte secrète s'engage entre les émissaires de l'un et de l'autre dans cette sombre affaire. Notre enquêteur va donc explorer les archives et les dessous de cette affaire, entre amours et trahisons, respect du devoir et luttes secrètes, faire connaissance avec la rocambolesque aventure du célèbre tableau de Vinci et bien entendu de la jeune Georgette qui en assura la garde. Elle sera emportée un peu malgré elle par le cours de l’histoire et courtisée par ceux dont la mission est de mettre la main sur ce plus célèbre tableau du monde.
J’ai retrouvé avec plaisir la plume de Peter May que j’avais croisée dans « L’île aux chasseurs d’oiseaux ».
A partir d'un fait réel, la présence secrète de la Joconde au musée de Montauban en septembre 1940 et d’un concours de circonstances plus personnelles, Peter May fait appel à son imagination féconde pour concocter ce roman policier palpitant. Quant à l’éventualité d’une copie du tableau représentant la Joconde, réalisé pour mieux tromper les Allemands et donc protéger l’original, ce n’est peut être pas si farfelu que cela, après tout nous sommes dans un roman, et le monde de l’art fourmillant de faux.
-
Ecritures carnassières
- Par hervegautier
- Le 28/11/2022
- Dans Ervé
- 0 commentaire
Écritures carnassières – Ervé – Éditions Maurice Nadeau.
C'était plutôt mal parti pour lui qui fut un enfant dont la mère alcoolique se débarrassa comme d'une chose encombrante, puis ce fut un parcours cahoteux de familles d'accueil en foyers avec pour seul refuge la solitude et les larmes face à l'indifférence, aux sanctions des adultes et au temps qui s'étire dans l'ennui. Il n'en faut pas plus pour aimer la marginalité ponctuée parfois d'une amitié fugace, de petits bonheurs, d'échecs, d'abus de toutes sortes, de détestation de soi, d'autodestruction par l’alcool le tabac, la drogue, l’idée du suicide... De "cas social" il devient tout naturellement asocial, peut-être plus mature que les autres enfants, ce genre de circonstances donnant très tôt une autre vision des choses et des gens que celle traditionnellement idyllique de l’enfance. Par réaction, il se fait des illusions d'avenir, se rêve autrement, il lit et même écrit tout ce que sa vie cabossée lui inflige. Il doit se rappeler aussi tous les propos suffisants des bien-pensants, ceux qui proclament à l’envi « qu’il suffit de vouloir pour pouvoir » parce qu’ils ont eu la chance qu’il n’a pas eue. Puis il se dit que les passades éphémères qui ont égrené sa vie n’ont qu’un temps, que le bonheur existe et qu'il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas pour lui aussi. Il y eu une rencontre et avec elle tous les fantasmes qu'on se tisse soi-même pour compenser tout ces manques, et pour tenter de faire changer les choses. Ce fut un prénom, Claire, la naissance de ses deux filles, ses deux poumons comme il dit, c’est pour elles qu’il écrit et cela me paraît parfaitement légitime. Nous savons que l’enfance conditionne la vie future et lui qui n’a pas eu d’amour pendant cette période se révèle incapable d’aimer, quitte cette famille qu’il avait créée et voulue pour tenter d’exorciser ce qui ressemble de plus en plus à un destin funeste. Ainsi pour ses filles, il devient « un père absent » qui ne leur donnera pas l’amour auquel elles ont droit. On ne peut donner ce qu’on n’a pas. Comme tous les malheureux qui font ce qu’ils peuvent pour s’en sortir, il n’échappe donc pas à cette règle non-écrite qui fait qu’on reproduit malgré soi l’exemple qu’on voulait précisément éviter. Elles aussi manqueront de son affection. Son univers devient donc la rue, l’errance, la manche et les petits bulots pour survivre... Il n’est pas clochard, même s’il le dit souvent, puisqu’il se déplace sur le cadastre national et même au-delà des frontières, qu’il voyage et on songe à Jack Kérouac et peut-être aussi à la génération perdue qu’il incarna, on pense surtout à une fuite qui ne dit pas son nom pour échapper à ses semblables marginaux, aux regard des autres, à sa région sinistre et sinistrée et peut-être aussi à lui-même, à ses erreurs, à son mal-être, avec sa solitude pour seule compagne...
De courts chapitres d'une écriture « carnassière » c’est à dire féroce, abrupte, saccadée, comme la marque d’une révolte contre l’adversité. Elle n’est pas vraiment académique, se moque de la chronologie , mais elle a du caractère, est dénuée d'artifices et les moments de poésie et de paroles de chansons cachent mal les fêlures et le désespoir de cet écorché-vif. Dans son cas, l’écriture est un témoignage, celui d’un être qui choisit ainsi de réagir contre sa condition et ce faisant, en mettant des mots sur ses maux, il les adoucit au moins temporairement, même si j’ai toujours douté de l’effet cathartique de l’écriture. Il s’en sert pour exorciser ce destin néfaste et je ne suis pas sûr, malgré les apparences qui, nous le savons, sont trompeuses, que cela soit effectivement efficace simplement parce que les séquelles malsaines de cette enfance ont la vie dure.
Le hasard fait parfois bien les choses qui fait se rencontrer des êtres qui n'auraient sans cela eu aucune chance de le faire. Tel a été le cas quand l'écrivain Guy Birenbaum a croisé Ervé qui à l'époque était SDF et s’intéressa à lui. Il y aurait donc une justice (immanente?) qui rectifierait parfois les épreuves que la vie ne manque pas de nous envoyer, et cette malchance qui s'accroche à vous et ne vous lâche pas. Cette expérience semble donc avoir un épilogue heureux et ouvrir à Ervé des perspectives d’avenir. Tant mieux pour lui, il a eu de la chance dans son malheur, est sorti de sa condition en devenant écrivain, son premier livre est publié, c’est à dire qu’il a réalisé son rêve. Pourtant, à un moment où il est difficile de trouver un vrai éditeur sans avoir un bon parrainage, ou sans payer parfois cher sa prestation sans pour autant que la promotion du livre soit correctement faite, l’aventure que vit Ervé est plutôt rassurante et peut-être encourageante pour la foule de ceux, et ils sont nombreux, qui se voient contraints de remiser leur manuscrit dans la poussière d’un tiroir... et d’abandonner leur projet. Pour une fois qu’un éditeur, qui est un découvreur de talents, fait effectivement son métier, il serait vain de s’en plaindre.
Le livre refermé, cette histoire que j’ai lue avec attention et intérêt me laisse quelque peu perplexe. Je ne suis qu’un simple lecteur qui n’ait, par chance, jamais dû vivre sans toit mais, si je comprends la volonté de l’auteur de fonder une famille pour tenter d’oublier son enfance désastreuse, je reste dubitatif devant sa décision de revenir dans la rue et dans la marginalité avec son lot de mépris et de violences en oubliant ses responsabilités de père, ce qui aura sûrement les mêmes conséquences sur la vie de ses filles que l’irresponsabilité de sa mère a eue sur la sienne. Il a certainement tenté d’inverser le cours des choses mais elles se sont imposées à lui, malgré lui. D’une certaine manière et même s’il dit se détester, il fait valoir une certaine forme de liberté face à sa double paternité non assumée, laissant à sa compagne le soin de s’occuper de sa progéniture. Confesser son amour pour ses filles et sa femme est, dans ses conditions, sûrement insuffisant pour elles. D’autre part, il raconte son histoire qui est celle de beaucoup de gens jetés dans la rue à la suite d’accidents de la vie et ils seront sans doute nombreux à s’y retrouver.
J’ai bien conscience que je suis assez mal placé pour juger cet ouvrage et surtout le message qu’il contient, même si, toutes choses égales par ailleurs, mon empathie personnelle me fait partager ce mal-être.
-
Saïd
- Par hervegautier
- Le 21/11/2022
- Dans Fabienne Swiatly
- 0 commentaire
N°1694 – Novembre 2022
Saïd – Fabienne Swiatly – La fosse aux ours.
Pour cette petite fille rousse et solitaire au nom polonais, dans les années 70, l’Algérie est loin de la Lorraine. Elle loge dans une petite cité ouvrière séparée de la barre d’immeubles où habitent des familles algériennes par une ligne à haute tension, une véritable frontière. On y rencontre le racisme ordinaire, le même sans doute que celui qui a accompagné la venue en France des Polonais et autres émigrés, quelques dizaines d’années auparavant, venus faire de travail que les Français ne voulaient pas effectuer. On les appelle le « bougnoules » comme jadis ces étrangers étaient les « ritals », les « espingouins », les « polak »...
Un peu hasard, elle croise Saïd, une amitié puérile naît et même si tout les sépare elle dépasse les préjugés de ses parents et se met à rêver du sable, du thé, des chameaux et du désert, malgré la violence de ses demi-frères. Un peu trop tôt pour elle peut-être, elle apprend à ses dépends que ce qu’on a imaginé ne se réalise pas forcément, que la vie vous joue parfois de bien mauvais tours, qu’il faut du temps pour parvenir à la résilience.
C’est un court récit qui se lit facilement, écrit à la première personne avec un style simple et sans artifice. Le livre refermé, ce texte à été l’occasion pour moi, une nouvelle fois, de m’interroger une sur l’effet cathartique de l’écriture au regard des capacités de l’être humain de s’adapter aux bouleversements qui perturbent durablement sa vie .
-
Italiani
- Par hervegautier
- Le 20/11/2022
- Dans Tim Parks
- 0 commentaire
N°1695 – Novembre 2022
Italiani – Tim Parks – Bompiani.
Italiani – Tim Parks. Bompiani.
Ce livre a été publié en 1995 et parle évidement des Italiens et de l'Italie. L'auteur est Anglais, né à Manchester en 1954, et est tombé amoureux de ce pays mais aussi d'une italienne qu'il a épousée. Il s'intéresse à la culture de ce pays, à sa littérature, au point de traduire les œuvres de Moravia, de Tabucchi, de Calvino...
Pour l'heure il évoque pour nous cette petite ville de montagne et d'eau, Montaldo en Vénétie, à l'atmosphère particulière où les gens ne sont pas spécialement heureux d'avoir pour voisin un Anglais qui a épousé une italienne, qui y loue une maison et qui raconte son histoire sur une année, évoquant méticuleusement ce qu'il voit. Rien n'échappe à cet étranger transplanté ici et à son regard aigu et qui décrit une société bien différente de la sienne. Il le fait avec ironie et ses remarques et ses annotations sont pertinentes qui sont pour lui une occasion de réfléchir sur lui-même. La vie à Montaldo n'est ni meilleure ni pire qu'ailleurs et il décrit ce qu'il voit sans complaisance, le comparant à son propre pays. Il n'est évidemment pas insensible à la beauté et l’originalité de son pays d'adoption, mais ce qui le frappe ce sont ces "vices" qu'il dénonce que sont la bureaucratie, l'usage des pots de vin, la corruption du sud et les irrégularités du nord du pays, les atermoiements des partis politiques, la superposition du sacré et du profane, la superstition et les croyances populaires, la cohabitation de la légalité et de l'illégalité, l'art de vivre des Italiens, leur façon de conduire et de se conduire, les bars et le rituel du café, la mafia ainsi que toutes choses qui sont propres à un pays latin, bien différent du sien. Il a un regard pointu sur les gens qu'il côtoie, ses voisins, ou plutôt ses voisines, qui, même s'il ne leur demande rien, le comble de conseils, comme s'il venait d'une autre planète. C'est un peu la version italienne des "carnets du major Thompson".
Malgré tout cela, Tim, l'auteur anglais sera convaincu de pouvoir vivre ici, loin de chez lui et peut-être de devenir Tino, un vrai italien. Il faut croire qu'il y est parvenu puisque non seulement il s'y installé depuis 1981 mais en a même pris la nationalité, traduit les grands auteurs transalpins et donne des conférences dans le cadre de l'université de Milan sur la traduction littéraire.
J'ai lu ce roman en italien non seulement parce qu'il n'est pas encore, à ma connaissance, traduit en français et que c'est toujours agréable de découvrir un auteur inconnu, mais aussi, comme d'habitude pour la musicalité de la langue lue souvent à haute voix, pour le plaisir. Apparemment il a été écrit en anglais, sous le titre de "Italian neighbours" en 1992, traduit en italien par Rita Baldassarre, son épouse.
-
Crénom Baudelaire
- Par hervegautier
- Le 19/11/2022
- Dans Jean Teulé
- 0 commentaire
N°1693 – Novembre 2022
Crénom, Baudelaire – Jean Teulé
C’est avec ce titre bien loin de ce nous avons appris pendant nos études sur Baudelaire que Jean Teulé qui malheureusement vient de nous quitter, nous invite à suivre la biographie de celui à qui la poésie française doit tant. C’est sans doute un peu iconoclaste mais tellement dans le style jubilatoire et baroque de ce biographe qui bouscula à l’envi tout ce que des générations de potaches ont dû apprendre et ce qu’ils ont dû disserter en s’inspirant parfois gauchement des pages du « Lagarde et Michard ». C’était un révolté par nature et ce n’est pas le remariage de sa mère avec un officier supérieur futur sénateur qui le réconcilia avec le genre humain et aussi avec la discipline. En se remariant, sa mère qu’il avait idolâtrée, lui échappa ; sa future attitude envers les femmes prend à ce moment sans doute sa source. Ses relations avec elles sont autant de rapports scabreux aux accents érotiques mais aussi de syphilitiques comme ceux qu’il eut avec Jeanne Duval, à la fois muse et compagne lascive et qui n’ont d’égal que son appétence au hachisch et autres paradis artificiels, vecteurs de poèmes ou d’attitudes étranges. Jeanne ne fut pas la seule. Il était certes très conscient de sa valeur de poète, bien décidé aussi à s’inscrire en faux sur les habitudes quotidiennes de ses contemporains, parasite insolent et fantasque, il marqua son siècle mais pas uniquement avec son verbe et ses vers contempteurs voire provocateurs.
Charles était volontiers facétieux, excentrique, halluciné avec cette exceptionnelle certitude qui était la sienne d’être différent des autres et de porter autour de lui et sur l’espèce humaine en général un regard circulaire et circonspect et il n’accordait à l’argent qu’une valeur d’autant plus relative que son héritage paternel, qu’il dilapidait avec une grande régularité, était important et lui permertait de vivre une existence de dandy sublime et oisif mais aussi une vie tout entière tournée vers la poésie. Il y eut certes cette tutelle pour faire échec à sa prodigalité et lui imprimer une existence chiche et résignée. Il y eut, devant un Baudelaire baillant et rotant, ce jugement correctionnel pour offense à la morale et aux bonnes mœurs, suite à la publication des « Fleurs du mal » et qui amputa le recueil de six poèmes et transforma les juges en critiques littéraires ce qui ne leur a pas réussi puisque, nonobstant l’amende et autres détails ressortant du droit pénal, ils firent à leur auteur une publicité inattendue. Il y eut cette vie de bohème désargentée et libre qui consacra sa marginalité définitive de poète maudit. Il lui resta les chats et leur mystère, ses mots et leur voyage incertain et parfois hostiles, des femmes souvent amoureuses, languides mais attachées à lui, cette inattendue candidature à l’Académie française, la mort certaine et surtout théâtrale et révolutionnaire, des projets culturels aussi étonnants qu’impossibles à réaliser, des obsèques finalement fantastiques et uniques. Rien que des choses bizarres mais attestant de son amour du plaisir, dénigreur du monde, poète définitif et éternel marginal et grivois aux poches trouées.
Cette expression n’est que l’abréviation d’un juron blasphématoire qu’il prononça au sortir d’une église belge et, en ayant manqué une marche, il s’affala. Répétée à l’envi jusqu’à sa mort, elle est bien éloignée des vers sublimes et des sonnets de ce poète exceptionnel.
C’est une biographie romancée, bien éloignées de celle des manuels scolaires, légèrement surréaliste, pertinente et impertinente, sensuelle humoristique, savoureuse.
-
Exécution
- Par hervegautier
- Le 14/11/2022
- Dans Pascal Marmet
- 0 commentaire
N°1690 – Novembre 2022
Exécution – Pascal Marmet – M+NOIR..
Dans le garage en sous-sol du Palais de Justice de Paris, on a assassiné Me Fender, un ténor du barreau. Le vol n’est pas le mobile, les indices sont minces et le commandant Chanel, du « 36 quai des Orfèvres » est chargé de cette enquête qui, compte tenu de la personnalité perverse et sulfureuse de l’avocat d’affaires, fasciné par l’argent et par les femmes et plus particulièrement par le personnage d’Emma Bovary (les citations tirées du roman et mises en exergue de chaque chapitre ne sont pas là par hasard) , devient prioritaire mais s’annonce difficile. Son exécution a été particulièrement sordide et on a même pris soin de balader son cadavre avant de l’abandonner dans ce parking. L’homme était à la fois accroc au harcèlement sexuel de ses secrétaires successives, adepte du fétichisme et l’intérêt qu’il portait à ses conquêtes féminines tenait de la cruauté, de la violence et de l’imaginaire. Ces femmes ont toutes une grande importance dans cette affaire, qu’elles soient manipulées, ou volontaires et la vengeance peut constituer un parfait mobile. La liste de ceux (et de celles) qui auraient pu en vouloir à sa vie est plutôt longue et le contexte judiciaire et personnel très spécial. Cette enquête un peu compliquée se déroule aussi dans un contexte d’attentats terroristes islamistes et antisémites avec une dimension religieuse extrémiste et la pratique de rites sataniques et cartomanciens, ce qui complique quelque peu la tâche des enquêteurs.
Un peu par hasard, Chanel rencontre un jeune homme amnésique aux pouvoirs étranges et le recrute pour l’aider dans ses investigations. On adjoint aussi à son équipe une jeune stagiaire surdouée qui va bouleverser l’ambiance du « 36 » avec sa compétence, ses appuis, son intuition et peut-être faire changer la traditionnelle misogynie du commandant.
J’ai retrouvé avec plaisir le commandant François Chanel déjà croisé dans une précédente enquête (« Tiré à quatre épingles ») et je remercie l’auteur d’avoir favorisé cette nouvelle rencontre. Il me plaît bien ce policier qui se souvient de ses lointaines études de psychologie pour analyser les postures et propos de ses interlocuteurs et en déduire ce qu’il doit en penser. Il mène ses investigations avec compréhension et humanité dans une société hypocrite qui ne reconnaît que la notoriété et la richesse et dont une des règles est le rejet de l’autre, son exploitation voire son élimination. au détriment d’une morale qui en est de plus en plus absente. Il le fait avec méthode, avec cependant d’heureuses contributions professionnelles en essayant de ne pas trop se préoccuper de sa supérieur hiérarchique surnommée « Mlle Maigret » connue pour son côté « pète-sec ». Être sous les ordres d’une femme et de celle-ci en particulier, ne lui plaît en effet que très modérément.
J’ai apprécié le style fluide, agréable à lire bien dans le ton d’un thriller, l’architecture du roman aux multiples rebondissements qui tient en haleine le lecteur jusqu’à la fin, les précisions techniques et procédurales de la police, l’analyse psychologie des différents personnages et l’ambiance de ce roman.
-
Fuir l'Eden
- Par hervegautier
- Le 13/11/2022
- Dans Olivier Dorchamps
- 0 commentaire
N°1692 – Novembre 2022
Fuir l’Éden – Olivier Dorchamps – Finitude.
L’Éden-Tower est vraiment très mal nommée. C’est un type d’immeuble caractéristique des années 50/70 construit en béton, représentatif du style « Brutaliste » que viennent photographier les touristes et les spécialistes de l’architecture moderne dans cette banlieue cosmopolite de Londres, près d’une gare. C’est une sorte de monument historique si mal entretenu que rien n’y fonctionne correctement. C’est là que vit Adam, dix-sept ans, avec son père, un ouvrier écossais alcoolique et violent, appelé« l’autre », et sa petite sœur Lauren. La mère est déjà partie sous d’autres cieux avec un autre homme, abandonnant tout ce petit monde à sa misère et les deux enfants ne veulent qu’une chose, quitter cet enfer pour retrouver leur mère. Adam ne veut pas devenir dealer, ni violent non plus, comme c’est le quotidien des jeunes ici. Il s’attache à être pour sa petite sœur une sorte de mère de substitution, un rempart contre ce père indigne. Il travaille au supermarché du coin pour un salaire de misère, traîne avec ses copains, Ben, un somalien adepte du Street Art et Pav un Polonais. Il n’a jamais vraiment quitté son quartier, rêve de voir la mer et passe son temps a réfréner comme il peut son surplus de testostérone. Adam croise sur un quai de gare le regard d’Eva et ses intentions supposées suicidaires. Son sac à main qu’elle lui a bizarrement abandonné lui permet de retrouver son adresse puisqu’il en est tombé passionnément amoureux. Un peu par hasard, il se retrouve le lecteur improbable d’une vieille professeure de faculté aveugle qui peu à peu lui redonne confiance en lui et l’éveille à la littérature. Sa rencontre furtive avec Eva lui révèle que l’amour est aveugle, qu’elle est sans doute inaccessible, que c’est une fille riche qui vit dans un autre quartier plus huppé, au-delà de la voie ferrée qui sert de frontière à son quartier pouilleux, mais qui s’intéresse quand même à lui. Quand il prend enfin conscience de ce qu’il s’est réellement passé lors de leur rencontre à la gare et qu’on ne peut pas revenir en arrière, lui qui n’a jamais eu de chance fait face aux circonstances et fait un choix difficile mais courageux qui hypothèque tous ses espoirs. Ainsi, sans qu’il le sache, la silhouette d’Eva s’estompe et disparaît définitivement alors que cette jeune fille aurait pu lui permettre de fuir définitivement son destin de garçon malmené par la vie : une façon d’illustrer l’impossible amour de deux êtres que tout oppose et la certitude qu’on échappe rarement à son milieu. Une sorte de roman social à la Ken Loach qui se déroule sur huit ans, une autre facette de ce XXI° triomphant.
Le livre refermé me laisse une impression forte et surtout juste. Je n’ai pas vraiment aimé le style pourtant en vogue actuellement et bien dans le style du roman, en revanche j’ai apprécié cette histoire écrite à la première personne par Adam comme un témoignage teinté de désespoir et de déchirements. C’est un garçon bien, plein de bonne volonté et de générosité pour sa famille mais il ne pourra pas échapper à son destin. L’amour impossible, la poisse qui le poursuit et l’ambiance malsaine dans laquelle vit Adam le rendent sympathique et j’ai eu pour lui plus que de l’empathie puisque cet amour fou qui aurait pu l’aider à se sortir de cet enfer se dérobe à lui. Ce roman me paraît illustrer ce qu’est notre société actuellement, caractérisée par un « ascenseur social » dont on nous parle à l’envi, mais qui ne fonctionne pas comme il le devrait. Adam quittera certes l’enfer de l’Eden mais, tiraillé entre l’espoir et l’angoisse, restera malgré tout dans sa condition modeste, avec la fatalité qui pèse sur lui et qui sans doute ne le lâchera pas.
-
La conspiration du Caire
- Par hervegautier
- Le 10/11/2022
- Dans Tarik Saleh
- 0 commentaire
N°1691 – Novembre 2022
La conspiration du Caire – Un film de Tarik Saleh.
(Prix du scénario – Festival de Cannes 2022)
Adam, le fils d'un pêcheur pauvre et modeste pêcheur lui-même, est choisi pour aller étudier la théologie à la prestigieuse mosquée Al-Azhar du Caire, haut-lieu de l'Islam sunnite. Il a même obtenu une bourse pour cela; son avenir s'annonce donc sous les meilleurs auspices. Il craint que son père, veuf, ne s'oppose à ce départ, mais, à sa grande surprise l'homme l'accepte puisqu'il y voit la volonté de Dieu. Au moment où il fait sa rentrée, le grand Imam qui la dirige meurt subitement. Son influence est respectée, ses fatwas sont redoutées jusque dans le mode politique, et se pose alors la question de son remplacement. Or, dans le même temps, cet établissement est l'objet d'infiltrations des radicaux "frères musulmans" qui veulent imposer leur candidat. Si un tel événement arrivait ce serait la fin du rayonnement millénaire de cet éminent centre d’études de l'Islam qui est l'enjeu d'influences entre les pouvoirs temporel et spirituel qui dans ce pays sont intimement liés. Adam est un jeune homme naïf à la foi sincère qui est un peu perdu dans cette grande ville qu'il ne connaît pas et dans cette mosquée qui lui est étrangère, mais qui entend bien mener ses études sérieusement et dans le respect des préceptes de la religion. Il se lie d'amitié avec un autre étudiant qui est tué sous ses yeux dans l'enceinte de la mosquée dans le cadre de cette lutte pour le pouvoir et une enquête est ouverte par la "Sûreté de l’État". Parce qu'il vient de la campagne et qu'il n'a pas d'attache au Caire, un officier chargé de l'enquête le recrute et lui fait comprendre qu'il n'a pas le choix, son ami assassiné était un de ses informateurs. Il se retrouve donc malgré lui au centre de cette lutte pour le pouvoir et la police politique le charge d'infiltrer "Les frères musulmans" et de faire échouer leurs manœuvres. Il ne peut évidemment pas s'opposer au recrutement dont il fait l'objet. Il devient donc un espion, un simple pion dans des luttes politiques qui le dépassent et où il a beaucoup de mal à se positionner. Dans un univers qu'il découvre chaque jour, et à cent lieues de ce à quoi il s'attendait, il tente de survivre, écartelé qu'il est entre les différents courants de l'Islam, le respect des dogmes religieux, l’obéissance aux ordres, le devoir de survie, la volonté de revoir sa famille, le sacrifice de sa propre vie au service d'une cause dans laquelle il n'est rien.
Avec ce film, Tarik Saleh, réalisateur suédois d'origine égyptienne, signe une œuvre politico-religieuse haletante ou de suspense est entretenu jusqu'à la fin. Un film dur mais aussi un grand film, servi par des comédiens de talent (Fares Fares, Tawfeek Barhom) où ce cinéaste prend des risques en s'attaquant ainsi à un sujet sensible et actuel qui a pour centre l'Islam et le pouvoir politique égyptien. Ce film s'inscrit dans la démarche de Tarik Saleh (né en 1972) qui n’hésite pas à interroger notre société en général sur ce qui peut la déranger. Déjà, en 2017,avec "Le Caire confidentiel", film interdit en Égypte basé sur une histoire vraie, il avait dénoncé la corruption à la fois de la police mais aussi de la société égyptienne ce qui lui a valu une interdiction de séjour dans ce pays au point qu'il a dû tourner " la conspiration du Caire" à Istanbul.
-
le jeune homme
- Par hervegautier
- Le 05/11/2022
- Dans Annie ERNAUX
- 0 commentaire
N°1689 – Novembre 2022
Le jeune homme – Annie Ernaux – Gallimard.
L’amour, est un des moteurs de la création artistique et Annie Ernaux nous avoue d’emblée que la simple jouissance sexuelle provoque pour elle l’écriture. A un certain moment de sa vie (elle a 54 ans) où elle connaissait peut-être une période de « sécheresse » créative, elle reçoit une lettre d’un étudiant de Rouen (« A ») qui admire en elle l’écrivain et peut-être aussi la femme. Leur relation dure de 1994 à 1997 au point qu’elle confie n’avoir jamais connu une telle ferveur de la part de ses autres amants. Pourtant tout les sépare, l’argent, le milieu social, la notoriété mais cet épisode rouennais permet paradoxalement à Annie de retrouver ses origines modestes et de revivre sa période « bohème » étudiante qu’elle avait aimée. Cette vie commune prend rapidement des accents d’initiation réciproque, une première vraie relation, un défi ou une une rencontre passionnée pour lui, un retour vers son passé et une quête de sa jeunesse pour elle, d’ailleurs pas forcément toujours agréable par l’effet miroir que de telles images tirées du passé pouvaient avoir ! Pour Annie cette différence d’âge n’était pas une honte, au contraire, elle correspondait à une quête de sa jeunesse enfuie et à une façon de transgresser un certaine forme de morale bourgeoise en ressuscitant la « fille scandaleuse » qu’elle avait été. Elle avoue qu’elle a vécu cet épisode comme une expérience réussie, loin d’une véritable passion, mais aussi comme une renaissance vers l’écriture. Un livre un peu court cependant pour montrer que, à l’occasion de cette aventure autobiographique amoureuse, ce qui importe vraiment pour elle c’est l’écriture, sa véritable raison de vivre.
Ici elle confie avoir aimé un homme de trente ans son cadet et vécu avec lui. Au cours des générations précédentes, la relation entre un homme âgé et une femme plus jeune ne choquait personne et était même communément admise, quand l'inverse, pas forcément authentifiée par le mariage, suscitait parfois une réprobation gênée ou carrément un dramatique scandale, comme ce fut le cas pour Gabrielle Russier dans les années 60. Actuellement cette situation se révèle au grand jour et n'est plus comme auparavant soit réprouvée par une morale bien-pensante, soit cachée au nom d'on ne sait trop quoi. Même si une telle situation, d'ailleurs officialisée au plus haut sommet de l’État, peut susciter les quolibets, elle témoigne de l’évolution des mentalités.
Déjà, l'an passé et par dérision on annonçait que le prix Nobel de littérature avait été décerné... à Annie Ernaux (L'italien Tommaso Debenedetti, spécialiste des fausses nouvelles qu'il démentait ensuite, avait déjà signé un canular sur Twitter annonçant la distinction attribuée à Annie Ernaux alors que l'Académie suédoise l'avait en réalité décerné cette année-là au romancier tanzanien Adbulrasak Gurnah). C'était évidemment faux mais cette année c'est vrai. Elle est la 17° femme à recevoir ce prix prestigieux et les Lettres françaises sont une nouvelle fois consacrées à travers elle.J Je remarque que le jury suédois semble apprécier les écrivains français qui explorent leur mémoire personnelle dans leur œuvre puisqu’il a déjà distingué en 2014 Patrick Modiano qui a fait la même démarche créative.fait la même démarche créative.
On peut ne pas partager ses idées, mais elle les affirme avec conviction et constance. Elle ne fait pas partie de ces gens à qui une simple promotion fait perdre la tête et oublier leurs origines ou leur quotidien. Elle ne s'est pas contentée, tout au long de sa carrière littéraire, d’être une auteure à succès, elle n'a jamais fait mystère de ses modestes origines et en a même fait un des terreaux de sa créativité, tout comme elle a fait de sa personne et de sa vie la source de son inspiration, jusqu'au solipsisme. Elle a parlé des nombreuses facettes de sa propre vie, défrichant au passage les arcanes de la mémoire jusqu’à un trop grande facilité de confidences peut-être. On peut en penser ce qu'on veut mais après tout un écrivain puise dans sa vie sa propre œuvre créatrice ce qui est souvent l'occasion soit d' intéresser ses lecteurs soit parfois de les aider dans la leur.
-
Le dimanche des Rameaux
- Par hervegautier
- Le 04/11/2022
- Dans Claire Sainte-Soline
- 0 commentaire
N°1688 – Novembre 2022
Le dimanche des Rameaux - Claire Sainte-Soline - Grasset
L'actualité a tiré le petit village de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) de son anonymat et de sa torpeur à cause du dossier compliqué et controversé des "bassines", ces grandes retenues d'eau destinées à l'irrigation estivale des cultures. Sans vouloir prendre position sur ce qui semble vouloir être un catalyseur politique de la contestation, je me suis souvenu que ce nom a aussi été porté par une sainte inconnue du calendrier mais aussi par une femme de Lettres, malheureusement oubliée, Claire Sainte-Soline (1891-1967), de son vrai nom Nelly Fouillet, qui adopta pour pseudonyme le nom d'un village deux-sévrien proche de son lieu de naissance. Elle fut une scientifique doublement agrégée de physique-chimie et de sciences naturelles, chercheuse universitaire, conférencière mais également enseignante pour obéir à son père, instituteur. Elle enseigna notamment à Blois, à Grenoble, à Paris et également à Fès au Maroc.
En 1934, elle publia son premier roman "Journée" qui évoque un village poitevin, ce qui lui valut l'attention d'André Gide puis plus tard de François Nourissier et le Prix Minerva. Cet ouvrage sera le début d'une vingtaine de romans et de quatre nouvelles, œuvres publiées quasiment annuellement. Elle donna également des conférences dans le cadre de "l'université populaire"pendant son séjour à Niort. Son style lui valut des éloges des critiques littéraires de l'époque, elle manqua d'une voix le Prix Femina en 1957 (avec « La mort de Benjamin » publié chez Grasset), ce qui lui conféra une certaine notoriété et lui valut son siège, l'année suivante, au jury de ce même Prix. Elle fut également membre du jury du "Prix du roman populiste". Elle voyagea dans toute l'Europe, en Inde et au Japon et publia des récits de voyages ("Grèce", "Maroc"), un ouvrage de vulgarisation scientifique ("Petite physique pour les non physiciens") et la traduction d'un roman grec. Sa fille, Paulette Coquard qui naquit de son bref mariage avec l'artiste peintre Louis Coquard fut la première épouse de Pierre Moinot (1920-2007) romancier et académicien.
Son écriture, influencée par sa formation scientifique et de sa qualité d'enseignante, est précise, sobre, rigoureuse et rappelle le style des écrivains du XIX° siècle. Avec une certaine ironie, elle se révèle une observatrice attentive de l'espèce humaine, de son immoralité et de sa dureté. L'atmosphère de ses romans est sombre, lourde, les personnages sont souvent lâches et violents, parfois laissés pour compte, marqués par la révolte due à des fractures douloureuses que seul l'amour de la nature peut atténuer. Tout au long de sa vie et de son œuvre elle a fait montre d'un grand humanisme, d'un esprit libre frondeur voire anticonformiste (Elle déclara que « l’art est un guet-apens » et que, à ses yeux l’écrivain n’avait pas droit à plus de considération qu’un boulanger) , mais resta fondamentalement classique en refusant le "Nouveau Roman".
Son nom a été donné à une allée à Niort où elle est inhumée, l'école de Melleran où elle est née porte son nom mais il semblerait qu'à l'exception du "dimanche des rameaux" (Grasset) aucun de ses romans n'ait été réédité.
« Le dimanche des Rameaux » publié en 1952 et réédité en 1997 est, nonobstant son titre printanier, un ouvrage sombre qui met en scène Marie, la narratrice, une femme mariée à Lucien, un sculpteur raté en mal d'inspiration et de commandes, ce qui compromet la situation financière du ménage. Cela n'empêche pas son mari d'imposer sous le toit conjugal, Berthe, son modèle qui est aussi sa maîtresse et une autre femme, Caroline, une danseuse qu'il veut séduire. Mina, l’enfant du couple que Lucien frappe souvent, lutte contre une grave crise d’appendicite et ce mini-harem sur lequel règne Lucien se complète avec la présence d'Alice, la servante. En ce dimanche des Rameaux, Marie, après l’avoir longtemps supportée par amour pour Lucien mais aussi peut-être par fatalisme mais surtout en souffrances, prend conscience de sa situation matrimoniale désastreuse définitive face à ce tyran domestique mais trouve le courage d'ironiser sur cet échec. La décision qu'elle prend et qui est le résultat d’une longue réflexion en fait un roman très actuel dont l'action respecte la classique unité de temps puisqu'il se déroule en vingt-quatre heures. Notre auteure, dans un texte fort bien écrit et agréable à lire, mène une remarquable analyse psychologique de ses personnages et se révèle être une observatrice attentive de l’espèce humaine plus spécialement dans les relations du couple. Elle montre la soumission de Marie puis sa révolte, dépeint Lucien comme un être violent, paresseux, un pervers d’une solide mauvaise foi. Marcel Arland a salué ce roman comme "une double satire : une satire, la plus virulente, contre la monstrueuse tyrannie de l'homme, son égoïsme, son inconscience… mais une satire aussi, mêlée de pitié, contre la faiblesse de la femme et sa complaisance dans l'humiliation".
Les événements de Sainte-Soline n’ont rien à voir avec cette auteure mais il serait bon que ses œuvres se retrouvent dans les rayons des librairies et des bibliothèques pour une redécouverte.
-
le pasteur et ses ouailles
- Par hervegautier
- Le 28/10/2022
- Dans Andrea Camilleri
- 0 commentaire
N°1687 – Octobre 2022
Le pasteur et ses ouailles – Andrea Camilleri – Fayard.
Traduit de l’italien par Dominique Vittoz.
En Juillet 1945 on a tiré sur Mgr Peruzzo, l’évêque d’Agrigente (Sicile) qui en réchappa miraculeusement. Devant le mystère de cette agression une question restait entière : Qui a voulu tuer un homme d’Église plus engagé aux côtés des pauvres contre les grands propriétaires fonciers et le système latifundiaire que dans son rôle traditionnel de pasteur ? On évoqua une sombre vengeance personnelle d’un ex-délinquant devenu religieux du couvent de la Quisquina tout proche qui a toujours été un lieu marginal au regard des règles monastiques et dont la création remonte au XVII° siècle, l’ombre de la mafia ou du fascisme... Une enquête partisane d’un policier corrompu n’a pas, à l’époque, réussi à éclaircir cette affaire. Pourtant il semblerait que cette survie ne soit pas due uniquement aux prières de ses ouailles mais soit la conséquence directe d’un vœux quelque peu surréaliste de dix jeunes religieuses du diocèse.
Pour ce récit nous retrouvons Camilleri (1925-2019) dans un registre où on ne l’attend pas forcément, celui de l’historien, même s’il n’abandonne pas tout à fait son goût pour l’énigme. Oubliant pour un temps son emblématique commissaire Montalbano, il entreprend un travail d’historien mais aussi de méticuleux enquêteur, non pas tant sur la tentative de meurtre que sur la réalité des conséquences du vœux des dix jeunes cloîtrées. Devant une telle énigme il se pose une multitude de questions qu’il ne résout qu’avec des hypothèses où l’imagination le dispute à une solide recherche documentaire et dont il dit lui-même qu’elles ne sont pas étayées de preuves. Ce travail a au moins l’avantage d’étancher sa curiosité et son insatiable volonté d’expliquer ce mystère quelque peu mystique. Il met aussi en lumière d’intéressantes remarques sur le catholicisme et ses dogmes, comparé aux autres religions au regard du respect de la vie, du sacrifice personnel, de la charité. Ses remarques avisées sur l’espèce humaine sont d’une grande pertinence.
Il ne se départit pas de sa langue fleurie traditionnelle, vernaculaire et même quelque peu inventive qui a dû poser quelques difficultés au traducteur pour peu qu’il ne soit pas, comme lui, originaire de Sicile.
Comme toujours cela a été pour moi un bon moment de lecture.
-
Congo
- Par hervegautier
- Le 25/10/2022
- Dans Eric Vuillard
- 0 commentaire
N°1686 – Octobre 2022
Congo – Eric Vuillard – Actes sud.
Dans ce récit, Eric Vuillard remonte le temps et évoque la conférence de Berlin en 1884 où les occidentaux se partagent l’Afrique au nom sans doute de le supériorité de la race blanche. On crée donc l’État indépendant du Congo, façade trompeuse qui permet au roi des Belges Léopold II de s’approprier à tire personnel ces terres et surtout les richesses qui vont avec. Bien entendu, une telle entreprise ne va pas sans flagorneries par souci de reconnaissance mais surtout sans exactions, pillages et atrocités commises par des aventuriers avides de richesses et de célébrité qui sont au surplus couverts par l’impunité. Leurs noms, attachés le plus souvent à une anecdote bien souvent fausse, cachent des faits que l’histoire n’a pas retenu ou simplement voulu occulter pour ne maintenir qu’une sorte de légende lénifiante et trompeuse. Le seul nom de Congo qui sert de titre à ce court ouvrage est à la fois un territoire et un fleuve, un paradis transformé en enfer pour le seul bénéfice de quelques-uns.
Comme il en a l’habitude, notre auteur détricote l’histoire officielle, ici celle du colonialisme, énumère des faits, les appuie de preuves et suscite l’esprit critique de son lecteur qui sans doute ne s’attendait pas à de telles révélations tant elles sont abominables. Ce genre de période qui revient régulièrement dans l’histoire de l’humanité à l’occasion des bouleversements et des guerres dont les hommes sont friands, met en lumière une facette bien peu reluisante de l’espèce humaine dans ce qu’elle a de plus abject et que le rachète pas tous les Coluche et les abbé Pierre. Les hommes, jusqu’au plus haut sommet de l’État, sont bien plus sensibles à l’argent et au pouvoir qu’aux grandes et généreuses idées si hypocritement proclamées. L’auteur termine cette sordide énumération par une invocation à un Dieu à la fois muet et absent de tout cela, une sorte d’image mensongère pourtant admise et entretenue depuis des générations comme un recours, un espoir, une caution et surtout un prétexte accompagnant les pires choses humaines.
Le style de Vuillard est volontiers brut et sans complaisance derrière une ironie de bon aloi et lire un de ses ouvrages est toujours pour moi un bon moment passé en sa compagnie à cause de ce qu’il dit et de la façon dont il le dit.
-
La testa perduta di Damasceno Monteiro
- Par hervegautier
- Le 24/10/2022
- Dans Antonio Tabucchi
- 0 commentaire
N°1685 – Octobre 2022
La testa perduta di Damanesco Monteiro – Antonio Tabucchi - Feltrinelli.
(La tête perdue de Damanesco Monteiro)
Imaginez un gitan qui, le matin dans son camp de la banlieue de Porto, veut satisfaire un besoin naturel et tombe sur un cadavre sans tête. C'est Firmino, un obscur journaliste d'un journal à scandale de Lisbonne qui est envoyé pour enquêter sur cette affaire alors qu'il n'aime pas cette ville et est davantage préoccupé par l'écriture d'une thèse universitaire et aussi par sa copine. C'est le début de cette histoire policière où chaque court chapitre balade le lecteur dans la ville de Porto et évoque ses spécialités, notamment culinaires, que Firmino ne goûte pas forcément. Au cours de ses investigations le journaliste se trouve en contact avec des personnages originaux, le gitan qui a découvert le corps, Dona Rosa, la propriétaire décidément bien informée de l'hôtel où il loge, un serveur, un travesti prostitué qui tombe du ciel au bon moment et un avocat, Don Fernando, homme riche et cultivé, à la fois anarchiste et aristocrate, érudit et humaniste, obsédé par la norme juridique qui se consacre à la défense des pauvres et donc qui accepte de représenter la victime pour un procès à venir qui met en cause la police. Firmino et Don Fernando échangent ensemble des propos métaphysiques et littéraires et l'avocat se fera le chantre les beautés de Porto et de sa cuisine. Firmino mène ses investigations avec talent, et aussi pas mal de chance, avec comme fil d’Ariane un tee-shirt publicitaire, une tête repêchée dans le Douro qui s'avère être celle du cadavre, sur fond de trafic de drogue et d'exactions policières. Le journaliste, avec l’aide de l'avocat, révélera cette affaire dans son journal et s’appuiera sur l'opinion publique.
Ce livre est l'occasion d'une critique des dérives policières dans un pays pourtant démocratique, les tortures et les exactions impunies de la Garde nationale, le système judiciaire portugais. L'épilogue est peut-être un peu trop facile.
Ce roman a pour origine un fait réel, l’assassinat d'un jeune Portugais par la garde nationale et la dissimulation de son corps dans un parc public.
Antonio Tabucchi (1943-2012) était un personnage assez particulier. Italien d"origine, il s'est intéressé à la culture, à la société portugaises et aux textes de Pessoa qu'il a traduits au point de s' installer dans ce pays et d'écrire certains de ses romans dans cette langue. Cette attirance pour cette culture est assez originale, lui Italien, qu'on imagine volontiers expansif alors que l'âme portugaise est gouvernée en principe par la "Saudade" qui est une mélancolie atavique.
C'est un roman policier avec une dimension documentaire intéressante sur la société portugaise de l'époque et aussi sur des considérations personnelles sur les romans et la poésie.
Ce roman est traduit en français et publié par Christian Bourgois mais je l'ai lu en italien pour la beauté et la musicalité de cette langue cousine malheureusement si peu parlée en France
-
l'innocent
- Par hervegautier
- Le 21/10/2022
- Dans Louis Garrel
- 0 commentaire
L'innocent
Un film de Louis Garrel
C'est le 4° film réalisé par l'acteur-réalisateur Louis Garrel qui joue le rôle d'Abel, un fils que le remariage de sa mère, Sylvie (Anouk Grinberg) avec un taulard, Michel, ( Roschdy Zem) inquiète au point de pister ce dernier avec l'aide de sa meilleure amie, Clémence (Noéamie Merlant), persuadé qu'il est que son nouveau beau-père va replonger. C'est là un thème traditionnel que le cinéma et la littérature ont souvent exploité. On verra rapidement que Michel n'a pas renoncé à l'usage du mensonge quand elle s'est à nouveau laissée happer par le tourbillon du grand amour.
Ici Sylvie, qui anime un atelier de théâtre en prison tombe amoureuse de Michel au point de l'épouser, n'en est pas à son coup d'essai et c'est bien ce qui inquiète Abel. Ses doutes seront rapidement confirmés notamment quand Sylvie qui ,depuis son mariage, semble vivre sur une autre planète, prend avec Michel la gérance d'un magasin de fleurs. Abel dont les filatures grossières n'échappent pas à Michel finit par marcher dans le jeu de ce derniet et se fait expliquer son prochain projet : braquer un camion transportant du caviar. Bizarrement, alors qu'il se méfiait de Michel et semblait vouloir le bonheur de sa mère, Abel décide de participer à cette opération avec la complicité active de Clémence. Pourquoi après tout et le coup est monté avec Jean-Paul (Jean-Claude Pautot). Evidemment la chose tourne mal et ce qui semblait devoir n'être qu'une formalité se termine par un fiasco.
Dans ce genre de scénario l'épilogue est souvent dicté par la morale qui veut que les voyous sont démasqués comme c'est le cas ici, Michel, trahi par Jean-Paul, retournera en prison et Abel, pris par la police sera incarcéré à son tour. Louis Garrel veut-il nous dire qu'il ne faut faire confiance à personne, mais cela nous le savions déjà. La morale est donc sauve, même si le bref mariage de Sylvie se terminera par un divorce. On imagine d'ailleurs qu'elle est prête à recommencer avec un autre homme, prisonnier ou pas, faisant semblant d'oublier que le mariage est une loterie et qu'elle n'est apparemment pas chanceuse dans ce domaine. Seule Clémence semble s'en tirer, encore qu'on imagine mal le sort de la cargaison de caviar entreposée avec les pinguoins dans un local réfrigéré de l'aquarium où Michel et Sylvie travaillent. Ces deux là finissent par se marier mais Abel, à son tour, va passer quelques années en prison.
Je ne partage pas du tout l'avis dithyranbique de la critique qui voit ce film comme drôle. Je n'ai pas du tout cru à cette histoire mais je n'ai peut-être rien compris. Quant au titre du film, le conducteur du camion, peut-être?
-
Une sortie honorable
- Par hervegautier
- Le 20/10/2022
- Dans Eric Vuillard
- 0 commentaire
N°1684 – Octobre 2022
Une sortie honorable – Eric Vuillard – Acres sud.
Sous ce titre très classique et convenu, il s’agit rien moins que de sortir la France de la guerre coloniale perdue d’avance d’Indochine mais qui aura duré de 1946 à 1954. Ce pays riche servait surtout aux importants banquiers et industriels français à s’enrichir sur le dos des coolies exploités dans les plantations d’hévéas et des soldats venus des autres colonies de l’empire pour y mourir au combat. Cette « sortie honorable » était réclamée par des hommes politiques plus enclins à assurer leur avenir dans la valse des ministères dont la IV° république avait la spécialité, devant l’issue inévitable de cette guerre lointaine dont personne ne parlait vraiment dans l’opinion. Pourtant il fallait tenir le terrain face au Viêt-minh qui chaque jour avançait dans sa reconquête, face à des généraux incompétents plus soucieux de leur avancement ou des décorations qu’on épinglait sur leurs poitrines. Il fallait frapper un grand coup et ce fut la construction du camps retranché de Diên Biên Phu pour lequel on sacrifia cette vallée paisible et agricole, on brûla des récoltes, on déplaça des populations, une cuvette entourée de collines auxquelles on donna des prénoms de femme et bordée par la jungle où l’ennemi ne manqua pas de se retrancher et d’attaquer sans relâche jusqu’à l’encerclement complet. Sa victoire fut d’autant plus facilement acquise que le camp manquait de tout, qu’il fallait organiser une résistance économique, autant dire au rabais, malgré la livraison du matériel des américains et leur projet atomique inspiré par hiroshima. Cependant la défaite militaire avec ses morts n’en fut pas une pour tout le monde et spécialement pour les banquiers.
J’ai déjà lu avec plaisir et attention Eric Vuillard et son « Ordre du jour » où il dévoile les dessous de l’Anschluss. J’ai retrouvé ici la même plume incisive, le même humour subtil et les mêmes précisions documentaires détaillées, avec des portraits de personnages emblématiques et célèbres dont il bouscule la légende, se glissant même fictivement dans leur peau, bref tout ce que l’histoire officielle a pris soin de nous cacher ou d’oublier.
Malheureusement pour les Vietnamiens, ce n’était pas terminé.
Pertinent, impertinent et passionnant, comme toujours !
-
la pension Eva
- Par hervegautier
- Le 16/10/2022
- Dans Andrea Camilleri
- 0 commentaire
N°1682 – Octobre 2022
La pension Eva – Andrea Camilleri – Metaillé.
Traduit de l’italien par Serge Quadruppani.
Chez Camilleri, c’est un peu comme chez Simenon qui étaitt un de ses écrivains favoris, ils étaient tous les deux de célèbres auteurs de polars avec un commissaire de police emblématique, Maigret pour l’un, Montalbano pour l’autre, mais ils étaient aussi deux romanciers traditionnels . Ici Camilleri (1925-2019) nous emmène dans un port de Sicile dans les années 40 c’est à dire quand l’Italie, alliée des nazis , commence à subir des bombardements alliés. Nerè . Un petit garçon se demande ce que signifie ces allées et venues d’hommes qui fréquentent la belle maison voisine où il aperçoit des femmes nues. La pension Eva, tel est le nom de cet établissement, fera l’objet de ses interrogations naïves jusqu’à ce qu’il la visite lui-même à l’âge requis, comme une sorte d’apprentissage initiatique, comme une terre promise. Il commence par découvrir les femmes grâce à sa jolie cousine et à leurs jeux puérils puis évoque les pensionnaires de cet immeuble et leur bienveillance. Il n’oublie pas de les croquer ainsi que certains de leurs clients et cela donne des portraits baroques et des anecdotes truculentes. Puis la guerre suivra son cours avec son lot de bouleversements et de destructions, entre les plaisirs érotiques, l’odeur des sardines grillées et celle du sang, les sourires et les larmes... Mais, goguenard , l’auteur, en postface, précise que ce court roman ne doit pas être regardé comme autobiographique, même si le personnage principal porte un nom semblable au diminutif dont les amis et la famille de Camilleri l’affublaient.
Il ajoute en revanche que la pension Eva a effectivement existé et il mêle dans à cette fiction des moments de l’histoire de cette petite ville. Il a attendu un âge assez avancé (près de 80 ans) pour l’écrire, ce qui témoigne de sa volonté de sortir de son image traditionnelle créative et d’offrir à son lecteur un moment de lecture où la tendresse et la dérision se mêlent à un érotisme discret.
-
le baron de l'écluse
- Par hervegautier
- Le 10/10/2022
- Dans Georges Simenon
- 0 commentaire
N°1681 – Octobre 2022
Le baron de l’écluse ou la croisière du Potam – Simenon .
Dossin une sorte d’aventurier flambeur et parasite qui s’affuble du titre de baron, amarre son petit yacht près d’une écluse du canal de la Marne à la Saône en direction de la Côte d’Azur. Il n‘a plus d’essence et surtout plus un sou, manger devient une nécessité et le mandat télégraphique qu’il attend n’arrive toujours pas. Lola, celle qui l’accompagne, finit par le quitter.
Le titre de baron, son monocle et son yacht impressionnent les gens du coin mais pas Maria, la tenancière du café-épicerie qui trouve Dossin à son goût. Lui c’est un flambeur qui ne paie jamais ses dettes mais il hésite à profiter de Maria et à se fixer ici avec elle et changer de vie. Finalement, après quelques jours, le mandat attendu arrive, il paie sa note et part vers sa destination, avec quelques regrets quand même.
Simenon, ce n’est pas seulement les romans policiers où règne le commissaire Maigret, c’est aussi un romancier et un nouvelliste. Ici ces quelques pages parues en 1940 dans un hebdomadaire puis chez Gallimard en 1954 dans un recueil intitulé « Le bateau d’Emilie » ont inspiré Jean Delannoy qui en 1960 a mis en scène, dans un film éponyme en noir et blanc, une adaptation de Maurice Druon avec des extraordinaires dialogues de Michel Audiard, Micheline Presle et Jean Gabin. Ce dernier est toujours baron, désargenté et joueur invétéré mais chanceux et campe un aristocrate haut en couleur. Celui qui était capable, avec le même talent de jouer un flic ou un voyou, un noble ou un prolétaire, un notable ou un quidam, donne au personnage du « baron » une autre dimension.
-
7 minutes
- Par hervegautier
- Le 10/10/2022
- Dans Stefano Massini
- 0 commentaire
N°1680 – Octobre 2022
7 minutes – Comité d’usine – Stefano Massini – Éditions l’Arche
Traduit de l’italien par Pietro Puzziti.
L’histoire est simple et même banale tant de nos jours le monde du travail est souvent bousculé par ce genre d’injustices. Jugez plutôt. Les nouveaux actionnaires de l’usine textile Picard et Roche « restructurent » suivant un mot à la mode, ce qui signifie pour les deux cents ouvrières une plus grande productivité avec une augmentation du temps de travail, évidemment sans aucun gain salarial, condition « sine qua non » pour échapper au plan social, c’est à dire au licenciement. Chantage ordinaire et malheureusement trop fréquent ! Pour se faire la direction envisage de réduire la pause déjeuner, déjà fixée à 15 minutes, a seulement 7 minutes ! Les délégués du personnel s’y opposent mais, y a-t-il une autre solution pour ces femmes qui ont ici leur vie et leur famille et qui souhaitent surtout garder leur travail ? Une déléguée du personnelle parviendra-t-elle à faire admettre à ses collègues de travail la réalité illusoire de ce marché ? Cela peut paraître extravagant mais cet épisode est bel et bien tiré d’un fait réel et Stefano Massini s’en est inspiré pour créer cette courte pièce de théâtre, adaptée au cinéma par Michele Placido en 2016 et diffusé en France en 2017.
Je n’aime pas beaucoup faire des comparaisons entre créateurs, mais il y a du Ken Loach dans la démarche de Massini qui choisit comme ici de faire revivre pour nous un fait oublié du quotidien. Il l’a déjà fait sous la forme de l’écriture classique (« Le laidies football club ») comme il le fait aussi dans le cadre de « La Reppublica » et plus exactement dans sa chronique «L’ufficio raconti smarriti » (bureau des récits perdus) diffusée également sur internet.
-
Le laidies football club
- Par hervegautier
- Le 07/10/2022
- Dans Stefano Massini
- 0 commentaire
N°1679 – Octobre 2022
Le laidies football club – Stefano Massini – Éditions Globe
Prix Médicis essai – 2018
Traduit de l’italien par Nathalie Bauer.
Nous sommes en Angleterre en avril 1917 dans une usine de munitions et, à la pause-déjeuner une ouvrière se mit, délaissant son sandwich et Dieu sait pourquoi, à taper dans quelque chose de qui ressemblait à un ballon... et ses dix collègues de travail d’en faire autant. Le football féminin était né, mais officieusement seulement. Ce sport existait déjà, mais pour les hommes uniquement, mais là ils étaient tous à la guerre. Sauf que cette sphère dans laquelle ces onze femmes tapaient n’était rien d’autre qu’un prototype de bombe légère destinée à évaluer la trajectoire des projectiles meurtriers prévus pour exterminer l’ennemi. Par chance il n’explosa pas et résista même pendant une demi-heure et même les jours suivants aux coups de pied de ces dames. Elles étaient toutes filles, épouses et mères, dans la trentaine, et rapidement elles s’érigèrent en équipe, avec maillot, capitaine et nom, le » Ladies Football Club » était né, une véritable révolution qui ne fut pas du goût des supporters masculins. Cette année 1917 était vraiment celle des révolutions, l’entrée en guerre des USA, la création d’une nouvelle Russie et maintenant les Anglaises qui se mettaient à jouer au foot ! Il leur fallu pas mal de patience et d’insistances puisque les mâles, maris, pères, frères et patrons, considéraient ce sport comme essentiellement masculin… et il convenait qu’il le reste.
Certes il y avait la guerre et les femmes prenaient par obligation la place des hommes dans les usines, mais il ne fallait surtout pas que cette petite entorse dans les prérogatives masculines dégénère. Après tout, à l’époque, la place traditionnelle des femmes était au foyer, à faire des enfants et à les élever. Alors le sport, pensez donc ! Pourtant, à force de persévérance, les portes des stades ont fini par s’ouvrir pour elles et les matchs n’ont pas toujours été nuls et faciles, bien au contraire mais le public les adopta malgré les oppositions masculines et les critiques journalistiques. Stefano Massini en profite même pour brosser les portraits hauts en couleurs de ces onze femmes qui changèrent les mentalités, firent naître des vocations chez les petites filles et furent même copiées d’une manière assez inattendue et pas vraiment sportive parfois. Pourtant, de retour des champs de bataille, les hommes ont su faire entendre leur voix et récupérer leurs attributions sportives et ce football féminin fut interdit légalement. Il fallu attendre longtemps pour que cela change en Angleterre et ce n’est que ces dernières années que, en France, les femmes ont conquis leur place dans le football et en général dans le sport traditionnellement réservé aux hommes. C’est en tout cas une des marques de luttes pour la liberté de nos compagnes, ce qui est une très bonne chose, même si, dans ce sport, les femmes qui le pratiquent sont loin de gagner autant d’argent que les hommes.
C’est une plaisante histoire que l’auteur nous raconte ici, Il le fait avec un humour subtil et de bon aloi et, chose particulière, en vers. Ce sont certes des vers libres qui sont ici traduits (je ne connais pas les règles de la prosodie italienne) et il a également emprunté ce mode d’expression dans d’autres œuvres notamment « Les frères Lehman ». C’est là sa « marque de fabrique » et c’est original. C’est une écriture légère et donc facile à lire. Alors pourquoi s’en priver !
On peut se demander si l’auteur est spécialiste des faits historiques oubliés. J’aime beaucoup la langue italienne et j’ai l’habitude de me connecter sur le site de « La Reppublica » et spécialement sur celui de «L’ufficio raconti smariti » (bureau des récits perdus)... de Stefano Massini qui nous raconte en quelques mots des faits historiques oubliés et ainsi nous rafraîchit la mémoire, un peu comme dans ce livre. Ce n’est pas vraiment un roman, mais c’est un régal !
-
Le sixième enfant
- Par hervegautier
- Le 02/10/2022
- Dans Léoplod Legrand
- 0 commentaire
N°1678 – Octobre 2022
Le sixième enfant – Un film de Léopold Legrand.
Pour une femme dont l’instinct maternel est fort, ne pas pouvoir enfanter est un drame et quand la médecine s’est révélée impuissante et que le droit multiplie les conditions de l’adoption au point de la rendre impossible, faire appel à son imagination, même si elle contrevient à la loi, est tentant. C’est le thème de ce film qui met en scène un couple d’avocats dont l’épouse, Anna (Sara Giraudeau), a fait plusieurs fausses couches et dont Julien (Benjamin Lavernhe), commis d’office dans une procédure, rencontre Franck (Damien Bonnard), un délinquant marginal gitan qui, au terme de l’instance, lui offre un marché. Son épouse, Meriem (Judith Chemla) enceinte de son sixième enfant est déterminée, avec l’accord de son époux, à ne pas le garder parce qu’ils ne pourront pas l’élever, pour des raisons financières. Une transaction est donc mise sur pied, l’enfant à naître sera « vendu ». Cette offre est simple et Anna et Julien ne peuvent ignorer que la loi qualifie un tel acte de trafic d’êtres humains et évidemment le condamne mais, après pas mal d’hésitations, surtout de la part du mari, et qui mettent à mal l’équilibre du couple, ils prennent quand même la décision d’accepter.
C’est une intrigue déjà présente dans la littérature, notamment chez Maupassant et c’est aussi, de nos jours une chanson de Viktor Lazlo, Mais ce film est une adaptation du roman d’Alain Jaspard (« Pleurez des rivières » aux Éditions Héloïse d’Ormesson) où les personnages et les situations ne sont pas tout à fait les mêmes, les événements plus ramassés, mais le sujet est parfaitement identique, celui d’un drame sur fond de choc des cultures, celui d’une rencontre de deux couples qui n’avaient aucune chance de se croiser, l’un, bourgeois parisien qui vit dans les beaux quartiers et l’autre qui survit en banlieue sur une aire réservée aux gens du voyage, une famille jeune mais triste, sans enfant et une autre plus âgée, joyeuse et pleine de gamins, mais tellement pauvre qu’elle ne pourra même pas faire face à la venue d’une autre bouche à nourrir. Il y a cependant dans cette opposition une note de liberté que la précarité ne gomme pas.
On pouvait se douter de l’épilogue, même si une décision contraire de dernière minute de la part de Meriem pouvait encore intervenir et empêcher la réalisation du projet. En outre, lors des préparatifs de l’accouchement et au cours de celui-ci, Meriem, plus âgée, est présentée comme une primo parturiente, mensonge qui ne pouvait échapper au médecin et à la sage-femme qui en ont d’ailleurs fait le signalement. D’autre part, je comprends parfaitement la réaction du fils aîné du couple qui analyse simplement la situation de la famille et l’accepte. Être l’aîné dans un contexte familial difficile mûrit plus vite un enfant et lui fait prendre conscience des réalités en hypothéquant son enfance. Catholique fervente, Meriem ne peut accepter l’avortement, en revanche, j’ai un peu de mal à concevoir que les gens du voyage, très croyants et également très attachés à leurs enfants se résolvent à vendre l’un d’eux. La complicité de ces deux couples, et spécialement des femmes que tout oppose, est bouleversante. Il faut cependant espérer pour Anna, qui prend sur elle toute la responsabilité de cette terrible histoire, que, même s’il s’agit d’une fiction, le jury des Assises soit majoritairement composé de femmes qui, mieux que des hommes comprendront ce problème.
C’est un très beau film, tout en nuances et en finesse, d’ailleurs couronné de nombreux prix (Prix du Public, d’interprétation féminine, de la meilleure musique et du meilleur scénario), servi par des acteurs talentueux et authentiques qui interprètent magistralement et dans le ton juste cette partition difficile. Une façon aussi de nous faire réfléchir sur la famille, la destiné des nantis par rapport aux plus pauvres qui sont aussi des êtres humains.
Hervé GAUTIER
-
La treizième heure
- Par hervegautier
- Le 27/09/2022
- Dans Emmanuelle Bayamack-Tam
- 0 commentaire
N°1677 – Septembre 2022
La treizième heure – Emmanuelle Bayamack-Tam - POL
La treizième heure c’est une église, une secte un peu spéciale qui tire son nom d’un poème de Gérard de Nerval dont on récite les œuvres ainsi que celles de Rimbaud et de Baudelaire au cours des offices. Sa philosophie, d’inspiration chrétienne et humaniste est aussi féministe et son but est l’acceptation de soi mais ne refuse pas une certaine forme de « paradis artificiels » et les chansons contemporaines. La Treizième heure c’est aussi celle de la révélation, du triomphe des laissés pour compte, pauvres et opprimés. Tout cela est un peu délirant et utopique.
C’est Farah, 16 ans qui en parle le mieux et en détaille la catéchèse, les rituels et la doctrine. C’est normal puisqu’elle n’a connu que cela, a été élevée par Lenny, son père, et participe activement à la vie spirituelle et au prosélytisme de cette église qu’il a fondée et dont il est le chef spirituel. Il l’ a crée à la suite de la fuite de son grand amour, Hind qui l’a abandonné à la naissance de Farah..
Farah est née intersexuée, un fille qui a des attributs sexuels d’un garçon et qui est élevée par son père à la suite d’une histoire un peu compliquée avec une GPA grâce à Sophie, de fuite de sa mère, d’une filiation un peu mystérieuse et une famille qui ne l’est pas moins, ce qu’elle combat comme elle peut. Sa vie jusqu’à présent a été difficile, faite de non-dits et de mensonges, incompréhensions de la part de ses parents, ce qui l’éloigne petit à petit de Lenny, elle comprend ce qui a présidé à sa naissance et, alors que Lenny se consacre à son éducation, Hind choisit, après sa fuite de faire prévaloir le plaisir des sens d‘une manière débridée, mais je ne suis ps sûr qu’elle rencontre l’amour qui toujours semble lui échapper.
C’est une fiction en trois partie où chacun des protagonistes, le père, la mère et la fille, s’exprime et s’explique, la fille se faisant le témoin d’une transformation christique paternelle assez surprenante.
C’est un roman très contemporain qui prend en compte le bouleversement des identités et des genres, parle de la solitude, de la dépression, du manque d’amour, de l’hypocrisie de notre société, de l’éclatement de la cellule familiale, d’ une certaine quête effrénée du plaisir, de la solidarité entre les membres de cette église marginale, de l’impossible rattrapage du temps perdu, bref des thèmes très actuels. Le style est fluide, agréable et facile à lire et j’ai également apprécié les nombreuses références littéraires, mais j’avoue que j’ai été quelque peu gêné par la longueur de ce texte et j’ai même eu un peu de mal à entrer dans cette histoire lue cependant jusqu’à la fin. Malgré tout j’ai eu plaisir à rencontrer cette auteure connue par ailleurs sous le nom de Rebecca Lighieri.
Le livre refermé, ce long texte me laisse perplexe à cause de cette saga quelque peu déjantée, conclue par les regrets de Farah, son pardon pour l’abandon de sa mère et les fantasmes spirituels et suicidaires de son père, une manière pour elle de tourner volontairement la page de cette tranche de vie ou singularité et solitude se sont conjuguées dans le mensonge et le malheur et lui a volé son enfance, cette vie qui s’offre désormais à elle et qu’elle veut différente, loin de cette parenthèse