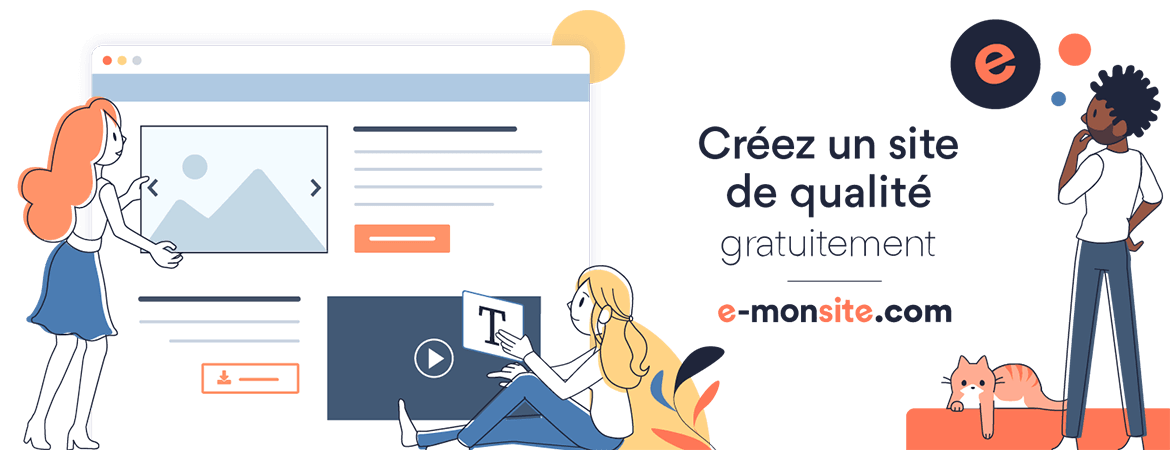Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
-
Petite histoire de La Rochelle - Jean-Louis Mahé
- Le 21/12/2025
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
La Feuille Volante - N° 2002 – Août 2025.
Petite histoire de La Rochelle -- Jean-Louis Mahé – La Geste.
La Rochelle, le nom de cette ville résonne dans la tête de chacun d’entre nous comme celui d’une cité exceptionnelle à la fois chargée d’histoire et désormais incontournable et pleine de mystères. Pour y être né et y avoir vécu mes années d’adolescence, je crois me souvenir qu’à cette époque, c’est à dire dans le première moitié du XX° siècle, cette ville n’’avait pas exactement cette aura culturelle et attractive qu’elle a actuellement, mais avait plutôt une dimension industrieuse et commerciale d’un port tourné vers le large. Cela dit quel que soit l’endroit où j’habite, je serai toujours, et définitivement, un « Rochelais ».
Les choses changent et c’est très bien et ce petit volume, forcément abrégé, refait l’histoire de ce petit village de pêcheurs devenu, au fil du temps, une cité prospère et même un « état dans l’État » que l’autorité de Louis XIII jugeait incompatible avec l’idée qu’il se faisait du pouvoir royal absolu. Ce fut le siège de la ville de 1627-1628 que l’Histoire a retenu avec l’ombre du cardinal de Richelieu et celle de Jean Guitton, les souffrances des Rochelais, la reddition puis le renouveau. Ce fut davantage une reconquête de la part de l’autorité royale qu’une véritable lutte des catholiques contre les protestants puisque dans ce conflit, les confessions n’étaient que secondaires. Historiquement, la ville fut d’ailleurs administrée alternativement par des maires des deux religions mais sous l’autorité du roi comme l’attestent les trois fleurs de lys présentes sur son écusson. Ce célèbre siège n’était pas le premier ce ne sera pas non plus le dernier et c’est l’apanage des villes d’exception que d’être ainsi convoitées.
Si on se réfère au Poitou on peut attribuer la création de la ville à la fée bâtisseuse Mélusine et ainsi donner à la cité une dimension à la fois merveilleuse et quasi divine. Sa devise, « Servabor retore deo », qu’on peut approximativement traduire par « Je serai sauvé par Dieu qui sera mon guide » donne aussi toute la dimension religieuse de ce qui a été son parcours historique, puisque la ville a été alternativement administrée par des catholiques te des protestants, par ailleurs adorateurs du même Dieu. Les églises et les temples qu’on peut y voir attestent d’un bel esprit de tolérance.
On l’a dite « Belle et rebelle » et ce ne sont pas là que des mots puisque les monuments et hôtels particuliers sont maintenant beaucoup plus attrayants qu’ils ne l’étaient du temps de ma jeunesse. Quant son côté rebelle, elle l’ a montré à différentes reprises et l’attitude de son maire, Léonce Vieljeux, face aux vainqueurs allemands en est une brillante illustration. Sa modernité actuelle n’est pas le moindre attrait de cette ville tournée vers la mer, vouée au commerce, à l’industrie et à la culture qui font sa richesse et son attrait
C’est donc un livre pédagogique avec des chapitres particuliers consacrés à des grandes figures rochelaises qui ont donné leur noms aux rues ou de grands moments ou mouvements qui ont émaillé son histoire.
-
Serge Gainsbourg
- Le 21/06/2021
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
Avril 1991
n°56
NON, CE N’EST PAS UN ÉNIÈME HOMMAGE A GAINSBOUG. – (A propos de l’article republié le 6 mars 1991 dans « Le Canard Enchaîné », article daté du 12 novembre 1958 et signé Boris Vian).
La Feuille Volante n’est pas un journal Elle ne rend pas compte de l’actualité. Pourtant, je ferai une exception puisque la mort de Gainsbourg nous concerne tous. Le personnage ne laissait pas indifférent. On avait pour lui de la sympathie, du dégoût, mais on avait un avis ! Le Canard Enchaîné publie un article daté de 1958 consacré à Gainsbourg (il avait trente ans) et signé Boris Vian.
Qu’y avait-il de commun entre le « Satrape » du collège de Pataphysique et ce chanteur « unanimement flingué par la critique de l’époque » ? (Ils s’étaient peu connus, mais beaucoup appréciés). Peut-être le goût de la musique, de la poésie, de cette marginalité littéraire si opportunément cultivée qui fait dire que la réussite ne sera jamais vraiment au rendez-vous ? Tous les deux ont fait du cinéma, du spectacle et Gainsbourg, on le sait moins était aussi romancier. La provocation cachait chez ses deux personnages une sensibilité exacerbée qu’ils camouflaient mal derrière l’homme public. Ils jouaient avec la vie tout en sachant mieux que personne qu’elle est éphémère et qu’il convient de la brûler aussi complètement que possible. Tous les deux étaient des « touche à tout » de génie, morts singulièrement de la même façon, ayant peut-être choisi, à l’instar du comédien qui quitta la scène, de tirer à un moment précis leur révérence au public (« Quand je veux » dit un personnage de Boris Vian), ayant peut-être, au fond de la poitrine ce nénuphar de Chloé dans l’écume des jours qui se nourrit de sa propre souffrance. Oui, chacun jouait à se faire peur avec pour enjeu cette mort que bizarrement ils avaient prévue, parce qu’ils portaient en eux ce qu’ils savaient pouvoir les emporter (« Je n’atteindrai pas 40 ans » avait prophétisé Vian, comme s’il savait que chaque note sortie de sa trompette était une mesure de plus pour sa propre symphonie funèbre)
Chacun d’eux avait quelque chose de rabelaisien et il convenait de briser l’os des apparences pour atteindre la substantifique moelle de la sensibilité. Tous les deux ont connu cette soif, mais surtout ce mal de vivre qu’ils ont combattu par le tabac, l’alcool… mais qui a donné cette œuvre qui ne peut sortir que du bouillonnement intérieur d’un écorché vif.
Pourtant une chose les sépare peut-être, c’est l’hommage populaire, toutes générations confondues. La disparition de Gainsbourg arrache des larmes à l’adolescent comme au retraité qui ainsi se retrouvent dans la perte de quelqu’un qu’ils aimaient. Pour lui les fleurs, mais surtout, témoignage dérisoire ou clin d’œil du destin des paquets de Gitanes, des cigarettes brisées, des bouteilles de whisky, des gens qui restent devant un mur ou un cercueil, en silence ou en chanson, en se disant qu’il est parti trop tôt et ne veulent pas y croire. « Quand je serai refroidi, ce qui me gène le plus sera de faire pleurer mes enfants » disait Serge ; Il n’y a pas que ses enfants qui ont pleuré ou plutôt si, puisque grâce à lui c’était un peu le gamin frondeur et contestataire qui dort en chacun de nous qui se réveillait et redevenait pour un moment joueur de billes, pilleur de troncs ou passionnément amoureux comme l’était Boris.
C’est vrai, c’est à chaque fois la même chose « Quand il est mort le poète … ». Ce qui compte le plus c’est l’hommage des gens, de ceux qui ne l’ont connu qu’à travers la presse, la télévision où il était parfois absent, mais maintenant qu’il est mort, il ne scandalisera plus, on n’aura plus à redouter ses écarts de langage ou de conduite qui mettaient si mal à l’aise les animateurs BCBG. Gainsbourg et Vian ont bien connu dame Censure !
C’est vrai que Serge n’échappe pas à la tradition qui veut qu’on dise surtout du bien des morts, même si ces mêmes louanges sont restées au fond des gorges de son vivant ! Heureusement, les média qui peuvent enfin parler que quelqu’un qui intéresse (et fait monter les ventes et l’indice d’écoute) car la Guerre du Golfe a mis quelque peu en exergue la pauvreté de l’information ces derniers temps !
« Ce qui restera ce sont ses chansons, je les fredonnerai toujours ! » a dit une vieille dame claudicante de retour du cimetière. C’est vrai que nous continuerons à fredonner « Le Poinçonneur des Lilas » de même que « Le déserteur » reste dans toutes les mémoires…
La chanson, vous avez dit « art mineur » ?
© H.G.
-
La Rochelle Années 1950
- Le 12/09/2020
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N° 1501- Septembre 2020.
La Rochelle, années 1950 – Photographies de Jean Gaillard présentées par Jean-Louis Mahé- Geste éditions.
Qu’est ce qui m’a fait acheter ce livre trouvé par hasard sur les rayonnages d’un libraire ? D’ordinaire la couverture de ceux qui sont consacrés à cette ville emblématique représente l’entrée du port, mais pas ici. Les photos qu’on y trouve sont celles des années 50 et j’ai sans doute espéré y croiser le regard de mes parents puisque c’est là que je suis né à peu près à cette époque…
La Rochelle est maintenant une cité connue de tous où il se passe toujours quelque chose mais, dans les années 50 ce n’était alors qu’une petite ville perdue sur le cadastre nationale, qui se relevait doucement de la guerre et de l’occupation allemande et pleurait son maire, Léonce Vieljeux, assassiné dans un camp nazi. J‘ai souvenir d’une ville un peu grise malgré les frondaisons du parc Charruyer et qui lentement changeait, avec de petits détails incrustés dans ma mémoire, la rue du Palais avec ses arcades que les Rochelais arpentaient, mais du seul côté allant de la Grosse Horloge à la place de Verdun. C’était un lieu de rendez-vous et si on voulait être vu ou rencontrer quelqu’un, c’était ici qu’il fallait être. L’été, l’unique plage de « la concurrence » accueillait la foule des baigneurs. Parfois pourtant on y tournait un film et on pouvait croiser Jean Gabin , Jean Claude Pascal ou Danièle Darrieux… Dans ma mémoire la place de Verdun c’était le parking des taxis, le kiosque à musique, l’agent de police qui face à la cathédrale réglait la circulation avec des gestes de sémaphore, la caserne Aufredi et ses militaires américains, le quai Duperré où des « photo-filmeurs » vous volaient votre image et vous la vendaient le lendemain pour quelques sous. Au « bassin des chalutiers » il y avait les bateaux de pêche qui partaient en haute mer pour des marées de quinze jours puis déchargeaient leurs cales à l’encan ; le poisson était trié puis expédié dans la France entière. Les sardiniers qui chaque soir accostaient près de la Tour de la chaîne vendaient leur poissons bleus aux marchandes de « sans sel » qui elles-mêmes les revendaient à grands cris dans les quartiers populaires ou sur le marché, les femmes en coiffes bigoudènes qui, sur le Cours des Dames, proposaient en silence leurs travaux d’aiguille, les voitures américaines qui semblaient glisser sur les pavés, les larges clous des passages pour piétons, les bus verts bringuebalants, les belles maisons du Mail, les baraquements insalubres de La ville-en-bois, Port-Neuf qui accueillait des HLM, les quartiers populaires, pauvres et sales comme Tasdon où habitaient mes grands-parents. Pour moi qui n’était qu’un gosse, la ville s’arrêtait là et le pont qui enjambait les voies ferrées près la gare était une véritable frontière que je passais toujours à pied. Mon plaisir était grand de le traverser quand une machine à vapeur l’inondait de son haleine d’ouate blanche. C’était la fête annuelle de la mer où, au large, on confiait aux flots des gerbes de fleurs en mémoire des marins péris en mer, la cavalcade avec ses chars de carton-pâte, ses batailles de confettis et ses fanfares de quartier, le port actif de La Pallice, ses usines, ses dockers, ses chantiers navals, ses bateaux venus des bancs de Terre-Neuve et du monde entier. D’ici on embarquait pour l’île de Ré qui n’était pas encore célèbre pour une brève traversée par le bac (il ne fallait pas manquer le dernier faute de passer la nuit sur l’île au retour) avec, au large, l’épave du « Champlain ».
Le port était aussi la destination de la course Plymouth-La Rochelle et les voiliers accostaient au « bassins des yachts », le port des Minimes n’existant pas encore. Je me souviens que plus tard, adolescent, il m’arrivait de me lever la nuit pour écouter longtemps, sur le Cours des Dames, la musique du vent dans l’accastillage métallique des bateaux de plaisance.
Tous les adultes qui figurent sur ces photos sont morts depuis longtemps et je n’ai reconnu personne, mes parents non plus n’ont pas croisé ce photographe qui n’a donc pas imprimé leur visage sur sa pellicule. Aujourd’hui, quand j’arpente les rues de cette ville maintenant presque méconnaissables par rapport à ces clichés, il y a toujours un peu de nostalgie, mais c’est toujours ma ville et je m’y sens chez moi, même si les choses ont changé et que je mesure ainsi le poids du temps et son inexorable cours.
-
Solo al vivo - Gianmaria Testa
- Le 27/12/2019
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°371– Octobre 2009
SOLO AL VIVO – Un disque de Gianmaria TESTA.
Décidément ces chanteurs italiens sont des enchanteurs.
Cette chronique s'est déjà fait l'écho de la poésie et des chansons de Paolo Conte, cette fois je ne manquerai pas l'occasion d'évoquer un auteur-compositeur-interprète que le hasard m'a permis de découvrir et dont le talent ne peut laisser indifférent d'autant qu'il a une parenté avec le crooneur piémontais, une parenté musicale et même physique. Sa rencontre à travers les chansons de ce disque constitue des moments précieux. Le personnage a quelque chose d'attachant, imaginez un chef de gare qui un jour choisit d'abandonner sa situation, ce qui est déjà extraordinaire parce que sous toutes les latitudes le Chemin de Fer est quelque chose d'autre qu'un simple métier et les cheminots des gens qui ont de leurs fonctions une certaine idée. Voilà, il a pris un jour sa décision , au lieu de voir chaque jour des gens monter dans des trains, il allait, grâce au son de sa voix et des accents de sa guitare, les faire voyager.
La langue italienne est déjà, à elle seule une musique et personnellement je n'aime rien tant que d'entendre parler des Italiens entre eux... même si je ne comprends pas ce qu'ils disent. Mais en plus, la voix de Testa a quelque chose de rocailleux, d'envoutant, peut-être parce qu'elle n'est pas mélodieuse, qu'elle est très mélancolique et un peu sourde comme voilée par un brouillard de montagne, parce qu'elle a des accents d'une authenticité un peu oubliée.
Ce disque est le septième dans sa discographie. C'est le résultat d'un concert en solo donné à l'auditorium de Rome, le 3 mai 2008, qui n'était pas destiné, à l'origine, à devenir un disque mais à la suite d'un miracle comme il s'en produit parfois, la complicité poétique qui s'est tissée entre le chanteur et son public, a transformé la vingtaine de morceaux tirés de ses précédents albums en moment d'exception.. On pourra en retenir le thème douloureux de la migration [Rital] ou celui du quotidien éphémère [Al mercato di porta Pallazzo ], mais chacun de ses textes de chanson qui sont autant de poèmes distille cette atmosphère où se conjuguent réel et imaginaire.
L'amour n'est pas absent de son répertoire, (comment pourrait-il en être autrement?)[come al cielo gli aeroplani], la sensibilité, la poésie délicate non plus qui tresse si belles images [« Et si jamais, comme par hasard, te cherchaient d'autres mains et d'autres mains dessinaient d'autres empreintes sur toi »]. Comme lui, l'univers des femmes et de l'amour qu'elles inspirent, parfois comme de simples passantes, qui croisent votre regard et disparaissent sans même se retourner, m'émeut.
Son côté poète me plait bien aussi parce qu'il sait que le temps passe, que la vie est un bref moment [« Oui la vie est un instant et nous passe sur les pieds et puis, tout devient souvenirs »], son aspect fragile, éphémère souligné par la simple conjugaison des mots à peine chantés et des arpèges de son instrument, comme une flamme qui vacille dans un courant d'air.
Les textes ont quelque chose de surréaliste, d'agréablement mystérieux qui pourtant ne m'est guère étranger.
Je lis sur le livret qui accompagne son disque que chacun de ses concerts s'accompagne d'un verre de vin et d'une cigarette. Enfin quelqu'un qui ne cache rien de ses envies, de ses origines populaires, pas un de ces intellectuels au discours abscons qui veulent être originaux et pour cela n'hésitent pas à jouer une comédie ridicule !
Et puis j'aime bien sa manière de vivre les choses « Les gens comme moi commencent par batailler tout seuls avec une guitare. Jusqu'à ce que le bois en perde son vernis et que les doigts se creusent de cordes- Ainsi avons -nous décidé, Paola et moi,de laisser une trace d'un jour de mai à Rome ». Je suis heureux d'avoir été au rendez-vous dont il parle, l'empreinte en reste vive!
©Hervé GAUTIER – Octobre 2009.http://hervegautier.e-monsite.com
-
Antisémite - Pascal Boniface
- Le 09/04/2018
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1234
ANTISÉMITE – Pascal Boniface – Max Milo Éditeur.
Être accusé d'antisémitisme en France n'est pas une chose anodine compte tenu de l'histoire de notre pays, de son combat en faveur de la liberté et des droits de l'homme, de son héritage des « Lumières », de sa traditionnelle vocation à recevoir et assimiler les étrangers désireux de devenir Français. Le cas des Juifs est un peu particulier puisqu'ils ont été pourchassés, accusés de tous les maux et même longtemps considérés par les catholiques comme le peuple déicide. Depuis 1948, date de la création de l’État d’Israël, la politique internationale et l'opinion publique ont évolué entre son soutien et sa condamnation au gré des événements. Pascal Boniface, universitaire, chercheur et directeur d'un centre de recherche géopolitique (IRIS), qui ne cache pas sa sensibilité de gauche et son appartenance au PS, n'échappe pas à ce phénomène et quand il rédige en 2001 une note pour le parti socialiste sur le conflit israélo-palestinien suivi d'un article dans « Le Monde », il assiste à un déchaînement médiatique qui le qualifie « d'antisémite ». Cette réaction lui paraît d'autant moins justifiée que critiquer le gouvernement d’Israël suffit à passer pour un antisémite et qu'il est un fervent adepte du débat, que toute sa vie, tous ses combats personnels sont en complète contradiction avec cette accusation. Ces écrits déchaînent les passions, réveillent les vielles querelles, troublent les certitudes les plus affirmées et portent préjudice à leur auteur qui ainsi cherche à se justifier par ce livre d'autant plus volontiers qu'il s'estime injustement accusé, qu'il n'a jamais été inquiété par la justice et qu'il mesure ainsi tout le poids de la solitude, de l'hypocrisie et de l'instinct grégaire d'autant plus actif qu'il vise à le détruire, lui et son centre de recherche. L'émotion a été grande à la publication de cet article, suivi d'un livre où notre auteur se demande si on peut « critiquer Israël ». Elle s'accompagna d'insultes, de critiques et même de menaces de mort qui caractérisent cette espèce humaine à laquelle nous appartenons tous et ce d'autant plus qu'il disait ce que beaucoup d'autres pensent mais n'ont pas l'opportunité et sûrement le courage de le verbaliser et que la société israélienne elle-même montre une diversité d'opinions sur le rapprochement avec les Palestiniens. La presse se déchaîna mettant en lumière la mauvaise foi, la désinformation, l'intolérance voire les erreurs volontaires des rédacteurs souvent inspirés par les organisations juives de France, mais des soutiens se manifestèrent également, illustrant le fait que ce problème est dans notre pays épidermique et de nature à réveiller les vielles idées reçues. Ainsi fut-il l'homme à abattre et il démissionna du PS.
J'avoue que je suis assez peu sensible aux essais politiques, mais je remercie Babelio et les éditions Max Milo de m'avoir fait parvenir cet ouvrage pour tenter de comprendre cette polémique qui, en France, a toujours un retentissement particulier. Je retiens une brillante analyse historico-politique de ce problème et je reconnais un certain courage à Pascal Boniface d'avoir ainsi pointé du doigt les positions contradictoires du PS sur le conflit israélo-palestinien rappelant notamment que si le peuple juif avait souffert de la Shoah, cela ne lui donnait pas pour autant droit d'opprimer les Palestiniens, que ces derniers avaient droit à un État au même titre que les Israéliens, que l'ONU, pourtant en charge de la paix mondiale et de la protection des populations civiles a toujours eu une position plus que tiède, acceptant d'intervenir en ex-Yougoslavie mais jamais en Israël et que les préoccupations électorales ne sont jamais loin des positions officielles d'un parti politique. La difficulté vient sans doute que sur ce sujet inflammable on mélange souvent antisémitisme et antisioniste mais notre auteur ne manque pas non plus de relever les nombreuses contradictions qui sont soulevées par ce problème dans le cadre de la démocratie française. Je dois dire que si l'antisémitisme n'est pas pour moi une découverte, je note que les contre-vérités ont la vie dure, surtout quand elles sont répétées à l'envi dans un contexte médiatique.
© Hervé GAUTIER – Avril 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
100 maisons - La cité des abeilles
- Le 04/11/2017
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1183
100 maisons – La cité des abeilles – Delphine Le Lay – Marion Boué – Alexis Horellou - DELCOURT
Nous sommes en 1950 à Quimper et la France se relève difficilement de la deuxième guerre mondiale. La crise du logement sévit et des familles s'entassent dans des maisons insalubres. Sur le modèle des « Castors » et d'une initiative semblable réalisée à Pessac (Gironde), une association est créée pour permettre aux ouvriers, après leur journée de travail, de participer à l'effort collectif de construction de logements modernes, la cité des abeilles, où chacun serait propriétaire. C'est une belle expérience de solidarité et de courage, née dans l’esprit de quelques militants catholiques et communistes, qui durera près de 4 années et que cette BD salue, pour le 60° anniversaire de sa création. Elle met en scène, dans un graphisme volontairement gris, deux familles, celle de Jeannette et Marie-Anne-Marie, deux sœurs qui habitent ensemble dans un taudis avec leur mari et leurs enfants. L'histoire n'occulte ni les tensions ni les difficultés nées du quotidien et du brassage social d'hommes aux convictions différentes. Elle est directement inspirée de l'expérience des grands-parents de Marion Boué qui ont eux-mêmes participé à cette aventure.
On ne peut que saluer cette initiative, cette mise en évidence de cette solidarité qui, aujourd'hui sans doute serait plus difficile à mettre en œuvre à cause de l'individualisme égoïste qui caractérise nos sociétés.
© Hervé GAUTIER – Novembre 2017. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Edward Hopper
- Le 17/10/2017
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 2 commentaires
La Feuille Volante n° 1177
Edward Hopper – Éditions Adam Biro
Cet ouvrage été réalisé à l'occasion d'une exposition sur le peintre américain Edward Hopper (1882-1967), qui a eu lieu au musée Catini à Marseille du 23 juin au 24 septembre 1989. Elle a ensuite été montrée à la Fondation March à Madrid. Comme il est normal dans un ouvrage collectif, de grands noms de la culture française l' ont éclairé de leurs commentaires .
La peinture américaine du début du XX° siècle, voulant se démarquer de son influence européenne et notamment celle de l’École de Paris , a développé un langage pictural original en explorant notamment l'expressionnisme abstrait. Dans le même temps le réalisme qui caractérise le style de Hopper s'est taillé une place privilégiée dans la peinture d'outre-atlantique au point d'y prendre une dimension mythique. Ainsi est retracé l'itinéraire de ce peintre qui, puisant son inspiration dans la lumière de Paris, dans l'impressionnisme et la peinture européenne, a modifié sa vision du monde et sa façon de le peindre. Avant, les tons étaient agressifs et sombres, hérités sans doute du puritanisme dans lequel il baignait ; après son séjour en France, sa palette s'est éclaircie, s'est libérée du carcan religieux et de ses interdits, a découvert les femmes, leurs corps, la nudité, l'érotisme, la vie ... Cette révélation ne le quittera plus. Il maniera la lumière, et son pendant les ombres, avec la même dextérité qu'il citait les poèmes de Verlaine pour séduire sa future épouse et ce séjour en Europe marquera son style au point qu'il mettra dix ans à s'en abstraire. Il conduira une évolution lente mais pérenne qui se révélera dans sa manière de représenter les paysages, les immeubles, parfois, encore marqués par l'architecture européenne, et d'y mettre des personnages.inspirés sans doute par les toiles de Degas. Cependant Hopper les traite à sa manière et quand il revient aux USA, il reprend son travail d'illustrateur et leur donne un aspect systématique et impersonnel qui accentue cette impression de solitude qui émane d'eux. Ce parti-pris est souligné par la technique de l'eau-forte plus sombre qu'il pratique également et qui tranche sur la lumière des aquarelles et des toiles de la même époque. Il choisit d'exprimer ainsi les angoisses et les hantises qui sont, selon lui, la caractéristique de l'espèce humaine. Jo, sa femme sera tout au long de sa carrière son unique modèle, ce qui renforce, par son unicité, cette sensation d'isolement ; Quand il représente des phares et des maisons, il le fait sur fond de ciels limpides et le paysage est souvent vide mais s'il décide d'y mettre des personnages, le plus souvent féminins, ces derniers sont étonnamment seuls. Sa peinture est en situation d'existence, en société et le plus souvent à la ville et dans des appartements et on peut, dans cette manière de s'exprimer ,voir le thème du deuil de quelque chose, du travail en plein air peut-être et quand il choisit de représenter quelqu'un, il agrémente cette représentation d'un rideau qui vole, d'un reflet sur une vitre ou d'une ombre sur un mur.
Hopper fit trois séjours en France de 1907 à 1910 et jusqu'à sa mort il resta francophile Il était certes l'héritier de Degas mais n'en reconnaît pas moins sa filiation avec des peintres réalistes américains tels de John Sloane ou Thomad Eakins mais refusa qu'on cantonnât son œuvre dans les « american scenes » à la manière de Hart Benson. Il était fasciné par la culture et l'art de vivre français et son époque parisienne fit découvrir les femmes, y compris d'ailleurs les prostituées des rues, au jeune protestant qu'il était alors et ce fut une révélation ; Il les croqua à la plume ou à l’aquarelle,. A son retour aux USA et dans sa période de maturité, il gardera pour elles cette posture attirante au point de se métamorphoser en véritable voyeur. De cette période française date également son goût pour la photographie. Il mettra du temps à s'extraire de cette influence parisienne pour s’affirmer dans un style spécifiquement américain. Cependant, nombre de ses toiles, et singulièrement la dernière qui le représente en Pierrot et Colombine avec Jo son épouse, sont d'inspiration européenne. Faisant référence à la fois à Watteau, à l’impressionnisme et à la commedia dell' arte.
Edward Hopper a donc été inspiré largement par la culture française et européenne avant de trouver son langage pictural original qui allait à l'encontre de l'art abstrait qui se développait en Amérique à cette époque..
© Hervé GAUTIER – Octobre 2017. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Edward Hopper au Grand Palais
- Le 15/10/2017
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1176
Edward Hopper au Grand Palais – Beaux Arts Éditions
Du 10 octobre 2012 au 28 janvier 2013 a eu lieu au Grand Palais à Paris une exposition de l’œuvre de peintre américain Edward Hopper (1882-1967), rétrospective importante, puisque sur la centaine de tableaux réalisés par l’artiste, 55 étaient exposés. Cet ouvrage s'ouvre sur les propos de Didier Ottinger, commissaire de l'exposition qui le présente comme un artiste mal connu. Il insiste notamment sur l'absence de mélancolie dans la plupart des toiles de Hopper. Le commissaire préfère voir en lui un rebelle, un résistant face à la société américaine de son temps et qui cristallise les angoisses de la civilisation dans quelle il vit qui, selon lui, a trahi ses idéaux d'origine. Il concède que Hopper est un peintre réaliste mais insiste sur son côté abstrait, lui-même motivé non par une vision de la réalité mais par une émotion humaine. Il choisit donc d'en montrer une vision décalée qui peut remettre en question l'idée traditionnelle qu'on se fait de cet artiste. Dans cet ouvrage, plusieurs intervenants livreront également leur vision du peintre.
J'avoue que, sans être spécialiste de Hopper, je ne le voyais pas exactement comme cela. Je le ressens comme un créateur paradoxale retirant à la fois peu de choses de ses séjours en France, mais affirmant, jusqu'à un âge avancé, son attachement aux impressionnistes français ainsi qu'à la poésie et ce malgré un style original conservé pendant toutes sa carrière américaine. Il était certes atteint par ce virus des voyages propre au Américains, qu'on peu déceler dans ses nombreuses représentations de routes, de voies de chemin de fer et d'hôtels mais il a choisi de représenter New-York, bizarrement vide de gens et de gratte-ciel, des maisons à l'architecture originale mais sans vie et la solitude du Cap Cod. Ses personnages comme ses paysages paraissent figés dans un isolement quelque peu malsain, mais il semblerait que, si certains de ses tableaux ont été influencés par la littérature de son temps, il n'en a pas moins imprimé sa marque au cinéma, celui d' Hitchcock notamment, et a l'ambiance des romans policiers où le malaise prévaut. En France, mais dans un autre registre, l’écrivain Philippe Besson ne fait pas mystère de l'attachement qui est le sien aux toiles de Hopper. Il est également présenté comme un peintre d'avant-garde alors qu'il s'est exprimé au moment où l'art abstrait se développait et combattait son parti-pris réaliste, lui-même refusant par ailleurs d'être mis en perspective avec Benson par exemple dont la préférence va à la représentation de scènes spécifiquement américaines.
L'espace urbain exerce sur Hopper une véritable fascination. Cela avait déjà commence lors de ses séjours parisiens mais, même dans ce registre, j'ai toujours ressenti une certaine solitude et un vide caractéristique. Il aimait certes New-York mais n'a pas négligé les maisons, parfois à l'architecture particulière, des localités petites et moyennes et le décor un peu désolé du Cap Cod. Même si elle n'est pas vraiment absente de ses tableaux, la nature n'y est représentée que secondairement et il n'y a pas chez lui de grands espaces qui sont la caractéristique de l'Amérique, à l'exception toutefois des scènes maritimes . Il était en effet particulièrement attaché au bord de mer et à son décor.
Il est également noté que, lorsqu'il représente un personnage, Hopper suscite une empathie chez le spectateur qui s'y identifie automatiquement et qui s'approprie sa mélancolie, communie à son silence, à ses préoccupations, à sa solitude et ce même si le peintre, par le truchement de sa toile, en fait un voyeur. Ce qui frappe aussi c'est la sensualité de sa palette. Non seulement il choisit de représenter majoritairement des femmes seules, souvent accompagnées de bagages, ce qui semble indiquer une fuite possible ou peut-être une aspiration vers plus de liberté, mais, le plus souvent, elles baignent dans une lumière chaude. Et douce En revanche, quand il évoque un couple, c'est une indifférence orageuse qui prévaut, à l'image sans doute de sa propre union avec Jo, son épouse.
Même si je ne partage pas toutes les analyses qui ont été faites dans cet ouvrage et tous les concepts qui ont été développés autour de son œuvre, j'ai retrouvé avec plaisir l'émotion personnelle que je ressens à chaque fois que je croise les œuvres de cet artiste à la fois intemporel et au talent si attachant.
© Hervé GAUTIER – Octobre 2017. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Edward Hopper
- Le 15/10/2017
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
La Feuille Volante n°1020– Mars 2016
Edward Hopper - Les 100 plus beaux chefs-d’œuvre – Rosalind Ormiston – Larousse.
Cet ouvrage richement documenté retrace la biographie d'Edward Hopper (1882-1967) qu'on retrouve dans tous les livres qui lui sont consacrés. Son originalité vient sans doute de la rétrospective effectuée par thèmes avec des illustrations.
C'est en France, lors de son premier séjour qu’il prend l'habitude de peindre en extérieur, à cause, selon lui, de la lumière parisienne, différente de ce qu'il avait connu jusque là. Quand il revient à New-York ce sont pour autant des scènes d'intérieur qui monopolisent sa palette où le spectateur joue, malgré lui, le rôle d'un indiscret. Le décor intérieur est pratiquement inexistant, soulignant l'impression de vide. Il reviendra cependant aux scènes extérieures à partir de son installation à Greenwich village, représentant des paysages urbains, les cafés notamment, avec la lumière du soleil sur les bâtiments. Je note que bien qu’ayant longtemps habité New-York, il n'a que très rarement représenté les gratte-ciel, préférant les immeubles de style victorien. Il développera ce thème lors de ses fréquents séjours au cap Cod, peignant des maisons basses et renouant avec son inspiration de jeunesse pour les bateaux, les bords de mer et les phares qui sont peut-être pour lui un symbole de liberté. Il y réside souvent au printemps ou en été, y fait construire une maison et favorise des vues de la campagne ou du littoral. Il voyagea beaucoup avec son épouse, notamment dans le sud et au Mexique d'où il rapportera des toiles et des aquarelles de paysages. Ses voyages ont suscité chez lui un thème particulier que sont les trains, les voies ferrées et les routes. Pourtant, si ce sujet peut être l'invite au départ, voire à la fuite, il n'en porte pas moins un message de solitude et de vide caractéristique de sa peinture. Il s’intéressera également à la vie moderne à travers toiles, aquarelles et aussi eaux-fortes mais il se dégage toujours des personnages qu'il choisit de représenter une sorte de morosité et d'ennui. Architecturalement, il représente ce qu'il voit, c'est à dire un décor essentiellement américain, mais les maisons qu'il donne à voir sont souvent vides et très rarement complétées par une représentation humaine.
Il peint des nus féminins, souvent dans le huis-clos d'une chambre, mais ces tableaux n'ont rien d'érotique et cela tient sans doute à son éducation puritaine. Son épouse sera d’ailleurs son seul modèle pendant toute sa vie. Quand il représente des femmes, habillées ou non, elles souvent seules, peut-être dans l'attente de quelqu’un ou de quelque chose, actrices d'un récit inachevé… Les hommes seuls sont plus rarement représentés, quant aux couples, il s'en dégage une atmosphère pesante qui était sans doute l'image de celui qu'Edward formait avec Joséphine, son épouse. Quand Hopper choisit de peindre des groupes de personnes, on sent imperceptiblement qu'il exprime surtout la distance qui existe entre eux.
Il s'intéressera, notamment à partir de 1942 et de son tableau «Les oiseaux de nuit » (son préféré, à la vie nocturne mais vue à travers des fenêtres ou des devantures de cafés, avec une sorte de tendance marquée pour le voyeurisme. On a déjà souligné que ses toiles tiennent beaucoup de l'instantané photographique ( Il semblerait d’ailleurs que Hopper ait beaucoup travaillé à partir de photographies) mais elles distillent cependant une lourde sensation de solitude et de vide bien qu'elles représentent des paysages urbains qu'on s'attendrait à voir peuplés de gens et de mouvement.
L'étonnant est que Edward Hopper ait traversé, sans les assimiler et sans qu'elles ait laissé la moindre trace sur sa façon de peindre, les périodes de la peinture expressionniste abstraite, du cubisme et du pop'art. Seul impressionnisme français l'a un temps inspiré, sans oublier le réalisme de Courbet, de Rembrandt et la pratique de son métier de d'illustrateur de magazines (activité alimentaire qu'il détestait cependant). Après avoir recherché le succès, il se présenta enfin, faisant de lui un artiste reconnu, emblématique de la peinture réaliste américaine. Son influence sera cependant déterminante sur les peintres américains tels que Andrew Wyeth (1917-2009) ou Eric Fischl notamment. On sait aussi que le cinéaste Alfred Hitchcok (1899-1980) s'inspira de certains de ses tableaux (notamment de « Maison près de la voie ferrée » dans son célèbre thriller « Psychose »). A titre personnel, je note également que l’écrivain français Philippe Besson fait souvent référence à Edward Hopper dans son œuvre et notamment dans son roman « L'arrière saison » [La Feuille Volante n° 604 -Décembre 2012] où il s’inspire du tableau intitulé « Les oiseaux de nuit ».
Pour autant, le mystère qui entoure son œuvre austère, simple et surtout figurative et réaliste, invite à l'interprétation toujours difficile et ce d'autant plus que Hopper était un adepte de Baudelaire qui privilégiait la « vision intérieure », issue de l'imagination. Ses séjours en Europe et l'étude qu'il fit de ses peintres ne sont pas étrangers à son style original. Cet ouvrage abondamment documenté et très pédagogique apporte un éclairage intéressant sur l’œuvre d'Edward Hopper que personnellement je ne me lasse pas de découvrir.
© Hervé GAUTIER – Mars 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
Edward Hopper
- Le 15/10/2017
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
La Feuille Volante n°1019– Mars 2016
Edward Hopper - Gerry Souter – Parkstone international.
Traduit de l’américain par Aline Jorand.
Je ne sais pas pourquoi, moi qui ne suis pas spécialiste de la peinture en général, et de la peinture américaine en particulier, je ressens pour Edward Hopper (1882-1967) une véritable fasciation. Aussi bien quand je découvre un livre qui lui est consacré, je ne manque pas de le lire avec intérêt.
L'auteur le présente à travers sa biographie, insistant sur ses origines modestes et sur le rôle de ses parents, de sa mère surtout qui a su favoriser sa vocation artistique. Son éducation a été fortement marquée par les femmes (sa mère et sa grand-mère) et cela se retrouvera dans son œuvre. Il note que son éducation victorienne complétée par une empreinte puritaine et religieuse (son arrière-grand-père, le révérend Griffiths a fondé l'église baptiste de la petite ville de Nyack (État de New York) où il est né – Edward ira à l'école privée) qui prône une vie austère, recommande de s'éloigner des plaisirs de la sexualité et des comportements immoraux. Cela développera une timidité naturelle qui, bizarrement, sera contrebalancée par un réel sens de l'humour. Cette formation ne sera pas sans influencer sa peinture et quand il représente des femmes, même si elles sont nues, il n'y a pas de dimension érotique. Je note également que après son mariage avec Joséphine, celle-ci sera son unique modèle. Dans certaine de ses toiles, surtout celles où il représente des chambres ou des bureaux il y a cependant une sorte de voyeurisme.
S'il a fréquenté des écoles de dessins, et notamment la New York School of Art, s'il s'est perfectionné par l'étude des impressionnistes français présents dans les musées américains et en France même où il fit trois séjours, il commença son apprentissage en copiant de façon empirique, très jeune, des couvertures de magazines. Ses séjours à Paris ne se confondent d'ailleurs pas avec la vie de bohème qu'on peut imaginer chez un jeune peintre et il en rapporte nombre de tableaux dans la manière impressionniste qui n'apparaissent malheureusement pas dans les illustrations de cet ouvrage.
Ce que je retiens ce sont les débuts difficiles de Hopper et toute sa vie sera rythmée par l’alternance du succès et de l'échec, l'obligation de gagner sa vie comme illustrateur, ainsi que de la sécheresse artistique passagère ce qui ne sera pas sans influencer son équilibre personnel. Il sera en effet souvent sujet à la dépression. A partir de 1923 cependant, date à laquelle il rencontre Joséphine qui va devenir son épouse, la chance semble lui sourire et, petit à petit, il devient un peintre connu et reconnu. Pourtant sa vie sentimentale sera des plus agitée, émaillées par de violentes disputes avec sa femme qui pourtant choisira de mettre sa carrière artistique personnelle entre parenthèses mais en ressentira une sorte de complexe d'infériorité. Edward semble ne pas avoir été heureux en ménage et il en concevra une profonde solitude qui ressort sur la plupart de ses toiles, notamment au niveau des personnages et des paysages. Les époux voyageront pourtant souvent ensemble, notamment au Mexique mais cet ouvrage ne publie aucune des toiles réalisées dans ce pays. Ils achèteront une maison au cap Cod et Edward renouera alors avec l'inspiration de la mer et des bateaux qui avait été la sienne, très jeune, à Nyack quand il fréquentait les chantiers navals et le « Boys Yacht Club ». Ce thème du voyage, incarné par les bateaux, les trains et les routes me semble également dénoter une sorte de volonté de départ, de fuite, l'envie d'un ailleurs qu'on ose cependant pas pas tenter. Les phares auront aussi une grande influence sur sa peinture.
Il affectionne également les paysages urbains, les trains ou les maisons isolées mais je note que s'il vécu et travaillé à New York, il ne représenta que peu de gratte-ciel pour se concentrer plutôt sur les maisons de style victorien avec toujours, peu ou prou, cette impression de solitude, de vide, d'attente de quelque chose qui n'arrivera peut-être pas. Cette idée d'isolement persiste même si le tableau représente un groupe de personnages et se retrouvera dans les oeuvres qu'il consacrera aux salles de théâtres ou de cinéma, aux chambres ou aux halls d’hôtels. Je ne suis pas spécialiste de ce peintre mais je ressens sa peinture comme une activité de compensation face à une vie qu'il supporte plus qu'il ne l'apprécie. Sa dernière toile, « deux comédiens », semble vouloir nous dire qu'il a fait son parcours aux côtés de son épouse, comme s'il avait joué un rôle, grimé en acteur, et trouvé dans celui-ci une raison d'exister.
Hopper est un peintre figuratif qui n'a guère changé de style. Il a du également lutter contre l'expressionniste abstrait très en vogue à son époque mais son style n'a jamais vraiment varié si on excepte sa période impressionniste.
Cet ouvrage complète l'étude entamée depuis de nombreuses années sur ce peintre emblématique américain. Il m'a prêté un bon moment de lecture.
© Hervé GAUTIER – Mars 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
Quelques mots sur Edward Hopper
- Le 15/10/2017
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
L A F E U I L L E V O L A N T E
La Feuille Volante est une revue littéraire créée en 1980. Elle n’a pas de prix, sa diffusion est gratuite,
elle voyage dans la correspondance privée et maintenant sur Internet.
-
N°607– Décembre 2012.
Quelques mots du Edward Hopper (1882-1967).
Pour moi, au départ, un tableau emblématique et connu à force d'être présenté quand on évoque la peinture américaine (Noctambules, 1942. The art institute of Chicago), l'annonce d'une rétrospective à Paris au Grand Palais d'Edward Hopper qu'on présente comme un célèbre artiste d'outre-atlantique, un article dans une revue littéraire (Le Magazine Littéraire n°525 de novembre 2012) sous la plume de Philippe Besson, un roman (L'arrière-saison, du même auteur) qui évoque ce tableau et qui m'a passionné (La Feuille Volante n°604), m'ont donné envie d'en savoir davantage et d'entrer dans l'univers de ce peintre.
Qui était donc ce jeune homme de 25 ans qui est venu à Paris étudier l' impressionnisme qui était à la mode, simplement parce que sa vocation est d'être peintre ? Pourtant la peinture américaine n'existe pas encore vraiment (Norman Rockwell – 1894-1978 en fera aussi partie) et la famille dans laquelle il est né est celle de modestes commerçants d'une petite ville de l'état de New-York . Il aime l'ambiance de la Capitale, le Quartier Latin, les jardins publics, les avenues, les musées et la littérature et la poésie aussi. La France, à l'époque, est le centre du monde culturel et un artiste se doit d'y être.
Comme chaque peintre débutant il s'inspire de ceux qu'il reconnaît comme ses maîtres au premier rang desquels figurent Edgar Degas, Pissaro, Renoir, Sisley et bien entendu finit par trouver son propre style. Il y a certes l'influence française qui l'amène à peindre des scènes de la vie parisienne comme la Seine et le Louvre mais il s'intéresse aussi à la photographie et devient francophile et francophone. Il voyage également en Europe, notamment aux Pays-Bas où les maître néerlandais (Veermer et Rembrand etre autre) le passionnent. Quand il rentre aux États-Unis il devient illustrateur, produisant des affiches, des gravures, des eaux-fortes et des aquarelles, mais assez peu d'huiles sur toile. Ce n'est que vers l'entre-deux-guerres qu'il commence à être connu pour son style réaliste et ses paysages américains Le succès est au rendez-vous et il s’installe avec son épouse au cap Cod dans l'état du Massachusetts. L'année 1925 le consacre en tant que peintre et ses toiles entrent dans les musées, notamment au Museum of Modern Art et au Withney Museum Américan Art.
De son séjour en France, il ne retient pas l'influence cubiste mais lui préfère le réalisme de Jean-François Millet et de Gustave Courbet. Ce sera en effet une des grandes tendances de son œuvre caractérisée par de larges aplats de couleurs souvent contrastées et des compositions fortement structurées. Pourtant l'article de Besson m'apporte des précisions. Le réalisme de Hopper « n'est qu'apparent et les apparences, comme chacun le sait sont trompeuses : ce sera sa signature ». Il semblerait en effet qu'Hopper ait souffert d'un sévère problème d'audition ce qui expliquerait, plus sans doute qu'une mésentente conjugale souvent évoquée, l'ambiance qui émane de ses tableaux
Ses origines américaines l'influencent peu à peu et, délaissant l’impressionnisme comme il le fera plus tard de la peinture abstraite, il s'oriente vers les paysages ruraux de Nouvelle-Angleterre et du cap Cod, privilégiant la représentation des bâtiments urbains, qu'ils appartiennent aux villes moyennes américaines ou à New-York. Il faut également noter que s'il choisit d'évoquer la modernité par la représentation des routes, voies ferrées et des ponts, il néglige totalement les paysages industriels bien qu'ils soient une composante importante des États-Unis. Il leur préfère la vie quotidienne des classes moyennes, témoignant ainsi d'une sorte d'ambiance immobile et parfois même nostalgique d'un pays qui naguère était riche et puissant et qui peu à peu voit son importance s'amoindrir notamment au moment de la grande dépression.
Au départ de son œuvre, il n'était pas portraitiste mais au début des années 30, les personnages, et spécialement les femmes, peuplent ses tableaux. Il poursuivra cette inspiration en donnant de plus en plus de place aux individus, leur instillant une sorte de présence grandissante mais avec une sorte de sentiment de solitude par un effet de juxtaposition. L'expression des visages où peut facilement se lire l'ennui né de l'attente, complète cette ambiance et le dépouillement du décor autour d'eux les transforment en individus anonymes dénués de toute émotion, presque en retrait, perdus dans leurs pensées ou simplement fatigués, impassibles comme s'ils portaient en eux une histoire individuelle impossible à raconter mais cependant dramatique. Ils semblent marqués par une véritable mélancolie voire du sceau de l'incommunicabilité. Le spectateur a facilement l’impression que dans ses œuvres, le temps est comme suspendu avec peut-être une idée sous-jacente d'un certain « paradis-perdu » qui ferait naître un spleen. Dans ces tableaux, les lignes sont épurées, le mobilier réduit à sa plus simple expression ou simplement absent, les paysages de campagne semblent baignés dans une sorte de langueur...Hopper sera en également largement inspiré par la photographie et par le cinéma qui exerceront une influence indéniable sur son œuvre. On peut se rappeler opportunément qu'il a aussi été illustrateur au cours de sa carrière.
Il décédera en 1967 à New-York où il avait son atelier.
Je reviens à cet article de Philippe Besson qui note que Hopper c'est la douceur mais il précise aussitôt qu'il y a chez ce peintre « une hésitation permanente entre douceur et danger ». Je retiens pour ma part un réalisme caractéristique qui fait l’originalité d'Edward Hopper et qui inspirera beaucoup d'autres artistes américains.
©Hervé GAUTIER – Décembre 2012.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LETTRES A MA MERE
- Le 25/10/2015
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°976– Octobre 2015
LETTRES A MA MERE – Présentées par Didier Lett - Le Robert.
Les relations que les enfants ont avec leur mère sont complexes. Cette femme leur a certes donné la vie mais les véritables liens se tissent entre eux au cours de leur existence en fonction des choix opérés, de l'éducation, de la place de chacun au sein de la famille, des préférences affichées ... Bien entendu, ils sont différents en fonction du sexe des enfants, de leur sensibilité, de l'attitude des parents. Les différentes civilisations ont mis en exergue ces liens. Il y a sur ce sujet tout une littérature abondante, d'ailleurs contradictoire, présentant la mère soit comme un être qui se sacrifie pour ses enfants soit un monstre d’égoïsme qui au contraire ne pense qu'à ses intérêt au détriment de sa propre famille. La mère est un personnage qui a été souvent idéalisé mais abusive, aimante, directive ou possessive, ce sont là bien souvent des qualificatifs qui s'attachent à cette mère qui inspirent à ses enfants de l'amour autant que de la haine. Les termes de ces correspondances filiales en font foi, soit touchants et tendres, soit formels, pleines de rancœurs, de reproches ou d'incompréhensions. Elles sont le reflet de la vie et de ces liens familiaux difficiles ou passionnés. Correspondances de gens célèbres ou de quidams, lettres ordinaires ou de guerre, quand la mort menace, qu'on attend une consolation pour un déboire amoureux ou un deuil, qu'on demande des conseils, de l'argent, des encouragements ou qu'on y exprime ses regrets de l'enfance, c'est souvent à sa mère qu'un enfant s'adresse[dans ce choix de Didier Lett, le père est souvent mort prématurément]. Les échanges épistolaires entre mère et fille adolescente sont parfois durs et marquent ainsi la différence de génération, mais quand les combats font rage et que la mort rôde pour les soldats, c'est bien souvent leur mère qu'ils appellent. Malgré des liens familiaux difficiles, les enfants remercient souvent leur mère pour ce qu'elle a été, pour l'éducation, l'exemple et l’amour qu'elle leur a donné.
Les lettres que Didier Lett a colligées sont majoritairement écrites à leur mère par des fils ayant atteint un certain âge, rares sont celles qui émanent d'une fille ou plus rares encore, celles écrites par une mère à son enfant. Ce choix est révélateur puisqu'on a toujours privilégié dans l'histoire épistolaire les lettres masculines et d'adultes au détriment de celles des femmes, des filles et des jeunes enfants. Ces lettres sont aussi principalement récentes mais certaines autres, plus anciennes, permettent de se faire une idée des mœurs, des croyances, du mode de vie, des relations familiales, de la culture de leur époque, c'est une véritable chronique vivante. Il y est souvent question de séparation entre une mère et sa fille, éloignée d'elle par le mariage comme chez Mme de Sévigné ou chez Léopoldine Hugo. On connaissait l'attachement d'Antoine de Saint-Exupéry à sa mère, plus étonnant sans doute sont les liens qui unissaient Le Corbusier à la sienne. C'est Robert Brasillach, écrivain collaborationniste, recherché à la Libération qui se livre pour que sa mère soit délivrée par la Résistance qui la retient captive. Plus surprenante encore est cette lettre de Simenon à sa mère, décédée quelques trois an plus tôt où il déplore l'absence de liens entre eux, même s'il lui reconnaît des qualités. Étonnant, quoique bien en accord avec son personnage, est ce témoignage de Depardieu pour sa mère qu'il appelle « La Linette » et malgré tout émouvant est son aveu.
Entre les hommes et les femmes, l'amour, surtout s'il se décline dans le mariage, est une chose fongible et consomptible. Dans ce recueil, obtenu dans le cadre de « Masse critique », ce dont je remercie Babelio et les éditions Le Robert, les lettres publiées montrent que l'appartenance à une famille ressert ce lien. Le fait pour une femme de donner la vie à des êtres qui n'ont pourtant rien demandé, c'est à dire de les projeter dans un monde hostile et, bien souvent de les charger de poursuivre l’œuvre parentale jusque dans la progéniture, lui donne une dimension différente. La filiation qui en résulte crée un attachement particulier entre une mère et son enfant, ce dernier trouvant souvent les mots pour l'exprimer simplement tout en craignant de ne pas être à la hauteur des espoirs qu'on a mis en eux. Qu'elle soient griffonnée sur un bout de papier ou sur un riche vélin, une missive est toujours, à mon avis, un moment fort, plus qu'un SMS ou qu'un e-mail plus communs aujourd'hui, parce qu'on peut la toucher, la sentir, la plier, la garder… On confie à la feuille blanche qui est pourtant un fragile support, surtout au pas de la mort, et en quelques mots, tout ce qu'on n'a pas pu dire avec de longs discours tout au long de son parcours sur terre. C’est une ultime trace laissée dans cette vie dont nous ne sommes que les modestes usufruitiers.
Hervé GAUTIER – Octobre 2015 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
La Rochelle 1939-1945 - Annick Notter Nicole Proux
- Le 14/06/2015
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°922– Juin 2015
La Rochelle 1939-1945 - Musée des Beaux-Arts de La Rochelle – Geste Éditions.
Sous la direction d'Annick Notter, conservatrice en chef et Nicole Proux, historienne.
A l'occasion du soixante-dixième anniversaire de la Libération de la ville, le musée des Beaux-arts de La Rochelle publie cet ouvrage richement illustré et documenté qui accompagne une exposition organisée dans ses locaux du 7 mai au 9 novembre 2015. Il s'agit d'un ouvrage collectif qui retrace ces six années de guerre et d'occupation.
Après l'armistice du 22 juin 1940, La Rochelle qui est une ville commerçante et industrielle active se retrouve en « zone occupée » puis en « zone interdite », est déclarée « ville ouverte ». Les Rochelais vécurent ces six années de tourmente dans la réserve, l'attentisme et la survie malgré les privations, l'afflux des réfugiés, les évacuations et les pénuries de tous ordres. Ceci n’exclut ni les actes de collaboration et de délation ni ceux de résistance et de sabotage. L'ouvrage rend hommage à celles et ceux qui se sont engagés dans ces actions d'opposition à l'occupant, qui ont donné leur vie pour que la ville soit à nouveau libre. Le maire Léonce Vieljeux (1865-1944) en fut la figure emblématique. Nombre de voies urbaines et portuaires rochelaises portent leur nom ce qui contribue à perpétuer leur mémoire.
La répression allemande et vichyssoise n'a épargné, ici comme ailleurs ni les juifs, ni les communistes ni les francs-maçons. La Garde Civique et plus tard la Milice, soutenues par des organisations pétainistes, furent de zélés collaborateurs des autorités allemandes. Les communistes qui entrèrent en résistance notamment après la rupture du pacte germano-soviétique (1941), furent particulièrement pourchassés par l’occupant. Les FTP, qui ont payé un lourd tribu, se montrèrent particulièrement agressifs mais le PCF, eu égard à son organisation interne, et malgré les coups portés par l'occupant, a été particulièrement efficace dans cette lutte. Dans la ville, la Résistance s’organisa dans la clandestinité, parfois sous couvert d’associations sportives mais pas seulement, vers l'action, le renseignement, le sabotage ou la propagande anti-nazie ce qui déclencha une vague d'arrestations et de répression de la part des Allemands. Ici comme ailleurs, dénonciations, déportations, tortures, exécutions sommaires furent l'ordinaire de la barbarie nazie... Comme partout, le maquis a connu un regain de recrutement à partir du début de l'année 1942 et de l'instauration du STO par le régime de Vichy, même si, à partir de cette période, les réseaux de résistance rochelais ont été décimés.
La pêche rochelaise a été lourdement handicapée non seulement par les mesures restrictives imposées à la profession(restrictions de carburant, prélèvements sur les prises) mais aussi par les mines et la destruction de bateaux par la marine allemande et la réquisition de chalutiers transformés en garde-côtes ou en navires de guerre auxiliaires. L'importance stratégique de La Pallice, port en eaux profondes et élément important du Mur de l'Atlantique, incite les Allemands à y implanter des infrastructures militaires(base sous-marine, construction de batteries côtières, mines...) qui seront la cible des bombardements alliés, épargnant cependant miraculeusement la vieille ville. En effet, même si la France n'était plus officiellement en guerre la position géographique de La Rochelle la désignait naturellement comme un objectif militaire.
La Rochelle doit être attractive puisque, avec celui de l'Aunis, elle subit là le septième siège de son histoire mais ce sont des Allemands qui sont retranchés dans la ville rebaptisée « poche »(septembre 1944-mai 1945). Cette ville doit bien être « bénie des dieux » comme a pu le dire plus tard un édile, puisque, malgré sa situation maritime et économique, elle a été épargnée alors que d'autres, dans la même configuration, ont été rasées et ce d'autant plus que sa position de « poche » allemande à la fin d'un conflit dont il n'était pas possible de douter de l'issue, l'exposait à des barouds d'honneur, des règlements de compte et autres débordements qui eussent pu l'endommager durablement. Les troupes allemandes cantonnées à La Rochelle étaient importantes tandis que les résistants (FFI), pourtant peu armés et mal équipés étaient cependant déterminés et combattifs. D'ailleurs, à la fin de la guerre, les Allemands avaient programmé la destruction de la ville mais en aucune façon une reddition et le général de Gaulle lui-même prévoyait qu'une action armée accompagnât la libération de la ville. Il a fallu toute l'humanité et toute la diplomatie du capitaine de Vaisseau Hubert Meyer, du vice-Amiral Ernst Shirlitz et du concours de la Suède pour négocier une trêve, assurer le ravitaillement des Rochelais demeurés dans la ville pour éviter les bombardements alliés comme à Royan, et surtout que cet épisode ne se transforme pas en un bain de sang avec d'inévitables destructions. Par ailleurs, à cette période les Rochelais ont fait preuve de solidarité et de compréhension : la ville était sous administration vichyssoise et allemande mais encerclée par les FFI sur un territoire divisé en zones d'influence, à un moment où la victoire des alliés était en marche. Ce siège, réglementé par une convention pourtant controversée et quasiment secrète, dura six mois relativement paisibles alors que le reste de l'Europe était un vaste champ de bataille. Même si les Allemands étaient craints, ils n'en étaient pas moins considérés, eux aussi, comme des prisonniers. Cette situation un peu surréaliste a donné lieu à des manifestations cocasses où la paix a cependant été privilégiée et sauvegardée. Ainsi, il n'était pas rare que, dans un même lieu, des Miliciens, des Allemands et des Résistants en armes cohabitent sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré, le but de chacun étant de gagner du temps. Le 8 mai 1945 la ville fut libérée par des troupes françaises (zouaves et spahis) épaulées par les FFI, sous les yeux d'un occupant, apparemment soulagé, les soldats allemands désarmés étant considérés comme prisonniers de guerre dans des conditions honorables. Ce fut la dernière ville à être libérées(8 mai 1945) sur le territoire.
J'ai découvert ce livre passionnant grâce à Babelio et à Geste Éditions que je remercie chaleureusement. Il m'a permis, à titre personnel, de compléter ma connaissance de l'histoire de cette cité qui m'est chère à plus d'un titre. En effet, quelque soit l'endroit où j'habite temporairement, je me revendique définitivement comme Rochelais.
La ville de La Rochelle a encore une fois mérité son surnom de « belle et rebelle ». Elle a connu au cours de son histoire bien des bouleversements. Cet ouvrage a pour but de ne pas oublier cette période pourtant pas si lointaine et surtout ceux qui se sont sacrifiés et envers qui les générations suivantes ont une dette imprescriptible. Il met en exergue l’héroïsme des Rochelais autant que leur vie quotidienne et les heures sombres qu'ils ont vécu à travers des textes, des photographies et documents d'époque.
©Hervé GAUTIER – Juin 2015 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
EDWARD HOPPER - Gail Levin
- Le 12/04/2014
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 1 commentaire
N°741 – Avril 2014.
EDWARD HOPPER- Gail Levin – Flammarion.
Traduit de l'américain par Marie-Thérèse Agüeros.
Ce peintre américain me fascine tellement que j'ai résolu de m'intéresser à ce qui a été écrit sur son style et sur son talent. Cette chronique s'est récemment fait l'écho de quelques-uns de ces ouvrages (La Feuille Volante n°696-698-739). A l'inverse d'autres qui dissertent volontiers sur sa peinture et, si l'on veut le dire comme cela, sur sa manière de voir le monde, ce livre nous parle de la biographie d'Edward Hopper (1882-1927), soulignant les différentes étapes de son évolution et montrant qu'il est assurément un des peintres importants du XX° siècle.
Sa famille, des commerçants baptistes de la petite ville de Nyack au bord de l'Hudson, fut attentive aux goûts artistiques d'Edward mais l'encouragea cependant à apprendre le métier d'illustrateur commercial, plus lucratif et aussi plus sûr que celui d'artiste-peintre. A la fin de ses études secondaires, il partit donc effectuer sa formation à New-York, fréquenta écoles et ateliers où, grâce à son talent précoce, on lui promit une belle carrière. Plus tard il rendit hommage à l'un de ses professeurs, Robert Henri, pour l'influence qu'il a exercée sur lui et notamment sur les tonalités sombres de sa peinture. Ce professeur l'avait encouragé à peindre en combinant l'observation et l'imagination mais lui qui aimait surtout les bords de mer ou en plein air n'oublia cependant pas ce conseil. Selon le message de Henri, Hopper a en effet eu soin de reproduire cette « sensation de nuit » caractéristique. Certes, au cours de sa carrière sa palette éclaircira ponctuellement, notamment sous l'influence des Impressionnistes, mais il restera fidèle à ces tonalités.
Toujours à l'instigation de ce professeur, il s'embarqua pour l'Europe afin d'y assimiler le message des Impressionnistes français, mais pas seulement. De 1906 à1910, il fit trois séjours sur le vieux continent qui l'amenèrent de Paris à Londres, Amsterdam, Berlin, Bruxelles et en Espagne où il se prit de passion pour la corrida. Il apprécia tout particulièrement Paris, ville qu'il trouva pleine de vie en comparaison de New-York. De ce séjour il rapporta un style et des œuvres, souvent composées de mémoire mais que la critique américaine apprécia très peu à son retour. Il restera cependant toujours fidèle au souvenir des Impressionnistes français. En 1915 et un peu par hasard, il découvrit la gravure qu'il pratiqua en restant fidèle à son inspiration française. Il prisait peu cette technique mais ses gravures se vendaient mieux que ses toiles. Revenu à New-York à partir de 1912, il s'installa à Greenwich-village où il exerça le métier d'illustrateur publicitaire pour différents magazines, ce qui lui permit de gagner sa vie, mais sans grande conviction cependant. A l'époque il continua à peindre et en 1920, à l'âge de 37 ans, il fit sa première exposition américaine. Il exposa un maximum de toiles d'inspiration française mais ce fut un échec. Il commença à s'intéresser à l'architecture américaine, caractérisée par la maison victorienne qu'il reproduira souvent dans ses toiles, gravures et aquarelles. A partir de 1928, période qui correspond à sa maturité, il abandonna la gravure et adopta un style de composition qu'il gardera toute sa vie. Il présentait ses toiles soit comme une composition frontale, soit en diagonale et souvent vues à travers une fenêtre. Cette dernière manière met le spectateur en position de voyeur mais aussi ouvre le tableau vers le monde extérieur. Il n'en continua pas moins à jouer sur l'ombre et la lumière ce qui caractérise les toiles de la maturité.
A New-York, la ville où il a pratiquement vécu toute sa vie il est inspiré par John Sloan (1871-1951). C'est à partir de cette époque qu'il s'intéresse aux femmes qu'il figure nues ou peu vêtues et représentées dans des scènes quotidiennes réalistes voire intimes, un peu comme si elles ne se savaient pas observées par le peintre. Il poursuivit son étude des fenêtres en explorant les jeux sur l'ombre et la lumière et en donnant à ses toiles une connotation sensuelle par la représentation d'un rideau gonflé par le vent. A cette époque il peignit également des maisons en aquarelles. Il rencontra Jo Nivison, peintre elle-même, qu'il épouse en 1924 ; Il a alors 42 ans. Elle l'encouragea dans sa recherche picturale et l'invita à participer à une exposition à Brooklyn. La critique accueillit favorablement ses aquarelles et il commença à vendre ses toiles et à connaître le succès même si ce fut au détriment de l’œuvre de Jo. Il put enfin abandonner son activité d'illustrateur qu'il prisait peu et se consacrer à sa peinture.
Ses toiles n'ont aucune connotation politique ou sociale mais il s’intéressa beaucoup aux atmosphères et aux relations humaines. Elles laissent notamment transparaître une certaine solitude et même de l'ennui mais c'était sans doute voulu. Ce qu'il recherchait en effet à travers les représentations c'était exprimer une pensée par la peinture. En réalité et compte tenu de ses propos, chacune de ses toiles est une étape dans la connaissance de lui-même. Il ne représente pas ce qu'il voit comme on a pu le dire mais il cherche à faire passer une émotion à travers la représentation. Ses toiles sont donc suggestives et l'invitation à une interprétation bien plus qu'une banale reproduction du quotidien. On peut notamment y lire une charge érotique, lui qui était si réservé, mais aussi l'absence, surtout à la fin de sa vie et bien entendu la mort ! Hopper disait volontiers qu'il lui était difficile d'exprimer une pensée par la peinture, pourtant, quand il choisit de représenter le couple, d'évoquer le mariage et les relations homme-femme, on peut aisément deviner son message. Au début, c'est l'amour qui l'emporte mais plus le temps passe plus les liens se distendent et dans le couple s'installent l'incompréhension et le silence. Cela est souligné par le choix de l'automne et du crépuscule qui ne sont pas sans rappeler les poètes symbolistes français que lui avait fait découvrir Henri. Pour figurer la solitude, le peintre représente souvent des rues, des routes ou des parc publics vides ou des personnages isolés qu'on s'attendrait plutôt à voir figurer dans une foule. Pour évoquer l'attente, il choisit souvent des femmes seules, s’inspirant sans doute des peintres hollandais et pour le voyage, il préfère les trains ou les bateaux en haute mer, les toiles vides de personnages. On peut aisément faire un parallèle avec sa vie personnelle.
Jo qui fut son unique modèle féminin, même si elle s'effaça devant le talent de son mari et mit sa propre carrière entre parenthèses, joua un rôle crucial dans l'imaginaire de Hopper au point d'être sa véritable complice dans ses compositions. Sa dernière toile les représente tous les deux en habit de théâtre de la « Commedia dell'arte »(ce qui paraît anachronique le concernant) , saluant un public imaginaire ce qui évoque évidemment le départ mais aussi l'idée de mort. Il s'éteindra en 1967 à l'âge de 85 ans. Jo le suivra moins d'un an plus tard.
Gail Levin (1946-2013) Universitaire, professeur d'histoire de l'art, spécialiste de la culture américaine et de la peinture de Hopper en particulier était tout à fait indiquée pour présenter ce peintre d'exception qui incarne si bien la peinture américaine et peut-être aussi la condition humaine.
©Hervé GAUTIER – Avril 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
HOPPER – Peindre l'attente
- Le 09/04/2014
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°739 – Avril 2014.
HOPPER – Peindre l'attente- Emmanuel Pernoud – Citadelles et Mazenod.
L’impression générale que peut avoir un non-initié à la vue des toiles d'Hopper est effectivement l'attente. En douze chapitres d'un livre richement documenté, illustré et pédagogique, l'auteur s'attache à montrer cet aspect de l’œuvre du peintre américain autant que les influences extérieures dont ses toiles se sont enrichies (Impressionnistes français, cubistes, peintres hollandais du XVII°, poètes symbolistes français, Proust...) ainsi que son empreinte sur les autres artistes, à la fois dans le domaine de la littérature et du cinéma. Il montre aussi tout le paradoxe de cette œuvre qui va à rebours de son temps.
Ce qui frappe d'abord chez Hopper, c'est le regard de ses personnages, leurs yeux sont vides, dirigés le plus souvent vers une sorte d'infini, baignés par une absence d'eux-mêmes. C'est un peu la solitude qu'on lit dans leur immobilité, car ce sont bien des êtres dénués de tout mouvement qu'il nous donne à voir. Cet aspect statique dénote comme un désintérêt du monde extérieur, un espoir d'autre chose qu'ils ne voient pas ou qu'ils imaginent. On sent en eux une sorte de vacuité ou peut-être de doute qui génère une mélancolie qui devait bien être aussi celle du peintre. Ils sont passifs face au décor qui se déroule devant eux et auquel ils sont étrangers. Ils ne bougent pas mais cette absence de mouvement peut signifier qu'ils sont à l'écart de tout changement. Ils sont comme résignés, capables d'attendre indéfiniment quelque chose qui ne viendra peut-être pas. Ils regardent souvent par une fenêtre et se perdent au loin, le ciel étant alternativement noir ou bleu, couleur qui suffit à caractériser leur état d'esprit, leur degré d'espérance. Généralement ils gardent le silence et quand ils parlent entre eux, le spectateur à l'impression que leur dialogue est suspendu de même d'ailleurs que leurs gestes, comme s'il existait entre eux une sorte d'incompréhension, un impossible dialogue. C'est là un paradoxe puisque Hopper qui vit principalement à New-York où tout est mouvement peint des villes et des rues généralement vides de voitures, de gens et même d'enfants. Lui, choisit tout autant de représenter des immeubles à l'architecture victorienne mais néglige les gratte-ciel alors que nombre de ses contemporains, peintres ou écrivains feront le choix d'une représentation plus contemporaine, du tumulte et du bruit. Dans ce décor figé, l'auteur veut voir un parti-pris d'attente et on retrouve cette idée autant dans la façade des immeubles que dans la fixité du regard des gens et, de la peinture de Hopper, pourtant réaliste, la vie ne ressort pas.
Le spectateur est placé dans la position indiscrète d'un voyeur et l'artiste excelle à montrer des scènes de la vie conjugale, dans le huis-clos d'une chambre mais ce qu'il donne à voir n'a rien d'érotique, au contraire, c'est l'ennui, l'indifférence, le silence, l'absence de communication, le spleen qui ressortent de ces toiles. C'est l'image d'un échec qui fut sans doute aussi le sien, son mariage n'ayant pas été des plus heureux et surtout sans descendance. Le lit est souvent représenté défait et vide ce qui est le symbole de l'isolement, de l'intimité non-partagée et les femmes parfois dénudées ou peu vêtues semblent attendre désespérément un amant qui ne viendra pas les rejoindre. C'est un peu comme si elles étaient vivantes mais presque déjà mortes, si elles attendaient un amour impossible ! Les derniers tableaux insistent peut-être sur cette idée quand ils montrent des pièces vides qui sont un peu comme des boites peintes où il est difficile de communiquer.!
Les personnages de Hopper (souvent des femmes) sont en train de lire des lettres ou des livres ce qui n'est pas sans rappeler l'influence de Vermeer mais cela accentue cette notion de solitude et d'attente, de désœuvrement, de désintérêt pour le monde extérieur et les lieux représentés sont souvent de transition (halls d’hôtel, gares, compartiments, bureaux, chambres) et impliquent l'expectative d'autant que ces personnages sont immobiles et regardent souvent par une fenêtre d'où on aperçoit à peine le ciel, comme s'ils étaient prisonniers et donc en espérance d'une libération, comme s'ils n’occupaient l'espace que temporairement. D'une manière générale les toiles de Hopper sont tristes, qu'elles représentent des couples, des être seuls ou des paysages. Les femmes semblent avoir sa préférence mais elles portent rarement de maquillage, le peintre restant puritain à l'image de ses contemporains. Quand il choisit de représenter les cafétérias, les cafés, il y introduit parfois la prostituée comme celles qu'il a vues lors de son séjour à Paris. Là aussi l'attente existe et peut être orpheline... mais c'est celle du client ! Les autres individus représentés sont souvent soit des femmes seules, soit des couples qui paradoxalement semblent absents. Ils paraissent espérer quelque chose sans que nous sachions très bien quoi. Leur attitude veut peut-être signifier un échec sentimental ou sexuel qui fut peut-être celui du peintre lui-même.
Un autre aspect de la représentation de Hopper est donnée par les bancs des parcs publics. Ils sont souvent déserts et illustrent ainsi à la fois l'attente et l'ennui. Cette vacuité dans les paysages s'étend aussi aux rues américaines ce qui est un paradoxe puisque l’Amérique est mouvement. Le siège lui-même est le symbole de l’attente et quand quelqu'un est assis, il y est comme vissé, immobile, figé, en contemplation de l'horizon ou du vide. S'il y a peu de statues chez Hopper, les êtres qu'il représente en ont souvent l’apparence.
Cette inactivité se retrouve dans la représentation des travailleurs. Là aussi c'est l'inaction, le chômage consécutifs à la crise de 1930 (il commence à être connu à partir de cette époque). Il pratique donc l'art social qui pour lui est réaliste. Quand il peint des travailleurs, il préfère figurer la pause, le temps de repos plutôt que l'acte de travail qui est mouvement. Pourtant, il faut noter qu'il a été illustrateur de presse et que, dans ce domaine seulement il a changé de registre et représenté exceptionnellement le mouvement, mais pour des raison professionnelles. Cependant en tant que peintre il montre la vie ordinaire, donne à voir assez peu d'usines et ignore le Taylorisme. Sa peinture est réaliste mais il en gomme cependant la vie comme pour figurer le souhait de quelque chose. Il préfère les bureaux, les restaurants, les cafés, mais des travailleurs qu'il représente sont dans l’expectative, dans une sorte de passivité, ils sont comme pétrifiés, acceptant leur sort, leurs gestes sont suspendus, leur regard est vide, un peu comme une photographie, une image fixe. C'est sans doute pour cela qu'on a parlé d'anachronisme chez Hopper.
Cet aspect statique des corps se retrouve également dans le sport. Il représente l'athlète non pas en plein effort mais au repos. Quand il choisit le théâtre c'est moins le spectacle que la salle d'attente (endroit d'événements potentiels) qu'il peint et s'il choisit quand même la salle de spectacle, le rideau symbolise chez lui encore une fois cette attente, la frontière entre deux mondes, entre deux temps. Lorsque c'est une scène de strip-tease qu'il peint, c'est le puritain qui ressort en lui et il réussit à faire passer chez le spectateur...une absence de désir ! Puritain encore quand il donne à voir des rues : elles sont vides et sabbatiques puisqu'il les choisit lors du dimanche protestant quand chacun est à l'office ou reste chez soi, c'est à dire attend. De même les voies ferrées qu'il représente semblent abandonnées et les trains sont le plus souvent à l'arrêt, les routes sont désertes et les poteaux télégraphiques sans fils, tout cela symbolise peut-être le désir du départ mais sûrement aussi l'attente que quelque chose. Même les phares sur les côtes du Maine qui peuvent trancher quelque peu dans l’œuvre de Hopper ressemblent à des guetteurs tournés vers le large, vers l'infini, donc là aussi l'idée d'ailleurs existe.
C'est un livre qui montre une approche différente, particulière mais pertinente, de la peinture de Hopper, une invitation à la voir différemment, à la comprendre dans le contexte de son temps et la psychologie de son auteur. Un ouvrage remarquable sur un peintre également remarquable !
©Hervé GAUTIER – Avril 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
EDWARD HOPPER – Entractes – Alain Cueff
- Le 23/11/2013
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°698 Novembre 2013.
EDWARD HOPPER – Entractes – Alain Cueff – Flammarion.
Je poursuis avec cet ouvrage mon approche passionnée de l’œuvre d'Edward Hopper (1882-1967) tant sa peinture exerce sur moi, comme sur beaucoup sans doute, une étrange attraction.
Alain Cueff reprend bien volontiers les idées développées depuis longtemps à propos du peintre américain [solitude, mélancolie, aliénation,...] mais invite son lecteur à regarder ses tableaux sous un autre angle, les commentant en fonction de son vécu personnel et des influences qu'il a pu subir, prenant comme fil d'Ariane chronologique certains d'entre eux. Il parvient à la conclusion que si ces idées sont certes justes, il faut en chercher la raison autant dans sa psychologie personnelle, dans ses illusions de jeunesse où il espérait que l'impressionnisme qui l'avait tant influencé lors de son séjour en France serait accueilli favorablement dans son pays, que dans les événements extérieurs que connaît son pays. En effet, Cueff prétend que le regard vide des personnages peut parfaitement aussi s'expliquer par le revers du « rêve américain » qui ne serait qu'un leurre. La crise économique née de 1929, les émeutes, le chômage ont mis à mal ce concept. De plus le francophile qu'il est s'alarme de l’attentisme de l'Amérique face à la montée du nazisme en Europe. Ses personnages prennent, sous son pinceau, conscience de la précarité de leur vie, il serait donc le peintre de « l’existentialisme américain » bien avant qu'en France cette philosophie soit développée.
D'emblée, l'importance de la lumière est soulignée dans l’œuvre de Hopper. Il en fera, à la fin le thème unique de ses tableaux. Il s'attachera également à peindre des personnages dont la mélancolie est visible. Ils sont à son image, lui-même étant quelqu'un de timide, réservé, peu souriant, puritain et aimant la lecture. Sa confession baptiste explique sûrement le côté dépouillé de ses toiles. On a dit de lui qu'il peignait ce qu'il voyait, ce qu'il connaissait le mieux, qu'il tirait son inspiration du quotidien. C'est sans doute vrai, mais sa vision était probablement sélective puisqu'il habitait New-York, a représenté des maisons à l'architecture victorienne mais n'a jamais peint de gratte-ciels. Cette ville qu'il aimait et où il a pratiquement toujours résidé fourmille de vie alors que ses tableaux sont vides de présence humaine et que ses personnages sont immobiles et silencieux. Même si, comme de Chirico et Magritte, il a une prédilection pour les paysages urbains déserts, l'auteur note le côté inquiétant des personnages représentés, leur immobilisme et le silence qui les entoure. C'est un peu comme s'il étaient des mannequins sans vie, des êtres désincarnés au regard vide, dans une expression d'attente, souvent plongés dans la lecture. C'est une constante de la peinture de Hopper que ce vide, que cette solitude. Ces deux thèmes viendront d'ailleurs en conclusion de son œuvre. Les paysages eux-mêmes n'inspirent pas au spectateur quelque chose de reposant comme ils pourraient le faire et là aussi il ressent cette même impression de vacuité.
Hopper est un contemplatif et ne s'intéresse qu'aux paysages suburbains d'une grande banalité. Il semble saisir l'instant dans son immédiateté, représentant ce qu'il voit mais à travers le prisme de son regard plein de solitude. Il prétendait d'ailleurs un peu bizarrement « n'avoir d'autre ambition que de peindre la lumière du soleil sur les murs d'une maison ». Le soleil est effectivement souvent présent dans ses toiles, éclaire les personnages, mais il n'est jamais visible de face, ce sont toujours ses effets que le peintre donne à voir, un peu comme s'il hésitait, s'il n'osait pas. Pourtant ce soleil éclaire mais ne réchauffe pas, ses toiles restant froides
Cueff propose à chacun de se laisser porter par les tableaux de Hopper, de se laisser inspirer par eux. Il retient l'un des plus emblématiques, « Les oiseaux de nuit » et note que des hommes de lettres ont obéi à une invite créatrice[J'ai personnellement retenu « L'arrière saison » de Philippe Besson – La Feuille Volante n° 604]. Je pense en effet, sans vraiment me l’expliquer, que Hopper interpelle chacun d'entre nous au point de nous inciter intimement à poursuivre pour nous seuls le prétexte de son tableau, de lui donner une suite personnelle.[Il semblerait que le tableau lui-même ait été peint après la lecture d'une nouvelle d'Hemingway, bien que Hopper ait prétendu le contraire].
Hopper n'a été vraiment connu qu'à partir de 1925, date à laquelle il commence à vivre de sa peinture. Auparavant il a été illustrateur, dessinateur d'affiches publicitaires et pour le cinéma et il ne fait aucun doute que cette période qu'on peut qualifier d'initiatique a été pour lui une sorte d'apprentissage qui va, par la suite, influencer son style réaliste. Tout n'a cependant pas été simple pour lui. Même s'il ne vend son premier tableau qu'en 1913 et qu'il commence à participer à des expositions collectives qui ne lui valent que de l'indifférence de la part de la critique, il doute, cherche sa voie et s'oriente même un temps vers la gravure et vers l'aquarelle. Il est en quelque sorte « coincé » entre l'invention de la photographie qu'il n'aime guère et l'évolution de la peinture vers le cubisme, l'abstrait, le surréalisme qui invitent davantage le spectateur au rêve et à l'imaginaire. Malgré sa relative réussite en gravure il revient cependant vers la peinture en privilégiant le nu féminin ce qui peut signifier chez lui à un désir sexuel latent, obsessionnel et refoulé. Jusqu’à la fin de sa vie il représentera des femmes nues ou vêtues au point qu'on a pu le qualifier de voyeur pudique. En observant les personnages féminins de ses tableaux, on ne peut qu'être frappé par leurs formes généreuses et sculpturales qui marquent un caractère sexuel évident. Les femmes (même si son épouse en est l'unique modèle, ainsi métamorphosée sur chaque toile) qu'il peint semblent attendre quelque chose, mieux, l'espérer. Le fait qu'il peignent des femmes dans cette sorte d'expectative peut parfaitement être la transcription personnelle et inversée de son attente à lui. Il n'est pas illogique de penser que cela peut être le « grand amour ». Hopper a toujours été un solitaire, on lui connaît peu de liaisons amoureuses et son union avec « Jo » a été plus un mariage, d’ailleurs tardif (il est dans la quarantaine), de raison qu'un amour passionné. Tout les oppose et cela ne peut qu'enfanter des disputes conjugales, une incommunicabilité définitive entre eux, un silence oppressant. « Jo » se révèle en effet être une épouse jalouse qui peint elle-même de moins en moins et compense sans doute par la tenue d'un journal intime tout comme son mari pratique la peinture. Ces deux activités peuvent être interprétées comme un refuge, pire peut-être, comme les deux faces d'une même souffrance ! Cueff note d'ailleurs que ce n'est pas le moindre des paradoxes que Hopper ait voulu peindre apparemment des tableaux impersonnels alors qu'en réalité ils sont le reflet de sa propre vie, entretiennent aussi une énigme qui reste entière.
Ce livre passionnant éclaire d'un jour nouveau la démarche créative de Hopper et contribue à lever une partie du voile sur un style réaliste (ou néo-réaliste) étrangement attractif et moderne à la fois, qui est le reflet de son siècle autant que de sa vie et de sa personnalité.
Hervé GAUTIER - Novembre 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
HOPPER (Métamorphoses du réel)– Rolf Günter Renner
- Le 22/11/2013
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°696 Novembre 2013.
HOPPER (Métamorphoses du réel)– Rolf Günter Renner- Éditions Taschen.
Dans mon opinion, Edward Hopper (1882-1967) a toujours incarné la peinture américaine de son temps, peignant des scènes de la vie quotidienne des classes moyennes avec un grand réalisme, une certaine mélancolie voire une aliénation. Il ressort de ses toiles une solitude des personnages autant que des paysages représentés, une ambiance un peu froide, secrète, silencieuse, presque désincarnée, à la fois étrangère et bizarrement familière. Cette esthétique est ambiguë mais dans l’histoire de l'art Hopper incarne cet « individualisme américain » qu'on retrouvera chez Johnson Pollock dans un registre évidemment différent. Il n'a été connu que tardivement, à peu près vers 1925, mais à partir de cette date il a été reconnu comme un artiste américain majeur et non plus comme un peintre ordinaire. Si Hopper a pratiquement toute sa vie habité modestement à New-York, à exception de vacances au Cap Cod, il a très tôt effectué des voyages en Europe et notamment en France d'où il a rapporté une inspiration très forte de l'Impressionnisme et aussi de Rembrandt. On peut distinguer au moins deux périodes dans son œuvre, d'abord l'impressionnisme héritée de l'Europe puis le réalisme qui le caractérise et qui fait sa véritable originalité ainsi qu'un double aspect, celui de polarité entre culture et nature d'une part et d'autre part un travail très poussé sur l'ombre et la lumière. Tout au long de sa vie il a insisté sur cette étude de la lumière, du soleil, donnant, à la fin, une impression de vide à ses toiles.
Il est certes un peintre réaliste, mais Renner nous invite à dépasser cet aspect purement visuel pour nous intéresser à une approche plus intimiste qu'il ne faut cependant pas négliger, une lecture codée de chaque toile qui donne à travers la posture des personnages, les paysages représentés mais aussi le jeu des ombres et de la lumière une véritable explication de la psychologie du peintre, un peu comme si, au paysage extérieur, correspondait son état d'esprit intérieur. Il transporte dans sa peinture ses perceptions intimes, ses obsessions.
Certes, il emprunte à l'Europe un peu de son romantisme qu'on peut déceler chez Magritte et chez Munch. De sa période parisienne il rapporte des paysages urbains bien dans le style du XIX° siècle français, mais progressivement et sans rupture marquée l'expressionnisme s'installe, les décors deviennent géométriques, droits, sans fioriture, maisons au style épuré, encadrements de fenêtres qui ouvrent sur l'extérieur d'où on découvre un paysage naturel ou parfois aussi le vide. Déjà, dans certains tableaux, il suggérait le vent par le simple mouvement d'un rideau. Le culte du détail s'affirme et Hopper jouant sur les ombres et sur la lumière souligne la perspective. La nature est parfois choisie mais elle est représentée dépouillée, réduite à quelques arbres, des collines, une maison isolée, une route, une voie de chemin de fer, un passage à niveau ... Les villes aussi sont mises en scène, ce sont le plus souvent des rues dénuées de présence humaine, des vitrines très éclairées, des stations-service, des panneaux publicitaires, des façades le plus souvent traitées dans une palette sombre avec cependant un grand souci du détail. Il incarne la marque indélébile de la civilisation dans laquelle il vit, du temps qui est le sien. Les intérieurs sont souvent impersonnels, halls ou chambres d'hôtels ou de maison, bureaux, cinémas, compartiments de train... Là aussi la couleur dominante est foncée et triste, contraste souvent avec un violent éclairage. Hopper est cependant très attaché aux symboles de cette civilisation américaine, il incarne le « symbolisme narratif » et l'ambiance qui se dégage de certains tableaux ne sont pas sans rappeler le traumatisme de la grande dépression des années 30.
Les personnages sont beaucoup plus intéressants et Hopper s'y attarde plus volontiers. Il ressort des scènes représentées une solitude un peu dérangeante. Au début de sa carrière, celle qui est plus volontiers tournée vers l'impressionnisme, on peut voir une parenté avec Degas et privilégier dans la toile un moment heureux que notre imagination peut éventuellement prolonger. Rapidement, il diverge cependant représentant des personnages figés. Quand il choisit des femmes pour modèle, il les présente souvent habillées mais parfois nues. Dans les deux cas, elles sont souvent sensuelles, leur corps a quelque chose de provoquant, elles évoquent un désir refoulé du peintre, incarnent une obsession qui jouxte le voyeurisme, qui évoque un désir refoulé. On peut y voir un désir charnel latent et il faut se souvenir que Hopper est de confession baptiste et donc puritain comme les Américains de son temps. Souvent ces femmes lisent ou attendent mais il y a une sorte d'ennui, de désespoir dans cette posture, une impression d’abandon, comme si elles espéraient quelque chose qui pourrait ressembler à l'amour ou la mort mais avec un grand détachement cependant. Le seul mouvement perceptible est suscité par le vent qui soulève un rideaux, une vague qui ondule... Quand elles sont représentées en présence d'autres personnages, il se dégage d'elles une sensation de solitude, pire de déréliction, d'abandon, de torpeur, d'apathie comme si elles étaient étrangères à la scène dans laquelle elles figurent. Il est possible que, sous les multiples visages de ces femmes c'est son épouse qu'il peint, mais cette représentation évoque davantage la séparation que la communauté tant les relations que Hopper avait avec son épouse « Jo » étaient conflictuelles. Souvent les personnages regardent vers l'extérieur mais leurs yeux sont vides. Les hommes eux-même portent sur leur visage ce détachement ; Ils sont pensifs et renfermés sur eux-mêmes. L'impression d'ensemble est qu'ils sont muets et quand un dialogue est suscité par le peintre il en ressort une impression malsaine de tension à l’intérieur du couple semblable sans doute à ses difficultés personnelles. Quand ils les représentent en société, Hopper les figure souvent dans des zones de transit, halls ou chambres d'hôtel, bars. Ils suggère sans vraiment le montrer, une invitation au plaisir, mais une invitation seulement.
Ses toiles sont à l'exacte image de sa vie, sans grands bouleversements, sans grands bonheurs non plus, sans moments d'exception, sans rupture importante, seulement brouillée par une mésentente conjugale constante renforcée par le fait que son épouse « Jo » est certes son premier critique mais est aussi peintre elle-même mais qui choisit d'abandonner progressivement cette activité. On peut aisément imaginer que pour Hopper sa peinture constitue un refuge, enfante une création constante, mais ce havre est parlant !
C'est un livre très pédagogique et bien illustré, plein d'explications techniques, pertinentes et passionnantes, en phase avec la vie de Hopper, personnage discret et sans doute malheureux dans son couple mais aussi attentif aux événements extérieurs.
Hervé GAUTIER - Novembre 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
HISTOIRE DE LA ROCHELLE – Sous la direction de Marcel Delafosse (†).
- Le 15/08/2012
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°592– Août 2012.
HISTOIRE DE LA ROCHELLE – Sous la direction de Marcel Delafosse (†).
Éditions Privat.
Cet ouvrage collectif publié en 2002 est une nouvelle édition reprise, complétée et augmentée d'un ancien ouvrage portant le même titre, chez le même éditeur dans la collection « Pays et villes de France » publié en 1985.
Les rédacteurs sont professeurs d'Université (Robert Favreau, Etienne Trocmé), maître de recherche au CNRS (Louis Pérouas), conservateurs (Olga de Sainte-Affrique, Marcel Delafosse(†). C'est assez dire que le document qui est ainsi livré au lecteur est un ouvrage de référence sur l'histoire de cette ville d'exception depuis sa fondation jusqu'à la période contemporaine.
Cette « ville bénie des dieux » n'est principalement connue actuellement que par le festival des « Francofolies » et par les tours emblématiques de son port. Sans vouloir minimiser ces références très médiatiques, ce livre nous fait entrer dans les arcanes de l'histoire riche et palpitante de cette cité qui, au départ n'était qu'un modeste village de pêcheurs entouré de marais. A partir de l'an mil, et sans doute un peu par hasard, il se transforme en une cité qui ne cessera de grandir, de s'affirmer tout au long de sa vie pour devenir une des toutes premières villes de la côte atlantique.
Grâce à cet ouvrage extrêmement bien documenté et pédagogiquement présenté, nous voyons cette cité, depuis sa création vivre et évoluer. Elle a été tour à tour anglaise, grâce à Aliénor d'Aquitaine, française à partir de 1224, puis à nouveau anglaise à la suite du traité de Brétigny de 1360 mais a toujours marqué son attachement à la couronne de France à laquelle elle est à nouveau rattachée en 1372.
mais a toujours marqué son attachement à la couronne de France. Au début elle a abrité nombre de congrégations religieuses puis est devenue protestante et même une place forte, pour redevenir ensuite catholique surtout à partir de la fin du siège.
Le XVII° siècle correspondit à l'essor colonial, celui du commerce et de la « course » qui enrichirent la ville et la dotèrent d'une architecture riche et originale. Lui succéda le XVIII°siècle pendant lequel le catholicisme revint en force, s'établit dans la ville et avec lui l'esprit de tolérance prôné par le siècle des Lumières qui a permis la cohabitation entre les deux communautés. Il en résulta l’émergence d'une nouvelle forme de société axée notamment sur la culture et un nouvel art de vivre ensemble.
La Révolution a été à La Rochelle singulièrement modérée, loin de l’agitation parisienne. Quant au XIX° siècle, il fut « trop calme » selon l'expression des auteurs, mais le dynamisme inhérent à cette ville s'est à nouveau manifesté à la fin de cette période. La ville a consolidé son port de pêche, s'est installée dans l'industrialisation puis à nouveau dans le commerce international. Lorsque les crises successives eurent atténué ces activités, ce furent la culture, le savoir et le tourisme qui émergèrent et s'installèrent durablement.
Très tôt la cité a dû sa richesse à son port d'où partaient le sel et le vin de l'Aunis. Puis des navires ont été armés, destinés au négoce avec les pays du nord, l'Afrique et les colonies ultramarines puis les Amériques, au commerce « en droiture » et « triangulaire », enrichissant considérablement La Rochelle et en ont fait une cité longtemps convoitée. Si la perte du Canada et le révocation de l’Édit de Nantes, les guerres l'ont affaiblie, elles ne l'ont pas anéantie. Son activité commerciale a connu des périodes fastes de grande prospérité mais elle a aussi frôlé la ruine, on l'a même menacée de destruction, mais ses habitants ont toujours su comment la faire perdurer dans une paix relative favorable au commerce et à la vie en société. Autour notamment de ses édiles, elle a su relever les nombreux défis économiques sociaux qui se sont présentés, a su affirmer sa spécificité, son originalité, son sens de l’innovation, son amour de la liberté qui font d'elle, et définitivement, une cité « belle et rebelle ».
Elle a donné à la France nombre de savants, juristes, militaires de haut rang, marins, écrivains et artistes. Son architecture urbaine exceptionnelle, son climat, sa douceur de vivre, ses attraits ont toujours fait d'elle une ville peuplée, attrayante, tolérante, véritable creuset, riche de diversités sociales et culturelle. On peut probablement regretter que Le Corbusier n'ait pas pu y donner toute la mesure de son talent mais Eugène Fromentin aurait aujourd’hui du mal à reconnaître « sa pauvre province », dans cette cité faite de pierre blanche et de toits ocres, bien différente de cette « vieille cité huguenote, grave, discrète avec ces maisons d'un luxe sévère aux façades sombres ».
L'histoire nous enseigne les grandes évolutions des idées et peuples. C'est une discipline indispensable dans le vaste domaine de la connaissance et de la culture. J'ai personnellement, et depuis toujours, une passion pour cette ville et un tel ouvrage ne peut que me conforter dans mes certitudes.
©Hervé GAUTIER – Août 2012.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA ROCHELLE, fille de la mer – Christian Errath, Raymond Silar
- Le 24/07/2012
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°589– Juillet 2012.
LA ROCHELLE, fille de la mer – Christian Errath, Raymond Silar - Geste Éditions.
Dans mon imaginaire personnel, il est des villes dont le nom seul évoque le voyage, l'exceptionnel, un attachement à la fois irrationnel et définitif. La Rochelle est de celles-là. Son nom sonne comme celui d'un rocher solide face à l'océan, elle évoque mon enfance et pas mal de souvenirs. Pour l'extérieur elle reste attachée aux paroles d'une chanson (« Les filles de La Rochelle »), au douloureux siège de Richelieu, à ses emblématiques tours, aux 4 sergents qui y furent emprisonnés. Jadis la reine Aliénor en fit le port de l'Aquitaine et lui accorda le privilège de « franche commune ». Elle fut ensuite dédiée aux expéditions lointaines, au commerce triangulaire, puis à celui des produits du pays, sel, vins puis plus tard céréales, à la pêche à la morue, à celle de haute mer et à celle des coureaux. Aujourd'hui elle est le symbole de la culture et de l'université, de la plaisance, des loisirs, de l'écologie, des Francofolies, de la porte vers l'île de Ré, d'un art de vivre différent, mais elle a toujours été tournée vers la mer...
Avec le texte érudit à l'humour subtil de Raymond Silar et les photographies pleines de cette lumière océane de Christian Errath, le lecteur se promène à la fois dans l'histoire et dans le présent de cette cité « bénie des dieux », créée, dit-on, par la fée Mélusine, mariée à l'Atlantique. Avec ces auteurs, le lecteur découvre « La grande aventure rochelaise » que ses différents musées évoquent et que sa pierre blanche conserve. Ses habitants ont su relever les défis de l'histoire, s'adapter aux changements structurels qui ont accompagné son parcours. Autrefois blottie derrière ses remparts, elle a su « prendre le vent des conquêtes nouvelles » et faire œuvre d'imagination dans bien des domaines ce qui a fait d'elle un véritable modèle. Cette ville à la fois « Belle et rebelle », conquise sur la mer a été successivement depuis Aliénor d'Aquitaine, anglaise puis française, catholique avec la présence des Templiers, des Carmes, des Jésuites et des Oratoriens... puis, évidemment, protestante, en paix et en guerre, peuplée à la fois d'ouvriers et de riches notables commerçants et armateurs. Elle garde les traces architecturales du temps, entre ses célèbres arcades, ses maisons à colombage, ses hôtels particuliers et ses bâtiments de style renaissance ou du XVIII° siècle. Une cité maritime où se mêlent tous les styles et toutes les influences, avec bonheur !
Depuis le hameau de Cougnes qui a été à l'origine de sa fondation, elle a été tour à tour place forte en guerre et ville de paix, a su s'opposer au pouvoir central si celui-ci devenait trop pesant mais aussi se montrer loyale à ce même pouvoir quand il le fallait. La devise de ses armes,« Servabor rectore deo »(guidé par Dieu, je serai sauvé), même si elle prête à diverses interprétations, illustre bien son attitude. Elle a abrité des célébrités, savants, voyageurs, artistes, peintres, écrivains, philosophes, avocats, inventeurs, marins mais aussi des hommes au caractère bien affirmé, notamment parmi ses édiles nommés ici depuis 1199. Les Rochelais ont dû se battre pour conserver le privilège d'élire leur maire et ce d'autant plus qu'ils devaient cette singularité à Aliénor, une Duchesse-Reine en plein Moyen-Age ! Ils ont payé un lourd tribut lors des luttes qui ont jalonné l'histoire de cette cité mais la vie, la liberté et l'indépendance ont toujours prévalu ce qui la rend extraordinairement attractive.
La Rochelle a toujours exercé une véritable fascination sur ceux qui l'ont approchée, a suscité des créations artistiques et des innovations parfois audacieuses de tous ordres, bref n'a laissé personne indifférent, a toujours insufflé à ses habitants autant qu'aux touristes de passage sa vitalité, son originalité, son souffle chaleureux.
©Hervé GAUTIER – Juillet 2012.http://hervegautier.e-monsite.com
-
La Rochelle, « Poche » de l'Atlantique - Christiane Gaschignard
- Le 02/07/2012
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°584– Juillet 2012.
La Rochelle, « Poche » de l'Atlantique – Christiane Gaschignard – Éditions « Rumeur des Ages ».
Les liens qui m'unissent à La Rochelle font que rien de ce qui touche à cette cité ne m'est indifférent, cette chronique s'étant déjà largement fait l'écho des événements qui s'y sont déroulés ou des gens qui y ont vécu. Son histoire a été mouvementée et bien souvent bousculée par des guerres, des sièges dont le plus célèbre est celui de 1627 au cours duquel Richelieu réduisit la place forte des protestants. Mais ce ne fut pas le seul ! La « Belle et rebelle », comme on l'appelle, a toujours été un endroit stratégique au bord de l' Atlantique. Le dernier en date fut celui de « la poche de La Rochelle » à la fin de la deuxième Guerre mondiale (Août 1944 – mai 1945).
Dès juin 1940, elle a été déclarée « ville ouverte » et rapidement occupée par les Allemands. La Pallice, port en eaux profondes, présentait en effet un intérêt particulier pour l'ennemi et l'organisation Todt y construisit, de 1941 à 1943, une imposante base sous-marine, élément essentiel du « Mur de l'Atlantique » complétée sur le littoral par des blockhaus, des batteries d'artillerie, des bunkers. La Rochelle-Pallice était en effet « le port allemand de l'atlantique » autant que le siège du commandement du sud-ouest. Pourtant, un débarquement sur ces côtes n'a jamais été sérieusement envisagé.
Cette période de huit mois a donc constitué le 5° siège de l'histoire de la cité rochelaise, période pendant laquelle l'angoisse a succédé à l'espoir, le temps s'est en quelque sorte arrêté puisqu'elle était coupée du reste de la France et que planait sur elle une menace de destruction. C'était une situation un peu surréaliste puisque les Allemands qui commençaient à reculer sur le reste du territoire tenaient encore ce port dans le but de le rendre inutilisable par les alliés mais aussi de fixer des troupes loin du front qui avançait vers l'Allemagne et de garder intacte leur base de sous-marins. Cette présence ennemie constituait donc un danger d'autant que pour les Américains, La Rochelle ne constituait pas une priorité et qu'il fallait marcher sur Berlin. Les Allemands tenaient certes la ville, mais, face aux troupes françaises et aux FFI, ils étaient également prisonniers ce qui entraîna une cohabitation avec les Rochelais. La présence de ces derniers fut salutaire puisqu'on pouvait penser qu'elle constituait une sorte de bouclier contre les bombardements alliés bien que, après la destruction de Royan, cette certitude fut quelque peu remise en question dans la population. De plus, l'imminence de la fin des combats a catalysé les mouvements de Résistance qu'il fallait impérativement unifier et coordonner aux manœuvres des régiments de l'armée régulière en évitant les débordements. Bien entendu se posa la question du ravitaillement qui intéressait à la fois les Français et les Allemands mais aussi la présence de la Milice, les « collabos », le marché noir, comme partout durant la guerre. Heureusement la Suède a apporté son concours et l'approvisionnement de La Rochelle fut réalisé dans l'ordre et le calme.
L'originalité de cette « poche » fut, comme le souligne opportunément l'auteur, « sa dimension humaine ». L'administration et les instances de Libération ont su faire preuve de souplesse pendant cette période mouvementée d'autant plus que si les comités de Libération commençaient à se manifester, les structures pétainistes demeuraient néanmoins en place. Mais les Rochelais se sont montrés sages et tempérés en évitant au maximum des occasions de friction avec l'occupant. De même que le signal de la Résistance avait été donné dès juin 1940 par le maire Léonce Vieljeux, cette volonté d'apaisement a été incarnée par des hommes tels que le commandant Hubert Meyer et l'amiral Schirlitz qui négocièrent diplomatiquement entre hommes de bonne volonté et de raison une reddition honorable pour les Allemands et la remise de la ville intacte aux forces françaises, ce qui était essentiel dans le futur redressement du pays. Le colonel Adeline, de son côté, fit preuve de détermination pour faire que « la convention du 20 octobre » soit signée. Il n'y eut donc pas de combats pendant cette période et les Allemands furent considérés comme des prisonniers de guerre.
Si La Rochelle a été libérée bien après Strasbourg, elle l'a été par les Français eux-mêmes et surtout sans dommages pour ses installations portuaires, la riche architecture de la ville et sa population. La situation aurait facilement pu rapidement dégénérer mais ce ne fut pas la cas et on préféra la négociation à l'emploi de la force et la volonté de vengeance.
J'ai lu ce livre fort bien documenté et passionnant du début à la fin avec les yeux d'un Rochelais désireux d'en savoir toujours davantage sur « cette ville bénie des dieux » dont le renom ne cesse de grandir. Même s'il a été publié en 1987, cet ouvrage est essentiel pour la connaissance de cette cité et de sa population.
©Hervé GAUTIER – Juillet 2012.http://hervegautier.e-monsite.com
-
Ils étaient 4 sergents de La Rochelle - Bernard Morasin
- Le 23/12/2011
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°545 – Novembre 2011.
Ils étaient 4 sergents de La Rochelle – Bernard Morasin – Éditions Bordessoules.
A La Rochelle, face à la mer, se dresse une tour gothique élégante qui servit de phare et qui, pour cette raison, porte encore le nom de « Tour de la Lanterne ». Ce n'est d'ailleurs pas son seul nom mais, parmi ceux-ci, elle est aussi connue comme « Tour des quatre sergents » puisque la Restauration emprisonna ici quatre sous-officiers séditieux qui furent guillotinés à Paris en 1822.
Ils étaient affectés au « 45° de Ligne », qui, basé à Paris depuis 1821 venait de prendre ses quartiers à La Rochelle. Crée sous Anne d'Autriche, ce régiment d'infanterie traversa la Révolution et l'Empire puis se trouva, à la Restauration, commandé par un de ces officiers émigrés, le colonel-marquis Louis-Victor-Alexandre Toustain de Fontebosc, sans grande autorité sur ses hommes, un peu naïf et même vindicatif.
A 26 ans, le sergent-major Jean-François Bories, Franc- Maçon, s'ennuyait ferme au 45° de ligne. Déçu par l'armée qui, selon lui ne reconnaissait pas ses mérites et le maintenait dans la subalternité, il avait fait le choix de la « Charbonnerie ». D'origine italienne, cette société secrète, dont le but était « la liberté conquise à main armée », convenait à son ambition. Elle s'était implantée fortement en France et était active dans l'armée. La Restauration avait décimé les rangs de l'armée impériale, multipliant les militaires en demi-solde ou carrément privés de leur grade et sans emploi. Le climat à l'époque était volontiers comploteur et nombre de militaires étaient des nostalgiques du Premier Empire et de la Révolution et conspiraient volontiers en faveur de la disparition des Bourbons. Bories avait efficacement œuvré, dans son régiment, en faveur de la Charbonnerie à la quelle « Les Chevaliers de Liberté », société secrète composée surtout de civils, mais très active dans l'ouest de la France, était affiliée. Il recruta donc divers sous-officiers et soldats qui prêtèrent serment à la « Charbonnerie » parmi lesquels le sergent Jean-Joseph Pommier, le sergent-major Charles-Paul Goubin et le sergent Marius Raoulx. Ils adhérèrent à ce mouvement pour des raisons personnelles, tenant à leur avancement ou à la future fortune qu'ils imaginaient à la suite de la chute des Bourbons. Bories fut naturellement leur chef.
Ce fut lors du mouvement que fit ce régiment de Paris à La Rochelle, à pied, dans le froid et la neige, que se déroula cette aventure épique, pleine de rebondissements et qui se révéla être un complot contre le régime monarchique. A force de malchance, de délations, de défections et surtout d'acharnement lors du procès, de nombreux prévenus se retrouvèrent condamnés mais les quatre sous-officiers terminèrent leur brève vie sous le couperet de la guillotine, en place de Grève.
Telle fut l'histoire personnelle de ces quatre jeunes fantassins dans une époque troublée où il fallait faire un exemple. La présence de civils dans la conjuration justifiait qu'on chargeât la Cour d'Assises de cette affaire qui fut jugée à Paris. Leur transfert fut long et pénible. S'il y avait effectivement eu complot, il n'y avait cependant pas eu commencement d'exécution, mais l'avocat général tira partie de toutes les ressources du Code Pénal de l'époque pour demander et obtenir la tête des quatre militaires. Si leur arrestation s'était passée dans le calme et l'indifférence à La Rochelle, leur procès se déroula dans une ambiance électrique et passionnée qui donna lieu à un réquisitoire enflammé et des plaidoiries bouleversantes. Parmi les trente six accusés, certains ne furent pas poursuivis, d'autres furent acquittés et d'autres encore condamnés à des peines de prison.
Cet épisode qui maintenant est définitivement inscrit dans l'histoire et même dans la légende, fut empreint de beaucoup d'illusions, d'approximations, d'inconséquences voire d'incompétences. Il témoigna d'affabulations, d'atermoiements, de trahisons, de délations et de fidélité à un idéal et à un serment. Ce qui aurait pu être la réalisation d'une aspiration humaine légitime pour la liberté s'est transformé en une aventure où les principaux protagonistes responsables et instigateurs du complot n'ont même pas été inquiétés. Le procès de lampiste qui s'en est suivi s'est terminé pour ces malheureux militaires un peu trop idéalistes par une mort infamante sur l'échafaud, sacrifiés sur l'autel de l'ordre public et de la sauvegarde d'un trône et d'un régime qui finiront par être balayés. La réhabilitation qui suivit grâce à la révolution de 1830 leur fit certes recouvrer une dignité posthume mais l'espèce humaine est oublieuse et leur épopée est maintenant réduite à un vague souvenir.
Mes origines rochelaises autant que l'intérêt que je porte personnellement à cette ville et à son histoire m'ont incité à lire ce livre passionnant et même parfois émouvant, fort bien écrit et abondamment documenté. Il plonge le lecteur dans l'ambiance délétère de cette époque à laquelle mettra fin la révolution des « Trois glorieuses », en juillet 1830. C'est un acte de mémoire important et un bel hommage à ces artisans de la liberté qui ont attaché leurs noms à cette cité d'exception.
©Hervé GAUTIER – Novembre 2011.http://hervegautier.e-monsite.com
-
MARIA DEL PILAR – Catherine LABORDE
- Le 05/12/2010
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°480– Décembre 2010.
MARIA DEL PILAR – Catherine LABORDE – Éditions Anne Carrière.
Qu'est ce qui m'a fait ouvrir ce livre ? La notoriété télévisuelle de son auteur ? Sûrement pas ! La beauté de la femme qui apparaît sur la couverture ? Peut-être car un livre commence aussi par là ! C'est plus assurément son nom espagnol et la mention qui apparaît en filigrane sur la photo d'identité : « combattant ». Sa coiffure évoque les années 40 quand, en France, il y avait la guerre. On a un peu trop vite oublié le rôle qu'ont joué les Espagnols, qui étaient le plus souvent républicains, dans ce conflit. Ils ont choisi d'aider notre pays qui les avait pourtant bien mal accueillis, ils ont choisi, le plus souvent dans l'ombre, de combattre ainsi contre le fascisme, comme ils l'avaient fait, chez eux, pendant le conflit sanglant de la « guerre civile ». Nous leur devons beaucoup et c'est sûrement cela qui m'a fait ouvrir ce livre !
Ce n'est pas un roman, où si peu [Ce livre ne comporte sur la couverture aucune mention de ce genre, mais une telle démarche laisse toujours une place à l'imaginaire]. La présentation sous forme de journal semble, dans sa première partie, indiquer un document brut retrouvé longtemps après et qui narre dans un style anecdotique une histoire simple, peut-être un peu enjolivée, mais peu importe. C'est une histoire d'amour comme il y en a tant, sans doute, mais celle-là se passe en temps de guerre. Maria est couturière à Tarbes, membre d'un réseau de Résistance. Irène est son nom de guerre et elle est Espagnole. Elle est amoureuse de Charles, lorrain et également chef de ce réseau. Elle est à ses côtés pendant la durée de la guerre, ils s'aiment mais, peu avant la Libération, il disparaît, probablement arrêté. De Tarbes à Paris elle le recherche, pendant un an, glanant d'improbables nouvelles, lui écrivant des lettres que, faute d'adresse, elle garde et range dans une valise en attendant son retour. Il aurait été fait prisonnier par les Allemands, serait dans un camp... Elle l'attend, avec pour soutien des nouvelles rares, hypothétiques et parcimonieuses, avec aussi le risque de ne pas le reconnaître à son retour. Elle n'a de lui que de rares photos, les épreuves meurtrissent les visages et les corps. Il se peut aussi qu'il l'ait oubliée, qu'il soit vivant, mais ailleurs, avec une autre...
A la Libération, ceux qui étaient partis rentrent, mais immanquablement il y a des absents, et Charles est de ceux-là. Il est à Buchenwald, mais il est prisonnier de guerre, officier britannique, en principe protégé par la Convention de Genève. Il ne fait pas partie des déportés, gazés et passés au crématoire. Les premiers camps sont libérés mais Charles reste absent et les nouvelles sont contradictoires, tissant l'espoir et l'angoisse. Pour Maria la paix ne sera pas joyeuse ! Puis en ce printemps 1945, quand la nature renaît, elle apprend la mort de Charles, peu de temps avant. Le journal s'arrête là.
En 1947 Maria épouse Robert, rescapé d'un oflag. Sans jamais oublier Charles, malgré les larmes et la blessure, elle fonde avec lui famille, sans rien lui cacher de sa vie d'avant. Et cet homme « tombe fou amoureux d'une femme qui pleure, plus fou d'amour sans doute que si elle n'avait pas pleuré ».
Dans la deuxième partie du livre, Catherine Laborde, qui jusque là était restée un peu en retrait, choisit donc de parler de sa mère qui avait elle-même rédigé en 1972 un cahier où elle évoque cette jeunesse de guerre, endeuillée par la mort de l'homme dont elle était éperdument amoureuse. Pour elle, l'écriture est un exorcisme autant qu'un témoignage qui dormait depuis longtemps dans un repli de sa mémoire... Pour ne pas le perdre, pour ses enfants, pour elle aussi qui avait un peu tendance à se complaire dans un passé révolu, intense et peut-être trop lourd, elle rédige naïvement ses souvenirs, ses espoirs. Ce genre de tentative intimiste tombe rarement au bon moment d'autant que le silence et le non-dit prennent le pas sur la confidence. Alors on le remet à plus tard, puis la vie continue... et s'arrête!
Parce qu'elle reçoit par hasard une lettre qui évoque cette période, l'auteur fait le chemin à l'envers, aidée de quelques photos, quelques témoignages... Entre crainte et vertige, elle va au devant de la famille de Charles, héros de la Résistance et dont une rue de Sarreguemines porte le nom. Elle découvre l'existence de sa parentèle, à la fois discrète et admirative pour cette histoire d'amour avec Maria que personne n'a oubliée, apprend la trahison et les circonstances de sa mort.
C'est un livre plein de sensibilité, d'émotion communicative, un hommage aussi à cette femme, à son amour devenu impossible pour un homme à cause de la guerre, du danger et finalement de la mort. C'est un témoignage bouleversant sur les chemins de la vie, du destin, sur la grandeur des hommes, sur le hasard qui fait se rencontrer les gens et sur la volonté de faire prévaloir la vie, sur la force de l'écriture qui gomme l'oubli...
Pour des raisons personnelles, j'ai lu ce livre avec passion et émotion. Je ne le regrette pas !
©Hervé GAUTIER – Décembre 2010.http://hervegautier.e-monsite.com
-
CARTAGENA CARAÏBE ET COLOMBIENNE – Bernard Lucquiaud
- Le 11/11/2010
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°473– Novembre 2010
CARTAGENA CARAÏBE ET COLOMBIENNE – Bernard Lucquiaud – Éditions du Panthéon.
Qu'est ce qui fait que nous éprouvons le besoin de relater par écrit une partie de notre vie, de transmettre aux nôtres et aussi aux autres une expérience qui nous a marqués ? Pourquoi choisissons-nous de privilégier un moment de celle-ci plutôt qu'un autre ? Peut-être parce qu'il a été plus créatif, plus enthousiaste, plus émouvant, qu'il a été riche en rencontres et en circonstances d'exception en quelque sorte ...
C'est sans doute le cas pour Bernard Lucquiaud qui, venant de Toronto (Canada) où il avait été professeur dans le cadre de l'Alliance Française, a pris la direction de l'antenne de Carthagène en Colombie. S'en suivirent six années pendant lesquelles il eut à remettre sur pied cet établissement voué au rayonnement de notre culture et notre si belle langue. Cela n'a pas été facile et il a fallu en passer par des exigences et des contingences, des mondanités aussi. Malgré des moyens financiers parfois dérisoires, il lui a fallu de l'imagination, de la créativité, du culot, de la chance, de la bonne volonté, du courage pour affronter les truands mais aussi l'administration et la diplomatie, un grand sens de l'organisation, de l'abnégation aussi pour finalement faire évoluer les mentalités, reculer la délinquance, faire naître des vocations professionnelles et finalement, dans le contexte de l'amitié colombo-française, de donner de notre pays une belle image, c'est à dire celle qu'il mérite.
« Carthagène des Indes », une ville coloniale et andalouse, un nom qui fleure bon le dépaysement, l'aventure, les terres lointaines, les tropiques, l'exotisme, l'ensorcellement du lieu aussi. On la surnomme d'ailleurs « la perle des Caraïbes ». L'auteur aborde cette ville avec les yeux émerveillés de l'étranger mais aussi avec dans la tête toutes les connaissances de la civilisation pré-colombienne, le mythe de l'El Dorado, l'histoire de ces Espagnols en quête de l'or, arrivés par la mer et que les Indiens prenaient pour des dieux, de la folie qui s'était emparé des conquistadors qui n'étaient bien souvent que des voyous, de l'extermination de cette civilisation au nom de la recherche du profit aussi de l'inquisition, de la colonisation... L'enseignant qu'il est se fait guide touristique et aussi refait l'histoire pour son lecteur, émaille son propos de citations littéraires, mais le pays de cocagne, la terre de tous les superlatifs est régulièrement pillée, se défend parfois victorieusement, est en partie détruite, renaît de ses cendres, devient un port négrier au XVIII° siècle et accède à l'indépendance avec Bolivar.
Mais tous ses rêves d'enfant tissés au fil des lectures et de l'imaginaire deviennent d'un seul coup des réalités d'adulte, tout cela va s'évanouir et faire place rapidement à la déception. La circulation y est désordonnée, les transports publics approximatifs, le service de santé folklorique, la corruption est partout, le trafic de drogue fait partie de l'économie, la criminalité est omniprésente, l'insécurité est quotidienne, la mort rode ... Pour cette antenne de l'Alliance française, les subventions sont minces, parfois détournées, l'auto-financement et souvent la débrouille deviennent la règle pour obtenir l'équilibre financier. Entre vivoter et se développer, il a choisi, mais cette politique d'épanouissement due à son ambition de directeur n'est pas sans soulever des difficultés, susciter des critiques, froisser des susceptibilités et générer des échecs ... Mais ici tout est différent, l'extraordinaire est banal, il n'y a pas de fêtes sans alcool, sans euphorie, sans extravagances, sans couleurs, sans musique...
Le professeur de Lettres qu'il reste cependant ne peut pas ne pas rencontrer Gabriel Garcia Marques, le fabuleux « Gabo », dont le talent sera, quelques années après cette rencontre, consacré par le prix Nobel de littérature. Son parcours personnel, chaque moment de sa vie et de celle de sa famille nourrissent son écriture et deviennent autant de romans qu'il a su, avec génie, faire partager à son lecteur, avouant lui-même que « La vie n'est pas ce que l'on a vécu, mais ce dont on se souvient et comment on s'en souvient ».
Une telle expérience ne saurait laisser celui qui la vit indifférent. Il en tire nécessairement un enseignement sur le peuple qu'il a appris à connaître, mais il ne suffit pas de faire rayonner sa propre culture en la considérant comme supérieure à celle des autres. A l'heure de le mondialisation, il conclut en paraphrasant Candide « il faut cultiver ensemble le même jardin, notre planète » car la nature que l'homme asservit et tue de plus en plus lui est pourtant essentielle. Il clôt ce récit par une réflexion personnelle et une manière d'avertissement à la fois humaniste et écologiste « Homme, arrête de convoiter ton voisin et de le mépriser... C'est en puisant dans nos cultures respectives et en respectant notre environnement que nous assurerons l'avenir de nos enfants ».
Il ne s'agit pas d'un roman comme il est dit dans la préface, mais d 'un témoignage rédigé dans un style narratif et anecdotique, plein de détails et parfois même émaillé d'humour et d'images poétiques qui témoignent de cette aventure d'exception. J'ai lu ce livre avec le yeux d'un sédentaire toujours émerveillé par les voyages lointains, par une ville jusqu'alors inconnue, maintenant vouée à la modernité et assurément fascinante. Je reste admiratif devant son action personnelle en faveur de la France mais aussi attentif au rayonnement de notre culture. Il nous rappelle opportunément que nous sommes tous citoyens du monde.
©Hervé GAUTIER – Novembre 2010. http://hervegautier.e-monsite.com
-
SANS ENTRAVES ET SANS TEMPS MORTS - Cécile Guilbert
- Le 18/05/2010
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°426– Mai 2010
SANS ENTRAVES ET SANS TEMPS MORTS – Cécile Guilbert - Gallimard.
Le titre est déjà tout un programme dans une société qui aspire à davantage de liberté, qui est possédée par la vitesse obligatoire d'exécution de tâches alors que l'espèce humaine est encline à la paresse, à la nonchalance...
La 4° de couverture m'en dit un peu plus qui cherche à caractériser l'écrivain contemporain et qui propose comme définition « un corps capable de se déplacer à travers le temps sur un maximum de théâtres d'opérations en trouvant partout matière à penser », autant dire quelqu'un à qui rien n'est étranger, qui promène sur le monde passé et présent un regard curieux et surtout critique, et il faut dire que notre pauvre monde se prête bien à cet exercice! Et des écrivains cités dans ce livre, il n'en manque pas!
A première vue, c'est une sorte de mosaïque de 50 textes déjà parus dans diverses revues, embrassant l'avis de l'auteur(e) sur les époques, les genres, les cultures... et surtout la littérature. Tout cela est bel et bon, mais qu'y a t-il de commun entre une réflexion menée sur le luxe, les vêtements noirs [elle en profite pour nous confier son goût immodéré pour cette couleur appliquée au porte-jarretelles], son témoignage pour Jean-Luc Godard, l'urbanisation contemporaine, l'histoire du rock ou la cruauté de Johnathan Swift? Et de nous avertir « contrairement au préjugé courant, les mots, servent pas à décrire la réalité, mais à créer du réel ». C'est une approche originale du phénomène de l'écriture et une piste finalement pas si inintéressante par laquelle on peut aborder la littérature.
Auteur(e) de romans, elle ne pouvait pas ne pas consacrer une partie de sa réflexion au langage qui est notre commun moyen d'expression et surtout le matériau de prédilection des « gens de lettres ». Elle note que chacun possède ses mots ou plus exactement en fait un usage personnel, ce qui complique un peu les choses puisque, par définition, ils sont une convention. Elle croit bon de préciser également que « la plupart des livres actuels sont écrits comme on cause ... pour aboutir à une absence de pensée quasi aphasique», ce qui n'est pas faux. Et de fustiger, pour illustrer ce propos, Houllebecq et Beigbeder, ce qui n'est pas pour déplaire à l'auteur de cette chronique! Elle dénonce le roman actuel, pas vraiment romanesque, trop autobiographique, trop standard ou trop impersonnel, c'est selon. Elle pointe du doigt le mélange des genres, comme le passé s'oppose à l'avenir ou quelque chose comme cela. Elle défend aussi ceux qui font partie de sa bibliothèque personnelle, Artaud, Chamford, Rimbaud, Sade, Céline, les appellent en quelque sorte à la rescousse, et là c'est plutôt bien. Elle réhabilite aussi des écrivains oubliés, des icônes actuelles, ce qui n'est pas mal non plus.
J'ai lu cet essai jusqu'au bout en appréciant peut-être davantage le ton que le style. Le livre est dense par la diversité des articles et des sujets traités. J'avoue bien volontiers que j'étais sceptique au départ puisque ma curiosité va plutôt vers la fiction. Le livre refermé, j'y vois un regard qui m'a paru pertinent, même si on peut toujours dire que la critique est facile. Elle a au moins le mérite d'être exprimée, de remettre en cause les choses les plus convenues et les plus consacrées par notre société prompte à la louange en faveur de ceux qu'elle a consacrés et ainsi d'ouvrir un débat. Je dois avouer que j'ai apprécié aussi l'érudition, le goût de la polémique, la sensualité et la liberté de parole qui justifie le titre, surtout si elle se fait libertaire et libertine, ce que je ne peux pas ne pas apprécier. C'est une invite à la lecture, à la fréquentation de notre belle langue française, et je ne pouvais pas en faire l'économie, d'autant qu'elle mène une large réflexion sur la littérature.
Cette invitation à jouir, dont il est question sur la 4° de couverture me paraît, évidemment de bon aloi. On la peut résumer en quelques mots: beauté, luxe, liberté, volupté, amour, vie... et la liste n'est pas exhaustive, reste ouverte à toutes les déclinaisons, et là aussi, c'est sans entraves et sans temps morts!
J'avoue que je ne connaissais pas Cécile Guilbert. Ce livre sera peut-être l'occasion de poursuivre cette découverte, quoique j'y préférerais sans doute son écriture romanesque, mais davantage pour faire « un petit bout de chemin » avec elle et apprécier, par la lecture, le plaisir évident qu'elle a d'écrire. Il est gourmand, jubilatoire...
Je préfère toujours cette approche à celle que la « presse spécialisée », trop souvent laudative, conseille pour le seul motif qu'un jury littéraire aura consacré un de ses ouvrages.
© Hervé GAUTIER – Mai 2010.http://hervegautier.e-monsite.com
-
SERAPHINE, de la peinture à la folie- Alain Vircondelet
- Le 24/09/2009
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°369– Septembre 2009
SERAPHINE, de la peinture à la folie- Alain Vircondelet – Albin Michel
L'univers des autodidactes m'a toujours fasciné, tout comme la spontanéité du style naïf en peinture comme dans d'autres disciplines artistiques. D'autre part, le succès, la notoriété ont des lois que je ne m'explique pas très bien surtout quand ils se manifestent en dehors des voies royales de la médiatisation, du matraquage journalistique ou d'un parisianisme incontournable.
Rien ne prédisposait en effet, Séraphine Louis, née à Asny [Oise] en 1864 dans une famille pauvre, d'un père horloger itinérant et d'une mère domestique de ferme qui meurt alors qu'elle vient d'avoir un an, à connaître le succès. Son père meurt lui-même alors qu'elle n'a pas encore sept ans. C'est donc une orpheline qui, recueillie par sa sœur aînée, devient bergère, domestique au Couvent de la Providence à Clermont [Oise] puis femme de ménage, à partir de 1901, à presque quarante ans, dans les familles bourgeoises de Senlis. C'est dans cette même ville qu'en 1912 s'installe un collectionneur et marchand d'art allemand, Wilhem Uhde, lassé de la vie parisienne. Amateur de Picasso et du Douanier Rousseau, il remarque, chez des notables, de petites œuvres peintes sur bois et découvre que leur auteur n'est autre que sa propre femme de ménage, Séraphine. Voilà tous les ingrédients d'un conte de fée, mais la réalité est toute autre. Celle qui aurait voulu devenir religieuse par amour de Dieu et qui a été maintenue par la Mère Supérieure dans sa condition de simple servante à cause de sa pauvreté et de son absence de dot, garde cependant en elle une foi inébranlable. Considérée comme un esprit simple, sans instruction et sans fortune, elle est finalement poussée dehors et commence à peindre en s'inspirant de ce qu'elle connaît, des images pieuses, des vitraux, des statues des églises et du culte marial, des fruits, des fleurs et des feuilles.
Elle s'humilie devant Dieu qui, le pense-t-elle, lui dicte son cheminement artistique. Elle peint sans véritable technique, sans avoir jamais appris, au Ripolin, pratique des mélanges inattendus et improbables mais reste à l'écoute exclusive de cet « ange » qui la guide. C'est un peu comme si, en elle, se révélait une sorte de « mémoire héréditaire » dont elle était l'expression, la manifestation, avec en plus la main de Dieu pour la soutenir. La folie mystique qui l'habite et dont elle ne cache rien, la fait déjà considérée par la rumeur publique comme une folle. Elle se compare à Jeanne d'Arc, à Bernadette de Lourdes, se définie comme une « voyante de Dieu », prétend entendre des voix qui lui intiment l'ordre de peindre, ce qu'elle fait comme un devoir sacré.
Après la guerre de 14-18, Uhde revient s'occuper d'elle et la révèle au grand public, organise des expositions. Son style, naïf et primitif, s'inspire d'une nature luxuriante semblable à celle qu'elle imagine au Paradis Terrestre. On la compare déjà au Douanier Rousseau et les surréalistes s'intéressent à ses œuvres. Elle-même se reconnaît une parenté artistique avec Van Gogh. La notoriété aidant, elle devient imbue d'elle-même, et elle qui avait toujours vécu de peu, se met à faire des dépenses inutiles et couteuses malgré les mises en garde de Udhe. Son style change et se surcharge de pierreries et de plumes, les couleurs, vives au départ, s'assombrissent mais elle continue d'exploiter les thèmes bibliques ... Sa peinture est, d'une certaine façon, la synthèse entre Dieu et les hommes, se définissant elle-même comme une médium solitaire et secrète, investie par les puissances surnaturelles. Dès lors, elle se prétend « l 'élue de Dieu », sa servante, son instrument, s'affirme cependant « sans rivâle » et s'enfonce de plus en plus dans une folie irréversible.
La grande dépression des années trente met fin à ses ventes ce qui affecte sa santé mentale et physique au point qu'on songe de plus en plus sérieusement à un internement. Les symptômes délirants s'accentuent avec la perspective de la guerre qui s'annonce, Uhde, juif, anti-nazi et homosexuel, disparaît, et avec lui sa source de revenus. Son discours mystique s'accentue, elle parle de la mort, abandonne la peinture, s'enfonce de plus en plus dans un dénuement moral dont elle ne sortira plus. Des plaintes sont déposées et, possédée par un délire définitif, finit par troubler l'ordre public, ce qui la précipite à l'hôpital psychiatrique de Clermont en 1932. Elle perd complètement la tête ainsi que l'atteste un rapport de police. Dès lors personne n'entendra jamais plus parler d'elle, elle ne fera jamais plus partie de ce décor provincial où elle dérangeait. Elle y restera dix ans sans jamais reprendre la peinture, prostrée, comme si cette vibration qui avait guidé sa main l'avait définitivement quittée. Elle est victime de délires hallucinatoires, de psychoses, l'hystérie la gagne et elle souffre de persécutions. Uhde retrouve sa trace et l'aide financièrement pour adoucir son sort, mais dans cet univers, la peinture qui a été toute sa vie n'a plus d'importance.
Son délire s'accentue dangereusement, elle se croit enceinte et la deuxième guerre mondiale éclate la précipitant dans un état de dénuement physique et mental alarmant que les restrictions alimentaires et un cancer aggravent. La politique d'extermination des nazis à l'égard des malades mentaux la précipite, fin 1942, dans la mort solitaire, mais c'est aussi de faim qu'elle meurt. Personne ne réclamant son corps, elle sera ensevelie à la fosse commune.
C'est un livre passionnant et agréablement écrit que j'ai lu d'un trait tant l'histoire de cette femme est inattendue mais pourtant si commune à celle de bien des artistes, et comme le note l'auteur « Comme Camille Claudel morte dix mois seulement après elle et dans les mêmes circonstances, elle a été de ces artistes qui ont été au bout d'eux-mêmes, à l'extrême de leurs limites et qui ont accepté la plus grande violence contre eux » .
De nombreux musées, celui de Nice, de Senlis mais aussi le musée Maillol à Paris exposent ses œuvres.
(C) Hervé GAUTIER – Septembre 2009.http://hervegautier.e-monsite.com
-
EXPOSITION EXCEPTIONNELLE AU MUSÉE DU DONJON DE NIORT.
- Le 03/07/2009
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°348– Juillet 2009
EXPOSITION EXCEPTIONNELLE AU MUSÉE DU DONJON DE NIORT.
[Vernissage du mardi 30/6/2009 – Exposition Juillet-Août 2009]
Renseignements 05 49 78 72 04 – musees@agglo-niort.fr
Je ne pouvais laisser passer un tel événement, dans une ville où l'intérêt du plus grand nombre ne va pas naturellement vers la culture, sans en porter témoignage.
C'est que le patrimoine niortais vient de s'enrichir de 48 tableaux et dessins de maîtres actuellement exposés au musée du Donjon. Il s'agit d'œuvres de Miro, de Raoul Dufy, de Marie Laurencin, de Suzanne Valadon, de Léonard Foujita, Georges Mathieu, d'Aristide Caillaud, de Jean Claude Chauray...
Cela n'a été rendu possible que grâce à une donation de Mme Jeanne Christine Ouvrard [1926-2008], récemment décédée. Elle avait, tout au long de sa vie et grâce à sa fortune personnelle, constitué une collection d'œuvres d'art, qu'elle avait décidé de léguer, à sa mort, et eu égard à ses attaches poitevines, à la ville de Niort. Elle était d'ailleurs cousine avec le comédien Jean Richard, lui-même niortais.
Mais il a aussi fallu aussi un autre miracle, celui de la rencontre de la vielle dame avec Daniel Courant, actuel Conservateur Adjoint du musée d'Agesci à Niort à qui nous devons d'avoir finalisé cette donation. Cela n'a pas été simple, demanda pas mal de temps, connut de nombreux rebondissements et même quelques périodes de découragement, mais le résultat est là, maintenant sous nos yeux. Elle avait cependant assorti ce legs d'une condition, que ces œuvres soient effectivement mises en valeur et ne terminent pas dans d'obscures réserves. C'est non seulement le cas dès maintenant, et quand cette exposition quittera le Donjon, c'est à dire à la fin de l'été, elle trouvera tout naturellement sa place dans notre beau musée Bernard d'Agesci.
Parmi ces œuvres figurent quelques toiles du peintre russe Abraham Mintchine [Kiev 1898- Paris 1931] pour qui elle s'enthousiasma. Celui qu'on appela « l'ange perdu du Montparnasse », membre de l'École de Paris, et dont « la peinture s'exalte dans les rouges qui semblent être de rubis, du sang coagulé, des velours lacérés, des cerises piétinées ou bien des couchers de soleil » [selon le mot de Giovani Testori], fut un artiste extrêmement prolifique. Il connut quand même, à la fin de sa courte vie, la reconnaissance, ne vécut que 5 ans en France mais « sa peinture demeure comme un cri sorti de l'âme, un cri déchirant, à la fois slave, juif et éternel, une association active entre la poésie, la peinture, et le rêve de Mintchine qui trouve aujourd'hui le juste écho au plus profond de nous même. »[Sylvie Buisson-Juin 2000].
Il fit l'objet de nombreux articles. On peut notamment lire sous la plume de Giovani Testori [1981]« Si le génie désespéré de Soutine déflagra dans un ciel parisien comme un hurlement pour rejoindre des sommets que bien peu égalèrent, il conviendra bien d'écrire que, sur le versant d'un déchirement pour ainsi dire serein, Mintchine, sur plus d'une toile, le dépassa. ». Boris Poplavski notait, dès 1931 « Tout chez lui vit, bouge, respire, comme s'il libérait tous les esprits et tous les anges enfermés dans les objets.».
En janvier 1930, la galerie Zak organisa une grande exposition consacrée aux peintres russes où Mintchine eut évidemment sa place. La revue Tchisla, créée cette même année et qui accorda une large place aux manifestations de l'école de Paris, salua le talent de Mintchine qui mourut, le 25 avril 1931 d'une rupture d'anévrisme. Au Salon des Indépendants de l'année suivante, figurèrent dix toiles du peintre disparu ainsi que dans l'exposition consacrée au « Visage humain » organisée par Tchisla. Dans l'article qu'il donna à cette revue, le critique Maximilien Gauthier nota « Même dans ses toiles les moins fantastiques, il parvient à créer une atmosphère qui amène à méditer sur les mystères qui nous entourent » n'hésitant pas à prophétiser « Dans l'histoire de l'École de Paris, le nom de Mintchine devra figurer aux côtés de ceux de Modigliani, Chagall et Soutine ».
Giovani Testori, dans le Corriere della Serra [1981] célébrait le talent de Mintchine en ces termes « Que celui qui aime la peinture aille donc voir de quels miracles fut capable notre « errant »[j'ai plus d'une fois appelé de cette manière les exilés russes réfugiés à Paris]. Une stupéfaction qui ne cessera jamais de croître et de s'élargir, l'arrêtera devant ses toiles, grandes et petites, comme si finalement quelqu'un lui récapitulait en face la puissance miraculeuse d'une peinture qui ne demande rien à elle-même, sinon de révéler sa propre entité qui est précisément ce battement, cet or, cette étendue inoubliable, cette lumière exaltante ».
Mme Hélène Ménégaldo, Professeur de littérature russe à l'université de Poitiers, présente à ce vernissage niortais, a retracé l'itinéraire de ce peintre d'exception.
Actuellement la galerie Di Veroli [Paris 8°] s'est spécialisée dans l'œuvre de ce peintre qu'elle a largement contribué à faire connaître. Massimo Di Veroli, son directeur, qui était également présent lors du vernissage niortais, organise régulièrement des expositions et réalise activement la catalogage de ses œuvres qui, par ailleurs sont conservées dans les musées du monde entier [France, Italie, Suisse, Russie, États-Unis, Israël...].
Cette rencontre fut personnellement une révélation pleine d'émotions et assurément une invitation à davantage de découvertes.
Je suis en outre très heureux de savoir que le musée de Niort devient désormais, eu égard à l'importance de cette donation, un centre européen de référence pour l'œuvre de Mintchine.
©
Hervé GAUTIER – Juillet 2009.http://hervegautier.e-monsite.com
Hervé GAUTIER – Juillet 2009.
-
TRAITE D'ATHÉOLOGIE - Michel ONFRAY
- Le 23/06/2009
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
TRAITE D'ATHÉOLOGIE – Michel ONFRAY - GRASSET.
J'ai beau tenter de m'abstraire de ce christianisme qui a quelque peu bouleversé mon enfance, il continue de répandre ses méfaits dans notre société qui, même si elle ne veut pas l'avouer, garde une profonde empreinte judéo-chrétienne. L'ouvrage d'Onfray, aussi savant que polémique, bien écrit avec humour, documenté, pertinent et impertinent parfois, était donc pour moi l'occasion de faire le point sur ce qui restait de mes croyances intimes, nourries d'ailleurs par une littérature humaniste. Je l'ai donc lu avec attention, y cherchant, le cas échéant, une justification de mes certitudes ou de mes abandons.
Il s'agit donc de parler de la présence de dieu, sous quelque forme que ce soit, dans notre société. Veut-on l'en chasser, il finit toujours par revenir. C'est que les hommes, mortels par essence, occultent, à tout le moins en occident, cette issue normale de la vie qu'est la mort. Il en résulte une peur exploitée savamment par les tenants de toutes les religions, qui, sous forme d'un nécessaire salut dans un au-delà qu'ils affirment réel, se croient autorisés à peser sur notre vie terrestre qui n'est que transitoire. Pour cela, ils nient l'intelligence, la pensée, la réflexion, édictent tabous et interdits, des règles morales dont le respect serait le sésame pour l'accès à ce paradis... Sans quoi, ce sont les feux de l'enfer qui nous attendent, pour l'éternité![une autre peur]! Ainsi assiste-on au retour du religieux dans notre vie et avec lui toute une série de négations, dont celle du corps, celui de la femme [nécessairement inférieure à l'homme par essence] en particulier, de la jouissance qu'il procure et qui serait un obstacle dans ce parcours obligatoire vers dieu. Il convient donc, pour le combattre, d'adopter une attitude hédoniste où l'esthétisme tient une grande place. Pourquoi pas?
De plus, l'homme a besoin de se sentir protégé. Quoi de plus normal que d'inventer une divinité qui jouera ce rôle? A cela, l'auteur oppose une définition de l'athéisme, démystifiant les monothéismes chrétien, juif ou musulman, démontant cette fiction de dieu, en en « déconstruisant » l'idée, sans cependant privilégier le nihilisme, simplement parce l'empreinte religieuse est présente jusque dans notre pensée et dans nos réactions. Que ces religions, qui ne sont finalement que des entreprises humaines, soient néfastes, je veux bien l'admettre, l'histoire est là pour nous en apporter une preuve surabondante [leurs déviances ne sont depuis longtemps plus à démontrer], et ne pas croire en ces religions reviendrait à ne pas croire en dieu, à être athée! Mais qu'en est-il de dieu puisque l'auteur entend nous montrer qu'il n'existe pas, ou qu'il serait mort? Lui aussi serait une création humaine liée à tous nos fantasmes et d'autant plus « crédible » qu'il est immatériel et donc au nom de qui ses représentants peuvent facilement parler! Cela je veux bien le croire. D'ailleurs l'auteur en appelle à des auteurs incontestés pour étayer son discours. Il démontre d'une manière surabondante que Jésus n'a pas existé en tant que personne physique unique, pointe du doigt des contradictions historiques flagrantes, indique que ses apôtres n'ont guère été les témoins de son existence humaine, que la chrétienté se réfère à la Vulgate, rejetant délibérément les écrits apocryphes, que St Paul n'était pas autre chose qu'un ignare frustré, que la chrétienté à fait beaucoup de ravages [et continue à en faire]au nom d'un Évangile dont elle a oublié le message de paix et d'amour, en s'alliant notamment avec tous les pouvoirs terrestres, que la littérature monothéiste est dogmatique, assez approximative et finalement fortement sujette à caution. Bref que tout cela n'est qu'une joyeuse compilation de textes disparates, incohérents, contradictoires et sans grande unité mais que les religions qui s'y réfèrent prennent pour unique boussole et dont chacun s'arrange à sa guise.
Pire peut-être, ces religions qui proclament la paix adorent la guerre et la mort et la justifient bien souvent, sans souci de la contradiction... et les fidèles suivent aveuglément sans mettre en doute cet enseignement! Et il ne réserve pas seulement ses remarques et critiques au seul christianisme, il y associe Judaïsme et islam qui, à se yeux, ne valent pas mieux sur le plan de l'enseignement.
Face à ce déferlement de démonstrations et de vérités, l'auteur milite pour une laïcité post-chrétienne... mais il avertit, elle s'appuie aussi sur l'éthique judéo-chrétienne et ne cherche à en modifier que la forme, l'aspect visible. La pensée laïque conserve un fond de christianisme, il faut donc la dépasser. L'égalité prônée par la république ne serait pas suffisante et peut-être même néfaste en ce qu'elle invite au relativisme qui uniformise tout. Selon l'auteur, il faut « promouvoir une laïcité post-chrétienne, à savoir athée, militante et radicalement opposée à tout choix de société entre le judéo-christianisme occidental et l'islam qui le combat » et de conclure « Aux rabbins, aux prêtres, aux imams, ayatollahs et autres mollahs, je persiste à préférer le philosophe ».
Cette invitation à ne plus croire en dieu m'intéressait d'emblée, cela me paraissait un thème de réflexion parfaitement humain. L'étude documentée des trois religions monothéistes m'a paru convaincante, encore qu'appliquée au raisonnement logique, leur discours toujours prosélyte ne résiste pas bien longtemps. Cependant la préférence donnée à la philosophie, comme remplacement efficace à des croyances aussi brillamment combattues ne me convainc pas davantage. Je dois cependant noter qu'elle a au moins l'avantage de ne pas jouer sur l'existence d'un monde après la mort et de fonder son enseignement sur cette hypothèse.
Ce livre ne fera de moi ni un athée convaincu ni [ sûrement pas] un chrétien militant!
©Hervé GAUTIER – Juin 2009.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA CONTREBASSE – Pièce de Patrick SUSKIND avec Jacques VILLERET.
- Le 05/04/2009
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 1 commentaire
N°157
Juin 1993
LA CONTREBASSE – Pièce de Patrick SUSKIND avec Jacques VILLERET.
Au risque de passer pour un importun et d‘aller à l’encontre d’une opinion laudative, je dirai que cette pièce, écrite en 1980 par Patrick Suskind m’a laissé une impression mitigée, pas vraiment mauvaise, mais largement en-deça de tout le bien que j’en ai entendu dire.
Non que Jacques Villeret fût mauvais, tant s’en faut, mais le texte m’a paru très moyen, et si cette pièce se veut être une comédie, il n’y a pas là de comique de mots, pas davantage de comique de situation. A preuve, le rire, quand le public en gratifie l’interprète, va plutôt à un effet de scène de Villeret qui, à mon sens, rachète beaucoup le texte.
De quoi s’agit-il ? simplement d’un homme de 35 ans qui connaît une solitude forcée (soulignée d’ailleurs par un monologue de 2H30 – une véritable performance pour l’interprète), un petit fonctionnaire de l’Orchestre National qui a renoncé à une carrière de virtuose plus en vue, pour préférer cet instrument encombrant qu’est la contrebasse ! Pourtant, a-t-il vraiment choisi ?
Au vrai, il est cossard, et qui plus est, limité dans ses possibilités. Il passe son temps à ressasser ses échecs. C’est un petit musicien d’orchestre, « un contrebassiste du 3° pupitre au fond » (derrière lui, il n’y a plus personne) à qui on ne fait guère attention et qui peut se permettre, en toute impunité, de ne jouer que quelques notes sans qu’on relève ses manquements ! Après tout, il ne sert que d’accompagnement !
C’est un être irascible qui passe ses nerfs sur son instrument, n’y voyant qu’un exutoire, se contentant de boire de la bière et de caresser les formes de sa contrebasse, faute de pouvoir effleurer celles de Sarah, la chanteuse soprano qu’il aime en secret, qui ne le connaît pas et qu’il n’aura jamais. C’est un être cupide, envieux, pusillanime, méchant et sans envergure qui remet chaque jour au lendemain le coup d’éclat qu’il prépare depuis longtemps, celui de lancer son cri d’amour à Sarah, en plein orchestre, ce qui attirera l’attention sur lui… mais lui coûtera sa place !
C’est un être mal dans sa peau, aussi petit que son univers quotidien de fonctionnaire. Il n’a peur de rien, mais ne fera rien pour être mieux qu’un modeste contrebassiste mal payé et qui rêvera toute sa vie de celle des autres, de ceux qui emmènent Sarah « dans des restaurants de poissons ». Lui restera éternellement à la porte, écarquillera les yeux à travers la vitre, mais ce sera tout ! Il est amer, un peu raciste, quant à la musique, s’il en joue, c’est sans l’aimer vraiment.
On aurait pu imaginer, puisque nous sommes en pleine fiction qu’un dialogue surréaliste s’installe sur scène et que l’instrument prenne la parole et réponde au personnage. Là un effet comique eût sûrement été au rendez-vous… Mais la contrebasse reste muette, se contentant d’imposer sa silhouette massive jusqu’à la fin. C’est que le personnage n’a rien de comique en lui-même, il joue le rôle ingrat de celui qui s’est égaré dans cette vie qu’il voyait autrement pour lui. Il s’y débat seul, sans grand espoir ni peut-être volonté d’échapper à sa condition qui ressemble pourtant à la condition humaine ordinaire.
Je le répète, Jacques Villeret sauve cette pièce. Je pense simplement qu’on s’est trompé de registre en voulant en faire une comédie, alors que c’est d’un drame qu’il s’agit.
© Hervé GAUTIER.
-
Sheller en solitaire.
- Le 01/04/2009
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°257 Août 2006
Sheller en solitaire.
Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises dans cette chronique, la valeur d’une publication ne réside pas uniquement dans sa nouveauté. Ce disque a été réalisé en public en 1991 par Wiliam Sheller et reprend de nombreuses chansons restées dans ma mémoire.
C’est quand même plus fort que moi, j’aime ces mots poétiques auxquels s’accrochent les notes claires d’un piano solitaire et complice. Ils font revivre l’enfance, difficile, nostalgique, la famille qui n’est peut-être pas celle qu’on avait espérée, qui ne correspondait pas tout à fait aux clichés admis « Dans cette famille où les gens voulaient toujours tout remettre en cause », où la quête de l’autre est forte, interrogative, s’apparente à de l’amour ou à quelque chose qui y ressemble « Et quand t’étais là, je ne savais rien dire, tu ne voyais même pas ce que ça voulait dire, quelqu’un qui tient ton regard aussi fort ». Chacun s’y s’affirme dans un rapport de force qui sera plus tard la règle d’un jeu adulte « Fallait savoir passer devant mes frères qui jugent et s’interposent »[Basket Ball]. L’enfance est un bien transitoire où l’on engrange des secrets étranges qu’on est seul à connaître. Ils forment les souvenirs d’un monde à venir, en seront les rêves, les fantasmes, les remords aussi… « Le goût usé d’un souvenir de jeunesse qu’on tire d’une machine à cachous » [Petit comme un caillou] J’ai choisi d’y lire le tumulte, l’angoisse, la peur du lendemain, de la mort peut-être, de l’absence assurément, de l’incompréhension, à cause de la différence d’âge, de l’éducation qu’on doit accepter, des choses qu’on doit faire parce qu’elles se font, et que c’est ainsi« Nicolas, il veut pas qu’on l’embête, tout ce qu’il a dans la tête c’est qu’ il veut rentrer chez lui, j’veux pas rester icii ».[Nicolas]
Mais bientôt, l’adolescent se libère, prend sa vie à pleins bras, la vit avec le hasard pour boussole, pour carte, l’image fluctuante des nuages, respiration blanche sur le fond bleu du ciel, avec des rêves et des projets plein la tête, parce qu’on l’a lâché seul, en lui recommandant de se débrouiller « On m’a bandé les yeux avant que j’ai vu le chemin, on n’a jamais dit viens, on m’a dit va où tu veux »… Alors pourquoi pas ici ? [Un endroit pour vivre]. Avec en soi, chevillé à l’âme, la certitude de n’être pas grand chose dans cette grande comédie d’une société qu’on n’a pas choisie et dans laquelle on se débat « Je suis un homme de peu, je suis le fils de rien, on m’a bandé les yeux avant que j’ai vu le chemin ».[Un endroit pour vivre] avec aussi cette solitude qui fait partie du jeu, qu’on aime ou qu’on apprivoise, qu’on exorcise un peu « je courre à côté d’un train qu’on m’a donné au passage, de bonheur … j’me sens toujours tout seul »[J’courre tout seul]. Il y a ceux qui réussissent et qu’on aime pour cela, qu’on envie, et les autres qui poussent des chimères sans consistance, parce que les mots sont du vent, ne bâtissent que des châteaux de sable, friables et éphémères. C’est qu’ils ne sentent pas bien « dans ce mal foutu monde » où ils n’ont pas leur place. Leurs histoires d’avenir « ne tiennent pas debout », alors, on les voue à la désespérance.
Il y a les jeunes filles qui deviendront femmes, aimantes ou indifférentes. Pour l’adolescent solitaire, elles vivent dans un autre monde, inaccessible, et les rêves deviennent fous « moi je ne vois rien, je suis fier, et je suis fou de vous … elle s’en fout »[fier et fou de vous] « Est-ce tu sais que j’taime en pagaille, c’est comme un mal de vivre à la débraille » [Les mots qui te viennent tout bas]. Il en reste toujours un peu de ces timidités maladives qui laissent une grande place à la chance « J’attendais toujours là debout, dans ce dernier coin qui me reste, que tu reviennes un jour passer devant chez nous » [Petit comme un cailloux ]. Parfois on peut aussi choisir de se trouver là, simple spectateur d’un décor « Les filles de l’aurore… elles ont autour du corps de l’amour et de l’or que l’on peut jouer au dés ». On pense, avec raison peut-être, qu’on y restera toujours un peu étranger, alors on tresse des mots qui sont longtemps restés au fond de sa gorge, qui n’ont jamais pu être dits ; on les écrit, dans le silence de la page blanche et du crissement de la plume sur la feuille. Les phrases, qui parfois sont des vers, sont jetées au vent, au hasard, ou jalousement conservées dans les replis de l’âme, pour qu’elles ne soient pas perdues. Elles sont à l’image de la folie qu’on porte en soi, l’autre face de nous-même ! Mots-messages, confiés au vent comme une bouteille livrée aux vagues, avec cet espoir fou qu’ils seront reçus et compris. Ce ne sont plus de simple vibrations mais de véritables déclarations intimes « Jusqu’à chanter des mots où tu te reconnaîtras » [Un endroit pour vivre]
La figure de la femme est présente, certes un peu idéalisée, un peu enivrante aussi. Elle accompagne cette vie, l’embellit peut-être. Sa conquête devient une quête intime et perpétuelle « J’ai gardé un mirage dans un drôle de cage, comme savent construire les fous… je t’ai cherchée partout » [Les miroirs dans la boue]
Quand même, la recherche du bonheur qu’on n’a pas connu est légitime, parce qu’on n’a qu’une vie, parce qu’on l’a juste entr’aperçu, comme une vision furtive, à travers les yeux des autres avec cette intuition prégnante, que ces joies existent mais ne sont pas pour soi [Je voudrais être un homme heureux] Alors on aborde ce monde et les gens qui le peuplent avec retenue, avec crainte, parce que cette quête reste empreinte de mystères, de doutes, parce l’amour procède de cette étrange alchimie où l’inconnu le dispute à l’espoir… « Et moi j’te connais à peine, mais ce s’rait une veine qu’on s’en aille un peu comme eux, on pourrait se faire, sans qu’sa gêne, de la place pour deux » [un homme heureux]
La solitude de William Sheller n’est pas seulement celle du musicien face à son instrument, ses doigts effleurant parfois les touches noires et blanches, parfois les frappant littéralement. Mots et notes trahissent cet isolement, cet abandon, que la poésie distille. Il y a dans la musique et dans ce compagnonnage avec son piano quelque chose de doux et de violent à la fois. Avec ses mots poétiques, cela donne quelque chose de bien, un dépaysement, une complicité, un climat ...
© Hervé GAUTIERhttp://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg
-
THE BEST OF PAOLO CONTE.
- Le 30/03/2009
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°265 – Janvier 2007
THE BEST OF PAOLO CONTE.
Paolo Conte, c’est d’abord la musique, une musique caractéristique avec sa voix rocailleuse et profonde comme les vallées et les montagnes de son Piedmont natal. Son parti pris pour le jazz ne se dément pas dans ce disque[ Sotto le stelle del jazz – Happy feet].
Les chansons sont traditionnelles et ont fait depuis longtemps son succès [Gelato al limon, via con me, Azzurro…], accompagnées au « piano forte » égrenant ses notes enivrantes et toujours avec cette couleur entraînante et dépaysante que prête le jazz et son rythme « Nouvelle Orléans »[Gong-oh]. Je n’oublierai pas non plus la Milonga qui ne l’a jamais laissé indifférent [Alle prese con una verde milonga ]
A mes yeux, un disque, c’est comme un recueil de poèmes ou les textes ne sont pas choisis au hasard mais entendent faire passer quelque chose qu’il faut lire et découvrir avec sa propre sensibilité sous les notes et sous les mots.
C’est la recherche de la femme, son double, son complément, une étrangère peut-être [Via con me - Elisir] mais aussi quelqu’un qui se situe à la lisière de l’incompréhension et de la complicité, la critique [Sparring Partner], la trahison et l’abandon peut-être, la solitude sûrement [Azzzurro] avec aussi un brin de nostalgie [Ho ballato di tutto], quelque chose comme un amour impossible et un regret du temps qui passe laissant derrière lui la cicatrice des souvenirs.
C’est peut-être une vue de mon esprit, mais je choisis d’y voir une forme de révolte contre la solitude, le temps qui passe et avec lui toute chose, même les plus intimement et amoureusement vécues [Gelato al limon] parce que l’amour peut n’être qu’une passade, qu’une foucade et ne durer que le temps d’une glace au citron, d’une journée à la mer, que la vie transitoire et contingente n’est finalement qu’une comédie, qu’une illusion et qu’il n’en restera rien quand elle aura été rejointe par la mort.
Cette évocation d’Hemingway, que je tiens personnellement comme le plus grand écrivain américain et assurément un témoin et un acteur de son temps, ne peut me laisser indifférent. Elle est à la fois un hommage à sa vie mais passe sous silence sa recherche constante de la mort qu’il finit par trouver dans le suicide. Je fais confiance à Conte pour tresser les mots dans une suite annoncée « Peut-être un jour, m’exprimerai-je mieux ? », dit-il à la fin de sa courte chanson.
Cette existence, ce passage sur terre, n’est pas un long fleuve tranquille, cela nous le savions déjà, le doute et la déprime en font partie et l’image juste évoquée du « Mocambo » et son arrière goût d’échec vient nous le rappeler[Gli impermeabili]. Là, le rythme change, comme pour souligner cette différence d’approche.
Je retiens aussi cette image fugace de cinéma, celle des journaux qui s’envolent [Bartali ], cette enfance à jamais enfuie et si bien invoquée à travers les images de Gênes, une ville et une chanson qui se confondent sous ses doigts et dans sa voix et qui reste pour moi un poème émouvant, un vrai chef-d’œuvre [Genova ].
Son écriture m’a toujours paru délicieusement surréaliste[Gong-Oh – Sparring-partner…] et évocatrice de cette écume des jours qui nous envahit et parfois nous submerge. Paroles écartelées qui répondent à une musique parfois désarticulée où le musicien et le poète se confondent et se rejoignent pour un moment d’exception.
Pour que le tableau soit complet, il lui ajoute une note de dérisoire [Quadrille] et aussi un soupçon de légèreté[ Happy feet]
Ce qui manque dans ce disque apparemment enregistré en studio, c’est le public, son public qui accompagne si bien chacun de ses passages sur scène et qui sait lui témoigner son attachement et son admiration… mais c’est quand même un bon moment.
© Hervé GAUTIER http://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg
-
Paolo CONTE
- Le 30/03/2009
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°253 – Mai 2006
Paolo CONTE
Cela fait longtemps que sa voix rauque habite ma mémoire.
Le hasard qui gouverne notre vie, la guide et parfois l’éclaire, m’a donné à découvrir ces derniers mois, les paroles de ses chansons et sa musique.
Je suis un amoureux du jazz, un béotien amoureux, sans aucune connaissance artistique, musicale ou technique, mais cette musique m’émeut, me fait marquer le tempo et me transporte, malgré moi, sans un ailleurs indistinct dont les arcanes me sont à la fois complètement inconnues et agréablement enivrantes. Cette musique qui illumine mon quotidien, sans que je sache vraiment ce qui m’y attache, sans que je comprenne pourquoi, moi qui suis incapable de sortir un son agréable d’un instrument de musique et pour qui le solfège reste une écriture illisible, un langage étrange et surtout incompréhensible… Je n’ai pas non plus ces connaissances qui font reconnaître un morceau aux meilleurs aficianados. Non, rien de tout cela, mais j’aime simplement la façon très particulière dont Paolo Conte distille le jazz, son jazz ! Je ne l’ai jamais entendu ailleurs que sur disques mais je comprends pourquoi des foules se déplacent pour l’écouter !
Et pourtant, le rythme que je retiens et qui me parle chez cet artiste, c’est moins le jazz que la musique mélancolique alliée à des paroles qui ne le sont pas moins et qui me plaisent peut-être davantage encore. Elles semblent écrites alternativement avec une encre diabolique, pleine de délire et de liberté au regard des règles académiques, parfois joyeuses, parfois tristes. Les notes semées sur son « piano forte » prennent une couleur plus sombre et nostalgique qui me plaît. Je choisis d’y lire les états d’âme d’un écorché vif par la vie, d’un poète aux amours impossibles qui poursuit inlassablement des chimères qui toujours lui échappent, des fantasmes distillés à travers l’image fugace des femmes entraperçues. Cela ressemble à une quête de quelque chose d’indistinct, situé ailleurs, loin de ces paysages gris et pluvieux d’un quotidien bien ordinaire qu’il barbouille de bleu, mais cette couche de mauvaise peinture ne tient jamais bien longtemps.
Il me semble parfois incompris, parfois délaissé par les femmes qu’il recherche et dont il poursuit l’ombre jusque dans le souvenir comme seuls savent le faire les êtres timides qui s’en remettent au hasard, à la chance qui souvent les déçoivent. C’est comme s’il habillait sa détresse de mots, comme des incantations, comme si ces phrases subitement démembrées et juste suscitées, renouvelaient cette impression première, avec une grande économie de paroles, comme si elles ne voulaient pas venir se poser sur la blancheur de la page ? Il me semble un poète égaré dans un monde qui pourtant l’enchante, avec une lourde valise encombrante. Elle est pleine de désirs inassouvis, de regrets, de remords, de fantasmes, de souvenirs, d’échecs mal vécus, avec la nostalgie de cette enfance comme un pays définitivement quitté sans espoir de retour, mais qui laisse à la bouche un goût d’orangeade, ou de glace au citron, une journée à la mer ou une soirée au cinéma.
Il me semble chercher quelque chose d’inaccessible et sait que sa quête est sans issue. Ses paroles sont parfois à peine chantées, comme si elles exprimaient une plainte qui imprime à l’âme quelque chose comme une empreinte en creux.
Cette nostalgie qui sourd de ses notes autant que de ses mots me plaît bien parce que tout cela est dit plutôt que chanté en italien qui est la langue de la musique, avec en filigranes l’intuition de l’aspect définitivement dérisoire et transitoire des choses et de la vie. S’il rie parfois, c’est pour éviter d’avoir à pleurer sur tout cela !
© Hervé GAUTIER http://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg
-
Paolo CONTE - « Elegia ».
- Le 30/03/2009
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°254 – Juin 2006
Paolo CONTE - « Elegia ».
(traduction française des textes par Doriana Founier)
Je ne pouvais pas trouver meilleure compagnie pour le 26° anniversaire de cette petite revue qui survit comme elle peut, garde ses marques et son indépendance, avec cette volonté un peu folle qui est la mienne et qui m’étonne toujours, de trouver en elle une véritable raison d’exister.
Dans un précédent numéro, je disais tout le bien que je pensais de Paolo Conte, je vais donc développer en insistant moins sur le jazz qui pourtant le plaît bien que sur la mélancolie qu’il distille dans cet album chanté en italien. C’est non seulement une langue musicale mais également un langage qui se prête à la nostalgie, une sorte de « saudade » portugaise que la voix rocailleuse du chanteur piémontais souligne en l’accompagnant au piano forte.
Il y a, certes, cette « musique rouillée, noirâtre, teinte à chaud de brume-métropole » (Elégia) qui va bien avec ces « ténèbres magnifiques », avec cette quête impossible d’un chemin dans l’obscurité et le brouillard de cette vie décevante où même une maison chinoise peinte en bleu ne peut constituer une réponse, un havre de paix, où le hasard tient lieu de gouvernail, de boussole au milieu des étoiles, des villes étrangères et du temps qui s’en va. « Qui sait, qui sait, le navire passera, qui sait si là quelqu’un y montera… » (Qui sait !)
Tout n’est qu’un décor, celui de la cité et des gens qui s’agitent, pressés par le temps qui fuit. Ils courent avec lui et après lui pour un peu plus d’argent, de considération, de reconnaissance… Et pourtant ce temps-voleur ( je traduirai peut-être « ladron » par voleur au lieu de larron, parce que le temps dérobe toujours quelque chose aux hommes, des moments de bonheur, leur jeunesse ou leurs illusions) est transitoire, fuyant ; il porte et enfante la musique qui elle aussi s’enfuit. Les notes s’envolent, se dissolvent dans l’air, se perdent dans la mémoire. Le temps assassin brûle tout sur son passage et Conte, sans doute, malgré son talent, son sourire et sa voix ne pèse pas lourd face aux rires moqueurs des femmes « Ne ris pas, ne ris pas, serre-moi, serre-moi, parle-moi, embrasse-moi (Ne ris pas) – « Je ne suis qu’un poisson à frire, je suis né pour perdre, ma silhouette vacille et va… J’étais un livre à lire… et tu n’as su qu’en sourire » (Bamboolah).
Il y a cette quête que j’imagine, moi, à jamais inassouvie, celle de l’amour impossible et inaccessible, parce que le véritable message qu’on porte en soi reste une énigme difficile à déchiffrer parce que ceux qu’on aime passeront éternellement à côté, parce que tout cela finit par donner le vertige et on avoue avec lui « Moi, je ne vole pas haut…je sens que ma vie va devenir un film, oui, mais, je l’ai déjà vu ce film, et je ne l’aime pas » (Sandwich man). C’est un jeu souvent cruel, parfois envoûtant, quelquefois décevant. Il en reste une sorte d’aura, mais aussi des interrogations « tu avais jeté un charme autour de toi, toi, qu’est ce tu es pour moi ? »(Elégie), l’envie de tourner avec lui une page de sa vie lue et relue cent fois « je laisse à mon enfance sensibilité et candeur… Je venais d’une vallée où le ciel s’assombrit dans la moiteur » (Elégie). Il a joué un rôle de clown-équilibriste maladroit de surcroît et qui recherche désespérément un peu de tendresse « Ne ris pas… nous sommes des anges ensorcelés par une allégresse infinie … serre-moi, parle-moi, embrasse-moi » (Ne ris pas). C’est effectivement un être incompris, égaré dans un monde auquel il est étranger, avec des espoirs fous, comme un trésor dérisoire « je ne suis même pas du pays, j’ai une valise en carton… mais il y a dedans un bandonéon. »(Le royaume du tango), comme l’évocation de Frisco, ville étrusque… « chic et ambitieuse, comme un sofa de cretonne »(Frisco).
Les mots de Conte viennent quand on ne les attend pas !
Il y a aussi les regrets que nous inspire la vie qui passe et qui s’en va, le temps qui s’enfuit en laissant en nous une empreinte indélébile comme celle que laisse un mal, avec sa douleur et ses souvenirs en signant d’une cicatrice, marque plus claire sur une peau hâlée par l’existence, vivante, mais qu’on porte en soi et qui se rappelle constamment à notre mémoire comme une trace qui ne disparaîtra qu’avec nous. C’est une sorte de quête impossible, de quelque chose qui n’existe que dans notre imaginaire, dans nos rêves inaccessibles « Tu es à la recherche d’un chemin… tu cherches la maison chinoise peinte en bleu », « tu me demandes le chemin, mais la maison chinoise, tu ne la trouveras pas. »(La maison chinoise). Il y a le hasard, l’éternelle interrogation sur les choses de la vie et qui peuvent la faire basculer « qui sait, qui sait, le navire passera, qui sait, si là, quelqu’un y montera » (Qui sait)).
Je n’oublierai pas non plus les couleurs et leur opposition, celles de bleu, de l’indigo, symbole de la lumière et celles de la nuit, de la brume et de l’indistinct, du temps marron. Cela me paraît être le symbole parlant d’un contraste omniprésent au quotidien, bien plus qu’un artifice de vocabulaire, que de simples images…
Conte est le personnage qui se situe à équidistance entre le dérisoire (« oui, mais moi, avec ma veste neuve, je ne travaille pas dans le music-hall. C’est là l’unique vérité… alors[ les gens] se vexent et puis t’oublient et la route continue »(La vieille veste neuve), l’humilité « Bamboula, je suis un poisson à frire… je suis fou de toi, inutile de te le dire mais c’est plus fort que moi… je suis né pour perdre, ma silhouette vacille et va »(Bamboolah), le doute « Qui sait, qui sait, le navire passera » (Qui sait) « peut-être tu ne m’aimeras pas, tu me rencontreras, tu souriras, mais tu ne m’aimeras pas »(Très loin), l’inconnu cher à Baudelaire et l’indistinct « Loin, très loin, c’est là que je veux me rendre dans les bras d’un musique qui arrêterait de parler, forte et pétomane, écrite par le diable, outrage manifeste au monde civilisé »(Très loin). Les paroles semblent comme éclatées, nées d’un douloureux accouchement sur la virginité de la page. S’exprimer est un acte respectable parce qu’il est authentique !
Alors, face à ce combat, il est tentant de se laisser aller. L’écriture est un exutoire, mais pas seulement et la tentation est grande de l’inconnu qu’on dessine soi-même parce que l’image que ce monde nous donne de lui est pleine de contradictions, d’hypocrisies et d’incertitudes et que tout cela devient rapidement insupportable. Alors, on rêve à ce pays étrange « là-bas, là-bas, est ce que sont des personnages ou des rêves, oui, là-bas… ou est ce que ce sont des pensées perdues dans l’immensité obscure »(Qui sait). Il y a le sommeil qui ressemble tant à la mort qui est une délivrance « sommeil lointain…fais –moi voler de montagne en montagne, sans plus penser, sans rien comprendre, sommeil patriarche merveilleux, archaïque plongeon dans l’eau sombre… poudre de riz dans l’air qui vibre de charme magique… tu es une mandarine parfumée et sacrée, sommeil de nuages, sommeil de coupole, sommeil géant, sommeil éléphant »(Sommeil éléphant). Il permet toutes les libertés, toutes les audaces !
Oui, chez Paolo Conte, la musique est envoûtante et parfois merveilleusement désarticulée mais il y a aussi les paroles, écartelées elles-aussi, celles du poète, amoureux et désespéré, écorché-vif et fragile. De la vraie poésie, comme je l’aime !
© Hervé GAUTIER . http://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg
-
Paolo CONTE - « Concerti » (1985) « Arena di Verona » (2005).
- Le 30/03/2009
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°255 Juillet 2006
Paolo CONTE - « Concerti » (1985) « Arena di Verona » (2005).
Ce qui reste, en tout cas pour moi, d’un concert de Paolo Conte, c’est une impression, celle que me donne le musicien, parce que, avant tout Paolo Conte, c’est une musique, un style, un rythme, bref une originalité.
Cette musique simple et émouvante, mariage heureux entre le saxophone et le piano [Parigi - La topolino amarante – Hemingway], clavier aux touches d’ébène et d’ivoire, de la couleur des notes de la portée, bois vernis du piano, miroir au tain sombre qui renvoie l’image virtuelle des doigts qui le caressent et en tirent alternativement des plaintes mélancoliques[Madeleine] ou un jazz entraînant[Boogie – La vecchia giacca nuova] accompagné par un orchestre talentueux et complice. La note bleue, « la blue-note », reste une quête qui plaît à mon oreille et qui, comme chaque recherche à cette dimension de hasard et d’exercice, de satisfaction et de remise en question. Il y a aussi cet instrument (à vent – à bouche ?) dont je ne connais pas le nom et dont il joue avec gourmandise. Les sons nasillards qui en sortent sont la prolongation de sa voix rocailleuse et envoûtante. Le public ne s’y trompe pas qui l’applaudit et certaines de ces chansons, « Come di », « Un gelato al limon », « via con me », font maintenant partie du patrimoine italien. C’est un chanteur populaire au point que ses meilleurs enregistrements sont ceux qui sont réalisés en concert. Malgré la barrière de la langue, il y a quelque chose qui passe entre le public et lui, comme un fluide et la communion entre eux est complète. C’est que sa voix est unique, basse et un peu rauque. Elle va bien à son style.
Il y a aussi les mots dont la musique non plus ne m’est pas indifférente. Ils procurent un supplément d’âme et d’images à l’auditeur attentif. Il joue sur l’opposition des couleurs alternativement sombres et claires [Il y a dans son écriture une symbolique forte, une opposition poétique. Je ferai probablement un jour cette étude] .
Il y a tout un travail d’écriture sur les allitérations, même s’il est vrai que l’italien est une langue chantante par elle-même. Elle est dit-on, faite pour parler aux femmes, mais Paolo Conte nous parle des femmes avec émotion, talent et amour. Les mots sont évocateurs, en demi-teinte, suggestifs et le souvenir des moments souvent amoureux est à chaque fois fortement tissé (Parigi). Le non-dit suscité est très présent.
Je suis réceptif à cette intention constante de marquer sa différence, de souligner son originalité, sa révolte contre les choses établies, rejetées peut-être ? Je sais que mon hypothétique lecteur va encore se dire que je suis un amoureux impénitent de la mélancolie, parce que l’amour existe mais n’est pas aussi bleu qu’on le voudrait (Bamboolah), pas aussi heureux non plus [« l’amour c’est comme le vent du nord qui balaye les jardins et ruine les rêves de récolte » - Ce n’est pas de moi, mais toujours trouvé ces mots pleins de bon sens et de beauté], parce que la vie est brève, que le hasard existe (Chissa) qui l’embellit ou la noircit, en tout cas il lui imprime sa marque plus souvent que nous voulons bien l’admettre, qu’elle peut être simple mais aussi autre chose, que la mort existe qui vient tout gâcher, que nous sommes mortels avant tout, que la solitude faut aussi partie du quotidien malgré les rencontres, que les souvenirs embellissent l’existence!
Ce que je retiens aussi, ce sont ces images fugaces de cinéma, des journaux qui s’envolent, une glace au citron offerte à une femme, le thème de l’eau toujours récurrent, celui de la mer, de la pluie ou d’une douche chaude, celui de la ville avec ses bruits de vie, celui d’une journée passée à la mer, pour l’unique plaisir de rester seul à regarder autour de soi, de figer le temps sur le papier glacé d’une photographie… Ces paroles ne sont pas un simple habillage des notes, elles sont porteuses d’un véritable message, mélancolique (Il nostro Amico Angionilo), allégoriques (Diavolo Rosso) même si elles sont parfois déconcertantes, surréalistes même, comme s’il voulait garder ses mots pour ne pas les perdre (Hemingway) et insistent sur la mémoire des moments amoureux (Parigi), sur la dérision (La vecchia giacca nuova- La topolino amarante). Elle fait aussi partie de la vie, heureusement, et l’humour aide bien souvent à la supporter, surtout quand le poids du passé, des souvenirs est trop fort.
© Hervé GAUTIER http://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg
-
PAOLO CONTE - Monique MALFATTO – Poésie et Chansons - Seghers.
- Le 30/03/2009
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°260- Novembre 2006
PAOLO CONTE - Monique MALFATTO – Poésie et Chansons - Seghers.
Il est des artistes, des créateurs, qui, par hasard, un jour, nous bouleversent par leur talent, leur façon de s’exprimer ou simplement par tout autre chose qui fait qu’on s’intéresse à ce qu’ils font et aussi à ce qu’ils sont, pour l’unique raison que cela éclaire leur œuvre. Il est des livres qui lèvent des coins du voile dont les vrais auteurs se recouvrent, parce que leur vie, et donc leur œuvre, sont autre chose que ce qui doit être jeté en pâture aux médias, parce que cela est dans l’air du temps et répond à une demande des lecteurs avides … Celui de Monique Malfatto est de ceux-là. Je l’ai lu avec passion parce qu’il éclaire la poésie de Paolo Conte, en donne des clés de lecture, parce que, moi aussi, je suis sous le charme de ce chanteur-poète, à la fois secret et chantre de la condition humaine, avec ses joies, ses peines, l’implacable poids de ses contingences et le temps qui inexorablement s’enfuit !
C’est un ouvrage captivant, trop bref peut-être et qui mériterait une suite. Grâce à lui, le lecteur attentif en sait davantage sur cet homme mystérieux et solitaire, à la fois baroque et réservé, catalogué comme crooner, séducteur peut-être, dont on ne retient souvent que le timbre si particulier de sa voix. Je l’avoue volontiers, ses chansons sont longtemps restées dans ma mémoire, à cause peut-être de l’harmonie naturelle d’une langue que je ne comprenais pourtant pas, à cause du son rocailleux de sa voix, des notes distillées par son « piano forte » qui elles aussi faisaient partie de mes souvenirs. Ces traces étaient restées, fortes et ténues à la fois. Je ne suis qu’un pauvre amateur, mais Paolo Conte n’était pour moi qu’un chanteur, qu’un musicien dédié au jazz des années d’avant-guerre, aux rythmes sud-américains, à la mélancolie de certaines de ses chansons…
Ses textes traduits m’ont donné accès à cet univers si particulier, baigné à la fois de surréalisme et de quotidien, d’imaginaire créatif et de souvenirs personnels. Ils tissent un paysage secret et connu pourtant de chacun d’entre nous. D’une certaine façon ses mots agissent à la manière d’un révélateur, nous font découvrir ce que nous connaissons déjà, un effet-miroir en quelque sorte. Cette poésie, si loin de la prosodie, nous est donc, paradoxalement peut-être, parfaitement intelligible parce qu’elle porte en elle des moments de notre propre vie. Il met des mots et des notes sur une expérience personnelle, une idée, et c’est à chacun de nous qu’il s’adresse.
Ses textes nous donnent un supplément de rêve autant parce qu’ils nous renvoient une image intime de nous-mêmes, entre nostalgie, mélancolie, solitude, déprime parfois et instants de folie, de fantasmes ou d’extrême bonheur. Chez lui, le dérisoire, l’humour, le disputent aux souvenirs d’enfance, aux silhouettes de femmes … la vie, tout simplement avec son cortège de doutes, d’échecs mal digérés, d’histoires d’amour jamais oubliées…
Chez lui, point de polémique et d’engagement politique ou religieux. Il y a ailleurs des terrains pour cela et l’art souvent y perd !
Un des grands mérites de ce livre est de donner la parole à Paolo Conte. Il nous raconte sa vie, son enfance à Asti, son attachement viscéral à sa terre natale, son parcours, ses passions, ses moments de galère, son amour du dessin, sa volonté d’être marginal, loin du show-biz et de son monde impitoyable, ses difficultés avec l’écriture, la souffrance face à la page blanche... C’est une manière de se livrer, mais avec tout ce qu’il faut de retenue, de droit au jardin-secret et de volonté de démystifier l’homme public qu’il est devenu autant malgré lui que de part sa propre volonté. Comme si tout cela était arrivé parce qu’il porte en lui des paroles que chacun attend, avec ce détachement et cet étonnement de celui qui enfante des chefs-d’œuvre sans vraiment s’en rendre compte. Ses spectacles, et les disques qui en gardent la trace, sont le témoin de cette complicité qu’il a avec un public international pour qui la langue n’est pas un obstacle, comme si, les mots et leur musique suffisaient à la compréhension du message naturellement universel et profondément humain. Qui prétendra dès lors que la chanson est un art mineur ? Elle permet au contraire de toucher le plus grand nombre de gens dans un siècle à la fois consacré à la communication et à l’abandon des valeurs culturelles traditionnelles et élitistes. Paradoxe peut-être chez cet homme qui confie volontiers sa timidité, qui s’exprime, son écriture en fait foi, toujours avec retenue et « Hésitation ».
Il y a de la désespérance chez lui, parce qu’il est le témoin du passage de l’homme [et de la femme] sur terre, de l’aspect à la fois difficile et douloureux mais aussi sensuel de la vie, de la crainte de la mort... Un mot incarne cela à mes yeux, « le Mocambo », symbole de l’incompréhension, de la solitude, de l’échec malgré une réelle volonté, toujours contrecarrée, d’être autrement.
Paolo Conte symbolise l’Italie au point que certaines de ses chansons font du patrimoine national. Ce ne sont pas des « chansonnettes » comme on a pu le croire au début mais véritablement une invitation à la réflexion mais aussi au rêve. Dans ce livre, il confie son attachement à La France, elle le lui rend bien !
C’est aussi, et c’est bien, un livre qui offre des chansons traduites en français par Monique Malfatto avec un grand sens de la complicité. Elle précise « traduire les textes de Paolo Conte, ce n’est pas traduire en français, un texte italien. C’est traduire Paolo Conte ».
© Hervé GAUTIER. http://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg
-
PAOLO CONTE LIVE
- Le 30/03/2009
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°258 - Septembre 2006
PAOLO CONTE LIVE.
(traduction des textes – Monique Malfato – Valter Unfer)
Comme j’ai souvent eu l’occasion de l’écrire dans cette revue, la nouveauté n’est pas le seul intérêt d’une publication. Cet aphorisme personnel trouve ici, encore une fois, son illustration puisque ce disque résulte d’un enregistrement public au « Montréal Spectrum » le 30 avril 1988. D’ailleurs peu importe la date, restent les chansons, la musique et les textes qui n’ont pas vieilli et révèlent l’artiste.
La musique tout d’abord. Le rythme sud-américain dépayse l’auditeur attentif, l’entraîne dans les pas d’un tango qu’on imagine argentin, cette danse énigmatique distillée par son « piano forte » mais aussi par le génial et complice saxophoniste qu’est Antonio Marangolo.
Cette danse, aux origines controversées nous est revenue après avoir été réinventée dans les quartiers populaires de Buenos Aires et fait écho à « la milonga », chère à Conte, mais en est légèrement différente. A l’origine, elle permettait aux hommes venus faire fortune en Argentine de se mettre en valeur face aux femmes en nombre plus limité. Très rythmée, mais aussi érotique, ses pas et figures tiennent l’homme et la femme enlacés dans une sorte de lutte où la sensualité le dispute à la pudeur, la communion des corps à la tristesse de la mélodie. La danse reste un exercice difficile ou « le hasard est léger comme un léopard(où) les figures ont mille nuances », elle laisse parfois place à la rumba qui « est seulement une allégresse de tango »[Dancing]
Les textes de chansons illustrent parfaitement cette atmosphère. Ils mettent en scène, comme toujours un homme et une femme qui, malgré toute l’intimité qui peut exister entre eux semblent demeurer étrangers l’un envers l’autre « Au rythme obscur d’une danse… la femme accueille ses souvenirs, même les plus bêtes et les plus balourds », comme si la danse avait ce pouvoir particulier de susciter le souvenir furtif de ses amants passés, des moments exaltants aussi bien que des erreurs, comme si le tango portait en lui cette contrition « Il y a en elle une sorte de ciel, un vol qui justifie et pardonne toute une vie friponne »[Blue tango]. L’homme, lui, reste secret « Je suis toujours un peu distrait, plus seul et dissimulé »[Dancing]. Leur relation reste intime « Dis-moi plutôt, auras-tu un peu de temps à me dédier dans cette nuit bleue ? » « retrouve-moi, repêche-moi, tire-moi au sort » [Bleu nuit], « Une seconde, je te prie, passe une main comme ça… au-dessus de mes livides… »[Les imperméables] « Mais quelles mains, quelles belles mains, fais-les encore parler avec moi »[Bleu nuit],pourtant, les sentiments existent aussi, embellis par la mémoire « Elle est belle, je sais, le temps a passé mais je l’ai toujours dans la peau… » même s’ils sont empreints d’interdits et d’impossibilités « Mon amour pour elle guidera ses pas dans la joie et la douleur… ce sont des sentiments de contrebande » [Mexico et nuages]. L’homme et la femme, dans les textes de Conte se livrent toujours à une quête sensuelle « Il y a des yeux qui se cherchent, il y a des lèvres qui se regardent…il y a des jambes qui s’effleurent et des tentations qui se parlent »[Aguaplano], leur monde sont différents mais parfaitement complémentaires cependant. Les interrogations font partie du jeu de la séduction comme l’attente et l’envie d’immoralité « Que me donnes-tu, où m’emmènes-tu, me plairas-tu, me comprendras-tu ?… Donne-moi un sandwich et un peu d’indécence [Come me vuoi]. C’est une constante intéressante dans sa démarche créatrice où il y a une dimension de dépaysement mais aussi de volonté de « décalage » comme le montre cette référence quasi constante aux bains et à la musique turcs puisqu’elle est pleine « d’enchantements, de détonations, de pétards » [Come me vuoi » .
Cette fois, c’est en l’Amérique du sud qu’il convie l’auditeur, témoin privilégié de son voyage. Elle constitue, avec la méso-amérique un véritable continent plein de mystères et d’attirance, plein de musique, d’un art de vivre si différent de celui des Européens. Cela va de l’ « altiplano » à l’aspect grandiose et dépouillé, dont l’auteur se limite malheureusement à nous indiquer que « Dieu habite là, à deux pas », au climat tropical qui dispense une lumière « comme un suaire »[Amérique du sud], au décor comme « une arche entre le calme et la tempête »[Amérique du Sud].
Ce disque entraîne l’auditeur attentif dans un autre monde fait de la musique et des mots de Conte. Un enchantement, comme toujours !
© Hervé GAUTIER http://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg
-
Histoire de La Rochelle - Collectif sous la direction de Marcel Delafosse
- Le 30/03/2009
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
HISTOIRE DE LA ROCHELLE – Ouvrage collectif sous la direction de Marcel Delafosse – Editions Privat.
La Rochelle est pour moi plus qu’une ville et les liens personnels et affectifs que j’ai avec elle font que tout ce qui s’y rattache ne peut me laisser indifférent. L’histoire de cette cité, dans sa richesse et sa diversité ajoute à l’intérêt que naturellement j’y porte.
Crée vraisemblablement aux alentours de l’an mil, elle n’apparut vraiment dans les faits qu’au XII° siècle où elle devint la principale citée de l’Aunis. Sans faire le résumé de cet intéressant et complet ouvrage, je dirai simplement que c’est une ville qui, entre guerres et paix a su rester fidèle au pouvoir central(Conformément sans doute à sa devise « Servabor rectore deo »), tout en étant jalouse de ses privilèges et de ses libertés. Tour à tour rebelle, sage et prudente, elle su affirmer son autorité tout en s’adaptant aux événements comme aux circonstances. Quand il a fallu montrer sa différence et son indépendance les rochelais l’ont fait savoir, à l’image de leur maire Léonce Vieljeux qui, malgré la défaite de 1940 s’est opposé, à sa manière à l’occupant allemand, ce qui lui a coûté la vie.
Bien que privée d’arrière-pays et dotée de richesses limitées, essentiellement constituées pendant longtemps de vin, d’eau de vie et de sel, elle a su développer son port au cours des siècles jusqu’à devenir une place importante avec un apogée au XVII° et XVIII° siècle. A cette époque elle a été florissante même si une partie de sa richesse était due au « commerce triangulaire ».
Entre protestantisme et catholicisme, elle est restée fidèle au message du Siècle des Lumières, c’est à dire tolérante mais toujours soucieuse de ses intérêts commerciaux. La Révolution y fut modérée, le XIX°calme et le XX° entre désastre économique et dynamisme retrouvé.
Son architecture particulière en fait un lieu attachant.
La ville que nous connaissons actuellement est l’héritière de toute cette histoire riche et mouvementée. Elle en est le digne témoin et porte en elle des promesses d’avenir qui la font se tourner résolument vers le XXI° siècle.
Elle est, comme a pu le dire un édile « une ville bénie des dieux ».
© Hervé GAUTIER.
-
ALIENOR AUX DEUX ROYAUMES - Joëlle Dusseau – Mollat.
- Le 30/03/2009
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°319– Novembre 2008
ALIENOR AUX DEUX ROYAUMES - Joëlle Dusseau – Mollat.
Est-ce mon intérêt personnel pour la vie d'Aliénor d'Aquitaine qui m'a fait choisir ce livre ou mon attirance pour les légendes en général et pour celle de la Fée Mélusine en particulier qui s'est tissée, dit-on, sur le modèle de cette reine, je ne sais? Toujours est-il que j'ai lu avec une attention toute particulière ce livre à la fois bien documenté, pédagogique et agréablement écrit.
Que dire de cette femme d'exception, duchesse d'Aquitaine et autres lieux, reine de France par son mariage avec Louis VII qui la répudia, officiellement pour consanguinité, puis reine d'Angleterre par son union avec Henri II Plantagenêt, duc de Normandie et comte d'Anjou? Le hasard de la féodalité fait que son second mari est vassal du premier, mais est infiniment plus riche et puissant que lui. Louis VII avait, en effet, par son inconséquent geste de répudiation, cependant béni par l'Église, précipité son ex-épouse dans le lit de celui qui allait devenir monarque. L'ennui pour notre Capétien, c'est que le fief d'Aliénor, ajouté à celui de son nouvel époux comprenait, outre ses possessions anglaises, une bonne moitié de la France actuelle. Le domaine royal de Louis était, à côté de cela, fort exigu.
Mariée une première fois à treize ans à Louis VII, elle épousera son second mari à vingt neuf ans pour finalement mourir à quatre vingt deux ans. Sa vie, quoique longue, n'a cependant pas été tranquille comme aurait pu l'être celle d'une épouse royale qui, au Moyen-Age, était le plus souvent dédiée à la naissance et à l'éducation des enfants. Reine, elle devait assurer une descendance à son royal époux, mâle, de préférence. Elle ne donna que des filles à Louis, mais assura la dynastie d'Henri par la naissance de huit enfants, notamment de « Jean sans Terre » et de « Richard Coeur de Lion », son préféré. Elle est la mère de deux rois d'Angleterre, la grand-mère d'un empereur germanique, Othon, et l'arrière-grand-mère d'un roi de France, Saint Louis! Elle su dépasser sa douleur de mère lors de la perte de nombre de ses enfants, notamment Richard Coeur de Lion, et choisir une de ses petites filles, Blanche de Castille, pour être reine de France et mère de Saint Louis. Grâce à elle, la France et l'Angleterre, pourtant ennemies héréditaires, se rencontrèrent .
Elle aima la guerre, la croisade d'abord qu'elle fit aux côtés de Louis VII et avec la Bénédiction du futur St Bernard, mais aussi, autour d'elle, naquirent des combats que souvent elle inspira et suscita, notamment entre Henri II et ses fils. C'était une forte personnalité qui su s'imposer dans un monde d'hommes par toujours raffinés et bien souvent rebelles... Même si ses efforts ne furent pas toujours couronnés de succès!
Elle aima aussi la politique à laquelle, à l'époque les luttes parfois fratricides et parricides, étaient liés. Elle su, avec une grande clairvoyance, favoriser les alliances entre les puissants, ne craignant pas de solliciter ceux qui pouvaient favoriser ses vues ou servir ses intérêts, même si ce jeu fit d'elle la prisonnière de son propre mari pendant quinze années! Pourtant elle survécu à ces épreuves comme aux nombreux deuils qui meurtrirent sa propre vie. Pour tous elle fut un exemple de courage!
Fut-elle heureuse en mariage? Les avis divergent, mais il semble que si elle a supporté Louis VII qui s'était auparavant destiné à la carrière cléricale, elle aima tendrement Henri II plantagenêt, au moins au début! Même si ce second mari, dont elle se sépara, la trompa sans scrupule. Pour autant la mort frappa ses deux époux successifs et nombre de ses enfants!
On la disait dévoreuse d'hommes et séductrice. Ce serait une des raisons de sa répudiation, même si cela fut motivé officiellement par la consanguinité qui existait entre elle et Louis VII. Là aussi les témoignages sont légions et avec eux les médisances. A-t-elle été la maîtresse de son oncle Raymond? A -t-elle été l'amante du poète Bernard de Ventadour qui la célébra? Certes, elle avait un fief alléchant, mais surtout, elle était belle [On parle d'elle comme la « perpulchra », la femme plus belle que belle]. Avant qu'elle ne rejoigne son second époux, deux prétendants,Thibault 1°, comte de Blois et Geoffroy d'Anjou entreprirent vainement de l'enlever. Lors de la Croisade qu'elle fit avec Louis, céda-t-elle aux charmes de Saladin? Il plane autour d'elle un parfum de scandale au point que sa conduite suscita des légendes qui lui prêtent des amours incestueux, séduisant le père avant de coucher avec le fils! Elle ne laissa personne indifférents au point que la célèbre « Chanson de Roland » en garda, dit-on, la trace de ses frasques conjugales. La mythologie française, trop peu étudiée et à laquelle on préfère celle des Grecs et des Latins, se serait inspirée bien plus tard de son personnage sous le nom de Mélusine!
On ne peut parler d'Aliénor sans évoquer les « cours d'amour » qu'elle tint, notamment à Poitiers dont elle fit, un temps, sa capitale. Elle y réunit autour d'elle une foule de troubadours, des poètes, des hommes d'Etat et de culture, « flamboyants » comme elle. Ses « jugements »attestent sa culture personnelle, sa clairvoyance son honnêteté intellectuelle, sans cesser d'être femme!.
Elle fut cependant ce qu'on appelle aujourd'hui, « une femme de tête », soucieuse, certes, de ses intérêts et de ceux du royaume, mais assurant l'avènement et le mariage de son fils Richard Coeur de Lion. Elle fut une administratrice éclairée, unifiant en Angleterre, la monnaie, les poids et mesures, inspirant les rudiments du droit maritime, développant l'exportation des vins de Bordeaux vers l'Angleterre, fondant ou dotant, comme Mélusine, châteaux, églises et monastères, chevauchant, jusqu'à un âge avancé, dans ses domaines pour accorder aux villes notamment, des Chartes qui, en pleine époque féodale, leur permirent de se gouverner elles-mêmes.
Telle fut cette femme d'exception dont la vie incroyablement longue pour l'époque et l'action infatigable, éclairèrent son temps au point qu'elle demeure encore aujourd'hui dans la mémoire collective.
Hervé GAUTIER – Novembre 2008.http://hervegautier.e-monsite.com
-
NIORT – Portrait de ville – Jean Pierre Andrault - Christophe Gauriaud.- Geste Editions.
- Le 30/03/2009
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°281 – Octobre 2007
NIORT – Portrait de ville – Jean Pierre Andrault - Christophe Gauriaud.- Geste Editions.
A quoi reconnaît-on qu'un homme, Jean Pierre Andrault, aime sa ville natale? Au fait qu'il lui consacre un livre où il en parle avec faconde. Peut-être, mais beaucoup d'ouvrages ont déjà été publiés sur Niort et les esprits chagrins ne vont pas manquer de penser que ce ne sera jamais qu'un volume de plus sur le même sujet. Et puis est-ce nécessaire d'être né dans une ville pour la célébrer ainsi avec des mots et des images? Cette ville, un peu oubliée en Poitou-Charentes, que beaucoup de Français ont du mal à situer sur la carte, existe pourtant, entre Poitiers, aristocrate et universitaire et La Rochelle, historique, maritime et touristique... C'est une ville moyenne où il fait certes bon vivre, mais qui ne fait pas rêver, au point que les Niortais eux-mêmes ne sont pas tendres avec leur cité.
Et puis il y a les vieilles idées bien ancrées jusque dans les dictons, des certitudes puisées dans l'histoire ou les petites histoires, des lieux communs entretenus depuis longtemps et selon l'un d'entre eux elle serait, un peu paradoxalement « une ville à la campagne », une « planète »où vivraient des êtres différents, sans qu'on sache vraiment pourquoi ils le sont, une ville qui vivrait au rythme lent de son fleuve et où régnerait une sorte de langueur, gage d'un art de vivre original et peut-être exceptionnel. Mais tout cela ne suffit pas. Le Poitou est un pays de légendes et Rabelais n'a pas oublié notre ville. Niort se mire depuis toujours dans l'eau, celle de la mer d'abord, mais il y a longtemps, et maintenant celle plus calme de la Sèvre. A quelques distance la quiétude du Marais Poitevin, par sa « fraîcheur d'aquarelle », invite au farniente et à la rêverie, à la nonchalance, à la pêche à la ligne où à la peinture...
Pour les amateurs d'histoire, la ville a pourtant donné de grands noms à la France dans bien des domaines. Rurale à l'origine et célèbre par ses foires, elle est devenue ville de garnison puis a su être industrielle, prospère, ouvrière mais aujourd'hui n'est plus qu'une riche ville administrative où souffle l'esprit mutualiste et associatif, peuplée de « cols blancs »où la culture ne serait qu'un vernis. Son habitat présente une grande diversité de styles depuis les quartiers ouvriers jusqu'aux demeures d'aristocrates ou de riches commerçants et aux réalisations plus contemporaines. Son urbanisme hésite entre grandes artères, rues médiévales, impasses ombreuses et passages secrets souvent dissimulés à la vue des passants. L'histoire l'a façonnée, alternativement anglaise, française, catholique, protestante, favorable à l'Empire ou au roi, elle est maintenant modérément républicaine, socialiste et laïque. L'Eglise, le temple et la loge maçonnique ont longtemps lutté pour leur influence. La géographie inscrit la vieille ville sur deux collines jumelles et dans un méandre de la Sèvre, ce qui fait d'elle une cité pittoresque et quelque peu indolente.
L'auteur parle opportunément de « tropisme niortais ». Tient-il à la douceur de son climat océanique, à l'ensoleillement quasi méridional, aux couleurs chaudes de calcaire et de tuiles qui dominent et serpentent dans la ville, à cet art de vivre qui existerait ici plus qu'ailleurs peut-être?
Les photos de Christophe Gauriaud ont des couleurs chaudes et dans un style agréable, technique, poétique parfois, et malgré un flot inévitable d'informations, Jean Pierre Andrault nous invite à revisiter cette ville qui est aussi la nôtre, nous incitant à lever les yeux, en nous attardant sur le détail d'une façade, l'originalité d'un haut-relief, la présence d'une enseigne, insistant sur un détail inattendu, autant de petites touches de patrimoine qui rendent cette cité attachante à qui sait la regarder.
Il fait le « portait » de Niort, comme on décrirait une personne, avec délicatesse, attention et amour.
Hervé GAUTIER - Octobre 2007.
-
1939 - 1945 - Delphin DEBENEST - Un magistrat en guerre contre le nazisme. Dominique Tantin – Geste Editions.
- Le 30/03/2009
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°323– Février 2009
1939 – 1945 - Delphin DEBENEST – Un magistrat en guerre contre le nazisme. Dominique Tantin – Geste Editions.
Lorsqu'il m'arrivait d'aller « Aux Iles », cette splendide demeure qui donne sur la Sèvre et qui fut naguère la maison d'un poète, j'y entendais évoquer Ernest Perrochon par la bouche de sa fille. Elle entretenait vivant le souvenir de ce père, écrivain et Prix Goncourt 1920, qui avait, entre autre, refusé de cautionner le régime de Vichy et avait fini par succomber aux harcèlements de l'occupant.
J'y rencontrais aussi son gendre, Delphin Debenest, qui s'occupait plus volontiers de son jardin. Il était cet homme tranquille qui ne parlait jamais de lui, souhaitait rester simple et donner l'image d'un retraité. Comme tout le monde, je savais qu'il avait été magistrat, que sa carrière, commencée à Niort comme substitut, avait été interrompue par la guerre, pour se terminer comme Président de chambre à la cour d'appel de Paris. C'était à peu près tout, et pour tous, il était un citoyen comme les autres... Il était pourtant bien plus que cela et sa frêle silhouette cachait un parcours hors du commun.
Mobilisé en 1939 comme homme du rang, il tiendra un journal de cette « drôle de guerre », décrivant la débâcle de l'armée, dénonçant l'attitude désastreuse du commandement, la défection des officiers... Il y a beaucoup de lucidité dans ses propos. Après sa démobilisation, en 1941, il retrouve ses fonctions de substitut dans une France vaincue et occupée et s'engage dans la Résistance. Il sera un agent de renseignements de la résistance franco-belge, communiquant des informations d'ordre administratives aux réseaux de la Vienne et des Deux-Sèvres, profitant de ses fonctions de magistrat en place pour combattre un régime qu'il désapprouvait mais dont il était pourtant le représentant, permettant à de nombreux Français, traqués par la police française et par la Gestapo, de leur échapper, disqualifiant des délits pour permettre aux prévenus d'échapper à la justice et de fuir ... C'est qu'un dilemme important se posait à lui. Il se mettait ainsi hors la loi, lui qui était censé l'incarner, alors qu'humaniste convaincu, il était animé d'une « certaine idée des droits de l'homme » et que, chrétien fervent, il puisait dans l'Évangile les raisons de son engagement et de son action. Il sut faire un choix qui n'était pas sans grandeur, entre l'accomplissement de son travail, et donc courir le risque de se faire à lui-même des reproches, pratiquer la désobéissance civique et ainsi mettre sa vie et celle de sa famille en danger. Resté en poste, il rendit à la Résistance plus de services que s'il avait choisi la clandestinité ou le maquis. Ils furent en effet peu nombreux, les membres de la magistrature qui, à cette époque, acceptèrent cette « dissidence ».
Arrêté en juillet 1944, il est déporté à Buchenvald puis au commando d'Holzen d'où il s'échappe, profitant de la débandade des nazis. Choisi pour faire partie de la délégation au procès de Nuremberg en qualité de procureur adjoint, il aura le privilège « d'être le juge de ses bourreaux ».
Pendant toute cette période il prend des notes « au jour le jour » qui montrent le quotidien dans ce camp de concentration où tout devient banal, la faim, la souffrance, la mort! Plus tard, lors du procès, il sera plus précis dans la relation qu'il en fait, plus critique aussi au regard des arguments développés par la défense, sans cependant se départir de son humanité et soucieux de ne pas obtenir vengeance à tout prix mais qu'une justice équitable soit rendue.
De retour en France, il devint un militant de la mémoire pour que tout cela ne se reproduise plus.
Il s'agit d'un témoignage écrit, non destiné à la publication, uniquement appelé à garder pour lui seul, le souvenir personnel de toute cette période dont « il veut (en) conserver seul le souvenir et aussi les traces ineffaçables » et « ne pas attirer l'attention sur lui ». Le lecteur y rencontre un narrateur qui veut, dans le camp, garder sa dignité et conserver intacte sa foi en la vie et en l'espoir de rentrer chez lui. On songe bien sûr à Jorge Semprun. Il continuera, pendant toute cette période, de transcrire pour lui-même, ses impressions et ses remarques, sous forme d'un simple témoignage. En fait, c'est beaucoup plus que cela, même s'il ne se fait aucune illusion sur l'intérêt que pourront montrer ses contemporains, et encore moins de la compassion qu'ils pourront éprouver.
Sur son action de Résistant, il reste discret et se qualifie lui-même de « modeste agent de renseignements d'un réseau » dont « l'action n'eut rien de spectaculaire ».
Ces écrits n'ont été exhumés après sa mort survenue en 1997, que grâce à la complicité de sa famille et publiés en marge d'un travail universitaire de Dominique Tantin dans le cadre de la soutenance d'une thèse de doctorat. Ce travail reste pédagogique puisque les écrits de Delphin Debenest ont été scrupuleusement retranscrits, annotés de commentaires et enrichis de citation d'historiens. Son histoire individuelle rejoint donc l'Histoire.
Pourtant, la mémoire collective n'a pas conservé le souvenir de cet « authentique résistant » qui regardait cette période de sa vie comme « malheureuse aventure » qu'il souhaitait oublier. Il avait seulement fait son devoir, c'est à dire agi conformément à sa conscience et son destin fut exceptionnel. De ce parcours, nulle trace officielle, simplement des décorations prestigieuses simplement rangées de son vivant et qui attestaient cet engagement. Il eut même la désagréable occasion de constater que sa carrière eut à pâtir de son action patriotique et que d'autres collègues, moins soucieux que lui de leur devoir et plus attentifs à leurs intérêts personnels, ont su tirer partie des événements à leur profit. C'est là un autre débat sur l'opportunisme et l'ingratitude.
Il faut remercier Dominique Tantin d'avoir ainsi mis en lumière la mémoire de cet homme d'exception que sa modestie rendait plus grand encore.
-
POEMES DE CARAMBELU - Un disque de MESTURA [Marisa López – Luis Suáres] - Pintar Editorial.
- Le 29/03/2009
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°306 – Juillet 2008
POEMES DE CARAMBELU - Un disque de MESTURA [Marisa López – Luis Suáres] - Pintar Editorial.
Quelqu'un a écrit un jour, je crois que c'est Antoine de Saint Exupéry, « Les adultes sont d'anciens enfants, mais très peu s'en souviennent ». Pourtant, les poètes ont cette faculté émotionnelle de faire revivre cet âge de la vie dont la plupart d'entre nous portons la nostalgie voire le deuil, une période sans retour qui conditionne tellement ce que sera notre parcours futur dans cette existence terrestre.
C'est tout cet univers insouciant et merveilleux qui sous la plume de Marisa López ressuscite pour le témoin attentif de ces poèmes où Louis Suárez a accroché les notes de sa guitare, un décor onirique ou un rêve éveillé, qu'importe, un autre monde en tout cas où les personnages sont des pies voleuses [Xujando al cascayu], des brebis blanches qui président au sommeil[Cuatro oveyines blanques], des araignées tisseuses de filets [Pela maňana bien ceo], des chats gourmands de nougats [El gatu], des écureuils joueurs [Los esguilos] ou de girafes qui tutoient les nuages [Les xirafes].
Le rideau de scène qui leur sert de décor est fait de reflets d'arcs en ciel, de ciel nocturne constellé d'étoiles, de lune d'argent, d'éclaboussures d'écume...
Ce sont des poèmes d'adulte qui parlent aux enfants qui ne veulent pas aller à l'école et sont attentifs aux palabres d'une pendule qui ne donne jamais la bonne heure [Mio güela tenia un reló], où le cerf-volant ressemble à la lune [La sierpe] où les escargots n'aiment pas forcément la pluie [El cascoxu coxu], où les écureuils espiègles jouent aux billes [Los esguilos] où les grenouilles chantent et font des bulles de savon [La xaronca].
Ces enfants ne veulent pas grandir et l'auteure nous offre un moment de rêve, nous invitant à nous installer avec elle dans un paysage d'exception, à en prendre notre part, à en être l'invité, le spectateur et donc a ouvrir notre imaginaire. N'hésitons pas!
Le bestiaire se prête particulièrement bien à cette évocation parce que le monde de l'enfance et celui des animaux sont comme complémentaires et les acteurs évoqués dans ces poèmes deviennent les complices de cet univers.
Le dernier poème me plaît particulièrement parce qu'il s'adresse à un enfant et parle de lui au moment où il s'endort. Comme l'enfance, le sommeil est un monde merveilleux auquel il s'apparente un peu. Là tout devient possible et tout ce qui est interdit ou impossible dans la vie courante devient tout à coup réalisable. Cet impalpable décor s'anime dans un ailleurs d'exception qu'on oublie sitôt le réveil et qui se dissout dans le présent sans que la mémoire puisse en garder l'exact souvenir. Paysages et décors transitoires...
Comme le rappelle le dernier poème « Les chansons de ce disque sont des chansons pour s'évader et pour jouer, pour dormir ou pour rêver, pour imaginer ou pour s'amuser...Ce sont des chansons qui cheminent de par le monde de la fantaisie et du rêve, des chansons douces et de toutes les couleurs, comme des caramels »
La rencontre d'un talent est toujours un moment fort dans une vie, surtout si ce dernier a plusieurs facettes. J'avais déjà eu l'occasion de saluer dans cette chronique l'existence du premier disque de ce groupe [la Feuille Volante n° 273 – Juin 2007]. Le second me paraît également digne du plus grand intérêt.
© Hervé GAUTIER – juillet 2008.http://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg
-
AGUA DEL NORTE – un disque de MESTURA [Marisa López et Luis Suáres].
- Le 29/03/2009
- Dans Autres centres d'intérêt culturel (peinture, théâtre histoire, chansons...)
- 0 commentaire
N°273 – Juin 2007
AGUA DEL NORTE – un disque de MESTURA [Marisa López et Luis Suáres].
Terres asturiennes, de vents, de pluies et de montagnes, de tempêtes et de labeur, loin des clichés espagnols pour touristes avides de soleil et de farniente. Printemps 2007, dans une salle à la chaleur moite, à Gijón... Dehors, il pleut, une pluie froide qui ailleurs dévaste le pays... Un après-midi presque désœuvré que quelques notes de guitare, d'accordéon et une voix vont illuminer. Un CD, cercle de plastique argenté aux reflets d'arc en ciel qui nous renvoie à la fois notre propre image et nous invite à l'ailleurs, au voyage, à la découverte, paroles et musique gravées , je l'ai rapporté avec moi, en France.
“Agua del Norte”[Eau du nord], pluie de cette région atypique où l'on joue de la cornemuse et où l'on boit du cidre, où la couleur dominante est le vert où les embruns atlantiques vous débarbouillent le visage de leur écume salée, où les vagues s'écrasent contre une grève déchiquetée par la violence des éléments, face à la mer et à son voyage incertain d'anciens émigrants porteurs de rêves, d'espoirs et de futur...
Et puis, par le miracle à chaque fois renouvelé et à chaque fois plus étonnant des mots, la poésie s'installe plante petit à petit un décor, les couleurs et les sons, tissent un ailleurs de leur trame légère et intemporelle, libèrent l'accès à un univers différent, d'autant plus inattendu qu'il surprend l'auditeur distrait, en fait un témoin attentif, oui, “les mots sont des ponts qui traversent le monde” comme l'indique l'exergue.
Les souvenirs s'avivent, la mémoire des choses revient, parfois triste, parfois pleine d'espoirs, comme les gouttes de cette pluie coutumière du pays asturien. Les notes de la guitare élégante de Luis, la voix envoutante de Marisa qui les module, en soulignent la musique, les silences, les regrets, les remords...le son du violoncelle qui évoque si bien le vent du large ... bouquet d'instants privilégiés!
Le poème est toujours le témoin d'une émotion et l'amour y est à la fois merveilleux et plein de douleurs muettes[Un día de febrero], moments d'extase et regrets du temps qui passe et ne revient jamais. Les mots sont des jalons dans nos vies, en portent la mémoire [La sombra de tu sueňo]. Le mot “rêve” revient souvent, comme pour nous rappeler qu'il nous aide à vivre, à nous projeter dans cet avenir qui porte l'existence, à sortir d'un quotidien morne, parce que cette vie n'est bien souvent faite que de choses fragiles [Corazón negro] dont l'équilibre instable n'est maintenu que par sa force d'attraction qui, nous étant prêté temporairement, nous révèle une autre notion plus acceptable du monde [Que amanezca otra vez]. L'amour transforme notre quotidien comme les gens qui l'inspirent [Quiero nomate], et son alchimie secrète et magique à la fois nous étonne, nous fascine à chaque fois.
Dans les textes autant que par la musique, l'aspect éphémère des choses est souligné [Lladrones de suaňos], soulignant la contingence des choses, leur précarité face au temps qui passe et qui détruit tout, jusqu'aux certitudes les plus établies. Cette fragilité est partout évoquée [Isla] dans la solitude et le son de la voix, aussi fuyant que le vent.
Même si chaque jour est une miracle, la nostalgie imprime inévitablement sa marque dans les larmes qui coulent des yeux, perles de pluie, traces de sel, qui impriment sur le visage sa cicatrice pérenne, y creuse parfois des rides. Les rêves sont fragiles qui habitent les nuits autant que l'imaginaire éveillé, mais ils entretiennent la vie, la barbouille de bleu et de soleil, comme la géographie maritime de cette contrée, comme tous les fantasmes humains... On en guérit, on les garde en soi comme un souvenir, comme un trésor ou comme une cicatrice. Ils font partie de nos vies, de notre parcours en ce monde, ils sont nos repères, moments douloureux parfois qui nous rappelle que rien n'est jamais définitif, que chaque jour est une remise en question[Un día des febrero].
Nos auteurs ajoutent que ce disque a été une belle aventure. Je veux le croire puisque chaque chanson témoigne d'eux-mêmes, de leur vie, porte témoignage d'un moment intime et priviligié...
Le partage n'est pas absent de leur démarche puisqu'ils précisent au témoin attentif de leur créativité « Si tu ries, si tu pleures, si tu es capable d'émotions, si tu le sens, si tu luttes, si tu partages, si tu donnes, si tu sais recevoir, si tu rêves, si tu crois que chaque jour est un miracle, ce disque tout entier t'est destiné. ».
Ce texte en forme d' envoi prend en quelque sorte congé de chacun d'entre nous, l'invitant à leur rendez-vous intime du poème, chaque fois que le besoin s'en fera sentir.
Ce message-là, habillé de mots précieux, serti dans une musique chaude et une voix fascinante , je l'ai goûté loin des Asturies, dans un autre pays de pluies et de verdure, gravé sur un disque argenté, et je m'en suis trouvé bien!
© Hervé GAUTIER - juin 2007