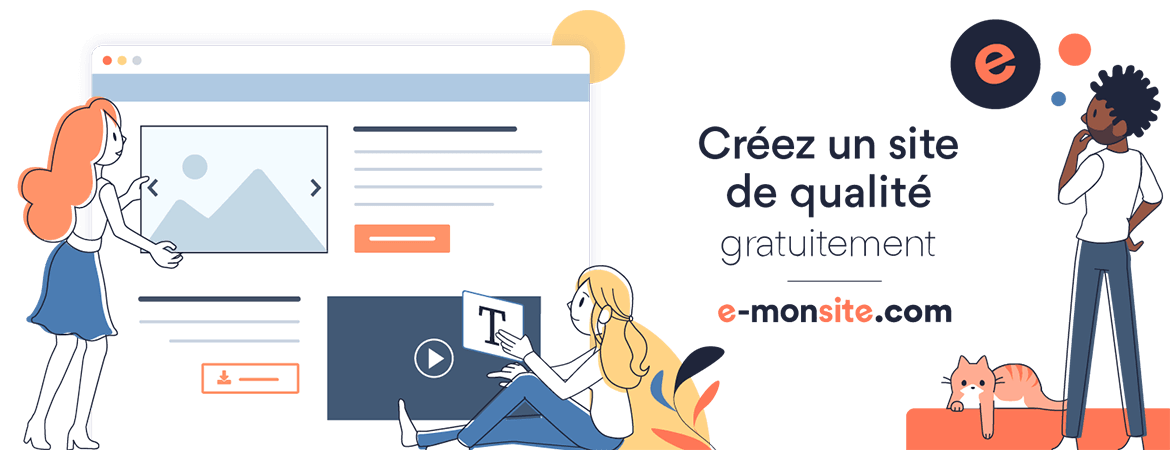Autres littératures étrangères
-
Au fond de la poche droite - Jyannis MAKRIDAKIS
- Le 12/10/2024
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°1940– Octobre 2024.
Au fond de la poche droite – Jyannis Makridakis – Éditions Cambourakis.
Traduit du grec par Monique Lyrhans.
La lecture de ce livre m’a laissé un peu perplexe. Le titre a quelque chose d’étrange et la lecture de la 4° de couverture semble annoncer un texte qualifié d’universaliste, l’histoire d’un moine orthodoxe, Vikentios qui, à un certain moment de sa vie, va devoir prendre des décisions qui lui apporteront peut-être l’apaisement.
C’est vrai que, pour le lecteur, ce roman réserve de belles images offertes par cette petite île grecque où la vie simple, proche de la nature et quelque peu mystique semble être réglée par ce monastère en ruines qui, après avoir été florissant, n’est plus habité que par un seul moine, Vikentios, qui, entré ici à 17 ans par vocation, y a passé 23 ans de sa vie. Le premier chapitre nous apprend que l’archevêque, primat de l’Église de Grèce, vient de mourir et que le même jour, la chienne du moine vient de donner le jour à une portée de chiots dont un seul survivra avant qu’elle-même ne meurt. L’homme d’église déploiera de louables efforts pour garder en vie le petit animal qui égaie sa solitude. Sa vie simple, austère, faite de prières, de privations, de solitude et de méditation nous est largement décrite. Apparemment elle lui procure une paix intérieure, loin de « l’odeur fétide de la vie sociale » et ne diffère en rien de la vie monastique de ce qu’un mécréant comme moi peut imaginer. Le monde autour de lui s’agite pour trouver un successeur au prélat décédé et la visite que lui font deux personnages mystérieux aux questions quelque peu inquisitoires et à qui il raconte son parcours, donne à penser au lecteur qu’un avenir différent est peut-être possible pour lui, mais il n’en est rien et sa vie solitaire et routinière et quelque peu misanthrope se poursuivra ici jusqu’à sa mort. Les dernières lignes donnent à penser que la sérénité de ce décor est partagé par un touriste de passage sur cette île.
J’ai poursuivi ma lecture malgré le peu d’attrait de l’écriture, à mes yeux bien conventionnelle, pour vérifier ce que ce court roman promettait. Certes les images de la Grèce, le bleu de la mer Égée, ont toujours quelque chose d’envoûtant mais, pour ce qui concerne ce moine et son histoire, je m’attendais à autre chose. Pas vraiment déçu, mais pas enthousiaste non plus.
.
-
Meurtre au 31° étage - Per Walhoo
- Le 07/10/2024
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°1938– Octobre 2024.
Meurtre au 31° étage – Per Walhöö- Le Mascaret -1988 .
Traduit du suédois par Philippe Bouquet et Joëlle Sanchez.
Dans une ville de Suède, un grand groupe d’édition vient de recevoir une lettre anonyme menaçant de faire sauter le siège social en représailles à un meurtre. Vu l’importance de l’entreprise, cette affaire remue jusqu’au ministère et on charge le commissaire Jensen d’investiguer, tout en lui faisant moultes recommandations de ne pas faire de vagues, ne lui laissant que 7 jours pour son enquête et sa hiérarchie le presse de limiter ses investigations à l’auteur de la lettre. En réalité ce n’était qu’une plaisanterie découverte rapidement par un autre service . Tout ce qu’il avait fait n’avait donc servi à rien. Pourtant il s’est avéré que celui qui avait avoué n’était pas le vrai coupable et Jensen fut donc invité à poursuivre ses recherches mais toujours à l’intérieur du délai indiqué. Dans ce groupe on rencontre des choses bizarres au regard du travail et du niveau intellectuel des cadres de cette entreprise ;
Ce roman a été écrit en 1964 et dépeint une société aseptisée, standardisée, aux ordres et sous le contrôle des autorités. C’était sans doute une sorte de photographie sociologique de cette époque, mais le fait qu’elle soit minée par alcoolisme, la drogue et les suicides peut donner à penser qu’elle n’est pas idéale et qu’elle a quelque chose de douloureusement actuel. Ce qui a retenu mon attention c’est le personnage du commissaire, d’une servilité affligeante face à sa hiérarchie tout en étant lui-même autoritaire vis à vis de ses autres collègues placés sous son autorité. Il obéis docilement à ses supérieurs et attend la même attitude de la part de ses subordonnés ! Cela nous donne des dialogues limités et quelque peu dénués d’intérêt. Je ne suis pas vraiment familier des polars nordiques mais je me fais une autre idée d’un commissaire de police en enquête même si le mode du travail lui-même est bien souvent baigné par ce genre d’attitude. Tout au long de la deuxième partie de son enquête il y a une atmosphère pesante, le commissaire faisant partie de ce système inquisitorial et en accepte les règles sans broncher, parlant le moins possible à ses interlocuteurs, n’éprouvant rien et combattant lui-même ce mal-être par l’absorption d’alcool pourtant prohibé.
Je ne suis pas fan de l’hémoglobine et de la violence, tant s’en faut, j’ai pourtant poursuivi ma lecture jusqu’à la fin pour connaître l’épilogue de ce livre mais je m’attendais à autre chose, à une autre sorte de crime, à une autre révélation à propos de ce fameux 31° étage et des mystères qu’il semblait receler. Le titre autant que la collection (Le mascaret noir) me donnaient à penser que j’allais lire un roman policier classique. J’ai été un peu déçu par ma première approche de cet auteur.
-
Était -ce lui? - Stefan Zweig
- Le 21/09/2024
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°1931 – Septembre 2024.
Était-ce lui ? Stefan Zweig -Gallimard.
Traduit de l’allemand par Laure Bernardi et Isabelle Kalinowski.
Stefan Zweig (1881-1942) s’est très tôt fait connaître par ses poèmes et surtout par ses nouvelles. Ce petit volume en comporte deux. « Un homme qu’on oublie pas » et « Était-ce lui ? » qui lui donne son titre.
La première, écrite à la première personne, met en scène Anton, un homme
exceptionnel, quasi clochard, mais que tout le monde connaît et estime, détaché des biens de ce monde et qui passe son temps à aider ses semblables sans rien leur demander en échange. D’autre part le témoignage qu’en fait le narrateur, intellectuel connu, qui admet que l’exemple de ce marginal a été pour lui une leçon de liberté et d’indépendance, est d’une grande importance. Ce texte est-il l’évocation d’une rencontre effective de l’auteur avec un tel homme (il sous-titre ce titre par la mention « histoire vécue ») ou est-ce le modèle humain auquel il aspire ? Zweig est un idéaliste et ce type d’individu, certes singulier dans ce monde gouverné par l’argent, peut parfaitement incarner sa vision de l’homme.
La seconde tient un peu du polar et donne la parole à Betsy qui passe sa retraite avec son mari près d’une petite ville anglaise. Vient s’installer près de chez eux un jeune couple sans enfant dont elle évoque le quotidien avec force détails, insistant sur l’analyse psychologique des personnages et notamment sur le mari. Il adopte un chien dont il devient quasiment l’esclave, mais les choses changent avec la naissance inespérée d’un enfant. L’atmosphère du récit devient pesante et le lecteur partage également l’angoisse et la question que se pose à elle-même la narratrice et qui donne son titre à cette nouvelle (Était-ce lui?). Le suspens est entretenu jusqu’à la fin et le texte, évidemment fort bien écrit (traduit), ajoute au plaisir du lecteur.
-
Volpone - Stefan Zweig
- Le 09/08/2024
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°1924 – Août 2024.
Volpone – Stefan Zweig – Petite bibliothèque Payot.
Cette pièce de théâtre est une adaptation très libre faite par Stefan Zweig de la pièce éponyme du dramaturge anglais de la période élisabéthain Ben Jonson que l’auteur de « La confusion des sentiments » trouva si drôle qu’il décida de l’adapter. Ce travail lui pris une quinzaine de jours et fut un succès immédiat et mondial. En France l’adaptation en a été faite par Jules Romains C’est une pièce en trois actes et en prose de 1925.
Cette œuvre caractérisée par une certaine drôlerie contraste avec l’écriture volontiers sombre de notre auteur. Pourtant, sous les apparences d’une comédie, c’est en réalité une critique de l’avarice et de la cupidité dont l’espèce humaine est coutumière ce qui lui donne une étonnante actualité.
Les personnages portent des noms d’animaux ce qui définissent leur caractère, un peu dans l’esprit de la commedia dell’arte ainsi qu’il est noté en didascalie, un peu le contraire des fables de La Fontaine ou du roman de renard
Nous sommes à Venise au temps de la Renaissance et Volpone, un riche Levantin, commerçant et célibataire est en parfaite santé mais joue les mourants pour éprouver la foule des notables de son entourage qu’il est en réalité désireux d’escroquer. Il se fait offrir des cadeaux somptueux par eux, sous forme de richesse et même la vertu d’une épouse, en leur faisant miroiter qu’ils seront ses uniques héritiers. C’est à la fois la critique de l’avarice et de l’envie. Il est aidé en cela par son serviteur, Mosca, qui a bien profité des leçons de son maître et se révèle aussi madré que lui. Cette forme de mise en scène qui révèle des serviteurs bien souvent plus malin que leur maître, sera reprise par plusieurs auteurs de théâtre. De plus l’épilogue a quelque chose de morale même si, le choix un peu extraordinaire qu’a fait Zweig en écrivant cette pièce drôle révèle non seulement une critique de la société et de l’espèce humaine mais peut-être une critique de lui-même, aristocrate de l’esprit, héritier d’une riche famille, une façon de rire de lui. Il y a, certes l’importance de l’argent, de la manipulation et du mensonge mais le véritable héros est moins Volpone que Mosca, valet aussi pervers que son maître et qui finit même par le dépasser en le ruinant, mais qui rachète cependant toutes ses fautes.
Il m’apparaît cependant que malgré son aspect quelque peu comique qui entraîne son lecteur avec lui, cette comédie est « grinçante » dans la mesure où elle est un des reflets de la nature humaine. C’est d’ailleurs un des aspects caractéristique de l’écriture de Zweig que d’en être le témoin et le dénonciateur . Il est en effet difficile de ne pas voir dans le personnage de Volpone, désireux de s’approprier l’argent et la femme de ses concurrents, autre chose qu’une image pas très reluisante de l’homme. On peut cependant envisager la dernière scène comme une sorte de rachat.
-
Le meilleur des jours - Yassaman Montazami
- Le 31/12/2023
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°1812 – Décembre 2023.
Le meilleur des jours – Yassaman Montazami – Sabine Wespieser éditeur.
« Le meilleur des jours » c’est la traduction française de Behrouz, le père iranien de l’auteure à qui elle souhaite rendre vibrant hommage après son décès. Pour cela elle choisit l’écriture pour conserver le souvenir de son passage sur terre.
Il naquit au sein de la bourgeoisie iranienne dans les années 40 et fut envoyé en Sorbonne pour y soutenir une thèse sur l’œuvre de Karl Marx qu’il n’achèvera cependant jamais, mais cette période fit de lui un éternel étudiant stipendié par sa mère, avide de connaissances, un homme épris de liberté, de démocratie et de laïcité, opposant farouche au régime de la révolution islamique, un mari excentrique qui vivait séparé de sa femme sans jamais divorcer tout en qui partageant la vie d’une femme mariée à Téhéran.
Ce court roman est un hommage poignant d’une fille à son père, avec ses folies, ses facéties, ses irrévérences parfois, son sens de l’hospitalité dont profitaient les réfugiés iraniens dans son appartement parisien, sa générosité , ses failles et ses faiblesses.
Le style fluide non dénué d’humour rend la lecture facile et agréable.
-
Le chat du rabbin -Vol 10 "Rentrez chez vous" - Joann Sfar (BD)
- Le 19/11/2023
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°1800– Novembre 2023
Le chat du rabbin – Volume 10 « Rentrez chez vous »- Joann Sfar -Dargaud.
Cet album illustre avec humour et à travers les yeux du chat l’antisémitisme ordinaire et traditionnel qui combat les Juifs là où ils se trouvent et leur ordonne de rentrez chez eux. Oui mais, pour des raisons historiques dues notamment à l’invasion de la Palestine par l’Empire Ottoman, ils n’avaient plus de pays à eux. L’expression « Juif errant » trouvait donc sa justification et ils étaient rejetés voire persécutés dans tous les pays où ils vivaient. En France, le décret Crémieux de 1870 accordait au Juifs d’Algérie la nationalité française et la déclaration Balfour de 1917 se prononçait en faveur de la création « d’un foyer national juif » mais cette terre qui était historiquement la leur était occupée par les Arabes. Le panarabisme ne tarda pas à s’opposer à ce processus ce qui conduisit la SDN a confier à la France et à la Grande Bretagne un mandat dans la région pour y maintenir la paix . Évidemment le problème religieux avec ses dogmes, sur cette terre où l’Islam, la chrétienté et le judaïsme devaient cohabiter, vint tout compliquer et l’établissement d’un état juif fut compromis. Il y eu des soubresauts historiques, notamment avant pendant et après la Seconde guerre mondiale mais l’État d’Israël naquit bel et bien sur cette terre et les Juifs du monde entier purent enfin espérer y émigrer. L ‘expression « L’an prochain à Jérusalem » devint donc un but pour chacun d’eux. Cet album, inspiré par une réalité, prend au regard des événements actuels une dimension particulière.
-
Le chat du rabbin - La tour de Bab-El-Oued - Joann Sfar (BD)
- Le 16/11/2023
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°1797– Novembre 2023
Le chat du rabbin – Joann Sfar – Dargaud
Volume 7 – La tour de Bab-El-Oued.
La vie continue à Alger, sauf que la mosquée est inondée et que l’imam Sfar demande au rabbin Sfar si ses fidèles ne pourraient pas venir prier dans sa synagogue, ne sont-ils pas cousins après tout ? Cela ne devrait pas poser de problèmes mais il apparaît rapidement évident qu’à la réflexion, il faut que chacun reste chez soi, cultive ses différences, qu’on n’est pas si frères que cela, qu’il faut remettre en cause les textes sacrés et ne pas se croire obligés de respecter la fraternité, la charité et l’amour du prochain et tant pis pour la tolérance.. Quand c’est la synagogue qui est inondée, le délire religieux reprend le dessus, on affirme que ce déluge c’est la volonté de Dieu, que c’est une punition divine à cause de la renonciation à sa foi, avec la culpabilité, le culte de la douleur, la recherche d’un responsable et la nécessité d’un sacrifice expiatoire. Pour cela le chat fait parfaitement l’affaire. Et pour que la fête soit complète, il fallait un prêtre catholique, mais il n’est pas question d’aller prier dans une église.
J’ai bien aimé cette fable, le graphisme en général et spécialement celui du chat. Oreillard, famélique, avec ses grands yeux verts, il est plein de bon sens et d’humour, donc attachant. A force de parler avec les humains il a fini par leur ressembler et a négligé, comme eux, les valeurs morales que pourtant ils lui ont enseignées.
Les religions répondent notamment aux aspirations de l’homme à croire dans un monde meilleur et la façon de le mériter durant son passage sur terre. Ainsi les différentes confessions se sont-elles opposées, parfois violemment, à coup de dogmes, de révélations, d’espérances et de prosélytisme, avec des lectures et des interprétations différentes des textes fondateurs et ont souvent été l’occasion de provoquer ou d‘entretenir ce que l’homme sait faire de pire : la guerre ! En Occident il y a certes eu des tentatives de dialogue entre elles pour rendre possible le « vivre ensemble » mais chaque conflit, pour des raisons différentes, a souvent pris, peu ou prou, une dimension religieuse, notamment contre les Juifs ce à quoi nous assistons actuellement dans un monde qui s’embrase.
-
Le chat du rabbin - Volume 6 - Joann Sfar (BD)
- Le 14/11/2023
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°1796– Novembre 2023
Le chat du rabbin – Joann Sfar – Dargaud
Volume 6 – Tu n’auras d’autre dieu que moi.
Zlabaya est enceinte. C‘en est fini des caresses et des câlins qu’elle réservait au chat. La présence future de ce bébé va faire s’effondrer cet univers dont il était le centre. Evidemment cela le rend triste même si, pour un temps, il est le seul à partager avec elle la nouvelle de cette future naissance. Le fait de parler le rapproche des hommes et, de fait, il réagit comme eux, surtout face à une femme qui, une fois mère, va se consacrer à son enfant au détriment des autres membres de sa famille et donc à lui. Son avenir n’est pas rose et ce n’est pas le rabbin avec son dieu et ses prières qui vont le consoler ; La solution qu’il trouve va le faire sortir de son cocon et aller au devant des hommes, de leurs jalousies, leurs hypocrisies, de leur violence, de leur désespoir. Il en prend même un peu de la graine.
J’ai bien aimé cette fable, le graphisme du chat aussi, pas beau mais attachant.
-
Le chat du rabbin - Joann Sfar (BD)
- Le 03/11/2023
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°1789– Novembre 2023
Le chat du rabbin (l’intégrale) - Joann Sfar- Dargaud (BD).
(Album en trois parties : La Bar-Mitsva- Le Malka des lions- L’exode.)
C’est une fable pour adultes, une longue complicité entre Zlabya, la fille du rabbin Abraham, et son chat, pas vraiment beau mais qui compense cette relative laideur par un solide bon sens, la faculté qu’il a de se faufiler partout et d’observer et surtout de parler avec sa maîtresse et son maître Abraham. C’est aussi l’histoire de ce rabbin algérien du début du XX° siècle et de sa fille racontée par ce félin philosophe, qui a appris à lire avec Zlabya et à qui le rabbin veut enseigner la Torah pour en faire un « bon juif ». Ce chat est le témoin de la vie des humains qui l’entourent et ses remarques sont pleines de logique au regard de la religion et de ses dogmes et de compréhension au regard des hommes. Au passage il ne manque pas de contester les préceptes religieux et y apporter son exégèse personnelle. Il va assister au mode de vie uniquement inspiré par le judaisme de ce vieux rabbin qui, à l’occasion du mariage de sa fille et de son voyage à Paris va remettre en cause tout ce pour quoi il avait vécu jusqu’à présent. Zlabya elle-même n’échappera pas à cette trasformation. Ce chat a des propos pleins de tolérance puisque sur cette terre du Maghrebe, les Juifs cohabitaient avec les Arabes et les chrétiens. Je ne sais pas si j’ai bien compris miais le message est sans doute qu’on peut vivre sereinement entre soi en s’accomodant des contradiction et de l’hypocrisIe des religions de leurs dogmes et de leurs interdits.
J’ignore tout de la religion juive mais il m’a semblé que dit ce chat génial s’applique à toutes les religions, aux interprétations sectaires, extrémistes et mensongères qui peuvent en être faites. Le dialogue entre le chat et le chien est révélateur du regard que ces animaux portent sur les hommes et que La Fontaine n’eut pas désavoué.
J’ai bien aimé le graphisme qui illustrret le texte de ce volume qui compile ces trois premiers albums .
Je ne connaissais pas Joan Sfar mais ce livre fut une belle découverte pour moi qui ne suis pas amateur de BD. J’ai trouvé intéressant de donner la parole à un chat qui est un animal que les Égyptiens vénéraient comme un dieu, que nous parons de nombreuses qualités et que certains dessinateurs transforment même en philosophe. Je crois que je vais volontiers poursuivre la lecture des albums suivants.
Ces propos prennent un relief particulier au moment où le monde s’embrase au Moyen-Orient et menace la paix de ces deux communautés qui ont bien des choses en commun et qui pourraient vivre en paix à condition de se respecter l’une l’autre.
-
la pitié dangereuse - Stefan Zweig
- Le 13/09/2023
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°1776– Septembre 2023
La pitié dangereuse – Stefan Zweig – Grasset.
Traduit de l’allemand par Alzir Heila .
A la veille de la Première guerre mondiale un jeune lieutenant obscur et pauvre, Anton Hofmiller, se trouve en garnison dans une petite ville d’Autriche. Par hasard, il se trouve invité chez un riche notable, M de Kekesfalva, veuf et malade dont la fille unique, Édith, est paralysée. A la suite d’une gaffe, le jeune officier multiplie les gestes d’apaisement et les visites faites à Édith pour se faire pardonner mais les circonstances amènent Anton à prendre la véritable mesure de la personnalité du vieillard. Celui-ci s’attache à Anton en lui témoignant des marques de confiance dans l’espoir de le voir épouser sa fille pour assurer son avenir, misant sans doute sur la pauvreté du jeune homme. Édith éprouve de l’amour pour Anton, où à tout le moins le croit-elle et lui ne lui témoigne que de la pitié pour lui permettre d’entretenir des espoirs de guérison tout en prenant conscience du danger de cet enjeu pour la jeune fille. Voit-il également son avantage dans cette proximité qui peut lui apporter une protection, une occasion unique de sortir de la gêne financière et un avancement plus rapide, les officiers supérieurs de son régiment étant également reçus chez ce riche notable. En réalité il est de parfaite bonne foi et sa pitié est authentique, comme l’est son rôle de bon Samaritain. Veut-elle voir dans cette somme de sollicitudes un attachement amoureux à sa personne que beaucoup d’hommes négligent à cause de son infirmité, nonobstant sa richesse ? Au cours du roman elle n’en est pas moins agressive à l’endroit du jeune homme ce qui peut laisser à penser qu’elle n’est pas dupe de sa conduite envers elle mais cela cache mal ses sentiments amoureux. Elle lui fait même des révélations inattendues au regard des sollicitudes dont elle est l’objet et les hésitations du jeune militaire, ses états d’âme face à cette situation trahissent peut-être celles de Zweig. Anton rassure-t-il Kekesfalva par compassion ou par intérêt face aux révélations du docteur Condor? Ce médecin continue-t-il à soigner Édith par pitié ou pour entretenir sa malade et son père dans l’illusion de la guérison ? Anton prend conscience qu’il a ainsi joué avec le feu et qu’il va s’y brûler, son sens de l’honneur et de la parole donnée sera un temps estompé par le maelstrom de l’Histoire, la mort tant recherchée comme une expiation, se refusant à lui, Ce qu’il considère comme une faute personnelle continuera à peser sur lui jusqu’à la fin.
J’ai retrouvé comme toujours chez Zweig la pureté de la phrase (servie par la traduction) mais surtout la délicate et pertinente analyse des sentiments humains, la façon habille et efficace de présenter chaque personnage dans sa réalité, derrière l’hypocrisie, les mensonges et les manœuvres que chacun déploie pour parvenir à ses fins face à la crédulité et à la naïveté de l’autre. Et la vanité des choses humaines ! L’amour est le thème central de ce roman comme il conduit et bouleverse parfois bien des destinés humaines sans qu’il soit toujours possible de distinguer les vrais sentiments des intérêts personnels et des petits arrangements mesquins., Il y a ici une dimension particulière, un sens de l’honneur et de la parole donnée, ce qui est quelque peu anachronique dans notre société d’aujourd’hui qui a perdu nombre de ses repères. Il n’y a pas d’amour mais seulement des preuves d’amour, dit-on, et Édith choisit de les voir dans les sollicitudes du jeune lieutenant qui n’agit envers elle que par pitié. Nous sommes certes dans un roman, mais mon observation de la société humaine me fait de plus en plus faire mienne cette pensée de Lacan « L’amour c’est donner ce qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas ». Quant à la pitié véritable, en dehors de celle de certains religieux ou humanitaires désintéressés, je n’y ai jamais tellement cru.
Zweig était un intellectuel hors pair, un humaniste, un témoin exceptionnel de son temps et de l’espèce humaine. Ce roman parait en 1939 alors qu’il est un écrivain célèbre mais persécuté par le nazisme, ce qui le déterminera à s’exiler en Angleterre sans espoir de retour en Autriche. Il est accompagné de Lotte, sa secrétaire qui deviendra sa femme et le suivra dans la mort au Brésil en 1942. Son désespoir face à l’humanité et à son devenir, le bouleversement dans sa vie personnelle affectent les dernières années de sa vie.
-
Le désert de quartz - George SCHINTEIE
- Le 30/07/2023
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°1765– Juillet 2023
Le désert de quartz – George Schinteie -
Tout d'abord je remercie Gabrielle Danoux de m'avoir fait parvenir ces poèmes dont elle est la traductrice et de m'avoir fait découvrir leur auteur comme elle l'avait naguère fait à propos de Valentin Dolfi (Ma poésie comme biographie), de Max Blecher ( Cœurs cicatrisés - roman) et Anton Holban (Le collectionneur de sons et autres nouvelles). Il convient de saluer son action en faveur de la popularisation en France de la culture roumaine, en particulier de sa poésie, même si, notre pays n’accueille plus ce registre créatif que par le biais de la chanson.
Découvrir un poète est toujours pour moi un moment d'exception même si, ne parlant pas roumain, je ne le découvre qu’à travers une traduction qui est une difficile transposition d’une langue à l’autre, avec une sensibilité et une musicalité différentes. Il s'agit d'un recueil bilingue qui ne sera pas commercialisé en France, illustré par Valeriu Sepi.
L'auteur s'est fait connaître tôt à travers une revue de poésie puis par la publication d’un premier recueil. Il a ensuite mis volontairement entre parenthèses sa créativité pour se consacrer au journalisme culturel, à la promotion de la poésie (des autres) et à la création d’organes de communication indépendants comme la radio et la télévision. Puis vinrent des publications sporadiques de poèmes, de deux recueils puis d’une série intitulée successivement 66, 67, 68 en référence à son âge ce qui peut signifier une obsession pour la numérologie mais assurément une obsession de la fuite du temps, le suivant, intitulé « l’ombre de l’horloge » corroborant cette impression.
Le présent recueil de poèmes, au titre quelque peu abscons, est le dernier, le neuvième et traduit l’univers onirique de son auteur contemporain. Le quartz ou cristal de roche, par sa dureté, sa transparence et sa longévité m’évoque la permanence des sentiments exprimés et leur universalité. Le désert m’inspire l’immensité, l’errance et ce qui résulte de l’érosion de la vie, ce sable qui coule entre les doigts et qu’on ne peut arrêter. Il en résulte l’usure des choses les plus dures dont on pouvait croire qu’elles seraient pérennes. L'auteur y exprime son questionnement sur le destin, le temps, l’amour, la mort, la vie, l’éternité, la relation avec Dieu, la mélancolie que suscitent pour lui l'automne et l'hiver à travers leurs couleurs et leur symbole. Les thèmes traités ne dérogent pas de ceux qui sont traditionnellement l'objet de la poésie et correspondent à des préoccupations humaines. Il en parle avec un lyrisme parfois incantatoire, des images impressionnistes et même surréalistes d’où la nostalgie n’est pas absente et qu’on peut rapprocher de la « saudade » de Pessoa ou du « spleen » de Baudelaire.
Les livres de Schinteie sont baignés par son autobiographie, le souvenir de son enfance à laquelle il ajoute esthétisme et musicalité des mots à la fois simples et naturels (l'ombre, la lumière, les saisons, la légèreté symbolisée par les images évoquant ce qui vole, animaux, feuilles ...).
Ses textes témoignent d'une sensibilité amoureuse mais j’y ai lu une forme de souffrance due à une absence de la femme aimée. Elle est comme lointaine, inaccessible, diaphane plutôt que palpable et corporelle. L'idée de l’amour est limitée au sentimental et à la méditation, les mots se limitant à évoquer l'idée de la femme plutôt que son corps lui-même et ses formes. Ainsi reviennent sous sa plume des allusions nombreuses au sang qui me paraissent symboliser ce manque, cette image qui peu à peu s’estompe ainsi qu’en attestent le graphisme esquissé de Valeriu Sepi.
Ses vers sont écrits sans ponctuation (comme tout poème il convient de les dire à haute voix en leur donnant le rythme que nous inspirent les mots) sans doute pour mieux susciter l’écoulement de la vie qui est chez lui une obsession prégnante. Les images métaphoriques qu'il emploie pour suggérer cette légèreté de la vie et son écoulement sont éloquentes (le papillon, le sable qui coule inexorablement entre les doigts, les traces laissées par les pas, l'arc en ciel, le bonhomme de neige...) et traduisent la mélancolie que lui inspire la fuite irrésistible du temps, la perte de l’énergie personnelle, les souvenirs d’une enfance passée, la disparition des gens seulement sauvée par l'empreinte mémorielle qu'ils ont laissée, la relation avec Dieu qui sont également des préoccupations humaines.
J'ai eu accès à la créativité de ce poète contemporain à travers la virtualité du texte comme cela se fait de plus en plus pour une foule de bonnes raisons. Je suis moi aussi de ceux qui regrettent le livre son aspect-objet, l’odeur de l’encre et du papier, le toucher des pages...Pour ceux qui ont eu le privilège de tenir ce volume entre leurs mains, c'est toujours un plaisir sensuel. Ce qui m’étonne toujours c’est que les mots, confiés au fragile support du papier, résistent au temps et parcourent les siècles alors qu’un simple clic peut les effacer de l’ordinateur. Le fichier refermé je me pose toujours la même question au sujet de l’écriture et de son pouvoir exorciste réel ou supposé. Le plus important à mes yeux c’est de laisser une trace, d’exprimer sa créativité avec des mots comme d’autres choisissent les actes ou des constructions.
-
le pingouin - Andreï Kourkov
- Le 28/07/2023
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°1764– Juillet 2023
Le pingouin – Andreï Kourkov - Éditions Liliane Levi.
Traduit du russe par Nathalie Amargier.
Victor est un écrivain raté, un peu paumé et dépressif qui vivote dans une Ukraine post-soviétique avec un pingouin, Micha, fourni par le zoo local qui n’a plus les moyens d’entretenir ses animaux et Sonia,une petite fille de quatre ans tombée du ciel. Un peu par hasard on lui propose de rédiger des nécrologies de personnalités, même si ces dernières sont encore en vie (pour combien de temps encore?). Faute de mieux il accepte et devient un journaliste reconnu mais apparemment recherché, à la vie menacée. Effectivement les meurtres mystérieux de ces VIP se multiplient autour de lui, perpétrés par un régime corrompu ou par la mafia locale de sorte que son travail et sa patience servent quand même à quelque chose. Victor ne sait pas trop où il en est mais évite de poser des questions parce que sa survie en dépend, lui fait-on savoir. Ici on combat l’hiver avec l’alcool mais aussi l’image que donne une société en pleine déliquescence. Je le trouve bien seul, ce Victor, malgré son pingouin et cette petite fille, Sonia, craintif aussi dans une société où chacun est épié dans le gris et de froid de l’hiver. Il semble être le jouet des événements qu’il traverse mais s’acquitte de sa tâche avec conscience. disparaît derrière des autres personnages, la petite fille, sa nounou, et même le pingouin, avec qui il forme une sorte de famille. Nous saurons à la fin la raison de son recrutement au sein du journal, la raison des sommes importantes qui lui ont été allouées, l’arbitraire de la situation dans laquelle il a été précipité, l’obsession de survivre, la peur de mourir, ... et le sort qu’on lui réservait
J’ai apprécié ambiance kafkaïenne de ce roman, cette atmosphère de l’ère post-soviétique faite de corruption, d’espionnage, d’enquêtes inquisitoriales et par ailleurs empreintes d’iniquité mais aussi l’humour avec lequel tout cela est dit. La vodka sert à la fois à combattre le froid et surtout le décor et la déprime des citoyens noyés dans une normalité absurde, la façon assez expéditive de se débarrasser de quelqu’un devenu gênant et la reproduction fréquente de ce modus operandi, l’état plus que préoccupant de la médecine et des hôpitaux. On est donc loin d’une apparente histoire pour enfant symbolisée par le pingouin et la petite Sonia qui s’y attache.
Les événements tragiques qui secouent actuellement le pays ont mis en lumière cet écrivain. Il nous révèle avec ce roman des détails surprenants de la vie des Ukrainiens au quotidien, les enterrements aux sons d’un orchestre, avec chants et pleureuses, les alcools forts qui se mesurent au poids, la détention de voitures de marques étrangères comme signes extérieurs de richesse, détails architecturaux...
Victor est le type même de l’anti-héro dépassé mais j’ai été un peu déçu par le déroulé de l’intrigue qui parfois s’enlise.
-
la voix
- Le 31/05/2023
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La femme en vert
- Par hervegautier
- Le 28/04/2016
- Dans Arnaldur INDRIDASON
- 1 commentaire
La Feuille Volante n°1037– Avril 2016
LA FEMME EN VERT – Arnaldur INDRIDASON – Point.
Traduit de l'islandais par Eric Boury.
Tout ce que les bébés trouvent, ils le portent à leur bouche. Lors d'une fête d'anniversaire, on découvre une fillette en train de mâchonner ce qui se révèle être un os humain trouvé par son frère dans des fondations de futurs maisons d'un quartier de Reykjavík. Le commissaire Erlandur et deux de ses collègues sont chargés de cette enquête pas vraiment riche en indices, juste un squelette là depuis une soixantaine d'années, une maison, jadis propriété d'un commerçant, rasée et la vague indication d'une femmes vêtue de vert, la présence de groseilliers à proximité, la disparition mystérieuse d'une jeune fille peu avant son mariage ! Pour compliquer un peu les choses, les policiers son aidés d'un géologue et d'un archéologue pour dégager le corps, c'est dire le luxe de précautions qui accompagne ce travail, ce qui ne hâte pas vraiment les choses. Les recherches s'éternisent un peu autour de la présence de militaires anglais puis américains dans les environs pendant la guerre, ce qui permet au lecteur d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de ce pays. On nous raconte que Reykjavík était au départ une petite ville et qu'à l'endroit où on a trouvé le squelette il y avait des maisons d'été. La ville s'étendant, on a construit sur ces terrains et on a ainsi découvert ces restes humains. L'auteur nous raconte aussi le calvaire d'une femme, battue par son mari violent et qui a vécu ici vers 1937. Cette femme a été courageuse et a accepté sa condition de femme battue et bafouée pour protéger sa fille handicapée et ses deux fils. Nous assistons à la lente destruction d'une famille par un tyran domestique, sadique et pervers. Il y a sans doute un lien entre cette affaire et son enquête à propos du squelette découvert. Mais lequel ?
Ce roman nous apprend à connaître ce commissaire, pas vraiment intéressant, marié très tôt et qui a abandonné très tôt son épouse et ses deux enfants. Il voit rarement son fils et sa fille, Eva-Lind, enceinte et droguée est entre la vie et la mort et bien sûr, il culpabilise même si c'est un peu tard. Il entame ainsi une deuxième enquête, personnelle celle-là, pour en apprendre davantage sur la vie de sa fille et ce qui l'a amenée ainsi au pas de la mort. Il parviendra quand même à parler avec sa fille, de son enquête d'abord et faute de mieux puis petit à petit de son enfance, comme une sorte d'acte de contrition, ce qui nous en apprend un peu plus sur lui. Ainsi l'auteur fait-il une sorte de parallèle entre la famille qui a vécu dans cette maison maintenant détruite et ce qui a secoué celle du commissaire. Cet épisode familial a aussi des répercutions sur les relations qui existent entre les différents membres de l’équipe que dirige le commissaire.
Ce sont donc plusieurs histoires qui s’entremêlent dans ce roman, de nombreux analepses, ce qui le rend un peu difficile à lire et égare un peu l’attention du lecteur à mon avis malgré la tension qu'il entretient tout au long de trois cents pages. C’est un roman policier puisqu’il y a un cadavre ou plutôt un squelette et des investigations diligentées par des enquêteurs mais c'est aussi un roman psychologique et social que j'ai finalement bien aimé.
© Hervé GAUTIER – Avril 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
PartagerFacebookTwitterEmailCommentaires
-
La femme en vert
- Le 31/05/2023
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n°1037– Avril 2016
LA FEMME EN VERT – Arnaldur INDRIDASON – Point.
Traduit de l'islandais par Eric Boury.
Tout ce que les bébés trouvent, ils le portent à leur bouche. Lors d'une fête d'anniversaire, on découvre une fillette en train de mâchonner ce qui se révèle être un os humain trouvé par son frère dans des fondations de futurs maisons d'un quartier de Reykjavík. Le commissaire Erlandur et deux de ses collègues sont chargés de cette enquête pas vraiment riche en indices, juste un squelette là depuis une soixantaine d'années, une maison, jadis propriété d'un commerçant, rasée et la vague indication d'une femmes vêtue de vert, la présence de groseilliers à proximité, la disparition mystérieuse d'une jeune fille peu avant son mariage ! Pour compliquer un peu les choses, les policiers son aidés d'un géologue et d'un archéologue pour dégager le corps, c'est dire le luxe de précautions qui accompagne ce travail, ce qui ne hâte pas vraiment les choses. Les recherches s'éternisent un peu autour de la présence de militaires anglais puis américains dans les environs pendant la guerre, ce qui permet au lecteur d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de ce pays. On nous raconte que Reykjavík était au départ une petite ville et qu'à l'endroit où on a trouvé le squelette il y avait des maisons d'été. La ville s'étendant, on a construit sur ces terrains et on a ainsi découvert ces restes humains. L'auteur nous raconte aussi le calvaire d'une femme, battue par son mari violent et qui a vécu ici vers 1937. Cette femme a été courageuse et a accepté sa condition de femme battue et bafouée pour protéger sa fille handicapée et ses deux fils. Nous assistons à la lente destruction d'une famille par un tyran domestique, sadique et pervers. Il y a sans doute un lien entre cette affaire et son enquête à propos du squelette découvert. Mais lequel ?
Ce roman nous apprend à connaître ce commissaire, pas vraiment intéressant, marié très tôt et qui a abandonné très tôt son épouse et ses deux enfants. Il voit rarement son fils et sa fille, Eva-Lind, enceinte et droguée est entre la vie et la mort et bien sûr, il culpabilise même si c'est un peu tard. Il entame ainsi une deuxième enquête, personnelle celle-là, pour en apprendre davantage sur la vie de sa fille et ce qui l'a amenée ainsi au pas de la mort. Il parviendra quand même à parler avec sa fille, de son enquête d'abord et faute de mieux puis petit à petit de son enfance, comme une sorte d'acte de contrition, ce qui nous en apprend un peu plus sur lui. Ainsi l'auteur fait-il une sorte de parallèle entre la famille qui a vécu dans cette maison maintenant détruite et ce qui a secoué celle du commissaire. Cet épisode familial a aussi des répercutions sur les relations qui existent entre les différents membres de l’équipe que dirige le commissaire.
Ce sont donc plusieurs histoires qui s’entremêlent dans ce roman, de nombreux analepses, ce qui le rend un peu difficile à lire et égare un peu l’attention du lecteur à mon avis malgré la tension qu'il entretient tout au long de trois cents pages. C’est un roman policier puisqu’il y a un cadavre ou plutôt un squelette et des investigations diligentées par des enquêteurs mais c'est aussi un roman psychologique et social que j'ai finalement bien aimé.
© Hervé GAUTIER – Avril 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
La voix
- Le 31/05/2023
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La voix – Arnaldur Indridason – Métaillé.
Traduit de l’islandais par Eric Boury.
Si le commissaire Erlandur croyait encore au Père Noël, ce qu’il a vu dans ce débarras d’un grand hôtel de Reykjavikl en ce matin d’hiver a dû lui mettre un sacré coup. Le Bonhomme rouge assassiné d’un coup de couteau dans le cœur, dans un sous-sol, le pantalon sur les chevilles, un préservatif imbibé de salive pendouillant entre ses cuisses… Pour la magie de Noël, on repassera ! Plus prosaïquement, Gudlaugur, la victime, était depuis vingt ans portier, en instance de licenciement, dans cet établissement. L’enquête s’annonce plutôt mal pour le commissaire et Oli, son adjoint, ça part dans tous les sens, on parle de prostitution, de drogue, du passé prometteur de la victime, d’homosexualité, de pédophilie, de solitude, de deuil, de difficiles relations parents-enfants, d’enfance sacrifiée, de déceptions, de solitude, de « promesses de l’aube » qui se transforment en catastrophes du soir, de l’implacable destin... Il est surtout question de l’éternel problème des parents qui reportent sur leur enfant leurs velléités d’une réussite qui s’est dérobée à eux ou qu’ils avaient patiemment tissée et dont la faillite devient insupportable au point qu’ils se désintéressent de leur progéniture.
J’ai retrouvé le commissaire Erlandur, comme une vieille connaissance croisée il y a longtemps et un peu oubliée (« La femme en vert »). Il est toujours aussi gourmand, a toujours les même problèmes personnels avec sa fille droguée et son fils alcoolique mais fait ce qu’il peut, depuis son divorce déjà lointain et difficile qu’il se reproche, pour s’en rapprocher et les aider. C’est une homme honnête, déprimé et seul qui fait son métier du mieux qu’il peut, mène une recherche laborieuse, pleine de conjectures hasardeuses avec la découverte de magouilles, de secrets, de tabous, de mensonges, avec en arrière-plan une autre enquête qui traite aussi de problèmes familiaux. Il reste marqué par le traumatisme et la culpabilité nés de la mort de son frère alors qu’il était encore un enfant et cette enquête est aussi pour lui l’occasion de remonter le temps avec nostalgie. J’ai apprécié qu’il n’y ait pas trop de sang ni trop de sexe ce qui est souvent le cas dans ce genre de roman mais aussi que l’auteur insiste sur de nombreuses facettes de notre espèce humaine, décidément bien peu fréquentable.
Dans le paysage littéraire islandais, Arnaldur Indridason est reconnu comme l’auteur de polars. Ici, il y a certes un contexte policier avec cadavre, enquêteurs, investigations, ambiance triste avec neige et froid malgré des préparatifs festifs de Noël auxquels notre commissaire reste étranger et je l’ai plutôt lu comme un roman psychologique, certes noir, mais aussi une étude de personnages qui, comme celui d’Erlandur est devenu plus attachant que lors de ma lecture antérieure.
-
Knulp - Hermann Hesse
- Le 16/02/2023
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°1717 – Février 2023
KNULP – Hermann Hesse – Calmann-Lévy
Traduit de l’allemand par Hervé du Cheyron de Beaumont.
Knulp est un vagabond, un homme libre mais correct , poète, un peu profiteur, instruit, sans attache mais peu respectueux des conventions sociales, un peu séducteur aussi. A sa sortie de l’hôpital il trouve refuge chez son ami, le tanneur Rothfuss qui l’invite à s’installer chez lui pour quelques temps. L’épouse de son hôte ne lui déplaît pas et cette attirance est partagée. Un autre épisode de la vie de Knulp évoque, à travers un témoignage d’un autre vagabond, la fuite du temps, l’amour, la politique, la vanité des choses, les remords, la solitude, la trahison, l’amitié, la mort… Dans la troisième partie il est atteint de tuberculose et va mourir. Il avait été un brillant élément et ceux qui le rencontrent et se souviennent de lui, évoquent ce qu’il aurait pu être au lieu de privilégier l’errance et le dilettantisme.
Petit roman paru en 1915 qui se lit rapidement et se caractérise par le romantisme. Il se décline en trois moments qui sont, sous la plume de Hesse un hymne à la liberté. Sentant sa fin Knulp entame avec Dieu un dialogue qui ressemble au jugement dernier, où il se justifie de ses fautes, ressasse ses blessures intimes, entre liberté et destiné, dans une sorte de bilan, ce qui correspond à une des obsessions religieuses de Hesse (1877-1962).
-
Il n'y a pas d'arc en ciel au paradis - Nétonon Noël Ndjékéry.
- Le 04/01/2023
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°1702 – Janvier 2023
Il n’y a pas d’arc en ciel au paradis – Nétonon Noël Ndjékéry. - Helice Helas Editeur.
A travers l’errance de Tomasta Mansour, un esclave eunuque en fuite qui se fait passer aux yeux des populations rencontrées pour un dignitaire religieux et belle et blanche Yasmina, fugitive elle aussi, échappée d’un harem, l’errance de ce couple hétéroclite croise la route de Zeïtoun, jeune esclave fuyant les trafiquants esclavagistes arabes. Des rives de la Mer Rouge au lac Tchad, le voyage de ce désormais trio à travers le désert comme à travers le temps où l’Histoire se mêle à la fiction, entre colonisation française et trafic d’êtres humains a quelque chose d’initiatique. Ce long voyage se transforme en une lutte pour la vie entre la mystification religieuse, la soif omniprésente et la constante volonté de ne pas revenir à l’état d’esclavage en tombant entre les mains des négriers arabes.
Dans l’évocation de son parcours se mêlent le merveilleux de la fable, le réalisme du témoignage, la magie et les légendes de l’Afrique, la tradition, l’occulte et les mythes. Cette île qui dérive au milieu du lac Tchad fait figure de terre d’où l’esclavage est absent et où règne la paix la liberté et la tolérance , mais cette fable quelque peu utopique s’arrête cependant brutalement quand les querelles de territoires prennent le dessus et que l’instabilité politique s’installe. La traditionnelle tranquillité de ce lieu insulaire est même bousculée par l’émergence de la foi islamique et avec elle de l’instauration d’un califat terroriste et confessionnel qui entend asservir au nom du Coran et de ses promesses ce peuple qui ne demandait qu’à vivre en paix. C’est l’image de ces pays jadis colonisés qui aujourd’hui peinent a trouver une indépendance et un ordre public et sont la proie de toutes les manipulations politiques et religieuses qui les asservissent toujours autant.
Cette saga africaine qui est agréablement et poétiquement écrite fait voyager le lecteur dans le temps et dans l’espace. L’épilogue quant à lui m’évoque les malheureux massacres perpétrés au nom de l’enseignement tronqué d’une religion qui se veut celle de la paix autant que les promesses illusoires de son enseignement.
-
Marie-Antoinette - Stefan Zweig
- Le 14/09/2022
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°1673– Septembre 2022
Marie-Antoinette – Stefan Zweig - Grasset.
Traduit de l'allemand par Alzir Hella.
C'est le destin des enfants des rois et des reines d'être mariés tôt et leur union est souvent conclue à des fins politiques. Marie-Antoinette, archiduchesse d'Autriche, fille de François 1° Empereur du Saint-Empire, n'échappa pas à la règle puisqu'elle le fut à quatorze ans avec le futur Louis XVI en vue du rapprochement entre la France et l'Autriche. Le rôle des femmes est évidemment d'assurer la descendance mais il lui faudra attendre sept ans avant d'avoir son premier enfant, ce qui inquiéta le pays et provoqua des quolibets et des rumeurs. C'est donc un mariage pour raison d’État qui amène Marie-Antoinette à épouser un jeune homme qu'elle n'aime pas et qui la délaisse et c'est à l'évidence un couple mal assorti. Cette jeune fille, sensuelle et pleine de vie, friande de plaisirs, de toilettes et de bijoux, se trouve trop tôt projetée à la cour, se rebelle contre "l'étiquette" de Versailles, peine à apprendre le français, est peu portée sur la lecture et la compréhension des choses et des événements qui l'entourent, préfère la liberté, les plaisirs et les frivolités. Toutes ces excentricités coûtent de l'argent et le peuple auquel elle ne s'est jamais intéressée gronde et lui donne des surnoms peu flatteurs doit celui de "Madame déficit". Certes, elle a assuré la descendance de la royauté mais les choses changent vite autour d'elle, les frustrations longtemps contenues éclatent, la révolte grandit et elle ne s'en rend pas compte. La cour se disperse devant le danger, la reine n'a plus beaucoup d'amis sauf le conte Axel de Fersen, un gentilhomme suédois qui reste à ses côtés dans une fidélité sans faille, ce qui nourrit les propos les plus fantasques au sujet de cette relation. "L'affaire du collier", la disette qui sévit dans le royaume, les idées des "Lumières" qui agitent le peuple, le "Tiers état" convoqué dans le cadre des "États généraux" qui entend bien porter des réformes de l’État, nourrissent une atmosphère révolutionnaire dans la capitale. Cette ambiance délétère est ressentie comme malsaine par la reine, ce qui lui fait craindre les pires choses face à l'indolence du souverain. Le retour forcé de la famille royale à Paris, la désastreuse fuite de Varennes, l'anarchie et l'atmosphère de complot qui règnent, la prise de la Bastille donnèrent le signal de cette révolution qui allait transformer la capitale en un bouillonnant creuset de mort, ensanglanter le pays tout entier le privant de sa traditionnelle structure sociale, promouvoir puis anéantir des volontés de réforme auxquelles se sont mêlés des velléités non moins grandes de destructions aveugles pour finalement déboucher sur un empire qui ressemblait par bien des côtés à cette royauté défaillante mais qui entraîna la France qui n'en avait pas besoin dans des campagnes militaires à la fois dispendieuses et destructrices. Ce genre d'événements inspirés par la Terreur et en marge d'une légalité changeante voire inexistante favorisent l'émergeance d'authentiques volontés de changement mais aussi le déferlement de violences, de trahisons, de palinodies, de débordements sanguinaires et de complots qui caractérisent bien l'espèce humaine.
L'auteur retrace avec minutie le destin tragique de cette femme qui, quand elle est confrontée à la mort du roi et à la certitude de ce qui l'attend, redevient dans la tragique et immense solitude qui est désormais la sienne, une femme ordinaire, une veuve de trente huit ans, abandonnée de tous, mais qui se défend fermement contre ses accusateurs mais aussi un être aimable pour ses gardes et digne face à la mort, c'est à dire l'image inverse de celle qu'elle a donnée pendant son règne.
Stefan Zweig (1881-1942) ne fut pas qu'un talentueux romancier et essayiste. Cet ouvrage, publié en 1932 et qui ne fut pas le seul dans ce registre, rappelle qu'il fut aussi un biographe pointilleux et scrupuleux qui, au cas particulier, sut faire le tri des nombreuses informations fausses qui courraient sur le sujet. Pour cette biographie fort richement documentée jusque dans les moindres détails et marquée par l'émotion, il s'inspira évidemment des ouvrages déjà parus mais surtout les mémoires de ses contemporains comme Mme Campan, Lauzin et bien d'autres mais surtout de la correspondance et des documents personnels d'Axel de Fersen. Il se livre à une étude psychologique du personnage de Marie-Antoinette mais aussi à de nombreuses remarques pertinentes et personnelles sur son destin
L’œuvre de Zweig revient aujourd'hui sur le devant de scène littéraire et on redécouvre le talentueux écrivain qu'il fut. C'est une très bonne chose qu'on se souvienne de l’œuvre de cet homme de Lettres exceptionnel qui illumina son temps.
-
Le manuel d'Epictète - Epictète
- Le 22/05/2022
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°1644 – Mai 2022
Manuel d’Epictète
Epictète (50-125 ou 130) fut un philosophe grec à la vie assez méconnue . Né dans l’actuelle Turquie, il meurt en Grèce après avoir été esclave à Rome et y avoir été affranchi. Après qu’il a été libre, il a mené une vie pauvre voire ascétique en accord avec son enseignement. Il n’a laissé aucune trace écrite (comme Socrate et Jésus), cet ouvrage, fut en effet rédigé par un de ses disciples, Arrien, qui publia ses notes prises au cours des leçons de son maître à penser. Cet ouvrage porte d’ailleurs le nom de « manuel » en ce sens qu’il doit être disponible à tout moment et qu’on peut le transporter avec soi, dans sa main . Un second ouvrage dénommé « Entretiens » a été également rédigé par ce disciple.
Il distingue les choses sur lesquelles nous ne pouvons intervenir (la mort) et celles qui dépendent de nous. Son enseignement qui est de nature essentiellement pratique qui vise à obtenir une meilleure qualité de vie , peut se résumer dans la manière dont il faut mener sa propre existence. Il tient dans la discussion et la remise en question des choses du quotidien, est de nature stoïcienne c’est à dire prône la soumission de l’homme à son destin, à une suite d’évènements qui ne doivent rien au hasard mais qui s’inscrivent dans l’ordre inéluctable de l’univers et contre lesquels l’homme ne peut rien. En revanche son action peut s’exercer sur ses opinions, ses jugements, ses choix, ses désirs, ses aversions. Ainsi, être libre c’est se concentrer sur ces actions qui sont à notre portée. Par exemple nous ne pouvons éviter de mourir mais nous pouvons donner un sens à notre vie. De même nous ne devons pas être angoissés par notre future mort mais voir en elle une sorte de délivrance, la fin de nos souffrances et de la vieillesse. Il suffit de peser sur nos jugements pour faire échec à la souffrance et nous rendre invincibles. Ainsi prône-t-il la discipline du désir, de l’action et la maîtrise du jugement, le détachement des biens de ce monde, ce qui mène, selon lui au bonheur (ataraxie). C’est évidemment un travail spirituel, silencieux et humble.
Son enseignement se décline en maximes essentiellement pratiques, loin de la théorie éthérée de la philosophie et la connaissance des choses est avant tout pragmatique.
Son message a influencé la pensée de Marc Aurèle, l’empereur philosophe, en partie la pensée de Pascal et le message chrétien mais je ne suis pas sûr d’adhérer complètement au message d’Épictète
-
Pensées pour moi-même - Marc Aurèle
- Le 19/05/2022
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°1643 – Mai 2022
Pensées pour moi-même – Marc Aurèle
Marc Aurèle (121-180) fut un empereur emblématique et original. Il l’est devenu sans l’avoir cherché par le biais de l’adoption, fréquente chez les Romains, mais pas à la suite d’un coup d’état ou des campagnes militaires sanglantes. Il partagea même son pourvoir avec son frère adoptif jusqu’à la mort de celui-ci en devenant en quelque sorte co-empreur.
Cet homme reste dans l’histoire comme un lettré (il écrit ses « pensées » en grec), un philosophe, adepte du stoïcisme qui prône la soumission de l’homme à son destin et sa nécessaire indifférence à tout ce qui peut lui arriver dans sa vie. Une telle théorie a sûrement dû l’aider dans sa vie d’homme d’État, son règne ayant été émaillé d’épidémies de peste, de révoltes ainsi qu’à surmonter la mort de sa chère épouse et de nombre de ses enfants. Il a partagé son temps entre sa famille et les affaires de l’État qu’il dirigea toujours avec humanisme et dans le respect du bien commun et de ceux dont il était responsable. Il fut un homme simple, droit, pieux, généreux malgré sa charge et ses maximes attestent sa sagesse. Son règne a corrspndu à une période de paix et de stabilité. Certains de ses aphorismes sont écrits sous le coup de l’émotion, d’autres au contraire son plus travaillés mais chacun d’entre eux
Saint Thomas d’Aquin conseillait qu’on se méfiât de l’homme d’un seul livre. Avec « Pensées pour moi-même » Marc Aurèle dévoile son paysage intérieur, ses aspirations et son sens de l’humain en adéquation totale avec les principes stoïciens qui gouvernèrent toute sa vie. Ses « Pensées » sont une réflexion sur la vie brève et transitoire où chaque être humain de toutes les époques peut se reconnaître et les méditer.
-
Les abeilles grises - Andreï Kourkov
- Le 11/05/2022
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°1641 – Mai 2022
Les abeilles grises – Andreï Kourkov – Liliane Levy
Traduit du russe par Paul Lequesne.
Nous sommes dans un petit village ukrainienne de la « zone grise » c’est à dire situé dans le Donbass entre l’armée régulière et les séparatistes pro-russes qui se livrent à des combats acharnés. Il ne reste plus grand monde sauf Sergueïtsh et Pachka, deux ennemis d’enfance que les événements ont cependant rapprochés. Ils ont fait taire leurs différents en réunissant leurs deux solitudes ce qui les oblige à s’entraider. Pourtant ils ne sont pas du même bord puisque que Sergueïtch, apiculteur, sympathise avec un soldat ukrainien, Petro, et Patchka s’approvisionne en nourriture auprès des Russes. Le quotidien est précaire, fait de bombardements et de la crainte des snipers et Sergueïch qui a grand soin de ses ruches, choisit de les éloigner de la guerre en les transportant dans d’autres contrées plus calmes et ensoleillées où il n’y pas de combats, en Ukraine puis en Crimée, mais son ennemi « véritable œil de Moscou » veille.
Ce roman est une sorte de fable. Les abeilles ne servent pas qu’à favoriser le sommeil, elles sont ici un symbole de paix et le miel est pour Sergueïtch plus qu’une marchandise ou une monnaie d’échange, mais c’est aussi pour lui l’invitation à la réflexion en les comparant à l’espèce humaine qui, à ses yeux, vaut moins qu’elles. Elles pourraient bien lui servir d’exemple pour le travail et l’organisation de la société. Elles sont aussi fragiles quand il les retrouve, grises et ternes après un séjour chez les Russes, un peu comme si elles avaient été contaminées ou peut-être infectées par eux pour diffuser une maladie bactériologique. Ce qu’il fait pour se délivrer de son doute est significatif. On ne coupe pas aux traditionnelles libations de vodka et de thé brûlant malgré la guerre mais c’est la vie qui prévaut, à l’image de Petro qui survit à tout ces bouleversements .
C’est évidemment un roman où fiction et réalité se confondent puisqu’il parle de cette guerre qui dure depuis quatorze années dans le Donbass. Ce n’est pas vraiment un roman aux accents prémonitoires comme « Le dernier amour du Président » qui met en scène quelqu’un qui est élu président à la surprise générale et qui doit faire face aux événements, mais il porte en lui de l’espoir. Cela évoque une réalité bien actuelle de ce pays.
Ce roman met en exergue le talent de cet auteur ukrainien, né en 1961, dont « les abeilles grises » est le dixième roman. Les descriptions qu’il fait de la nature sont agréables à lire. Ce livre est aussi l’occasion pour nous, à travers le personnage de Sergueïtch qui promène sur le monde qui l’entoure un regard à la fois humain et philosophe, de goûter l’humour ukrainien et son sens de la dérision et parfois de l’absurde. C’est aussi l’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’Ukraine, sur sa cuisine et le mode de vie de ses habitants et notamment sur Taras Chevtchenko (1814-1861) peintre et poète emblématique ukrainien qui symbolise la résistance de son pays contre les atteintes à sa liberté et à sa culture ainsi que l’émergence de l’esprit national. Cette référence n’est bien entendu pas sans évoquer la guerre qui a débuté en 2014 avec les revendications territoriales russes sur le Donbass et l’annexion de la Crimée et bien entendu les évènements actuels qui secouent l’Ukraine, injustement envahie et détruite par un « peuple frère » en vue de reconstituer l’ex-empire soviétique, sous la fallacieuse accusation de nazisme.
-
Le contrat - Maureen Demidoff
- Le 04/03/2021
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N° 1531
Le contrat – Maureen Demidoff – Ateliers Henry Dougier.
Tout d’abord je remercie les Ateliers Henry Dougler de m’avoir fait parvenir ce roman.
Avec ce livre le lecteur plonge dans la tradition albanaise des mariages arrangés. Nina, sept ans, fille unique, est promise par sa mère à un homme de quarante ans, riche et puissant, mais elle doit attendre d’avoir vingt ans pour la cérémonie. D’ici là sa future belle-famille devra s’occuper de ses parents pauvres. Vu avec nos yeux de Français, cela peut paraître archaïque mais c’est une coutume ancrée dans la société et d’autant plus forte qu’elle est scellée devant tout un village rural qui en est le témoin. C’est une question d’honneur et surtout de honte en cas de non respect de la parole donnée. Quand le futur mari est condamné à treize ans de prison puis s’évade, les parents de Nina se considèrent toujours tenus par cette transaction alors que la famille de son futur mari s’en estime déliée en l’absence du fugitif. Dès lors Nina est rejetée par sa mère qui voit disparaître, avec ce mariage qu’elle souhaitait, l’assurance de sortir de sa pauvreté et son entretien à vie. Elle part faire des études à la ville, en revient diplômée, ira plus tard à l’université, mais souhaite, en recherchant cet homme, parfaire ce « contrat » qu’elle n’a pas pour autant signé personnellement. J’imagine que cette jeune fille, belle, instruite, moderne, libre, pourrait trouver un mari de son âge et de son niveau intellectuel ou simplement fuir, choisir de vivre dans l’anonymat de la ville ou profiter de la vie comme l’y incite Lucia, son amie, mais sa démarche me paraît inspirée, certes par le respect de cet usage ancestral, mais surtout par l’amour qu’elle porte à son père soumis à une épouse dominatrice qui ne pardonne pas à sa fille cet échec dont elle n’est cependant pas responsable. Elle entend même instiller en elle une culpabilité judéo-chrétienne et entretient un état valétudinaire constant face au quant-dira-t-on du village alors que si ce mariage se faisait, il ne ferait en réalité qu’unir deux familles miséreuses !
A titre personnel, Nina entame des recherches d’autant plus étonnantes que cet homme n’a plus aucune aura pour elle. Elle prétend, dans ce texte écrit à la première personne, comme une confidence, qu’elle veut revenir au village pour retrouver ses racines et son identité, mais en réalité il y a de la fierté dans son geste : retrouver cet homme et en faire son mari, non seulement pour redonner l’honneur de sa famille mais surtout pouvoir se pavaner à son bras devant tout ce village où tout se sait, après avoir assumé le destin de ces jeunes filles qui attendent patiemment leur futur mari. C’est d’autant plus étonnant que lorsqu’elle le trouve enfin, c’est non seulement un repris de justice fugitif qu’elle rencontre et qui ne veut plus de ce mariage, mais c’est surtout un vieillard miséreux, abandonné de tous et qui a perdu de sa superbe d’antan. Est-elle attirée par lui à cause de la pleutrerie d’un père inexistant ou d’une éventuelle fascination pour les mauvais garçons ? Elle est rejetée par lui comme elle l’est de chez ses parents. Reste sa mère et sa future belle-mère qui ne songent plus qu’à assurer leurs vieux jours. Il y a un mystère autour de sa mère qu’elle baptise de noms peu élogieux, mais surtout de son père qui n’ose affronter son épouse et ce jusqu’à souhaiter le départ de sa fille qu’il aime cependant.
Je comprends mal Nina qui a tant besoin des autres pour s’épanouir, qui est une jeune fille libre et qui cherche à s’enfermer dans un mariage quelque peu contre nature à cause d’une parole donnée par un autre et le respect d’une tradition anachronique. En retrouvant cet homme, elle risque le kidnapping et peut-être pire, mais elle n’hésite pas. Je ne suis que très peu entré dans cette histoire dont on devine aisément la fin à double détente, d’une part en forme de pantalonnade où personne n’est dupe et où la police est ravalée à un rôle de figuration et de collaboration des plus douteuses et d’autre part à une forme de « happy end » un peu trop facile.
Il s’agit d’un premier roman qui se lit facilement, et donc d’une fiction de cette auteure qui s’est par ailleurs signalée notamment par des ouvrages documentaires sur la société russe (« La tête et le cou », « Portraits de Moscou», « Vivre la Russie »). Le livre refermé je me rends compte que j’ai eu beaucoup de mal à en suivre à la fois les méandres et à adhérer à cette comédie. Cela vient sûrement de moi !
-
La trahison de Rembrandt - Alexandra Connor-
- Le 31/01/2021
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N° 1526- Janvier 2021
La trahison de Rembrandt – Alexandra Connor – Éditions Prisma.
Ce roman met en scène le monde de l’art et des marchands de tableaux de nos jours, entre Londres Amsterdam et New York. Il y est question de lettres écrites au XVII° siècle par la maîtresse-servante de Rembrandt qui est aussi la mère d’un garçon, Carel Fabricius, né bien des années auparavant alors que le peintre était encore jeune et inconnu, de sorte que, au départ, il ne sut rien de sa paternité illégitime ni Carel de sa filiation naturelle. Les hasards de la vie ont fait qu’il est devenu son meilleur élève et aussi son singe, son faussaire. Ainsi Rembrandt a-t-il signé de sa main des toiles peintes par Carel et c’est ce que révèlent ces lettres, qui, si elles étaient publiées bouleverseraient le marché de l’art et provoqueraient des revers de fortunes. Elles comporteraient en outre une liste tableaux, attribués à Rembrandt et qui ne sont pas de lui. Elles sont en possession d’Orwel Zeigler, galeriste londonien endetté, confronté à la vente d’un authentique Rembrandt attribué à un inconnu. Il est retrouvé sauvagement assassiné. Ces lettres auraient assuré sa notoriété autant qu’elles auraient été la solution à ses problèmes d’argent mais auraient pu aussi être un instrument de chantage ou constituer le mobile du meurtre d’Orwel tant ceux qui en connaissaient l’existence étaient nombreux. Il les a légué avant sa mort à Marshall, son fils et tous ceux qui les ont eu en mains sont morts férocement assassinés, comme si une malédiction mortelle y était attachée, ce qui constitue une menace sur la vie de Marshall. Ces morts n’étaient d’ailleurs pas sans rappeler certains tableaux du maître, ce qui épaissit le mystère. Marshall, même s’il habite Amsterdam, est complètement étranger à la gestion d’une galerie et du monde de l’art, veut découvrir l’assassin de son père : c’est devenu son obsession, son combat, il fouille dans son passé et découvre quelqu’un qu’il connaissait mal mais aussi que le marché de l’art est un milieu interlope et vénal qui, comme les autres, révèle la face sombre et perverse de l’espèce humaine.
C’est un polar comme je les aime, à la fois historique et contemporain avec rebondissements et mystères autours de ces lettres, meurtres qui ressemblent à des exécutions rituelles, morts déguisées en suicides, mises en scènes macabres, tentatives d’élimination, manipulations diverses qui mettent en lumière la perfidie de l’homme, capable du pire comme du meilleur mais bien plus souvent du pire. Il y a une atmosphère de suspicion, de trahison, d’espionnage, de mensonge, de vanité, de cupidité, de duplicité, de vengeance, de vielle histoires d’adultères, de non-dits, de paranoïa et une lourde ambiance macabre. Une belle évocation du genre humain ! Les tueurs qui visiblement sont aux trousses de Marshall sont sans visage, sans identité, mais constituent une menace constante sur sa propre vie. En permanence, on balance entre bluff, réalité et canular ! Grâce à différents analepses, c’est l’occasion d’en apprendre davantage sur la personnalité de Rembrandt, sur ses techniques, pas vraiment quelqu’un de bien cependant selon sa maîtresse et d’autre part, le monde contemporain du négoce de tableaux comporte depuis longtemps des faux, des certificats de complaisance et des expertises douteuses, loin de l’atmosphère bohème qui a présidé à la naissance d’une œuvre plus tard reconnue ou du milieu feutré d’une réussite officielle. La police semble être étrangement absente de cette affaire et en tout cas particulièrement inefficace dans ses recherches à propos de ces différents meurtres. Marshall découvre aussi les secrets de son père, tant il est vrai qu’on ne connaît jamais vraiment ses proches. Quant à ses amis c’est un autre histoire !
Je suis entré complètement dans cette histoire romancée tant elle est prenante. Au départ les bribes d’une vie bien ordinaire donnent lieu à des développements crédibles et passionnants. C’est bien écrit et le suspense y est distillé au long de 530 pages ce qui a constitué pour moi un bon moment de lecture d’autant plus apprécié en cette période un peu bouleversée par le virus.
-
sang chaud - Kim Un Su
- Le 10/01/2021
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N° 1523 – Janvier 2021
Sang chaud – Kim Un-Su – Éditions Matin Calme
Traduit du coréen par Kyungran Choi et Lise Charrin.
Huisu est un petit truand qui a eu une enfance difficile sans père, entre errance et prison et, dans sa quarantaine triste, est condamné à vivre dans l’ombre de son mentor, le parrain local Père Sohn, c’est à dire à vivoter alors qu‘il voudrait monter son propre réseau et fonder une famille dont il rêve depuis longtemps avec Insuck, l’ex-prostituée et patronne de bar dont il est amoureux depuis l’enfance. Il n’a pour tout horizon, dans ce quartier de Guam de la ville portuaire sud coréenne de Bassan, que les dettes qui le hantent, une chambre d’hôtel minable qui sent l’alcool et le tabac, quelques moments intimes avec des filles de passage qui ne reviennent pas et une dépression qu’il soigne mollement aux anxiolytiques. Il n’a pas d’autres voies que la pègre, ses trafics et ses violences et cela l’angoisse. Cette période n’est donc pas vraiment faste pour lui d’autant que des guerres sont en train de s’ourdir entre truands pour la possession de territoires et la conquête de zones d’influence. Il va donc être entraîné un peu malgré lui dans cette lutte à mort.
On ne compte plus les trahisons à l’intérieur de chaque clan à cause de vieilles rancunes, les menaces de mort, les passages à tabac entre voyous, les coups de couteaux meurtriers, le tout sur fond de drogue, de corruption des autorités, de dettes de jeu, de séjours en prison, de racket des petits commerçants, le commerce légal aux mains des truands ne servant finalement qu’à blanchir l’argent sale. Bref, dans ce monde interlope il y a beaucoup d’hémoglobine et de luttes de « grands frères » et Huisu, trop naïf et désireux de rester fidèle à son protecteur, a beaucoup de mal à s’y retrouver . L’épilogue a cependant quelque chose de faussement calme dans cette atmosphère de violence et de mort.
C’est un peu, dans le contexte de la pègre sud coréenne, la marque de l’évolution des choses. Les anciens avaient établi des codes que chacun respectait alors que maintenant l’appétit de jeunes loups voudraient les renverser et faire leur propre loi.
Je suis peu coutumier des romans coréens et celui-ci a bien failli me tomber des mains à plusieurs reprises. Je l’ai cependant lu jusqu’au bout à cause de ma participation à un jury littéraire. C’est un roman noir où les cadavres se multiplient, même si Huisu qui n’oublie pas son projet de mariage avec Insuck, échappe de justesse à ce charnier ? mais quel sera son avenir ?
-
L'ivresse de la métamorphose - Stefan Zweig
- Le 25/09/2020
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N° 1504- Septembre 2020.
Ivresse de la métamorphose– Stefan Zweig – Belfond.
Traduit de l’allemand par Robert Dumont.
C’est un roman inachevé de Stefan Zweig, dont le titre lui-même est tiré d’une phrase de ce roman non publié de son vivant, commencé en 1930 et dont la rédaction fut reprise en 1938. Je suis toujours curieux du phénomène de l’écriture surtout quand, comme c’est le cas ici, la rédaction d’un roman est entamée puis abandonnée pendant quelques années pour être reprise plus tard. La maturation de l’écriture, le mûrissement des personnages me paraissent intéressants, leurs réactions dans un contexte changeant aussi d’autant que, au cas particulier, la vie de l’auteur a été bouleversée par les évènements politiques. D’un côté il connaît le succès dans son pays et de l’autre la montée du nazisme pèse sur son œuvre et sur sa personne ce qui détermine son départ pour l’Angleterre. Pour autant la déclaration de guerre fera de lui un expatrié, ennemi de surcroît, ce qui lui fera, un temps, relativiser l’ivresse de la notoriété et ce malgré sa naturalisation britannique. Cela a donné un texte en deux parties bien distinctes à l’atmosphère différente mais avec une constante volonté de critiquer l’état autrichien et le contraste que l’auteur lui-même avait noté entre les laissés pour compte de la guerre et les riches qui en ont profité ,une volonté de montrer la fragilité de cette jeune fille, coincée entre sa condition initiale et la prise de conscience que sa transformation peut lui procurer
Dès la première page, la description du bureau de poste de Klein-Reifling, petit village perdu en Autriche de l’entre-deux guerres, vaut son pesant de tristesse administrative à laquelle, malgré la sécurité d’emploi, Christine Hoflenher, vingt sept ans, jeune auxiliaire en charge de cet office veut absolument échapper tout comme à son décor domestique aussi triste que pauvre. Ainsi n’hésite-t-elle pas, quand elle reçoit une invitation de sa riche tante Claire Van Boolen à la rejoindre en Suisse pour quelques jours de vacances. Là elle pénètre dans un univers différent de celui qui fait son quotidien, ce sont des beaux vêtements qui la rendent belle, plus jeune, les tourbillons de la danse qui l’étourdissent, le luxe de l’hôtel, les hommes qui se pressent autour d’elle, l‘argent facile du jeu... autant de marques de changement qui l’enivrent . On lui prête de nom de sa tante et malgré elle elle devient une riche et noble héritière que chacun envie courtise et désire. Ainsi s’installe-t-elle dans ce rêve tourbillonnant au point de se croire devenue une autre, bien différente de ce qu’elle était avant ! Pire peut-être, elle perd toute mesure ce qui irrite son oncle. Elle comprend d’un coup son pouvoir sur les hommes mais aussi sa fragilité et ses limites et prend conscience de la duplicité, de la volonté de nuire de sa rivale. Les choses finissent par revenir à leur vraie place, la réalité aussi et Zweig examine la psychologie des gens qui l’entourent et les commérages ont raison d’elle et c’est la dégringolade. Elle devient une proie après avoir été le centre d’intérêt et réintègre sa condition originaire.
il n’y a aucun mal à souhaiter améliorer sa situation mais vouloir à toutes forces faire ce pour quoi on n’est pas fait peut se révéler désastreux. Ce roman est l’image de la condition humaine où ce genre d’épisode ne se termine pas toujours par un « happy end ». Cette parenthèse de sa vie a un caractère initiatique. Elle fait l’expérience de l’hypocrisie et de la méchanceté ordinaire, prend conscience qu’il y a ce qu’elle voit et la réalité et que ce sont deux choses bien différentes. C’est un regard aiguisé posé sur l’espèce humaine autant que sur la société qu’elle a entr’aperçue. Le retour à la réalité est tellement insupportable qu’elle rejoue pour elle-même, un soir, à Vienne le rôle qu’elle avait à l’hôtel mais elle est seule. Sa rencontre avec Ferdinand, un être brillant mais brisé par la guerre, sera un peu sa vengeance mais le prix en paraît élevé et surtout hypothétique. Pour autant, partageant les désillusions de Ferdinand, elle se met néanmoins sous son influence. Même si cet roman est inachevé il préfigure ce que sera le destin tragique, peut-être déjà envisagé par son auteur et son épouse, au Brésil.
-
La ruelle au clair de lune - Stefan Zweig
- Le 22/09/2020
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N° 1503- Septembre 2020.
La ruelle au clair de lune– Stefan Zweig – Stock
Traduit de l’allemand par Alzir Hella et Olivier Bournac.
Le narrateur a manqué le train qui devait le ramener en Allemagne et se trouve bloqué dans un petit port français à cause d’une tempête qui a retardé le bateau. Il prend une chambre d’hôtel et décide nuitamment de faire quelques pas dans la ville. Ça l’amène, par des ruelles sombres qu’il affectionne, dans un quartier interlope et entre dans un bar louche où un client, un habitué, est humilié devant lui par une prostituée. Écœuré il sort et, sans l’avoir souhaité,obtient l’explication de toute cette scène.
Cette nouvelle, comme toujours fort bien écrite, sonne pour moi comme une confession de ce client repoussé qui éprouve le besoin de raconter son histoire à cet inconnu qu’il ne reverra plus. Il trouve les mots pour s’accuser de son attitude passée, un peu comme si les mots qu’il prononçait dans la noirceur de la ruelle avaient la dimension de ceux dont on use dans l’isolement d’un confessionnal et avaient pour lui une fonction rédemptrice. Il n’y a en effet rien de tel qu’un proche pour humilier quelqu’un, surtout quand ces vexations sont gratuites et aux humiliations qu’il a lui-même infligées répondent les avanies qu’il a dû endurer dans ce lupanar. Dans sa volonté de sortir enfin de son infortune et de s’amender il va même jusqu’à se donner lui-même en spectacle, offrant de lui l’image d’un pauvre homme désespéré. Il charge même le narrateur d’être son intercesseur auprès de cette femme mais il n’obtient qu’une marque de lâcheté de sa part et finalement sa fuite.
L’épilogue reste en quelque sorte à la charge du lecteur et est laissé à son entière liberté d’interprétation. J’y vois une image de l’espèce humaine pas aussi reluisante que celle qu’on veut bien célébrer à l’envi.
En principe la parole est libératrice et apaisante, ce qui ne semble pas être le cas de ce pauvre homme qui est à ce point désespéré et seul qu’il se confie à un étranger, dans le cadre d’un bordel de surcroît. Il est vrai qu’il ne rencontre pas avec ce dernier une écoute suffisante pour se sentir libéré, ce qui explique sans doute la détermination qu’on peut deviner à la fin. L’attitude du narrateur, pour être compréhensible dans ce contexte n’en est pas moins frustrante pour lui.
La femme semble vouloir incarner la vengeance dans ce qu’elle a de plus définitif et de plus déterminé. Lorsqu’on a délibérément décidé de briser ainsi des liens et d’humilier quelqu’un pendant si longtemps, il est souvent trop tard pour réparer quand les choses éclatent , cette remarque valant pour elle et pour lui.
Le rapport des hommes à la richesse est il ici illustré, allant de l’avarice la plus sordide qui dilue toute relation humaine à la fausse assurance que l’argent peut tout acheter.
Stefan Zweig est d’origine bourgeoise et a fait partie toute sa vie de l’élite intellectuelle de son temps. Il est étonnant que sous sa plume se retrouvent des scènes de pauvreté comme ce sera également le cas des « L’ivresse de la métamorphose ». D’autre part, lui l’écrivain célèbre semble affectionner les quidams, les héros de l’ombre.
Comme d’habitude Stefan Zweig excelle dans l’analyse des sentiments et je l’apprécie pour la qualité de son écriture.
-
Lettre d'une inconnue - Stefan Zweig
- Le 16/09/2020
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N° 1502- Septembre 2020.
Lettre d’une inconnue – Stefan Zweig – Stock
Traduit de l’allemand par Alzir Hella et Olivier Bournac.
Il s’agit d’une nouvelle publiée en 1922. Elle met en scène, à Vienne, un écrivain célèbre, R, célibataire, de retour d’une excursion en montagne, le jour de ses 41 ans et qui reçoit une longue lettre d’une femme qui le tutoie, l’appelle « mon bien-aimé », et lui annonce la mort de son enfant, ce qui dénote entre eux une certaine intimité, mais pour lui, elle demeurera inconnue. Elle évoque la grippe qui a emporté son fils et donne à penser qu’elle en est également atteinte de sorte que cette missive prend la forme d’un ultime témoignage , un testament qu’on ne peut mettre en doute, on ne ment pas devant l’imminence de la mort ! Elle relate pour lui sa vie et l’itinéraire de leur rencontre qui remonte au moment où elle avait treize ans et qu’elle était sa voisine de palier, pauvre et transparente. L’écrivain de 25 ans qu’il était alors la fascine au point qu’elle tombe aussitôt amoureuse mais sans rien oser dans sa direction. Quant à lui il ne la remarque même pas et plus tard leur fugitive étreinte ne s’imprime même pas dans sa mémoire mais au contraire cette jeune femme compte parmi ses conquêtes vite oubliées.
J’ai une grande admiration pour Zweig dont je lis toujours passionnément les écrits, pour l’écrivain et pour ses analyses psychologiques subtiles et passionnantes, la qualité de son style, autant que pour l’homme, mais, même si nous sommes dans une fiction, j’avoue que je suis assez dubitatif devant cette histoire et cet amour inconditionnel, désintéressé et même volontairement aveugle et miséricordieux de cette jeune femme pour cet homme. Peut-être après tout, a-t-il puisé dans sa vie, lui l’écrivain célèbre en perpétuelle errance, la trame d’une telle fiction et se sert-il de l’effet cathartique de l’écriture pour s’en libérer ? Le fait que cette nouvelle se termine par une double mort ne peut pas ne pas me faire songer à son propre suicide, à sa propre désespérance. J’ai du mal à admettre que l’amour de cette femme se nourrisse de l’indifférence, du mépris et des infidélités de ce séducteur et qu’elle se mette dans la peau d’une sorte de vestale qui refuse les plaisirs de la chair puis plus tard d’une prostituée pour mieux élever cet enfant et refusant un mariage prestigieux, dans l’attente très improbable de son retour. Je ne sais trop quelle femme admettrait cela sans se venger, allant même jusqu’à célébrer à sa manière anonyme chaque anniversaire de cet homme! Cela me paraît trop théorique, trop irréel pour emporter mon adhésion. Cela tient sans doute à moi, à mon vécu, à mes expériences délétères… peut-être ? Je veux bien que l’amour existe, mais il me semble qu’il est comme les choses humaines, fongible et consomptible et j’ai du mal à concevoir qu’une telle femme, même à ce point idéaliste et amoureuse puisse exister et vivre ainsi un amour à ce point désincarné. Certes il y a un gouffre entre R et la narratrice mais ils parviennent quand même à se rencontrer et à s’aimer, mais lui est un « donnaiolo » comme le disent si joliment nos amis Italiens, un être hâbleur et inconstant qui va de femme en femme alors qu’elle reste seule à l’attendre désespérément, dans l’ombre, tissant de lui, malgré son absence ou peut-être à cause d’elle, une image par trop embellie. Pire elle disparaît volontairement, transforme son attachement en une véritable idolâtrie au point de sacrifier son bonheur et son avenir dans l’espoir insensé d’être préférée par cet homme pourtant lointain et détaché d’elle. Peut-être même se complétait-elle un peu dans sa posture solitaire et oubliée, allant jusqu’à ne pas lui révéler sa propre histoire avec lui, n’hésitant pas à se vendre pour procurer à ce fils ce que son père aurait pu lui donner. Personnellement, je vois dans l’ultime lettre de cette femme une sorte de vengeance, une manière de répondre à toutes celles que R. ne lui a pas écrites comme il s’y était engagé. Elle lui rappelle que la jeune fille timide du début était devenue une belle femme qu’il a pourtant croisée et qui n’a pas hésité à sacrifier ses intérêts pour un autre instant intime avec lui sans pour autant qu’il la reconnaisse. A-t-elle la volonté de faire naître en lui une culpabilité pour avoir dû se vendre et se sacrifier pour que cet enfant ne connût pas la misère, pour ne l’avoir considérée que comme une banale conquête sans importance, l’avoir humiliée et pour avoir été la victime du destin qui lui a imposé sa mort et la sienne propre et lui en faire porter le poids toutes sa vie. Son attitude eût-elle été différente si cette femme l’avait informé de sa paternité ?
En tout cas si je me trompe et si un cas semblable peut exister dans la vraie vie, ce R doit être à la fois heureux d’avoir été à ce point aimé de cette femme et malheureux de n’avoir pas été capable de le voir,j’imagine ce que doit être son état d’esprit à l’annonce de cette mort et de celle de son enfant qui resteront pour lui, à jamais, des inconnus.
-
Le duel
- Le 11/09/2020
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
Le duel – Arnaldur Indridason. Points
Nous sommes à l’été 1972 à Reykjavík et, en plein cœur de la guerre froide, la ville accueille le championnat du monde d’échecs qui oppose le champion américain Fischer au Russe Spassky. L’Américain est arrogant et le Russe sûr de sa victoire. Le duel auquel ils vont de livrer est autant professionnel qu’idéologique. Dans le même temps, dans une salle de cinéma, Ragnar Einarson, un adolescent est retrouvé poignardé et le commissaire Marion Briem est chargé de l’enquête mais, même si elle est assisté d’Albert, ils se sentent bien démunis, le principal des forces de police étant consacré à la sécurité de la rencontre d’échecs. Cela paraît être un meurtre aussi brutal que gratuit. Ces deux faits semblent ne pas avoir de lien l’un avec l’autre, mais l’absence de mobile et de témoins fiables laisse la place aux hypothèses les plus farfelues à cause de la disparition d’un magnétophone que la victime aurait eu pendant la séance de cinéma, la présence dans la salle lors de l’homicide d’un resquilleur, de bouteilles de rhum vides et d’un couple illégitime. Avec la découverte d’un paquet de cigarettes russes on évoque même le KGB à cause du contexte de la rencontre d’échecs et on reparle des étrangers et peut-être, pourquoi pas, d’un troisième homme dont la présence énigmatique pose bien des problèmes aux enquêteurs. En fait l’enquête patine d’autant plus que la presse s’en mêle et fait carrément dans le délire.Bref le suspense dure jusqu’à la fin.
L’auteur en profite pour évoquer les problèmes de son pays autant que de la vie antérieure de Marion, malade dans son enfance de la tuberculose. Je ne connaissais pas Arnaldur Indridason mais j’avoue bien volontiers que je suis assez friand de l’histoire personnelle des personnages principaux qui reviennent de roman en roman. Je poursuivrai volontiers la découverte de l’œuvre de cet auteur.
-
Poèmes- Constantin Cavafy
- Le 06/09/2020
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
Une relecture de ces poèmes m'inspire cette chronique.
N° 1499- Septembre 2020.
Poèmes – Constantin Cavafy – Gallimard.
Traduits du grec par Marguerite Yourcenar et Constantin Dimiras.
Constantin Cavafy est parmi les poètes grecs modernes l’un des plus connus. Pourtant il est né à Alexandrie en 1863 et c’est là qu’il mourut en 1933 . Il n’a publié aucun recueil de son vivant se contentant de distribuer chichement des poèmes à des amis ou à des revues (ce qui était une certaine forme de publication) des poèmes qu’il remaniait sans cesse et même pour certains qu’il rejetait (Une première édition posthume et partielle est parue en 1935 suivie en 1963 de l’édition de ses œuvres complètes puis en 1968 une autre consacrée aux poèmes de jeunesse). Il a été une grande partie de sa vie fonctionnaire au ministère de l’irrigation et courtier à la bourse et pendant longtemps son œuvre a été inconnue du grand public. Il est resté très secret, sauf peut-être vers la fin de sa vie où le succès est enfin venu. Dans son œuvre, bien qu’il parlât anglais, français et un peu italien, il est resté grec et s’exprimait dans cette langue, ne faisant aucune place dans son écriture au monde arabe et musulman qui pourtant était son quotidien. Il était un émigré grec à Alexandrie, un levantin, mais, et peut-être malgré lui, il a considérablement marqué la poésie grecque de son temps . Ce qui frappe c’est une poésie qui n’est pas lyrique, qui ne parle pas de la nature, qui est laconique, évocatrice de la rue parfois inquiétante, malfamée, des quartiers interlopes, des lupanars sordides à la recherche de jeunes garçons, des cafés populaires… Elle évoque aussi la rencontre fortuite et éphémère d’éphèbes qui sont ses amants et de leur départ qu’il déplore tout en notant leur âge ce qui traduit à la fois son obsession du temps qui passe, de la vieillesse et sa fascination pour la jeunesse associée à la beauté. Sa poétique ne s’attache pas à un être en particulier comme chez nombre de poètes mais au contraire Cavafy parle souvent de visions furtives, évoque à mots couverts l’amant d’un soir et parfois même fait appel à ses souvenirs. Chez lui, plus sans doute que chez les autres poètes, la poésie est intimement liée à lui-même, avec cet usage du soliloque et de l’auto-évocation, un peu comme s’il ne s’adressait pas au lecteur. Cela certes donne des poèmes sensuels, voire érotiques, mais aussi sans grand lyrisme et le style est à la fois sec et souple, un peu comme dans le grec ancien. A côté de ce penchant essentiellement homosexuel, son écriture se transforme en pastiche, prend une dimension historique, toujours d’inspiration grecque, avec des références à la mythologie (c’est son côté érudite) et fait appel à la notion de destin, de déclin, de moralité, c’est à dire revêt un côté sentencieux. Elle est parfois distante, peu émotionnelle.
Cavafy est un poète chrétien et, avec sa sexualité refoulée, il ne peut que concevoir une culpabilité, et c’est sans doute ce qui a motivé son volontaire maintien dans le secret, refusant la notoriété que son talent aurait pu lui procurer. Il avait en effet peur du scandale que la publication de ses poèmes pourrait provoquer, l’homosexualité était en effet un tabou. Il était l’habitué des tavernes et des bordels et ressentait du désir et de la honte à cause de cela.
Ce que je retiens dans la poésie de Cavafy c’est son aspect éminemment personnel, il explore sa mémoire, la ravive avec des mots et j’y vois un effet cathartique, son écriture ayant aussi une fonction purificatrice pour cet être refoulé, une manière d’y trouver ce que ses amants lui ont refusé, de compenser ce temps perdu pour le plaisir, ce temps enfui que la mémoire fait renaître. Il note aussi le coté transitoire de ses rencontres en parlant de leur départ qui le laisse toujours seul et abandonné, comme une fatalité. C’est une certaine manière de dénoncer le temps perdu, la clandestinité des rencontres, leur côté clandestin, furtif. Il n’empêche, cela fait de lui un être essentiellement solitaire, friand de voluptés mais hanté par la mort, une sorte de danse lente entre Éros, Chronos, Mnémosyne et Thanatos.
-
La collection invisible - Stefan Zweig
- Le 28/08/2020
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N° 1496- Août 2020.
La collection invisible – Stefan Zweig.
Traduit de l’allemand par Manfred Schenker.
Nous sommes dans cette Allemagne de l’entre-deux-guerres, un pays vaincu où l’inflation galopante ruinait les citoyens qui se dépêchaient de dépenser immédiatement l’argent qu’ils percevaient avant qu’il n’ait plus la moindre valeur. Dans ce contexte, tout objet d’art était une source de richesse et le narrateur, un antiquaire désœuvré mais désireux de faire quelques bonnes affaires, a l’idée de visiter ses anciens clients et parmi eux un vieux collectionneur de gravures de grand prix qu’il avait acquises en se privant toute sa vie et qu’il gardait jalousement. Il a perdu la vue il y a quelques années, mais a gravé dans son souvenir chaque détail de ses estampes et d’une certaine façon c’est heureux parce que sa femme et sa fille, pour survivre, ont dû vendre les originaux pour les remplacer par des feuilles vieillies, analogues au toucher. Et, bien sûr, il ne s’est rendu compte de rien et c’est à leur demande que l’antiquaire accepte de jouer le jeu jusque dans le moindre détail.
Le vieil homme ne veut pas les vendre, seulement les montrer et les commenter à l’antiquaire et ce n’est évidemment que des feuilles jaunies qu’il lui décrit, avec le seul secours de sa mémoire, sans que son interlocuteur ait le courage de lui dévoiler la vérité. Il s’ensuit une sorte de parade fantasque mais imminemment charitable où le vieil homme prend plaisir à présenter à son hôte des chiffons de papier que sa seule imagination suffit à faire vivre. Le narrateur lui emboîte le pas et sa démarche, certes généreuse, permet au vieux collectionneur de se féliciter de son choix d’avoir ainsi investi dans des valeurs sûres qui lui survivront. La félicité du vieillard lui redonne sa jeunesse et est à ce point communicative que les deux femmes sont comme transformées par leur propre supercherie.
Cette histoire ressemble à une fable qui serait presque comique si on la sortait de son contexte. J’y vois une image de la condition humaine, de la propension qu’ont les hommes à circonvenir les autres hommes, à leur mentir, à être hypocrites avec eux, souvent pour des raisons moins humaines ou humanitaires que celle qui nous est soufflée ici puisqu’il s’agit de la survie. Il s’ensuit souvent des situations ubuesques où les mystifiés se couvrent de ridicule, souvent à cause de leur grande naïveté. Se répéter les choses jusqu’à satiété suffit souvent pour les mystificateurs, à se convaincre de leur réalité.
Cette nouvelle n’est pas sans référence à la vie de Stefan Zweig qui était lui aussi collectionneur de livres originaux, de manuscrits, d’autographes et de portraits d’auteurs mais cette collection sera dispersée par les nazis. Par l’écriture de cette nouvelle, publiée en 1925 en Autriche, a-t-il eu l’intuition des dégâts irréversibles qu’allait occasionner le nazisme en Allemagne puis en Europe, les autodafés où ses livres seront détruits ?
©Hervé Gautier mhttp:// hervegautier.e-monsite.com
-
Le voyage dans le passé - Stefan Zweig
- Le 25/08/2020
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N° 1496- Août 2020.
Le voyage dans le passé – Stefan Zweig.
Traduit de l’allemand par Baptiste Touverey.
Il s’agit d’une nouvelle, retrouvée après la mort de Zweig (1881-1942), parue sous forme de fragments dans un recueil de 1929 et publiée dans la forme définitive en 1976.
Louis est un jeune homme travailleur mais pauvre qui a passé toute sa jeunesse au service des autres et souhaite ardemment sortir de sa condition. Ses mérites le mettent en contact avec le Conseiller G, directeur d’une usine importante qui fait de lui son secrétaire particulier avec le titre de « Professeur », une belle revanche sur ces années d’humiliation. Après quelques mois il est envoyé au Mexique pour diriger une annexe de cette entreprise ce qui lui assure son avenir mais l’éloigne de l’épouse de Conseiller dont il était tombé amoureux. Est-ce, de sa part , une volonté de promouvoir le jeune homme ou une volonté de l’éloigner de sa jeune épouse ? Ce sera une séparation à laquelle cet amour réciproque risque de ne pas résister, l’épouse du Conseiller, demeurée fidèle à son époux plus vieux, lui jurant de se donner à lui à son retour. Cela dura neuf longues années et Louis revint après la guerre et après s’être marié vers cette femme désormais veuve et donc libre, mais, malgré une correspondance assidue leurs retrouvailles sont empreintes de silences gênés, de non-dits, d’hésitations, minées par le vieillissement, la volonté pour elle de laisser les choses en l’état pour garder intacts leurs sentiments l’un envers l’autre, Mme G enjoignant à Louis d’oublier sa promesse d’intimité entre eux. Rien n’avait changé pour elle dans ses sentiments pour lui, rien sauf les ravages du temps sur sa personne et la séparation. Elle était devenue une vieille femme, désireuse d’oublier ses emportements amoureux de jadis face à la passion intacte de Louis. Il y a des connotations contraires dans le « pèlerinage » qu’ils font ensemble à Heidelberg (avec la symbolique du voyage en train toujours émouvante) et le cortège nationaliste et revanchard qu’ils croisent avec sa volonté de bousculer l’histoire, face à la détermination de Louis de revivre intensément cet amour passionné et intact et la résolution contraire de Mme G, le poids du destin ?
Zweig, nous le savons, était un fin psychologue et même si ce qu’il décrit est une manière surannée de vivre l’amour, avec passion mais aussi retenue et respect de l’autre (en cela aussi il est témoins de son temps mais aussi d’une certaine manière de vivre une relation amoureuse, différente de celle d’aujourd’hui), il analyse les sentiments de chacun de ses personnages avec une grande finesse et traduit avec des mots justes leurs états d’âme au cours du temps, évoque leur passion réciproque dans le contexte, dissèque la nature des changements qui affectent chacun d’eux, mesure le poids du temps auquel « l’humaine condition » est assujettie. C’est bien effet là le sujet, l‘effet du temps et de l ‘éloignement sur les relations humaines , son action sinon destructrice à tout le moins définitivement transformatrice. L’amour de Louis pour Mme G est intact, en apparence du moins, mais il réclame son moment d’intimité jadis promis alors qu’elle souhaite laisser les choses en l’état, conservant leurs instants de pur bonheur passés pour ne privilégier que le présent, les réduisant à ces deux spectres dont parlent les quelques vers de Verlaine qu’ils évoquent ensemble. Les descriptions sont à la fois précises et poétiques et traduisent elles aussi cette nostalgie qui s’installe entre eux comme une sorte d’obstacle que ni l’un ni l’autre, mais pour des raisons différentes, ne franchira. Ils se sépareront, sans espoir de se revoir et garderont de cette liaison idéalisée un souvenir différent, amour intact mais désir inassouvi pour lui, volonté de se résoudre à l’action du temps pour elle et ainsi se retirer du monde, fidèle à la fois à son époux défunt et à cet amour romantique et impossible
Écrire, même dans le registre de la fiction, n’empêche pas celui qui tient la plume de mettre un peu de lui-même dans une histoire sortie de son imagination et il est difficile de ne pas faire de parallèle entre la vie de Zweig et ses personnages. Il y a aussi un aspect cathartique de l’écriture qui fait admettre plus facilement les choses quand elles sont écrites et surtout sublimées par la création littéraire.
-
Ma poésie comme biographie - Valentin Dolfi
- Le 28/05/2020
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
Ma poésie comme biographie - Valentin Dolfi.
Tout d’abord je remercie Tanderica (Gabrielle Danoux) de m’avoir permis d’aborder Valentin Dolfi, un poète roumain contemporain, né en 1961 qui vit dans la ville thermale de Băile Govora où il est bibliothécaire et dont elle est la traductrice.
En réalité ce recueil est intitulé « Photos de famille », rebaptisé par la traductrice avec l’accord de l’auteur « Ma poésie comme biographie » et s’inscrit dans une anthologie « La nature éphémère des choses » . Le recueil se décline en plusieurs moments : « Casamate de papier », « Le monde de plâtre », « La vie de carton-pâte », « L’anthologie de la petite ville de Băile Govora ». Le titre général de ce recueil indique assez clairement que l’auteur va parler de lui, de sa vie, de sa mémoire.
Aborder un écrivain étranger est toujours une aventure surtout si cette découverte se fait par le biais de l’écriture poétique, différente de celle du roman. La poésie n’est jamais aussi appréciée que lorsqu’elle se lit à haute voix mais ici je diviserai ce recueil en deux parties inégales. Dans les trois premiers chapitres, les mots sont un peu saccadés comme les images de rue qui se succèdent devant les yeux de celui qui écrit, des clichés du quotidien qui réveillent son enfance, ses rêves d’ailleurs et ses folies ou simplement s’imposent par leur banalité quotidienne. L’écriture est hachée, avec des inversions, des répétitions sans ponctuation, des expressions et des mots étrangers, ce qui ne facilite pas la lecture et on perd souvent en émotion. Il y a la fascination de l’Amérique ou de la France, c’est à dire de l’ailleurs que les événements, le destin où je ne sais quoi ont fait avorter, celle de l’amour qui donne l’illusion de la jeunesse et de la liberté mais n’enfante que la solitude déprimante face à la silhouette d’une femme en allée. Les mots qu’on emprisonne sur le papier, parce qu’ils doivent sortir pour fixer l’instant ou libérer l’âme grâce à son pouvoir cathartique, restent morts même face aux volutes bleues de la fumée d’une cigarette ou le farniente d’une bière sirotée à une terrasse de bistrot. Écrire est un accouchement douloureux et se heurte parfois à l’indifférence d’autrui, mais ceux qui ont choisi d’écrire le font quand d’autres préfèrent invoquer Dieu, verser des larmes ou boire de l‘alcool.
Dans ces trois parties j‘ai senti l’auteur perdu dans ce monde, qu’il ait la couleur d’une grande ville ou le microcosme d’une maison, malgré la présence d’une mystérieuse Mme Fisher, j’ai senti l’omniprésence de l’ennui et du dérisoire quotidiens, « une vie de carton pâte », celle du travail chaque jour recommencé, sans intérêt, sans amour et avec des souvenirs qui la pourrissent tous les jours un peu plus. L’écriture ne parvient pas toujours à l’apprivoiser comme elle n’apprivoise pas davantage la vie ordinaire en général ni la mort, simple événement qui en marque la fin, sonne comme une sorte de délivrance, le terme d’une existence sans joie et souvent dans la souffrance, face à un Dieu absent, inutilement invoqué et qui restera toujours mystérieusement silencieux, comme un leurre. Un abandon, une déréliction que ni le travail ni l’écriture ne suffisent pas à exorciser, parce que les mots ne pèsent rien.
En revanche j‘ai beaucoup plus apprécié la dernière partie consacrée à la ville de Băile Govora parce que l’auteur y parle des autres, des petites gens qui vivent comme ils le peuvent et se battent pour survivre ne trouvant leur salut que dans l’abnégation, le travail dur et ingrat ou l’alcool. La vie s’interrompt vite ou perdure dans la souffrance ou dans l’injustice de la maladie et la trahison des autres, toute chose que Dieu, ou l’idée qu’on s’en fait, ne suffit pas à adoucir. Ces moments délétères ainsi évoqués se conjuguent avec l’histoire de la Roumanie, l’arrivée des communistes, la dictature de Ceausescu et la cruauté de ceux à qui on croyait pouvoir faire confiance. Ces petits, ces sans grade, meurent ne laissant rien derrière eux que la désolation et le malheur et leur passage sur terre se dissout dans l’oubli ou dans un souvenir douloureux.
-
Cœurs cicatrisés - Max Blecher
- Le 25/05/2020
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1468.
Max Blecher- Cœurs cicatrisés.
Tout d’abord je remercie Tanderica de m’avoir permis d’aborder Max Blecher (1909-1938) romancier roumain dont elle est la traductrice.
Ce roman a été publié en 1937 soit quelques mois avant la mort de son auteur. Emmanuel, un jeune étudiant roumain, atteint du mal de Pott, la tuberculose osseuse, interrompt ses études pour être soigné dans un sanatorium à Berck sur mer. A cette époque, cette maladie était redoutée parce que très contagieuse, sans traitement autre que le sanatorium réservé aux plus riches. Cet endroit est évidemment un microcosme où tout est exacerbé par cette maladie, la vie s’y déroule au rythme de la douleur, des espoirs de guérison, de la solitude, de la désespérance, avec ses histoires de haine et d’amour, de violences et de jalousies, une société en raccourci, mais avec des séances quelque peu surréalistes et même érotiques où les malades font semblant d’être bien portants. Les malades, de véritables morts-vivants, vivent couchés sur un chariot mobile et plâtrés, dans l’atmosphère aseptisée du sanatorium ou face à la mer, mais aussi dans la crasse et la sueur qui s’accumulent sous la coque qui les entrave. Le plus étonnant est que les soignants de cet établissement et même les habitants de Berck sont tous d’anciens malades qui ont été traités et guéris dans les sanatoriums de cette ville, comme si quitter cet univers leur était impossible. Pourtant Emmanuel, pendant cette période entre parenthèses fuit autant qu’il peut cette emprise « hospitalière », comme pour préparer son retour à la vraie vie. Ce récit débute en automne/hiver mais le plus surprenant est que cet établissement se transforme, l’été venu, en hôtel pour touristes, reléguant les malades dans une partie plus discrète des lieux.
Le titre évoque des cicatrices, mémoires d’anciennes blessure souvent profondes qu’on porte sur la peau et aussi dans le souvenir, comme une empreinte douloureuse. Elles ne font pas mal mais elles portent en elles la trace de la souffrance. La peau s’est reformée mais différemment en laissant des marques souvent insensibles au froid ou à la chaleur. C’est bien la mémoire qui est sollicitée dans ce roman, mais celle des moments difficiles à l’image de l’exergue de Kierkegaard qui évoque « un terrible souvenir à affronter » . C’est aussi celle des femmes qui entourent Emmanuel et qui toutes semblent amoureuses de lui alors que lui-même, au bout du compte, s’en détache facilement. Quand il est encore étudiant, Colette lui voue un amour sincère mais il y a une sorte d’oubli entre eux et au sanatorium Solange s’attache à lui, mais finalement on a l’impression que naît entre eux une sorte de lassitude qui se traduit par le quasi suicide de Solange et la fuite d’Emmanuel. Apparemment il ne les considère que comme des partenaires sexuelles, destinées à lui adoucir la vie. Dans le domaine du souvenir il y a aussi une place pour ceux des malades dont certains guérissent, perdent la tête à force d’avoir espéré une guérison qui ne vient pas, s’en remettent à des charlatans ou simplement décèdent. A la fin Emmanuel est considéré comme guéri mais quand il quitte l’établissement on a l’impression que la camarde est en embuscade et qu’elle va bientôt le délivrer et lorsque Quintonce meurt, il y a une sorte de fou rire qui soit dédramatise la mort soit introduit une notion d’hallucination face au phénomène.
Il sourd de ce roman une sorte d’ambiance malsaine, une envie de fuir cet établissement, à cause de la maladie et de sa guérison hypothétique, un peu comme si toute la douleur du monde s’était donné rendez-vous en ces lieux, mais aussi de la mélancolie de cette côte du nord, déserte une grande partie de l’année, de la tristesse de la ville et l’ennui qu’elle suscite, mais c’est pourtant un ouvrage fort bien écrit, aux descriptions d’un émouvant réalisme sans négliger l’analyse psychologique des différents personnages.
Il y a beaucoup de traits communs entre Emmanuel et l’auteur, mort de tuberculose à vingt-huit ans au point qu’on a parlé de roman autobiographique. Cependant il me semble que Max Blecher a pu écrire cette œuvre en y mettant de l’imaginaire, ce qui peut le faire classer dans la catégorie de l’auto-fiction, dans le but d’exorciser sa souffrance mais aussi de forcer le destin pour repousser l’échéance de sa propre disparition prochaine dont il avait peut-être l’intuition.
-
Le collectionneur de sons et autres nouvelles - Anton Holban
- Le 21/05/2020
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N° 1467– Mai 2020.
Anton Holban – Le collectionneur de sons et autres nouvelles.
Tout d’abord merci a Tandarica qui m’a permis de rencontrer Anton Holban (1902-1937), cet écrivain roumain mort à 34 ans dont les œuvres ont été publiées à titre posthume et dont elle est la traductrice.
Découvrir un écrivain, surtout s’il est étranger, est toujours pour moi un événement, même à travers une seule œuvre. Le livre refermé il me reste de cet homme l’impression d’un écorché-vif, qui n’a pas trouvé sa place dans ce monde et qui s’est réfugié dans l’écriture et dans son pouvoir cathartique. Son oncle, Eugène Lovinescu qui était aussi un célèbre critique littéraire roumain de l’entre-deux guerres le considérait comme atteint de névrose. L’écriture d’Holban se caractérise par la pratique de l’autofiction qui consiste à mêler l’imaginaire à des événements de sa propre vie, comme l’ont fait Proust ou Colette, sans pour autant tomber dans l’autobiographie. Ce concept est récent et il m’a toujours paru évident qu’un écrivain, même s’il choisit l’imaginaire le plus effréné, projette toujours dans son texte un peu de sa propre personnalité, de ses fantasmes et de ses obsessions, voire de son inconscient et ce même dans l’évocation de personnages secondaires. En effet il parle souvent de lui, de ses goûts et de ses passions, de sa carrière de professeur (« Glorieuse journée à Cernica »), de ses voyages, de ses études ou de ses grands-parents et même s’il met en scène un tiers, par exemple Sandu dans « Le collectionneur de sons », c’est de sa vie dont il parle. Quand il mêle l’imaginaire à des souvenirs de voyage, comme dans « Châteaux sur le sable », des éléments de sa propre vie et de sa personnalité sont sous-jacents. Cela lui a même valu d’être considéré comme dépourvu d’imagination au point que certains de ses collègues se sont reconnus dans ses romans. Je notre cependant qu’il peine un peu à imaginer les années de maturité que vivront pour les jeunes filles croisées dans sa vie.
Holban est notamment un explorateur de la mémoire, un peu à la manière de Proust et ce n’est sans doute pas un hasard s’il a emprunté le titre d’une de ses nouvelles à l’auteur français (« A l’ombre des jeunes filles en fleurs »). Dans cette nouvelle il se souvient qu’il a été professeur et se livre à une explication d’Andromaque de Racine, avec de nombreuses citations en français, en souvenir de son séjour dans notre pays, mais il s’adresse surtout à des jeunes filles. Pourtant, une autre caractéristique de cet écrivain tourmenté me paraît être la timidité, surtout vis à vis des femmes. Dans « Petite aventure sur une interminable plateforme »le narrateur raconte sa rencontre dans un train bondé d’étudiants en état d’ébriété avec une jeune japonaise réservée. Cela m’évoque le merveilleux poème d’Antoine Pol, « Les passantes » chanté par Georges Brassens avec cette silhouette furtive de femme qui s’évanouit. De femme Japonaise, (est-ce un fantasme personnel de l’auteur?) il sera encore question dans « Châteaux sur le sable » où un voyageur, Paul, accompagne Mitsuko lors d’un voyage en Égypte avec un groupe de touristes. Leurs relations va de la complicité amicale mais réservée de la part de le jeune femme aux discussions houleuses et à une certaine goujaterie de Paul, sans doute à cause du bousculement de ses obsession secrètes. L’épilogue lui donne une sorte de claque. De jeune fille il est encore question dans « Antonia », une jeune musicienne russe qui ne cache pas son attirance pour le narrateur, un jeune lycéen roumain qui, bien entendu est amoureux d’elle. Son attitude à elle est ambiguë et lui se comporte d’une manière jalouse et embarrassée au point de l’imaginer, de nombreuses années après, parce qu’évidemment il ne l’a pas oubliée. Pourtant ses relations avec les jeunes filles ou les femmes semblent être entachées d’impossibilité et de remords, un peu à l’image de son mariage, d’ailleurs bref et probablement malheureux.
La musique tient une grande place dans la créativité d’Holban. Il y fait souvent des allusions précises dans nombre de ces nouvelles et mêmes des références nombreuses (« Le collectionneur de sons ») et montre une véritable addiction pour cet art. Avec « Le tarin et son maître », il nous parle d’un oiseau prénommé Boris qui a une préférence pour le violon et une œuvre d’un compositeur français admirée par Debussy ! C’est aussi l’occasion pour le lecteur de partager la culture musicale de l’auteur. Cependant son idée maîtresse qui revient sans cesse comme une obsession, c’est la mort. Elle plane sur l’ensemble de ce recueil au point d’être un leitmotiv prégnant. Nous sommes tous mortels mais dans nos sociétés occidentales nous vivons comme si nous ignorions cette échéance. Holban au contraire la rappelle constamment comme s’il savait que pour lui le parcours serait bref. Il l’évoque à travers son aïeule (« Grand-mère se prépare à mourir ») mais également il est souvent question de la mort de ses personnages. Je me suis toujours demandé si les êtres qui sont destinés à mourir jeunes n’en ont pas l’intuition et s’y préparent. Lui-même s’inquiète du devenir de sa collection de disques après sa mort. Dans « Hallucination» il met en scène son propre enterrement avec cette interrogation.
Une belle découverte en tout cas.
©Hervé Gautier http:// hervegautier.e-monsite
et qui rend les rues petit à petit un peu moins bleues.
-
Meurtriers sans visage - Henning Mankell
- Le 07/03/2020
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
 N° 1440 - Mars 2020.
N° 1440 - Mars 2020.Meurtriers sans visage – Henning Mankell- Christian Bourgois éditeur.
Traduit du suédois par Philippe Bouquet.
Dans une ferme isolée, un couple d’agriculteurs retraités a été sauvagement assassiné. Ce qui intrigue les enquêteurs c’est le nœud coulant peu commun qui a servi a étrangler la femme qui, avant de mourir a prononcé des mots inaudibles et le terme « étranger »semble avoir été entendu. L’information ayant fuité ça ne va pas manquer de déclencher une vague de xénophobie dans la région où séjournent nombre d’immigrés. Il y avait sûrement eu des fuites au commissariat ! Ce sera l’occasion pour Wallander, et pour le lecteur, de prendre conscience que la société suédoise est moins lisse et policée qu’il y paraît et connaît les mêmes soubresauts racistes que les autres.
De dénonciations en investigations, il apparaît que cette famille aurait fait une fortune illicite pendant la deuxième guerre mondiale . De plus les circonstances du meurtre sont des plus bizarres et le mot « étranger » qu’un policier a cru entendre dans la bouche de cette femme qui allait mourir et qui a miraculeusement été publié dans la presse , nourrit les tensions xénophobes et génère un autre meurtre.
Au cours de cette enquête Wallander qui vient de se séparer de sa femme vit une solitude difficile ainsi que des relations conflictuelles avec sa fille. Les visites qu’il fait à son père vieillissant sont également pour lui une épreuve, les relations entre les deux hommes n’ayant jamais été vraiment bonnes, et notre inspecteur est confronté à titre personnel, outre à cette enquête qui n’avance pas, à des difficultés d’ordre familiale dont il se passerait bien.
Ce policier désabusé, un peu dépressif et même alcoolique me plaît bien.
C’est le premier roman de cette série qui sera popularisé en France par la télévision, sûrement pas le meilleur de la série et dont l’intrigue traîne un peu mais qui met en lumière cet inspecteur devenu emblématique.
©Hervé Gautier http:// hervegautier.e-monsite.com
-
Une main encombrante - Henning Mankell
- Le 13/02/2020
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
 N° 1430 - Février 2020.
N° 1430 - Février 2020.Une main encombrante – Henning Mankell – Éditions du Seuil.
Traduit du suédois par Anna Gibson.
Il est plutôt chanceux l’inspecteur Kurt Wallander. En ce mois d’octobre 2002, il vient de trouver ce dont i rêve depuis longtemps, lui qui voulait quitter son appartement d’Ystad pour vivre à la campagne, avec Linda sa fille qui travaille avec lui au commissariat et avec un chien, un avant-goût de la retraite en quelque sorte. Ça tombe plutôt bien puisqu’il est vraiment lessivé et même un peu désabusé par son métier, par la vie en général, sauf que la réalité va être un peu différente. En explorant le jardin de cette propriété qui lui plaît bien, il tombe sur les os d’une main, et donc sur une enquête. Au bout de la main il y a évidemment un squelette dont l’état laisse à penser que les investigations vont être difficiles à cause de la mort qui remonte au siècle dernier, de la charge de travail qui augmente pour des enquêteurs de moins en moins nombreux et par-dessus tout cela la presse qui s’en mêle et qu’un autre squelette est découvert.
J’ai retrouvé avec plaisir le personnage de Wallander et l’ambiance de cette courte enquête qui nous fait remonter le temps et qui insiste sur son état d’esprit et ses aspirations. Selon l’auteur, ce serait la dernière de l’inspecteur, fatigué, désireux de se retirer... Mais aussi pour l’auteur cette volonté de passer à autre chose, de l’abandonner à la vieillesse, à une sorte de néant ! On sent que Mankell lui aussi est sans doute gagné par la nostalgie. Les investigations sont quelque peu hésitantes mais mon attention a été attirée par les dernières pages consacrées par l’auteur aux rapports qu’il entretenait avec Wallander, c’est à dire les relations créateur-créature. Il nous parle de la « naissance » de son personnage, de l’origine de son nom, de son diabète, de sa solitude dans l’attente d’une hypothétique compagne, de son côté désabusé... Mankell aborde la question d’une manière originale se demandant si Wallender lisait les mêmes livres que lui. Et lui de répondre, à sa place, en précisant que Kurt n’était sans doute pas un grand lecteur, avec peut-être un faible pour Sherlock Holmes ! Puis il passe à autre chose. Mais là, je suis resté un peu sur ma faim. Le personnage de roman vit en effet, certes par intermittence, mais néanmoins une existence quasi réelle puisque, en Suède, il est souvent arrivé qu’on interpelle Mankell dans la rue... en lui demandant des nouvelles de Wallander ! J’aurais bien voulu le voir développer les rapports qu’entretient, à l’intérieur de l’intrigue, l’écrivain qui tient la plume et reste, en principe, maître du jeu avec le personnage qui lui obéit mais souvent, au fils des pages, entend bien imposer sa manière de vivre les événements et de faire valoir sa liberté individuelle. Ce concept qui peut paraître anodin voire inutile m’a toujours fasciné et n‘est pas, à mon avis, un simple exercice de style mais fait partie intégrante du processus créatif. Laisser au personnage son libre arbitre, se laisser porter par lui au point de modifier son idée de départ est pour l’écrivain une façon de s’effacer devant sa création.
Henning Mankell est mort en 2015. A ma connaissance, il n’a pas renouvelé ce genre d’explications, passionnantes pour moi.
©Hervé Gautier http:// hervegautier.e-monsite.com
-
Un soupçon légitime - Stefan Zweig
- Le 07/02/2020
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
 N° 1427 - Février 2020.
N° 1427 - Février 2020.Un soupçon légitime - Stefan Zweig- Bernard Grasset.
Traduit de l'allemand par Baptiste Touverey.
Le titre lui-même peut évoquer une fiction policière, ce qui est étonnant sous la plume de Zweig, mais après tout pourquoi pas ? C’est une longue nouvelle publiée longtemps après sa mort mais écrite par Zweig alors qu'il s'est installé en Angleterre pour fuir le régime nazi et qui fait allusion dès la première page à un meurtre. La narratrice, Betsy s'est installée avec son mari dans la campagne anglaise pour une paisible retraite. Un couple d'Anglais plus jeune dont le mari John Limpley est aussi excessif et exubérant que son épouse, Ellen, est oisive et réservée, devient leur voisin. Face à l’état de déréliction de l’épouse et au nom des relations de bon voisinage, les retraités leur offre un chien, baptisé Ponto, auquel John s’attache, à en devenir esclave. Quand son épouse tombe enceinte l'animal est rejeté et c'est le drame.
Comme toujours chez Stefan Zweig, outre le style élégant et coutumier de notre auteur, c'est l'analyse psychologique des personnages et des sentiments qui est importante bien que le personnage principal soit un chien. Dans le couple Limpley le mari est amoureux de sa femme et l’entoure de son attention mais en réalité l’oppresse par son attitude excessive et même par sa présence débordante, tandis que cette dernière est particulièrement effacée et aspire à la solitude. John déborde d’amour et devant la relative indifférence d’Ellen, reporte cette affection sur son chien. Puis tout change à partir du jour de la naissance de l’enfant du couple. Zweig décrit cette manière de s'attacher à quelqu'un avec passion au point de l'idéaliser, voire de l'idolâtrer pour ensuite, soit à la longue soit à la suite d'un évènement extérieur de le rejeter au point de l'ignorer complètement de l'humilier voire de le haïr. Cette attitude, bien qu'elle s'adresse à Ponto et qu'elle ait quelque chose d'excessif, est vérifiable tous les jours dans l'espèce humaine. D’un autre côté, si le rôle du chien me paraît quelque peu exagéré, son attitude au regard de l’état de déréliction que lui impose plus tard son maître, ses pulsions d’hypocrisie et de vengeance et bien entendu de mort, ont quelque chose d’humain.
Pour autant j'ai été un peu surpris par cette nouvelle qui me paraît quelque peu différente du registre traditionnel de Zweig. Je lis que ce texte aurait été écrit lors de son passage en Angleterre soit entre 1935 et 1940 et publié en 1987 (et en 2009 dans sa traduction française) soit longtemps après sa mort. Certes, mettre ainsi en scène un animal est original et tient de la fable, ce qui est peu commun chez Zweig, de même que le caractère enjoué de John tranche quelque peu sur l’atmosphère qui baigne généralement les œuvres de notre auteur et ce même si cette histoire porte au paroxysme le message qu’il entend faire passer. Mais après tout pourquoi pas puisqu’il y ajoute une atmosphère de suspense ? Je reste cependant dubitatif devant cette nouvelle, et ce bien que j'aie pour l’œuvre de Zweig un intérêt intact.
©Hervé Gautier http:// hervegautier.e-monsite.com
-
Le joueur d'échecs - Stefan Zweig
- Le 07/11/2019
- Dans Autres littératures étrangères
- 2 commentaires
La Feuille Volante n° 1407– Novembre 2019.
Le joueur d'échecs - Stefan Zweig - Éditions Payot et Rivages.
Traduit de l'allemand par Jean Torrent.
Sur un paquebot qui va de New-York à Buenos Aires, se joue une série de parties d'échecs. Cette nouvelle met en scène le narrateur dont nous ne saurons rien, Mirko Czentovic, un être inculte, médiocre et arrogant qui a la particularité d'être un génie devant un échiquier en y jouant automatiquement et d'instinct, une sorte d'autiste, et qui, la partie gagnée, de redevenir ce qu'il est, un quidam vulgaire, ignare et sans intérêt mais qui est, depuis l'âge de vingt ans, champion du monde d'échecs. Le troisième personnage est un autrichien mystérieux, MB, qui accepte de jouer avec lui alors qu'il n'a pas touché un échiquier depuis plus de vingt ans. Il rencontre Czentovic par hasard lors de la traversée. La première partie est réputée nulle, il gagne la deuxième mais perd la troisième d'une manière assez bizarre, une sorte de démission volontaire, un peu comme s'il était victime d'une hallucination, s'il jouait une autre partie que celle qu'il était en train de disputer.
Il est difficile de ne pas voir, dans cette courte nouvelle posthume des connotations avec l'auteur, sa vie ayant largement nourri son œuvre. Zweig pratiquait les échecs en amateur et on pourrait y voir un exemple d'addiction au jeu ou plus sûrement une illustration d'une forme particulière de violence. Le personnage intéressant ici, c'est MB, un avocat autrichien exilé, un peu comme l'auteur qui a passé sa vie à fuir les nazis qui avaient destiné aux flammes ses différents livres, qui a parcouru le monde pour débarquer en Amérique du sud, à ses yeux, terre de liberté et de tolérance. Ainsi, à la suite d'une rencontre avec le narrateur, MB accepte de lever le voile sur sa vie. Il raconte comment il a été l'objet d'internement de la part de la Gestapo, mais pas dans un camp de concentration comme on pourrait s'y attendre mais dans une chambre d’hôtel, maintenu au secret. Par hasard, il tombe sur un traité d'échecs et apprend par cœur les combinaisons des grands maîtres au point de jouer dans sa chambre contre lui-même avec un échiquier de fortune et des pièces faites de miettes de pain. Remarquons au passage le lien fait entre le pain nécessaire à la vie et ce jeu reconstitué qui va prendre pour lui une importance capitale. Jusque là, sa solitude et le silences étaient tels qu'il allait devenir fou et aurait presque préféré être astreint au travail et à la promiscuité des camps, ce qui lui aurait occupé l'esprit. Dès lors qu'il trouve ce livre, il reprend confiance, exerce son esprit puisque ce jeu, à l'inverse des autres, ne fait pas appel au hasard mais à la technique, mais c'est de courte durée. Certes il s'exerce au point d'être fasciné par les échecs et, à force de jouer mentalement contre lui-même, il devient son propre bourreau puisqu'il ne pense qu'à cela, ce qui rend sa solitude destructrice. Il tente de pallier la folie en se remémorant des articles du Code Civil ou des œuvres littéraires, ce qui peut être interprété comme le fait que la culture puisse faire échec à la barbarie. Là aussi c'est une sorte d'impasse puisque il perd ainsi le sens des réalités et il ne voit d'autres issues que la fuite. MB bénéficie heureusement de l'aide d'un médecin qui le sort de cette détention et de cette spirale infernale, mais il garde quand même des marques indélébiles de sa détention et des violences qu'il a subies en perdant la troisième partie contre Czentovic. Pour Zweig, qui pensait trouver au Brésil la paix intérieure, cette fuite débouche sur le suicide.
Il y a une excellente analyse de ce que peut-être cette forme subtile de violence qui est loin d'être théorique puisqu’elle sert encore quand on veut se débarrasser de quelqu'un, mais cette nouvelle illustre, à mon avis, l'effet cathartique de l'écriture (ou de la parole), mais, comme je l'ai toujours pensé, ce pouvoir a ses propres limites et ne saurait guérir de ses obsessions un être tourmenté comme Zweig qui n'a pas pu ne pas connaître les théories de Freud dont il prononce l'éloge funèbre. Une telle histoire ne peut rester sans explication et l'interruption de la partie par MB à l'invitation du narrateur, sa volonté de se retirer du jeu, appellent, à mon sens, celle de la vie devenue insupportable à notre auteur et donc de son suicide.
©Hervé Gautier.http:// hervegautier.e-monsite.com
-
La mort d'Ivan Illitch - Tolstoï
- Le 01/08/2019
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1372 – Août 2019.
La mort d'Ivan Illitch – Léon Tolstoï - Le livre de poche.
Les trois textes réunis dans ce recueils "La mort d'Ivan Illitch - Maître et serviteur- Trois morts" ont été publiés à des dates différentes, dans de revues différentes et ont été accueillis favorablement par les cercles littéraires et par le public.
Dès lors qu'il prend conscience de sa vie, la mort devient pour l'homme une source de préoccupations et de questions que les religions ne résolvent qu'autant qu'on y croit. Elle est l'image de notre peur et notre impuissance face à elle et se vouloir immortel, même dans un éventuel autre monde est à la fois une absurdité et un leurre savamment entretenus. Cette immortalité peut même parfois être supposée ou simplement espérée en ce monde, au nom même de la vie, alors qu'en tant qu'humain nous sommes tous assujettis à cette même condition de mortels. c'est un peu ce que pense Illitch au début, peut-être pour se assurer. Le temps qui passe, le vieillissement, la souffrance et la douleur en font partie, sont, surtout à son époque, les prémices du trépas et c'est un éternel questionnement de savoir s'il faut révéler au malade son état ou l'entretenir dans l'illusion et le mensonge de la guérison. On cache la réalité de sa santé à l'épouse de Dmitrievich et Ivan Illich supplie qu'on lui dise la vérité sur son état qu'il sent bien aller en se dégradant et il perçoit la camarde qui rôde. Cet Illich, semble-t-il inspiré par un personnage réel, après avoir connu une vie matrimoniale assez quelconque mais une réussite professionnelle brillante, se débat dans les affres de l'agonie, sent qu'elle va l'emporter, porte sur sa vie un dernier regard. La mort est un passage vers le néant, le même que celui qui existait avant notre naissance, la simple fin de notre parcours terrestre et ce magistrat semble l'accepter sans la moindre peur, comme une délivrance. Ce thème est particulièrement présent dans l’œuvre de Tolstoï (1828-1910) et il a sûrement exprimé dans le personnage d'Ivan Illictch ses propres cruelles obsessions puisque, nous le savons, l'écriture a aussi une fonction cathartique, mais je ne peux pas ne pas penser qu'un écrivain ne veuille pas, après sa disparition, laisser une trace grâce à ses œuvres qui lui survivront. Notre auteur a connu cette réalité très tôt dans sa vie, dans sa famille, puisque, à son époque, la médecine était balbutiante. La mort c'est aussi l'heure du bilan, l'exacte forme du "jugement dernier" où, face à soi-même et sans complaisance on se met en scène dans cette "parabole des talents" de l’Évangile. Qu'a été notre vie, à quoi ou à qui a-t-elle servi, qu'en avons-nous fait? c'est sans doute le sens de ce dialogue entre le magistrat et"la voix de l'âme". Cette nouvelle est un peu longue et un peu ennuyeuse, notamment dans tout ce qui concerne la vie professionnelle et matrimoniale du personnage. En revanche son appréhension de la mort est intéressante.
Avec "Maître et serviteur" nous avons le récit d'un voyage mouvementé au cours de l'hiver russe ainsi qu'une étude de caractères, Vassili est un riche négociant, orgueilleux et fourbe qui exploite et méprise Nikita, son valet qui lui a un caractère enjoué et résigné et ne songe qu'à servir son maître. Vassili fera quand même dans ses derniers moments preuve d'une humanité assez inattendue de sa part et qui ressemble un peu à une rédemption. Il est question des relations maître-serviteur, de la valeur de l'argent et seulement à la fin de la mort des deux hommes avec pour Nikita une sorte de consolation, une délivrance avec l'espoir d'un monde meilleur. Les évocations et les descriptions sont émouvantes et on sent bien de la part de l’auteur la volonté de mettre en exergue les qualités des paysans russes. De ces trois nouvelles c'est de loin celle qui a ma préférence.
Avec "Trois morts" c'est le début de la carrière littéraire de Tolstoï et ce thème de la mort sera repris plus tard avec "La mort d'Ivan IIlitch". aussi et peut-être seulement la fin de l'homme qui est traitée. En réalité ce sont trois morts bizarres qui sont évoquées ici, celle d'une femme, d'un paysan et d'un arbre. La dame refuse sa maladie et s'entête à faire un long voyage vers l'Italie en quête de la guérison. Elle ment devant la mort comme elle l'a fait toute sa vie. Elle est chrétienne mais il semble que le christianisme ne l'aide pas au moment fatal. Cette mort est mise en perspective avec celle d'un paysan qui lui accepte son sort et meurt en paix. Il donne même ses bottes en échange d'une pierre tombale qu'il n'aura pas et qui sera remplacée par une simple croix. Celle de l'arbre qui est abattu pour confectionner cette croix, une fin naturelle, un peu comme celle des humains! C'est le lien que personnellement je vois avec les deux autres.
©Hervé Gautier.http:// hervegautier.e-monsite.com
-
Le coeur converti -Stefan Hertmans
- Le 20/06/2019
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1358 – Juin 2019.
Cœur converti – Stefan Hertmans – Gallimard.
Traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin.
Au début du XI° siècle, à l’ère des croisades, Vigdis, une belle jeune fille de la bonne bourgeoisie rouennaise catholique, noble par sa mère, se convertit au judaïsme par amour pour David, étudiant à Rouen, le fils du grand rabbin de Narbonne. Elle devient donc Hamoutal. Elle a envie de liberté et rejette la vie rangée qui lui est promise et suit donc David. C’est une remise en question radicale en ce haut Moyen-Age, une percée dans l’inconnu et le danger. Ils fuiront ensemble jusqu’à Narbonne entre les pogroms, le lancement de la 1° croisade par Urbain II, et les conflits internes dans les régions traversées. Ils doivent se méfier de tout le monde, déjouer les pièges et braver les dangers. Le père de Vigdis ne l’entend pas de cette oreille et demande aux croisés de la rattraper. Les deux amants doivent donc les éviter autant que possible et ne pas éveiller l’attention des personnes rencontrées en chemin, mais David est assassiné à Monieux, en Provence, où ils se sont réfugiés et ses deux enfants enlevés par les croisés. Vigdis va dès lors devenir un fuyarde à leur recherche et ses pérégrinations l’amèneront jusqu’au Caire en passant par la Sicile. Telle est l’histoire de la fille chrétienne d’un viking qui devient la belle-fille d’un grand rabbin du sud de la France puis plus tard l’épouse d’un juif important du Caire. Le narrateur qui fait, mais en voiture puis en bateau, quelques siècles plus tard ce chemin d’errance, communique au lecteur les périls rencontrés par les deux amants puis plus tard par Vigdis seule guidée par l’espoir de retrouver ses enfants.
Tout ce récit part d’un authentique document historique, notant l’existence de cette femme et de son choix exceptionnel pour l’époque, évidemment romancé, découvert par l’auteur dans les archives du village de Monieux où il réside et où, mille ans plus tôt a été perpétré un pogrom consécutif à l’esprit de la croisade. En effet, par ces massacres, il convenait de punir les juifs d’avoir condamné le Christ et aussi les châtier pour leurs richesses. Plusieurs siècles plus tard, il a suivi cette femme jusqu’en Égypte où l’auteur a découvert un document attestant du périple d’une jeune noble normande. Son long travail de recherche s’est doublé d’une démarche d’empathie à son égard, d’une belle érudition et d’un style somptueux.
Je suis bouleversé par cette preuve d’amour de Vigdis envers David ; il m’est difficile d’imaginer que cela est possible. Sa dangereuse pérégrination me rappelle que l’aventure humaine est mystérieuse, longue pour certains et brève pour d’autres et ce sans aucune raison et que l’explication qu’on peut y donner se perd entre hasard, chance et destin sans qu’on soit capable d’en démêler les fils. Ce roman évoque aussi l’antisémitisme qui est la forme la plus ancienne du racisme, solidement ancré dans l’espèce humaine. Je me suis toujours demandé pourquoi ce sont les juifs, un communauté tranquille, qui étaient à l’époque l’objet de ces tueries et de cette haine. Certains d’entre eux étaient des banquiers et en les tuant on tuait aussi leurs créances mais il y avait chez eux aussi des pauvres qui n’échappaient pas pour autant au massacre. Au Moyen-Age l’emprise de l’Église catholique était telle qu’elle gouvernait les institutions et les consciences, manipulait l’opinion, et il lui a été facile de susciter cette détestation des juifs qu’elle considérait comme les meurtriers du Christ. Elle était surtout l’incarnation de l’intolérance, voyait la marque du diable partout et la justice expéditive qu’elle exerçait ou suscitait sans aucun discernement ne jurait que par le bûcher. L’esprit de la charité chrétienne et de l’Évangile était bien loin de ses actes. C’est peut-être cela aussi, avec également l’indulgence plénière, qui a motivé les chevaliers à partir en croisade délivrer le tombeau du Christ, encore que, auparavant, les occidentaux vivaient sur les terres d’Orient en relative paix avec les musulmans et les croisades n’ont pas atteint leur but, certaines s’arrêtant en chemin pour tuer et piller les villes, notamment Constantinople. Elles se sont révélées, non comme un pèlerinage armé, mais comme des opérations militaires dont l’époque était coutumière et qui s’inscrivaient dans le cadre de la lutte défensive contre l’expansion arabe en occident. On pourrait penser que les choses ont aujourd’hui changé, que les mentalités ont évolué avec le temps mais aux pogroms du Moyen-Age a succédé la Shoah et les attaques actuelles contre les juifs prouvent que ce vieux fond d’antisémitisme est bien ancré dans nos civilisations.
J’ai bien aimé ce roman, cette fresque historique est particulièrement émouvante.
©Hervé Gautier.http://hervegautier.e-monsite.com
-
Bleu de Delft - Simone van der Vlugt
- Le 07/06/2019
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1355 – Juin 2019.
Bleu de Delft – Simone van der Vlugt - 10/18.
Traduit de néerlandais par Guillaume Deneufbourg.
Catrijn est une jeune veuve qui quitte son village natal après la mort suspecte de son mari. Ce fut un mariage bref mais malheureux et l’important héritage qu’elle fait entraîne ragots et soupçons de meurtre de la part de sa belle-famille. Elle a toujours rêvé de vivre en ville et arrive à Amsterdam où elle trouve une place d’intendante dans une riche famille patricienne, membre de la compagnie des Indes. Elle a toujours été passionnée par la peinture et aide la maîtresse de maison à parfaire son apprentissage mais les circonstances de la mort de son mari lui reviennent sous la forme d’un chantage auquel bizarrement elle accepte de se soumettre sans broncher. Cet épisode de sa vie la poursuivra sans trêve sous l’apparence de Jacob, son ancien valet de ferme à la solde de la famille de son défunt mari, avec toute la culpabilité que cela entraîne et le châtiment divin que cela implique pour elle. Ce personnage est ambigu, il accepte de la surveiller, la fait chanter, la rançonne mais ne manque jamais de lui dire son attachement alors, au fil de ses apparitions, on se demande quel est exactement le jeu qu’il joue. Cela évoque à Catrijn l’ombre du gibet et motive sa constante volonté de disparaître. Cet homme est pour elle comme une présence obsédante pour sa réussite professionnelle et son bonheur personnel, une menace omniprésente aussi, intéressé qu’il est par son argent. Elle n’a plus qu’à quitter Amsterdam et cette fuite s’accompagne de la chance d’une rencontre, d’ailleurs assez éphémère avec Vermeer, un peintre encore inconnu, puis plus tard avec Rembrand. Elle est admise dans une faïencerie où elle terminera sa formation et mettra au point le fameux « Bleu » qui a fera la fortune de la ville et de sa famille.
J’ai un peu de mal à imaginer qu’au XVII° siècle une jeune femme, même si c’est un personnage ayant réellement existé, puisse ainsi voyager seule, s’affranchissant aussi facilement des contraintes sociales et parvienne à se faire une place dans une société gouvernée par les hommes. Je la trouve quand même très chanceuse, peut-être un peu trop, pour que son histoire soit vraiment crédible, et l’ambiance religieuse de l’époque ramène cela à une protection divine. J’ai notamment trouvé que son voyage de retour vers Delft, à pied, seule et enceinte, dans une région où a sévi la peste, est un peu surréaliste! C’est aussi une séductrice, une gourgandine et une femme certes travailleuse, mais qui sait ce qu’elle veut, ce qu’elle vaut et surtout que rien n’arrête. Elle ne perd jamais de vue son intérêt. J’ai noté un important travail de documentation sur les coutumes de l’époque, les techniques de la faïencerie et l’inévitable peste, cette maladie mystérieuse qui était surtout considérée comme un châtiment divin et qu’on soignait bizarrement. Elle tuait à peu près la moitié de la population et épargnait l’autre moitié et on ne manquait pas à l’époque d’y voir la main de Dieu ! On n’avait à l’époque aucun traitement sérieux si ce n’est les recherches du chirurgien français Guy de Chauliac (1298-1368) et les différents essais empiriques en usage dans certaines régions (à Niort on la combattait avec l’angélique). Catrijn, qui use d’une thérapie étonnante mais apparemment efficace pour l’éviter ou la guérir, fait évidemment partie des survivants ; elle prend des risques inconsidérés face à l’épidémie et échappe à la mort alors qu’autour d’elle les disparitions se multiplient.
Je ne connaissais pas cette auteure et j’ai lu avec plaisir ce roman fort bien écrit et qui s’attache son lecteur jusqu’à la fin sans que l’ennui s’insinue dans sa lecture, même si cette histoire, qui met en scène certains personnages réels insérés dans un contexte historique, m’a paru par moments un peu trop romancée. Je veux bien que nous soyons dans une fiction mais les aventures de Catrijn pour être passionnantes m’ont semblé être trop dans l’irréalité.
©Hervé Gautier.http://hervegautier.e-monsite.com
-
Trouble - Jeroen Olyslaegers
- Le 10/05/2019
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1348 – Mai 2019.
Trouble – Jeroen Olyslaegers – Stock.
Traduit du néerlandais par Françoise Antoine.
Wilfried Wils revient sur son passé et se raconte, dans un long monologue, à son arrière-petit-fils qu'il ne peut pas voir. Quand il commence son récit, il a 22 ans à Anvers et les nazis occupent le pays. Il a l'âge d'être envoyé en Allemagne au titre du « Service du travail obligatoire » et, pour y échapper, entre dans la police comme auxiliaire. En France ses contemporains ont plutôt rejoint la Résistance, le maquis. Dans ces fonctions il connaît une situation plutôt ambiguë puisqu'il doit traquer ceux qui, comme lui, fuient le STO. De plus Anvers est la ville des diamantaires où les Allemands procèdent à des rafles et des déportations et d'un côté son collègue Lode le met en relation avec des résistants qui viennent en aide à des Juifs et de l'autre, son ancien professeur devenu son mentor, surnommé Barbiche teigneuse, le présente à des collaborateurs. Ainsi est-il, témoin et acteur, ballotté entre antisémitisme, collaboration avec l'occupant, dénonciations et résistance au cours de cette période trouble mais sans jamais pouvoir ou vouloir prendre parti pour un camp ou pour un autre, acceptant sans trop réfléchir les missions qui lui sont confiées avec pour seul objectif survivre. Il a en effet contact notamment avec le boucher traficoteur dont il finit par épouser la fille, Yvette. Il est effectivement mal à l'aise dans son uniforme de policier notamment parce qu'il écrit des poèmes sous le pseudo d' « Angelo », sa voix intérieure, sa part d'ombre. Ce personnage n'est pas là par hasard puisque, lorsqu'il avait 5 ans, Wilfried a été victime d'une méningite, est resté longtemps dans le coma et à son réveil il a dû tout réapprendre et a fini par penser que ses parents le trompaient sur sa propre identité. Ainsi imagine-t-il Angelo, poète à la fois violent et passionné, rêvant pour lui d'un destin littéraire qu'il ne connaîtra pas, quand Wilfried reste lui dans la normalité, une illustration manichéenne de sa personnalité, une dualité troublante dans cette période. La publication de ses poèmes se fera après-guerre, mais sous le titre de « confession d'un comédien » sous le pseudo d'Angelo, Wilfried, lui, restant policier.
Il y a aussi un contexte familial particulier et difficile puisque que sa famille l' abandonné, car si lui est plus que « trouble » dans son attitude, sa tante elle choisit de profiter pleinement de la présence de l'ennemi. Il y a aussi lui l'idée prégnante de la mort, celle de son fils, de sa petite-fille, dévastée par son attitude, puis de sa femme. Pourquoi écrit-on ses mémoires ? Pour nourrir son œuvre quand on est écrivain, pour laisser une trace après sa mort pour sa descendance, pour faire le bilan de sa vie, se justifier aussi et c'est sans doute ce que veux faire Wilfried quand il destine cette confession à son arrière-petit-fils parce que, dans un telle démarche, surtout si elle est spontanée, il y a toujours la contrition et la recherche de la rédemption. Il a survécu à cette période orageuse au terme de nombre de compromissions personnelles et souhaite s'expliquer pour laisser sans doute une bonne image de lui. Il est difficile au lecteur de prendre parti. Je ne suis pas très sûr qu'il soit cependant sincère dans sa démarche puisque, écrasé par la culpabilité, il ne lui reste plus que cela, avant sa propre mort, pour justifier sa conduite. Pour ceux qui n'ont pas connu la Deuxième guerre mondiale, il est difficile de juger objectivement ceux qui ont chaque jour dû survivre, parfois au prix d'abandons, de machinations, de compromissions, de trahisons, autant de situations dont on n'est pas fier après coup mais qui ont permis de sauver sa propre vie. Cela nous revoie à l'éternelle question qu'on ne peut pas ne pas se poser. « Qu'aurais-je fait si j'avais vécu à ce moment-là ? » que je me suis souvent posée. J'aurais probablement fait comme la plupart des gens de cette époque, j'aurais cherché à survivre pour moi-même et pour ma famille en évitant de jouer les héros, une attitude de tiède qui n'a rien de bien glorieux. La dualité du personnage qui a traversé cette vie en solitaire est intéressante puisqu'elle nous concerne tous. En outre cette période se prête particulièrement bien à l'étude de l'espèce humaine qui trouve dans ces événements matière à révéler sa véritable nature, bien loin de ce que tous les propos lénifiants qu'on nous a souvent assénés. Elle est capable du pire comme du meilleur, mais bien souvent du pire, à l'image des salauds ordinaires qui pullulaient sous l'Occupation. Cette fiction évoque aussi l'histoire de la Belgique face à l'occupation allemande et notre littérature nationale a également trouvé là matière à réflexion et à écriture.
Sur le plan de la forme, j'ai noté beaucoup de longueurs, des faits et des personnages multiples, ce qui m'a un peu rebuté.
©Hervé Gautier.
La Feuille Volante n° 1348 – Mai 2019.
Trouble – Jeroen Olyslaegers – Stock.
Traduit du néerlandais par Françoise Antoine.
Wilfried Wils revient sur son passé et se raconte, dans un long monologue, à son arrière-petit-fils qu'il ne peut pas voir. Quand il commence son récit, il a 22 ans à Anvers et les nazis occupent le pays. Il a l'âge d'être envoyé en Allemagne au titre du « Service du travail obligatoire » et, pour y échapper, entre dans la police comme auxiliaire. En France ses contemporains ont plutôt rejoint la Résistance, le maquis. Dans ces fonctions il connaît une situation plutôt ambiguë puisqu'il doit traquer ceux qui, comme lui, fuient le STO. De plus Anvers est la ville des diamantaires où les Allemands procèdent à des rafles et des déportations et d'un côté son collègue Lode le met en relation avec des résistants qui viennent en aide à des Juifs et de l'autre, son ancien professeur devenu son mentor, surnommé Barbiche teigneuse, le présente à des collaborateurs. Ainsi est-il, témoin et acteur, ballotté entre antisémitisme, collaboration avec l'occupant, dénonciations et résistance au cours de cette période trouble mais sans jamais pouvoir ou vouloir prendre parti pour un camp ou pour un autre, acceptant sans trop réfléchir les missions qui lui sont confiées avec pour seul objectif survivre. Il a en effet contact notamment avec le boucher traficoteur dont il finit par épouser la fille, Yvette. Il est effectivement mal à l'aise dans son uniforme de policier notamment parce qu'il écrit des poèmes sous le pseudo d' « Angelo », sa voix intérieure, sa part d'ombre. Ce personnage n'est pas là par hasard puisque, lorsqu'il avait 5 ans, Wilfried a été victime d'une méningite, est resté longtemps dans le coma et à son réveil il a dû tout réapprendre et a fini par penser que ses parents le trompaient sur sa propre identité. Ainsi imagine-t-il Angelo, poète à la fois violent et passionné, rêvant pour lui d'un destin littéraire qu'il ne connaîtra pas, quand Wilfried reste lui dans la normalité, une illustration manichéenne de sa personnalité, une dualité troublante dans cette période. La publication de ses poèmes se fera après-guerre, mais sous le titre de « confession d'un comédien » sous le pseudo d'Angelo, Wilfried, lui, restant policier.
Il y a aussi un contexte familial particulier et difficile puisque que sa famille l' abandonné, car si lui est plus que « trouble » dans son attitude, sa tante elle choisit de profiter pleinement de la présence de l'ennemi. Il y a aussi lui l'idée prégnante de la mort, celle de son fils, de sa petite-fille, dévastée par son attitude, puis de sa femme. Pourquoi écrit-on ses mémoires ? Pour nourrir son œuvre quand on est écrivain, pour laisser une trace après sa mort pour sa descendance, pour faire le bilan de sa vie, se justifier aussi et c'est sans doute ce que veux faire Wilfried quand il destine cette confession à son arrière-petit-fils parce que, dans un telle démarche, surtout si elle est spontanée, il y a toujours la contrition et la recherche de la rédemption. Il a survécu à cette période orageuse au terme de nombre de compromissions personnelles et souhaite s'expliquer pour laisser sans doute une bonne image de lui. Il est difficile au lecteur de prendre parti. Je ne suis pas très sûr qu'il soit cependant sincère dans sa démarche puisque, écrasé par la culpabilité, il ne lui reste plus que cela, avant sa propre mort, pour justifier sa conduite. Pour ceux qui n'ont pas connu la Deuxième guerre mondiale, il est difficile de juger objectivement ceux qui ont chaque jour dû survivre, parfois au prix d'abandons, de machinations, de compromissions, de trahisons, autant de situations dont on n'est pas fier après coup mais qui ont permis de sauver sa propre vie. Cela nous revoie à l'éternelle question qu'on ne peut pas ne pas se poser. « Qu'aurais-je fait si j'avais vécu à ce moment-là ? » que je me suis souvent posée. J'aurais probablement fait comme la plupart des gens de cette époque, j'aurais cherché à survivre pour moi-même et pour ma famille en évitant de jouer les héros, une attitude de tiède qui n'a rien de bien glorieux. La dualité du personnage qui a traversé cette vie en solitaire est intéressante puisqu'elle nous concerne tous. En outre cette période se prête particulièrement bien à l'étude de l'espèce humaine qui trouve dans ces événements matière à révéler sa véritable nature, bien loin de ce que tous les propos lénifiants qu'on nous a souvent assénés. Elle est capable du pire comme du meilleur, mais bien souvent du pire, à l'image des salauds ordinaires qui pullulaient sous l'Occupation. Cette fiction évoque aussi l'histoire de la Belgique face à l'occupation allemande et notre littérature nationale a également trouvé là matière à réflexion et à écriture.
Sur le plan de la forme, j'ai noté beaucoup de longueurs, des faits et des personnages multiples, ce qui m'a un peu rebuté.
©Hervé Gautier.
La Feuille Volante n° 1348 – Mai 2019.
Trouble – Jeroen Olyslaegers – Stock.
Traduit du néerlandais par Françoise Antoine.
Wilfried Wils revient sur son passé et se raconte, dans un long monologue, à son arrière-petit-fils qu'il ne peut pas voir. Quand il commence son récit, il a 22 ans à Anvers et les nazis occupent le pays. Il a l'âge d'être envoyé en Allemagne au titre du « Service du travail obligatoire » et, pour y échapper, entre dans la police comme auxiliaire. En France ses contemporains ont plutôt rejoint la Résistance, le maquis. Dans ces fonctions il connaît une situation plutôt ambiguë puisqu'il doit traquer ceux qui, comme lui, fuient le STO. De plus Anvers est la ville des diamantaires où les Allemands procèdent à des rafles et des déportations et d'un côté son collègue Lode le met en relation avec des résistants qui viennent en aide à des Juifs et de l'autre, son ancien professeur devenu son mentor, surnommé Barbiche teigneuse, le présente à des collaborateurs. Ainsi est-il, témoin et acteur, ballotté entre antisémitisme, collaboration avec l'occupant, dénonciations et résistance au cours de cette période trouble mais sans jamais pouvoir ou vouloir prendre parti pour un camp ou pour un autre, acceptant sans trop réfléchir les missions qui lui sont confiées avec pour seul objectif survivre. Il a en effet contact notamment avec le boucher traficoteur dont il finit par épouser la fille, Yvette. Il est effectivement mal à l'aise dans son uniforme de policier notamment parce qu'il écrit des poèmes sous le pseudo d' « Angelo », sa voix intérieure, sa part d'ombre. Ce personnage n'est pas là par hasard puisque, lorsqu'il avait 5 ans, Wilfried a été victime d'une méningite, est resté longtemps dans le coma et à son réveil il a dû tout réapprendre et a fini par penser que ses parents le trompaient sur sa propre identité. Ainsi imagine-t-il Angelo, poète à la fois violent et passionné, rêvant pour lui d'un destin littéraire qu'il ne connaîtra pas, quand Wilfried reste lui dans la normalité, une illustration manichéenne de sa personnalité, une dualité troublante dans cette période. La publication de ses poèmes se fera après-guerre, mais sous le titre de « confession d'un comédien » sous le pseudo d'Angelo, Wilfried, lui, restant policier.
Il y a aussi un contexte familial particulier et difficile puisque que sa famille l' abandonné, car si lui est plus que « trouble » dans son attitude, sa tante elle choisit de profiter pleinement de la présence de l'ennemi. Il y a aussi lui l'idée prégnante de la mort, celle de son fils, de sa petite-fille, dévastée par son attitude, puis de sa femme. Pourquoi écrit-on ses mémoires ? Pour nourrir son œuvre quand on est écrivain, pour laisser une trace après sa mort pour sa descendance, pour faire le bilan de sa vie, se justifier aussi et c'est sans doute ce que veux faire Wilfried quand il destine cette confession à son arrière-petit-fils parce que, dans un telle démarche, surtout si elle est spontanée, il y a toujours la contrition et la recherche de la rédemption. Il a survécu à cette période orageuse au terme de nombre de compromissions personnelles et souhaite s'expliquer pour laisser sans doute une bonne image de lui. Il est difficile au lecteur de prendre parti. Je ne suis pas très sûr qu'il soit cependant sincère dans sa démarche puisque, écrasé par la culpabilité, il ne lui reste plus que cela, avant sa propre mort, pour justifier sa conduite. Pour ceux qui n'ont pas connu la Deuxième guerre mondiale, il est difficile de juger objectivement ceux qui ont chaque jour dû survivre, parfois au prix d'abandons, de machinations, de compromissions, de trahisons, autant de situations dont on n'est pas fier après coup mais qui ont permis de sauver sa propre vie. Cela nous revoie à l'éternelle question qu'on ne peut pas ne pas se poser. « Qu'aurais-je fait si j'avais vécu à ce moment-là ? » que je me suis souvent posée. J'aurais probablement fait comme la plupart des gens de cette époque, j'aurais cherché à survivre pour moi-même et pour ma famille en évitant de jouer les héros, une attitude de tiède qui n'a rien de bien glorieux. La dualité du personnage qui a traversé cette vie en solitaire est intéressante puisqu'elle nous concerne tous. En outre cette période se prête particulièrement bien à l'étude de l'espèce humaine qui trouve dans ces événements matière à révéler sa véritable nature, bien loin de ce que tous les propos lénifiants qu'on nous a souvent assénés. Elle est capable du pire comme du meilleur, mais bien souvent du pire, à l'image des salauds ordinaires qui pullulaient sous l'Occupation. Cette fiction évoque aussi l'histoire de la Belgique face à l'occupation allemande et notre littérature nationale a également trouvé là matière à réflexion et à écriture.
Sur le plan de la forme, j'ai noté beaucoup de longueurs, des faits et des personnages multiples, ce qui m'a un peu rebuté.
©Hervé Gautier.
La Feuille Volante n° 1348 – Mai 2019.
Trouble – Jeroen Olyslaegers – Stock.
Traduit du néerlandais par Françoise Antoine.
Wilfried Wils revient sur son passé et se raconte, dans un long monologue, à son arrière-petit-fils qu'il ne peut pas voir. Quand il commence son récit, il a 22 ans à Anvers et les nazis occupent le pays. Il a l'âge d'être envoyé en Allemagne au titre du « Service du travail obligatoire » et, pour y échapper, entre dans la police comme auxiliaire. En France ses contemporains ont plutôt rejoint la Résistance, le maquis. Dans ces fonctions il connaît une situation plutôt ambiguë puisqu'il doit traquer ceux qui, comme lui, fuient le STO. De plus Anvers est la ville des diamantaires où les Allemands procèdent à des rafles et des déportations et d'un côté son collègue Lode le met en relation avec des résistants qui viennent en aide à des Juifs et de l'autre, son ancien professeur devenu son mentor, surnommé Barbiche teigneuse, le présente à des collaborateurs. Ainsi est-il, témoin et acteur, ballotté entre antisémitisme, collaboration avec l'occupant, dénonciations et résistance au cours de cette période trouble mais sans jamais pouvoir ou vouloir prendre parti pour un camp ou pour un autre, acceptant sans trop réfléchir les missions qui lui sont confiées avec pour seul objectif survivre. Il a en effet contact notamment avec le boucher traficoteur dont il finit par épouser la fille, Yvette. Il est effectivement mal à l'aise dans son uniforme de policier notamment parce qu'il écrit des poèmes sous le pseudo d' « Angelo », sa voix intérieure, sa part d'ombre. Ce personnage n'est pas là par hasard puisque, lorsqu'il avait 5 ans, Wilfried a été victime d'une méningite, est resté longtemps dans le coma et à son réveil il a dû tout réapprendre et a fini par penser que ses parents le trompaient sur sa propre identité. Ainsi imagine-t-il Angelo, poète à la fois violent et passionné, rêvant pour lui d'un destin littéraire qu'il ne connaîtra pas, quand Wilfried reste lui dans la normalité, une illustration manichéenne de sa personnalité, une dualité troublante dans cette période. La publication de ses poèmes se fera après-guerre, mais sous le titre de « confession d'un comédien » sous le pseudo d'Angelo, Wilfried, lui, restant policier.
Il y a aussi un contexte familial particulier et difficile puisque que sa famille l' abandonné, car si lui est plus que « trouble » dans son attitude, sa tante elle choisit de profiter pleinement de la présence de l'ennemi. Il y a aussi lui l'idée prégnante de la mort, celle de son fils, de sa petite-fille, dévastée par son attitude, puis de sa femme. Pourquoi écrit-on ses mémoires ? Pour nourrir son œuvre quand on est écrivain, pour laisser une trace après sa mort pour sa descendance, pour faire le bilan de sa vie, se justifier aussi et c'est sans doute ce que veux faire Wilfried quand il destine cette confession à son arrière-petit-fils parce que, dans un telle démarche, surtout si elle est spontanée, il y a toujours la contrition et la recherche de la rédemption. Il a survécu à cette période orageuse au terme de nombre de compromissions personnelles et souhaite s'expliquer pour laisser sans doute une bonne image de lui. Il est difficile au lecteur de prendre parti. Je ne suis pas très sûr qu'il soit cependant sincère dans sa démarche puisque, écrasé par la culpabilité, il ne lui reste plus que cela, avant sa propre mort, pour justifier sa conduite. Pour ceux qui n'ont pas connu la Deuxième guerre mondiale, il est difficile de juger objectivement ceux qui ont chaque jour dû survivre, parfois au prix d'abandons, de machinations, de compromissions, de trahisons, autant de situations dont on n'est pas fier après coup mais qui ont permis de sauver sa propre vie. Cela nous revoie à l'éternelle question qu'on ne peut pas ne pas se poser. « Qu'aurais-je fait si j'avais vécu à ce moment-là ? » que je me suis souvent posée. J'aurais probablement fait comme la plupart des gens de cette époque, j'aurais cherché à survivre pour moi-même et pour ma famille en évitant de jouer les héros, une attitude de tiède qui n'a rien de bien glorieux. La dualité du personnage qui a traversé cette vie en solitaire est intéressante puisqu'elle nous concerne tous. En outre cette période se prête particulièrement bien à l'étude de l'espèce humaine qui trouve dans ces événements matière à révéler sa véritable nature, bien loin de ce que tous les propos lénifiants qu'on nous a souvent assénés. Elle est capable du pire comme du meilleur, mais bien souvent du pire, à l'image des salauds ordinaires qui pullulaient sous l'Occupation. Cette fiction évoque aussi l'histoire de la Belgique face à l'occupation allemande et notre littérature nationale a également trouvé là matière à réflexion et à écriture.
Sur le plan de la forme, j'ai noté beaucoup de longueurs, des faits et des personnages multiples, ce qui m'a un peu rebuté.
©Hervé Gautier.
La Feuille Volante n° 1348 – Mai 2019.
Trouble – Jeroen Olyslaegers – Stock.
Traduit du néerlandais par Françoise Antoine.
Wilfried Wils revient sur son passé et se raconte, dans un long monologue, à son arrière-petit-fils qu'il ne peut pas voir. Quand il commence son récit, il a 22 ans à Anvers et les nazis occupent le pays. Il a l'âge d'être envoyé en Allemagne au titre du « Service du travail obligatoire » et, pour y échapper, entre dans la police comme auxiliaire. En France ses contemporains ont plutôt rejoint la Résistance, le maquis. Dans ces fonctions il connaît une situation plutôt ambiguë puisqu'il doit traquer ceux qui, comme lui, fuient le STO. De plus Anvers est la ville des diamantaires où les Allemands procèdent à des rafles et des déportations et d'un côté son collègue Lode le met en relation avec des résistants qui viennent en aide à des Juifs et de l'autre, son ancien professeur devenu son mentor, surnommé Barbiche teigneuse, le présente à des collaborateurs. Ainsi est-il, témoin et acteur, ballotté entre antisémitisme, collaboration avec l'occupant, dénonciations et résistance au cours de cette période trouble mais sans jamais pouvoir ou vouloir prendre parti pour un camp ou pour un autre, acceptant sans trop réfléchir les missions qui lui sont confiées avec pour seul objectif survivre. Il a en effet contact notamment avec le boucher traficoteur dont il finit par épouser la fille, Yvette. Il est effectivement mal à l'aise dans son uniforme de policier notamment parce qu'il écrit des poèmes sous le pseudo d' « Angelo », sa voix intérieure, sa part d'ombre. Ce personnage n'est pas là par hasard puisque, lorsqu'il avait 5 ans, Wilfried a été victime d'une méningite, est resté longtemps dans le coma et à son réveil il a dû tout réapprendre et a fini par penser que ses parents le trompaient sur sa propre identité. Ainsi imagine-t-il Angelo, poète à la fois violent et passionné, rêvant pour lui d'un destin littéraire qu'il ne connaîtra pas, quand Wilfried reste lui dans la normalité, une illustration manichéenne de sa personnalité, une dualité troublante dans cette période. La publication de ses poèmes se fera après-guerre, mais sous le titre de « confession d'un comédien » sous le pseudo d'Angelo, Wilfried, lui, restant policier.
Il y a aussi un contexte familial particulier et difficile puisque que sa famille l' abandonné, car si lui est plus que « trouble » dans son attitude, sa tante elle choisit de profiter pleinement de la présence de l'ennemi. Il y a aussi lui l'idée prégnante de la mort, celle de son fils, de sa petite-fille, dévastée par son attitude, puis de sa femme. Pourquoi écrit-on ses mémoires ? Pour nourrir son œuvre quand on est écrivain, pour laisser une trace après sa mort pour sa descendance, pour faire le bilan de sa vie, se justifier aussi et c'est sans doute ce que veux faire Wilfried quand il destine cette confession à son arrière-petit-fils parce que, dans un telle démarche, surtout si elle est spontanée, il y a toujours la contrition et la recherche de la rédemption. Il a survécu à cette période orageuse au terme de nombre de compromissions personnelles et souhaite s'expliquer pour laisser sans doute une bonne image de lui. Il est difficile au lecteur de prendre parti. Je ne suis pas très sûr qu'il soit cependant sincère dans sa démarche puisque, écrasé par la culpabilité, il ne lui reste plus que cela, avant sa propre mort, pour justifier sa conduite. Pour ceux qui n'ont pas connu la Deuxième guerre mondiale, il est difficile de juger objectivement ceux qui ont chaque jour dû survivre, parfois au prix d'abandons, de machinations, de compromissions, de trahisons, autant de situations dont on n'est pas fier après coup mais qui ont permis de sauver sa propre vie. Cela nous revoie à l'éternelle question qu'on ne peut pas ne pas se poser. « Qu'aurais-je fait si j'avais vécu à ce moment-là ? » que je me suis souvent posée. J'aurais probablement fait comme la plupart des gens de cette époque, j'aurais cherché à survivre pour moi-même et pour ma famille en évitant de jouer les héros, une attitude de tiède qui n'a rien de bien glorieux. La dualité du personnage qui a traversé cette vie en solitaire est intéressante puisqu'elle nous concerne tous. En outre cette période se prête particulièrement bien à l'étude de l'espèce humaine qui trouve dans ces événements matière à révéler sa véritable nature, bien loin de ce que tous les propos lénifiants qu'on nous a souvent assénés. Elle est capable du pire comme du meilleur, mais bien souvent du pire, à l'image des salauds ordinaires qui pullulaient sous l'Occupation. Cette fiction évoque aussi l'histoire de la Belgique face à l'occupation allemande et notre littérature nationale a également trouvé là matière à réflexion et à écriture.
Sur le plan de la forme, j'ai noté beaucoup de longueurs, des faits et des personnages multiples, ce qui m'a un peu rebuté.
©Hervé Gautier.
La Feuille Volante n° 1348 – Mai 2019.
Trouble – Jeroen Olyslaegers – Stock.
Traduit du néerlandais par Françoise Antoine.
Wilfried Wils revient sur son passé et se raconte, dans un long monologue, à son arrière-petit-fils qu'il ne peut pas voir. Quand il commence son récit, il a 22 ans à Anvers et les nazis occupent le pays. Il a l'âge d'être envoyé en Allemagne au titre du « Service du travail obligatoire » et, pour y échapper, entre dans la police comme auxiliaire. En France ses contemporains ont plutôt rejoint la Résistance, le maquis. Dans ces fonctions il connaît une situation plutôt ambiguë puisqu'il doit traquer ceux qui, comme lui, fuient le STO. De plus Anvers est la ville des diamantaires où les Allemands procèdent à des rafles et des déportations et d'un côté son collègue Lode le met en relation avec des résistants qui viennent en aide à des Juifs et de l'autre, son ancien professeur devenu son mentor, surnommé Barbiche teigneuse, le présente à des collaborateurs. Ainsi est-il, témoin et acteur, ballotté entre antisémitisme, collaboration avec l'occupant, dénonciations et résistance au cours de cette période trouble mais sans jamais pouvoir ou vouloir prendre parti pour un camp ou pour un autre, acceptant sans trop réfléchir les missions qui lui sont confiées avec pour seul objectif survivre. Il a en effet contact notamment avec le boucher traficoteur dont il finit par épouser la fille, Yvette. Il est effectivement mal à l'aise dans son uniforme de policier notamment parce qu'il écrit des poèmes sous le pseudo d' « Angelo », sa voix intérieure, sa part d'ombre. Ce personnage n'est pas là par hasard puisque, lorsqu'il avait 5 ans, Wilfried a été victime d'une méningite, est resté longtemps dans le coma et à son réveil il a dû tout réapprendre et a fini par penser que ses parents le trompaient sur sa propre identité. Ainsi imagine-t-il Angelo, poète à la fois violent et passionné, rêvant pour lui d'un destin littéraire qu'il ne connaîtra pas, quand Wilfried reste lui dans la normalité, une illustration manichéenne de sa personnalité, une dualité troublante dans cette période. La publication de ses poèmes se fera après-guerre, mais sous le titre de « confession d'un comédien » sous le pseudo d'Angelo, Wilfried, lui, restant policier.
Il y a aussi un contexte familial particulier et difficile puisque que sa famille l' abandonné, car si lui est plus que « trouble » dans son attitude, sa tante elle choisit de profiter pleinement de la présence de l'ennemi. Il y a aussi lui l'idée prégnante de la mort, celle de son fils, de sa petite-fille, dévastée par son attitude, puis de sa femme. Pourquoi écrit-on ses mémoires ? Pour nourrir son œuvre quand on est écrivain, pour laisser une trace après sa mort pour sa descendance, pour faire le bilan de sa vie, se justifier aussi et c'est sans doute ce que veux faire Wilfried quand il destine cette confession à son arrière-petit-fils parce que, dans un telle démarche, surtout si elle est spontanée, il y a toujours la contrition et la recherche de la rédemption. Il a survécu à cette période orageuse au terme de nombre de compromissions personnelles et souhaite s'expliquer pour laisser sans doute une bonne image de lui. Il est difficile au lecteur de prendre parti. Je ne suis pas très sûr qu'il soit cependant sincère dans sa démarche puisque, écrasé par la culpabilité, il ne lui reste plus que cela, avant sa propre mort, pour justifier sa conduite. Pour ceux qui n'ont pas connu la Deuxième guerre mondiale, il est difficile de juger objectivement ceux qui ont chaque jour dû survivre, parfois au prix d'abandons, de machinations, de compromissions, de trahisons, autant de situations dont on n'est pas fier après coup mais qui ont permis de sauver sa propre vie. Cela nous revoie à l'éternelle question qu'on ne peut pas ne pas se poser. « Qu'aurais-je fait si j'avais vécu à ce moment-là ? » que je me suis souvent posée. J'aurais probablement fait comme la plupart des gens de cette époque, j'aurais cherché à survivre pour moi-même et pour ma famille en évitant de jouer les héros, une attitude de tiède qui n'a rien de bien glorieux. La dualité du personnage qui a traversé cette vie en solitaire est intéressante puisqu'elle nous concerne tous. En outre cette période se prête particulièrement bien à l'étude de l'espèce humaine qui trouve dans ces événements matière à révéler sa véritable nature, bien loin de ce que tous les propos lénifiants qu'on nous a souvent assénés. Elle est capable du pire comme du meilleur, mais bien souvent du pire, à l'image des salauds ordinaires qui pullulaient sous l'Occupation. Cette fiction évoque aussi l'histoire de la Belgique face à l'occupation allemande et notre littérature nationale a également trouvé là matière à réflexion et à écriture.
Sur le plan de la forme, j'ai noté beaucoup de longueurs, des faits et des personnages multiples, ce qui m'a un peu rebuté.
©Hervé Gautier.
La Feuille Volante n° 1348 – Mai 2019.
Trouble – Jeroen Olyslaegers – Stock.
Traduit du néerlandais par Françoise Antoine.
Wilfried Wils revient sur son passé et se raconte, dans un long monologue, à son arrière-petit-fils qu'il ne peut pas voir. Quand il commence son récit, il a 22 ans à Anvers et les nazis occupent le pays. Il a l'âge d'être envoyé en Allemagne au titre du « Service du travail obligatoire » et, pour y échapper, entre dans la police comme auxiliaire. En France ses contemporains ont plutôt rejoint la Résistance, le maquis. Dans ces fonctions il connaît une situation plutôt ambiguë puisqu'il doit traquer ceux qui, comme lui, fuient le STO. De plus Anvers est la ville des diamantaires où les Allemands procèdent à des rafles et des déportations et d'un côté son collègue Lode le met en relation avec des résistants qui viennent en aide à des Juifs et de l'autre, son ancien professeur devenu son mentor, surnommé Barbiche teigneuse, le présente à des collaborateurs. Ainsi est-il, témoin et acteur, ballotté entre antisémitisme, collaboration avec l'occupant, dénonciations et résistance au cours de cette période trouble mais sans jamais pouvoir ou vouloir prendre parti pour un camp ou pour un autre, acceptant sans trop réfléchir les missions qui lui sont confiées avec pour seul objectif survivre. Il a en effet contact notamment avec le boucher traficoteur dont il finit par épouser la fille, Yvette. Il est effectivement mal à l'aise dans son uniforme de policier notamment parce qu'il écrit des poèmes sous le pseudo d' « Angelo », sa voix intérieure, sa part d'ombre. Ce personnage n'est pas là par hasard puisque, lorsqu'il avait 5 ans, Wilfried a été victime d'une méningite, est resté longtemps dans le coma et à son réveil il a dû tout réapprendre et a fini par penser que ses parents le trompaient sur sa propre identité. Ainsi imagine-t-il Angelo, poète à la fois violent et passionné, rêvant pour lui d'un destin littéraire qu'il ne connaîtra pas, quand Wilfried reste lui dans la normalité, une illustration manichéenne de sa personnalité, une dualité troublante dans cette période. La publication de ses poèmes se fera après-guerre, mais sous le titre de « confession d'un comédien » sous le pseudo d'Angelo, Wilfried, lui, restant policier.
Il y a aussi un contexte familial particulier et difficile puisque que sa famille l' abandonné, car si lui est plus que « trouble » dans son attitude, sa tante elle choisit de profiter pleinement de la présence de l'ennemi. Il y a aussi lui l'idée prégnante de la mort, celle de son fils, de sa petite-fille, dévastée par son attitude, puis de sa femme. Pourquoi écrit-on ses mémoires ? Pour nourrir son œuvre quand on est écrivain, pour laisser une trace après sa mort pour sa descendance, pour faire le bilan de sa vie, se justifier aussi et c'est sans doute ce que veux faire Wilfried quand il destine cette confession à son arrière-petit-fils parce que, dans un telle démarche, surtout si elle est spontanée, il y a toujours la contrition et la recherche de la rédemption. Il a survécu à cette période orageuse au terme de nombre de compromissions personnelles et souhaite s'expliquer pour laisser sans doute une bonne image de lui. Il est difficile au lecteur de prendre parti. Je ne suis pas très sûr qu'il soit cependant sincère dans sa démarche puisque, écrasé par la culpabilité, il ne lui reste plus que cela, avant sa propre mort, pour justifier sa conduite. Pour ceux qui n'ont pas connu la Deuxième guerre mondiale, il est difficile de juger objectivement ceux qui ont chaque jour dû survivre, parfois au prix d'abandons, de machinations, de compromissions, de trahisons, autant de situations dont on n'est pas fier après coup mais qui ont permis de sauver sa propre vie. Cela nous revoie à l'éternelle question qu'on ne peut pas ne pas se poser. « Qu'aurais-je fait si j'avais vécu à ce moment-là ? » que je me suis souvent posée. J'aurais probablement fait comme la plupart des gens de cette époque, j'aurais cherché à survivre pour moi-même et pour ma famille en évitant de jouer les héros, une attitude de tiède qui n'a rien de bien glorieux. La dualité du personnage qui a traversé cette vie en solitaire est intéressante puisqu'elle nous concerne tous. En outre cette période se prête particulièrement bien à l'étude de l'espèce humaine qui trouve dans ces événements matière à révéler sa véritable nature, bien loin de ce que tous les propos lénifiants qu'on nous a souvent assénés. Elle est capable du pire comme du meilleur, mais bien souvent du pire, à l'image des salauds ordinaires qui pullulaient sous l'Occupation. Cette fiction évoque aussi l'histoire de la Belgique face à l'occupation allemande et notre littérature nationale a également trouvé là matière à réflexion et à écriture.
Sur le plan de la forme, j'ai noté beaucoup de longueurs, des faits et des personnages multiples, ce qui m'a un peu rebuté.
©Hervé Gautier.
La Feuille Volante n° 1348 – Mai 2019.
Trouble – Jeroen Olyslaegers – Stock.
Traduit du néerlandais par Françoise Antoine.
Wilfried Wils revient sur son passé et se raconte, dans un long monologue, à son arrière-petit-fils qu'il ne peut pas voir. Quand il commence son récit, il a 22 ans à Anvers et les nazis occupent le pays. Il a l'âge d'être envoyé en Allemagne au titre du « Service du travail obligatoire » et, pour y échapper, entre dans la police comme auxiliaire. En France ses contemporains ont plutôt rejoint la Résistance, le maquis. Dans ces fonctions il connaît une situation plutôt ambiguë puisqu'il doit traquer ceux qui, comme lui, fuient le STO. De plus Anvers est la ville des diamantaires où les Allemands procèdent à des rafles et des déportations et d'un côté son collègue Lode le met en relation avec des résistants qui viennent en aide à des Juifs et de l'autre, son ancien professeur devenu son mentor, surnommé Barbiche teigneuse, le présente à des collaborateurs. Ainsi est-il, témoin et acteur, ballotté entre antisémitisme, collaboration avec l'occupant, dénonciations et résistance au cours de cette période trouble mais sans jamais pouvoir ou vouloir prendre parti pour un camp ou pour un autre, acceptant sans trop réfléchir les missions qui lui sont confiées avec pour seul objectif survivre. Il a en effet contact notamment avec le boucher traficoteur dont il finit par épouser la fille, Yvette. Il est effectivement mal à l'aise dans son uniforme de policier notamment parce qu'il écrit des poèmes sous le pseudo d' « Angelo », sa voix intérieure, sa part d'ombre. Ce personnage n'est pas là par hasard puisque, lorsqu'il avait 5 ans, Wilfried a été victime d'une méningite, est resté longtemps dans le coma et à son réveil il a dû tout réapprendre et a fini par penser que ses parents le trompaient sur sa propre identité. Ainsi imagine-t-il Angelo, poète à la fois violent et passionné, rêvant pour lui d'un destin littéraire qu'il ne connaîtra pas, quand Wilfried reste lui dans la normalité, une illustration manichéenne de sa personnalité, une dualité troublante dans cette période. La publication de ses poèmes se fera après-guerre, mais sous le titre de « confession d'un comédien » sous le pseudo d'Angelo, Wilfried, lui, restant policier.
Il y a aussi un contexte familial particulier et difficile puisque que sa famille l' abandonné, car si lui est plus que « trouble » dans son attitude, sa tante elle choisit de profiter pleinement de la présence de l'ennemi. Il y a aussi lui l'idée prégnante de la mort, celle de son fils, de sa petite-fille, dévastée par son attitude, puis de sa femme. Pourquoi écrit-on ses mémoires ? Pour nourrir son œuvre quand on est écrivain, pour laisser une trace après sa mort pour sa descendance, pour faire le bilan de sa vie, se justifier aussi et c'est sans doute ce que veux faire Wilfried quand il destine cette confession à son arrière-petit-fils parce que, dans un telle démarche, surtout si elle est spontanée, il y a toujours la contrition et la recherche de la rédemption. Il a survécu à cette période orageuse au terme de nombre de compromissions personnelles et souhaite s'expliquer pour laisser sans doute une bonne image de lui. Il est difficile au lecteur de prendre parti. Je ne suis pas très sûr qu'il soit cependant sincère dans sa démarche puisque, écrasé par la culpabilité, il ne lui reste plus que cela, avant sa propre mort, pour justifier sa conduite. Pour ceux qui n'ont pas connu la Deuxième guerre mondiale, il est difficile de juger objectivement ceux qui ont chaque jour dû survivre, parfois au prix d'abandons, de machinations, de compromissions, de trahisons, autant de situations dont on n'est pas fier après coup mais qui ont permis de sauver sa propre vie. Cela nous revoie à l'éternelle question qu'on ne peut pas ne pas se poser. « Qu'aurais-je fait si j'avais vécu à ce moment-là ? » que je me suis souvent posée. J'aurais probablement fait comme la plupart des gens de cette époque, j'aurais cherché à survivre pour moi-même et pour ma famille en évitant de jouer les héros, une attitude de tiède qui n'a rien de bien glorieux. La dualité du personnage qui a traversé cette vie en solitaire est intéressante puisqu'elle nous concerne tous. En outre cette période se prête particulièrement bien à l'étude de l'espèce humaine qui trouve dans ces événements matière à révéler sa véritable nature, bien loin de ce que tous les propos lénifiants qu'on nous a souvent assénés. Elle est capable du pire comme du meilleur, mais bien souvent du pire, à l'image des salauds ordinaires qui pullulaient sous l'Occupation. Cette fiction évoque aussi l'histoire de la Belgique face à l'occupation allemande et notre littérature nationale a également trouvé là matière à réflexion et à écriture.
Sur le plan de la forme, j'ai noté beaucoup de longueurs, des faits et des personnages multiples, ce qui m'a un peu rebuté.
©Hervé Gautier.
La Feuille Volante n° 1348 – Mai 2019.
Trouble – Jeroen Olyslaegers – Stock.
Traduit du néerlandais par Françoise Antoine.
Wilfried Wils revient sur son passé et se raconte, dans un long monologue, à son arrière-petit-fils qu'il ne peut pas voir. Quand il commence son récit, il a 22 ans à Anvers et les nazis occupent le pays. Il a l'âge d'être envoyé en Allemagne au titre du « Service du travail obligatoire » et, pour y échapper, entre dans la police comme auxiliaire. En France ses contemporains ont plutôt rejoint la Résistance, le maquis. Dans ces fonctions il connaît une situation plutôt ambiguë puisqu'il doit traquer ceux qui, comme lui, fuient le STO. De plus Anvers est la ville des diamantaires où les Allemands procèdent à des rafles et des déportations et d'un côté son collègue Lode le met en relation avec des résistants qui viennent en aide à des Juifs et de l'autre, son ancien professeur devenu son mentor, surnommé Barbiche teigneuse, le présente à des collaborateurs. Ainsi est-il, témoin et acteur, ballotté entre antisémitisme, collaboration avec l'occupant, dénonciations et résistance au cours de cette période trouble mais sans jamais pouvoir ou vouloir prendre parti pour un camp ou pour un autre, acceptant sans trop réfléchir les missions qui lui sont confiées avec pour seul objectif survivre. Il a en effet contact notamment avec le boucher traficoteur dont il finit par épouser la fille, Yvette. Il est effectivement mal à l'aise dans son uniforme de policier notamment parce qu'il écrit des poèmes sous le pseudo d' « Angelo », sa voix intérieure, sa part d'ombre. Ce personnage n'est pas là par hasard puisque, lorsqu'il avait 5 ans, Wilfried a été victime d'une méningite, est resté longtemps dans le coma et à son réveil il a dû tout réapprendre et a fini par penser que ses parents le trompaient sur sa propre identité. Ainsi imagine-t-il Angelo, poète à la fois violent et passionné, rêvant pour lui d'un destin littéraire qu'il ne connaîtra pas, quand Wilfried reste lui dans la normalité, une illustration manichéenne de sa personnalité, une dualité troublante dans cette période. La publication de ses poèmes se fera après-guerre, mais sous le titre de « confession d'un comédien » sous le pseudo d'Angelo, Wilfried, lui, restant policier.
Il y a aussi un contexte familial particulier et difficile puisque que sa famille l' abandonné, car si lui est plus que « trouble » dans son attitude, sa tante elle choisit de profiter pleinement de la présence de l'ennemi. Il y a aussi lui l'idée prégnante de la mort, celle de son fils, de sa petite-fille, dévastée par son attitude, puis de sa femme. Pourquoi écrit-on ses mémoires ? Pour nourrir son œuvre quand on est écrivain, pour laisser une trace après sa mort pour sa descendance, pour faire le bilan de sa vie, se justifier aussi et c'est sans doute ce que veux faire Wilfried quand il destine cette confession à son arrière-petit-fils parce que, dans un telle démarche, surtout si elle est spontanée, il y a toujours la contrition et la recherche de la rédemption. Il a survécu à cette période orageuse au terme de nombre de compromissions personnelles et souhaite s'expliquer pour laisser sans doute une bonne image de lui. Il est difficile au lecteur de prendre parti. Je ne suis pas très sûr qu'il soit cependant sincère dans sa démarche puisque, écrasé par la culpabilité, il ne lui reste plus que cela, avant sa propre mort, pour justifier sa conduite. Pour ceux qui n'ont pas connu la Deuxième guerre mondiale, il est difficile de juger objectivement ceux qui ont chaque jour dû survivre, parfois au prix d'abandons, de machinations, de compromissions, de trahisons, autant de situations dont on n'est pas fier après coup mais qui ont permis de sauver sa propre vie. Cela nous revoie à l'éternelle question qu'on ne peut pas ne pas se poser. « Qu'aurais-je fait si j'avais vécu à ce moment-là ? » que je me suis souvent posée. J'aurais probablement fait comme la plupart des gens de cette époque, j'aurais cherché à survivre pour moi-même et pour ma famille en évitant de jouer les héros, une attitude de tiède qui n'a rien de bien glorieux. La dualité du personnage qui a traversé cette vie en solitaire est intéressante puisqu'elle nous concerne tous. En outre cette période se prête particulièrement bien à l'étude de l'espèce humaine qui trouve dans ces événements matière à révéler sa véritable nature, bien loin de ce que tous les propos lénifiants qu'on nous a souvent assénés. Elle est capable du pire comme du meilleur, mais bien souvent du pire, à l'image des salauds ordinaires qui pullulaient sous l'Occupation. Cette fiction évoque aussi l'histoire de la Belgique face à l'occupation allemande et notre littérature nationale a également trouvé là matière à réflexion et à écriture.
Sur le plan de la forme, j'ai noté beaucoup de longueurs, des faits et des personnages multiples, ce qui m'a un peu rebuté.
-
Ton histoire. Mon histoire - Connie Palmen
- Le 05/05/2019
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1347 – Mai 2019.
Ton histoire. Mon histoire – Connie Palmen – Actes Sud
Traduit du néerlandais par Arlette Ounanian.
C'est un roman inspiré par la vie de Sylvia Plath (1932-1963), écrivain et poétesse américaine et Ted Hughes (1930-1998) poète et écrivain anglais, leur bref mariage et leurs relations difficiles. C'est Ted qui prend la parole et évoque tout d'abord leur rencontre, à la fois violente et sensuelle. Lui c'est un idéaliste réservé qui croyait au destin, un séducteur, mais à cette période, un étudiant pauvre, un poète « sans nom ni renom ». Elle, c'est une belle étudiante, exubérante et inattendue qui croit en son avenir de femme de lettres. Il découvre cette jeune fille, sa tentative de suicide avant de le connaître, sa volonté de se mettre en danger, de disparaître, ce qui est une façon de faire planer sur sa vie l'ombre inquiétante de la camarde. Il y a tout au long de ce roman une atmosphère malsaine, ésotérique avec la pratique de la divination, de l'hypnose avec Sylvia comme objet et également l'usage du ouija, la présence oppressante de la part d'ombre que chacun d'eux porte inconsciemment et qui se révèle destructrice, avec le constant rappel du concept de la séparation, de la mort suivie d'une hypothétique renaissance. Après leur mariage, ils voyagent en Europe, dans Paris occupé par les nazis et en Espagne où le décor de mort violente est symbolisée par la tauromachie, puis en Amérique, ce qui, malgré leur appétit de voyage et de grands espaces ressemble à un exil. Ce climat un peu délétère laisse place à l'écriture, mais seulement en contrepoint, comme si elle était accessoire, alors qu'ils sont tous les deux écrivains. En outre semble s'installer entre eux une atmosphère de secret et leur mariage est d'emblée mis sous l'égide du non-dit, du mensonge et de la dissimulation de la vérité, de méfiance, de lourds silences. Leur amour fou du début s'habille très vite des soupçons de Sylvia et d'une jalousie maladive de sa part, d'attirance supposée de Ted pour les jeunes et belles étudiantes, puis, plus tard, des relents d'adultère, Sylvia voyant dans toutes les femmes que rencontrait son mari, une possible rivale. Lui, de son côté, sans doute accablé par Sylvia, répond facilement aux étourdissements libérateurs de l'amour.
Sylvia a un lourd passé névrotique avec une incompréhension et un désamour de ses parents, le fantôme envahissant d'un père traumatisé par la guerre, une mère abusive puis, plus tard, après son mariage, le côté agressif de sa belle-sœur. Elle a sans doute pensé que sa rencontre avec Ted puis leur union serait une solution, un exorcisme, mais elle a été obligée de se rendre à l'évidence qu'il n'en était rien. Elle voudrait être une épouse attentive, peut-être une future bonne mère de famille mais elle voit bien qu'elle n'est guère douée pour cela et les événements semblent lui donner raison. Lorsque que leur deux enfants naîtront, elle ne sera pas vraiment à la hauteur de son rôle de mère. De plus elle est un génial poète et le sait, veut pratiquer son art avec passion et recherche légitimement le succès qui ne vient pas alors que Ted connaît dans ce domaine une relative réussite ce qui induit un atmosphère délétère dans ce ménage de créateurs littéraires qui ont ainsi tendance à se détruire alors qu'ils devraient s'épauler. Elle en conçoit une improbable cabale dirigée contre elle et s'y accroche, nourrissant ainsi une réelle paranoïa. Son état mental lui interdit même pendant longtemps de tomber enceinte, ce qui pour elle a des accents d'échec et entretient ses pulsions destructrices. L'amour réel que Ted éprouve pour Sylvia engendre une situation assez surréaliste. Chacun d'un cherche sa propre voix poétique mais elle est jalouse des succès de son mari et il en résulte une attitude nocive et lui se laisse manipulé. Pire peut-être, les angoisses et les obsessions de son épouse deviennent les siennes propres au point que Ted finit par ne vivre que par elle et pour elle. Leur vision idyllique du mariage s'estompe peu à peu et, face à cela, une démarche psychiatrique s'impose pour Sylvia et, dans ce contexte de paroles, son mari se retrouve facilement au centre de ses accusations avec toute la culpabilité incontournable, sa position au sein du couple s'en trouve affectée et le suicide de Sylvia le met définitivement pour le monde extérieur dans le rôle du coupable. Le retour sur le passé, inévitable dans ce genre de thérapie, ne fait qu'aggraver les choses et l’écriture ne joue même plus pour elle son rôle cathartique. Au terme de ce processus Sylvia devient une véritable inconnue pour son mari, une femme insaisissable, victime de ses vieux démons, de ses obsessions, qui, malgré leurs efforts pour rendre plus douce la vie, malgré la présence des enfants et l'atmosphère commun de créativité, à cause des infidélités de son mari, s'avance inexorablement vers la mort tandis que Ted connaît enfin une notoriété dont elle est exclue.
Ce roman met en scène fictivement Ted qui écrit à la première personne et qui ainsi nous donne sa vision unilatérale des choses sans que son épouse puisse prendre vraiment la parole. Il y confesse lui-même, comme une quête de rédemption, son attirance pour d'autres femmes, comme pour se libérer du carcan de sa vie conjugale pourtant brève mais de tout temps vouée à l'échec et ne pouvait avoir pour Sylvia qu'une issue fatale, présentée comme une sorte de sacrifice fait à un amour impossible, à la vie et aux illusions qu'elle engendre.
J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce roman fort bien écrit et poétique qui, à titre personnel, a nourri ma réflexion sur le mariage, sur l'amour qui devrait y présider et qui finalement n'est pas autre chose qu'une frêle illusion, sur l'espèce humaine et ses incroyables légèretés, ses faiblesses et ses hypocrisies entretenues, sur la fragilité de la vie...
©Hervé Gautier.
-
Taxi Curaçao - Stefan Brijs
- Le 21/04/2019
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1344 – Avril 2019.
Taxi Curaçao– Stefan Brijs – Éditions Héloïse d'Ormesson.
Traduit du néerlandais (Belgique) par Daniel Cunin.
Max Tromp , 12 ans, n'est pas peu fier de débarquer, un matin de 1961 dans la classe du Frère Daniel à Barber (Caraïbes néerlandaises), dans la Dodge Matador rutilante conduite par son père, Roy, chauffeur de taxi. On ne peut pas ne pas la remarquer tant la misère fait partie de ce lieu. Pourtant les relations entre eux sont difficiles et la famille s'est désunie à cause du père menteur et volage. Max est un élève brillant et se voit bien devenir instituteur. Le Frèr Daniel, qui est noir et originaire de ce pays, obtiendra pour lui une bourse qui lui permettra de poursuivre ses études, mais s'il représente un espoir pour cette famille, le père, Roy, en est toujours absent. Oui, mais voilà, comme lui comme pour les autres le destin lui sera contraire et quand son père tombe malade, revient au foyer qu'il avait abandonné, Max n'a d'autre choix que d'abandonner ses études et devenir à son tour chauffeur de taxi avec la vieille Dodge Matador, en renonçant à son rêve de devenir instituteur. Les années passent, Max, épouse Lucia qui lui donne un fils, Sonny, sur qui repose l'espoir familial de sortir de cette condition précaire qu'ont aggravé les émeutes ouvrières de 1969 qui ont embrasé l'île de Curaçao. On appelle cela les promesses de la vie, qui pourtant n'en fait aucune, et l'imagination est toujours féconde quand il s'agit de son propre avenir. Malheureusement la réalisation de ces fantasmes est rarement au rendez-vous et Max n'échappe pas à cette règle.
C'est le Frère Daniel qui prête sa voix à cette saga pleine de rebondissements et d'anecdotes de la famille Tromp, sur trois générations. L'auteur évoque la place des femmes dans cette société, le destin de ces îles pourtant paradisiaques qui ont été la proie de la colonisation et qui, sous couvert d'une politique d'émancipation des populations locales n'a finalement engendré que pauvreté, corruption, exclusion et évidemment racisme. Il y a aussi une étude sociologique, celle de la société des noirs parfaitement résumée par l'exergue, les femmes qui travaillent et les hommes qui friment, avec, au sein de cette famille, les mensonges de Roy mais aussi de Max au sujet de l'argent et la culpabilité ressentie sincèrement par ce dernier. A travers Frère Daniel, c'est l'action de l’Église et la sienne propre et surtout l'abnégation de ses missionnaires qui est ici mise en avant, leur sens du combat aux cotés des plus démunis même si la révolte des noirs est aveugle, s'exprime dans le cadre général de la colonisation, de la haine du « blanc » et frappe ainsi ceux qui les ont toujours défendus. Il y a aussi une réflexion sur le phénomène colonial, cette attitude de mépris de la classe dirigeante blanche qui maintient les noirs dans un état d'infériorité en raison d'une supposée supériorité mais aussi la recherche du profit au détriment des populations locales. Le plus étonnant est de Frère Daniel, malgré ses origines et peut-être un peu malgré lui-même, a contribué à faire entrer les noirs dans un moule fabriqué par les colons pour mieux les dominer. Il prend conscience de cela et culpabilise à un point tel qu'il décide de troquer sa soutane pour des vêtements civils, ce qui est plus qu'un symbole. Avec la troisième génération de Tromp, l'auteur introduit l'argent facile, le trafic de drogue et ses dangers, le destin de Max, et on imagine ce que sera la vie future de Sonny.
Il y a aussi cette étude de personnages, Roy est un être détestable, hâbleur, menteur, égoïste et Max est plein de bonne volonté, fait ce qu'il peut pour les siens avec un sens aigu du sacrifice, mais est poursuivi par un destin tragique qui s'acharne sur lui. Sa vie aurait pu être belle mais ne l'a pas été.
Cette saga est évoquée par le Frère Daniel, cet homme d’Église bienveillant et peut-être un peu trop idéaliste voire utopique face aux populations qu'il entend protéger, qui est fidèle à ses vœux est malgré tout d'un engagement religieux et personnel inébranlable. Non seulement il a fait de la défense de Max et de sa famille un des buts de sa vie mais cette action individuelle s'inscrit dans une sorte de recherche de rédemption personnelle. En toile de fond, il y a cette voiture vieillissante, qui, comme lui, est le témoin de la déchéance de cette famille.
Le style est quelconque, pas vraiment attirant, entrecoupé d'expressions locales évoquant des coutumes, des croyances et des superstitions, de phrases en anglais, mais le message au contraire est important.
©Hervé Gautier.
-
Mariage contre nature - Motoya Yukiko
- Le 22/03/2019
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1337 – Mars2019
Mariage contre nature – Motoya Yukiko – Éditions Philippe Picquier. [Prix Akutagawa 2016]
Traduit du japonais par Myram Dartois-Ako.
San est mariée depuis quatre ans. Elle a quitté son emploi de bureau pour épouser un homme tellement transparent que nous ne saurons même pas son prénom, mais la vie domestique l'ennuie un peu d'autant qu'elle n'a pas d'enfant et que le salaire de son conjoint est suffisant pour la dispenser de travailler à l'extérieur. J'ai eu l'impression qu'elle avait épousé cet homme non pas par amour mais par opportunité, l'important revenu de ce dernier lui permettant d'être une femme au foyer. Quand elle est seule avec lui, il a une addiction pour la télévision, l'oisiveté… et aussi pour le whisky-soda ! Sa vie est telle qu'elle dit elle-même être comme en apesanteur. San qui se cherche des activités ménagères fait un jour le tri de ses photos dans son ordinateur, découvre que son mari et elle se ressemblent et trouve cela inquiétant tant ils sont apparemment dissemblables ! Pourtant le nez et les yeux de son mari ont des velléités migratoires sur son visage ! Il lui semble légitime de s'interroger, d'autant que ses relations de couple, hormis peut-être les séances intimes de simulacre de la reproduction, sans véritable plaisir pour elle, sont plutôt en panne. Peu semble lui importer cependant puisque, de ce point de vue, et avant de connaître cet homme, elle avait un rôle plutôt passif avec ses autres partenaires éphémères, au point que non seulement elle n'en a gardé que peu de souvenirs mais surtout qu'elle se sentait menacée par eux. Aussi bien mettait-elle rapidement fin à leur liaison. A l'intérieur de son couple, il n'y a rien de vraiment nouveau et c'est un peu comme si elle se faisait manger, c'est à dire détruire, par son mari. San ne doit pas avoir beaucoup d'attachement pour cet homme puisque, quand elle parle de lui, elle le nomme comme « la chose qui est censée être mon mari », ce qui, après quatre années de mariage, est quand même révélateur. Elle en vient même à se demander si elle ne regretterait pas davantage la mort de son chat que celle de son époux !
San doit être une belle femme puisque son mari a quitté son ex, qui ressemblait à une pin-up ou à une actrice de cinéma, pour l'épouser. D'évidence elle s'ennuie avec lui mais je note qu'elle est suffisamment loyale à son époux pour ne pas le tromper. L'adultère se pratique pour moins que cela ! Lui-même semble vivre à côté d'elle sans vraiment lui accorder de l'importance. Ce concept de ressemblance entre époux est récurrent puisqu'il revient à propos d'un autre couple marié depuis beaucoup plus longtemps. Le plus étonnant est que, sans vraiment l'expliquer autrement que par un long congé de maladie de son mari, San constate que, dans son couple, les rôles se sont inversés, elle s'étant mise à la télévision... et au whisky soda et lui aux tâches ménagères en prenant toutes les charges de son épouse. Est-ce à dire que dans le mariage on perd sa personnalité au point de ressembler à l'autre ? La ressemblance supposée entre ces deux époux irait-elle jusque là ?
Je n'ai pas une culture nippone, je ne connais pas la symbolique de la pivoine dans ce pays et franchement, même s'il y a un côté poétique à l'épilogue, il m'a un peu échappé. J'y verrais plutôt l'image de l'abandon voire de la destruction physique de cet homme. San a-t-elle un réel problème avec les hommes dont, avant son mariage, elle se débarrassait rapidement, rôle qu'elle reprend avec son mari dans une métamorphose poétique. Veut-elle nous signifier qu'il vaut mieux vivre seul que de supporter un conjoint insupportable et ainsi fuir le mariage ? A travers ce court roman un peu étrange, veut-elle nous signifier que cette union était, comme l'indique le titre, contre nature?
Motoya Yukiko, qui est une jeune auteure (née en 1979), nous montre les défauts du couple, le peu d'attirance qu'elle a pour le mariage et l'amour semble être, pour l'instant, son thème de prédilection favori. Au vrai, c'est un sujet classique d'autant que, allez savoir pourquoi et sous toutes les latitudes, les hommes et les femmes semblent vouloir s'inventer la vocation du mariage comme un passage obligé dans leur vie, alors que manifestement, vu le nombre grandissant de divorces, ce serait plutôt un échec.
Ce thème fait partie des préoccupations humaines et a toujours été un sujet de réflexion pour les hommes et les femmes et de création pour les artistes. Il est certes intéressant et cette histoire l'illustre à sa manière assez particulière, même si chacun de nous a forcément une idée précise sur la question.
Ce roman a obtenu le prix Akutagawa qui est le plus prestigieux du Japon. Là je me dis que compte tenu de la distinction, je n'ai effectivement rien compris et que je suis passé à côté d'un chef-d’œuvre nonobstant la fin poétique et sûrement métaphysique de cet ouvrage.
©H.L.
-
Ces rêves qu'on piétine - Sébastien Spitzer
- Le 19/03/2019
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1335 – Mai 2019
Ces rêves qu'on piétine – Sébastien Spitzer- Éditions de l'Observatoire.
Tout d'abord je remercie Babelio et les éditions de l'Observatoire de m'avoir fait découvrir ce roman.
Ce livre s'ouvre sur un concert, le dernier qui sera donné à Berlin et les notes de l'orchestre le disputent au bruit des orgues de Staline tirées aux portes de la capitale du Reich. C'est la fin des rêves de la grande Allemagne. Magda est la reine de cette ultime moment parce qu'elle est non seulement une fort belle femme mais elle est aussi l'épouse de Joseph Goebbels, le ministre de la propagande. C'est dans ce genre de circonstances, quand tout s'effondre autour de soi et qu'on sent la fin, qu'on refait le chemin parcouru jusque là. Dans le bunker berlinois d'Hitler, qui sera bientôt son tombeau et celui de ses enfants, elle se revoit jeune fille pauvre mais heureuse, puis mariée à un homme riche et influent dont elle divorcera. Elle sera fascinée par le nazisme et par ce petit homme boiteux qui parle si bien et qu'elle finira par épouser. Il est pourtant bien dépourvu des caractéristiques aryennes exigées par le nouveau pouvoir, mais cela lui importe peu après tout, ce qui compte pour elle c'est de faire partie des puissants du régime, de satisfaire ses ambitions. Magda est le type de femme qui n'aime qu'elle-même et qui sait jouer de sa séduction, qui accepte les nombreux adultères de son mari pour arriver à ses fins. Ses rêves à elle ont été satisfaits puisqu'elle est « la première dame du Reich » et un modèle pour tous. Elle a seulement un attachement pour Harold, un fils qu'elle a eu d'un premier mariage à qui elle écrit une dernière lettre pleine d'espoirs dans le nazisme mais n'hésitera pas à assassiner ses six enfants dans une sorte de rituel avant de se donner la mort avec son mari. Elle a réussi à cacher ses origines juives comme l'ont fait beaucoup de dignitaires du III° Reich.
L'auteur s'approprie l'Histoire, y mêle de la fiction, imagine que le père de Magda, Richard Friedländer, prisonnier à Buchenwald où il sera exécuté, lui écrit des lettres pour lui demander de l'aide. On a du mal à imaginer que ces lettres ont pu lui parvenir et même quitter le camp et, de fait, c'est une invention de Spitzer. Le vrai Friedländer, qui n'était d'ailleurs que son père adoptif, s'était effectivement occupé d'elle, enfant, et avait eu, à son égard, toutes les attentions d'un père. Il est mort sans laisser de traces, comme la plupart d'entre nous. Compte tenu de la personnalité de Magda, on peut parfaitement imaginer que, si ces lettres eussent existé et eussent été portées à sa connaissance, elle les eût ignorées parce que simplement cela eût détruit un fragile édifice qu'elle avait mis tant de temps et de compromissions à édifier. Cela aussi eût piétiné ses rêves.
Il avait des rêves lui aussi, ce pauvre M. Friedländer, des rêves de libération et de vie normale, mais ils ont été foulés par les bottes des SS, comme toutes les victimes de la Shoah persécutés et tués pour la seule raison qu'ils étaient juifs.
Il n'est pas besoin de faire appel à la fiction pour illustrer cette caractéristique de l'espèce humaine, capable du pire comme du meilleur, mais bien souvent du pire. C'est l’égoïsme qui s'exerce jusques et y compris contre les membres de sa propre famille quand ils sont une gêne pour ses propres intérêts immédiats et contre lesquels on n'hésite pas à pratiquer l'oubli, le mensonge, la trahison voire l'élimination. C'est peut-être difficile à admettre, cela va à l'encontre de toutes les affirmations lénifiantes qu'on a pu nous asséner depuis des lustres, mais c'est une réalité que ne rachètent pas tous les abbé Pierre et tous les Coluche du monde. Nous ne pouvons l'ignorer parce que simplement, nous faisons, nous tous, partie de cette espèce humaine.
En parallèle, on assiste aux derniers moments des prisonniers des camps assassinés par les SS puis à la fuite désespérée de ceux qui, un temps, échappent à la mort puis succombent, pour se focaliser sur Fela, cette femme violée dans le camp, favorite du commandant qu'elle présente comme le père d'Ava, sa fille. Quand tant d'autres bébés étaient assassinés dès leur naissance, cette pauvre petite enfant née dans le camp, sans père et sans nom, croisera par les hasards de la vie Lee Meyer, une belle correspondante de guerre pour « Vogue » et qui révélera cette histoire, « avatar » d'une authentique mannequin, Lee Miller, amie intime de Man Ray et de Picasso et photographe de guerre dont les clichés porteront témoignage des atrocités de Dachau.
L'auteur rappelle également que de grandes entreprises allemandes, actuellement prospères et cotées en bourse et qui produisent encore aujourd'hui des articles de luxe qui sont l'emblème de la réussite sociale de ceux qui les possèdent, ont fait leur fortune sous le III° Reich.
J'ai bien aimé ce livre, même s'il est glaçant, pour le message qu'il délivre, mais aussi parce qu'il est bien écrit, bien documenté.
©H.L.
-
Cette nuit - Joachim Schnerf
- Le 09/11/2018
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1291
Cette nuit – Joachim Schnerf - Zulma.
La nuit dont il va être question n'est pas n'importe laquelle. C'est celle de Seder de Pessa'h qui, dans le rituel hébraïque, commémore la fuite d’Égypte, c'est à dire le retour à la liberté pour le peuple juif après des années d’esclavage. Cette cérémonie a lieu au cours d'un repas familial le soir où les mets sont chargés de symboles et dont le déroulement répond à une codification précise avec ablutions, bénédictions psaumes et lectures. C'est un moment consacré à la fête, au souvenir, à l'espoir aussi. L'auteur détaille toutes ces phases pour les non initiés.
Ce n'est pas non plus n'importe quelle nuit puisque c'est le premier Seder que Salomon, le narrateur, célèbre sans Sarah, l'amour de sa vie, morte quelques mois plus tôt. Il la revoit pourtant toujours à ses côtés. C'est l'occasion de réunir toute la famille, ses deux filles Michelle et Denise, leur mari respectif Patrick et Pinhas, ses petits enfants, Samuel et Tania et d'autres membres de la parentèle. Tout le récit est baigné par le souvenir de Sarah, de leur vie commune, mais aussi de la Shoah, des rafles, de la vie dans les camps à laquelle il a survécu ... En plus de la liturgie on évoque les absents, on moque gentiment les présents, on s'amuse avec les petits-enfants, on plaisante parfois comme s'est son cas, usant d'un humour particulier aux juifs, comme lors de tous les repas dans les familles traditionnelles. Les personnalités s'affrontent aussi et pour Salomon les analepses se bousculent dans sa tête et avec eux le souvenir obsessionnel de son épouse On ne coupe pas non plus à l'éternel opposition entre les Séfarades et les Ashkénazes, aux vieilles histoires et querelles, aux questions des plus jeunes sur Israël, sur Dieu, sur le peuple juif… Salomon doit jouer les pères de famille et maître de cérémonie malgré les souvenirs personnels douloureux qui l'assaillent et bien que les circonstances ne s'y prêtent pas, aborde la délicate question de l'héritage et de la maison qu'ils vont acheter et qui sera celle de toute la famille. La querelle des générations est elle aussi inévitable, l'Europe s'est faite et avec elle la réconciliation franco-allemande à laquelle les petits-enfants sont plus sensibles, malgrè le ressentiment des adultes à propos des nazis…
Ce que je retiens, moi qui ait toujours cru que les êtres faits l'un pour l'autre n'existent pas, c'est l'amour de Salomon pour Sarah et je choisis de croire qu'il est sincère, qu'il perdure par delà la mort quand bien des couples se promettent fidélité pour la vie, se séparent quelques années après et chacun recommence avec un autre partenaire en faisant semblant de croire que cette fois c'est la bonne et que cela durera toujours. Entre eux c'est un amour qui n'a plus besoin de la dimension physique du corps. Il ne remplacera jamais Sarah. Nous sommes dans un roman et donc dans une fiction et que l'auteur choisisse de donner à ce récit une dimension sacrée en l'évoquant à propos d'une fête religieuse ne change rien. A la fin du livre, c'est un peu comme si Salomon devenait fou, comme si le fantôme de Sarah devenait tellement présent que lui-même n'existait plus, un peu comme si, d'avoir ainsi remonter le temps vécu en commun lui avait donné le vertige, comme si la vie sans cette femme était effectivement impossible pour lui. Il sent que la mort le guette parce que la solitude lui semble soudain insupportable et que ce premier Seder depuis la disparition de Sarah sera pour lui le dernier . Il prend conscience qu'il est à la fois un veuf et un vieillard et que la camarde le guette du coin de l’œil. Cette cérémonie terminée, la nuit s'annonce et avec elle le sommeil, antichambre de la mort et toutes ses plaisanteries sur la Shoah n'y feront rien, comme deviennent prégnantes les souffrances que les nazis infligeaient aux juifs dans les camps, il perd son souffle comme ses congénères étouffaient dans les chambres à gaz et les crématoires. Le Seder évoque le voyage des Hébreux fuyant l’Égypte vers la Terre Promise et c'est pour lui la fin de son parcours terrestre.
Même si je ne suis pas familier des coutumes traditionnelles juives, détaillées ici dans leurs significations et leurs procédures, si je ne partage pas le message de ce livre, pour peu que je l'aie compris, je dois reconnaître son côté émouvant.
© Hervé Gautier – Novembre 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Montaigne - Stefan Zweig
- Le 21/08/2018
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1272
Montaigne – Stefan Zweig – PUF,
La biographie de Michel de Montaigne est l'ultime ouvrage de Stefan Zweig avant son suicide au Brésil en février 1942, On peut sans doute y voir une dernière tentative de conjurer son projet de quitter cette vie que Montaigne aimait tant mais qui ne lui convenait plus à lui, à moins qu'il n'ait fait sienne cette pensée des Essais « La plus volontaire mort est la plus belle » .
Du propre aveu de Zweig, la rencontre avec l'auteur des « Essais » n'a pas facile puisque, bien que nourri de culture française il n'était pas prêt, à vingt ans, à en recevoir le message. Il lui a fallu attendre longtemps qu'il mûrisse en lui pour qu'il lui consacre cette biographie comme on retrace la parcours d'un ami. Même si notre auteur, qui est aussi connu comme romancier et nouvelliste, a consacré son talent à nombre de biographies, ce sujet n'a peut-être pas été choisi par hasard à cause peut-être de similitudes qui existaient entre eux. Les voyages, la fuite de Montaigne quittant Bordeaux pour échapper à la peste à laquelle répond celle de Zweig fuyant le nazisme, une autre peste, mais brune celle-là, la violence des guerres de religion et celle qui poussa l'écrivain autrichien à errer par le monde... Il a souhaité honorer le combat de Montaigne pour la liberté, de penser, d'agir, d'écrire, d'aimer … une valeur si menacée en cette première moitié du XX° siècle en Europe et qui lui manqua tant parce que son absence signifiait aussi l'intolérance. Il célèbre sa lucidité face au naufrage de l'humanisme et à la folie meurtrière des hommes qui ne vivent que pour la violence, parle de sa dénonciation de l'inhumanité, de la fragilité de la condition humaine de son époque et de sa volonté d'être lui-même, c'est à dire un homme qui refuse de prendre part à toute ce déchaînement de haine à l'extérieur. Pourtant il attendra longtemps pour devenir véritablement Montaigne ; il renoncera aux charges publiques et se retirera dans sa tour comme en lui-même et bien sûr avec le rempart de ses livres, sans pour autant renoncer à ses richesses ni aux voyages. Pourtant, cette forme d'égoïsme de Montaigne qui ne parle que de lui, cesse d'une certaine façon quand il devient écrivain, c'est à dire accepte d'écrire non plus pour lui mais pour les autres en leur confiant le résultat de ses méditations personnelles et intimes. Son œuvre est en effet une « quête de soi-même » menée au rythme d'une vie retirée dans sa tour. Pourtant sa notoriété littéraire le fait élire maire de Bordeaux, ce qu'il apprend quand il est en Italie et alors même qu'il n'a rien demandé . Plus tard ce mandat sera renouvelé et il sera, lui-même sollicité par le roi pour des médiations et des négociations dont l'avenir du royaume a peut-être dépendu, Ainsi, par un revirement du sort, quand plus jeune il avait sollicité des charges publiques et que, celles-ci lui avait été refusées , il se voit, alors qu'il avait décidé de se retirer du monde, de méditer et de se préparer à la mort, pressé par le roi lui-même d’intervenir dans les affaires de l’État. Est-ce à dire que Zweig voyait entre eux beaucoup de similitudes ? Peut-être.
L'auteur refait la généalogie des Eyquem, commerçants enrichis et anoblis qui s'allient à une demoiselle Louppe de Villeneuve, d'une famille de commerçants prospères d'origine juive espagnole , la mère de Michel, ce qui n'est pas sans rappeler es propres origines de Stefan. Si Montaigne chercha à cacher cette ascendance, Zweig ne se signalera pas comme écrivain juif mais, lui aussi, comme un humaniste brillant, éclairant le monde de sa pensée. Comme Michel il reçut une éducation de qualité caractéristique de chaque époque et chacun aura une lente maturation d'écrivain. Zweig comme Montaigne honoreront le nom de leur famille par la culture et le transmettront aux générations futures.
Pourtant si Montaigne, mis à part un « journal » de voyage, est l'homme d'un seul livre, ce n'est pas le cas de Zweig, plus prolixe. et si les « Essais » n'ont jamais cessé d'être une référence de notre littérature, les écrits de l'écrivain autrichien ont longtemps été dans l'oubli même s'ils sont heureusement redécouverts actuellement
Montaigne s'interroge abondamment sur lui-même, cherche à se connaître, se demandant notamment « Que sais-je ? » ce qui le distingue des érudits et des religieux de son époque qui affirmaient péremptoirement détenir la vérité. Je note que s'il revenait aujourd’hui, il pourrait utilement se poser la même question. Ainsi,se peignant lui-même, il constate au long de sa vie des changements que le font passer de l'épicurisme au scepticisme, au stoïcisme pour finalement lui conférer une certaine sagesse mais aussi un forme de solitude, Cela , à mes yeux, fait de lui un écrivain de l'humain, de « l'humaine condition ».
© Hervé Gautier – Août 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Angoisses - Stefan Zweig
- Le 03/08/2018
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1269
Angoisses – Stefan Zweig – Gallimard.
Traduit par Bernard Lortholary.
C'est une histoire simple, presque banale que Stefan Zweig nous offre dans cette longue nouvelle : En sortant de chez son jeune amant, Irène, la trentaine, femme mariée et mère de famille de la bonne société viennoise est agressée par une femme pauvre et frustre qui se dit l'amie de l'homme qu'elle vient de quitter. Revenue au foyer, Irène y reprend sa place grâce à son aplomb et l'hypocrisie bourgeoise qui la caractérise. Cependant, le lendemain elle gamberge mais heureusement la mode féminine est à la voilette et elle ne craint pas d'être reconnue. Pourtant son agresseuse de la veille la retrouve et c'est le début d'un chantage au terme duquel elle peut tout perdre, sa famille, son confort , sa place dans la société... Elle est dès lors assaillie par des certitudes contradictoires. Certes elle est encore belle, désirable et est attirée par des passades, mais n'est pas prête à tout sacrifier d'autant que l'adultère qu'elle pratique n'est en rien une vengeance envers son mari à qui elle n'a rien à reprocher, mais n'a pour but que de briser l'ennui et le confort routinier de son univers quotidien,
C'est l'occasion pour elle de pratiquerun de ces retours en arrière qui donnent le vertige, son mariage arrangé par ses parents avec un jeune avocat pénaliste, huit ans de bonheur paisible plein d'indifférence et d'oisiveté, mais la certitude que pour elle son mari n'est qu'un étranger. Elle a donc parfaitement de droit de s'octroyer, de temps en temps, un petit accroc. Vient ensuite l'inévitable culpabilité judéo-chrétienne qui se double de la nécessité de rester chez elle pour échapper à la maître chanteuse, Cela brise ses habitudes et et elle vit sous la menace d'une révélation, ce qui ne manque pas d'éveiller les soupçons de son entourage. Elle essaie bien de rompre son isolement en dansant, lors d'une soirée avec un autre homme, suscitant la jalousie de son mari, mais rien n'y fait. Cette situation devient rapidement une obsession génératrice de panique, d'angoisse, de frayeur et de désespoir, une vraie descente aux enfers. On lui demande de payer de plus en plus et elle le fait, se mettant elle-même dans un état de dépendance qu'elle voulait éviter et dont elle ne voit pas comment sortir. En réalité elle n'était pas préparée à cette vie de mensonge comme nombre de ses amies qui s'y complaisaient et elle fit ce qu'elle pouvait pour se déculpabiliser. Non seulement elle n'aimait pas cet amant, elle s'aimait elle-même et évidemment le plaisir qu'elle retirait de cette toquade, mais son bonheur était aussi celui d'enfreindre l’interdit. et elle chercha à se convaincre, dans une sorte de dédoublement de personnalité, que c'était une autre femme qu'elle qui avait commis ce faux-pas. Elle se voulait une femme libre, au mépris du code pénal de l'époque qui n'était pas tendre avec l'épouse adultère, capable de vivre en pointillés une vie quelque peu dépravée au mépris de son mari et de ses enfants, mais le hasard s'en était mêlé qui venait brouiller ce bel agencement. Elle se découvrait différente, certes attachée à son confort mais suspicieuse, persuadée que son mari connaissait son faux-pas mais n'en parlait pas (L'épisode où il fustige sa fille pour un mauvais geste n'est pas sans rappeler la scène où Raimu, dans « la femme du boulanger » tance sa chatte devant sa jeune épouse contrite), incapable elle-même de discerner les discordances dans l'attitude de la maître-chanteuse mais acculée à une décision qu'elle n'avait jamais imaginée.
Je ne suis pas sûr cependant que cet épisode venant bouleverser leur vie commune se termine par cette forme de « happy-end » que je trouve toujours artificiel et un peu trop éloigné de la vraie vie. Je ne suis pas sûr non plus qu'il ne restera rien de cela dans leur vie commune future, d'un côté des adultères pas forcément avoués de l'épouse et de l'autre, ce montage un peu grossier d'un mari qui certes veut récupérer sa femme, mais apprend du même coup à la connaître vraiment et se rend compte qu'il a donné son amour et sa confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Certes l'auteur joue sur la différence sociale entre le jeune pianiste et la maître chanteuse, laide et grossière, mais est-ce vraiment crédible ? L'auteur, puisant sans doute dans son vécu personnel (A cette époque Zweig a commencé une liaison avec une femme mariée qu'il finira par épouser), réussit non seulement à se livrer, selon son habitude, à une fine analyse de l'esprit humain et de ses passions, mais il le fait avec un sens consommé du suspens qui tient son lecteur en haleine jusqu'à la fin. Il montre comment la culpabilité finit par s'imposer à elle, puis le regret et enfin la réaction finale. Ce qui aurait pu être l'histoire d'une banale passade devient malgré tout, une étude psychologique passionnante.
Comme toujours, il déroule son récit avec un style fluide qui transforme une lecture en moment d'exception.
© Hervé Gautier – Août 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Amok - Stefan Zweig
- Le 25/07/2018
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1266
Amok – Stefan Zweig – Stock
Traduit de l'allemand par Alzir Hella et Olivier Bournac.
C'est un recueil de trois nouvelles. Le première qui lui donne son titre évoque une sorte de folie meurtrière chez les Maltais (amok) et ceux qui en sont victimes portent aussi ce nom. C'est ce qui est arrivé à ce médecin européen de la jungle qui a refusé par orgueil de venir en aide à une femme blanche de la bonne société et qui le regrette au point de la poursuivre frénétiquement, en vain. Il y a dans leur attitude respective de l'attachement amoureux chez le médecin ainsi qu'une volonté de se racheter et de l’orgueil hautain et destructeur chez cette femme, une sorte de stupidité paralysante et suicidaire pour les deux. La deuxième (« Lettre d'une inconnue ») est la lettre d'une jeune femme qui va se donner la mort et qu'elle destine à un écrivain connu et riche séducteur qui fut son amant d'un soir et à qui elle révèle la mort de son enfant ainsi qu'un secret qu'il ne pouvait connaître. La troisième (« La ruelle au clair de lune ») se passe dans un port argentin et son quartier chaud avec ses bars et ses bordels. Même si on trouve de la poésie aux ruelles sombres, elles abritent toujours une faune interlope, des habitués et des putes. L'homme que rencontre le narrateur est un être abandonné par son épouse tombée dans la prostitution et qui l'humilie.
Il y a dans ces nouvelles à la fois une crainte et un désir de la mort face à l'impuissance ou à l'inutilité désormais évidente de la vie. Dans ces situations la vie n'est pas belle comme on nous en rebat un peu trop les oreilles mais au contraire est une épreuve constante qui justifie ou peut justifier l'atteinte à sa propre existence ou à celle de l'autre qui la pourrit. A cela s'ajoute le culte du secret, le respect de la parole, celle qu'on donne à un autre et qu'on se donne à soi-même, la volonté que personne ne sache la vérité sur un drame devenu une chose à cacher, mais que le hasard contribue à révéler...
Nous assistons au déroulements d'événements qui annihilent la liberté individuelle comme si le destin implacable se manifestait soudain dans le quotidien et bouleversait définitivement les choses au point que les personnages, lassés peut-être de vouloir agir, mais désespérés par le cours que prennent les circonstances, s'en remettent au hasard pour finalement s'autodétruire posant cet acte comme le seul qui vaille dans cette vie dont ils veulent enfin se libérer. Dois-je rappeler que Stefan Zweig lui-même devait sans doute voir ainsi les choses puisqu'il s'est suicidé. .
Monologue dans un cas, lettre d 'amour anonyme et témoignage quasi solitaire dans les autres, nous avons là une confession qui précède la mort et la sanction qu'on s'inflige est avant tout une délivrance de cette vie désormais insupportable. Au-delà de l'absence de noms qui est un artifice parfois inutile, l'anonymat est important dans ces textes où les personnages principaux racontent leur histoire. Il donne sa tonalité de l'ensemble du recueil, un peu comme si, indépendamment de chaque contexte, tout cela ressortait de la condition humaine, appartenait à chacun d'entre nous simplement parce que, s'agissant de l'amour que nous avons tous un jour ou l'autre ressenti, cela ne peut pas ne pas nous parler. Dans ces trois nouvelles, l'amour est associé à la mort, c'est encore une fois Éros qui danse avec Thanatos dans une sarabande infernale . Il y a le personnage principal, celui qui parle et qui ressent les choses . Il est humilié par celui ou celle pour qui il éprouve de l'amour et qui le décevra forcément parce qu'il ou elle le méprise ou l'ignore, C'est souvent l'image de la condition humaine quand l'amour n'est pas partagé et qu'on met en scène des personnages orgueilleux et qui se considèrent comme supérieurs aux autres , se croient tout permis et ne peuvent donc frayer qu'avec leurs semblables en jetant sur le reste du monde un regard condescendant. Il y a de la folie dans tout cela, celle du médecin devenu « amok », celle de la femme inconnue qui n'a plus rien au monde , celle de ce pauvre homme qui veut croire que sa femme reviendra à lui alors qu'il finira par la tuer dans un geste désespéré.
Ces nouvelles sont une analyse de l'espèce humaine et notamment tout ce qui concerne la fierté. Le médecin commence par refuser son assistance à la femme parce que celle-ci ne veut pas le supplier de lui venir en aide. L'homme de la dernière nouvelle attend de son épouse qu'elle le remercie pour l'avoir sortie de la pauvreté et c'est aussi une certaine forme d'orgueil, conjugué il est vrai avec un amour fou, qui fait que la femme de la deuxième nouvelle refuse le mariage avec des hommes fortunés pour ne vivre qu'avec son enfant et le souvenir idéalisé de son seul amant. Il y a aussi cette incroyable légèreté de ceux qui se croient autorisés à infliger à leurs semblables toutes les vilenies avec cette volonté d'humilier l'autre, surtout quand il s'agit de son conjoint,. L'homme de la troisième nouvelle qui prend plaisir à rabaisser son épouse en lui refusant de l'argent est lui-même mortifié par elle quand il veut la reprendre.
J'ai, comme à chaque fois que je lis une œuvre de Stefan Zweig, apprécié à la fois le style fluide et agréable à lire de l'auteur autant que la finesse de l'analyse des sentiments et de la condition humaine.
© Hervé Gautier – Juillet 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Illusions dangereuses - Vitaly Malkin
- Le 06/05/2018
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1242
ILLUSIONS DANGEREUSES – Vitaly Malkin - Éditions Hermann.(Traduit et adapté du russe.)
Le récent Salon du Livre de Paris a accueilli l'écrivain russe Vitaly Malkin et son dernier ouvrage. J'ai personnellement toujours eu des interrogations sur la religion et dans nos sociétés, parler de ce sujet a toujours été tabou, d'autant plus que, la religion, qui a plus ou moins fait partie de notre éducation, n'a pas manqué de faire naître en nous illusions et fantasmes. Le livre de Vitaly Malkin, aimablement envoyé par Babelio et les éditions Hermann, ce dont je les remercie, ne pouvait donc pas me laisser indifférent, son sous-titre étant « Quand les religions nous privent du bonheur », la recherche de celui-ci étant une aspiration légitime de l'homme lors de son passage sur terre. Prendre pour thème la religion qui, en France en tout cas, semble être boudée par les citoyens, est une gageure face à la phrase attribuée à Malraux « Le XXI° siècle sera religieux ou ne sera pas ») et à la montée des fondamentalismes. C'est un ouvrage qui est d'abord un beau livre dans sa présentation, mais aussi un document important pas seulement par le nombre de ses pages (447) mais surtout par les arguments développés, la richesse de ses illustrations, l'érudition des citations choisies et le style simple et accessible avec lequel il est rédigé. L'auteur le présente comme un livre de combat, un pamphlet politiquement incorrect qui s'inscrit dans le droit fil des « Lumières » où les auteurs du XVIII° siècle n'ont pas hésité à remettre en question la religion et le pouvoir et l'influence de l’Église catholique. Il le veut un acte guerrier contre les pratiques inspirées par le monothéisme qui n'ont pour objet que de manipuler et asservir les fidèles pour mieux les dominer au moyen de rituels et d'interdits religieux. Ici l'auteur choisit de réfléchir dans le détail opposant les religions polythéistes de l'Antiquité, le bouddhisme, aux trois grands cultes monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam et jette sur chacun d'eux un œil critique formulant un avis personnel avec parfois une pointe d'humour. Pour faire bonne mesure, il étend même sa démonstration aux régimes totalitaires en mettant en perspective leurs méthodes.
Face à la croyance religieuse, à la foi, qui implique une adhésion aveugle et sans aucune preuve à des vérités souvent illogiques et même absurdes qui amènent les fidèles à vivre dans une complète illusion, l'auteur oppose la raison. Il note que le monothéisme de ces trois religions du Livre, présenté comme un progrès dans le domaine spirituel, contribue au contraire à l'appauvrissement de la raison et de la liberté de pensée, qui promet certes le bonheur, mais dans l'au-delà seulement, et conseille aux croyants pendant leur séjour sur terre l'observation stricte de règles censées leur garantir une place dans le Paradis, la soumission entière aux dogmes et la piété face aux manifestations surnaturelles qui ne peuvent émaner que de Dieu qui préside à la marche du monde, ce qui n'est pas sans engendrer des « Chimères ». Dans ces conditions on peut douter légitimement de l'amour de Dieu, si hautement proclamé, d'autant que les exemples ne manquent pas où la divinité s'est complètement désintéressée de cette humanité pourtant chérie et on ne peut pas ne pas constater que, contrairement à ce qui nous est répété à l'envi, les religions monothéistes sont plus tournées vers la mort que vers la vie. La tolérance est bien entendu sacrifiée et avec elle la raison ce qui n'est pas sans enfanter des violences et des conflits qui ont émaillé l'histoire du monde. L'auteur remet en cause les dogmes du catholicisme, y substitue une lecture plus logique et humaine que celle de l’Église, les analyse à travers l'histoire de l'humanité, en explique les dérives, les absurdités et les contradictions, dénonce nombre d'idées considérées comme immuables, voire utopiques et qui faisaient sans doute jusqu'à il y a peu la solidité de nos sociétés traditionnelles, en France notamment où les églises étaient pleines, la hiérarchie religieuse respectée et le message évangélique basé sur l'amour et la crainte de Dieu, observé. Face à cela l'auteur invite son lecteur au culte du plaisir, conteste l'ascétisme et l’abstinence sexuelle, la souffrance volontaire qui a longtemps été l'apanage du christianisme, le concept de sainteté, les symboles du Mal, refuse la virginité de Marie, tente une explication à propos de l'expulsion de l'homme du jardin d’Éden, prône l'épicurisme et le plaisir charnel, dénonce le principe selon lequel l’Église ordonne l'abstinence et condamne le sexe uniquement destiné à la procréations, étudie l'approche de la sexualité et la place de la femme dans ces trois croyances, évalue l'impact des religions sur notre vie, déplore l'instinct grégaire des fidèles si prisé par les religions, se désole du célibat des prêtes catholiques et encore plus de leur pédophilie et du silence qui l'entoure ...
On peut ne pas partager toutes les analyses faites par cet auteur, il faut cependant admettre qu'elles sont érudites et pertinentes et qu'elles ont le mérite de s'inscrire en faux face aux idées ancrées en nous depuis des siècles. A titre personnel, j'avoue avoir apprécié cette lecture.
© Hervé GAUTIER – Avril 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Pays de neige - Yasunari Kawabata
- Le 01/05/2018
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1241
Pays de neige – Yasunari Kawabata – Albin Michel.
Traduit du japonais par Bunkichi Fujimori.
C'est dans un wagon de chemin de fer que Shimamura, un homme entre deux âges, marié et père de famille qui va rejoindre la jeune geisha, Komako, dans une petite station thermale de montagne, croise le regard de Yôko, une jeune femme accompagnée d'un homme, Yukio, visiblement très malade. On ne dira jamais assez la magie des trains pour les rencontres qu'ils suscitent. Ce n'est certes pas le thème principal, mais je note que l'intrigue de « Tristesse et beauté » est également introduite par un voyage dans ce moyen de transport. Il y a bien du sortilège dans cette relation triangulaire subtile entre Komako, Shimamura, Yôko, ces trois personnages qui vont se croiser tout au long de ce roman, Yukio, quant à lui restant en retrait, au pas de la mort, mais dont la personne a également hanté Komako dans le passé. Shimamura doit sans doute être un bel homme qui ne peut oublier le regard envoûtant de Yôko comme par le son de sa voix suave et il se sent attiré par elle, cette attirance semblant réciproque mais tout en retenues cependant du côté de Yôko. Pour Komako, c'est un peu différent, elle cherche toujours la compagnie de Shimamura qui n'est pas un inconnu pour elle, mais quand son travail de geisha lui en laisse le loisir et elle se laisse même aller à l'ivresse du saké, ce qui donne d'elle une dimension différente. La relation entre les deux femmes n'est pas non plus exempte d'une certaine jalousie. La mémoire, et spécialement celle que l'amour irrigue, revient sous la plume de Kawabata comme une obsession, mais la thématique du temps qui passe, à travers le très japonais rythme et de l'harmonie de la nature et des saisons de « ce pays de neige », est ici également agréablement soulignée.
J'ai également retrouvé ce charme et cette musicalité des mots, parce que le style de Kawabata est toujours aussi épuré et poétique, surtout quand il évoque la nature apaisante et la beauté et la sensualité féminines qu'à la lecture de « Belles endormies » j'avais qualifié d'hymne à la femme. Mais, comme nous le rappelle Armel Guerne qui préface cet ouvrage, notre auteur est certes un poète, mais qui n'écrit pas de poésie, se limitant à des romans, véritables poèmes en prose, ce qui lui a valu le Prix Nobel de littérature.
La blancheur de la neige est aussi récurrente comme elle l'est dans « Premières neiges sur le Mont Fouji ». Il note son importance dans le blanchissage particulier des exceptionnels tissus de chanvre qu'on tisse dans ce pays. Il faut sans doute y voir une obsession de la pureté, tout comme l'eau dont elle est issue, qui sort ici directement de la terre, c'est à dire de la nature et qui est représentée sous la forme du bain qui non seulement est un rituel nippon mais aussi une sorte de hantise chez cet auteur, comme le symbole fort, une sorte de toilette qui débarrasse l'esprit de ses fantasmes et de ses obsessions.
La mort qui chez Kawabata est un sujet prégnant, puisqu'il a été très tôt orphelin de ses deux parents, perdit également les grands-parents à qui il avait été confié et se suicidera. Ce thème n'est pas absent de ce roman et qui est annoncé par Yukio dont l'état de santé donne des signes de faiblesse. L'embrasement de la fin du roman est comme un point d'orgue mis sur l'éphémère de la vie, sur son côté transitoire et aussi sur l'impossible amour entre Yôko et Shimamura. La solitude qui en résulte et qui fut celle de l'auteur ressurgit dans ce personnage, tiraillé entre ces deux femmes et sa propre famille. Jouant sur la symbolique des couleurs, Kawabata évoque la voie lactée mais aussi oppose à la fin le blanc immaculé du kimono de Komako au rouge du vêtement qu'elle porte en dessous et qui répond à l'embrassement des flammes qui vont mettre fin à la magie de « ce pays de neige », présenté comme une sorte d’Éden hors du temps, un véritable paradis perdu, autant qu'à l 'impossible amour qu'éprouve Shimamura pour Yôko.
© Hervé GAUTIER – Avril 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Et l'amour aussi a besoin de repos - Drago Jancar
- Le 12/04/2018
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1235
Et l'amour aussi a besoin de repos – Drago Jančar – Phébus.
Traduit du slovène par Andrée Lück-Gaye.
Tout commence par une carte postale de Maribor, une ville de Slovénie, pendant la Deuxième Guerre mondiale et la rencontre d'une jeune fille Sonja et Ludwig qu'elle a connu quelques années auparavant et qui est devenu officier SS. Elle compte sur lui pour faire libérer Valentin, son petit ami, qui a été arrêté en état d'ivresse par les Allemands à la suite d'une maladresse. Cette ville, près de la frontière autrichienne compte beaucoup pour l'occupant et Ludwig fait libérer Valentin qu'il espère ainsi utiliser pour infiltrer les réseaux de résistance. Malheureusement pour lui Valentin lui échappe et va rejoindre les partisans qui le connaissent et Sonja sera déportée à Ravensbrück. C'est donc l'histoire de trois jeunes gens que la guerre réunit et sépare. La mort rôde partout mais pourtant chacun d'eux survivra à cette guerre mais pas exactement de la manière qu'il imaginait. Le hasard se joue de leur vie qui n'est pas grand chose en ces temps troublés comme c'est le cas pour chacun d'entre nous. La chance en servira certains et en oubliera d'autres mais ils survivront aux hostilités et aux règlements de compte de l'épuration. C'est aussi un rapport de forces entre eux. Valentin a été arrêté par la Gestapo, mais est libéré par Ludwig qui souhaite grâce à lui infiltrer les réseaux de résistants qu'il rejoint cependant. Chez les partisans, on le soupçonne d'être un infiltré parce qu'on ne sort jamais vivant des prisons de la Gestapo, mais il devra imposé sa bonne foi et pour cela changer sa perception du monde. A cette occasion il ira à la rencontre de l'incompréhension, de l'absurde qui tuent aussi sûrement que l'ennemi en temps de guerre. Dans cet univers hostile ou la mort lui fait peur, la sienne probable et celle qu'il donne sur ordre ou pour continuer à vivre, lui est obligé d'obéir aveuglément, lui qui n'a pas été préparé à se battre. Il apprend à résister à la fois aux tortures des nazis et à la crainte d'être tué par les partisans qui doutent de lui. De son côté Ludwig, solitaire mais puissant, peut disposer de la mort et de la vie des gens, tant que le succès des armes est de son coté. Il cherche à séduire Sonja en contrepartie de cette libération mais la jeune fille est partagée entre sa volonté de sauver son ami et celle de ne pas le trahir. Après son arrestation, les camps brisent sa vie définitivement. Puis la victoire change de camp et Ludwig devient un fuyard traqué.
L'accent est mis sur la trahison qui est caractérise bien souvent l'espèce humaine à laquelle nous appartenons tous, trahisons pour survivre, par peur, pour obtenir des prébendes, des avantages, de l'argent, pour se donner de l'importance ou pour le plaisir de porter préjudice et ce genre d'époque les favorise. Dans cette aventure Valentin n'a pour boussole que le souvenir de Sonja dont il ne sait plus ce qu'elle est devenue. L'unique photo où ils sont représentés ensemble, celle « d'un couple heureux » comme leur a dit le photographe de rue qui l'a prise, la photo d'une histoire d'amour, a été perdue par Valentin et petit à petit Sonja devient pour lui cette amie irréelle à qui il a jadis écrit des poèmes et qu'il recherche à travers d'autres femmes. Il l'oubliera comme il oubliera ses serments d'amour pour le jeune fille parce sa vie l'aura entraîné ailleurs et que les choses sont ainsi. L'amour qui existait entre eux n'aura plus sa place dans aucune de leur vie et le temps passera pour chacun, avec les regrets et la mélancolie, puis l'oubli effacera tout. Comme à la suite de chaque guerre, la violence fait suite à la violence et la vengeance et la haine inspirent les hommes qui donnent ainsi libre court à leurs instincts destructeurs qui caractérisent bien souvent la condition humaine.
Ce roman douloureux a un goût de gâchis, comme bien souvent dans nos vies et ce malgré des moments de poésie.
Je ne connaissais pas cet auteur et je remercie Babelio et les éditions Phébus de m'avoir permis de le découvrir.
© Hervé GAUTIER – Avril 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Récits de la paume de la main - Yasunari Kawabata
- Le 02/04/2018
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1233
Récits de la paume de la main – Yasunari Kawabata (1899-1972)– Albin Michel.
Traduit du japonais par Anne Bayard-Sakai et Cécile Sakai.
C'est un recueil d'une soixantaine de courtes nouvelles écrites tout au long de la vie de l'auteur nobélisé en 1968. Dans ces textes il y a l'idée de la mort qui nous attend tous et du souvenir que laissent ceux qui ont existé, proches ou lointains, de ce qui reste d'eux après leur passage sur terre. Le titre lui-même, parlant de la paume de la main dans les lignes de laquelle, dit-on, est inscrit notre destin individuel, est révélateur, comme si la lecture de ces nouvelles donnait à voir aussi bien la simplicité de la nature, la beauté des femmes, la fragilité des choses de ce monde, l'épaisseur d'un rêve, la solitude de l'être humain, la fugacité du temps et le vertige qu'on peut ressentir en en prenant conscience, la brièveté de cette vie dont nous ne sommes que les usufruitiers et qui peut nous être ravie à tout moment. Cette fugacité est soulignée par la difficulté qu'à notre mémoire, le livre refermé, à fixer les anecdotes rapportées. La complexité du creux de cette main, la multiplicité de ses traits et le mystère de leur signification éventuelle reste une énigme, comme si toute notre vie y était résumée.
Ce sont des textes de toute une vie, à peu près sur quatre décennies, jetés sur le papier à l'appel de l'inspiration, d'une émotion, d'un fantasme ou d'une vision fugace parce que l'auteur en a été marqué et qu'il a voulu en conserver le souvenir. Les mots qu'il a pu mettre sur « ces choses de la vie », anecdotes réalistes, moments heureux ou douloureux, ont balisé sa propre existence, enfance, adolescence insouciantes ou marquées par le rêve, illustrant ou exorcisant son parcours. Cela a donné des nouvelles hétéroclites à la prose poétique dépouillée, intense et subtile à la fois, à la brièveté proche des haiku, tressées à l'invite de l’imaginaire ou de sa biographie comme des instantanés photographiques. On peut les lire comme des fables ou les apprécier comme des images fuyantes et ces nouvelles tranchent sur des romans comme « Les belles endormies »( la Feuille Volante n° 1203), « Tristesse et beauté »(la Feuille Volante n° 1209) ou « Premières neiges sur le mont Fuji »(la Feuillle Volante n°1202).
Les mots sont forcément plus forts que ceux du quotidien, le style plus dépouillé, parce que chargés d'une émotion qu'il a confiée à cette page blanche qui est pour lui, comme pour chaque écrivain, un défi autant qu'un confident mais beaucoup plus exigeant qu'il y paraît.
© Hervé GAUTIER – Avril 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Les chaussures italiennes - Henning Mankell
- Le 04/03/2018
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1223
Les chaussures italiennes – Henning Mankell – Seuil.
Traduit du suédois par Anna Gibson.
En prenant ce roman sur les rayonnages d'une bibliothèque, je pensais entrer encore une fois dans l'atmosphère du roman policier dont Mankel est le créateur. J'ai toujours apprécié l'ambiance créée par lui, le personnage de Kurt Wallander, policier humain et désabusé, le dépaysement de ces ouvrages... Cette chronique s'en est souvent fait l'écho. Rien à voir cependant avec une enquête policière cette fois, mais je n'ai pas regretté.
En deux mots cette histoire évoque un chirurgien suédois de soixante-six ans, Fredrik, venu s'exiler sur une île de la Baltique parce que culpabilisé par une erreur médicale, une amputation inutile, faite par erreur douze ans plus tôt et qui a mis fin à une carrière qui aurait été brillante. Il y vit seul, dans une vielle maison de pêcheur qui a appartenu à ses grands-parents, en compagnie de deux vieux animaux, une chienne et une chatte et… une fourmilière envahissante! Son activité se résume à faire des trous dans la glace pour s'y baigner et à tenir le journal d'une vie qui a tourné court et qui finit par être une chronique de la météo du jour et de simples annotations brèves, presque incompréhensibles. Il n'a pour tout contact avec le monde extérieur que la visite de Jason, un facteur hypocondriaque et curieux qui le prend pour son médecin traitant. Autant dire qu'il attend la mort. Tout au long de ce récit Fredrik écrira et recevra des lettres, seul vrai moyen qu'il a choisi, même à l'époque du téléphone portable, pour correspondre avec ses semblables. Malgré son retrait du monde, vient à lui Harriet, une femme qu'il a jadis aimée puis abandonnée, mais qui ne l'a jamais oublié. Elle est vieille et malade d'un cancer et ils vont faire ensemble un dernier voyage, parce qu'elle exige qu'il tienne une vielle promesse. Son obéissance servile ressemble un peu à un chemin de Canossa et est à la mesure du remords qu'il éprouve et du pardon qu'il espère. Lui qui n'a jamais eu d'enfant, apprend qu'il est le père de Louise, une femme maintenant adulte, pour qui il ne peut avoir les sentiments qu'on ressent face à un enfant, et qui est la fille d'Harriet. Ce fait va bouleverser sa vie et ses projets. Ce n'est cependant pas la seule femme qui va débouler dans sa vie et la bouleverser mais la coïncidence n'est pour rien dans la rencontre qu'il fait d'Agnes, la femme qu'il avait amputée par erreur d'un bras et aussi ruiné sa carrière de nageuse de haut niveau. D'elle aussi il attend un pardon.
Il y a beaucoup de décès (humains et animaux) tout au long de cette histoire, la camarde qui rôde autour de lui parce que la mort est la seule chose qui en ce monde est certaine, mais aussi de solitude, d'abandon de regrets et de remords. La mort, il nous est simplement possible d'y faire échec avec des rituels et la permanence de la mémoire, encore est-elle limitée à la durée de notre propre vie. Pourtant, à son âge et dans son état d'isolement Fredrik pensait qu'il était enfin en règle avec sa vie et qu'il pouvait oublier toutes ses trahisons, comme si le temps était capable de tout abolir, de tout réguler, mais ce sont des femmes qui vont se charger de rafraîchir sa mémoire et surtout de raviver sa culpabilité. Il est donc question de pardon qu'il obtiendra peut-être avant de mourir à son tour. Ce ne sera pas simple, à l'aune sans doute de ses mensonges et de ses oublis. Il sera accordé, simplement parce qu'il le demande, avec sincérité et repentance, par celles à qui il a porté préjudice. Nous faisons en effet du mal par action mais aussi par omission, sans pour autant le vouloir effectivement. Tout cela prendra du temps et la ronde des saisons, avec son alternance de canicule et de glace, est là pour souligner ce long cheminement, avec le temps fort des solstices. Il pourra mourir sereinement, assuré de s'être racheté.
Je ne m'attendais pas à ce genre de roman mais je l'ai trouvé tout à la fois passionnant et émouvant, fort bien écrit et agréable à lire. .
© Hervé GAUTIER – Février 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com
-
Marx et la poupée - Maryam Madjidi
- Le 02/03/2018
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1222
Marx et la poupée- Maryam Madjidi – Éditions Le Nouvel Attila.Goncourt du premier roman 2017
La petite Maryam vit les premières heures de la révolution iranienne depuis le ventre de sa mère qui doit, enceinte, sauter du 2° étage pour ne pas être capturée. Puis, six ans plus tard elle rejoint ses parents à Paris et raconte ses souvenirs. Cela commence plutôt bien, l'expression "il était une fois" souvent répétée, évoque une belle histoire voire carrément un conte de fées. Pourtant la petite fille qui parle n'est pas vraiment ravie de ce qui lui arrive puisqu'elle doit quitter son pays. Pour cela elle doit donner ses jouets aux enfants du quartier de Téhéran où elle habite parce que ses parents communistes l'ont décidé ainsi et que pour eux la propriété est bannie de leur vie. De toute manière elle n'aurait pas pu les empoter dans ses valises. C'était pourtant des cadeaux de sa grand-mère qu'elle aime tant. C'était pourtant aussi des livres pour enfants.
On peut lire ce livre comme une fable ou comme un journal écrit cependant en français, langue qu'elle rejette au début parce qu'elle symbolise l'exil, l'abandon de son pays et de sa famille mais qu'elle s'approprie au point de l'utiliser pour écrire ce témoignage. Le français est à la fois le symbole de la liberté absente de l'Iran mais aussi de l’accueil des étrangers. Nous sommes donc avec cet ouvrage, en plein symbole. Pourtant il y a une réalité et une question. Comment devenir une autre personne tout en restant soi-même, sans rien oublier de ses origines? Pour l'auteure, l'apprentissage du français a été cette réponse en ce sens qu'elle a adopté cette langue, d'abord par nécessité, pour se faire comprendre, pour vivre en France et aider ses parents dans leurs démarches administratives, puis ensuite par goût puisqu'elle a choisi d'exprimer son témoignage dans cette langue et de le faire sous le forme de l'écriture. Cela ne signifie par pour autant qu'elle a choisi de tirer un trait sur son passé et sur sa culture originelle qui sont une sorte de refuge parce que la mémoire est partie prenant de la vie, surtout pour un écrivain qui ainsi confie aux mots et à la page blanche tout ce qu'il a été avant. C'est un peu comme une nouvelle naissance, sans rien oublier, sans renier sa langue maternelle au profit de la langue de l'exil …Il y a pourtant un paradoxe qu'elle incarne et dont elle joue en tant qu'étrangère. Elle en rajoute même un peu dans la poésie persane qu'elle cite à l'envi. Elle devient conteuse, incarne l'exotisme, la magie de l'orient, folklore de senteurs et de voiles, une sorte de fantasme collectif entretenu à travers la littérature et la peinture françaises pour un auditoire déjà conquis. Qu'on le veuille ou non, elle est porteuse, en tant qu'exilée, d'une charge émotionnelle et culturelle qu'un Français souhaite connaître, ce qui entraîne une foule de questions. Elle aime se présenter comme quelqu'un de différent, une femme qui vient d'ailleurs et qui se cache en permanence derrière un masque qu'elle donne à voir et qui la dissimule. Elle prétend vouloir qu'on lui pose des questions inattendues et qui révéleraient un message plus politique, plus quotidien qu'est par exemple la condition des femmes qui, dans ce pays, vivent sous la dépendance des hommes et de la loi islamique, ce qui fait d'elles une cible de choix, uniquement destinées à mettre des enfants au monde et à rester cantonnées dans un rôle domestique. En Iran, le combat contre le régime des Ayatollahs est un combat pour la liberté, ce qui est d'autant plus vrai pour les femmes. C'est aussi un thème de réflexion qui ici est offert à propos de la politique, de la liberté, de la démocratie et l'usage qu'en font les gouvernants qui, une fois élus, se dépêchent de faire le contraire de ce qu'ils avaient promis. Cette forme de confiscation touche tous les régimes de tous les pays, et en cela ce livre a un côté universel.
Il y a tout dans cet ouvrage, de l'autobiographie, de la fiction, des témoignages, de la poésie, et on peut se demander en quoi ce livre est un roman. Nous savons depuis longtemps que la littérature n'a aucun compte à rendre à la réalité, qu'elle ne s'inscrit ni dans un essai politique ou sociologique ni dans un récit authentiquement historique et fait la part belle à la fiction et même au délire. Dans sa démarche créatrice, l'auteur puise l'essence de son œuvre autant dans son vécu, dans sa souffrance, dans ses souvenirs personnels et parfois ses rancœurs et ses remords que dans ses fantasmes ou dans son imaginaire. La littérature est un monde à part dans lequel le lecteur entre ou n'entre pas, le décor qui est tissé tient entre les pages d'un livre et permet l'évasion, ou pas, suivant le degré de disponibilité de celui qui le tient entre ses mains.
© Hervé GAUTIER – Février 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com
-
Tristesse et beauté - Yasunari Kawabata
- Le 23/01/2018
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1209
Tristesse et beauté – Yasunari Kawabata – Albin Michel.
Traduit du japonais par Amina Okada.
Oky est un écrivain célèbre, dans la maturité, qui prend seul le train pour Kyoto en cette fin d'année dans l'espoir incertain, après plus de vingt années de séparation, de retrouver Otoko qui fut il y a bien longtemps sa très jeune maîtresse. Il était à l'époque déjà marié et père de famille, mais l'enfant qu'il avait eu avec Otoko était mort-né et la jeune fille avait tenté de se suicider. Cet épisode avait donné un roman autobiographique à succès pour Oky et avait fait de lui un écrivain reconnu. Elle est maintenant une artiste peintre reconnue, demeurée célibataire et vit avec Keiko, son élève, une jeune fille d'une étonnante beauté et qui voue à son professeur une grande dévotion. Elle considère que Oki est le seul responsable de la destruction de la vie d'Otoko et envisage une vengeance d'autant plus étrange que personne ne lui a rien demandé, que la jalousie qui semble en être le moteur est quelque peu étonnante et que, à l'évidence, Otoko est encore amoureuse d'Oky. Cette punition est d'autant plus subtile qu'elle ressemble au style abstrait de Keiko qui donne à voir dans ses peintures autre chose que la réalité perçue par le commun des mortels.
Un quatrième personnage, Fumiko, l'épouse d'Oki, a mal vécu le succès littéraire de son mari puisque qu'il est inspiré par un adultère de ce dernier mais a pourtant profité de l'aisance financière qu'il lui a apportée lui a apporté, mais on sent bien qu'elle n'a pas oublié la trahison de son mari. Comment aurait-elle pu l'oublier d'ailleurs ? Quant au pardon toujours possible, cela n'a toujours été pour moi qu'un invitation à recommencer, une dangereuse position dans le contexte de l'espèce humaine, volontiers inconstante, et à la quelle nous appartenons tous.
Le livre refermé, j'ai un peu de mal a me forger un avis sur ce roman au dénuement prévisible, sans doute à cause de la pudeur avec laquelle chaque personnage est décrit et ce malgré l'indéniable dimension érotique de certains passages. C'est sans doute là un trait de la culture nippone qui m'est étranger. En tout cas, j'ai perçu quelque chose d'universel, une forme de vertige, comme ce qu'on ressent quand on prend conscience du temps qui passe, qu'on se remémore les choses importantes ou au contraire minuscules qui se sont produites dans notre vie et la façon dont nous les avons abordées. Alors reviennent avec une netteté étonnante notre naïveté, notre complicité inconsciente, notre incompréhension, notre précipitation dans le vécu de ces événements qui maintenant appartiennent au passé et qu'on regrette. C'est très humain mais m'est revenue cette impossibilité de remonter le temps dont nous subissons la course inexorable. La méditation sur la mort qui s'ensuit est incontournable, sur l'éphémère des choses humaines, sur la beauté comme sur l'amour.
Nous savons qu'un écrivain puise dans sa vie et ses souvenir l'essence même se son œuvre. Tout au long de ma lecture, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que l'ensemble de l’œuvre de Kawabata est baignée par les personnages féminins qui doivent sans doute leur présence à l'émotion que ressentit l'auteur, encore tout jeune garçon, quand, lors du passage d'un cirque ambulant, il croisa une danseuse d'un grande beauté. Plus tard, quand il était étudiant, il tomba sous le charme d'une jeune serveuse qu'il voulut épouser mais avec qui il rompit cependant. Je n'ai pas pu oublier non plus que Kawabata a choisi de se suicider.
J'ai abordé l'ouvre de Kawabata à propos Du roman « Les belles endormies » (La Feuille Volante n °1203) qui m'avait bien plu. Je ne suis pas aussi enthousiaste avec celui-ci.
© Hervé GAUTIER – Janvier 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
La petite pièce hexagonale - Yoko Ogawa
- Le 15/01/2018
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1204
La petite pièce hexagonale – Yoko Ogawa – Actes Sud.
Traduit du japonais par Rose-Marie Makino-Fayolle.
Le mal au dos est le mal du siècle et en tant que secrétaire, la narratrice en souffre. C'est donc tout naturellement que son médecin lui conseille la piscine, lieu où elle rencontre par hasard Midori, une inconnue aussi banale que silencieuse qu'elle croise quelques jours plus tard accompagnée d'une vieille dame. Elle les suit jusqu'à une loge de concierge d'immeuble où elles semblent attendre leur tour. Le plus étonnant est que la plus âgée entre dans une haute armoire qui donne accès à un espace hexagonal, « la pièce à raconter ». Cela m'évoque à la fois le rituel de passage d'un monde à un autre autant que ces grandes armoires qui étaient souvent le refuge des enfants mais on peut tout aussi bien y voir la silhouette d'un confessionnal. C'est le début d'un récit assez surréaliste où cette femme, à travers un monologue et dans cet espace restreint, confie au silence, ses préoccupations les plus intimes et son appétence pour la vie solitaire.
J'ai lu ce court roman comme une fable philosophique mais je suis assez peu entré dans le récit personnel de cette femme, de son histoire chaotique et finalement désastreuse avec Michio, son amant et de son mal au dos chronique qui est peut-être la marque de sa culpabilité au regard de son couple. Finalement la haine qu'elle porte à cet homme pourtant prévenant, patient et bien entendu amoureux d'elle, est incompréhensible mais sa démarche intimiste de parole dans « la pièce à raconter » n'apporte aucune explication. De même pour la réflexion, d'ailleurs assez rapidement menée, sur le destin et le hasard qui est une interrogation traditionnelle autant qu'une énigme récurrente sur le sens de la vie et qui restera sans doute définitivement sans réponse. En revanche, je me suis intéressé au phénomène de la parole dont je ne suis plus très sûr qu'elle soit aussi libératrice qu'on veut bien le prétendre. Qu'elle soit, comme c'est le cas ici, exprimée sous forme de monologue traduit, à mon sens, davantage un phénomène de société où l'individu est de plus en plus seul, ou qu'elle prenne la forme un peu plus ambiguë de l'écriture qui est une autre manière de parler tout seul. Je note que, dans une société où le partage de la parole est de plus en plus grand, le soliloque me paraît bizarrement très répandu et les gens se sentent de plus en plus solitaires, même au sein de la famille et du couple. J'en veux pour preuve la pratique de plus en plus grande de l'écriture notamment grâce notamment aux réseaux sociaux. Chacun s'y exprime souvent à titre personnel sans qu'il y ait vraiment d'échanges constructifs et cela débouche souvent sur la polémique. Auparavant on confiait le rôle d'écoutants aux curés de paroisses à travers la confession mais la réponse qui était donnée, inspirée par la parole de Dieu, supposait la foi religieuse et l'observation des sacrements, autant que la nécessité de se libérer de ses fautes en les avouant, pratique qui de nos jours est bien émoussée. Maintenant que les églises sont vides et qu'on se méfie des ecclésiastiques, d'ailleurs de plus en plus rares et qui faillissent à leur mission, ce rôle est dévolu aux psychiatres qui s'acquittent de cette tâche avec des résultats parfois inégaux. De plus en plus les individus éprouvent le besoin de combler par la parole solitaire le vide de leur existence.
Je ne sais comment s'en tirera cette narratrice après le départ de cette « pièce à raconter » qui est itinérante, ce qui traduit bien son rôle qui se veut universel. Je ne sais pas comment interpréter la haine qu'elle porte à son ancien amant ni les relations éphémères qu'elle a eues avec le céramiste mais elle avoue elle-même qu'elle a agi ainsi « pour s'enfoncer de plus en plus dans (la) boue de sa conscience ». La résilience qui fait aussi partie de la vie et de la thérapie a en elle-même des ressources insoupçonnées qui viendront sans doute à son secours à moins que sa propre mauvaise foi et l’auto-persuasion ne l'aident aussi pour la convaincre de la haine qu'elle porte à Michio est exclusivement de sa faute à lui.
Au départ, ce récit m'a séduit par son originalité mais rapidement, nonobstant le style agréable à lire, j'ai vite décroché, à cause sans doute des questions soulevées et qui restaient en suspens ou de la fin du récit un peu trop facilement précipitée.
© Hervé GAUTIER – Janvier 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Les belles endormies - Yasunari Kawabata
- Le 13/01/2018
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1203
Les belles endormies – Yasunari Kawabata [1899-1972]– Albin Michel.
Traduit du japonais par René Sieffert – Illustrations et photos Frédéric Clément.
L'immeuble dans lequel pénètre le vieil Eguchi est une sorte d'auberge où tout est silencieux sauf le bruit des vagues qu'on entend dans le lointain. Les règles qui la gouverne sont étranges et pour éviter des dérives, il convient de ne pas y déroger. De vieux messieurs y viennent pour dormir aux côtés de jeunes filles nues, elles-mêmes endormies grâce à la drogue de sorte qu'elles restent inconscientes toute la nuit, ne seront réveillées qu'après le départ de leur client et ne sauront donc jamais avec qui elles ont passé la nuit. Il ne s'agit pour autant pas d'un vulgaire lupanar puisque le vieillard doit impérativement dormir auprès de la jeune fille en la respectant. Eguchi viendra plusieurs fois dans cette maison, se risquera même à enfreindre légèrement les règles non écrites au risque de se voir refuser l'accès à cet établissement, envoûté et tenté qu'il est par la beauté de corps de la jeune fille mais, n'étant plus capable « de se comporter en homme », il devra se contenter de la regarder, de l'effleurer toute en respectant son sommeil. C'est une situation un peu ambiguë que celle-ci puisque la jeune fille reste provocante par sa nudité, sa virginité, l'odeur de sa peau, elle bouge voire parle un peu à l'invite d'Eguchi et l'interdit qui s'impose à lui lors de ces séances nocturnes réveille ses regrets de jeunesse et accentue son actuelle décrépitude. Pour autant la règle de cette maison veut qu'il s'endorme à son tour et qu'il se réveille avant la jeune fille et parte.
Les partenaires qui sont dévolues à Eguchi sont de très jeunes filles d'une beauté sensuelle mais lui-même n'est plus capable « de se comporter en homme » en face d'une femme, aussi les effleure-t-il des yeux et des doigts en ayant soin de respecter leur sommeil. Pourtant, les sensations visuelles et olfactives qu'il ressent réveillent chez lui des souvenirs amoureux qu'il croyait définitivement enfuis de sa mémoire, mais aussi un sentiment de honte et de gêne. Il avait croisé beaucoup de femmes dans sa vie, qu'elles aient été conquêtes d'un soir ou prostituées mais il gardait d'elles l'image indélébile de leur beauté, de leur sensualité qui se réveillaient à cette occasion, avant de sombrer lui aussi dans un sommeil artificiel chargé de songes et parfois de fantômes. Ses nuits ont cependant été chastes ainsi qu'il convient dans cette maison mais ses souvenirs autant que ses séances nocturnes lui donnent l'intuition de la solitude d'autant plus grande qu'il ressent, comme chacun de ces hommes âgés qui se retrouvent ici, l'impossibilité de rendre à une femme le plaisir qu'elle donne dans l'étreinte. Pire peut-être cette impression de déréliction est exacerbée par le fait qu'ils ressentent du désir pour une jeune et jolie fille qui doit rester assoupie et qu'ils doivent dormir à ses côtés sans pouvoir assouvir leur libido et ce d'autant plus qu'ils ont dû être jadis des amants fougueux. Ils sont le plus souvent veufs ou célibataires, c'est à dire à cause de leur âge délaissés par les femmes et abandonnés à eux-mêmes. Ainsi Eguchi a la certitude que pour lui une page est définitivement tournée, qu'il arrive au terme de quelque chose et qu'il se pourrait bien qu'il dorme ici « d'un sommeil de mort ». Cela l’obsède au point de devenir un tourment, sans doute parce que le sommeil est effectivement l'antichambre de la mort et que, dans son cas comme dans celui de ses autres confrères, le trépas qui est l'inévitable issue de sa vie, peut être rendu plus doux par l'ultime partage d'une nuit, même chaste, aux côtés d'un femme sensuelle. Ainsi la pulsion qu'il ressent se transforme-t-elle en dégoût d'une vie finissante, en ce mal-être que prête la fuite du temps, en une réflexion amère sur la vieillesse, en une indignation face à la camarde qui frappe au hasard.
C'est un texte intensément érotique, tout en retenue où l'auteur souligne à l'envi les traits fins d'un visage, la blancheur d'une peau, l'odeur fascinante d'un corps nu, la pulpe des lèvres, la fluidité d'une chevelure, la rondeur d'un sein, le galbe d'une hanche, la finesse d'une attache, mais à travers l'incontestable charge sensuelle et poétique du texte, j' ai surtout lu une ode au corps des femmes, un hymne à leur beauté. C'est un texte somptueux illustré de photos et dessins non moins évocateurs de Frédéric Clément.
J'ai rencontré Kawabata par hasard et la première impression m'avait surpris (la Feuille Volante n°1202). Je dois dire que j'ai été conquis par cette deuxième approche.
© Hervé GAUTIER – Janvier 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Première neige sur le Mont Fuji - Yasunari Kawabata
- Le 09/01/2018
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1202
Première neige sur le Mont Fuji – Yasunari Kawabata [1899-1972]– Albin Michel.
Traduit du japonais par Cécile Sakai.
Je dois avouer que je suis assez peu versé dans la culture et la littérature japonaises, aussi bien ai-je lu ce recueil de ces six courtes nouvelles, écrites entre 1952 et 1960, comme une découverte de cet écrivain qui fut Prix Nobel de littérature en 1968.
L'art de la nouvelle est difficile et colliger des textes en vue de leur publication est un exercice délicat qui ne procède ni du hasard ni de l'humeur passagère. D'autre part, avoir entre les mains le livre d'un auteur qui a été consacré par le Prix Nobel de littérature m'impose des réflexions personnelles d'autant plus que ma lecture est une découverte. Le livre refermé, j'avoue être un peu circonspect face à ces textes d'où se dégagent des thèmes qui ne procèdent pas, dans le cas de Kawabata, de la simple fiction mais ont une connotation nettement autobiographique et personnelle puisque, comme tout écrivain, il puise dans sa vie et ses souvenirs la substance même de son œuvre. Sous sa plume, comme un exorcisme, reviennent ses obsessions, ses fantasmes qu'il extériorise et matérialise avec des mots, des situations imaginées qui, parfois malgré lui peut-être, lui font plus facilement supporter ses épreuves et ses craintes.
Il y a chez lui une hantise de la guerre et sûrement du traumatisme d'Hiroshima, des séparations qu'elle entraîne et avec elle la solitude définitive, des couples qui se défont à cause d'elle, l'histoire de vies qui auraient pu être belles mais qu'elle a bouleversées. Cette rupture dans leur lien sentimental évoque peut-être un épisode de sa propre vie, la mort aussi, et singulièrement celle d'un enfant, parce qu'ainsi l'avenir s'effondre. Cette lecture attentive me donne également à penser que les symboliques n'en sont pas absentes, celle de l'eau d'un établissement de bains où se retrouvent deux anciens amants que la vie a séparés(« Première neige sur le Mont Fuji »). Ils tenteront par le bain, comme un rituel, de se débarrasser de ce passé délétère mais n'y parviendront pas et repartiront chacun de leur côté, illustrant ainsi une pensée d'Albert Camus selon laquelle on ne peut connaître à l'âge adulte les joies qui ont enchanté notre jeunesse. Même la présence de la montagne sacrée en pointillés, n'y fera rien. Le passé est bien l'idée maîtresse de cette anthologie.
Il me semble qu'il y a aussi une évocation de la difficulté d'écrire pour un écrivain, d'exprimer ses sentiments avec des mots. Ce thème me paraît être abordé dans cette nouvelle (« En silence ») qui met un scène un vieil écrivain qu'une attaque empêche définitivement de s'exprimer par oral ou par écrit. C'est non seulement ces périodes de sécheresse créatives, parfois définitives, qui menacent l’auteur qui sont abordées ici, mais aussi peut-être la difficulté définitive d'exprimer ses émotions, de mettre des mots sur ses maux ou peut-être l'ébauche d'une des sources cachées de l'écriture qu'on peut analyser comme « la mémoire héréditaire », une forme particulière de l'inspiration. Le temps qui passe, vu à travers le très japonais rythme de la nature et des saisons, et avec lui la joie des premières années, l'amour évanoui, la jeunesse définitivement enfuie et la mort à venir, sont des thèmes également abordés à travers la présence du fantôme d'une femme qui accompagne le visiteur du vieil homme (« En silence ») ou celui de cette autre vieille grand-mère qu'il rencontre en revenant dans son village d'enfance longtemps après l'avoir quitté(« Terre natale ») ? Est-il obsédé par la famille et par sa fragilité, lui qui a très tôt été orphelin de père et de mère, par les présences féminines, (sa mère, sa sœur et sa grand-mère) qui ont disparu prématurément de sa vie, par la fidélité entre époux, par l'adultère, par la trahison d'autant plus injuste qu'elle vient d'un proche (« Goutte de pluie »), par le suicide qu'il choisira lui-même pour mettre fin à sa vie ? D'autres nouvelles, comme « Une rangée d'arbres » veulent sans doute souligner la fuite du temps et son action sur les choses, le poids du passé tandis que « La jeune fille et son odeur » insiste sur l'innocence des enfants qui souffrent des méfaits perpétrés par les adultes.
La lecture de ses nouvelles me laisse quelque peu perplexe, plus angoissé que vraiment passionné par ma découverte, étonné peut-être par le style très épuré, par une esthétique différente de la nôtre
© Hervé GAUTIER – Janvier 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Certains souvenirs - Judith Hermann
- Le 26/12/2017
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1197
Certains souvenirs – Judith Hermann – Albin Michel.
Traduit de l'allemand par Dominique Autrand.
L'auteure renoue avec l'art de la nouvelle qui l'a révélée.
J'avoue bien volontiers qu'avant que Babelio et les éditions Albin Michel, que je remercie, ne me fassent parvenir ce recueil, je ne connaissais pas Judith Hermann. Je l'ai donc découverte et ce fut une surprise, surtout eu égard aux éloges de la presse. Pourtant ce ne fut pas comme d'habitude et mon étonnement fut d'une autre nature. Ici, ce qui est décrit est plutôt un univers connu et quotidien, loin des fictions où on nous raconte que la vie est belle ou qu'elle est un long fleuve tranquille. Il suffit, pour s'en convaincre, d'ouvrir les yeux sur le monde, de prendre conscience de l'injustice, de l'hypocrisie et de la violence qui y règnent. Convoquer les mots pour le dire, même au moment de Noël où l'on préfère le merveilleux, ne me gène pas. Je dois le dire, j'ai été surpris par ces nouvelles, et notamment par le style, délibérément abrupt, simple, sans fioritures littéraires, presque brutal, avec un luxe de détails ou au contraire une sorte de précipité d'images sommaires, avec aussi parfois des moments poétiques d'autant plus appréciés qu'ils sont inattendus. Je respecte cette option puisqu'elle procède sans doute de l'effet cathartique de l'écriture qui est pour l'auteur une motivation essentielle.
Judith Hermann évoque effectivement des souvenirs, comme le font la plupart des auteurs qui puisent dans leur vie la substance de leur œuvre. Les mots servent souvent à décrire des situations ordinaires, banalement quotidiennes où règnent le désordre et même parfois la folie. Ils naissent de la mémoire sollicitée, de rencontres de gens qu'on a oubliés depuis longtemps ou que l'on croise. Parfois une photo ravive la mémoire et les personnages sur papier glacé s'animent pour un moment, avec la nostalgie, les regrets en prime et la prise de conscience du temps qui passe et qui nous donne le vertige quand nous tentons d'en remonter le cours. Tout cela suscite des dialogues convenus où l'on brasse des informations ou des évidences, où l'on évoque des moments souvent intimes, habituels, comme volés aux personnages, des tranches de vie décisives ou anodines, des conversations qui souvent sont banales, des échanges où chacun se cache derrière des paroles, des petits gestes, des instants fugaces qui font la vie simple et dont les mots et les phrases, simples aussi, rendent compte.
Ce sont dix-sept courts textes, des portraits et des situations vus à travers les yeux de la narratrice, une vie ordinaire, intime ou populaire, des mariages qui prennent l'eau et qu'on regrette amèrement, des familles qui se décomposent sous les yeux des parents qui auraient voulu inventer autre chose, des amours qui ne durent pas toujours, des vies qu'on a données parce que c'est le point de passage ordinaire et peut-être obligé de chacun, des circonstances dont on a du mal à comprendre comment elles se sont installées au fil du temps ou des événements, du chômage ou des petits boulots mal payés et dévalorisants qu'on recherche cependant, des familles monoparentales au quotidien difficile à vivre, de l'avenir qu'on imagine forcement meilleur, les apparences qu'on entretient au nom de la tartuferie ou d'une improbable amélioration, des jours gris qu'on repeint à grands coups de chimères ou d'alcool, parce que cela aide à supporter la vie et parce qu'il n'y a souvent pas d'autres réponse, et peut-être parce que les mots des autres ne servent plus à rien. Ces sollicitations de la mémoire entraînent l'imaginaire ou une démarche malsaine où l'on s’immisce dans la vie de l'autre pour le plaisir d'en savoir plus sur lui, sur ses fêlures, sur ses zones d'ombre et les interrogations qu'il suscite. Des êtres se rencontrent et d'autres se quittent, des couples se forment et se défont, moments cruciaux ou ordinaires où le bonheur n'est pas toujours au rendez-vous d'une vie qu'on voyait autrement, qui s'est souvent déroulée au rythme du hasard, de la malchance, qui aurait pu être belle mais ne l'a pas été, à cause des mauvais choix qu'on ne referait plus et qu'on déplore. Dans ce monde tel qu'il est évoqué, le temps passe aussi et c'est d'ailleurs à cause de cette fuite que naissent et se forment les souvenirs, mais aussi les regrets et les remords même si, inconsciemment nous faisons un tri pour n'en retenir que certains, bons ou mauvais, plus forts ou plus marquants que les autres, certains flous ou étonnamment précis. Cette lecture me laisse une sorte d'impression nostalgique, un malaise ou un mal-être un peu désagréable, une atmosphère de solitude, de mélancolie et de mort qui rode, mais quelque chose de forcément vécu, quelque chose d'humain.
Le livre refermé, je dois dire que j'ai été surpris par ce recueil, davantage par la façon de s'exprimer de cette auteure et que par les thèmes qu'elle a choisis de traiter. Malgré cela, malgré moi peut-être, malgré mon goût pour le beau langage, cette démarche ne me laisse pas indifférent, peut-être parce que cette manière d'évoquer le monde qui nous entoure, avec tout ce qu'il a d'abrupt, de violent, d'injuste, de révoltant ne peut laisser un lecteur indifférent. Ai-je compris le message ou suis-je passé à côté ?
© Hervé GAUTIER – Décembre 2017. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
L'été infini- Madame Nielsen
- Le 22/11/2017
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1188
L'été infini – Madame Nielsen – Notabilia.
Traduit du danois par Jean-Baptiste Coursaud.
Je suis peut-être de la vieille école, mais j'aime les phrases courtes. Ici c'est plutôt le contraire et je dois bien reconnaître que cette manière démesurément longue de s'exprimer, à l'image du texte labyrinthique qui doit sans doute être lu sans désemparer faute d'égarer le lecteur, m'a un peu dérouté. Je dois d'ailleurs déplorer cette habitude qui semble s'installer dans les romans, d'adopter cette manière, un peu fastidieuse à mes yeux, d'écrire désormais. C'est dommage parce que, au début, ce livre avait attiré mon attention et mon intérêt pour cette histoire dont j'ai vite perdu le fil. Pourtant il y a de belles images, un souffle de vie, entre ombres et lumières, des analepses parfois oniriques, des allusions pleines d’ambiguïtés, une histoire d'amour qui n'est pas banale. C'est aussi un roman sur le destin et la fatalité qui sont des thèmes récurrents et toujours passionnants, une histoire qui parle de la jeunesse, cette période que nous avons tous vécue, pendant laquelle on s'ouvre au monde, où tout semble possible, l'amour et le reste, où la beauté s'impose, où le temps ne compte pas et qui ressemble à « un été infini ».
L'auteure raconte, dans les années 1980 , l'histoire d'une famille danoise un peu étrange qui vit dans un manoir reculé, un beau-père taciturne qui finit par disparaître, une mère non moins bizarre qui passe ses journées à cheval (elle mettra à profit l'absence de son mari) et des enfants un peu laissés libres de vivre leur vie d'artistes. Il est question d'amour, d'insouciance, de jeunesse , de beauté, de temps comme suspendu, mais la mort plane qui gagnera à la fin, comme toujours, parce qu'ainsi va la vie.
Qu'est ce qui m'a fait poursuivre ma lecture alors que j'avais bien envie de l'arrêter ? Peut-être l'épilogue à venir qui est toujours un mystère dans le cadre d'une fiction, peut-être l'image fugace et mystérieuse de ce jeune garçon gracile qui devait porter en lui autre chose que de la banalité ?
Ce roman est sous-titré « Requiem », une pièce de musique que je n'ai pas perçue comme telle, peut-être à cause de la traduction du danois au français, peut-être parce que mon oreille n'est pas assez exercée, mais qui appartient à un rituel qui est aussi associé à la mort. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, cet « été infini » reste en effet un mythe et le quotidien ordinaire et banal, avec ses hasards, ses échecs et les remords qu'il suscite reprend ses droits. Le temps qui passe avec son lot de solitude et d'abandon, de rides, de douleurs et de corps décrépis, pèse sur les humains, instille la maladie et la mort. Elle fait partie de notre parcours, en est simplement la fin parce que nous ne sommes ici que de passage, simples mortels, usufruitiers de notre propre vie.
Je me suis aussi interrogé sur le prénom de l'auteure, un peu mystérieux, dont la signification est révélée par la notule du début et qui peut sans doute expliquer à la fois cette envie d'écrire et cette manière de le faire, une sorte de thérapie face à ce tourment réel qu'à été cette longue attente et cette réflexion sans doute douloureuse avant l'opération chirurgicale. Claus Beck-Nielsen, auteur, acteur et musicien, né homme en 1963, est effectivement mort en 2001 pour renaître sous le nom de Madame Nielsen.
Je suis peut-être passé à côté d'un chef-d’œuvre, mais, le livre refermé, je reste sur une impression déroutante.
© Hervé GAUTIER – Novembre 2017. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Une vie entière - Robert Seethaler
- Le 04/12/2016
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1095
Une vie entière. Robert Seethaler – Sabine Wespieser éditeur.
Traduit De l'allemand (Autriche) par Elisabeth Landes.
Je note tout d'abord un paradoxe apparent : ce titre laissait présager un ouvrage important quantitativement et finalement nous avons une œuvre de 157 pages. C'est vrai qu'Andreas Egger est le type même du quidam qui passe inaperçu et dont on ne parle pas. Orphelin, il a été recueilli par une brute dont les coups répétés l'on rendu boiteux et dont chacun se moque. Il a vécu comme il a pu, construisant seul sa vie marginale mais honnête, dans les montagnes autrichiennes au sortir de la Première Guerre mondiale. Ce n'est qu'à l'âge de 35 ans qu'il rencontre un peu par hasard dans une auberge, Marie qui y était serveuse. Le fait qu'il effleure seulement son corsage le bouleverse et il l'épouse. Son existence jusque là difficile, faite de petits boulots ingrats et mal payés, change soudain avec la venue d'une entreprise qui construit des téléphériques. Il s'y fait recruté et apprécié et on pense que ses malheurs sont enfin terminés, qu'il va passer le reste de sa vie aux côtés de Marie, mais une avalanche ensevelit sa maison et tue son épouse. C'est un peu comme si la mauvaise étoile sous laquelle il est né s'était réveillée soudain. Ils n'avaient même pas eu le temps d'avoir un enfant. Pour exorciser son chagrin il poursuit son travail, ingrat et dangereux puisque cette vallée veut s'ouvrir au tourisme mais la guerre arrive qui bouleverse tous ses projets. L'Histoire le rattrape cependant et la fin du conflit l'envoie sur le front de l'Est mais, comme beaucoup de ceux que le destin a choisi pour être ses victimes, il passe plus de 8 ans dans un camp de prisonniers de la steppe russe avant de revenir dans son village en 1951. Là il connaît le sort des vétérans, oublié, ne survivant que de maigres indemnités et de petits emplois . Par chance les nazis ont disparu et le tourisme est enfin florissant. Lui qui était resté constamment en marge, constate l'avancée du progrès, l'apparition de la télévision, la marche sur la lune. La mode de la randonnée en montagne fait de lui un guide.
Je dois dire qu'au départ j'ai eu un peu de mal à entrer dans cette histoire mais j'ai quand même ressenti de l'empathie pour le personnage d'Egger. Non seulement il n'a pas de chance, semble avoir traversé sa vie comme un passager clandestin, toujours méprisé et exploités par les autres, mais j'ai compris sa volonté de rester en retrait du monde, sa vocation pour la solitude, sa décision de quitter son emploi de guide pour se retirer à la fin dans une pauvre étable, creusée dans la montagne à la manière d'un terrier, une sorte de caveau avant le vrai, sa timidité avec les femmes, sa façon de s'excuser presque de faire partie d'un décor dans lequel il n'a qu'un rôle de furtif figurant. Évoquant sa jeunesse, il ne peut parler du « bon vieux temps » , il aurait pu être heureux, fonder une famille, mais son destin funeste s'y est toujours opposé, tuant ses rêves et son aventure avec la vieille institutrice est restée sans lendemain. Comme tous les solitaires, il se met à soliloquer, prend goût à sa vie d'ermite et traite par le mépris les ragots des villageois qui dans son dos dénigrent sa manière de vivre. La mort qu'il avait touché de près en Russie le saisit, comme elle saisit tout être humain, mais elle se fait précéder pour lui par les visions et on le prend au village pour un fou. Pourtant il a vécu soixante-dix neuf ans, une longévité étonnante pour un homme à qui la vie refusait le bonheur mais qui pourtant s'y était accroché. Il a survécu à bien des choses, a mené sa vie honorablement, sans immoralité et sans tapage et finalement en a été assez satisfait au point de rire de son malheur. Lui aussi choisit de mourir dans la montagne en acceptant la mort comme une délivrance, comme il y a bien longtemps, le vieux chevrier qu'il avait descendu dans sa hôte vers le village mais qui au dernier moment lui avait échappé pour aller s'abîmer dans la crevasse d'un glacier. On retrouva son cadavre plusieurs dizaines d'années après. J'ai bien aimé ce texte poétique et émouvant, cette vie simple, simplement évoquée, comme un hommage.
© Hervé GAUTIER – Novembre 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
la passage de la nuit - Haruki Murakami
- Le 23/08/2016
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n°1067– Août 2016
Le passage de la nuit – Haruki Murakami – Belfond.
Traduit du japonais par Hélène Morita.
Ce roman nous entraîne dans Tokyo pendant une nuit, une manière de respecter la sacro-sainte unité de temps (rythmé par les horloges qui introduisent chaque chapitre) et de lieu. Mari Assaï, une jeune fille est assise devant une tasse de café dans un restaurant et lit un gros livre à une table. Un jeune homme, Takahashi, s’assoit à côté d'elle et un dialogue s'instaure. Il vient ici pendant la répétition du groupe de jazz où il joue du trombone. Plus tard, c'est Kaorou, gérante d'un « love hôtel » qui vient interrompre la jeune lectrice. Elle lui raconte que dans son établissement un client a tabassé une prostituée chinoise et vient chercher Mari qui, selon Takahashi parle le chinois. Dans le même temps Eri, la sœur de Mari, dort profondément mais dans son sommeil est peuplé d'étranges rêves.
C'est un eu une histoire où il ne se passe rien et qui sert de prétexte à une visite nocturne de Tokyo. Ainsi le lecteur est-il invité à visiter, en qualité de témoin privilégié, des lieux interlopes comme ce « love hôtel » mais aussi un bar de nuit, un bureau où s'affairent nuitamment des informaticiens, la chambre d'Eri où la télévision, bien que débranchée, fonctionne et montre un homme dont on ne sait pas très bien s'il observe ou veille sur le sommeil de la jeune fille, des miroirs qui semblent garder le reflet de ceux qui s'y regardent, le monde de la pègre, celui de le prostitution... Ces petites touches qui composent un paysage bien étrange dessinent cette nuit qui est peut-être, pour l'auteur, semblable aux autres mais qui va transformer les intervenants, et va faire se croiser leur destin. Chaque scène est décrite différemment en fonction de celui qui la voit et on a cette espèce d'impression étrange de voler par dessus tout ce paysage, de découvrir le décor et la vie à travers l’œil indiscret d'une caméra.
Cette lecture instille du mystère, de l'inattendu, une atmosphère énigmatique et imaginaire à laquelle je ne m'attendais pas. J'avoue que, malgré mon goût pour ce genre d'ambiance, je ne suis pas vraiment entré dans ce roman. Pourtant le titre était engageant et laissait place à la poésie qui, à travers l'écriture de Murakami, n'est pas absente de ce roman.
Rêve, virtualité, réalité, absurde, surréalisme, je suis resté un peu sur ma faim, dubitatif aussi, mais je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Huraki Murakami est un auteur que je découvre petit à petit. Je dois dire qu'ici je n'ai pas été convaincu.
© Hervé GAUTIER – Août 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com
-
Après le tremblement de terre - Haruki Murakami
- Le 19/08/2016
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n°1066– Août 2016
Après le tremblement de terre – Haruki Murakami – 10/18.
Traduit du japonais par Corinne Atlan.
Je l'ai déjà dit dans cette chronique, l'univers d'un recueil de nouvelles est particulier. A travers chaque texte le lecteur recherche, parfois vainement, le fil conducteur de l'ouvrage. Ici, comme le titre l'indique il s'agit d'un tremblement de terre, celui de Kobé en 1995 et des conséquences qui peuvent en découler dans la tête de chaque Japonais. A vrai dire, les séismes font partie depuis longtemps de la vie de ce pays au point qu'existe une légende qui les explique. Depuis le XVII° siècle deux poissons-chats géants, Mamazu et Ōnamazu [une autre légende voulait que ce fût un dragon], vivant dans les profondeurs de la terre et très turbulents remuent régulièrement leur échine sur laquelle repose le Japon. Ainsi naissent les tremblements de terre au pays du « soleil levant ».
Le livre refermé je ressens une impression de vide, d’inutilité, d’éloignement, de déréliction et de mort qui règne sur ces six textes, six fables, qui sont une variation sur ces thèmes. Certes le tremblement de terre apporte avec lui la mort, le néant, la destruction et cet événement, augmenté par la perspective de son renouvellement inévitable laisse dans l'esprit des gens qui vivent là une sorte de peur constante et ineffaçable qui souligne la certitude que nous ne sommes que les usufruitiers de notre propre vie, que nous ne sommes sur terre que de passage. L'auteur insiste sur l'isolement des êtres qui pourtant vivent en société [le thème de la boîte, à la fois petite et hermétiquement close est significatif]et pour cela il a de la matière. Que cela soit dans le domaine de la religion où Dieu se fait complètement inexistant et abandonne l'homme à son sort, et ce en pleine contradiction avec ce qu'on nous a dit au catéchisme, ou dans celui du mariage. C'est étonnant comme les hommes et les femmes se précipitent dans cette institution sans en avoir la moindre vocation, comme si c'était un point de passage obligé dans le parcours terrestre de chacun et comme si avoir un enfant était obligatoire. Rares sont les mariages qui perdurent longtemps et leur dissolution entraîne bien souvent un replis sur soi. Nier que les relations entre les époux sont toujours exemptes de mensonges et de trahisons est un leurre, dans ce domaine « amour » ne rime jamais avec « toujours » et le « happy end » est rarement au rendez-vous. Comme si cela n'était pas suffisant, la timidité, les amours manquées, les regrets et les remords, le temps qui passe se chargent d'accentuer ce phénomène. Nous savons tous que les apparences existent, qu'elles sont mensongères et que la solitude est parfois une meilleure voie. L'espèce humaine dont nous faisons tous partie, capable du pire comme du meilleur, choisit bien souvent le pire avec beaucoup de talent et cet état d'abandon dont parle l'auteur existe ; il est bien souvent la conséquence de l'action maléfique des autres. Vivre en société ressemble à un combat où chacun défend ses intérêts contre l'autre qu'il oublie ou qu'il cherche à éliminer, ce qui ne favorise guère les relations sociales. Et d'ailleurs, comme pour faire bonne mesure, cette solitude est aggravée par l'originalité dont certains individus peuvent éventuellement faire montre, un peu comme si, n'être pas comme les autres, dans la norme générale, excluait les relations humaines et les amitiés, comme s'il fallait satisfaire à l'instinct grégaire, renoncer à soi-même pour être admis à fréquenter les autres.
Certes l'auteur prend le tremblement de terre de Kobé comme référence, un peu comme si ce phénomène presque ordinaire au Japon servait de catalyseur pour révéler l'état d'isolement de l'homme et le traumatisme que ce phénomène suscite. En effet, on cesse, dans ce pays, de se considérer en sécurité sur terre parce que, quand elle tremble, elle devient meurtrière, traîtresse, très semblables aux hommes finalement. Nous le savons bien, malgré la vie en société à laquelle chacun se consacre, la solitude existe de plus en plus et comme si cela ne suffisait pas, on est seul face à la mort. Il file une sorte de métaphore à travers différentes images qui personnalisent le tremblement de terre, un peu comme ces poissons-chats de la légende.
© Hervé GAUTIER – Août 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com
-
Astrid et Veronika - Linda Olsson
- Le 19/06/2016
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n°1050– Juin 2016
ASTRID ET VERONIKA – Linda Olsson – L'Archipel.
Traduit De l'anglais (Nouvelle-Zélande) par Mélanie Carpe.
Veronika Bergman, trente ans, est écrivain. Elle a choisi la solitude dans un village de Suède pour écrire le livre qu’elle portait en elle depuis longtemps. Elle fait connaissance de sa voisine, Astrid Mattson, soixante dix ans, que tout le mode considère une sauvage. Tout les oppose : l'une est casanière et l'autre est une voyageuse et pourtant entre elles le courant passe, elles échangent des confidences, entre sensibilité et pudeur, se découvrent des points communs malgré la différence d'âge. Astrid a très tôt perdu sa mère et son père a abusé d'elle. Pour échapper à cet enfer elle s'est mariée avec Anders un homme qu'elle n’aimait et pour des raisons obscures elle a étouffé leur fille unique, Sara. La mort d'Anders la libère mais la solitude lui pèse. Veronika avait tout quitté pour James qu'elle aimait passionnément mais qui s'est tué en mer. Les deux femmes s'observent avec hésitation d'abord puis se se retrouvent dans la douleur, le deuil et leur amitié procède de cette situation délétère. Ce sont des blessées de la vie et chacune d'elles tente de panser ses plaies à sa manière, Astrid en se coupant du monde, Veronika en exorcisant sa douleur par les mots. Pourtant leur rencontre a quelque chose d'exceptionnel. Leur nécessaire connaissance réciproque suppose que, pour l'autre, chacune évoque son propre passé, même le plus secret. Dès lors, ce cheminement dans la sphère intime procède aussi du retour dans le présent, une manière de renouer avec le monde extérieur, de se couler à nouveau dans le quotidien et faire prévaloir la permanence et la continuité de la vie et la résurgence du bonheur.
C'est bizarre mais j'ai lu ce livre à cause d'un engagement d'être (modestement) juré pour un prix littéraire, c'est à dire satisfaire à une obligation de lire un livre que je n'aurais peut-être pas choisi de moi-même puisque je ne connaissais pas cette auteure dont c'est le premier roman. Pourtant, je suis entré dans ce récit qui dès lors est devenu autre chose qu'une histoire racontée, que des mots écrits. Je me suis attaché à ces deux femmes de deux générations différentes, à leur façon de se protéger de cette vie qui aurait pu être heureuse mais ne l'a pas été à cause du hasard, du destin, des autres, allez savoir ! J'ai communié avec elles dans leur façon de réagir face aux épreuves qui ont jusqu’alors pourri leur passage sur terre. Pour elles, l'amour tant souhaité s'est enfui et ne reviendra pas. Face à cette certitude, pour Astrid c'est la recherche de la solitude et les larmes et pour Veronika c'est l'écriture, deux réactions parfaitement respectables, avec, en toile de fond, le chagrin et l'impuissance. C'est pourtant leur amitié réciproque qui les sauvent, une amitié bizarrement distante puisqu'elles se cesseront de se vouvoyer dans un pays où le tutoiement semble être généralisé. Astrid est de ces gens qui sont passés à côté de leur vie et à qui la malchance colle à la peau comme une ombre portée à un corps. Sa vie a été vouée au manque d'amour et elle l'a détesté au point qu'ayant été mère par hasard ou par obligation (il fallait bien donner un héritier mâle à son mari), elle a préféré tuer sa fille plutôt que de lui imposer une vie semblable à la sienne. Seule cette rencontre un peu pilotée par le hasard a permis à cette vieille femme qui attendait la mort comme une délivrance, de connaître un moment de répit. Elle qui n'aurait jamais été grand-mère a trouvé avec Veronika une petite-fille qu'elle ne pouvait imaginer. Veronika, quant à elle a réagi face à la mort de James en exorcisant sa peine par l'écriture, c'est à dire en faisant son métier d'écrivain, mais surtout en arpentant le monde. Cet épisode de sa vie la rapproche d'un père qu'elle avait un peu oublié. Pour elle aussi cette rencontre avec Astrid illumine sa vie et l’épilogue est un message d'espoir parce qu'il fait obstacle à l'oubli qui ne manque jamais de s'insinuer dans l'esprit des vivants. Ici, il y aura les mots imprimés qui malgré leur fragilité sont souvent plus solides que les murs. Cette maison qui était celle de la haine et du malheur devient le lieu d'un bonheur partagé et on peut imaginer que Veronika la peuplera de rires d'enfants ou au contraire sera la gardienne solitaire de la mémoire et répondra à l'appel de l’inspiration pour d'autres romans à venir puisque, pour elle, ce lieu s'y prête particulièrement et qu'elle porte encore en elle tant de choses à exprimer.
Le livre refermé, il me reste des descriptions agréablement poétiques, une ambiance calme et apaisante, un style sobre et bien dans le ton du récit. Je n'ai donc pas passé un mauvais moment de lecture, loin s'en faut. J'ai même trouvé cette relation émouvante, une belle rencontre et un message peut-être un peu optimiste, mais qu'importe !
© Hervé GAUTIER – Juin 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
Cent ans - Herbjorg Wassmo
- Le 15/06/2016
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n°1049– Juin 2016
CENT ANS – Herbjørg Wassmo – Gaïa.
Traduit du Norvégien par Luce Hinsch.
Comme le titre peut sembler l'indiquer, c'est une saga familiale sur quatre générations de femmes en Norvège septentrionale et plus spécialement dans les îles Lofoten. Celle de Sara Suzanne commence au milieu du XIX° siècle, suit celle de sa fille Elida puis de sa petite fille Hjørdis puis Herbjørg, l'auteure elle-même, toutes de la même lignée. C'est une chronique familiale, des vies qui se déroulent entre la mer et la ferme, mais c'est surtout un livre de femmes dont le destin est de se marier et d'enfanter. Ces portraits nous montrent des personnes courageuses, volontaires, résignées ou révoltées, avec chacune son caractère mais aussi des hommes rudes qu'elles ont choisis aimés et mérités. Ils ont fiancés époux , pères, tous marins ou paysans. D'eux sont nés de nombreux enfants (dix en moyenne par femme pour les premières générations) qui ont perpétré leur nom et leur mémoire mais de ces maternités répétées, les femmes en sortent épuisées pas forcément heureuses et souvent veuves, dédiées à une vie de labeur et de dévouement, entre prière et pauvreté, ayant abandonné leurs rêves de jeunesse et leurs légitimes aspirations de départ. Comme partout il y a des brouilles familiales et la vie qui côtoie la mort... L'amour est parfois au rendez-vous de leurs rencontres mais pas toujours. Comme on s'en doute la vie y est dure, ingrate, dans une nature hostile, parfois généreuse parfois moins, malgré la beauté rude des paysages et le progrès y arrive certes, mais plus tard et plus lentement qu'ailleurs. Ce récit n'épargne rien de ce qui est humain : amours déçus, conflits de couples, chocs de personnalités, ambitions ravalées, mariages d'amour ou de raison, deuils ...
L'auteur nous raconte cette histoire sans omettre les détails parfois les plus anodins ou les plus exceptionnels, entre plaisirs et douleurs, un récit qui se déroule depuis l'intime jusqu'à l’épique. L'écriture de ce roman m'a paru par moments assez laborieuse, à cause notamment de la chronologie difficile à suivre mais j'ai apprécié d'en connaître un peu plus sur la culture norvégienne, sur l'histoire du pays. J'avoue bien volontiers que je ne connaissais pas cette auteure.
A mon avis, écrire une saga n'est pas comme raconter une histoire romancée, c'est une démarche particulière où l'exorcisme tient une grande place et peut-être aussi la quête de réponses restées longtemps en suspens, de motivations personnelles, d'explications d'un choix particulier ... Certes il y a un souffle différent, une durée forcément plus longue, mais les finalités me paraissent autres, avec cette volonté, par le miracle de l'écriture créatrice, de porter témoignage dans un cadre familial, de donner à voir des personnages originaux, entre fiction et réalité, qui incarnent leur époque et s’inscrivent dans une lignée personnelle, peut-être aussi d'exhumer le souvenir d'hommes et de femmes, c'est à dire faire autant que possible échec à la mort et assurément à l'oubli, de rechercher des racines enfouies, oubliées ou occultées. C'est clarifier des psychologies ou des situations parfois taboues ou volontairement cachées, défendre un ancêtre injustement condamné ou rejeté de son vivant, lui prêter peut-être des sentiments qu’il n'a jamais éprouvés, éclairer un destin ou un point de sa généalogie resté obscur et s'inscrire soi-même dans cette ascendance familiale. C'est souvent parce qu'on porte en soi cette démarche particulière de l'écriture d'une saga qu'on devient écrivain, c'est à dire qu'on prend conscience de la nécessité impérative de poser cet acte qui tient, dans l'exploration d'un passé familial, à la fois de la création, du témoignage autant que de la volonté plus ou moins consciente, non pas tant d'aligner des mots, mais bien plus sûrement d'arracher quelque chose à la mort.
© Hervé GAUTIER – Juin 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
In altre parole - Jhumpa Lahiri
- Le 07/06/2016
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n°1048– Juin 2016
In altre Parole – Jhumpa Lahiri. Ugo Guanda Editore in Parma.
Comme le dit si bien Cioran " On n'habite pas un pays, on habite une langue" et c'est sans doute ce qui caractérise cette auteure, née à Londres en 1967 de parents bengalis, qui a suivi des études de littératures comparées à l'université de Boston pour ensuite s'installer à New York. Elle s'exprime donc en anglais, et c'est dans cette langue qu'elle a écrit "L'interprète des maladies" (Prix Pulitzer 2000) et "Un nom pour un autre" roman adapté au cinéma en 2007. Est-ce parce qu'elle a grandi dans l'état américain de Nouvelle-Angleterre, terre découverte en 1524 par l'explorateur Giovanni da Verrazzano qu'elle a choisi l'italien pour écrire ce témoignage ? Toujours est-il que Jhumpa a préféré s'exprimer dans une langue qui n'est pas la sienne à la suite d'une visite à Florence, cette merveilleuse ville de Toscane qui porte un nom de femme.
Ce livre a été écrit directement en italien par cette auteur dont le parler maternel est le bengalis et qui s'est toujours exprimée en anglais. C'est l'évocation d'un parcours et d'une découverte de cette langue et de cette culture, à la fois puissants et fluides, parce que la motivation de tout cela est avant tout le désir, une sorte de besoin de s'exprimer et de penser autrement. D'emblée elle compare l'étude de l'italien à un bain dans l'eau d'un lac, à la fois un plaisir et un exercice d'apprentissage, une véritable métaphore assurément. Elle relate sa première rencontre avec cette langue, à Florence, un parler que certes elle ignorait où tout pour elle était à découvrir mais qui lui était quand même familier à cause sans doute de sa musicalité, du côté théâtral de cette ville et de ses habitants. Elle ressentait pour elle comme un lien affectif, un véritable coup de foudre. Pour autant les difficultés n'ont pas manqué de se révéler parce que rien n'est facile, il reste toujours des automatismes, mais l'attirance pour le pays et pour la langue a été la plus forte et ce furent d’autres voyages, une étude plus poussée chez elle à New-York puis une installation à Rome avec sa famille, malgré les difficultés de l'expatriation et bien sûr l'usage du langage. C'est presque naturellement qu'elle fit aussi la démarche d'écriture parce que sa qualité d'écrivain ne pouvait pas ne pas s'adapter à cette nouvelle manière de s'exprimer. De plus le fait d'écrire et plus spécialement en italien, est pour elle une sorte de révélateur, un peu comme si elle avait ainsi trouvé sa véritable identité, elle qui appartenait certes à deux cultures mais n'en avait peut-être aucune complètement. Suivent des remarques passionnantes sur l'écriture en général et plus spécialement sur la démarche qui a été la sienne, pas toujours reçues comme telles cependant.
On peut traduire ce titre par « en d'autres termes » ou par « avec d'autres mots », une manière d'exprimer différemment une démarche qui non seulement est originale mais aussi qui procède d'un certain mystère, un peu comme si, à l'aide d'une sorte de mémoire héréditaire, c'est à dire étrangère à la sienne propre, et malgré les difficultés de toutes sortes, les doutes, la facilité apparente, la parenté avec le latin que, plus jeune elle pratiquait, elle remettait, avec beaucoup d'humilité, ses pas dans une dimension déjà connue, dans une sorte de vie antérieure...Elle confie au lecteur les divers obstacles qu'elle a rencontrés, les méthodes empiriques et pragmatiques qu'elle a adoptées pour en triompher.
Cette démarche ne pouvait me laisser indifférent parce que, toutes choses égales par ailleurs, j'ai toujours, moi aussi ressenti une attirance irraisonnée pour l'italien, rencontré pourtant bien tard dans ma vie et donc avec davantage de difficultés, notamment de mémorisation. Je ne saurais dire pourquoi mais cette langue m'a toujours fasciné, même si je ne la comprenais pas. Et puis,il y a tellement d'Italiens qui parlent le français et peu de Français qui font l'effort de parler cette langue pourtant cousine que cela me paraissait une évidence que d'aller en ce sens. J'aime cette façon de s'exprimer, à la fois mélodieuse et légère que j'ai retrouvée avec plaisir dans les mots de Jhumpa, lus à haute voix comme il convient pour en apprécier la musique. Cela a été pour moi l'occasion de me remettre en question, d'y puiser peut-être des encouragements et de penser que, peut-être un jour, je serai capable, moi aussi, de rédiger cette chronique dans cette langue… Oui je sais, je rêve !
© Hervé GAUTIER – Juin 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
Roseanna - Maj SLÖWALL
- Le 21/05/2016
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n°1044– Mai 2016
ROSEANNA – La Feuille Volante n°1044– Mai 2016
ROSEANNA – Maj SLÖWALL – Per WAHLÖÖ – PAYOT ET RIVAGES.
Traduit de l'anglais par Michel Deutsh.
Nous sommes en Suède, dans la petite ville de Motala où le corps d'une femme inconnue, dénudée et violée a été retrouvé dans le chenal de l'écluse qui donne accès au lac. L'inspecteur principal Martin Beck de la criminelle de Stockholm est dépêché sur les lieux pour épauler l'équipe locale. Il a beau être un bon flic, les indices dans cette affaire ne sont pas légion et les investigations patinent complètement au début, au grand dam de la presse et sur le thème bien connu de « Que fait la police ? » Il y a en effet de quoi s'inquiéter car ce n'est quand même pas tous les jours que la quiétude de cette petite cité est ainsi troublée. Du temps passe sans beaucoup d'informations au sujet du cadavre et ce malgré les investigations qui partent dans tous les sens, d'autant qu'il finit par être évident que cette femme s'appelait Roseanna Mc Graw… et venait du centre des États-Unis. Et tout cela grâce aux recherches d'un inspecteur américain dont le rapport révèle la personnalité contradictoire de cette femme. Quant aux enquêteurs suédois, ils piétinent toujours mais leurs vaines filatures et leurs errements infructueux n'ont d'égal que l'intuition et les certitudes parfois surréalistes de Martin Beck [ Je ne suis pas spécialiste des enquêtes judiciaires, des procédures suédoises, mais il m'a semblé que les questions posées par les enquêteurs, notamment dans le domaine de l’intime, étaient limite et n'apportaient rien à la manifestation de la vérité]. Dès lors, ce dernier qui refuse de se laisser abuser par les apparences, suit une idée qu'il est le seul à avoir, poursuit la traque, hasardeuse et solitaire, d'un suspect même si cette dernière s'accompagne de méthodes originales et inattendues, un peu en marge des procédures traditionnelles. Pour lui, qui est avant tout « têtu », l'efficacité et les résultats priment, même si sa hiérarchie se montre un peu frileuse, mais, après tout, il n'y a pas autre chose. Personnellement, j'aime bien le personnage de Beck, un peu bourru, taciturne et amoureux de son travail jusque y sacrifier sa vie de famille.
Ce roman se lit bien et a consisté pour moi en une agréable découverte même si le suspense se conjugue avec une certaine lenteur dans dans son déroulement. Cet ouvrage, sous-titré « Le roman d'un crime » n'est pas récent puisque sa première publication remonte à 1965, paru en France à partir de 1970, mais j'ai déjà dit dans cette chronique que, à mes yeux, la valeur d'un livre ne réside pas dans sa seule nouveauté. Les deux auteurs ont crée le personnage de Martin Beck, décliné ensuite dans une dizaine de romans. Les auteurs ont la particularité d'avoir été mariés, Per (1926-1975), ancien journaliste s'était signalé, à partir des années 50, par l'écriture de romans de politique-fiction, Maj (née en 1935) était pour sa part éditrice. Ils créèrent ensemble, à partir de 1965, des romans-policiers qui s'inscrivent dans la société suédoise de cette époque. Cette série a été interrompue à la suite de la mort de Per et ont fait l'objet d'adaptation cinématographiques.
© Hervé GAUTIER – Mai 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
Comment braquer une banque sans perdre son dentier - Catharina Ingelman-Sundberg.
- Le 10/05/2016
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n°1041– Mai 2016
Comment braquer une banque sans perdre son dentier - Catharina Ingelman-Sundberg. - Fleuve Éditions
Traduit du suédois par Hélène Hervieu.
Rien que de lire le titre et la 4° de couverture, c'est déjà tout un programme. Il allait être question de pacemakers, de listes de médicaments, de déambulateurs, de rhumatismes, de fractures du col du fémur… Pour une fois qu'on met les vieux en scène autrement qu'avec le scrabble, les verres de vin rouge, le tricot ou la belote ! Ils sont donc donc cinq, pensionnaires de la même maison de retraite suédoise et chantant dans la même chorale, qui soudain prennent conscience que les prisonniers incarcérés ont une meilleure vie qu'eux. La solution s'impose donc d'elle-même, ils vont devenir délinquants et après pas mal de réflexions et d'hésitations, le braquage d'une banque s'impose, même si cela ne se fait plus depuis longtemps ; une attaque de transports de fonds suffira donc. Mais, c'est pour la bonne cause : ils prendront aux riches pour donner aux pauvres, pour améliorer le sort des pensionnaires des maisons de retraite et, bien entendu, iront en prison, leur véritable objectif, drôle d'idée quand même ! C’est vrai que personne ne pourrait soupçonner une bande de vieillards séniles avec leurs déambulateurs. C'est vrai aussi que, dans ce genre d'exercice, ils sont plutôt novices, des coups d'essais s'imposent donc, entre jouer les rats d’hôtel et les dévaliseurs du musée de Stockholm, et pas du tout par amour de l’impressionnisme français ! Ils sont aidés involontairement en cela par le directeur de leur maison de retraite qui file la parfait amour avec l'infirmière chargée des soins, ainsi la surveillance est quelque peu relâchée et leur départ passe inaperçu. Dans leurs entreprises, ils font pourtant ce qu'ils peuvent, pensent au plus petits détails, s'inspirent des romans policiers anglais, font preuve de beaucoup d'imagination. Ils vont même jusqu'à s'accuser du vol des tableaux, à donner des renseignements précis, mais on les prend pour des affabulateurs. Malheureusement, il y a toujours un grain de sable qui se loge dans l'engrenage et qui fait tout foirer. C'est le début d'un polar hilarant aux multiples rebondissements dans lequel la police ne prend pas vraiment au sérieux la disparition de ces cinq vieillards de leur établissement. Quant à leurs idées reçues sur la prison et sur l’argent qu'ils voulaient partager, ils vont un peu évoluer. Et leurs manigances bancaires n’attirent pas que l’attention de la police !
C'est un livre léger (malgré ses plus de 400 pages) et agréable à lire malgré les invraisemblances qu'on lui pardonne aisément. Cependant, en le lisant, j'ai eu plusieurs impressions. D'abord la morale est sauve, mais attendais-je vraiment autre chose de cette aimable plaisanterie ? En outre, j'ai eu un sentiment étrange et peut-être bien éloigné de la farce qui veut nous être offerte. Quand on a mené une vie rangée, encombrée de difficultés, d’interdits et de tabous, quand vient la vieillesse, et avec elle une certaine mais ultime liberté, c'est aussi la dernière occasion de faire ce qu'on n'a pas pu réaliser avant, alors on se lâche et c'est sans doute ce que font ces cinq compères. Ils ont peut-être envie d'autre chose que d’attendre la mort, une dernière fois envie d'exister, de faire quelque chose, d'avoir leur quart d'heure de gloire surtout dans une société qui ne veut plus d'eux. Ils ont peut-être l'excuse d'avoir été abandonnés dans ce mouroir par leurs enfants qui attendent impatiemment l'héritage. Allez savoir ? Moi j'y ai vu cet aspect des choses, au-delà de l'humour réel que le titre laissait prévoir, mais peut-être n'ai-je rien compris ?
© Hervé GAUTIER – Mai 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
Les chiens de Riga - Henning Mankell
- Le 07/05/2016
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n°1040– Mai 2016
LES CHIENS DE RIGA– Henning MANKELL – Éditions du Seuil.
Traduit du suédois par Anna Gibson.
On a retrouvé dans un canot dérivant sur la Baltique, au large du port suédois d'Ystad, le corps de deux Russes, bien habillés, assassinés après avoir été préalablement drogués et torturés. Wallander est chargé de l'enquête alors qu'il est encore bouleversé par la mort de son collègue Rydberg, victime d'un cancer et préoccupé par l'état de santé de son père. Cela débute mal avec l'assassinat de Liepa, un major letton venu en renfort, la disparition de pièces à conviction, le transfert du dossier à Riga en Lettonie où la présence de Wallander est temporairement requise. Dès son arrivée dans cette ville, il est amené à s'intéresser à la mort mystérieuse du major mais les zones d'ombre se multiplient autour de cette affaire dont les méthodes sont inspirées par l'ancienne Union Soviétique. Très tôt le commissaire pense que l'enquête sur les Russes du canot et l'assassinat du major sont liés mais ses investigations sont contrariées par des écoutes téléphoniques et une surveillance que n’aurait pas renié de KGB. En Lettonie il est confronté à l'existence de complots, de corruption, de chantage, de trafic de drogue qui faisaient l’objet des recherches du major mais aussi à des dissensions et des jalousies entre collègues avec leurs inévitables délations et flagorneries. C'est aussi la combinaison de mensonges, de non-dits, de demi-vérités, de fausses pistes et d’enchaînements bien réels qui débouchent sur la mort d'un homme apparemment trop intègre. C'est donc autre chose que les banales affaires qui font l’ordinaire policier du commissaire et ce d'autant plus que, pris dans une sorte de logique du désespoir, il finit par faire une affaire personnelle d'une enquête qui ne le regarde plus, au point même d'exposer sa propre vie. De plus, à 43 ans, notre commissaire qui ne s'est jamais remis de la séparation d'avec sa femme, a un peu de mal à apprivoiser sa solitude dépressive avec de l'alcool, doute de son métier et ce n'est pas cet épisode letton, avec ses connotations personnelles, ses recherches longtemps vaines et chaotiques de documents et ses erreurs d'appréciations qui vont le remettre sr les rails. Il est certes, de par son métier, en contact permanent avec le côté obscur de la nature humaine mais là cela va prendre des proportions inattendues et lui révéler le vrai visage des pays baltes et peut-être lui faire apprécier la vie dans son beau pays.
C'est un roman policier plein de suspense, aux ramifications internationales, où plane en permanence le fantôme de Rydberg, où pour Wallander l'assassin qui se dérobe en permanence peut prendre l’apparence banale d'un policier comme d'un tueur nostalgique de l'ancien ordre soviétique, où il a l'impression d'assister à une sorte vendetta secrète dont il ne maîtrise ni les raisons ni les conséquences. Le texte, riche en rebondissements, bien construit, est entrecoupé de phrases en italiques qui se font l'écho des remarques intimes et désespérées du commissaire sur une situation qui lui échappe de plus en plus au fil de ses investigations.
Comme toujours, cela a été pour moi, un bon moment de lecture.
© Hervé GAUTIER – Mai 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
La femme en vert - Arnaldur INDRIDASON
- Le 28/04/2016
- Dans Autres littératures étrangères
- 1 commentaire
La Feuille Volante n°1037– Avril 2016
LA FEMME EN VERT – Arnaldur INDRIDASON – Point.
Traduit de l'islandais par Eric Boury.
Tout ce que les bébés trouvent, ils le portent à leur bouche. Lors d'une fête d'anniversaire, on découvre une fillette en train de mâchonner ce qui se révèle être un os humain trouvé par son frère dans des fondations de futurs maisons d'un quartier de Reykjavík. Le commissaire Erlandur et deux de ses collègues sont chargés de cette enquête pas vraiment riche en indices, juste un squelette là depuis une soixantaine d'années, une maison, jadis propriété d'un commerçant, rasée et la vague indication d'une femmes vêtue de vert, la présence de groseilliers à proximité, la disparition mystérieuse d'une jeune fille peu avant son mariage ! Pour compliquer un peu les choses, les policiers son aidés d'un géologue et d'un archéologue pour dégager le corps, c'est dire le luxe de précautions qui accompagne ce travail, ce qui ne hâte pas vraiment les choses. Les recherches s'éternisent un peu autour de la présence de militaires anglais puis américains dans les environs pendant la guerre, ce qui permet au lecteur d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de ce pays. On nous raconte que Reykjavík était au départ une petite ville et qu'à l'endroit où on a trouvé le squelette il y avait des maisons d'été. La ville s'étendant, on a construit sur ces terrains et on a ainsi découvert ces restes humains. L'auteur nous raconte aussi le calvaire d'une femme, battue par son mari violent et qui a vécu ici vers 1937. Cette femme a été courageuse et a accepté sa condition de femme battue et bafouée pour protéger sa fille handicapée et ses deux fils. Nous assistons à la lente destruction d'une famille par un tyran domestique, sadique et pervers. Il y a sans doute un lien entre cette affaire et son enquête à propos du squelette découvert. Mais lequel ?
Ce roman nous apprend à connaître ce commissaire, pas vraiment intéressant, marié très tôt et qui a abandonné très tôt son épouse et ses deux enfants. Il voit rarement son fils et sa fille, Eva-Lind, enceinte et droguée est entre la vie et la mort et bien sûr, il culpabilise même si c'est un peu tard. Il entame ainsi une deuxième enquête, personnelle celle-là, pour en apprendre davantage sur la vie de sa fille et ce qui l'a amenée ainsi au pas de la mort. Il parviendra quand même à parler avec sa fille, de son enquête d'abord et faute de mieux puis petit à petit de son enfance, comme une sorte d'acte de contrition, ce qui nous en apprend un peu plus sur lui. Ainsi l'auteur fait-il une sorte de parallèle entre la famille qui a vécu dans cette maison maintenant détruite et ce qui a secoué celle du commissaire. Cet épisode familial a aussi des répercutions sur les relations qui existent entre les différents membres de l’équipe que dirige le commissaire.
Ce sont donc plusieurs histoires qui s’entremêlent dans ce roman, de nombreux analepses, ce qui le rend un peu difficile à lire et égare un peu l’attention du lecteur à mon avis malgré la tension qu'il entretient tout au long de trois cents pages. C’est un roman policier puisqu’il y a un cadavre ou plutôt un squelette et des investigations diligentées par des enquêteurs mais c'est aussi un roman psychologique et social que j'ai finalement bien aimé.
© Hervé GAUTIER – Avril 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
Rosa candida - Audur Ava Ólafsdóttir
- Le 14/04/2016
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n°1031– Avril 2016
ROSA CANDIDA– Audur Ava Ólafsdóttir -Zulma.
Traduit de l'islandais par Catherine Eyjólfsson
Rosa candida c'est le nom d'une rose à huit pétales, à la tige dénuée d'épines. C'est aussi une rare variété de fleurs que la mère de Arnljótur, morte il a quelques années dans un accident de voiture, aimait à cultiver et faisait partager à son fils sa passion pour la jardinage. La vie est bizarre puisque, un soir de fête, dans la serre familiale, Arnljótur fait l'amour à une inconnue qui quelques temps après vient le voir pour lui annoncer qu'elle est enceinte. Pour l'heure il doit se rendre dans un monastère loin de chez lui, dont les moines sont dédiés à l'horticulture et spécialement aux roses. Il y sera un simple jardinier et apprendra la langue du pays, nouvelle pour lui. Un moine cinéphile et un peu alcoolique deviendra son confident.
Il est un peu bizarre ce Arnljótur, se laisser chargé de paternité comme cela, par une inconnue avec qui il a passé une courte nuit d'amour, sans chercher à savoir si l'enfant est de lui. Il semble heureux d'avoir une fille,Flóra Sól, mais ne cherche pas pour autant à vivre avec sa mère ni à se marier avec elle. Ils ne forment pas un vrai couple. Je veux bien qu'il soit ému par les femmes et que la simple rencontre avec l'une d'entre elles le bouleverse, mais quand même ! De son côte Anna, après avoir mis son enfant au monde semble vouloir reprendre sa vie solitaire et ni l'un ni l'autre n'ont cherché à connaître leurs beaux-parents. Seul le père d' Arnljótur paraît heureux d'être grand-père ne serait-ce parce que ce bébé assurera la descendance familiale puisque sont second fils, Joseph, est handicapé mental.
Il est beaucoup question de jeunesse et de vie dans ce roman mais dans le même temps l'idée de la mort et de l'absence est constamment présente. Certes nous sommes tous mortels et nous le savons et cela ne me gêne pas mais ce que je retiens c'est aussi la coté candide, naïf de ce jeune homme qui semble avancer dans sa vie comme un automate. L'arrivée inopinée de sa fille de neuf mois et de sa mère, bouleverse son quotidien puisque la présence de cette enfant ne peut être compatible avec la vie monacale. Il s'adapte cependant et finit par s'habituer et souhaiter que cela dure toute sa vie. Dès lors, j'ai eu l'impression qu'il est victime d’une sorte de dédoublement de la personnalité. D'une part il semble heureux dans sa nouvelle vie un peu égoïste et de l’autre, il veux voir sa fille grandir et souhaite assumer son rôle de père avec enthousiasme. Quant à la mère, elle s'installe avec lui, mais pour un temps seulement, non pour tenir son rôle d'épouse mais surtout pour rédiger son mémoire d'études sur la génétique. Seules semblent compter ses études et sa liberté qui finalement prévaudra.
J'ai lu ce livre sans moi-même, pendant longtemps, savoir quoi en penser, plus intéressé par un épilogue que j'avais du mal à imaginer que par réel intérêt pour cette histoire. Cela m'a paru être le récit banal d'un jeune homme victime de cette jeune fille qui sait ce qu’elle veut et finalement se débarrasse de son enfant et s'en va. Lui accepte cette situation en faisant prévaloir le présent immédiat avec une détermination surréaliste et même complètement irresponsable, sans avoir la moindre idée de l'avenir. Je respecte infiniment le travail de l'auteur, mais je dois dire que je me suis un peu ennuyé à la lecture de ce roman.
© Hervé GAUTIER – Avril 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
l'énigme du clou chinois - Robert Van Gulik
- Le 24/03/2016
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n°1025– Mars 2016 ans
l'énigme du clou chinois - Robert Van Gulik– 10/18
Traduit de l’anglais par Anne Duchanet, Roger Guerbet et Jos Simons
A peine installé dans la ville de Pei-Tcheou, proche de la frontière tartare, le juge Ti est confronté à la disparition d'une jeune fille dont on se demande si elle a été enlevée, assassinée ou s'il ne s'agit que d'une simple escapade amoureuse. Puis c'est la découverte du cadavre d'une jeune femme, décapitée dans la chambre conjugale. Entre accusations, disparition suspecte et solide alibi du mari, l'affaire s'annonce mal. Enfin, un célèbre champion de boxe est retrouvé empoisonné dans un établissement de bains où il avait ses habitudes ; des bouts de carton formant un puzzle, une voix de femme et un surnom aideront Ti a élucider cette affaire. Cette région inhospitalière favorise largement la pratique de la sorcellerie, du mystère et de la violence
J'avais l'habitude de lire les aventures de ce magistrat à la fois intègre et fort talentueux qui a, sa vie durant, déployé de louables efforts au service de l’État, sous la plume de Frédéric Lenormand. Cette chronique s'en est très souvent fait l'écho. Cette fois c'est Robert Van Gulik (1910-1967), ambassadeur mais aussi fin lettré, sinologue érudit et homme de Lettres hollandais qui nous fait partager des épisodes de la vie de cet authentique fonctionnaire chinois, Ti Jen-tsie (630-700), dont la carrière se déroula sous la dynastie des Tang, dans différentes villes de province pour se terminer dans la Capitale en qualité président de la Cour Métropolitaine de Justice. Ce roman nous montre un juge mais aussi un homme habité de sentiments pour une femme qui n'est pas la sienne mais que sa fonction officielle rend solitaire. De mes lectures précédentes, j'ai retiré l'impression d'un juge omnipotent, craint de ses administrés et quasiment infaillible. Le magistrat de cette époque détenait en effet une sorte de pouvoir absolu puisqu'il représentait et appliquait la loi, mais cette dernière ne lui conférait aucune immunité puisqu’elle prévoyait que toute personne (lui y compris) ayant accusé à tort quelqu'un d'autre devrait subir le châtiment de la personne injustement poursuivie. En outre la culte des ancêtres était, chez les Chinois de cette époque, une obligation religieuse à laquelle nul ne pouvait se soustraire et la non-observance des préceptes légaux était lourdement punie. La vie sexuelle des hommes avant la mariage faisait l'objet d'une grande tolérance, mais il n'était pas question de consommation avant la cérémonie elle-même entre les deux futurs époux.
Ce recueil policier est donc ainsi l'occasion d'en connaître davantage sur la civilisation chinoise de cette époque, sur son système judiciaire et pénal, un simple manque de respect pour la Cour étant, par exemple, punis de coups de fouet. Les faits rapportés sont réels mais pas forcément traités par Ti lui-même. En tout cas, les personnages de Van Gulik sont ceux des romans policiers chinois traditionnels : le juge , ses sbires, les prêtres, les lettrés, les brigands ... C'est un réel dépaysement culturel et un bon moment de lecture.
© Hervé GAUTIER – Mars 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
Joseph Fouché - Stefan Zweig
- Le 22/02/2016
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
La Feuille Volante n°1016– Février 2016
Joseph Fouché – Stefan Zweig – Grasset .
De cet homme, nous ne retenons souvent que l'image que nous a donnée Chateaubriand dans ses « Mémoires d'outre-tombe ». Alors qu'il attend dans l'antichambre royale, l'auteur voit passer devant lui Talleyrand soutenu par Fouché et pour évoquer cette scène il parle « du vice appuyé sur le bras du crime ». C'est vrai que Fouché a toujours fasciné à la fois les historiens et les écrivains par sa manière de s'adapter aux circonstances plus que mouvementées de son époque et son extraordinaire longévité. Stefan Zweig n'échappe pas à cette attirance et lui consacre une biographie détaillée, très documentée et fort pertinente, parue en 1920. C'est d'ailleurs assez étonnant de la part de l'auteur de « La confusion des sentiments » que le désespoir conduisit au suicide.
C'est vrai que Fouché est un personnage pour le moins controversé et surtout contradictoire, qui a quand même gardé du professeur de mathématiques qu'il avait été, le côté calculateur. Il appartenait à l'ordre des Oratoriens (il a seulement reçu les ordres mineurs) qu'il a quitté pour embrasser les idées de la Révolution, mais il ne s'est pas moins signalé comme organisateur de l'armée contre les Vendéens mais aussi par son zèle à déchristianiser la Nièvre, à détruire les ornements sacerdotaux, les crucifix, les églises et piller leurs trésors. Qu'il ait été convaincu de divers détournements et participations à des affaires douteuses reste anecdotique au regard de ses autres méfaits. Sur le plan personnel, l'amitié n'avait que peu de valeur pour lui ; c'est ainsi que s’il soutint Robespierre au début de sa carrière politique, il n'eut aucun état d'âme à participer activement à sa chute, le 9 Thermidor. Quant à l'image de Chateaubriand, elle n'est bien entendu que de façade, Talleyrand étant en réalité son ennemi juré. Il n'était d’ailleurs pas dénué de cynisme et n’hésitait devant aucun abus de pouvoir, dût-il d'ailleurs précipiter ses détracteurs et parfois même ses amis dans la mort pour se sauver lui-même. Sur le plan purement politique il a été un attentif élève de Machiavel, pratiqua avec grand talent la palinodie, la flagornerie, la trahison, l'opportunisme et la délation, ce qui fit de lui, et à plusieurs reprises, un ministre de la police « efficace », ambitieux et surtout redouté. Au début, il s'est fait élire député de la Convention, passant du Marais (qu'on peut classer au centre) pour ensuite choisir le clan des « Montagnards » (qu'on classe carrément à gauche). Il n'en servira pas moins ensuite le Directoire, le Consulat, l'Empire puis la Restauration. Il reste aussi dans l'histoire, en plus des nombreux qualificatifs peu glorieux dont on l'affubla, comme « Le mitrailleur de Lyon » puisqu'il encouragea les cruautés et organisa la destruction par le canon (la guillotine étant jugée trop lente à tuer) des insurgés ou des suspects, ce qui n'était pas vraiment dans la philosophie des « Lumières ». Quant à l'exemple donné au reste du monde par la France d'alors, il était loin de l'idéal révolutionnaire.
Il faut lui reconnaître une certaine clairvoyance, à laquelle sans doute son appartenance à la franc-maçonnerie n'était pas étrangère . Il soutint Bonaparte le 18 Brumaire lequel sut se souvenir de son appui en lui confiant le portefeuille de ministre de la police mais son parcours dans l'Empire est jalonné de trahisons. Il restera attaché au Directoire, à Bonaparte alors Premier Consul puis à l'Empire mais Napoléon se méfiera toujours de lui, le fera même surveiller, craindra son pouvoir et ses félonies, même s'il le fit « Duc d'Otrante » pour son action en l'absence de l'empereur. Il saura d'ailleurs se maintenir non loin du pouvoir malgré ses disgrâces parfois lourdement désargentées et fort mal vécues, sauvegardera l'autorité de l’État pendant les « Cent-jours », négociant avec les puissances alliées face à la défaite prévisible de Napoléon et préparant la transition vers la royauté. Il n'hésitera pas à remettre Louis XVIII sur le trône et à être également son ministre sous la Restauration. C'est pourtant le même homme qui a voté la mort de Louis XVI, le même prêtre défroqué, pilleur d'églises qui jure « fidélité » au roi très chrétien !
Ce personnage ne laissa personne indifférent. Stéfan Zweig lui reconnaît du talent. Il semble être déconcerté par sa faculté de Fouché à avoir survécu à cette période, préférant bien souvent l'ombre à la lumière, évitant de trop s'engager, préférant observer et réfléchir avant d'agir... un véritable animal politique au remarquable sang-froid, à la patience exemplaire, à la clairvoyance proverbiale mais surtout dénué de scrupules. Il était fasciné par le pouvoir mais aussi par l'argent qui parfois lui manqua. L'auteur le prend comme modèle, mais comme un modèle pervers qu'il ne faut pas suivre, comme l'image de l'homme soucieux de faire oublier tous ces petits reniements et ses grandes trahisons et s'attache à l'accabler. Le Duc d'Otrante dont les armes étaient parlantes («D'azur à la colonne d'or, accolée d'un serpent du même, semé de cinq mouchetures d'hermine d'argent, deux deux, et une ; au chef des ducs de l'Empire brochant ») , était avant tout arriviste et comploteur, et incarnait sans doute la dualité qui est en chacun d'entre nous, était le parangon de tout ce que l'espèce humaine a de plus méprisable et que ne rachètent pas ni les «Père de Foucault », ni les « Mère Teresa » ni les « Saint-Vincent -de-Paul ».
© Hervé GAUTIER – Février 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
TOURNER LA PAGE - Audur Jónsdóttir
- Le 25/08/2015
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°957– Août 2015
TOURNER LA PAGE – Audur Jónsdóttir – Presse de la Cité.
Traduit de l'islandais par Jean-Christophe Salaün.
Eyja est une jeune fille épileptique mariée à un alcoolique surnommé « Coup de vent » tant il est absent, toujours entre une séance de désintoxication et une visite au pub. Il est un peu idéaliste, a l'âge d'être son père, n'est pas vraiment un acharné du boulot et plutôt accroc aux dessins pornos. A l'occasion, il touche aussi à la drogue qu'il partage avec Agga, sa belle-sœur, qui vit avec eux. Elle l'a épousé pour fuir une atmosphère familiale un peu irrespirable et sa mère divorcée qui change souvent de compagnons et cherche elle aussi dans la bouteille une consolation à cette vie. A l'entendre ce mariage a été motivé par la perspective d'un congé et des cadeaux... Autant dire qu'il est, comme sa vie partagée entre alcoolisme et tabagisme, complètement raté ! Sa grand-mère est consciente de cette situation et n'y voit qu'une solution, le départ de sa petite-fille pour la Suède chez sa cousine Rùna, mais seule ! Elle est même prête à subventionner ce voyage mais la jeune femme s'accroche à ce mari et quand son amie Bimba lui conseille elle aussi de le quitter, elle refuse au seul motif qu'il lui apporte une tasse de café au lit le matin, quand il est là bien sûr ! C'est sans doute un peu léger mais elle est peut-être plus attachée à cet homme qu'elle ne le croit. Quant à sa grand-mère, elle la verrait bien changer de vie, « tourner la page », écrire enfin ce roman qu'elle porte en elle depuis longtemps. Après tout, dans cette famille un peu bizarre, le grand-père d'Eyja a été un homme de Lettres célèbre et sa mère s'est aussi un temps essayée à l'écriture mais dans le seul domaine de l'élégie mortuaire, alors pourquoi pas elle ? Mais, dans l'esprit de sa mère et de sa cousine, ce voyage n'est pas vraiment destiné à être créatif. Ce séjour en Suède sera pour elle le prélude à une nouvelle vie, plus près de la nature et du quotidien, mais pas vraiment les vacances qu'elle espérait. D'ailleurs quand elle devenue à son tour écrivain, quelques années plus tard, elle a eu une tentative d’explication « J'écris parce que j'ai passé ma vie entourée de gens souffrant d'une soif insatiable. Ils se gorgent d'alcool comme les nourrissons de lait maternel. Et je voudrais comprendre pourquoi ». Auparavant, elle a fait ses gammes en publiant des articles dans un quotidien local et sa grand-mère est vraiment déterminée à soutenir son projet littéraire autant qu'à l'aider à vivre au quotidien. Au fil du roman le lecteur peut comprendre que cette aïeule peut aussi vouloir rattraper ainsi les erreurs d'éducation dont a pu être victime sa propre fille, la mère d'Eyja.
Est-ce qu'avoir raté sa vie, ne pas s'aimer, refuser son corps, être épileptique, avoir des problèmes de couple ou des relations familiales difficiles avec sa mère à qui elle ne veut pas ressembler, sont des motivations suffisantes pour écrire ? A titre personnel, je répondrai sans hésitation par l'affirmative d'autant que cela peut correspondre à une reconstruction de soi, ce qui me paraît être le cas de Eyja. Son séjour suédois lui sera bénéfique à plus d'un titre, lui permettant de devenir enfin ce qu'elle est. L'écriture n'est pas seulement une alchimie, c'est aussi un phénomène complexe au terme duquel l'auteur n'est pas seulement un simple raconteur d'histoires mais aussi le thérapeute intime de ses propres maux, loin de l’alcoolisme général. Grâce à elle, celui qui tient le stylo apprend à s'accepter lui-même, quant à ce qui résulte de son inspiration, le texte définitif, c'est à la fois un paradoxe et un mystère.
Jusqu'à ce que les Babelio et les Presses de la Cité me fassent parvenir ce roman, ce dont je les remercie, je ne connaissais pas Audur Jónsdóttir. Je ne suis pas familier des romans islandais mais j'avoue que j'ai été assez surpris par cet ouvrage, parfois aussi un peu agacé par les longueurs, par ses incessants analepses qui déclinent l'histoire mouvementée de cette jeune femme un peu paumée. Contrairement à ce qu'indique la 4° de couverture, le style en m'a paru aussi original qu'annoncé, pas vraiment ce que j'attends d'ordinaire d'un roman.
Hervé GAUTIER – Août 2015 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
KADDISH POUR L'ENFANT QUI NE NAITRA PAS - Imre Kertész
- Le 17/04/2015
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°895– Avril 2015
KADDISH POUR L'ENFANT QUI NE NAITRA PAS -Imre Kertész – Actes Sud.
Traduit du hongrois par Nathalia er Charles Zaremba.
Le kaddish, ce n'est pas comme on le dit souvent la prière des morts mais des endeuillés. Ainsi le titre prend-il tout son sens dans la mesure où l'auteur, refusant d'avoir un enfant, est endeuillé par sa propre décision.
D'abord, il s'agit d'un soliloque, c'est à dire d'une réflexion face à soi-même couchée sur le papier par le truchement de l'écriture, une manière de fixer les choses. Le narrateur qui est juif est un traducteur qui a renoncé à être écrivain et qui entame une conversation avec M. Oblàth, un philosophe qui lui demande innocemment s'il a des enfants. Sa réponse est un « Non » catégorique à son interlocuteur et cela le bouleverse au point que, dans la nuit qui suit, il se remet à écrire, c'est à dire fixer ce soliloque sur la page blanche, avec pour thème cette négation. Cette conversation « entre deux intellectuels moyens » tourne donc autour d'un enfant qui aurait pu naître mais qui ne naîtra pas, une inexistence qui est le prélude à « son auto-liquidation consciente », le premier coup de pelle à cette tombe qu'il creuse pour lui dans les nuages avec sa plume! Bien entendu, cette réflexion intime sollicite sa mémoire et c'est tout naturellement qu'il évoque sa femme dont il est séparé depuis. Il refait à l'envers le chemin de leur amour, de leur bonheur qui bien que « considéré comme une obligation » ne fut pas au rendez-vous à cause de cet enfant qu'il lui refusa mais aussi cette impossibilité d'écrire ce roman qu'il portait en lui et qu'elle espérait comme la consécration de leur union. En réalité pour lui l'écriture était la marque de sa souffrance (suivant l'expression communément admise « je souffre donc j'écris ») et non la conséquence de sa liberté, et donc incompatible avec l'expression alors que pour elle, elle était symbole de la réussite littéraire. Il revient sur cet épisode de la liberté quand il évoque l'attitude de celui qu'il appelle « Monsieur l'instituteur »qu'il rencontre quand ils sont ensemble dans un wagon à bestiaux que les emporte vers les camps. Le narrateur, alors adolescent, est incapable de bouger, immobilisé par la douleur. Cet homme s'est chargé de lui apporter sa portion de nourriture mais disparaît un moment, happé par la foule. Le narrateur suppose qu'il se l'est appropriée pour augmenter ses chances de survie mais il réapparaît et la lui apporte, s'indignant de son étonnement. Il n'était pas obligé de faire ce geste qui illustre sa liberté intérieure et va à l'encontre de sa propre survie. L'auteur y voit même la marque de l'illogisme. Pour lui-même, le narrateur revendique sa liberté d'écrivain en refusant par avance toute intrusion dans son travail. Ainsi la propriété d'un logement. Il en va de même pour l'amour qui d'ordinaire est plutôt un moteur de la création artistique. Au contraire, à ses yeux, il est le symbole de l'attachement, l'inverse de la liberté qui pour lui est la seule source de création littéraire. C'est que, pour lui, l'écriture n'est pas exactement le reflet de la vie, sa façon d'écrire ce texte en est la manifestation et peut parfaitement, comme il le dit lui-même, être une fuite. Il y avait donc, au départ une contradiction (peut-être inavouable) dans leur union. Il avait bien tenté de l'exprimer en explorant son enfance dans une nouvelle mais ce fut un échec. De plus, pour lui, sa judéité reste quelque chose de laquelle il est prisonnier. Son épouse qui est juive et dont les parents eux-mêmes ont connu Auschwitz comptait sur lui, sur son écriture, pour se libérer de ce poids, alors que lui entendait faire cette démarche en solitaire. En outre, il lui a refusé cet enfant dont la femme qu'elle est avait envie sans doute parce qu'on ne pouvait pas donner raisonnablement la vie après avoir vécu l'Holocauste. Il ne le pouvait pas non plus à cause de ce mariage raté auquel il met cependant fin. Du coup il est lui « le mauvais juif » par rapport à cette « belle juive », de 15 ans sa cadette qui fut son épouse. Il n'empêche, cette liberté qu'il revendique en tant qu'écrivain se manifeste pleinement dans ce « non » opposé à la fois à Oblàth et à son épouse.
Ainsi, peut-on imaginer que ce kaddish s'adresse aux vivants en leur enjoignant de vivre malgré tout. S'il avait eu cet enfant, l'auteur aurait, d'une certaine façon prolongé sa propre existence, mais peut-on vivre et transmettre la vie dans un monde qui a enfanté Auschwitz? Comment croire à la beauté et à la grandeur de cette humanité quand on a assisté à sa si profonde déchéance? L'auteur sait qu'il peut avoir un enfant mais le refuse pour provoquer une prise de conscience et un acte de mémoire dans une société si encline à l'oubli, pour l'inciter à se souvenir des martyrs qui ont payé de leur vie le seul fait d'être juif et qu'il est indispensable d'en garder la mémoire pour que cela en se reproduise pas. Ce texte est pourtant une sorte de prière, solitaire, longue et tortueuse, qui se conclue par un « amen ». Il est une longue négation de la vie qui ne peut être vécue pareillement après les horreurs des camps. Il adresse cette prière à Dieu comme une excuse de ne pas pouvoir jouir pleinement de la vie qu'Il lui a donnée à cause de ce qu'il a vécu et de cette paternité qu'il refuse. J'ai personnellement lu ce livre avec les yeux d'un désenchanté et je suis, moi aussi, bien enclin, moi aussi, à désespérer de cette humanité que les philosophes nous ont présenté souvent comme humaine et humaniste.
Le texte est dense, labyrinthique, douloureux, la phrase est longue, pesante, désarticulée, disloquée, écartelée en multiples digressions, ce qui n'en facilite pas la lecture. Qu'est -ce à dire ? Cela veut-il montrer l’intensité de la souffrance ou au contraire la difficultés de s'exprimer [avec ce texte il dit creuser sa propre tombe « dans les nuages », son « auto-liquidation »] Je choisis d'y lire une sorte d'attirance vers la mort de celui qui n'est pas vraiment sorti d’Auschwitz et qui n'en sortira jamais, une sorte d'accomplissement de sa judéité dans la mort. Il a connu l'horreur des camps [et aussi la joug soviétique en Hongrie après la guerre] et puise dans cette mémoire qui nourrit sa réflexion jusqu'à désirer la mort à la fois terme normal de la vie mais ici vécue comme une libération de la souffrance pour celui qui traîne sa vie comme un fardeau. Cela me rappelle le suicide de Romain Gary, laissant pour toute explication ces quelques mots « Je me suis enfin exprimé complètement ». Ainsi me semble -t-il que ce kaddish est certes pour Dieu, pour cet enfant qui en naîtra pas de lui mais aussi et peut-être surtout pour lui, pour obtenir cette paix dont parle cette prière et qui est impossible!
J'avoue avoir lu ce livre parce qu'il fallait sans doute avoir eu connaissance de ce texte, de ce message exprimé par un écrivain majeur et couronné par le Prix Nobel en 2002. Il est animé des mêmes angoisses à la fois sur le destin des juifs, sur l'horreur de la Shoah et sans doute aussi sur la culpabilité d'y avoir survécu. J'ai bien conscience que mon commentaire est largement en-deçà de ce qu'à voulu ou pu exprimer l'auteur, que je n'ai peut-être rien compris et qu'il peut parfaitement être contesté.
©Hervé GAUTIER – Avril 2015 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
Docteur Lapin et Mister Tigre - Akira HONMA (manga)
- Le 26/12/2014
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°846 – Décembre 2014.
Docteur Lapin et Mister Tigre – Akira HONMA.(Volume 1)-Taifu comics
Je ne suis pas familier des mangas aussi bien ce livre est-il déconcertant dès l'abord. Heureusement qu'il y a un avertissement, il se lit dans le sens de lecture originale japonaise, c'est à dire de droite à gauche, il faut donc le lire à l'envers de nos livres occidentaux traditionnels, en commençant par la fin ! Cela a été un peu déroutant pour moi mais je m'y suis rapidement fait. Il s'agit d'une édition originale publiée au Japon en 2009 et traduite. L'auteure, une femme dont je ne connaissais pas auparavant l'existence, se présente qu'une manière originale à son lecteur en lui donnant la date de son anniversaire, son signe astrologique et... son groupe sanguin ! Elle nous confie que ce manga est le 5° qu'elle publie et que cela n'a pas été simple. Elle a dû faite tomber pas mal d'obstacles et on devine aisément lesquels. Elle précise que le deuxième tome est encore inédit.
Cette bande dessinée se compose de trois histoires qu'il est inutile de résumer, « Docteur Lapin et Mister Tigre », « Ça s'écrit mensonge mais ça se lit vérité » et « Manhood child », déclinées sur le même thème, celui de l'homosexualité masculine. Après tout, pourquoi pas ? Je ne connais pas la société japonaise, ses habitudes, ses convenances mais j'imagine qu'elle ressemble un peu à la nôtre quand il s'agit de l'hypocrisie. L'homosexualité doit y être bannie ou sûrement dissimulée aux regards, tolérée peut-être comme chez nous même si elle y est de plus en plus admise, au moins officiellement. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas dans la norme qu'on doit la rejeter et cette sacro-sainte doctrine qui a été inspirée par la religion, les convenances sociales et les règles relatives à la procréation a, chez nous, quelque peu évolué ces derniers temps sur le plan de la loi, des coutumes et du changement des mentalités. Cette acceptation de l'autre, forcément différent, fait partie de la démocratie et être dans la norme sexuellement admise, une relation homme-femme, n'exclus évidement pas le mensonge, la trahison, l’adultère qui sont des composantes ordinaires de l'espèce humaine. Je ne suis pas, tant s'en faut, un spécialiste de l'homosexualité, ni même un amateur, je crois ne pas être homophobe non plus mais pour une fois que cette société basée sur le jésuitisme accepte de transgresser, sous la forme d'une œuvre rendue publique, un traditionnel interdit, ce n'est déjà pas mal. Il y eu certes des précédents célèbres par le passé mais ils se sont toujours accompagnés de protestations au nom de la morale et des bonnes mœurs.
J'ai finalement bien aimé ces trois histoires d'amour et j'attends le 2° tome qui je pense me plaira, autant pour le graphisme si particulier des mangas que pour l'histoire déclinée tout en nuances et demi-teinte, plus subjective, qui laisse deviner les choses beaucoup plus qu'elle ne les montre et conjugue un texte minimaliste avec des dessins épurés. Les liens amoureux entre les partenaires masculins y sont montrés d'une manière subtile et ni la présence fortuite d'une femme ni même ses manœuvres ne réussissent à les perturber (« Ça s'écrit mensonge mis ça se lit vérité » - « Manhood Chlid »). La découverte de la mutuelle attirance qui existe entre Mr Tigre et Uzuki à la suite d'une méprise du premier sur le look androgyne du second est bien amenée.
©Hervé GAUTIER – Décembre 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
VINGT-QUATRE HEURES DE LA VIE D'UNE FEMME- Stefan Zweig
- Le 27/05/2014
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°753 – Mai 2014.
VINGT-QUATRE HEURES DE LA VIE D'UNE FEMME- Stefan ZWEIG - Stock.
Traduit de l'allemand par Olivier Bournac et Alzir Hella.
Nous sommes au début du XX° siècle dans un hôtel calme de la Riviera et parmi les clients une femme mariée, mère de famille choisit de quitter son mari et ses enfants et de s'enfuir avec un jeune homme. Aussitôt, chacun y va de son commentaire conventionnel, moralisateur ou bassement médisant, mais le narrateur prend la défense de cette femme. Parmi ces clients, une vieille veuve anglaise de la haute société, discrète et digne, Mrs C …, se confie à lui et lui avoue que, vingt ans auparavant, elle avait alors quarante deux ans, alors qu'elle venait de perdre son mari et que ses enfants n'avaient plus besoin d'elle, était elle aussi tombée sous le charme d'un homme jeune qui venait, à Monte-Carlo, de tout perdre au jeu et qui voulait pour cela se donner la mort. Cet épisode amoureux ne dura que vingt-quatre heures et bouleversa sa vie même s'il ne fut pas partagé. Ce qui n'était au départ qu'une volonté de faire prévaloir la vie sur la mort s'est transformé, sans peut-être qu'elle le veuille vraiment, en un exaltante passade avec cet inconnu qui aurait pu être son fils. Pour elle qui vivait retirée du monde et confite dans le deuil, cette rencontre est une renaissance, une redécouverte du bonheur. Pour celle qui avait voulu, dans un élan de générosité et d'humanité, éviter à cet inconnu de se laisser glisser vers le suicide, cette journée passée avec lui est une invitation à retrouver cette vie à laquelle elle se fermait volontairement jusque là. L’amour dévastateur du jeu chez le jeune homme a ici son pendant sentimental chez cette femme respectable pour qui cette rencontre est un véritable « coup de foudre » ! Cela prend même une dimension quasi religieuse lors de la scène de l'église et Mrs C...pense même l'avoir sauvé définitivement de son addiction au jeu. La passion de Mrs C... pour ce jeune étranger est au vrai à peu près semblable à celle que ce dernier vouait au jeu mais pour lui, elle dura plus longtemps et eut raison de lui.
Ce court roman est bouleversant non seulement à cause du style (j'ai particulièrement été sensible à la description des mains du jeune homme face à la table de jeu, elles préfigurent le début de ce fantasme féminin et je ne dirai jamais assez que la lecture à haute voix souligne la musique des mots) mais aussi de la sincérité de l'auteur qui analyse, suivant son habitude, finement les sentiments des personnages. Ce texte est dans la même veine de « la confusion des sentiments » (La Feuille Volante n°747) qui m'avait tant plu.
Il n'y a rien d'érotique dans cette passade mais bien plutôt l'analyse de deux formes de passions apparemment incompatibles l'une avec l'autre. Tout est dans l’exhalation des sentiments de cette femme, ses projets insensés pour appartenir à cet homme alors que lui ne lui témoigne qu'une ingratitude brutte. L'auteur excelle à guider son lecteur attentif et passionné dans cet univers qui est le sien. L' issue n'est pas celle qu'aurait souhaitée Mrs C... mais ces vingt-quatre heures de vie intense (au vrai un bref instant dans sa longue existence) ont laissé dans sa mémoire une trace indélébile.
J'avoue que, à titre personnel, je suis particulièrement attentif aux écrivains qui se penchent sur la condition humaine et l'histoire intime des hommes et des femmes (cette histoire est très actuelle et le sera tant que les humains existeront), sur ce qui fait notre quotidien ou ce qui le bouleverse, ce qui est raison ou déraison, folie ou routine.
Ce roman a fait l'objet adaptations cinématographiques notamment en 1968 et 2003.
©Hervé GAUTIER – Mai 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA CONFUSION DES SENTIMENTS - Stefan Zweig
- Le 05/05/2014
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°747 – Mai 2014.
LA CONFUSION DES SENTIMENTS – Stefan Zweig – Stock
Traduit de l'allemand par Alzir Hella et Olivier Bournac.
Pour son soixantième anniversaire, Roland de D, un vieux professeur de faculté reçoit un livre qui est censé être sa biographie. Deux cents pages qui lui sont consacrées retracent son parcours . D'emblée il note des erreurs. En effet, puisqu'il a réussi, on suppose qu'enfant il avait des dispositions puisqu'il était le fils d'un proviseur et donc baignait dans le domaine de l’intellect. On voyait légitimement en lui un futur professeur alors que lui, secrètement se voyait plutôt marin. Il confesse qu'il a eu du mal à avoir son baccalauréat et que, à dix neuf ans, pour ne pas déplaire à son père il s'est inscrit en faculté. Las, une fois étudiant à Berlin c’est à dire loin de chez lui, son côté naturellement épicurien prit le dessus et il négligea les cours pour s'adonner aux plaisirs simples de la vie, le cabaret, les femmes... Pourtant le goût de l'étude lui vint d'un coup, après il est vrai une semonce paternelle, mais la véritable raison de ce revirement resta secret. Pour le reste de l'année, il s'inscrivit dans une autre faculté et découvrit un vieux professeur qui sut lui faire partager sa passion pour Shakespeare et dont il devint le secrétaire et presque le confident ; Il proposa en effet de l'aider à terminer un travail universitaire qu'il avait abandonné. Bien entendu, cette démarche personnelle le mit d'emblée à part parmi les communauté des étudiants.
Il n'était pas non plus indifférent au charme de sa jeune et belle épouse qui lui avoua que son mari s'absentait fréquemment sans qu'elle ne trouve rien à redire. C'était une femme effacée mais ce couple sembla au jeune homme assez singulier et pas seulement à cause de la différence d'âge. Elle paraissait s’accommoder des absences de son mari, les comprendre, les tolérer et peut-être les approuver ce qui faisait de cette union un mariage de façade
Au départ, le lecteur peut facilement être égaré par une supposée et potentielle liaison entre Roland et la femme du professeur. Après tout, cela ressemble bien à cet étudiant épicurien qui renouerait là avec ses anciennes habitudes. D'autant plus que non seulement l'épouse se montre, en l'absence de son mari non seulement portée sur les confidences intimes mais aussi complice et même compatissante, dénonçant l'état de subordination et même d'esclavage de l'élève par rapport au maître. Elle l'engage à mener une vie d'étudiant plus conforme à son âge mais s'affiche publiquement en sa compagnie et lui révèle des détails sur sa vie privée qui sont de nature à provoquer l'adultère. Pourtant, il y a de la part de l'épouse une série d'hésitations troublantes qui fait naître dans l'esprit du jeune homme une certaine confusion. Bizarrement Roland, confie qu'il n'aime guère ce genre de trahison, ce qui est étonnant de la part d'un jeune étudiant aussi amoureux de la vie, mais il ajoute qu'il est, comme l'épouse sans doute, sous l'influence de son maître. L'expression s'applique pour les deux, pour cette femme en tant qu'épouse et pour Roland en tant que disciple, l'ascendant que cet homme exerce notamment sur lui est présenté comme déstabilisant. Non seulement le professeur est peu reconnaissant du travail que son élève fournit à son profit mais il est parfois blessant voire humiliant au point que naît dans l'esprit du jeune homme à la fois une culpabilisation due à la jalousie et à une certaine tension entre eux mais aussi à un attachement certain à sa personne. Si le jeune homme se laisse aller, avec la complicité active de cette épouse, à ce qu'il appelle une trahison, c'est moins l'acte de chair qu'il réprouve mollement que le voile que cette femme lève pour lui sur les secrets intimes de son mariage. Pourtant Roland est à la fois honteux et demandeur de cette révélation qui, le pense-t-il, le déculpabiliserait. S'il séduit cette femme c'est aussi en pensant très fort au mari de cette dernière ce qui ajoute, dans son esprit en tout cas, à cette confusion de sentiments. [« J'ai de tout temps exécrer l'adultère, non par esprit de mesquine moralité, par pruderie et par vertu, non pas tant parce que c'est là un vol commis dans l’obscurité, la prise de possession d'un corps étranger, mais parce que presque toute femme, dans ces moments-là, trahit ce qu'il y a de plus secret chez son mari »].
On sent qu'il y a une évolution personnelle du jeune homme dans l'exercice du plaisir. Auparavant, il jetait sa gourme avec des femmes en ne s'attachant pas à elles, profitant de l'occasion pour jouir de l'instant, maintenant, avec l'épouse de son maître, c'est un peu différent. Certes il la fréquente au point de se retrouver dans son lit mais sa démarche est plus laborieuse, plus amoureuse aussi. Non seulement on a l'impression que leurs relations est d'une autre nature, qu'elles sont empreintes de retenue et de culpabilisation mais surtout elles interviennent avec en toile de fond les disciplines intellectuelles avec lesquelles Roland a décidé de renouer. C'est dans ce contexte sans doute qu'il en éprouve à la fois du dégoût et de la honte et que les relations qu'il peut avoir avec l'un et l'autre séparément sont tendues, qu'il est en quelque sorte partagé entre entre le plaisir dont il entend profiter et la colère qu'il ressent contre lui-même au point qu'il tente de fuir cette ambiance qu'il ressent comme malsaine. Cette fuite répond à celle qui l'a fait partir de Berlin mais elle est évidemment causée par des raisons différentes. Pourtant la réaction du maître est bien opposée, non seulement il suppose un écart de la part de son épouse, n'y accorde que peu d'importance et avoue même à Roland la grande liberté qu'il lui octroie par principe. Cette licence a pourtant un pendant puisque lui-même pratique des relations extra-conjugales, mais avec des hommes et il lui déclare son amour, ce qui achève de déstabiliser le jeune étudiant. Il s'attendait à un châtiment de la part de cet homme et c'est un aveu quelque peu humiliant qu'il reçoit de sa part, assorti d'ailleurs de confidences personnelles et bouleversantes. De cette situation finalement délétère il choisit de sortir par la fuite (encore une fois). Il tourne cette page de sa vie en choisissant de poursuivre son cursus universitaire mais surtout en se cachant sous le masque de la respectabilité. Cet épisode de sa vie est resté secret puisqu'il correspond autant à l'éveil intellectuel qu'à la rencontre d'une passion qui aurait pu être destructrice.
Il est vrai que Zweig se livre ici à une analyse psychologique très fine des sentiments de chaque personnage autant que le trouble qu'engendre une passion pour ceux qui en sont l'objet. Cela n'a pas échappé à Sigmund Freud qui expliquait les relations humaines par la sexualité.
Il s'agit d'une nouvelle parue en 1927 qui a fait l'objet d'une adaptation télévisuelle en 1979 réalisation d’Étienne Perrier avec Miche Piccoli dans la rôle du professeur.
©Hervé GAUTIER – Mai 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
TSUBAKI (Le poids des secrets 1)- AKI SHIMAZAKI
- Le 13/01/2014
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°718 – Janvier 2014.
TSUBAKI (Le poids des secrets 1)- AKI SHIMAZAKI – Actes sud
Juste avant de mourir et pour la première fois, une grand-mère japonaise, Yukiko, accepte de parler à son petit-fils de la guerre qui a exterminé le Japon. Elle est en effet la survivante des bombardements d' Hiroshima et de Nagasaki. Elle avait toujours gardé le silence sur cet épisode de sa vie pendant lequel son père et son grand-père ont été tués. Sa mère s'était mariée comme on le fait dans la société japonaise et était venue s'installer avec sa famille à Nagasaki alors qu'elle était originaire de Tokyo. Avec son mari ils avaient eu une fille, Yukiko qui découvre un peu par hasard qu'elle a un demi-frère. Son père a en effet eu, avant de se marier, une liaison avec une orpheline qu'il n'a pu épouser à cause des convenances familiales et avec qui il a eu un fils, Yukio. Cette orpheline s'est elle-même mariée ensuite avec un autre homme qui a reconnu Yukio. En venant s'établir à Nagasaki, le père de Yukiko a choisi de retrouver cette femme et de vivre avec elle une liaison amoureuse malgré sa famille. C'est ce que découvre sa fille. De plus Yukiko rencontre Yukio et les deux enfants tombent amoureux l'un de l'autre mais doivent se séparer à cause de leur parenté. Bouleversée par la trahison paternelle Yukiko décide d'empoisonner son père qui meurt le jour du bombardement de Nagasaki. Sa mère qui n'était pas présente à Nagasaki lors du largage de la bombe est morte cinq ans après le bombardement d'une leucémie. Elle était restée seule près la mort de son époux. A la mort de Yukiko, sa fille, Namiko, apprend l'existence de Yukio, son oncle, alors que sa mère lui avait toujours dit être une fille unique. Il est maintenant un homme âgé qu'elle rencontre à la fin.
C'est une histoire un peu compliquée qui mêle les générations mais c'est aussi celle d'amours contrariées d’adolescents, d'un adultère, des mensonges du père, de sa responsabilité dans la déliquescence de sa propre famille et la révélation d'un meurtre. La faute du père est d'autant plus grave qu'elle met un terme à l'amour authentique de deux enfants qui n'y sont pour rien. Le poids de ces secrets de famille est exprimés par les paroles de la grand-mère « Il y a des cruautés qu'on n'oublie jamais. Pour moi ce n'est pas la guerre ni la bombe atomique », une manière de dire que nul n'échappe à son destin.
C'est donc un bref roman où le parfum du camélia (Tsubaki) se mêle au cyanure mais ce n'est pas pour autant un roman policier. Bien qu'il s'agisse d'une saga, on y trouve peu de renseignements sur la société japonaise de l'époque à l'exception des règles régissant le mariage mais en revanche je note une analyse pertinente de ces événements historiques. Je ne sais pas si c'est à cause du style assez quelconque ou de l'histoire, mais je ne suis pas entré dans ce roman que j'ai cependant lu jusqu'à la fin.
©Hervé GAUTIER – Janvier 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE PIGEON- Patrick SÜSKIND
- Le 10/01/2014
- Dans Autres littératures étrangères
- 2 commentaires
N°716 – Janvier 2014.
LE PIGEON- Patrick SÜSKIND – FAYARD.(1987)
(Traduction de l'allemand par Bernard Lortholary).
Tout est médiocre chez Jonathan Noël, son emploi actuel de vigile dans une banque, sa jeunesse sans joie séparée de sa mère déportée dans un camp de concentration et de son père lui aussi disparu, sa vie d'enfant recueilli par un oncle, caché pendant la durée de la guerre puis employé comme travailleur agricole. Plus tard, en 1953, il fut sommé par ce parent de s'engager pour combattre en Indochine, ce qu’il fit docilement. Ce furent trois années tristes au terme desquelles il apprit que sa sœur aussi avait disparu. A son retour, cet oncle tyrannique exigea qu’il épouse une jeune fille qu'il n'avait jamais vue, ce qu'il accepta, pensant trouver enfin le bonheur et le calme. Las, elle était enceinte d'un autre avec qui elle partit. La seule chance qu'il eut fut de trouver près de la banque parisienne où il travaillait, un petit chambre de bonne sans confort au sixième étage d'une maison bourgeoise où d'emblée il se trouva bien et qu'il aménagea à son goût. Bien des années plus tard, alors qu'il est maintenant près de la retraite, il va l'acheter pour y être complètement chez lui. C'est donc un être rangé et solitaire qui vit au jour le jour depuis longtemps sans trop se poser de questions et surtout en évitant le plus possible les relations avec les autres hommes[« De toutes ces péripéties, Jonathan Noël tira la conclusion qu’on ne pouvait se fier aux humains et qu'on ne saurait vivre en paix qu'en les tenant à l'écart »]. Lui qui n'a pas vraiment eu de femme dans sa vie, sa petite chambre est « sa maîtresse car elle l’accueille tendrement en elle ».
Lui qui, d'ordinaire prenait soins de ne rencontrer personne quand il sortait de sa chambre tombe dans le couloir, un matin, nez à nez avec un pigeon. Cette rencontre fortuite le bouleverse au point que, dans son travail, il commet pour la première fois quelques étourderies dans son service, déchire son pantalon, événements sans importance mais qui, à ses yeux, prennent la dimension d'un drame puisqu'il se croit fini. Il envie même le clochard qui lui vit en liberté et sans aucune contrainte ; il en conçoit une véritable admiration lui pour qui la vie n'est qu’obéissance, qu'apparences, que subordination, que déférence. Alors qu'il a largement passé la cinquantaine et qu'il devrait pouvoir relativiser bien des choses de la vie, la rencontre avec ce pigeon le perturbe tellement qu'il va jusqu’à dormir à l'hôtel pour ne pas avoir à le rencontrer de nouveau, passe une nuit tourmentée qu'un orage d'été va venir inopportunément troubler en faisant revivre des souvenirs douloureux de son enfance. Il parvient cependant a surmonter cette épreuve, rentre chez lui pour constater que le pigeon a disparu, ce qui l'apaise. Bizarrement, cet être tourmenté revit son enfance mais celle d'avant la disparition de sa mère et éprouve un plaisir puéril à patauger dans les flaques d'eau. C'est un peu comme si l 'orage en éclatant l'avait délivré de ses phobies.
Voilà donc l'histoire apparemment sans relief de cet homme. Il m’apparaît qu'elle illustre une sorte de phobie des êtres humains, pas forcement de la vie qui s’arrêtera un jour, mais de ses semblables qui ne lui ont réservé que des déboires et qui sont la vraie source de tous ses malheurs. Sa vie qu'il a organisée lui-même et qui est volontairement en retrait du monde extérieur ne peut même pas s’accommoder de la présence d'un pauvre volatil arrivé là par hasard et qui provoque chez lui une véritable angoisse. Il y a toute une symbolique dans ce personnage à la fois lié à une divinité chrétienne par son nom et son prénom et par la vie quasi-monacale qu'il mène. Comme un ascète ou un mystique, il voit dans ce pigeon bien innocent qui intervient dans sa vie si bien réglée la personnalisation du mal au point qu'il la bouleverse. Il vit volontairement coupé des autres mais les humains ne lui sont pour autant pas étrangers puisqu’ils l'observent et en est conscient. A cet égard, le spectacle du clochard lui inspire une sorte d’injustice puisqu'il vit sans contrainte alors que lui qui a fait toute sa vie son devoir d'état vit un véritable malaise puisqu'un simple pigeon est capable de venir troubler un équilibre décidément bien précaire. La thématique de l’œil, celui du pigeon (« Cet œil, un petit disque rond, brun avec un point noir au centre était effrayant à voir... C'était un œil sans regard. Et il fixait Jonathan ») mais aussi celui de la couturière grossi par ses lunettes en est la marque. Même s'il refuse le monde des humains Jonathan Noël en fait cependant partie. Non seulement il doit travailler pour vivre mais aussi il a avec lui un minimum de contacts inévitables. Il partage avec la race humaine qu'il fuit des caractéristiques et pourtant il est seul au point de n'échanger que peu de mots avec la concierge et surtout de se parler à lui-même, à la deuxième personne.
Les déjections en sont une marque qu'il retrouve dans la saleté apparente du pigeon, celles des matières fécales de l'oiseau mais aussi celles du clochard (alors qu'il avait éprouvé une certaine attirance pour sa vie libre, dès lors qu'il l'a vu déféquer en pleine rue, il en a conçu du dégoût, du mépris et de la pitié) et même la répulsion qu'il éprouve face à sa propre urine rappellent aussi la décomposition, la vieillesse et la mort qui nous attend tous. Dans cette chambre qui a les dimension d'un cercueil, il songe au suicide
Ce récit est une méditation sur la vie qui n'est pas aussi belle que tous ceux à qui elle a souri veulent bien le proclamer, sur la fragilité du bonheur patiemment et même égoïstement tissé et peut-être aussi de l’être humain. La réaffirmation que les autres (et bien souvent nos proches qui sont bien plus à même de pratiquer la trahison et l'hypocrisie) sont trop souvent la source de nos maux peut paraître un truisme mais, à mon sens, il n'est pas inutile de le rappeler et de l'illustrer ainsi par une histoire romancée.
Cette chronique s'est déjà intéressé à l’œuvre de Süskin (La Feuille Volante n° 157 à propos de « La contrebasse » et n°159 à propos du «Parfum »). Cela a toujours été une intéressante invitation à la réflexion.
©Hervé GAUTIER – Janvier 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
Un combat et autres récits - Patrick SÜSKIND
- Le 09/01/2014
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°717 – Janvier 2014.
Un combat et autres récits Patrick SÜSKIND – FAYARD.(1996)
(Traduction de l'allemand par Bernard Lortholary).
Composer un recueil de nouvelles n'est pas une chose facile si on veut respecter un thème commun à tous les textes écrits le plus souvent à des périodes différentes et sous l'emprise d’une inspiration passagère mais suffisamment émouvante pour donner naissance à un récit qui va relater des faits réels ou évoquer sous couvert d'une fiction une obsession de l'auteur. L'écriture a ce pouvoir exceptionnel de transcender les désagréments petits ou grands de la vie, deuils, douleurs, bouleversements, visions furtives ou d'enjoliver un moment apparemment anodin. Des mots sur les maux mais aussi sur les émotions instantanées ou durables. Je préfère pour ma part cette explication à une littérature « alimentaire » qui suscite chez le lecteur davantage le négoce que l'intérêt émotionnel, le désir de durer, d'occuper le terrain médiatique... mais c'est là un autre débat.
Le livre refermé, ce que je retiens de ce recueil c'est la détresse ressentie par les différents personnages face à un événement de leur vie à une prise de conscience intérieure face à une agression extérieure bien souvent gratuite et volontairement blessante. Elle détruit celui qui en est l'objet et la rumeur, l'habitude délétère et grégaire se chargent de lui donner de l'ampleur en attendant les conséquences. Dans le premier texte, une jeune artiste pleine de talent et d'avenir est en butte à un critique qui lui reproche, l'air de rien son « manque de profondeur ». Je ne dirai jamais assez qu'il faut se méfier des critiques qui sont souvent des créateur ratés ou incapable de vraiment s’exprimer autrement qu'en stigmatisant les tentatives des autres. Et puis qu'est ce que la profondeur dans une œuvre ? On peut en discuter à l'infini et le succès en matière artistique est une chose fluctuante et assez irrationnelle. Bref cette jeune femme qui aurait pu développer son art en laissant une trace derrière elle et sa marque en ce monde, se trouve confrontée à cette observation qui, prise en compte par le plus grand nombre finit par la détruire. Le poison subtil de cette appréciation apparemment anodine se répand autour d'elle, lui colle à la peau, fait partie de sa vie au point qu'elle finit elle-même par se convaincre de sa pertinence. Après bien des années de lutte elle deviendra elle-même l'artisan de sa propre perte et il ne manquera pas de gens, ceux-là même qui s'en faisaient l'écho et l'ont laissé de débattre seule, pour le regretter... et passer à autre chose. On m’objectera que, de toutes façons les artistes vivent bien souvent hors du monde et passent leur temps à détruite leur vie, meurent bien souvent par suicide. Je ne peux pas ne pas voir là cette volonté de détruire ses semblables qui est inhérent à la race humaine.
Cette obsession est aussi présente dans le deuxième texte où un orfèvre du XVIII° siècle prend conscience par hasard de l'importance des coquillages dans sa vie, de leur faculté de se transformer en fossiles avec le temps et les éléments au point que la mort le saisit transformé en statue de pierre. Ce qui au départ n'était qu'une simple constatation, la découverte d'un socle de pierre qui, dans son parc empêchait les roses de pousser, devient pour lui une hantise personnelle qui, pour cette fois, ne doit rien à ses contemporains. Il s'agit sans doute d'un fantasme longtemps refoulé qui trouve ici l'occasion de s'actualiser, d’une notion philosophique qui prend soudain une dimension théologique. Même si la fin n'est ici que fictive, la certitude reste évidente : les idées personnelles qui guident notre vie peuvent parfaitement la détruire et la mort est là aussi au bout du chemin.
Quoiqu’il en soit, cet homme est seul comme celui qui, dans le dernier texte prend soudain conscience que sa mémoire lui manque, qu'il se révèle de plus en plus incapable de fixer le passé dans son cerveau et d'en conserver la trace. Cette perte de mémoire est l'apanage de la vieillesse même si, pour lui elle est prématurée. Seuls aussi ces deux joueurs d'échec, l'un face à l'autre, Jean, le vieux matador, méthodique et prudent face à un plus jeune, impétueux et imprévisible, avec en toile de fond les spectateurs parfois circonspects mais surtout avides de sensations et peu avares de commentaires. L'un perdra et se retirera en montrant le dédain du vaincu, l'autre gagnera avec son habituelle facilité mais avec des regrets quand même de n'avoir pas été assez rapide, assez décisif dans ce jeu. Lui aussi vieillissait, perdait de sa superbe. Il aurait voulu trouver en ce jeune homme son maître, pour lui passer le flambeau de la victoire qui faisait depuis si longtemps partie de son personnage et qu'il avait de plus en plus de mal à porter. C'était raté et cette fois il avait vaincu sans vraiment mener de combat comme il les aime, cela l’écœurait presque et son public aussi ressentait cela en l'abandonnant à son destin de champion. Sa décision était donc sans appel, il vaincrait à sa manière la solitude angoissante du joueur d’échec en se consacrant au jeu de boules qui au moins avait l'avantage d'être convivial et moins gourmand en états d'âme.
Ce sont donc des nouvelles angoissantes où la détresse se lit à chaque page. Une image de la vie finalement.
©Hervé GAUTIER – Janvier 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA MORT A VENISE – Thomas MANN
- Le 09/10/2013
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°684– Octobre 2013.
LA MORT A VENISE – Thomas MANN- Fayard.
Il est des endroits sur terre où, parce qu'ils sont plus fascinants que les autres, un être humain souhaite y rencontrer la mort. Ici ce n'est pas tout à fait cela. Cette nouvelle, publiée en 1912 est, comme bien des ouvrages de Thomas Mann, inspirée par sa biographie. L'auteur fit effectivement un voyage à Venise au milieu de l'année 1911 et commença à écrire ce texte.
Le célèbre écrivain munichois, reconnu et anobli, Gustav Aschenbach, la cinquantaine, est pris d'une soudaine envie de voyager. « Il lui fallait une détente, un peu d'imprévu, de flânerie, l'air du large qui lui rafraîchirait le sang, pour que l'été fût supportable et donnât des fruits. Il voyagerait donc...Une nuit en wagon-lit, et un farniente de trois ou quatre semaines dans quelques stations cosmopolites du riant Midi». Le voilà donc parti. Quand Aschenbach est sur la bateau qui l'amène à Venise, une sombre embarcation qui déjà appelle le thème de la mort, il est scandalisé par le spectacle d'un vieux-beau qui cache comme il peut son âge et sa décrépitude. Pour lui l'image de la vieillesse annonce la mort. L'homme fait ce qu'il peut pour cacher son état et cela énerve plutôt Aschenbach. Partout, l'idée de la mort est suggérée, jusque dans la couleur noire des gondoles vénitiennes. Quand il monte dans l'une d'elles qui l'amène à l'hôtel, il souhaite que ce voyage ne se termine jamais, ce qui est aussi l’image de l'éternité et du néant. La sérénissime elle-même n'a rien d’attrayant pour lui, le temps est maussade et l'odeur de la lagune est fétide. Lors d'un précédent séjour, il avait déjà eu cette sensation bizarre et avait quitté précipitamment la cité des doges. A peine arrivé à Venise, il songe donc à repartir à cause de la chaleur pesante et l'odeur répugnante des ruelles quand, dans son hôtel, il croise le regard d'un jeune adolescent polonais de quatorze ans, Tadzio, dont la beauté le bouleverse. Malgré cela, il n'abandonne pas son projet de départ mais un concours de circonstances l'y fait renoncer. Il prend conscience que, grâce à ce contre-temps il décide inconsciemment de rester à cause du jeune homme. Dès lors, il n'a plus d'yeux que pour son éphèbe dont il est follement amoureux et qui, lui semble-t-il, devient peu à peu son complice. Dès lors il est repris du désir d'écrire et c'est Eros qui lui souffle les mots. Il suit Tadzio de loin dans Venise sans vraiment l'aborder.
La saison touristique se termine et une odeur de phénol se répand dans les rues que les autorités justifient par le sirocco et la lourde température coutumière à cette période de l'année. En réalité un étrange mal, le choléra asiatique, s’installe dans la cité et l'épidémie s'étend malgré le silence des services officiels et une décision de quarantaine qui tarde. L’angoisse étreint Aschenbach que ce dernier combat en voulant retrouver un semblant de jeunesse peut-être pour séduire le jeune homme. L’écrivain meurt en contemplant une dernière fois l'objet de son amour.
Ce texte , d'inspiration romantique, est écrit dans une langue très riche et truffée d'allusions empruntées à la mythologie grecque où Éros et Thanatos tiennent une grande place. C'est une histoire de mort et de désir de mort, de passion comme désordre de la vie, inspirée par le dernier amour de Goethe qui, à soixante dix ans, tomba amoureux d'une jeune fille. L'auteur des « Souffrances du jeune Werther » fascinait Mann tout comme il fut bouleversé par la mort du compositeur Gustav Mahler intervenue quelques temps avant son voyage à Venise. L'influence dionysiaque de Nietzsche, une autre référence de Mann, est également présente dans cette nouvelle dont Luchino Visconti a tiré un film « Morte a Venezia » en 1971. On a beaucoup dit que cette nouvelle qui est inspirée par un fait réel, correspond à la révélation de l'homosexualité latente de l'auteur.
La seconde nouvelle intitulée « Tristan » met en scène un écrivain esthète, Detlev Spinell qui n'a jamais connu le succès et s'est retiré dans une sorte de sanatorium à Einsfried situé dans un univers montagneux et glacé . Il est l'archétype de l’égoïste capable seulement de détruire ce qu'il y a de beau autour de lui. Il y rencontre Gabriele Klöterjahn dont il s'éprend. Cette femme, maladive mais très belle va sans doute mourir de tuberculose mais ne répond pas à son amour. Elle vit dans l'ombre de son mari, prospère commerçant et attaché à sa réussite. Spinell, écrivain raté dont le travail essentiel consiste à expédier des lettres qui ne reçoivent généralement pas de réponse, se révèle superficiel face à cette femme. Il est même carrément pitoyable face au mari à qui il écrit à propos de son épouse. Cette atmosphère est un peu surréaliste et le monde qui est ici évoqué semble être déjà loin de la vie. Cette nouvelle de 1903 met en scène Spinell qui incarne la spiritualité esthétique opposée à la bourgeoisie utile représenté par l'époux de Gabriele, thème qu'on retrouvera dans« La montagne magique »(1924), œuvre bien plus célèbre de Mann qui reçut le Prix Nobel de Littérature en 1929. C'est aussi le thème de Tristan et Iseult, qui fut traité par Richard Wagner, celui de l'amour malheureux qui conduit à la mort.
La troisième nouvelle intitulée « Le chemin du cimetière » met en scène Lobgott Piepsam, un veuf qui a perdu également ses trois enfants, qui a été licencié de son travail et qui n'a pas été épargné par la vie au point que face à cette malchance et malgré sa volonté de résister moralement à l'adversité, il a perdu toute relation sociale. Il en a conçu une sorte de mépris de lui-même qui l'a conduit à devenir alcoolique. Cette nouvelle dont le titre est significatif, le présente sur le chemin du cimetière où il va fleurir les tombes de ses défunts. Puis tout à coup, parce qu'il est doublé par un cycliste, un jeune homme présenté comme « la vie triomphante face au marginal solitaire". Il se met à l'insulter sans raison, comme s'il le tenait pour responsable de tous ses malheurs. Alors, coup de folie, manifestation tangible de sa soûlerie ou envie soudaine et longtemps refoulée de désigner quelqu'un comme bouc émissaire ? Si cette dernière explication prévalait, elle me paraît bien humaine cependant.
La mort mais aussi la jalousie, la vengeance contre une destiné contraire ou un amour impossible sont les thèmes centraux de ce recueil.
© Hervé GAUTIER - Octobre 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
ANGES DECHUS – Gunnar Staalesen
- Le 04/10/2013
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°682– Octobre 2013.
ANGES DECHUS – Gunnar Staalesen- Gaia
Depuis que feu le service militaire a disparu, il ne reste plus que les rencontres d'anciens camarades de classe pour parler du bon vieux temps. Pour cela, il n'est rien de tel que des enterrements pour se retrouver, même si c'est autour d'un cercueil qu'on évoque les bons moments. Jan Petter Olsen vient de mourir, tombé d'un échafaudage, un banal accident du travail et c'est l'occasion pour Varg Veum, policier privé norvégien, de retrouver ses vieux copains, ceux avec qui il peut parler de sa jeunesse, des années d'insouciance, l'occasion aussi de se pencher sur le parcours personnel et professionnel de chacun et bien entendu du groupe de rock, « les Harpers » qui, à cette époque ont connu un vif succès et dont faisait parti le défunt. Varg, quant à lui était en marge des « Harpers », en était juste un admirateur qui les suivait.
La cérémonie terminée c'est dans les bars de Bergen que se poursuit leurs conversations d'autant qu'elles évoquent aussi leurs amours passées. Jakob, ancien membre de des « Harpers » demande à Varg de retrouver sa femme, Rebecca, qui vient de le quitter. C'est délicat pour lui puisque cette Rebecca est l'ancienne amie d'enfance de Varg que, bien sûr, il n'a pas oubliée, même si l'amour qu'il lui portait n'était pas vraiment partagé et qu'entre eux il n'y a jamais rien eu que de très chaste. Si, à l'époque il lui avait parlé, sa vie aurait sans doute pris une autre route ! C'est l'occasion pour Varg d'aller au devant de ses illusions perdues, de rencontrer les fantômes qu'il croyait oubliés. Apparemment elle est partie avec Johnny Solheim, le chanteur de l'ancien groupe mais rien n'est sûr, cette Rebecca paraît être une nomade de l'amour. Au fur et à mesure de ses recherches, notre « privé » constate que deux des anciens membres du groupe sont déjà morts, mais pas de vieillesse, et Johnny, objet des recherches de Varg est retrouvé poignardé en pleine rue. Pourtant, les choses se compliquent un peu puisque Jan Petter Olsen qui vient de mourir n'était pas membre des « Harpers ». Seul Jakob survit... pour combien de temps ? C'est d'autant plus inquiétant que Johnny, avant de mourir avait reçu un message explicite qui donnait à penser à une suite fatale, une série de quatre images d'anges dont deux était déjà rayés (Harpers veut dire anges en norvégien). De plus, il s'interroge sur ce qui a bien pu provoquer, à l'époque, son éclatement mystérieux, c'était en 1975, exactement le 16 octobre, onze ans avant !
Apparemment c'était une histoire de filles, Johnny avec Rebeca, déjà, et Jakob avec Anita , même si c'est un peu plus compliqué et apparemment la gent féminine tournait beaucoup autour des « Harpers » ! Ce n'était pas la même époque, on vivait plus librement, et le groupe avait des fans féminines prêtes à tout. Quant à Anita, elle semble avoir beaucoup contribué à l'éclatement du groupe, sa vie amoureuse était à l'époque sans entrave, son mariage avec Johnny battait de l'aile... Cette année 1975 a sonné comme celle des anges déchus. Elle a été le début de la fin pour le groupe mais aussi l'explication de bien des événements.
Les investigations de Varg l'amènent à connaître des membres de la police, le Commissaire Dankert Muus et son adjoint Ellingsen, Vadheim et Jensen... et de tâter des geôles locales puisqu'il était le dernier à avoir vu Johnny vivant. Ses recherches bousculent un peu le passé de ses anciens amis, dépoussièrent leur personnalité et leur amitié de façade, ce qui n'est jamais sans mauvaises surprises. Il est vrai qu'il patine un peu notre « privé » mais il a bien du mal à faire parler des gens qui veulent avant tout oublier cette période de leur vie. Silences, non-dits, choses inavouables, mensonges, adultères, viol, inceste, trahisons, rivalités amoureuses, vies brisées, vengeance, fascinations réciproques mais aussi haines et violence entre personnages, forment la trame de ce roman. Et tout cela sur fond de période de Noël, de normalité et d’apparences trompeuses qui dégoûtent Varg. Il y a là sans doute de quoi noyer ce chagrin là dans l'alcool. On se raccroche à ce qu'on peut face à une vie qui ne vous fait pas de cadeaux. S'y ajoute un discours religieux surannée et en aucune façon apaisant sauf pour ceux qui en sont convaincus d'avance, le contraire en tout cas d'un traditionnel message d'espoir qu'on est en droit d'attendre de cette institution. Ce qui importe au Pasteur Berge Brevick à la fois pathétique et hypocrite, c'est, comme au plus beau temps du Moyen-Age, qu'une âme soit sauvée ! Les hommes sont bien des anges déchus mais assurément l'espèce humaine n'est guère fréquentable, un roman de la désespérance ou peut-être de la réalité !
C'est un roman un peu glauque et pessimiste que j'ai lu jusqu'à la fin, partagé entre l'envie de connaître la fin et étonné par les nombreux rebondissements qui entretiennent le suspense. La fin quant à elle ne surprend guère et est bien dans le droit fil de ce récit, pas tellement fictif.
Je suis moi-même un peu versé dans la nostalgie et j'avoue que ce roman en est chargé, notamment avec des souvenirs d'enfance, des moments perdus ou gaspillés qu'on ne peut rattraper et qu'on regrette, avec le souvenir des Beatles, d'Elvis Presley et de James Dean, ce qui n'est pas pour me déplaire, même si cela ne me rajeunit pas !.
© Hervé GAUTIER - Octobre 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE RETOUR DU PROFESSEUR DE DANSE – Henning MANKELL
- Le 01/07/2013
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°654– Juillet 2013.
LE RETOUR DU PROFESSEUR DE DANSE – Henning MANKELL – SEUIL Policiers. Traduit du suédois par Anna Gibson.
Nous sommes en décembre 1945 en Allemagne, Donald Davenport arrive d'Angleterre pour y effectuer un travail bien particulier. Il s'agit d'exécuter par pendaison des criminels nazis. Il est le bourreau officiel.
Puis nous changeons brusquement d'époque et de lieu puisque nous sommes en Suède en 1999. Un jeune policier de 37 ans qui vient d'appendre qu'il est atteint d'un cancer, Stephan Lindman, vient d'être informé de l'assassinat d'un de ses anciens collègues, Herbert Molin, qui avait pris sa retraite dans un coin retiré et boisé du nord du pays. Il vivait seul dans une grande maison isolée et y menait une vie retirée mais énigmatique. Arrivé sur place et malgré une enquête officielle dont il est bien entendu exclus, Lindman, en bon policier, tente d'en savoir davantage. Il établit très vite que si Molin se cachait ici, c'était par peur, que ce meurtre n'est pas le fait d'un rôdeur mais au contraire ressemble à une véritable exécution, précédée d'ailleurs de tortures, que l'homme qu'il croyait connaître se révèle être un véritable étranger pour lui. Le modus operandi est en effet des plus bizarres et fait référence à une passion de la victime... pour le tango ! Intrigué, Lindman, qui aide maintenant ses collègues, pousse plus loin ses investigations et se pose de plus en plus de questions à propos de Molin. Le fait qu'il ait changé de nom, de profession, que ses enfants se soient définitivement détournés de lui, qu'il ait, pendant la guerre, adhéré au parti nazi au point de porter l'uniforme de la waffen SS et qu'il soit resté convaincu par cette idéologie jusqu'à la fin de sa vie, que son voisin soit par la suite lui aussi exécuté d'une manière apparemment rituelle, le fait aussi que Molin ait sciemment cherché à effacer les traces de son passé, contribuent grandement à épaissir le mystère qui l'entoure. Notre policier patine encore davantage quand, dans sa quête, il rencontre un vieux portraitiste admirateur d'Hitler, une femme, voisine de Molin, qui partage ses convictions politiques et s'accuse d'un meurtre qu'elle n'a apparemment pas pu commettre, peut-être pour protéger quelqu'un, la disparition énigmatique d’un chien qui pourrait bien avoir une signification précise dans son enquête, la rencontre avec la fille de Molin qui elle aussi semble vouloir cacher bien des choses la concernant, des ombres qui rôdent autour de lui, un vieil avocat qui se veut amnésique, des suspects de plus en plus nombreux et insaisissables et une révélation inattendue sur son propre père à l'occasion d'une incursion dans un appartement qui fait de lui un véritable cambrioleur... Cela fait beaucoup pour quelqu'un qui venait simplement dans ce coin reculé du pays pour assister aux obsèques d'un ancien collègue !
Parallèlement, le lecteur fait connaissance d'Aaron Silberstein qui lui aussi a changé de nom pour adopter le mode de vie argentin et dont l'ombre mystérieuse plane sur tout ce récit. Il porte en lui la vengeance et l'accomplira quoi qu'ils arrive.
Ce roman palpitant du début à la fin, avec en toile de fond un pan d'histoire controversé de la Suède et la survivance éventuelle de l’idéologie nationale- socialiste, des personnages qui changent d'identité, une enquête qui se complique de chapitre en chapitre par des rebondissements inattendus et des pistes en forme d'impasses, ne met pas, pour une fois en scène le commissaire Kurt Wallander. Cela n'en a pas moins été pour moi un bon moment de lecture.
© Hervé GAUTIER - Juillet 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA LIONNE BLANCHE – Henning MANKELL
- Le 28/06/2013
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°653– Juin 2013.
LA LIONNE BLANCHE – Henning MANKELL – SEUIL Policiers.
Traduit du suédois par Anna Gibson.
Nous sommes en avril 1992 et une jeune mère de famille, agent immobilier, Louise Åkerblom a disparu. C'est son mari qui vient en faire la déclaration au commissaire Wallander. D'emblée, celui-ci subodore une disparition peu commune qui n'a rien à voir avec une passade amoureuse. C'est là une de ses intuitions coutumières. Le couple était heureux, méthodiste de confession, très croyant et pratiquant au sein d'une petite communauté religieuse. Les recherches aussitôt entreprises orientent les policiers vers l'explosion d'une maison inhabitée et isolée. Dans les décombres, on retrouve les débris d'un poste émetteur, des restes épars d'un revolver uniquement fabriqué en Afrique du Sud et un doigt humain... noir ! A priori rien à voir avec la disparition de Louise qui est cependant retrouvée assassinée au fond d'un puits d'une ferme abandonnée. C'est évidemment Kurt Wallander qui est chargé de cette affaire au demeurant assez obscure.
La chute du mur de Berlin et la disparition de l'ex-URSS ont éparpillé dans le monde entier des agents du KGB qui, contre la promesse d'une nouvelle vie et d'un passeport, sont prêts à tout. Le meurtre est une de leurs spécialités et Konovalenko en fait partie. La démocratie suédoise reste pour eux un refuge. A peu près à cette époque, en Afrique du Sud, une organisation criminelle favorable au maintien de l'apartheid projette d'assassiner une personnalité politique de premier plan. Konovalenko qui souhaite se réfugier en Afrique du Sud pour y changer de vie, lui offre de familiariser un tueur professionnel sud-africain noir, Victor Mabasha, avec de nouvelles armes mises au point en Union soviétique et pour cela le fait venir en Suède. L'affaire tourne mal cependant, une femme est assassinée par hasard et Mabasha s'évanouit dans la nature, après avoir perdu un doigt.
Sur place, en Afrique du Sud, l'insécurité grandit, la tension monte, et , au sommet de l’État, on sent que quelque chose va se passer qui ressemble à un attentat. Frédéric de Klerk, alors président de la République et désireux de mettre fin à l'apartheid fait figure de victime potentielle mais Nelson Mandela, enfin sorti de prison, porte les espoirs du peuple noir. L'Afrique du Sud est encore gouvernée par une minorité blanche et la perspective d'un changement politique en faveur des Noirs fait craindre une guerre civile, une vengeance collective et une répression sanglante.
Ces deux affaires n'ont rien à voir l'une avec l'autre au départ. Wallander est chargé du meurtre de Louise Åkerblom, mais ses investigations l'amènent à Stockholm où un jeune policier vient d'être tué au cours d'une opération. Encore une fois l'intuition de Wallander lui dit qu'il y a sans doute un lien entre ces affaires. C'est donc le début d'une histoire un peu compliquée avec des complications, des débordements, des erreurs qui égarent un peu le lecteur. La toile de fond est constituée par l'Afrique du Sud où notre commissaire n'a jamais mis les pieds, la silhouette de deux personnalités d'exception que sont Nelson Mandela et Frederick de Clerk et la marche inexorable de l'Histoire dans ce pays.
Au cours de ce roman, le lecteur n'est pas à l'abri de ses surprises et les rebondissements du scénario vont l'étonner autant sur le plan du dépaysement géographique que sur l'attitude de Wallander. Il perdra un temps tout sens de la raison et même des réalités en n'écoutant que son devoir de policier pour mener à bien une mission qui, petit à petit le dépasse. Malgré lui sa fille Linda sera impliquée dans cette enquête et lui sera un peu malgré lui l'acteur médiatique de cette affaire qui se déroule dans la petite ville d'Ystad, d'ordinaire tranquille. Il devient le meurtrier d'un homme et ce geste, même accompli en état de légitime défense, le transforme complètement au point qu'il est lui-même recherché comme un authentique criminel. L'auteur nous montre ici un Wallander vieillissant qui doute à la fois de lui-même et de sa mission de policier, qui culpabilise à cause de la mort d'un homme dont il s'estime responsable. Cela provoque chez lui une grave dépression dont il aura sans doute du mal à se remettre d'autant qu'il est seul après un divorce difficile et qu'il a du mal à renouer avec une femme.
J'ai rencontré cet auteur par hasard et je dois dire que l'écriture de ce roman, et probablement sa traduction (je ne lis pas le suédois dans le texte) distillent le suspense jusqu'à la fin pour le plus grand plaisir du lecteur attentif et passionné.
© Hervé GAUTIER - Juin 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA FAILLE SOUTERRAINE – Henning Mankell
- Le 21/06/2013
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°652– Juin 2013.
LA FAILLE SOUTERRAINE – Henning Mankell – Policiers SEUIL
Traduit du suédois par Anna Gibson.
Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai eu très tôt une passion pour les romans policiers. Bizarrement, j'ai toujours été moins attiré par l'histoire, l'énigme policière, que par le roman lui-même et surtout les personnages. Ces derniers m'ont toujours paru beaucoup intéressants par leur personnalité, leur psychologie, leur façon d'agir, la qualité de leur raisonnement, leur histoire personnelle même.
Dans ce volume qui est en fait un recueil de cinq nouvelles plus ou moins longues, dont l'action se situe avant les titres déjà parus, l'auteur nous présente les débuts dans la police de Kurt Wallander, déjà héro d'une série que la télévision a popularisé et que le succès littéraire a consacré. Dans « Le coup de couteau », nous sommes en 1969, il est encore jeune gardien en uniforme de 22 ans qui va intégrer la criminelle à Malmö, autant dire qu'il apprend son nouveau métier. Il rencontre Mona qu'il épousera et avec qui il aura une fille, Linda, a déjà des relations houleuses avec son père qui n'a jamais admis son engagement dans la police. Son côté un peu perdu me plaît bien, il n'est guère un amoureux flamboyant, est plutôt en retard à ses rendez-vous, n'est pas vraiment le Don Juan irrésistible que nombre de films du même genre nous ont donné à voir... Le personnage se révèle éminemment humain et réfléchit avant d'agir mais fait des erreurs, écoute son intuition, son entêtement et son désir de s'abstraire des procédures réglementaires, de privilégier les enquêtes parallèles, marquent déjà le futur inspecteur. Je n'ai jamais goûté les feuilletons américains du même tonneau où l'hémoglobine coule à chaque scène parce qu'un américain est avant tout un cow-boy qui sait faire honneur à la tradition et l'usage systématique de son arme.
Avec le déroulement des récits, nous le voyons vieillir, il monte en grade, devient commissaire et est affecté en Ystad, se montre de plus en plus dépressif, à cause des meurtres sanglants dont il a à connaître dans le cadre de ses enquêtes mais aussi sans doute de sa vie affective qui part à la dérive. Il combat cela par l'alcool et ce n'est sans doute pas ce qu'il fait de mieux. Dans « La mort d'un photographe », sa femme a obtenu une séparation amiable, ne vit plus avec lui et supportait sans doute mal son travail de policier comme c'est le cas de la plupart des épouses de flics. Seule Linda, leur fille, maintient encore un semblant de lien dans leur couple. Kurt se sent seul parce qu'elle lui manque, lui échappe aussi et il mesure sur lui-même le temps qui passe, la vieillesse qui arrive. Dans « La pyramide », il est définitivement divorcé et un peu paumé, Linda, alors âgée de 19 ans, cherche sa voie et lui tente sans grande conviction une liaison avec une autre femme mais sent bien que cela ne marchera pas. Il a de la vie une autre vision mais a, lui aussi, été rattrapé par elle, a subi ses leçons. La mélancolie qui en résulte lui donne un côté humain qui le fait ressembler au commun des mortels, une sorte d'anti-héros en quelque sorte, un policier qui fait passer son métier avant tout, un homme de bonne volonté.
Même s'il y a autour de lui une équipe de policiers chevronnés, il reste un homme seul d'où émane une certaine mélancolie et qui est aussi doué pour passer à côté de son propre bonheur. Il incarne à lui seul ce qu'il est convenu d'appeler « l'inquiétude suédoise » et enquête bien souvent sur des solitaires comme lui, victimes ou auteurs.
Cela dit, le suspense est savamment distillé au cours des récits et jusqu'à la fin, le style est agréable à lire. C'est à chaque fois un bon moment de lecture.
© Hervé GAUTIER - Juin 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE BUREAU DES OBJETS TROUVES – Siegfried Lenz
- Le 08/02/2013
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°626– Février 2013.
LE BUREAU DES OBJETS TROUVES – Siegfried Lenz1 – Robert Laffonf.
Traduit de l'allemand par Frédéric Weinmann.
Henry Neff, 24 ans, se présente au bureau des objets trouvés d'une gare allemande (« Là où nulle part au monde(on ne rencontre) autant de contrition, d'angoisse et de mea-culpa »).
S'il fait cela, ce n'est pas parce qu'il a égaré un objet comme on pourrait s'y attendre mais il vient y prendre son poste et surtout souhaite faire une longue carrière dans cet emploi subalterne alors qu'un poste plus important s'offre à lui dans le négoce familial. Pourquoi cette voie de garage pour un homme jeune et plein d'avenir ? C'est qu'il est un peu marginal, cet Henry et avoue volontiers une passion pour le hockey et pour les marque-pages ! Pire peut-être, il semble avoir choisi cet emploi aux « objets trouvés » pour satisfaire son imagination débordante, un peu comme si c'était là sa seule motivation. Chaque propriétaire met un point d'honneur à récupérer des objets anodins, irremplaçables pour eux, un peu comme si toute leur vie y était contenue et en dépendait. Lui considère que ces objets improbables venus de nulle part qui se retrouvent ici à titre temporaire sont certes autant de tranches de vie appartenant à des inconnus mais aussi autant d’invitations à une mise en situation qui satisfait son imaginaire. Il devient le metteur en scène de saynètes parfois un peu surréalistes.
Au travail, il cohabite avec des collègues aussi différents que Paula, une femme encore jeune qui souffre que son mari la délaisse et qu'il cherche à consoler, ou qu' Albert, un vieux garçon tout entier dévoué à son vieux père.
Son travail l'amène à rencontrer Fédor Lagutin, un mathématicien universitaire russe avec qui il devient ami. Ce dernier ne laisse indifférentes ni Barbara, la sœur d'Henry qui travaille dans la florissante entreprise familiale ni même sa mère. Les deux femmes apprécient autant la discrétion de l'homme que sa manière de parler la langue allemande dont il maîtrise parfaitement les nuances. Cette manière d'être est, en plus des mathématiques, son oasis à lui.
Henry et d'ailleurs son ami Fédor, un peu perdus dans leur monde respectif, semblent apprécier la tranquillité, pourtant la bulle dans laquelle s'était volontairement enfermé Henry se fissure sous les coups du quotidien: A l'extérieur, il est agressé par une bande de motards, il voudrait bien, en séduisant Paula, sortir de sa routine ou s'enfermer dans un autre univers, mais cette femme qui l'aime bien et l'apprécie comme collègue ne veut pas en faire son amant parce qu'elle sait qu'une passade ne débouche sur rien et lui préfère la vie rassurante de femme mariée, moins délétère à ses yeux que celle de femme adultère. Au travail, Albert, trop vieux, est mis au chômage malgré les initiatives généreuses d'Henry. Fédor, quant à lui, quitte l'Allemagne devant les scènes de racisme ordinaire et Barbara est désespérée par la fuite de Fédor.
Dans une société qui apprécie les êtres à l'aune de leur rentabilité, leur richesse, leur potentialité, ce livre est consacré aux « perdants », non pas tant à ceux qui ont perdus un objet, mais surtout à ceux, comme Henry, qui refusent cette logique de la société, ceux qui préfèrent être des rêveurs et surtout pas des décideurs, ceux qui refusent la promotion parce que cette finalité ne leur convient pas, qui préfèrent rester à l'écart de tout cela pour être tout simplement seuls et libres, c'est à dire en marge des exigences sociales. Ce roman consacre cette impossibilité en mettant en évidence la réalité quotidienne faite d'intolérance, d'incompréhension, de haine, d'hostilités, de logique financière, une manière de rappeler que si une forme de vie marginale est possible, elle se heurte à tous ceux qui ne la comprennent pas ou simplement ne l'admettent pas.
Il est aussi question de ceux qui agressent les autres, les plus faibles, ceux-là même qui ont choisi une forme marginale de vie. Ces provocateurs portent la méchanceté en eux, la matérialise avec violence et lâcheté sous la forme d'un racisme ordinaire ou de l'ostracisme, pour se prouver qu'ils sont les plus forts ou simplement qu'ils existent.
Le romancier nous raconte une histoire, lui aussi se réfugie dans sa bulle et recrée un monde qu'il offre au lecteur, libre à lui de le recevoir ou pas. Ce roman peut être considéré comme une simple fiction, mais en réalité tout cela est bien banal, c'est un simple miroir de notre quotidien. Combien sommes-nous à avoir voulu vivre dans de belles certitudes, à avoir voulu nous draper dans l'assurance que les choses ne changeront jamais, qu'elle sont le gage d'une vie selon notre cœur... Puis un jour tout s'effondre brusquement à l'occasion d'un rien, mais ce rien est révélateur d'un changement définitif. Combien sommes-nous à refuser l'autre parce que simplement il est différent ?
©Hervé GAUTIER – Févrer 2013.http://hervegautier.e-monsite.com
1Siegfried Lenz, né en 1926, est l'un des écrivains allemands les plus connus. Il est l'auteur de romans et de nouvelles et a obtenu le Prix Goethe en 1999.
-
LE SIXIEME HOMME – Monica Kristensen
- Le 03/02/2013
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°625– Février 2013.
LE SIXIEME HOMME – Monica Kristensen - Gaïa Polar.
Traduit du norvégien par Loup-Marelle Besançon.
L'archipel norvégien du Svalbard est situé dans la partie la plus septentrionale de l'Europe, à la jonction des océans Arctique et Atlantique. Il est plongé pendant une grande partie de l'année dans la nuit polaire et nous sommes en hiver ! Cette période autant que la situation géographique de ces îles sont de nature à modifier le comportement de ceux qui n'en sont pas originaires. A Longyearbyen, la minuscule capitale, il ne se passe jamais rien dans cette ville plus habituée aux ténèbres glacées et à l'arrivée soudaine des ours polaires dont les chemins migratoires passent par là. Pour la police locale, la routine administrative est constituée des petits trafics des marins-pêcheurs, des méfaits de l'alcoolisme, des mésententes conjugales ou des magouilles des contrebandiers dans une ville qui vit exclusivement de la mine de charbon. C'est un microcosme où tout le monde se connaît et bien entendu tout le monde s'épie de sorte que le secret ici n'a que peu de place. Un sorte d'univers clos !
Il est donc difficile d'imaginer que cette petite cité puisse cacher un criminel aussi bien croit plus volontiers à un accident toujours possible quand, au jardin d'enfants, d'ordinaire bien surveillé, la petite Ella Olsen, cinq ans, a disparu. Au départ on ne s'affole pas trop puisque les enfants jouent souvent à se cacher et puis cela ne viendrait à l'idée de personne d'enlever un enfant ici ! Il n'empêche, c'est quand même un problème pour la police locale dont le petit effectif va être mobilisé pour la retrouver. L'ennui c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'indices, seulement des traces de pas dans la neige qui mènent à la mine. Rapidement l’enquête s'oriente vers le père, Steinar Olsen, ingénieur récemment arrivé à la mine et qui, lui aussi disparaît à son tour. Son ménage bat un peu de l'aile, des projets de divorce sont même évoqués ; il est un peu trop porté sur la bouteille et il aurait parfaitement pu venir chercher sa fille pour affoler son épouse. Quant à lui, son nouveau travail n'est guère satisfaisant et on parle même de le licencier quelques mois après son embauche.
L'hypothèse d'un ravisseur se fait jour peu à peu ou celle d'un voyeur qui offrait volontiers des bonbons aux enfants. Bref, la police nage en plein mystère et les trois policiers de l'île seront vite rejoints par un renfort venu du continent. Peu à peu des secrets se révèlent, des adultères, des lettres anonymes avec menace de mort...
A la mine où Steinar Olsen a été embauché son arrivée n'est pas passée inaperçue et les deux mineurs qui l'ont accueilli, et dont il deviendra plus tard le complice, l'initient au mystère des lieux, lui parlant notamment de ce sixième homme « qui suit les gueules noires au fond de la mine », une sorte de fantôme né dans cette atmosphère confinée et mystérieuse qui tisse des légendes. On se demande qui il est et on le confond volontiers avec le voyeur du jardin d'enfants.
Dans une ambiance un peu irréelle faite de tempêtes glacées, de navigations parmi les icebergs, de chasses aux rennes et de drames intimes, le dépaysement joue complètement. Il faut cependant un parcours un peu chaotique d'Olsen avec sa fille, un incendie mystérieux sur un parking, la mort accidentelle de l'ingénieur, une vengeance de femme qui tourne mal et une série d'accidents miniers pour que cette histoire de fantôme, ce sixième homme caché à la fois au fond de la mine et dans les rues désertes, et qu'on soupçonne de rapt, débouche sur une fin heureuse.
Monica Kristensen qui est aussi glaciologue, connaît bien cette région pour y avoir séjourné pendant six années. Avec un art consomme du suspens, elle fait partager à son lecteur la beauté des paysages autant que la dure vie des mineur du Spitberg. C'est donc autant un roman policier qu'un ouvrage documentaire sur cette région.
Cet volume appartient à une série de polars se déroulant au Svalbard.
l
I
©Hervé GAUTIER – Févrer 2013.http://hervegautier.e-monsite.com
-
Le loup dans la bergerie - Gunnar Staalesen
- Le 06/06/2012
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°581– Juin 2012.
LE LOUP DANS LA BERGERIE – Gunnar Staalesen – Gaïa [1977]
Traduit du norvégien par Olivier Gouchet.
Pour Varg Veum, détective privé de son état à Bergen (Norvège), cette période de l'année est plutôt exceptionnelle : deux clients pratiquement à la fois sollicitent ses services. L'un, un avocat connu, William Moberg, pense que sa femme le trompe et souhaite qu'il en fasse la preuve et l'autre, Ragnar Veide veut retrouver sa sœur, Margeret, disparue depuis de nombreuses années et dont il est sans nouvelles. C'est d'autant plus urgent que leur père est à l'article de la mort. Bien qu'il lui faille payer ses factures qui s'entassent dangereusement sur son bureau, il refuse la première enquête mais accepte la seconde... pourtant il ne tarde pas à s'apercevoir, d'après une photo, qu'il s'agit de la même personne ! Après d'ennuyeuses filatures, l'épouse de l’avocat est retrouvée morte et le frère commanditaire de la deuxième enquête s'avère être une autre personne... et la police soupçonne Veum d'être l'auteur du meurtre. C'est donc un classique du roman policier qui nous est ici proposé.
Il y a du Nestor Burma chez Veum, les même ennuis avec les autorités, le même désœuvrement, la même foule de cadavres qui l'entoure, le même problème avec l'alcool et les femmes, le potentiel de séduction en moins peut-être ? Bref, l'image traditionnelle du privé. Le thème abordé ici est le trafic de drogue, ce qui était peut-être original il y a quelques années, à l'époque de l'écriture de ce premier roman,(1977) mais qui aujourd'hui est plutôt banal. Comme cela sera son habitude dans les autres romans, il le livre à une attaque de la société, montrant ici que les bénéficiaires de ce commerce illicite ne sont pas forcement ceux qu'on attend. Il dénonce ici les agissements d'une couche pourtant aisée de la société norvégienne de cette ville portuaire mais qui se drape dans l'hypocrisie et le faux semblant. Il s'agit aussi de relations extra-conjugales qui conduiront Veum à un réseau de prostitution.
Comme je l'ai déjà indiqué dans le numéro précédent (La Feuille Volante n° 580), j'ai découvert cet auteur par hasard. J'avais déjà noté le style humoristique qui doit sans doute beaucoup à la traduction, mais j'ai toujours un faible pour un livre qui m'accroche dès la première ligne. Au moins cela m’encourage à poursuivre ma lecture. Jugez plutôt la première phrase de celui-ci « Au commencement était le bureau et au bureau, il y avait moi,les pieds sur la table. Le bureau était rangé … A gauche il y avait une pile de facture, à droite il y avait ce que je possédait en argent liquide, dix couronnes et trente ore... » Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai trouvé cela engageant ! J'ai pu vérifier au long du roman qu'il a aussi le sens de la formule.
Il s'agit ici du premier roman de Gunnar Staalesen
©Hervé GAUTIER – Juin 2012.http://hervegautier.e-monsite.com
-
La nuit tous les loups sont gris - Gunnar Staalesen
- Le 03/06/2012
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°580– Juin 2012.
LA NUIT TOUS LES LOUPS SONT GRIS – Gunnar Staalesen - Gaïa
Traduit du norvégien par Alexis Fouillet.
Il est un peu conventionnel ce Varg Veum, détective privé de son état, avec son manteau épais et son chapeau de pluie. Il est vrai que nous sommes à Bergen, en Norvège. Comme il se doit, il a été abandonné par la femme qu'il aime et noie son chagrin dans les bars. Les débits de boissons sont des endroits d'exception où on fait des rencontres, mais elles sont plutôt masculines. N'allez pas vous méprendre, Veum reste un professionnel d'autant plus qu'il rencontre Hjalmar Nymark, un policier à la retraite mais aussi un ancien Résistant. Et quand deux détectives se rencontrent, qu'est ce qu'ils se racontent … (air connu) Justement, à force de sympathiser, l'ancien policier évoque pour son interlocuteur une vieille affaire dont il garde une mémoire encore vivre, d'autant qu'il est persuadé que le coupable n'a jamais été inquiété. Il s'agirait de l'incendie d'une usine de peinture dans les années 50 qui avait fait plusieurs morts. Il pense avoir retrouvé la trace d'un homme, Harald Ullven surnommé « Mort au rats », ancien collaborateur des nazis pendant la guerre et qui était employé et qui serait responsable de ce sinistre pourtant considéré comme un accident et classé sans suite. Cet homme a une particularité physique : il boite. De plus, il y a la disparition bizarre d'un autre homme, « Johan le Docker », celle d'un ouvrier un peu trop curieux et la présence d'un ancien président du conseil municipal de Bergen...
Veum, qui s'ennuie un peu reprend mollement cette affaire et veut bien admettre qu'elle n'a pas été complètement élucidée puisque cet ancien policier le prétend, mais quand ce dernier est renversé par une voiture cela prend des proportions inquiétantes. Certes Nymark survit mais trouve mystérieusement la mort à sa sortie de l'hôpital, avec, en prime l'ombre de Ullven. C'est donc au tour de notre détective de s'occuper sérieusement de cette affaire, ce que, bien entendu, il fait. Même si c'est trente ans après, Veum refait l'enquête, contacte les rares survivants de cet incendie. Après les bars qu'il affectionne, c'est dans le milieu des SDF qu'il va devoir exercer ses talents puisque un survivant de l'incendie est maintenant dans la rue. Décidément, ce Veum a tous les attributs d'un privé avec en plus la nuit « où tous les loups sont gris ».
C'est non seulement un roman policier avec morts mystérieuses, enquêtes qui soulèvent plus de doutes qu'elles ne résolvent de questions, rebondissements, fausses-pistes mais c'est aussi une évocation de cette période troublée de l'histoire de la Norvège où, comme ailleurs, une partie du pays s'est soulevé contre l'occupant et l'autre a choisi la collaboration. Il met en lumière la collusion entre le nazi Ullven et et le démocrate Fanebust qui avait été aussi un héros de la Résistance.
C'est aussi la critique du milieu économique qui prospère dans le mensonge et le crime tandis que les plus faibles sont appauvris. S'il lui est possible d'accéder aux plus démunis, il lui est en revanche impossible de rencontrer notamment le patron l'usine qui a brûlé et qui aurait pu éclairer son enquête. C'est la manière de l'auteur de dénoncer les disparités qui règnent dans son pays.
J'avoue que je ne connaissais pas cet écrivain rencontré par hasard sur les rayonnages de la bibliothèque où j'ai mes habitudes. Son personnage fétiche, même s'il date un peu et s'il a des côtés bien conventionnels me plaît bien. Ce n'est pas tant qu'il est en conflit avec les femmes et qu'il a un faible pour l'alcool et les bars, mais le regard qu'il pose sur la société qui l'entoure et le cynisme dont il fait preuve ne me laisse pas indifférent. C'est une histoire un peu compliquée avec des gens qui ne veulent pas parler, d'autres qui ont changé de nom, d'autres encore qui se sont vengés en temps de paix d'une guerre qui ne leur avait pas permis de faire justice.
Il y a aussi ces réparties qui se sont gravées dans ma mémoire [-ça, ça venait du fond du cœur – ça vient tout droit de mon cul, renchérit-elle en tordant la bouche. - C'est ce que je voulais dire, certains l'ont à cet endroit.]
C'est une occasion aussi de voir ce pays sous un autre jour que l'actualité immédiate nous l'a présenté, avec notamment les meurtres perpétrés par Anders Behring Breivik.
Au bout du compte, je ne me suis pas ennuyé, et c'est cela l'essentiel.
©Hervé GAUTIER – Juin 2012.http://hervegautier.e-monsite.com
-
El BUSCÓN
- Le 17/03/2012
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°559 – Mars 2012
El BUSCÓN – Francisco de Quevedo – Éditions Sillage.
Traduction de Rétif de la Bretonne.
Le titre tout d'abord « el Buscón », vient du verbe espagnol buscar qui signifie chercher. On pourrait donc traduire ce nom par « celui qui cherche, le chercheur » mais il serait plus pertinent de lui préférer « le filou », bien plus dans l'esprit du roman picaresque car c'est bien dans ce courant et dans la continuité de « La vie de Lazarillo de Tormes » que s'inscrit cette œuvre de jeunesse écrite probablement vers 1603. (sur ce récit et sur le roman picaresque en général, voir la Feuille Volante n°558).
Le sous-titre espagnol de ce roman est plus explicite puisque qu'il précise qu'il s'agit de « [l'] histoire de la vie du filou appelé Don Pablo, exemple de vagabond rusé ». Il s'agit de l'unique roman de Francisco de Quevedo y Villegas [1580-1645], écrivain baroque du « siècle d'or » espagnol, contemporain de Cervantès, érudit, homme d'action, polémiste et humaniste. L'auteur y raconte l'histoire de ce Don Pablo, fils d'un barbier dont l'honnêteté douteuse le fera mourir sur l'échafaud pour vol et d'une mère tout aussi peu recommandable emprisonnée pour sorcellerie. Très tôt il est mis au service de Don Diego, un fils de famille qui l'emmène avec lui à Alcalà de Hénarès pour y étudier. Pourtant, loin de profiter de cette occasion pour être plus instruit et devenir meilleur, il préfère la situation de voleur et d'escroc, ce qui fait de lui un fugitif particulièrement apte à duper ses contemporains, n'hésitant pas à se déguiser pour cela en mendiant, en comédien ou en homme d' Église, à se dire noble ou dévot, à changer de nom pour exercer sa vrai profession d'aigrefin itinérant. Il est vrai qu'au début de sa vie, il fut lui aussi abusé par ses professeurs et retint d'eux surtout cette leçon.
Au lieu d'étudier, il a choisi une vie d'errant qui lui convient parfaitement et la liste est longue des compagnons avec qui il s'acoquinera volontairement, chacun d'eux ayant sa spécialité pour extorquer de l'argent au pauvre monde, jouant alternativement sur l'hypocrisie, le mensonge, la charlatanerie, la séduction, le vol... Il donne lui-même à son lecteur des conseils avisés pour tricher au jeu. Bien sûr, à vivre ainsi, Don Pablo tâte des prisons du royaume mais trouve toujours le moyen d'en sortir par ruse.
Il s'agit donc d'un récit humoristique plaisant à lire parce que admirablement traduit par Rétif de la Bretonne. Bien qu'il s'inscrive dans le courant picaresque, l'auteur cherche moins à condamner des actes répréhensibles qui mériteraient une punition qu'à distraire et amuser ses lecteurs. D'ailleurs nombres d'actes condamnables, perpétrés par Don Pablo, restent impunis et on cherchera vainement une fin moralisatrice à ce récit. Pourtant, il n'échappera pas au lecteur attentif que Don Pablo tente quand même de s'évader de sa condition, notamment par un riche mariage, et, peut-être, de s'améliorer, mais il échoue dans toutes ces entreprises qui peuvent passer pour des tentatives avortées d'ascension sociale parce que la malchance le poursuit. Pourtant, si on en juge par la lettre qu'il laisse à son oncle, bourreau à Ségovie, il veut à la fois oublier sa famille et poursuivre son errance parasite et fructueuse. En tout état de cause un roturier ne pourra jamais devenir noble ce qui est bien dans l'esprit du roman picaresque. A la fin, il tente de partir pour l'Inde et ainsi de refaire sa vie mais l'auteur nous laisse à penser qu'il échoue également dans cette entreprise. Tout au plus conclue-t-il lui-même « qu'il ne suffit pas à l'homme de se transplanter pour que son état se bonifie; il faut encore qu'il change de vie et de mœurs, quand elles son dépravées et changer est une chose presque impossible à l'homme familiarisé avec le crime, et qui s'y endurci » sans qu'on sache très bien s'il s'agit là d'amères regrets, d'une leçon temporaire dont évidemment il ne tirera aucun profit ou une ultime pirouette...
Dans ce récit, Quevedo ne manque pas de faire des réflexions aigres sur le monde qui l'entoure, de se moquer de la société de son temps, les intellectuels comme les ecclésiastiques, les charlatans comme les gens du peuple et des nobles ruinés. C'est donc aussi une critique sociologique qui nous est offerte sous couvert d'une présentation résolument comique.
Le style de ce roman est baroque, notamment dans les descriptions qui sont faites où tout est poussé à l'extrême et caricaturé [notamment quand il nous livre avec force détails la description des artifices employés pour masquer la pauvreté de la vêture faite de pièces de vêtements mille fois ravaudés]. Les pérégrinations de Don Pablo sont, l'occasion pour le lecteur de connaître une société interlope où la pauvreté n'a d'égal que la débrouillardise pour la camoufler. D'autre part, l'auteur n'hésite pas à utiliser les jeux de mots et des expressions savoureuses [Don Pablo indique, non sans humour que son père sortit de prison « avec tant d'honneurs qu'il était accompagné de de deux cents cardinaux que l'on ne traitait cependant pas d'éminence »,désignant ainsi les traces laissées sur sa peau par les coups de fouet qu'il avait reçus en prison et qui rappelaient par leur couleur la robe des cardinaux].
Cette œuvre rencontrera un grand succès lors de sa publication et sera traduite dans différentes langues mais il semblerait que Quevedo ait nié sa paternité à cause sans doute de l'Inquisition.
© Hervé GAUTIER - Mars 2012.
-
LA MAISON OÙ JE SUIS MORT AUTREFOIS - Keigo Higashino
- Le 23/07/2011
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°533– Juillet 2011.
LA MAISON OÙ JE SUIS MORT AUTREFOIS – Keigo Higashino – Actes Sud.
Traduit du japonais par Yukata Makino.
Le narrateur, un universitaire japonais, n'avait plus de nouvelles de son ex-petite amie, Sayaka, mariée à un homme d'affaires qui s'absente beaucoup. Même la maternité n'a pas suffi à la faire aller mieux puisque qu'elle maltraite sa fille de trois ans qui a été confiée à la garde de ses beaux-parents. Son enfance à elle a été un cauchemar dont elle ne garde pas de bons souvenirs. Elle n'apparaît guère dans les albums de sa famille avant l'âge de cinq ans, et elle ne sourit jamais sur les photos ! Après la mort de son père, elle découvre dans le sac de pêche de ce dernier une clé à tête de lion et une carte annotée d'indications bizarres, conduisant à une maison de montagne, isolée et située près d'un lac. Accompagnée du narrateur, elle décide de la retrouver pour l'explorer.
Après avoir longtemps cherché et hésité, ils finissent par découvrir la maison et par y entrer à l'aide de la clé, mais par une porte du sous-sol seulement. Étrange détail, cette maison, maintenant complètement abandonnée et fermée et dont les habitants de la région ne connaissent même pas l'existence, semble avoir été habitée par une famille. La porte d'entrée est verrouillée, toutes les pendules sont arrêtées à 11h10 et la vie semble s'y être arrêtée précipitamment 23 ans plus tôt ! C'est un peu comme si le temps avait interrompu son cours ! De plus, sans être vide, cette demeure n'a ni télévision, ni téléphone, ni appareils ménagers, ni calendrier, ni même d'électricité... La famille qui habitait là se composait d'un couple avec un garçon, le petit Yusuke qui tenait un journal intime que nos détectives découvrent. L'enfant, apparemment bon élève, y notait qu'il recevait des jouets d'un homme, ce qui semblait indisposer son père et y faisait mention d'une certaine Mme Otai, d'une petite fille et d'un chat, Chami ! Puis son père mourut et un autre homme vint prendre sa place...
Le journal du garçon recèle des détails troublants qui vont servir de fil d'Ariane pour recomposer ce passé un peu confus. Il s'interrompt brusquement mais des lettres retrouvées vont poser plus de questions qu'elles n'apportent de réponses ! Sayaka qui au départ n'a aucun souvenir de cette maisons finit par ressentir une impression de déjà vu, et va retricoté sa propre histoire à travers de petits détails comme un rideau vert, un vase, une porte qui apparemment n 'existe plus et un coffre-fort. C'est Sayaka qui en découvrira la combinaison, mais son contenu épaissit le mystère !
J'ai toujours pensé que ce n'est pas parce qu'un roman se fonde sur des énigmes qu'il doit être violent et même sanglant. Ici l'intérêt de ce récit noir est tout en nuances. Le thème de la mémoire perdue puis retrouvée est bien exploité et avec lui celui de l'enfance disparue. La complicité née d'une ancienne histoire d'amour entre le narrateur, incrédule au départ et Sayaka, anéantie par la vie, fera, petit à petit, éclater la vérité.
A l'invite du narrateur et de cette aventure hors du commun, le lecteur échafaude diverses hypothèses, suit les péripéties de ce récit dont le style, volontairement sobre et dépouillé et la construction bien menée distillent le suspense jusqu'à la fin. De plus, ce roman a le mérite de se dérouler dans le calme et la vraisemblance. Passionnant !
Jusqu'à présent je n'avais jamais lu de romans policiers japonais. Je n 'ai pas été déçu.
© Hervé GAUTIER – Juillet 2011.
-
L'HIVER DES LIONS – Jan Costin Wagner
- Le 03/06/2011
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°522 – Juin 2011.
L'HIVER DES LIONS – Jan Costin Wagner – Éditions Jacqueline Chambon.
Traduit de l'allemand par Marie-Claude Auger
L'intrigue, se passe en Finlande, entre Noël et le 31 décembre.
Le Commissaire Kimmo Joentaa est de garde et l'ambiance mi-festive mi-indolente à cause des fêtes de fin d'année gagne les locaux du commissariat de Turku à quelques deux cents kilomètres d'Helsinki. De toute manière, il sait qu'il passera la soirée de Noël seul puisque, depuis la mort de son épouse, Sana, il n'a plus vraiment le goût de vivre. La soirée est pourtant agitée et Larissa, c'est à tout le moins le nom qu'avoue cette jeune prostituée à l'imagination féconde, entre dans sa vie un peu par hasard et ne paraît guère disposée à en sortir.
Cela ne fait que commencer puisque, le matin suivant, Kimmo apprend que Patrick Laukkanen, le médecin légiste, vient d'être assassiné. Bizarrement, il apparaît que les coups de couteau mortels, « portés au hasard sur presque tout le buste » ont été donnés sous le coup de la colère. Une enquête est donc ouverte.
Un meurtre semblable est commis à Helsinki. Même mode opératoire, même absence de mobile. Cette fois, la victime est Harri Mäkelä, un fabricant de mannequins pour le cinéma. Le commissaire devine très vite que le seul lien existant entre ces deux crimes est le fait que les deux hommes ont participé à un talk-show télévisé, très suivi dans tout le pays. C'est l'émission de l'animateur Hämäläinen intitulée « Les maîtres de la vie et de la mort » et la prestation des deux hommes y a été particulièrement remarquée. Bien entendu on y a parlé de catastrophes mortels ou de crimes. Il se pourrait donc que le meurtrier s'en prenne systématiquement à ceux qui passent dans cette émission. Dès lors et si ce raisonnement est exact, l'animateur est en danger de mort ! Effectivement, il est l'objet d'une agression au couteau, mais moins violente, il n'y succombe pas. Le visionnage de l'enregistrement de l'émission n'apporte aucune information si ce n'est la bonne humeur générale dans le public alors que le thème ne s'y prête guère. La police est dans une sorte d'impasse. C'est alors que Joentaa a une idée. Il se pourrait que le coupable se trouve dans le public invité à l'émission et aussi parmi les victimes survivantes d'un accident spectaculaire d'avion ou de train et qui aurait transformé son deuil « en agression irrationnelle ». Cela paraît plausible bien que son supérieur estime que « les idées de Kimmo sont toujours saugrenues ». Faute de mieux, l'enquête explore cette piste, s'égare un peu pour finalement s'orienter, un peu par hasard, sur une femme dont l'attitude pendant l'émission télévisée a tranché sur l'ambiance générale. Son passé est systématiquement et laborieusement épluché...
Je dois dire que ce roman m'a bien plu au départ, mais rapidement, peut-être à cause de diversions, j'ai un peu lâché le fil du récit. Je n'ai pas été très convaincu non plus par le personnage du commissaire qui ne cesse de s'excuser (de quoi ?), ni d'ailleurs par la présence de Larissa. Je n'ai pas vraiment adhéré à l'épilogue non plus. Le texte est pourtant agréable à lire, avec des passages poétiques notamment des descriptions hivernales inconnues sous nos latitudes et un suspense entretenu jusqu'à la fin.
©Hervé GAUTIER – Juin 2011. http://hervegautier.e-monsite.com
-
Un garçon parfait – Alain Claude Sulzer
- Le 04/01/2011
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°490– Janvier 2011.
Un garçon parfait – Alain Claude Sulzer- Editions Jacqueline Chambon.
Traduit de l'allemand par Johannes Honigmann
En ce mois de Septembre 1966, Ernest vient de recevoir une lettre postée de New-York par son ami Jacob Meier qu'il n'a pas revu depuis 1936. Pourtant, il tarde à ouvrir l'enveloppe comme s'il savait ce qu'elle contenait. C'est que cette missive, qui en réalité est un appel au secours, va faire revivre un passé qu'il voulait oublier.
Ernest est un homme qui passe parfaitement inaperçu. Serveur attentif et effacé, il mène une vie personnelle indépendante, solitaire et anonyme. Employé depuis de nombreuses années dans le restaurant d'un palace suisse à Giessbach, il est très professionnel au point qu'il résiste sans le vouloir vraiment à tous les licenciements. En ce sens, c'est un garçon parfait. Il est le témoin muet des relations parfois adultères qui se nouent entre les clients comme celle d'une de ses cousines, mariée à un industriel français, qui file le parfait amour, et ce pendant presque vingt ans, avec son amant anglais. Ils se retrouvent régulièrement dans cet hôtel et Ernest est leur messager secret.
En 1935 Jacob a fait irruption dans sa vie professionnelle puisqu'il a été chargé de sa formation. Il a fait de lui un employé à son image, un garçon parfait lui aussi ! Il a conçu pour lui une passion amoureuse à la fois violente et exclusive mais sa liaison avec lui a été brutalement interrompue par une passade de Jacob avec un client de l'hôtel, le célèbre écrivain allemand Julius Klinger. Sur fond de montée de nazisme et de guerre mondiale qui couve, les deux hommes partent pour les États-Unis, en compagnie de la famille du poète. Officiellement, il sera son serviteur, situation qui masquera leurs véritable relation. Pourtant Jacob n'a jamais oublié complètement Ernest. Dès lors il se tisse entre Jacob et l'écrivain une relation complexe de dominant à dominé et même de prostitué à client et l'attitude de Jacob est davantage dictée par son propre intérêt que par l'amour qu'il prétend porter à son protecteur. En réalité Julius est subjugué par la beauté et la jeunesse de son amant alors qu'il est, lui, en réalité vieux et dépendant.
Cette lettre de Jacob, envoyée trente ans après sa fuite, est donc l'occasion pour Ernest de revivre des souvenirs qu'ils souhaitaient rayer de sa mémoire. Elle est suivie d'une autre qu'il finit par ouvrir et qui lui demande de reprendre contact avec Klinger revenu en Suisse. Après bien des hésitations, il s'exécute et prend contact avec l'écrivain. En réalité ce que lui révèle celui-ci le bouleverse durablement. Non seulement Jacob ne l'a pas oublié, mais il s'est longtemps servi de lui ou plus exactement de son souvenir, pour dominer encore plus Julius. Troublé par ce qu'il a appris et dans le seul but de venir en aide à son ancien ami, Ernest se transforme en maître-chanteur, menaçant de révéler à la presse à scandale l'homosexualité de l'écrivain, devenu entre-temps un citoyen fort respectable. Il n'est cependant pas au bout de ses surprises et la fin du roman révèle les rapports complexes qui existent dans la famille de l'écrivain et le rôle réel que Jacob y joue.
Le style de Sulzer parvient à tisser cette ambiance impersonnelle et lisse qu'on imagine faire partie du patrimoine de la Suisse. Le lecteur ressent parfaitement la nature des rapports qui existent entre les clients et les employés de cet hôtel ainsi qu'entre les différents personnages de cette fiction.
©Hervé GAUTIER – Janvier 2011.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA VAGUE - Todd STRASSER - Éditions Jean-Claude Gawsewitch.
- Le 05/05/2010
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°423– Mai 2010
LA VAGUE – Todd STRASSER - Éditions Jean-Claude Gawsewitch.
C'est un récit assez déconcertant, encore que, inspiré par une histoire qui s'est réellement déroulée dans un lycée américain dans les années 70. Imaginez un professeur d'histoire qui, pour faire comprendre à ses élèves idéologie nazie et leur faire toucher du doigt l'horreur de ses crimes, leur passe un film sur les camps d'extermination. C'est pour eux une révélation en même temps qu'une occasion de poser des questions sur la réalité de ces faits mais aussi sur la raison de la passivité de la population allemande, de son hypocrisie, l'inertie des juifs face à la mort. Çà, c'est pour le programme scolaire.
Dans le même temps, il se heurte, en tant qu'enseignant, aux difficultés liées à l'indiscipline, à l'absentéisme, au manque de sérieux des élèves qui règne dans sa classe quand ce n'est pas également dans les activités extra scolaires. Mis à part les rares bons élèves, l'atmosphère de son cours se résume à une sorte de léthargie. Il s'aperçoit en outre qu'il n'est pas vraiment capable de répondre à toutes les questions des élèves d'une manière satisfaisante. Pour remédier à cet état de chose quelque peu délétère autant que dans un but pédagogique, il prend l'initiative, s'inspirant de la doctrine nazie, d'inscrire au tableau « La force par la discipline », et d'expliquer que la discipline entraine la réussite, le pouvoir... Lui, qui d'ordinaire avait beaucoup de peine à capter leur attention, fut étonné du résultat. Cela au début pouvait passer pour un nouveau jeu mais les potaches, ordinairement peu passionnés par ses cours et un tantinet indisciplinés, se changèrent en soldats obéissants, respectueux de leur professeur, et arborant une tenue correcte!
Et le professeur de constater « On aurait dit qu'ils n'attendaient que cela depuis toujours ». Puis, il affina la notion parlant de « communauté », de l'esprit d'équipe qui devait prendre la pas sur l'individualisme... Puis, pour que les choses soient plus parlantes, il fait adopter un symbole, « la vague », qu'il compléta par un salut, un slogan, des meetings, le culte du chef, le tout dans un contexte de discipline librement acceptée et même réclamée! L'instinct grégaire gagna petit à petit chaque élève et, presque naturellement on finit par encourager la délation, l'autorégulation du groupe en vue de l'action, l'informatisation, le prosélytisme, l'obsession de l'ordre et du résultat, l'esprit de compétition autant que l'absence d'esprit critique, l'endoctrinement systématique... L'illustration se fait plus précise quand un élève juif est agressé par un membre du groupe. Mais ce message ne passe pas auprès de tous cependant. Une réaction s'organise, ce qui est rassurant. L'épilogue l'est également.
Cette expérience fait évidemment débat. Doit-on voir dans ce qui n'était à l'origine qu'un jeu ou l'illustration du cours, un mode d'éducation dont l'histoire nous a enseigné les conséquences et les méfaits, une manipulation, un réel besoin de transformation, une contagion, une expérience qui tourne rapidement au drame et menace de déborder tout le monde, une propagation de la peur et de la passivité du groupe devant la force, l'attitude du professeur, partagé entre la griserie du pouvoir et la peur d'être dépassé par le phénomène?
Cela a beau s'appuyer sur des faits réels, j'avoue bien volontiers que j'ai été, au début, partagé entre la peur et le scepticisme. On a beau se dire que tout cela ne peut pas se reproduire, il ne faut pas perdre de vue ce qu'est la condition humaine, avec ses grandeurs mais aussi ses turpitudes, sa volonté de domination autant que celle de se réfugier sous la houlette d'un chef providentiel qui dictera sa loi, la tentation du totalitarisme...
J'ai lu jusqu'à la fin ce récit en me demandant la part de fiction et de réalité. Ce n'est pourtant pas un chef-d'œuvre d'écriture. Le texte adopte le ton d'un témoignage sec, au phrasé simple et direct, ce qui permet un abord facile. Il a cependant eu un réel succès en Allemagne ainsi que le film qui en a été tiré (Réalisé par Denis Gensel – sorti en 2008).
Il y a quand même quelque chose d'effrayant dans ce témoignage.
© Hervé GAUTIER – Mai 2010.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LES HOMMES QUI N'AIMAIENT PAS LES FEMMES – Stieg LARSSON
- Le 17/12/2009
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°383– Décembre 2009
LES HOMMES QUI N'AIMAIENT PAS LES FEMMES – Stieg LARSSON – Actes Sud.
Chaque année, depuis 44 ans un homme reçoit anonymement des fleurs séchées pour son anniversaire et téléphone à un policier à la retraite pour l'en informer.
Le journaliste économique Mikael Blomkvist est condamné pour avoir diffamé un financier Hans-Erik Wennerstrom. Cette condamnation met en évidence des lacunes dans ses investigations. Il devra donc aller en prison à cause de cette décision de justice. A ce moment, un industriel suédois très connu, Henrik Vanger, lui confie la rédaction de l'histoire de cette puissante famille. En réalité, ce qu'on attend du journaliste, c'est l'élucidation d'un meurtre perpétré il y a plus de quarante ans, celui de la petite-nièce d'Henrik, Harriet Vanger, alors âgée de 16 ans. Pour corser le tout, Henrik reçoit chaque année des fleurs séchées et, comme dans toutes les familles, celle-ci qui est nombreuse cache des secrets. Blomkvist accepte donc, d'autant que Vanger se propose de fournir au journaliste des informations complémentaires sur Wennerstrom.
Lisebth Salander, jeune femme de 24 ans un peu gothique a la caractéristique de vivre en dehors de la société qui ne l'intéresse d'ailleurs pas. Un lourd passé psychiatrique l'a fait mettre en tutelle Elle a aussi un don, celui de découvrir par le biais du piratage informatique et d'une étonnante mémoire des données cachées et, bien entendu elle finit par être engagée par Blomkvist et par l'aider efficacement. Ainsi, tous ces personnages finissent par se croiser et les ingrédients d'un véritable polar sont dors et déjà en place et les rebondissements ne manqueront pas de se produire. Il y a aussi des personnages secondaires qui gravitent autours de ceux qui font ce récit, Erika Berger, co-fondatrice avec Mikael Blomkvit du journal Millénium et qui vit avec lui une liaison épisodique, dans l'indifférence du mari de cette dernière, Nils Bjurman, tuteur de Lisebth Sanders, un sadique et un obsédé sexuel qui se sert d'elle...
Le récit a quelque chose de manichéen, les hommes étant les méchants et les femmes les gentils. L'histoire qui est racontée n'est pas vraiment une fiction mais se rattache à la réalité historique suédoise et va révéler des secrets de véritables familles pas toujours avouables. Cette enquête part d'une mystérieuse photo prise le jour de la mort d'Harriet Vanger, fait référence à des crimes anciens particulièrement horribles et rituels perpétrés en Suède avec, comme boussoles des citation de la Bible et une conclusion provisoire tirée par nos enquêteurs« C'est simplement un fumier ordinaire qui hait les femmes ». Tout s'explique à la fin mais ne comptez pas sur moi pour vous la dévoiler!.
C'est vrai que c'est un peu long, parfois même laborieux, surtout au début. Personnellement, je ne goûte pas trop ce genre de « pavé »(650 pages!) et ce d'autant moins que le véritable intérêt du livre n'apparait que vers la moitié du récit, ce qui me paraît un peu discutable, d'autant que la première partie du livre est parsemée de détails dont on n'aurait parfaitement pu se passer pour la compréhension générale. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'écrire dans cette chronique, j'aime les écrivains qui s'attachent leur lecteur dès le début du texte et je n'ai pas eu cette impression ici. Cela paraît être un parti-pris de l'auteur de promener un peu son lecteur et de faire s'imbriquer, petit à petit, les pièces du puzzle. Cela pourrait être bien, mais j'ai peu apprécié. Pourtant, l'écriture, dans sa version traduite en français, est simple et le style facile à lire.
Pour autant, et malgré le grand succès qu'il a connu en Suède et en France, ce roman qui est le premier d'une trilogie, ne m'encourage guère à poursuivre avec cet auteur que, je l'avoue, je ne connaissais pas avant.
©Hervé GAUTIER – Décembre 2009.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE WEEK-END – Bernhard SCHLINK
- Le 22/11/2009
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°379– Novembre 2009
LE WEEK-END – Bernhard SCHLINK – Gallimard Roman [traduit de l'allemand par Bernard Lortholary].
J'avais été bouleversé par « Le liseur » du même auteur. La feuille Volante n°378 garde les traces de la découverte enthousiaste de Bernhard Schlink que je lisais pour la première fois.
Ici, c'est un peu différent. Jörg est gracié par le Président de la République allemande après vingt années passées derrière les barreaux. Sa sœur Christiane invite ses anciens amis a venir fêter sa libération dans sa maison à la campagne berlinoise. Pourtant, ce week-end qu'elle espérait paisible va vite devenir invivable. C'est que Jörg est un ancien terroriste de la Fraction Armée Rouge et dans ce groupe ainsi reformé s'entrechoquent des questions d'abandons, d'oublis, de responsabilités, de culpabilités, de pardons, de regrets, de suspicions, de rêves abandonnés, de mensonges, de coups de bluff, de blocages ... C'est que pendant l'emprisonnement de Jörg chacun a trouvé sa place dans une société qu'auparavant ils combattaient. Quid de l'amitié au regard de l'idée pour laquelle on s'était engagé? Est-elle plus forte que l'idéal? Finit-on par s'insérer dans un monde qu'on refusait, par nécessité, par évolution obligatoire, par conviction lentement forgée par le temps, par récupération plus ou moins volontaire? Doit-on rester toute sa vie habité par par un modèle même s'il se révèle utopique? La société peut-elle être réformée ou doit-elle être dominée constamment par l'argent et le pouvoir qu'elle sous-tend sans qu'il soit possible d'imaginer autre chose? La nécessaire lutte sociale est-elle destinée à n'être qu'un court moment dans la vie des hommes pour n'être plus ensuite qu'un souvenir? La volonté de faire changer les choses légitime-t-elle la violence et l'assassinat? Le fanatisme ne conduit-il pas de lui-même ses protagonistes dans une impasse? La politique doit-elle se conjuguer toujours avec la violence?
Le huis-clos augmente encore l'ambiance parfois lourde, parfois nostalgique de ces trois jours passés ensemble où les souvenirs reviennent lentement à la surface. Le délabrement de la maison qui sert de cadre à cette rencontre est un peu à l'image de l'ambiance qui y règne et le respect des unités de lieu et d'action donne encore plus de force à ce récit.
Et puis, Jörg lui-même n'a été que gracié et doit donc sa liberté provisoire au pouvoir politique qu'il combattait jadis. Cela a fait l'objet d'une demande de sa part...
On sent le décalage qui existe entre Jörg et les autres, ceux qui veulent le voir reprendre le flambeau contre toutes les injustices, il y a tant de combats à mener contre l'oppression ...et tous les autres devenus notables établis. Même la religion est convoquée! Pour lui, c'est un peu comme si le temps s'était arrêté il y a vingt ans et que son idéal d'alors était resté intact face à « l'adaptation » de ses anciens compagnons de lutte.
Comme à son habitude, l'auteur soulève des questions qui bien souvent n'ont de réponse qu'en nous-mêmes. Il conduit sa démarche sans concession. C'est un bon écrivain, qui a à la fois le courage d'affronter les vieux démons de son pays mais c'est aussi un juge professionnel dont le rôle est de défendre une société établie et qui mérite sans doute de l'être au nom de « l'ordre public », de la prospérité économique....
Comme je l'avais noté lors de mon premier commentaire, j'ai trouvé ce livre bien écrit [en tout cas bien traduit], agréable à lire. Le thème choisi colle parfaitement à la condition humaine et à l'action politique. Des exemples ne manquent pas pour l'illustrer et nos sociétés démocratiques et occidentales ont toutes été secouées, à un moment ou à un autre de leur histoire, par ces tentatives révolutionnaires. Cela en fait un livre parfaitement actuel et universel.
Pourtant, je ne saurais trop dire pourquoi, il a moins retenu mon attention et mon intérêt que le premier.
©Hervé GAUTIER – Novembre 2009.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE LISEUR – Bernhard SCHLINK
- Le 21/11/2009
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°378– Novembre 2009
LE LISEUR – Bernhard SCHLINK – Gallimard Roman [traduit de l'allemand par Bernard Lortholary].
Des les premières lignes, le narrateur, Michaël Berg, se présente comme un adolescent chétif et maladif âgé de quinze ans qui fait sa première expérience amoureuse avec une femme qui a l'âge de sa mère. A bien y réfléchir, cette sorte d'initiation, sans être courante, est quand même exceptionnelle. On n'oublie jamais un tel épisode de sa vie, surtout s'il se déroule sous de tels auspices et ce récit pourrait s'arrêter là. C'est, certes, une remémoration du passé, mais l'auteur l'exprime avec une formule qui revient souvent « C'est aussi une image qui me reste d'Hanna ». Mais l'évocation de sa partenaire, Hanna, a quelque chose de lointain, sans pour autant que cette impression d'éloignement ne doive rien au temps qui a passé. Les réactions de cette femmes sont bizarres: elle lui donne du plaisir, a des réactions violentes et coléreuses mais lui demande de lui faire la lecture(d'où le titre), puis un jour elle disparaît de sa vie sans motif. Lui, qui de son côté avait choisi de ne rien révéler de cette liaison, ressent du chagrin solitaire face à ce départ précipité.
Il la retrouve quelques années plus tard, alors qu'il est étudiant en droit et qu'elle est dans un box d'accusés. Pendant la guerre, elle s'était engagée aux côtés de SS comme surveillante de camp de concentration et doit répondre de ses crimes. Dès lors pour lui, bien des choses qui étaient restées en suspens, trouvent une explication, sa fuite sans raison, son habitude de choisir dans le camp une lectrice parmi les prisonnières, lui permettant ainsi de vivre quelques heures plus supportables avant la mort, ses différentes dérobades professionnelles, plus tard, après la guerre... Au cours de ce procès, qu'il suit de bout en bout, il découvre qu'elle est analphabète. Dès lors, face à ses juges, elle se défend mal, cherche même la condamnation et n'ose pas avouer qu'elle ne sait pas lire. De quoi a-t-elle le plus honte, de ne pas savoir lire ou d'avoir été un bourreau? L'auteur lui-même est partagé et en conçoit une culpabilité d'avoir aimé une criminelle. Dès lors se bousculent dans son esprit l'image de la femme sensuelle qu'elle a été pour lui et celle de la tortionnaire qu'elle a dû être pour ses prisonnières même si des zones d'ombre subsistent et des questions émergent : Est ce qu'on tue sur ordre, par amour de la violence, par désir de vengeance, par haine des hommes?
Malgré sa position de subalterne, à cause sans doute d'un épisode particulièrement atroce où elle laisse planer un doute sur sa responsabilité, elle finit par être condamnée à la prison à perpétuité sans que l'auteur puisse rien faire pour elle. D'ailleurs, malgré la fascination qu'elle exerce toujours sur lui, il choisit de ne rien faire et de laisser passer la justice. Cette attitude ambiguë répond sans doute à celle d'Hanna désirant garder le secret sur son analphabétisme?
Puis la vie du narrateur s'est déroulée comme celle d'un homme, un mariage, un divorce, des liaisons avec d'autres femmes, mais, dans chacune de ses passades, il recherchait malgré tout et sans peut-être se l'avouer à lui-même, le goût et le parfum de cette Hanna. Autant de fuites dont il se sent coupable...Devenu juriste et historien du droit, il s'intéressa au Troisième Reich et retrouva la trace d'Hanna dans sa prison. Pour elle, il se mit à lire l'odyssée d'Homère(« l'odyssée est l'histoire d'un mouvement qui à la fois vise un but et n'en a pas »), puis à Schnitzler, à Tchekhov et à beaucoup d'autres auteurs qu'il enregistra à haute voix et sur des cassettes qu'il lui fit parvenir. Une nouvelle fois il redevient son « liseur ». Puis vinrent des textes originaux de l'auteur écrits exclusivement pour cette femme.
Cela avait quelque chose de surréaliste : écrire et dire ces textes à haute voix pour cette femme à la fois analphabète et absente, lui faire parvenir sans jamais chercher à la voir, des enregistrements qui étaient autant de déclarations d'amour alors qu'il demeurait volontairement loin d'elle, manifestaient cette volonté de ne pas l'oublier et de lui permettre d'accéder à la lecture. De fait Hanna fait l'effort d'apprendre à lire et à écrire pour lui seul. Ses lettres brèves qui étaient autant de victoires sur elle-même, devinrent avec le temps pertinentes et pleines de sens critique au regard de l'écriture créative de l'auteur. Ces enregistrements étaient le seul lien qui la reliait à l'extérieur mais elle semblait indifférente à cette opportunité. Quand vint le temps du pardon et qu'une libération anticipée fut envisagée pour Hanna, le narrateur est amené à la rencontrer, à envisager pour elle une réinsertion dans cette société. C'est pourtant une vielle femme qu'il retrouve après tant d'année d'incarcération de sorte que si lui fait un effort réel dans sa direction, elle préfère la mort pour échapper probablement à une vie commune avec lui ou pour gommer à jamais l'image grise qu'elle lui a donnée d'elle, incapable peut-être d'accepter le pardon impossible qu'un séjour en prison lui a fait « mériter », préférant peut-être la mort à la rencontre toujours probable d'une de ses anciennes prisonnières?
J'ai rarement lu un roman aussi bouleversant, bien écrit [et en tout cas bien traduit] qui tient en haleine le lecteur de bout en bout.
Le livre refermé, il reste des questions sur le pouvoir de l'écriture. L'auteur s'en explique « Je voulus écrire cette histoire pour m'en débarrasser », mais l'écriture a-t-elle véritablement ce pouvoir exorcisant? Les Allemands, qui bien souvent n'étaient pas nés lors de la deuxième guerre mondiale éprouvent-ils des difficultés à aborder l'histoire de leur pays lors de cette période? La culpabilité, qui est très présente chez Schlink, peut-elle être gommée par le pardon? Le pardon est-il possible?
©Hervé GAUTIER – Novembre 2009.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE CHANT DE LA MER – Norman LEWIS
- Le 07/11/2009
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
N°377– Novembre 2009
LE CHANT DE LA MER – Norman LEWIS– Phébus.
« Il n'y a rien ici »!
En effet, c'est un décor du nulle part, quelques barques, des chats maigres qui s'acharnent sur les reliefs de la dernière pêche, la mer, quelques maisons qui forment un méchant bourg ensoleillé de Catalogne après la deuxième guerre mondiale, après la guerre civile espagnole, en pleine période franquiste. Que vient donc faire ici, dans ce petit village de Farol, sur les bords de la Méditerranée, cet étranger, un Anglais, un « homme tranquille », un peu taiseux à cause de sa vie antérieure, de la guerre à peine terminée il y a quelques mois avec ses désillusions, ses désespoirs, ses horreurs ? Il pourrait rentrer chez lui, en Angleterre, mais il a plutôt suivi les prescriptions de son médecin, le changement d'air, le changement de vie...
Mais voilà, il est ici un étranger et on se méfie de lui. Lui, désireux de n'être pas venu ici pour rien et surtout d'y demeurer, à cause probablement des rituels, des silences, de la vie simple de cet endroit où il n'y a effectivement rien, de sa volonté de se poser quelque part sur terre, parce qu'il est saisi intimement de cette appétit de réadaptation au monde, de son attachement intime à l'imperfection qu'il chérit, de la volonté d'être différent politiquement, de rester fidèle au valeur de l'ancienne république, va petit à petit se faire accepter par ce peuple, s'acclimater dans ce petit port catalan. C'est en cherchant à se fondre dans ce paysage, gardant le silence et cherchant à n'être « personne » qu'il va, sans même s'en apercevoir, être accepté par les autres villageois, sans doute parce qu'il leur ressemble! Il va l'être tellement qu'on lui fait des confidences, qu'on l'invite pour des parties de pêche tout en l'initiant aux tabous du métier, qu'on lui confie les comptes...
Il a choisi cet endroit parce qu'il est l'écart, parce que le temps semble s'y être arrêté, à cause des chats qui, plus que les autres animaux donnent l'impression à l'étranger qu'il vient effectivement d'une autre planète.
Un village n'est rien sans ses personnages : ce curé assez anachronique dans un bastion où historiquement on a toujours refusé le clergé; on le supporte à cause peut-être de la maîtresse qu'il entretient au vu et au su de tous, l'alcade, désigné par le pouvoir central et dictatorial de Franco qui fait semblant de diriger tout ce petit monde, Don Alberto, grand propriétaire, personnage anachronique qui semble tout droit sorti d'un roman de Cervantès, mais surtout la grand-mère chez qui l'auteur choisit de loger, une femme à la fois fantasque et attachante, qui, en réalité gouverne ce village et qui tient son pouvoir du seul fait que c'est là « le pays des chats », Muga qui incarne la modernité mais surtout le changement, le pouvoir de l'argent.
C'est un récit labyrinthique, nécessairement magique que nous offre l'auteur. Il y distille, avec un certain humour, le délicat parfum de l'éphémère de cette vie, de la fragilité de ce monde qui est le nôtre, une délicate musique un peu enrouée de fin de quelque chose qui, même si on ne le veut pas, finit par être tragique et pleine de désespoir. Les choses évoluent sur cette terre, et pas forcément dans le sens souhaité, la nostalgie des temps anciens peut exister et perdurer, l'humour combattre plus ou moins efficacement tout cela, mais la réalité est là. Farol, avec ses airs d'ailleurs, comme marginalisé par lui-même et désireux de faire durer ce climat d'exception va être emporté par la spirale du temps: les bancs de poissons vont se faire de plus en plus rares, les chênes-lièges, richesse de l'arrière-pays, seront atteints par la maladie, l'argent qui corrompt tout, les « libertés venues du Nord », la spéculation... Ce petit peuple « d'irréductibles », attaché viscéralement à son originalité va voir la voir se dissoudre avec rapidité... C'est probablement là ce qu'on appelle le sens de l'Histoire, l'évolution des choses, le progrès, la recherche inévitable et irréversible du confort, même si tout cela ressemble étrangement à une auto-destruction, au nom du sacro-saint profit, dont les sociétés dites civilisées sont friandes. Face à cela, ce petit coin de terre ne pèse rien et cette fable, pas si fictive que cela, ce « chant de la mer »,qui nous renvoient peut-être à celui des sirènes qui charmèrent Ulysse qui nous endort assurément est une prise de conscience bienvenue mais qui, malheureusement a toute les chances de demeurer lettre morte.
©Hervé GAUTIER – Novembre 2009.http://hervegautier.e-monsite.com
-
CONSTANTIN CAVAFY-Poèmes - Présentation critique par Marguerite YOURCENAR.
- Le 30/03/2009
- Dans Autres littératures étrangères
- 0 commentaire
CONSTANTIN CAVAFY-Poèmes - Présentation critique par Marguerite YOURCENAR.
Traduction du grec par Marguerite YOURCENAR et Constantin DIMARAS.
Est-ce le hasard du calendrier qui nous a fait découvrir au Petit Palais la statue d'un Ptolémée en Pharaon, ces fondateurs grecs de la dynastie Lagide qui régna sur Alexandrie ou ma curiosité des choses de la littérature du Moyen-Orient? L’œuvre de Constantin Cavafy (1863-1933), poète grec né à Alexandrie et présentée par Marguerite Yourcenar ne pouvait me laisser indifférent.
Cavafy lui aussi fut à la croisée de deux cultures exceptionnelles. Né à Alexandrie, il était d'origine grecque mais c'est dans cette ville qu'il passa la presque totalité de sa vie. Il n'en est pas moins considéré comme le plus grand poète grec contemporain. Cultivé et humaniste, il aurait pu être un aristocrate de l'écriture mais les vicissitudes de l'existence en décidèrent autrement qui firent de lui un courtier à la bourse puis un fonctionnaire au Ministère de l'Irrigation.
La gloire ne viendra que tardivement pour cet auteur qui avait choisi de distribuer ses poèmes sur des feuilles au seul usage de ses amis. Ces cent cinquante-quatre poèmes ne furent publiés qu'en 1935, soit deux ans après sa mort et selon un ordonnancement qu'il avait lui-même préparé. Ce sont eux qui sont traduits et publiés ici. Ils constituent son canon.
Il fallait bien toute la culture et le sens de la poésie de l'académicienne pour faire goûter au lecteur la beauté des poèmes de Cavafy. En bonne pédagogue, elle classe les textes selon trois critères: Les poèmes historiques, gnomiques et érotiques. Dans le commentaire qu'elle fait des poèmes historiques elle a soin, pour le lecteur peu versé dans l'histoire de replacer chaque texte dans son contexte notant au passage la liberté qu'a pu prendre l'auteur avec l'exactitude des faits, ce qui au vrai n'apporte qu'une précision technique.
Elle montre que Cavafy était un lettré, un humaniste qui a fait honneur à la culture grecque même si, sous sa plume elle se teintait un peu d'orientalisme. Elle rappelle à l'occasion le climat levantin qui baigne ses écrits. Le problème du destin ne l'a pas laissé indifférent de même que dans les poèmes de caractères et ceux ayant trait à la politique il se montre sensible à la perfidie, au désordre, à l'inertie qui caractérisent l'histoire grecque qu'elle soit ancienne ou moderne.
Marguerite Youcenar distingue ensuite les textes gnomiques qu'elle caractérise comme des "poèmes de réflexion passionnée" où le destin et la liberté se fondent, où Alexandrie est souvent présentée comme un être humain qu'il a passionnément aimé.
Puis viennent les poèmes érotiques. L'auteur de cette présentation note d'emblée que Cavafy prend le parti de l'inspiration exclusivement pédérastique, ce qui pour le chrétien du XIX° siècle qu'il était a une dimension "actes interdits et désapprouvés" mais où la notion de péché est ignorée. Il y a, certes, l'emploi du "il" plus détaché mais il reste que ses poèmes sont toujours directs et personnels. Une remarque cependant, ces textes mettent toujours en scène des éphèbes jeunes dont il note souvent l'âge avec précision comme pour souligner la fuite du temps, de la jeunesse et des plaisirs que pour souligner peut-être qu'à travers le souvenir qu'il a gardé de ses émotions ces poèmes sont ceux de la maturité. L'auteur de cet essai insiste cependant sur le fait qu'à ses yeux ce ne sont là que des poèmes d'inspiration hédoniste ou érotique où Cavafy est souvent absent un peu comme si l'Alexandrin choisissait de colliger pour lui-même ces moments d'exception ainsi que le ferait l'amateur d'une collection précieuse. Ces poèmes sont autant d'occasion d'exercer une mémoire qui l'obsède. Il y a dans l'écriture de Cavafy une sorte de sagesse, de didactisme qui sont peut-être puisées dans la solitude du poète et de l'homme. L'apparente sérénité qui ressort de ses poèmes tient sans doute autant à la quasi-absence de révolte qu'à l'acceptation de la condition humaine qui est la sienne. L'académicienne a bien raison de noter que l'écriture de Cavafy est celle d'un vieillard avec cette dimension du silence et du secret. Il y a aussi chez lui une délectation de l'écriture qui, nous le savons est un plaisir et quel que soit le thème traité c'est à un exercice littéraire auquel il se livre avec passion pour nous faire approcher la notion de l'humain qui est la sienne. Car c'est bien d'une poésie humaine dont il s'agit, toute en nuances, en non-dits mais aussi distillée dans un vocabulaire à la fois précis et emprunt d'émotions que la traduction de Marguerite Yourcenar a su admirablement rendre.
Je dois dire, à titre personnel que, le livre refermé il y certes les poèmes de Cavafy qui n'avaient pas d'emblée accroché mon attention mais aussi le texte de M. Yourcenar, son délicat scalpel, son sens aigu de la distinction et des nuances et sa constante passion de l'explication dans le respect de l'auteur et de ses émotions, son style à la fois simple et pur qui en fait un livre de référence sur le poète alexandrin. On retrouve ici ce qui a bien souvent été sa règle et qu'elle exprimait dans Mémoires d'Adrien "Un pied dans l'érudition...l'autre dans la magie sympathique qui consiste à se transporter en pensée à l'intérieur de quelqu'un".
Au moment ou l’œuvre de Constantin Cavafy, au cinéma comme à la télévision semble susciter un regain d'intérêt, ce livre publié en 1958 et réédité en 1978 mériterait bien quelque publicité.
Notes personnelles de lecture - (c) Hervé GAUTIER