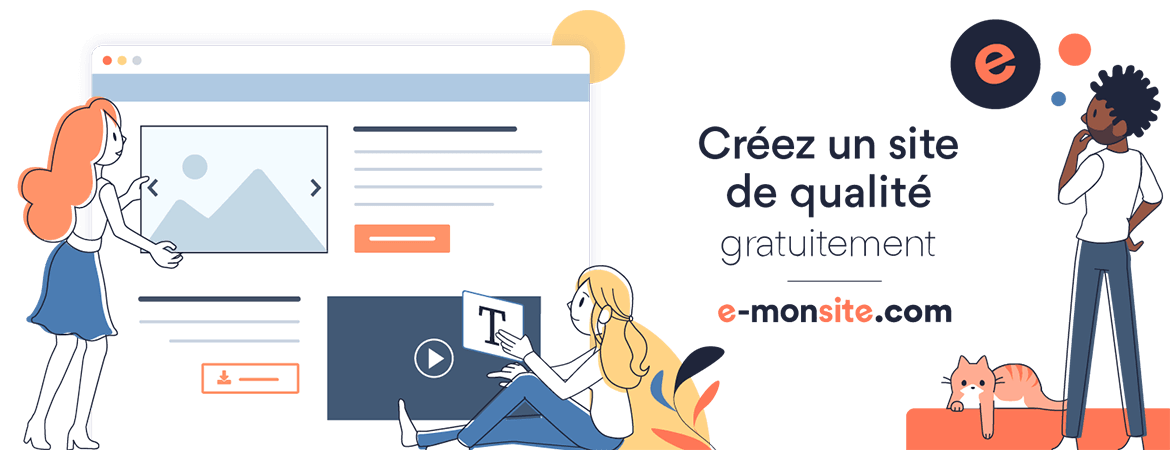Littérature anglo-américaine
-
Voyage avec Charley - John Steinbeck
- Le 22/01/2026
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La feuille Volante n° 2032 – Janvier 2026.
Voyage avec Charley (Mon caniche, L’Amérique et moi) – John Steinbeck – Édition Phébus .(1995) - Traduit de l’américain par Monique Thiès
En septembre 1960 John Steinbeck (1902- 1968), mondialement connu pour ses romans tels que « Les raisons de la colère », « Des souris et des hommes » ou « A l’est d’Éden », même s’il n’est pas encore nobelisé, ce qui lui arrivera deux ans plus tard, décide de partir à la découverte de son propre pays, lui dont l’œuvre se déroule principalement en Californie pendant la Grande Dépression et parle des injustices sociales. Pour cela il décide de voyager seul et incognito pour privilégier les rencontres authentiques, se fait construire une sorte de mobile-home et emmène son chien, un caniche français nommé Charley, pour lui confier ses impressions et discuter avec lui. Si les échanges entre un homme et son chien(son chat?) peuvent parfois réserver des surprises et pas mal de sources d’étonnement (Il lui donne même la parole), l’équipée, façon road-trip à la Jack Kérouac, très en vogue à l’époque, dure 75 jours, traverse le pays de New York à la Californie puis retour par les états du sud. Une sorte d’occasion qu’il se donne pour aller à la découverte de son propre pays.
Une telle démarche sollicite la mémoire et notre auteur ne manque pas ce rendez-vous avec ses souvenirs. Dans ce livre écrit sur un ton humoristique, alternativement dans un style fluide sans recherche littéraire et qui voisine avec de longues descriptions des paysages qui font penser aux grands espaces, notre auteur s’attache aux échanges avec des Américains de rencontre, grâce d’ailleurs aux bons offices de Charley. Il découvre un pays, le sien, qu’il ne connaissais pas vraiment, décrit une nouvelle « american way of life » faite de maisons-caravanes itinérantes et leurs nouvelles commodités, le progrès, la mobilité, les autoroutes, l’essor de la BD, un nouveau souffle de la littérature orientée vers le sexe, la violence, le crime, la réalité pour ces enfants de migrants qui étaient la force vitale de ce pays, une civilisation qu’il semblait ignorer. Pendant son parcours il fréquente les routiers, sympathise avec eux, chemin faisant il découvre des gens différents, plus ouverts, moins enclins au parler local et le désert l’invite à une réflexion sur la vie, la société, l’humanité mais on sent dans ses propos une certaine mélancolie face à une manière d’uniformisation de l’Amérique atteinte par la modernité et surtout dénonce la ségrégation raciale dans les états du sud.
Ce n’est sans doute pas l’œuvre de Steinbeck la plus connue mais c’est un témoignage sur cette période et qui eut un grand succès à sa publication. J’ai eu plaisir à le lire notamment à cause de l’authenticité des échanges, un écrivain devant être, à mon avis et entre autres, le témoin de son temps. Steinbeck est un authentique américain qui aime son pays, mais les contrées qu ‘il traverse successivement lui donnent à penser qu’il ne le reconnaît plus vraiment et, malgré sa verve, on sent, au fil des lignes une réelle déconvenue. Il y a une incontestable nostalgie dans cette longue évocation , un certain désarroi même.
Si on excepte les œuvres posthumes, ce roman est l’un des derniers parus de son vivant. Il y constate que les choses ont changé dans son pays et le déplore un peu comme s’il disait adieu à quelque chose. C’est sans doute le sens de la préface de Michel Le Bris. La tentation est grande pour ceux qui sont en fin de parcours de proclamer que « c’était mieux avant » même si cette affirmation est souvent sujette à débats. Je l’ai ressentie comme cela même si cette formule m’a toujours paru fausse. Pour autant je me demande comment il réagirait s’il voyait son pays aujourd’hui !
Pour autant, quelques cinquante ans plus tard, en 2010, un journaliste américain Bill Steigerwald décide de remarcher sur les traces de Steinbeck dont il apprécie l’œuvre à l’aide de témoignages de proches de l’écrivain, de sa correspondance et d’une première version du texte retrouvée par hasard. Au terme de ses investigations, Steigerwald, s’aperçoit que même si l’auteur fait, dans son récit quelques allusions à des visites de sa femme, il a en réalité effectué son voyage non pas seul mais en sa compagnie et qu’ils ont plus volontiers fréquenté les hôtels plutôt que leur inconfortable habitat mobile. Quant à Charley il a souvent connu les chenils avec, il est vrai, la possibilité qui était la sienne de partager ses impressions de voyages... avec ses colocataires canins*. Ainsi ce roman serait une mise en scène et les circonstances de ce voyage ne correspondraient pas exactement à la réalité. Qu’importe après tout et si nous avons affaire à une fiction qui est le domaine des romanciers, ce livre met au moins en évidence le talent de l’écrivain d’autant plus pertinent que le message de désillusion qu’il transmet est une source de réflexions pour le lecteur d’aujourd’hui.
* J’ai découvert cette information sous la plume de Pierre Bayard (« Comment parler des faits qui ne se sont pas produits » Éditions de Minuit – 2020- p 32)
-
Quelques réflexions personnelles sur l'oeuvre de Patricia Cornwell
- Le 04/11/2025
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N° 243–Septembre 2002
Quelques réflexions personnelles sur l’œuvre de Patricia CORNWELL.
Je n’ai pas honte de l’avouer, en ce qui me concerne, la première lecture d’un auteur inconnu se fait souvent à partir d’un amical conseil, d’un article de presse ou tout simplement d’un livre pris, parfois au hasard, sur les rayonnages d’une bibliothèque !
De telles méthodes ont leurs insuffisances et bien souvent leurs limites et si au bout de cinquante pages l’intérêt n’est pas au rendez-vous, j’abandonne.
Je ne sais pas comment le nom de Patricia Cornwell a suscité mon attention, mais ce qui est certain c’est que le roman policier, aussi bien en ce qui concerne l’écriture que la lecture, prend de plus en plus de place dans ma vie et dans mes loisirs… Je ne m’en plains pas !
Au-delà de l’auteur, dont la biographie révèle une réelle réussite d’écrivain et une générosité notable d’autant plus appréciable qu’elle sait rester discrète, pour le progrès de la médecine légale et donc de la justice, il y a les personnages, les histoires…
Tout d’abord je dois dire que ses romans sont servis par une remarquable traduction française, car, s’agissant d’un texte original écrit en américain, il est injuste d’oublier le nom du traducteur (ou de la traductrice) c’est à dire celui qui rend l’ouvrage lisible en français et contribue largement à son succès.
L’héroïne principale, le docteur Kay Scarpetta, d’origine italienne comme son nom l’indique est médecin légiste qui prend d’ailleurs des allures de policiers. La vie du personnage se nourrit des expériences professionnelles et personnelles de l’auteur puisque Patricia Cornwell a été, outre chroniqueur judiciaire, informaticienne à l’institut médico-légal de Richmond (Virginie) où elle noue des liens d’amitié avec le docteur Marcella Fierro, directrice de la morgue, ce qui donnera naissance, sans doute malgré elle, au personnage de Kay Scarpetta. Richmond sera bien entendu le lieu géographique de la plupart de ses romans.
Avec ses collègues, dont l’inséparable capitaine Marino, un peu macho et entretenant avec la bière des liens étroits, elle mène inlassablement ses enquêtes qui l’entraînent parfois à l’autre bout des Etats-Unis.
Ici le rythme est rapide et fascinant à la fois et Kay risque sa vie dans chaque enquête. Elle y perdra même l’homme de sa vie dont la mort continue de l’obséder. Mais elle fait face malgré les chausse-trappes que lui tendent les tueurs désireux de l’éliminer physiquement ainsi que les brimades de sa hiérarchie, le monde macho de la police…
Elle a des relations intimes avec Benton Wesley, un « profileur » du FBI. Elle partage sa vie par intermittente et ses sentiments pour lui montrent combien un auteur peut se révéler dans une de ses œuvres (« Combustion »). Un roman policier n’est pas seulement le récit d’histoires sordides où la mort est présente à chaque page. Dans les cas des œuvres de Patricia Cornwell, j’ai ressentis, personnellement du moins, une forte charge émotionnelle au moment notamment où elle décrit avec moult détails l’atrocité d’un meurtre autant que les différentes sentiments qui habitent Kay Scarpetta quand elle disperse les cendres de son amant sur une plage selon la volonté du défunt. On met toujours un peu de soi dans son écriture et l’œuvre en témoigne !
Pete Marino, omniprésent à ses côtés tel un ange gardien, respectueux cependant de sa vie privée est un peu son double inversé, mais j’aime surtout qu’elle soit cette mère de substitution pour sa nièce, la fragile Lucy, agent du FBI, surdouée, homosexuelle, mais toujours un peu en marge de cette société qu’elle contribue à défendre mais qui la rejette parce qu’elle est une femme œuvrant dans un monde essentiellement masculin.
Il y a deux styles sinon deux manières d’écrire chez Patricia Cornwell. Bien sûr, il n’y a pas de roman policier sans crime et sans atrocités. C’est là le parti pris de l’auteur qui puise largement dans son expérience glanée en médecine légale, mais il ne faut pas oublier que la mort fait partie de la vie et que notre société est aussi composée de criminels, de sadiques, de psychopathes. C’est donc cette face cachée que Patricia Cornwell nous donne à voir… et elle le fait non seulement avec talent mais aussi avec des précisions scientifiques et un goût du détail qui rendent, même pour un non initié comme moi, l’histoire d’autant plus crédible et intéressante.
Il n’en existe pas moins deux séries de personnages-phares : Kay Scarpetta qui vit imprime sa marque dans onze roman. Elle y côtoie Marino, Benton et sa nièce Lucy. A mon avis ce sont de loin les plus intéressants ; puis il y a une seconde série d’où tous ces personnages sont absents. Ce sont les romans les plus récents. Les chefs de la police locale sont des femmes telles Judy Hammer (« L’île aux chiens »-« La griffe du Sud ») ou Virginia West (« La ville des frelons »). Dans cette série émerge un personnage masculin qui sans doute prendra de l’importance dans son œuvre à venir, c’est celui d’Andy Brazil, ex-journaliste de talent devenu policier.
Patricia Cornwell entraîne son lecteur dans une série d’aventures passionnantes qui révèlent autant les bas fonds de la société américaine que la cupidité la cruauté des hommes, quand ils sont des criminels, mais aussi l’humanité des êtres dits « normaux ».
L’auteur est de son temps et l’informatique, inévitable, incontournable de nos jours, tient une grande place dans son œuvre. Internet aussi, évidemment et c’est souvent à cause de ce vecteur que le docteur Scarpetta et ses autres personnages sont entraînés, presque malgré eux dans des enquêtes où le macabre le dispute à l’horreur ! Il est vrai que nous sommes loin des fictions lentes et lénifiantes aux trop heureuses conclusions !
Elle décrit sans complaisance la vie de son temps, de Richmond, cette ville de Virginie qu’on pourrait croire assoupie, mais aussi de cette société américaine, avec ses travers, son quotidien, cette « américan way of life », rêve pour certains, cauchemar pour d’autres, minée par le racisme, la drogue, la corruption, l’omniprésence des armes, le profit, la réussite, la situation centrale des Etats-Unis dans le monde, son goût pour le pouvoir ! Cette société qui a souvent attiré les hommes du monde entier parce que c’est un espace de liberté mais elle masque à peine son autre visage d’insécurité et de violence, d’injustice aussi !
Elle a du se battre pour faire reconnaître son talent et ce n’est pas là la moindre de ses qualités personnelles, même si maintenant on lui rend justice par l’attribution de prix prestigieux tels que le « Edgar Poe Award » ; l’ « Anthony Award », le « Macavity Award », le « Dagger Award ». »
La France, pays de la culture, n’a pas non plus été en reste qui lui a accordé le « Prix du roman d’aventure » (1992) qui récompensait, pour la première fois une Américaine/
Je serai pourtant toujours attentif à cet écrivain dont la notoriété dépasse largement et heureusement les frontières de son pays.
© Hervé GAUTIER. http://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg
P.-S. Patricia Cornwell a notamment publié « Postmortem » (1992) – « Mémoire mortes » (1993) – « Et il ne restera que poussières… » (1994) – « Une peine d’exception (1994) » - « La séquence des corps » (1995) – « Une mort sans nom » (1996) –« Mort en eaux troubles » (1997) – « Mordoc » (1998) – « Combustion » (1999) – « Cadavre X » (2000) – « Le dossier Benton » (2001) – « La ville des frelons » (1998) – « La griffe du sud » (1999) – « L’île des chiens » ( 2002)
-
la peste écarlate - Jack London
- Le 04/11/2025
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°472– Novembre 2010.
LA PESTE ÉCARLATE et autres nouvelles – Jack London - Phébus Libretto.
Le seul nom de Jack London évoque l'aventure, la nature, la liberté.
Dans la première nouvelle, qui est plutôt un court roman et qui donne son nom au recueil, un vieillard qui fut jadis professeur évoque pour ses petits-enfants sauvages et illettrés ce qu'était, soixante ans plus tôt la vie en 2013, date de l'apparition de la peste écarlate, ainsi nommée parce qu'elle colore le visage en rouge. Elle décima la population de la terre et réduisit les humains pourtant civilisés et cultivés, à l'état d'êtres égoïstes, défendant le seul bien qui leur reste : leur vie ! Nous sommes donc en 2073 et l'ex-professeur Smith raconte ce qu'était la société civilisée et organisée et comment, épargné par la pandémie, il a survécu dans ce monde hostile redevenu sauvage où les opprimés d'alors ont réussi à s'affirmer grâce à leur brutalité et à prendre le pas sur leurs oppresseurs d'avant. Ses petits-enfants ne peuvent se figurer ce qu'il décrit pour eux mais il place son espoir dans les livres et la clé de lecture qui permet de les déchiffrer. Il a caché le tout dans une grotte et espère que l'espèce humaine retrouvera, grâce à cela, sa splendeur passée.
La seconde nouvelle, intitulée « Le dieu rouge » évoque la croyance d'une tribu sauvage en un dieu extraterrestre matérialisé par une sphère rouge qui émet un son. Un blanc, perdu dans la forêt, tente de percer ce mystère qui ne peut s'expliquer qu'au prix de la vie.
La troisième intitulée « Qui croit aux fantômes ?» met en scène deux rationalistes qui se sont donnés rendez-vous dans une maison hantée. Ils vont se trouver « possédés » par deux fantômes qui reviennent pour disputer une partie d'échecs dont leur vie dépendra.
« Mille morts » parle d'un fils de famille parti sur les mers et récupéré par un navire commandé par son père. Ce dernier va se servir de ce fils pour mener à bien des expériences où la mort est suivie de résurrections successives. Mais le fils ne saurait, jusqu'au bout être son cobaye.
L'auteur change de registre avec« la seconde jeunesse du major Rathbone » où il analyse, sur le mode humoristique, les conséquences des tentatives de rajeunissement du corps et de l'esprit d'un vieillard. Il faudra quand même compter avec Déborah, son ancien amour de jeunesse qui, elle aussi, bénéficia de cette expérience.
L'architecture d'un recueil de nouvelles n'est pas chose facile. Avec celui-ci, paru en 1912, Jack London (1876-1916) passe du registre tragique à l'humour, au moins en apparences. Avec la première nouvelle, publiée peu de temps avant sa mort, il semble nous avertir d'une possible fin du monde, provoquée par la maladie. Songeait-il à la Grande Guerre qui allait bouleverser le monde? Peut-être? Encore qu'il nous confie que les survivants restent capables de le reconstruire au moyen des livres refaire et de la connaissance que le Professeur Smith a sauvegardés. Il explore ici un registre plus mystérieux voire apocalyptique, jouant à la fois sur le fantasme de la fin du monde, de la mort, de l'éventuelle résurrection, l'anéantissement de la vie et la responsabilité humaine dans ce cataclysme ?
Avec la se seconde nouvelle, c'est clairement l'angoisse de la mort et une certaine désespérance qui transparaissent ici. La couleur rouge rappelle celle de la peste du premier texte et les mots évoquent une certaine perfection des formes et des sons, comme quelque chose qu'on découvre enfin après l'avoir tant recherché. Ce qui est ici suggéré c'est à la fois l'attrait de l'inconnu et la fascination et l'acception de la mort, une sorte de sérénité devant elle, le terme du parcours qui fut le sien durant sa vie et que l'écriture magnifia. Même la présence de Balatta n'y fera rien. Il la repoussera faisant prévaloir Thanatos sur Eros. Rappelons-nous que ce texte a été écrit quelques mois avant sa disparition.
Avec les deux autres textes, il semble présenter les choses sous un angle différent, peut-être plus léger? Voire. Celui où il évoque la présence de fantômes et qu'il écrivit à dix-neuf ans, doit sans doute beaucoup à Edgar Poe dont il fut le lecteur attentif. C'est la fascination de l'étrange qui habite la condition humaine avec son cortège de névroses, de perversions, de dérèglements... la mère de l'auteur était une spirite convaincue et celui qui fut son père et qui les abandonna tous les deux, versait lui aussi dans l'ésotérisme. Voulut-il régler ainsi, par l'écriture et l'imaginaire, ses comptes personnels avec eux? Quand il choisit le thème des expériences sur l'humain, sur le vivant, on songe à un médecin fou mais le registre ici est le fantastique. Derrière des considérations techniques difficiles à suivre, il évoque des expériences un peu déjantées qui procurent la mort mais aussi qui redonnent la vie. C'est certes de la pure fiction, mais c'est aussi une autre forme de réflexion sur la mort. N'oublions pas que Jack London est avant tout un athée, lecteur de Marx et que donc l'idée de Dieu est absente de ces textes.
On peut aussi y voir une forme de victoire de l'homme sur les événements qui pèsent sur sa vie, le triomphe du pessimisme, du défaitisme. Au dernier moment il réagit et fait prévaloir sa liberté. Le héros de « Mille morts » s'échappe, le vieux major redevenu jeune convole avec son amour de jeunesse,
Avec ce recueil, Jack London qui fut un auteur prolifique de plus de 50 livres qui, pour la plupart évoquent l'aventure explore ici un registre différent. Encore une fois, sa vie personnelle ses expérience ont nourri son écriture, mais celle-ci a joué pour lui un rôle d'exorcisme, mais c'est aussi le sien!
-
Le bureau des assassins - Jack London
- Le 04/11/2025
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°332– Mars 2009
LE BUREAU DES ASSASSINATS – Jack LONDON [1876-1916]– Stock.
Deux protagonistes principaux dans cette drôle d'histoire écrite par Jack London, laissée inachevée et terminée par Robert L Fish, un spécialiste de l'auteur d'après ses propres notes et finalement publiée de manière posthume en 1963.
D'une part Yvan Dragomiloff qui dirige un syndicat d'assassins comme au meilleur temps de la prohibition américaine, de l'autre Winter Hall qui a recours aux services du premier. Jusque là, ça va et tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles comme on dit quand on a des lettres, sauf que, pour être un authentique thriller, cela ne peut se passer comme cela. Cette organisation criminelle veut bien exécuter ses victimes pour de l'argent, mais encore faut-il que ce meurtre soit justifié! C'est à dire que celui qui doit mourir doit avoir attenté à l'existence de la société en perpétrant des méfaits tels que leur auteur doit effectivement être éliminé... pour le bien de tous! C'est là une condition sine qua non sur laquelle cette organisation ne transige pas. On devrait d'ailleurs plutôt parler de « bureau des exécutions ». C'est déjà peu banal, mais là où cela se complique vraiment, c'est que cet Hall entend passer un contrat avec Dragomiloff... pour tuer ce dernier, et comme on est franchement en plein délire, ce contrat est accepté par celui-là même qui dirige cette association, autant dire qu'il va lui-même organiser son propre assassinat, tout en ayant notifié à son commanditaire son intention de ne pas cependant se laisser faire et de vendre chèrement sa peau. Cette idée l'enthousiasme même et quand l'autre s'en étonne, il lui déclare tout de go qu'il a accepté cela par goût de « l'aventure », pour rompre une routine devenue trop pesante! Et comme nous sommes en pleine fiction délirante, Dragomiloff accepte ce contrat parce qu'il le juge moral et répondant totalement aux critères mis en place par lui-même dans le cadre de ce bureau des assassinats. C'est donc Hall qui devient en quelque sorte le dirigeant par intérim de cette organisation composée, on le verra, non d'assassins comme on pourrait s'y attendre mais d'érudits plus obsédés par les idées, la logique et les engagements moraux que par le respect de la vie humaine. A leurs yeux, ces principes surpassent tous les autres, jusqu'à l'absurde!
Pour compliquer le tout, Dragomiloff n'est pas exactement celui qu'il prétend être et a usurpé une identité... et bien entendu l'amour va venir aggraver en peu plus ce cas qui n'en avait vraiment pas besoin, en la personne de Grounia, la « nièce » de ce dernier dont Hall va bien entendu tomber amoureux! Là, cela devient franchement cornélien! Cette traque mortelle va-t-elle déboucher sur la destruction totale du « bureau », puisque, après avoir longuement hésité, chacun de ses membres se met en chasse pour éliminer celui qui en est le chef...et bien souvent y laisse sa vie.
Voilà donc le décor planté qui est le point de départ de cette rocambolesque histoire pleine de rebondissements et d'interrogations intimes et existentielles de la part des membres de cette organisation qu'il faut lire jusqu'à la fin.
Je dois dire que j'ai eu du mal, au début, à entrer dans cet univers romanesque. J'ai, cependant, une attirance particulière pour Jack London, pas seulement à cause de son talent littéraire qui n'est plus à démontrer, mais surtout parce que il était l'archétype de l'autodidacte. Il a été tour à tour marin, chercheur d'or, ouvrier, vagabond et j'aurais toujours une tendresse particulière pour ses hommes à qui la vie a réservé ses troubles, ses bouleversements, ses chagrins aussi et qui les ont sublimé dans l'art. Leur expérience protéiforme a nourri leur écriture qui vaut bien celle des intellectuels patentés. Elle est authentique parce que, non seulement ils savent prêter au lecteur le dépaysement de leur aventure, mais aussi parce qu'ils le font avec un naturel que seul les créateurs de leur trempe sont capables de recréer!
-
Quelques mots sur Walt Witman
- Le 28/10/2025
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°287– Décembre 2007
QUELQUES MOTS SUR WALT WITMAN [1819-1892]
Je crois que c'est Saint Augustin qui demandait qu'on se méfiât de l'homme d'un seul livre. Walt Witman fut pourtant cet homme puisque son recueil de poèmes « Feuilles d'herbe »[Leaves of grass), même s'il ne fut pas son oeuvre unique [Il est moins connu pour Good by my Fancy, Spécimen Days and Collecte...], il reste qu'il est surtout célèbre pour ce recueil de textes souvent remaniés et réédité neuf fois de son vivant, parfois sans l'aide d'un éditeur. On ne sait d'ailleurs pas s'il s'agit de prose ou de poésie, tant sa prosodie emprunte la forme nouvelle pour son époque du vers libre, pourtant le film « Le cercle des poètes disparus » de Peter Weir [1989] a remis à l'honneur un de ses poèmes, écrit à la suite de l'assassinat d'Abraham Lincoln [Oh capitaine, mon capitaine]. Son style est à la fois baroque et les grandes envolées lyriques voisinent avec des banalités étonnantes et quotidiennes. Son écriture passe sans grandes transitions de phrases prétentieuses voire pédantes, à l'usage de mots argotiques, abstraits, voire des néologismes ou des mots créés à partir de langues étrangères ou d'onomatopées, pour repartir en évocations mystiques, usant d'une langue faite d'éléments hétéroclites donnant au lecteur une impression mitigée, déconcertante même, sans réelle différence entre la langue parlée et la langue écrite. C'est un peu comme si l'auteur se sentait grisé par les mots et leur musique. On a voulu en faire le précurseur des symbolistes en ce qu'il a voulu exprimer l'inexprimable puisqu'existe dans sa créativité des correspondances entre le monde matériel et spirituel. On a même été jusqu'à voir en lui l'annonciateur des surréalistes. C'est dire l'importance de cet écrivain qui ne laisse personne indifférent.
On a beaucoup parlé de Witman, et il est vrai qu'il s'agit d'un grand poète américain, autodidacte et humaniste. L'expression peut d'ailleurs surprendre chez un peuple traditionnellement plus attaché à la recherche du profit et à la réussite sociale qu'à la culture et qu'à la poésie dont on sait qu'elles ne rapportent rien ou pas grand chose, mais c'est ainsi! Ce fils de fermier de Long Island s'est très tôt tourné vers l'écriture, comme journaliste d'abord, comme homme de Lettres ensuite. Il reste un écrivain spécifiquement américain qui croit en l'homme, en ses capacités de construire l'avenir dans le respect de la démocratie et la foi dans le bonheur sur terre et l'égalité entre hommes et femmes. Il était en cela tout à fait en phase avec son temps, mais aussi un précurseur notoire.
C'est vrai qu'il a été un auteur controversé, mais il a évoqué l'humanité toute entière, ce qui a fait de lui un poète universel. Il a été un être complexe, comme nous le sommes tous, à la fois poète de la terre, du peuple, célébrant les valeurs physiques, celles du travail, de la vie au grand air et volontairement oublieux des barrières sociales, mais étonnament moderne et intellectuel. Pour autant son écriture trahit un être angoissé, désespéré parfois ou bizarrement optimiste, mais sans la souffrance et le mélange de sentiments que seule nous inspire la vie, il n'y a pas de création artistique, d'autant que son existence ne fut pas exempte de passions tumultueuses [on a même évoqué l'homosexualité] dont il parla.
En cela, Witman était un être humain, avec ses passions, ses contradiction, ses doutes, ses espoirs et ses découragements. Il fut à la fois un écrivain mythique et mystique en ce sens qu'il parla de la vie sous toute ses formes, évoqua Dieu, source de toute création mais aussi force qui donne l'impulsion à toute l'humanité. Pourtant il n'était pas chrétien, mais célébra l'âme comme intimement liée au corps, aux sens. Il fut un visionnaire, chantre de la liberté et de l'égalité entre les hommes, désireux de voir d'avènement de « l'homme moderne »mais étonnamment individualiste, voire anarchiste parfois, un romantique et un prophète aussi!
Un poète disparu et injustement oublié!
© Hervé GAUTIER - Décembre 2007.
-
Le palais de l'infortune - Donna Leon
- Le 27/07/2025
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°1995 – Juillet 2025.
Le palais de l’infortune - Donna Leon – Calman-Levy.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Gabriella Zimmermann.
D’emblée le titre anglais « So shall you reap » qu’on peut traduire par « on récolte ce que l’on sème » donne le ton.
Ce palais c’est le « Plazzo Zaffo dei Leoni » à Venise. On découvre dans les canaux, le cadavre d’un homme, Inesh, un ouvrier quinquagénaire sri-lankais apparemment sans histoire, de sensibilité bouddhiste, habitant dans une dépendance de ce vieux palais depuis 8 ans. De plus il s’avère que la victime avait un os de doigt humain dans son gousset. Or, il se trouve que e commissaire Guido Brunetti l’avait rencontré la veille de sa mort, par hasard, à propos de l’éventuelle mise en vente de ce palais. Il est donc chargé de cette enquête et ses investigations révèlent la présence chez Inesh de documents sur les années 70-80 en Italie, période sombre marquée par les attentats, les enlèvements, les demandes de rançons et les assassinats politiques de la part des « Brigades rouges ». De plus il découvre des écrits de jeunesse d’hommes devenus depuis d’éminents universitaires et hommes politiques, Il devient dès lors étonnant que de tels documents soient en possession d’Inesh et que cela pourrait bien expliquer sa mort.
Le livre refermé, ce 32° roman de Donna Leon m’a paru un peu lent au début avec des considérations sur l’homosexualité d’un des collègues de Guido, sur le racisme, l’immigration, les déconvenues de la jeunesse, la vie familiale heureuse de notre commissaire et les talents culinaires de son épouse Paola. Il faut en effet attendre la page 80 pour entrer dans le vif du sujet et mon attention n’a véritablement été éveillée que vers la fin, avec l’intervention d’une religieuse… et d’un chien.
Ce n’est pas inutile de le rappeler, mais à Venise on ne peut que marcher et les investigations que notre commissaire y mène vont au rythme de cette déambulation. On n’échappe pas, et c’est inévitable, aux évocations sur le passé glorieux et sur les richesses culturelles de la cité des doges et c’est évidemment un plaisir de retrouver toutes ces descriptions vues à travers les yeux du commissaire qui est aussi un homme cultivé. On retrouve le vice-questeur Patta, inconsistant chef de service et surtout l’indispensable Elettra et ses recherches sur internet. L’étude des documents trouvés chez Inesh l’invitent à replonger dans le passé et les écrits révolutionnaires de ceux qui maintenant sont des notables respectés. Cette mémoire de papier est toujours intéressante à explorer… et pleine de surprises.
Donc un roman assez lent à suivre au départ que j’ai cependant continué à lire, parce que c’était une œuvre de Donna Leone que par ailleurs j’apprécie(un livre est le résultat d’un travail et le lire jusqu’au bout est un hommage à son auteur) mais surtout parce que, vers la fin seulement, cela devient passionnant.
C‘est certes bien écrit (bien traduit) mais l’ensemble m’a paru un peu décevant.
N°1995 – Juillet 2025.
-
Pourquoi j'ai mangé mon père -Roy Lewis
- Le 11/10/2023
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°1782– Septembre 2023
Pourquoi j’ai mangé mon père – Roy Lewis- Actes sud
Traduit de l’anglais par Vercors et Rita Barisse.
Sous un titre peu engageant, entre humour et concept quasi œdipien, l’auteur nous présente une famille de pithécanthropes. C’est, Ernest, un des fils qui nous la présente. Il y a Édouard, son père, inventif, toujours en quête découvertes qui généreront l’évolution dont profiteront les siens et qui leur permettront de survivre, son oncle Vania, plus réfractaire aux améliorations, qui se cantonne dans une vie arboricole mais n’en est pas moins un peu profiteur. La mère Mathilde et quatre gars, Oswald le chasseur, Tobie le scientifique, Alexandre l’artiste et Ernest le narrateur, plus volontiers réaliste et, tempère l’impétuosité et l’ingéniosité de son père, complètent le tableau. Sans compter toute une parentèle. On se doute bien que, à l’énoncé de cette maisonnée et dans le contexte préhistorique les anachronismes ne vont pas manquer et avec eux les occasions de sourire mais peut-être pas de rire, n’en déplaise à Vercors, le traducteur et le préfacier. Les remarques et réflexions des différents personnages, les situations actuelles transposées dans cette époque lointaine valent leur pesant de confusion et d’humour. On ne coupe pas à toutes les découvertes, bonnes ou mauvaises mais le père et ses vues sur l’avenir, ses réflexions philosophiques et ses projets moraux ont de quoi nous étonner. Quant aux remarques de certains fils pour s’opposer à la tutelle du père elles ont effectivement quelque chose de très actuel. Après tout ses considérations étaient peut-être aussi celles des hommes de la préhistoire.
La quête de femelles pour perpétrer la race à quelque chose de « l’enlèvement des Sabines » et la façon de draguer et de passer une une de miel est très couleur locale.
Pour autant, malgré la 4° de couverture, le style humoristique et agréable à lire, la qualité de la documentation et l’avis général, ma lecture n’a pas été à ce point enthousiaste .
.
-
Avec la permission de Gandhi - Abir Mukherjee
- Le 02/05/2023
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°1739 – Avril 2023
Avec la permission de Gandhi - Abir Mukherjee – Liana Levi
Traduit de l’anglais par Fanchita Gonzalez Battle.
Calcutta fin décembre 1921, le prince de Galles est en visite officielle dans cette partie de l’Empire et les partisans de Gandhi, favorables à l’indépendance, entendent bien en profiter pour fomenter des troubles que le capitaine de police Wyndham, opiomane et alcoolique, et son adjoint le sergent Banerfee sont précisément chargés d’éviter. Il ne manquerait plus que la visite princière soit polluée par une révolte populaire. Des entrevues ont lieu avec les meneurs indépendantistes d’autant plus facilement que le sergent est de leur famille, mais compte tenu des événements cela ne servira à rien puisque le sergent il a du mal à concilier ses sympathies pour les mouvements indépendantistes et son appartenance à la police britannique. Un soir qu’il quitte précipitamment une fumerie d’opium, le capitaine tombe sur le cadavre d’un chinois qui peu de temps après disparaît pour se retrouver dans une morgue, une infirmière portugaise est retrouvée morte, assassinée dans d’étranges circonstances, d’autres cadavres sont découverts, exécutés selon le même modus operandi et les troubles se multiplient dans le quartier résidentiel anglais, ce qui commence à faire beaucoup. Il enquête donc, dans les vapeurs de son whisky favori et le brouillard des fumeries d’opium, mais ses investigations sont troublées par les militaires anglais, un peu comme si ses recherches gênaient paradoxalement les autorités britanniques.
Le style est alerte, agréable à lire, avec un sens consommé du suspense.
-
La sanction - Trevanian
- Le 14/03/2023
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°1725 – Mars 2023
La sanction – Trevanian – Gallmeister.
Traduit de l’américain par Jean Rosenthal.
Jonathan Hemlock est un alpiniste chevronné et célèbre, bel homme, célèbre professeur dans une université américaine et spécialiste des Impressionnistes français qu’il collectionne à grands frais, mais cela c’est pour la couverture ; en réalité c’est un tueur à gages au service de l’organisation sécrète CII (Central Intelligence Institute) et il doit, un peu contraint à cause de son impérieux besoin d’argent, accepter d’infliger une « sanction », c’est à dire un meurtre , à l’ennemi en représailles à l’assassinat d’un des agents de l’institut. Il apprend que cela doit avoir lieu dans le cadre d’une ascension très médiatisée dans les Alpes suisses de la face nord de l’Eiger, voie demeurée inviolée. Il s’intègre donc à ce groupe sans savoir qui des trois hommes qui le composent il doit exécuter ; il ne le saura qu’au dernier moment, situation d’autant plus délicate pour lui que la victime potentielle peut aussi devenir son assassin et que sa mission doit évidemment demeurer secrète pour tous. Même s’il a vieilli et que ses réflexes de sa jeunesse se sont émoussés, Jonathan reste un montagnard passionné pour qui cette escalade est un défi personnel , d’autant que la météo est ici particulièrement capricieuse et le danger constant. Il ne connaît guère les membres de l’expédition mais ils ont tous une idée précise pour la réaliser, sous les yeux curieux d’une faune avide de sensations fortes, les « oiseaux de l’Eiger », journalistes, riches curieux, acteurs désireux d’être vus… Au passage l’auteur se livre à une étude pertinente sur l’espèce humaine et ses comportements. C’est donc une histoire haletante, bien écrite et agréable à lire, entre roman d’espionnage et thriller où Jonathan a tout d’un agent secret, séducteur, prompt à la bagarre, toujours en éveil et efficace qui ne peut croiser une jolie femme, mariée ou non, sans la mettre dans son lit, ce qui risque de compromettre cette mission.
De « La sanction » on a tiré un film en 1975.
De l’auteur on ne sait pas grand-chose si ce n’est qu’il s’agirait de Rodney Whiteker (1931-2005) et qu’il usait souvent de pseudonymes pour écrire ses nombreux romans, qu’il aurait vécu au pays basque français, que ses livres ont pour la plupart été des succès de librairies et traduits dans de nombreuses langues. Il a toujours refusé les interviews filmées et les photos pour préserver son anonymat. Ce détail assez original me paraît importante à l’heure où chacun recherche, par des moyens pas toujours honnêtes, à se faire connaître du grand public. J’avais déjà fait cette remarque à propos d’Elena Ferrante, la talentueuse auteure de « L’amica geniale », (« l’amie prodigieuse » en français) qui cultive également le mystère autour de sa personne.
-
La cloche de détresse - Sylvia Plath
- Le 03/02/2023
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°1713 – Février 2023
La cloche de détresse – Sylvia Plath – Gallimard.
Traduit de l’anglais par Michel Persitz.
Après avoir lu le roman de Coline Pierré « Pourquoi pas la vie » consacré à Sylvia Plath (1932-1963), j’ai eu envie d’en savoir davantage sur cette poétesse et romancière américaine qui s’est suicidée à 30 ans. Elle est surtout connue internationalement pour ses poèmes et ce livre, d’inspiration autobiographique comme beaucoup de ses textes, est son unique roman.
Sa courte vie a été marquée par la dépression, la désespérance et l’influence étouffante et néfaste de son mari, le poète Ted Hughes. avec qui elle resta mariée sept années. La plus grande partie de son œuvre fut publiée après sa mort par son ex-mari qui était également son exécuteur testamentaire et ses poèmes, dont certains étaient prémonitoires, lui ont valu, à titre posthume, le Prix Pulizer de poésie en 1982. Sa vie et son suicide ont fait d’elle, de la part des féministes, la figure emblématique de la femme étouffée par une société dominée par les hommes.
Ce roman dont le titre lui-même est révélateur, a été publié en 1963, un mois avant sa mort, sous le pseudonyme de Victoria Lucas, puis à nouveau republié après son suicide. Il révèle la dépression et la bipolarité dont souffrait Sylvia Plath. La narratrice, Esther Greenwood, 19 ans, est lauréate d’un concours de poésie ce qui l’amène à passer un été à New York et à goûter à la vie mondaine qu’elle refuse, l’année de l’exécution des époux Rosemberg. Elle se lie d’amitié avec Dooren, bien différente d’elle mais à qui elle veut ressembler malgré le mépris qu’elle lui inspire. Elle prend peu à peu conscience de son inutilité, ce qui ne l’encourage pas à aimer sa vie. La perte de sa virginité l’obsède en même temps qu’elle refuse la chasteté imposée aux jeunes filles avant le mariage alors que les hommes pouvaient mener une vie sexuelle débridée. Après son séjour new-yorkais qui l’a quelque peu déçue, elle rentre chez ses parents mais la mort de son père la plonge dans une profonde dépression que des soins, notamment des électrochocs, ne parviennent pas à guérir. Elle se révolte contre la société qui l’entoure et on la sent prise dans le maelstrom de la dépression entre manque de sommeil, dépendance aux médicaments, état d’abattement, solitude, enfermement et paranoïa (une cloche de verre). Elle veut sortir de l’univers psychiatrique où elle s’enfonce cependant de jour en jour. La perte de sa virginité qui correspondait à ses aspirations vers l’indépendance et la liberté se termine mal, à l’image de sa vie et sonne comme un échec.
C’est évidemment une critique de cette société américaine des années 50, paradoxalement enviée par le reste du monde mais où elle ressent une impression d’étouffement. C’est donc un roman qui, par delà l’histoire, résume bien ce qu’a été la vie de son auteure, pleine de révoltes et d’espoirs dans la vie mais bousculée et engluée dans la dépression jusqu’à sa triste fin. Autant de jalons de son parcours inspiré par son attirance vers la mort. Une lecture éprouvante.
-
Satchmo - Léo Heitz
- Le 15/01/2023
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°1707– Janvier 2023
Satchmo - Leo Heitz – Jungle RamDam.
Derrière ce nom un peu bizarre qui n’est en fait qu’un surnom, se cache un petit garçon noir, amoureux du jazz et du chant qui deviendra Louis Armstrong;Nous sommes au début du XX° siècle dans un quartier pouilleux de la Nouvelle-Orléans... Il prend conscience que cette musique essentiellement noire qui est née de l’esclavage et la religion chrétienne est désormais jouée avec succès par les blancs du nord des États-Unis et cela le révolte. Son histoire débute plutôt mal, son père est déjà parti vers d’autres aventures, sa mère est une prostituée et il tâte de la maison de correction où il trouve dans l’étude de la trompette un manière d’évasion. Tout cela n’a pas été aussi simple, il a fallu ramer et ramer encore, il a eu de a chance, a peut-être rencontré Al Capone (renommé Al Ratone) à Chicago, pourquoi pas ?
On a l’impression d’après le titre que c’est une biographie d’Armstrong que nous allons lire ; c’est en partie vrai mais en réalité c’est une fiction violente, par ailleurs parfaitement acceptable, qui tourne autour de la volonté de Louis d’arracher sa mère à la prostitution.
Ce n’est pas une histoire drôle, la vie l’est rarement, le graphisme est assez brut et les couleurs sombres, noir, marron et sépia, sont là pour accentuer cette certitude. Mais pourquoi leur avoir fait à tous des têtes de rats ?
-
Italiani - Tim Parks
- Le 20/11/2022
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°1695 – Novembre 2022
Italiani – Tim Parks – Bompiani.
Italiani – Tim Parks. Bompiani.
Ce livre a été publié en 1995 et parle évidement des Italiens et de l'Italie. L'auteur est Anglais, né à Manchester en 1954, et est tombé amoureux de ce pays mais aussi d'une italienne qu'il a épousée. Il s'intéresse à la culture de ce pays, à sa littérature, au point de traduire les œuvres de Moravia, de Tabucchi, de Calvino...
Pour l'heure il évoque pour nous cette petite ville de montagne et d'eau, Montaldo en Vénétie, à l'atmosphère particulière où les gens ne sont pas spécialement heureux d'avoir pour voisin un Anglais qui a épousé une italienne, qui y loue une maison et qui raconte son histoire sur une année, évoquant méticuleusement ce qu'il voit. Rien n'échappe à cet étranger transplanté ici et à son regard aigu et qui décrit une société bien différente de la sienne. Il le fait avec ironie et ses remarques et ses annotations sont pertinentes qui sont pour lui une occasion de réfléchir sur lui-même. La vie à Montaldo n'est ni meilleure ni pire qu'ailleurs et il décrit ce qu'il voit sans complaisance, le comparant à son propre pays. Il n'est évidemment pas insensible à la beauté et l’originalité de son pays d'adoption, mais ce qui le frappe ce sont ces "vices" qu'il dénonce que sont la bureaucratie, l'usage des pots de vin, la corruption du sud et les irrégularités du nord du pays, les atermoiements des partis politiques, la superposition du sacré et du profane, la superstition et les croyances populaires, la cohabitation de la légalité et de l'illégalité, l'art de vivre des Italiens, leur façon de conduire et de se conduire, les bars et le rituel du café, la mafia ainsi que toutes choses qui sont propres à un pays latin, bien différent du sien. Il a un regard pointu sur les gens qu'il côtoie, ses voisins, ou plutôt ses voisines, qui, même s'il ne leur demande rien, le comble de conseils, comme s'il venait d'une autre planète. C'est un peu la version italienne des "carnets du major Thompson".
Malgré tout cela, Tim, l'auteur anglais sera convaincu de pouvoir vivre ici, loin de chez lui et peut-être de devenir Tino, un vrai italien. Il faut croire qu'il y est parvenu puisque non seulement il s'y installé depuis 1981 mais en a même pris la nationalité, traduit les grands auteurs transalpins et donne des conférences dans le cadre de l'université de Milan sur la traduction littéraire.
J'ai lu ce roman en italien non seulement parce qu'il n'est pas encore, à ma connaissance, traduit en français et que c'est toujours agréable de découvrir un auteur inconnu, mais aussi, comme d'habitude pour la musicalité de la langue lue souvent à haute voix, pour le plaisir. Apparemment il a été écrit en anglais, sous le titre de "Italian neighbours" en 1992, traduit en italien par Rita Baldassarre, son épouse.
-
La vie tumultueuse du Gréco - Donald Braider
- Le 05/08/2022
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°1662 - Août 2022
La vie tumultueuse du Gréco – Donald Braider – Presses de la cité.
Traduit de l'américain par Marie Alyx Revellat.
Quand on évoque le Gréco (1541-1614), de son vrai nom Domenikos Theotoko, on songe presque automatiquement à ses tableaux très colorés, à son possible astigmatisme en raison de la forme allongée de ses personnages et à son côté mystique à cause de l'inspiration religieuse de nombre de ses tableaux.
Fils d'un important marchand crétois, il était destiné à prendre la suite de son père, mais se signala très tôt par son talent de peintre d'icônes. Il était donc de confession orthodoxe. La Crête étant à cette époque une possession de la Sérénissime catholique, il s'y rendit et fut bouleversé par la beauté picturale des églises romaines et plus précisément par les œuvres du Titien qui le prit dans son atelier vénitien. Là réside peut être le secret de sa conversion? Le cardinal Farnèse l’accueille à Rome où il rencontra également Le Titoret, mais c'est l'Espagne de Philippe II, torturée par l’Église et par l'Inquisition qui va le consacrer. Sa révolte contre les épreuves que la vie lui a envoyées et son séjour dans l'austère et très chrétienne ville de Tolède vont faire de lui un peintre très soucieux de faire reconnaître sa peinture mais aussi un mystique qui va se consacrer aux sujets religieux et aux portraits d'aristocrates et d'ecclésiastiques, donnant un nouveau mais déterminant sens à son talent.
Le style du livre est très journalistique puisque c'était le métier de Donald Braider, bien documenté sur le plan historique même si je ne m'imaginais pas un jeune homme venu d"une lointaine province vassale de Venise, puisse s'adresser de cette manière à un maître de la peinture dont il souhaite être l'élève. J'ai été passionné par la vie de ce peintre, certes illuminée par le succès mais aussi assombrie par la mort de ceux qui l'entouraient et qu'il aimait. C'est une bonne approche de cet artiste majeur, en revanche, le livre refermé, je n'ai pas bien saisi le côté "tumultueux" de cette vie, à part peut-être sa mutation intérieure vers la religion comme refuge et qui a influencé son art contre l'adversité. J'aurais sans doute préféré la traduction du titre original, "Colors from a Light Within"( Couleurs d'une lumière intérieure") qui me parait plus évocatrice et sans doute mieux appropriée. Ce peintre me laisse davantage l'impression d'un mystique, un témoin de son temps, un homme torturé par une vie intérieure, bouleversé par l'intolérance de l'Espagne et qui a dû se battre pour s'imposer.
-
Meurtre à Cape Cod - Mary Higgins Clark
- Le 14/11/2021
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
Meurtre à Cape Cod – Mary Higgin Clark – Albin Michel.
Traduit de l'américain par Anne Damour.
C'est un ensemble de huit nouvelles dont l'une d'elles donne son titre au recueil. Willy et Elvira forment un couple d'Américains moyens qui a eu la chance de gagner à la loterie nationale et qui maintenant fréquente la haute société. Ils sont cependant restés très simples et attentifs à leur prochain ce qui fait d'eux les heros de ces courtes aventures policières. Ce sont là des valeurs chrétiennes d'entr'aide qui se retrouvent dans l'écriture de Mary Higgins Clark (1927-2020) qui était une fervente catholique. Son oeuvre est également marquée par l'illustration de thèmes révélateurs de l'espèce humaine dans ce qu'elle a de moins attachant tels que la trahison, les rivalités familiales et amoureuses, la cupidité...L'auteure qui avait eu une autre vie avant d'entrer en littérature publia notamment une biographie romancée de Georges Washington qui ne connut pas le succès espéré. A partir de 1975, elle s'essaya au roman policier avec "La maison du guet" qui devint très vite un best-seller. et de nombreux autres romans suivirent, couronnés par des prix prestigieux, ce qui lui valut d'être reconnue comme "la reine du suspens" et connut un succès mondial .
Ce recueil est notamment marqué par la dernière nouvelle intitulée "La mort porte un masque de beauté" où il est question de la mort bien mytérieuse d'un top modèle et où le suspens est distillé par petites touches et maintient le lecteur en haleine jusqu'à la fin.
Je continue à explorer la culture nord-américaine à travers le cinéma, la litterature, la peinture...
-
l'appel du cacatoès noir - John Danalis
- Le 08/03/2021
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N° 1533 – Mars 2021
L’appel du cacatoès noir – John Danalys – Éditions Marchialy.
Traduit de l’anglais (Australie) par Nadine Gassie.
Je remercie les éditions Marchialy et Babelio qui m'ont permis de découvrir ce roman.
John Danalis est Australien, blanc, écrivain, et a passé sa jeunesse avec Mary, un crâne aborigène, dans le salon de ses parents. Pour eux ce n’était qu’un élément de décoration et pour lui un jouet original. Un peu par hasard, à quarante ans, en 2005, après un parcours professionnel hésitant, il le retrouve, prend conscience que sa place est au sein de son peuple et fait vœu de l’y rapporter. Ce choix va changer sa vie et celle de ses proches. Jusqu’à présent, pour lui l’Australie c’était le folklore des kangourous et les Aborigènes un mystère, un peuple jamais croisé, tout juste aperçu de loin et dont les membres vivaient parqués dans des communautés. C’est aussi, depuis toujours, un pays d’immigration et de conquête intérieure avec confiscations de leurs terres aux indigènes. Pire, il y a un thème récurent, celui de « la génération volée »qui, à partir de 1814, a consisté à voler les bébés des autochtones pour les placer dans des institutions ou les confier à des familles blanches ; pour nous européens cela rappelle le nazisme de la Seconde guerre mondiale mais cela correspondait à une volonté de perpétrer un génocide culturel et spirituel en même temps que d’en effacer les traces. Pourtant, auprès des Aborigènes locaux et même au sein de la famille de John, son projet de restitution de ce crâne, avec rituels religieux, protocole culturel et autorisations des clans, emporte l’accord enthousiaste de tous. Ce qui n’était au départ qu’une simple intention devient rapidement un événement local avec la présence d’un couvre-chef traditionnel en plumes de cacatoès noir, totem emblématique de la tribu à laquelle appartenait Mary.
Au départ, quand j’ai ouvert ce livre, je me suis dit que j’allais devoir le parcourir par obligation et qu’il allait sûrement me tomber des mains. Pourtant, au fil de l’histoire de John, apparemment un récit autobiographique plus qu’un roman, on découvre petit à petit une foule de centres d’intérêt et ce d’autant plus que le texte est bien écrit et devient passionnant. Le lecteur l’accompagne dans un mal-être puis dans une profonde dépression avec de « folles » intentions suicidaires à cause de la prise en compte progressive de faits avérés à connotation xénophobe qui se sont succédé au cours de l’histoire de l’Australie, un peu comme s’il en faisait une affaire personnelle avec l’inévitable culpabilisation judéo-chrétienne qui gangrène nos sociétés et nos consciences. Il nous la présente comme la conséquence directe de cette « rencontre » avec Mary et surtout son histoire et celle de ce peuple opprimé par les colons anglais, arrivés sur cette terre avec l’intention précise d’en expulser les occupants en les massacrants, de prendre leur place et d’y prospérer. C’est le geste ancestral de tous les colonisateurs qui révèle encore une fois le côté sombre de l’espèce humaine, avec en prime un discours moralisateur, altruiste, hypocrite et bien-pensant avec une volonté de civiliser et d’humaniser ces peuples. J’ai cependant du mal à imaginer qu’il ait dû attendre l’âge de quarante ans pour prendre réellement conscience de ce racisme, que ce crâne n’ait été pendant ses années d’enfance qu’un jouet sans qu’il ne pose aucune question à ses parents d’un niveau culturel élevé et que ces autochtones n’ai été qu’un décor lointain. Qu’il dénonce la réponse psychiatrique qui consiste en l’administration de médicaments toxiques, je veux bien le croire, qu’il ne trouve sa guérison qu’en mettant des mots sur ses maux, pourquoi pas si cela fonctionne, encore que j’ai toujours un petit doute sur l’aspect libératoire à long terme de la parole.
Je ne suis pas spécialiste de ce pays mais il me semble que les Aborigènes sont pour lui un problème récurrent, qu’une véritable réconciliation n’est pas possible et que ce qu’à fait John, pour être remarquable, n’en restera pas moins lettre morte.On maintiendra les autochtones dans un état d’infériorité en méprisant leur philosophie et leur culture ravalés au rang de folklore en maintenant leurs restes dans des musées.
-
Betty - Tiffany Mac Daniel
- Le 22/12/2020
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N° 1520 – Décembre 2020
Betty – Tiffany Mc Daniel - Gallmeister.
Traduit de l’américain par François Happe.
Betty, c’est la narratrice,née en 1954 dans l’Ohio d’une mère blanche et d’un père Cherokee. Elle nous raconte l’histoire de sa famille, de cet homme et de cette femme apparemment faits l’un pour l’autre et de leur parcours dans la vie. C’est aussi un vibrant hommage à son père, travailleur infatigable et attentif à sa maisonnée qui sait lui transmettre la culture indienne, pratiquer la médecine empirique et vivre dans le respect de la nature. Plus que ses autres enfants, Betty sera pour lui « la petite indienne » à qui il va transmettre son savoir auquel elle va ajouter la folie et la naïveté de l’enfance et, dans une sorte de syncrétisme, y intégrer le message du christianisme et de la culpabilité judéo-chrétienne inévitable. Pour elle l’écriture sera, malgré son jeune âge, déjà un exorcisme. Elle écrit des histoires pour redessiner le monde autour d’elle et conjurer les fantômes de son enfance. Cette famille restera à part de la communauté et, compte tenu de ce contexte, la pauvreté, le racisme, l’intolérance, l’exclusion, la marginalité, l’errance font aussi partie du décor, mais aussi, comme en contrepoint, toute la magie de la poésie et de la sagesse indiennes
La figure de ma mère reste douloureuse et marginale par rapport à celle du père. Son domaine à elle c’est la maison, le quotidien et son rôle de protectrice de la famille la libère un peu de son passé obsessionnel. C’est à Betty et à aucun autre de ses nombreux enfants qu’elle confie ce qu’a été son enfance difficile faite d’inceste paternel et de passivité maternelle au point que la petite fille a du mal à comprendre ce qu’ont été ces épreuves si lourdes à porter qui, même longtemps après, se réveillent sans crier gare et l’ont conduite au bord de la mort. Elle les traînera toute sa vie. Pour autant cette famille n’a rien d’idyllique et c’est, sans doute au nom de l’exemple reproduit, qu’un des garçons viole une de ses sœurs. Dans ce microcosme familial le père représente le coté merveilleux, avec ces histoires extraordinaires, sa façon de vivre dans un autre monde et la mère le côté à la fois réel et obsessionnel. Les enfants de ce couple grandissent dans ce contexte aimant et complice, pleins de rituels puérils, avec la peur et l’envie de grandir, de voir le monde à l’extérieur de cette petit ville de Breathed où ils habitent, l’espoir et la crainte du lendemain, du temps qui passe et la mort qui peut frapper à tout moment...Pourtant, ces liens qui les unissaient finissent par se distendre et chacun part dans sa direction. C’est aussi un regard aiguisé porté sur la société de cette Amérique profonde inchangée depuis des générations.
Ce que je retiens avant tout, au-delà de l’hommage, c’est la démarche de mémoire, l’échec à l’oubli qui est une grande constance de l’espèce humaine, pour que la parentèle de l’auteure garde le souvenir de ce couple à la fois ordinaire et exceptionnel. C’est aussi un texte initiatique de passage de l’enfance à l’âge adulte, un livre sur les secrets de famille et ses dénis, les non-dits. Je ne me suis pas ennuyé au long des sept cents pages de ce récit anecdotique découpé en chapitres distillé sous l’égide alternatif de faits divers relatés répétitifs et mystérieux par le journal local, de versets de la Bible et dans l’omniprésence de Dieu et du péché, ce qui réalise une sorte de synthèse religieuse avec les légendes indiennes et du quotidien. J’ai senti une sorte de doute sur Dieu quant à son absence d’action sur La vie des hommes autant que le poids réaffirmé de son double, le diable ce qui met en lumière la dualité traditionnelle de cette religion autant que les fantasmes et les phobies populaires.
J’ai aimé cette saga bien écrite et agréable à lire, un texte poétique et émouvant qui retient l’attention de son lecteur jusqu’à la fin.
-
une confession - John Wainwright
- Le 29/09/2020
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N° 1506- Septembre 2020.
Une confession - John Wainwright – Sonatine Éditions.
Traduit de l’anglais par Laurence Romance.
John DuxBury, la cinquantaine, en est à un point de son existence où on fait le point. Son entreprise d’imprimerie est prospère mais son mariage se révèle morne, routinier et il recherche vainement le chemin du bonheur. Ainsi prend-il la plume pour un journal intime à destination de son fils Harry et pour cela il n’omet rien dans sa tentative de compréhension de sa situation personnelle et des raisons qui ont présidé au basculement d’un mariage qui s’annonçait sous les meilleurs auspices...Jusqu’à l’accident fatal de son épouse qui tombe d’une falaise lors d’une balade en amoureux. C’est une mort accidentelle mais il éprouve un sentiment de tristesse mêlé de culpabilité et sur des allégations incertaines d’un marginal quelque peu tourmenté et pas vraiment fiable, une enquête criminelle menée par l’inspecteur Harry Harker est ouverte, pour assassinat, malgré les conclusions du coroner ! Ce sont donc de simples suppositions qui la motivent et cela le perturbe comme cela dérange son chef direct, incapable de l’aider à la résoudre.
Le roman alterne journal intime de Duxbury, des moments de l’enquête et des détails donnés par divers protagonistes qui nourrissent ces recherches. L’inspecteur mène ses investigations souvent au bluff et à la limite de la légalité, mais à force de ténacité il en apprend beaucoup sur ce couple apparemment uni au point qu’il en est quelque peu ébranlé et se prend au jeu, en fait une affaire personnelle, malgré l’absence de preuves, en faisant simplement valoir « son intime conviction ». Au départ il n’est pas du tout convaincu de la culpabilité de Duxbury mais au cours de l’enquête et surtout après la révélation, par hasard, de l’existence d’un journal intime tenu par celui qu’il croit coupable, il s’accroche. Ce document qu’on tient dans le secret de sa conscience, pour fixer des circonstances particulières avant qu’elles ne soient happées par l’oubli, pour se justifier à ses propres yeux, s’expliquer à ceux des autres, bref des phrases qui ne sont destinées qu’à soi-même où à des proches et qui visent peut-être à une sorte de contrition. Cela me rappelle que l’écriture est une chose simple, ordinaire mais fascinante et peut se révéler dangereuse. C’est un peu la version particulière du « jugement dernier » où on est soi-même son propre procureur. S’appuyant sur ce document, Harker est un fin psychologue, joue sur les états d’âme des personnages, sur leur psychologie, fait appel à son imagination, à son expérience, interprète, dissèque, profite de l’effet cathartique supposé de l’écriture, flaire le mensonge possible, démonte l’image hypocrite que cet homme a toujours voulu donner de lui, se fait accusateur, inquisiteur même, exploite les fêlures de Duxbury et obtient des aveux. Ce policier qui est imperméable à tout, à la hiérarchie comme aux convenances administratives, me plaît bien.
Le livre refermé, j’avoue avoir apprécié ce roman policier publié dans les années 80, c’est à dire « à l’ancienne » comme on dit, différent de ce qu’on fait maintenant, avec sexe et violence aveugle, tout un univers qu’on retrouve chez Simenon qui, parait-il, a apprécié ce roman. L’auteur était lui-même un ancien policier et son expérience a nourri la trame de ce polar baigné de suspense jusqu’à la fin, mais il en a aussi profité pour se livrer à des considérations sur la vie, l’éphémère et la fragilité des choses, la volonté de nuire et de détruire de l’homme, l’amour, le mariage, le couple, l’image qu’on veut donner de soi-même et l’hypocrisie qui enveloppe le tout, tout cela loin des clichés communément admis. Le style est fluide, sans recherche particulière et fort agréable à lire.
Cette ambiance rappelle l’ambiance du film « garde à vue » projeté récemment à la télévision et qui est l’adaptation d’un autre roman de John Wainwright.
-
La peur qui rôde et autres nouvelles -Howard Philips Lovecraft
- Le 11/03/2020
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
 N° 1438 - Mars 2020.
N° 1438 - Mars 2020.La peur qui rôde – Howard Phillips Lovecraft- Denoël.
Traduit de l’américain par Yves Rivière.
C’est un recueil de trois nouvelles avec pour unique thème la peur, comme son titre l’indique. La première, qui donne son titre à l’ouvrage évoque une maison hantée habitée par une vieille légende et une présence mystérieuse, une famille maudite, des disparitions, des souterrains et des tombes viennent compléter le décor que les éclairs et la nuit illuminent.
Je serais, à titre personnel, assez versé dans ce genre littéraire mais j’avoue être très peu entré dans l’histoire étrange et absurde de la première nouvelle intitulée « La peur qui rode » . En revanche l’histoire labyrinthique de « la maison maudite » et l’évocation de la lande irlandaise désolée et chaotique et les allusions au Moyen-Age et à la peste de « La tourbière hantée » m’ont passionné.
Je ne connaissais pas Lovecraft [1890-1937] avant d’avoir lu ce recueil, son enfance meurtrie par la mort de son père, ses obsessions morbides et oniriques qu’il exorcise par l’écriture, l’influence d’Edgar Poe et de Guy de Maupassant notamment à l’exemple de sa nouvelle « l’appel de Cthulhu ». Son nom est associé à l’horreur à la peur, au mystère, à la superstition, aux spectres... et il a influencé et inspiré nombre d’écrivains tel Jorge Luis Borges ainsi que des auteurs de science- fiction.
©Hervé Gautier http:// hervegautier.e-monsite.com
-
Le vieil homme et la mer - Ernest Hemingway
- Le 03/03/2020
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
 N° 1437 - Mars 2020.
N° 1437 - Mars 2020.Le vieil homme et la mer – Ernest Hemingway. Gallimard
Traduit de l’américain par Jean Dutour.
C’est la courte histoire de Santiago, un vieux pêcheur cubain malchanceux qui n’a pas attrapé de poisson depuis quatre vingt quatre jours au point que les parents de Manolin, le garçon qui d’ordinaire l’accompagne, ont embarqué le gamin sur un autre bateau qui, lui, rapporte du poisson, mais le petit aime bien Santiago et en prend soin. « Le vieux » prend la mer, attrape un gros marlin et après une longue lutte de deux jours et trois nuits qui l’amène bien au-delà du Gulf-Stream, sa zone coutumière de pêche, l’arrime à sa barque mais à ce moment il subit l’attaque de requins qu’il combat également mais c’est un squelette d’espadon qu’il ramène au port. Il retrouve Manolin et s’endort en rêvant à sa jeunesse.
C’est un cour roman ou un longue nouvelle, comme on voudra, qui se lit d’une traite et qui commence comme un conte par « il était une fois », comme une de ces histoires merveilleuses pour enfants qu’il faut aussi que les adultes comprennent comme un message. Cet ouvrage a fait l’objet de nombreux commentaires sur l’amitié entre ce vieil homme et ce jeune garçon qui prend soin de lui, mais ce sont sans doute les monologues de Santiago qui soulignent sa solitude qui est aussi probablement celle de l’auteur. C’est peut-être une vue de mon esprit mais dans cette lutte aussi bien du poisson que du vieux j’y vois quelque chose qui ressemble à la quête d’Hemingway pour acquérir sa qualité d’écrivain, que certes il portait en lui depuis toujours, mais qu’il devait reconquérir et réaffirmer à la publication de chacun de ses livres. Le combat du vieux contre le poisson, avec les souffrances que cela implique pour lui , c’est un peu la même chose. Ce que Santiago ramène au port et qui ne lui rapportera rien, c’est peut-être aussi la conquête de l’inutile ou la reconquête de son honneur de pêcheur, une victoire sur la malchance ou l’intuition de l’humilité face à un trop grand appétit de réussite. J’y vois aussi le simple cours de la vie qui pour l’auteur a sans doute été belle mais qu’il sent petit à petit lui échapper. Quand il écrit ce roman il a 52 ans et décédera 10 an plus tard. Peut-être se ressent-il déjà des maux qui précéderont sa mort [il n’a d’ailleurs pas été à Stockholm recevoir son Prix en raison de sa santé défaillante]. On peut y voir aussi un dernier combat, une sorte de baroud d’honneur avant de se retirer définitivement. Le sommeil du vieux à la fin ressemble symboliquement à la mort inévitable avec ses regrets et ses remords d’une vie qui s’achève. Il y a dans la démarche de Santiago qui demande pardon au poisson pour l’avoir tué et en ressent de la culpabilisation une dimension religieuse, c’est à mes yeux, le dernier message de quelqu’un qui va mourir. Les requins pourraient tout aussi bien symboliser les « autres », tous ceux qui, par nécessité, par jalousie ou par plaisir font obstacle à la bonne volonté de quelqu’un et s’acharnent sur lui. Sa réussite littéraire, son talent ont à coup sûr suscité des rivalités et chacun d’entre nous, à sa suite, peut donner un visage à tous ceux qui souhaitent la disparition, la mise sur la touche de son semblable qui a réussi.
Cet ouvrage, écrit en 1951 et, comme à son habitude dans un style fluide et agréable à lire a été un immense succès qui relança sa carrière et lui valut le Prix Pulitzer en 1952 et, pour l’ensemble de son œuvre le Prix Nobel en 1954. Hemingway met beaucoup de lui-même dans cette dernière œuvre majeure publiée de son vivant, comme un ultime message qui lui ressemble. Il parle du base-ball, de Di Maggio en particulier, de sa passion pour la pêche au gros qu’il a longtemps pratiquée et dont il donne force détails techniques
Hemingway est un monument de la littérature américaine.
©Hervé Gautier http:// hervegautier.e-monsite.com
-
Paris est une fête - Ernest Hemingway
- Le 02/03/2020
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire

 N° 1436 - Mars 2020.
N° 1436 - Mars 2020.Paris est une fête – Ernest Hemingway. Gallimard
Traduit de l’américain par Marc Saporta.
Après la première Guerre mondiale pendant laquelle il servit comme ambulancier volontaire dans la Croix-Rouge italienne, Hemingway(1899-1961) fut engagé comme journaliste et arriva à Paris avec femme, enfant et chat en 1921, quelque peu désargenté. Ils y resteront cinq ans. Ce livre est, selon son auteur, un mélange d’imaginaire et de réel, un récit autobiographique qu’enchante la ville et son aura insouciante. On le voit déambulant dans les rues de la capitale, s’arrêtant dans les cafés pour y écrire à l’invitation de l’ambiance du lieu, de l’alcool ou du regard d’une belle inconnue, visitant les musées de peinture ou les librairies, flânant sur les bords de Seine en discutant avec les bouquinistes ou les pêcheurs, s’intéressant aux courses hippiques ou cyclistes. Il retrouve ici son travail de journaliste en ce sens que ce roman peut aussi être regardé comme un reportage, écrit dans un style fluide comme à son habitude. Il est attentif à tout ce que cette ville lui réserve, même si les vrais Parisiens en sont absents, aux événements les plus banals de la rue, la pratique du turf comme à une rencontre à la Closerie des Lilas ou dans les bars de Montparnasse. Il doute certes mais croit en lui, en son talent, abandonne le journalisme pourtant lucratif, veut sortir de l’anonymat par l’écriture mais ça s’avère difficile et la faim fait partie de son quotidien. Il constate, amer, que lui qui sera Prix Nobel de littérature ne parvient pas à s’imposer dans un milieu qui boude son talent, mais il ne perd pas espoir. Il fait la rencontre d’autres américains comme la riche collectionneuse Gertrud Stein qui tient salon, plus âgée que lui elle jouait à la mécène découvreuse de talents, l’écrivain Scott Fitzgerald pourtant bien différent de lui mais déjà célèbre, le poète Ezra Pound, l’Irlandais James Joyce, Picasso, Blaise Cendras… Il faut cependant souligner le fait que les contacts avec les écrivains français n’ont pas vraiment déterminants pour Hemingway à cause peut-être de la barrière de la langue. Il se tient au courant des potins littéraires parisiens, se laisse aller à son côté épicurien et on le sent amoureux de cette ville mythique où il faut être en ce début du XX° siècle surtout pour de jeunes écrivains américains qui peinent à être reconnus aux USA et aussi du style de vie à la française, et ce même si l’auteur fait partie, comme Pound, d’une « génération perdue » selon le mot de Gertrud Stein. Il y avait certes un taux de change plus intéressant pour les Américains mais Paris était en quelque sorte un milieu littéraire de référence et de légitimation, une éducation créatrice à laquelle l’exil pouvait sans doute un peu contribuer. La France, c’était un contexte de liberté qui contrastait avec la côté puritain d’Outre-Atlantique. Pour Hemingway, c’est aussi un moment fort de son histoire d’amour avec sa femme Hardley Richardson, dont pourtant il divorcera.
Certes aujourd’hui nous sommes loin du Paris des années 20, emblématique et même allégorique, loin aussi de la vie un peu bohème qu’y menait l’auteur alors jeune auteur talentueux. L’ambiance y était différente, on sortait d’une guerre qu’on voulait oublier parce qu’elle évoquait les souffrances et la mort. Cette ville représentait un espoir de reconnaissance pour lui, un lieu où il voulait vivre ce moment de sa vie, lui l’Américain alors inconnu qui sentait grandir cette envie d’écrire. Certes Paris reste encore aujourd’hui ce lieu d’une réussite potentielle où, plus qu’ailleurs sans doute, des rencontres d’exception peuvent décider de toute une vie, même si les fantasmes y ont une large place et que la désillusion peut aussi faire partie de la réalité. J’ai apprécié que ce roman moins connu d’Hemingway, composé au départ de notes éparses, écrit longtemps après son séjour parisien puis remanié et publié après sa mort, soit redécouvert et brandi par les Parisiens, et par les Français, au lendemain des attentats de novembre 2015 en réponse à l’obscurantisme meurtrier de Daech.
©Hervé Gautier http:// hervegautier.e-monsite.com
-
l'appel - Fanny Wallendorf
- Le 01/03/2020
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
 N° 1435 - Mars 2020.
N° 1435 - Mars 2020.L’appel – Fanny Wallendorf – Éditions Finitudes.
Ce livre est réellement un roman dans la mesure où le personnage principal, Richard, est un être fictif. L’auteur n’a retenu pour écrire son ouvrage que les événements sportifs et peut-être quelques détails de la vie de Dick Fosbury, athlète qui révolutionna le saut en hauteur en franchissant la barre … sur le dos quand la façon classique et reconnue était la technique du « ciseau » ou du rouleau ventral. Ce faisant il a ouvert une brèche, a créé une voie qu’il a portée jusqu’aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968, a inventé quelque chose de nouveau qui désormais porte son nom [le « Fosbury flop »]et que chacun désormais peut adopter.
Revenons au roman. Nous somme en Amérique, dans l’État de l’Oregon, en 1957 et Richard est un adolescent ordinaire pas vraiment doué pour les études, dégingandé, timide et qui fait le désespoir des coachs sportifs de l’établissement dont le but est de le voir améliorer son saut en hauteur qui stagne depuis des années. Selon eux, il n’est vraiment pas fait pour ce sport mais fait pourtant ce qu’il peut pour perfectionner sa technique du « ciseau ». A l’occasion d’une rencontre sportive et d’une idée venue par hasard en regardant une branche d’arbre, il passe la barre d’une manière peu académique, sur le dos, et améliore son propre record, ce qui lui vaut le surnom d’ « hurluberlu ». Dès lors le regard des autres change et son saut, même s’il ne déroge pas au règlement mais suscite des critiques extérieures, des moqueries et évidemment des jalousies. Beckie, son amie, s’éprend de lui et ensemble ils vivent le parfait amour et lui continue à améliorer ses performances. Tout aurait été pour le mieux dans le meilleur des mondes mais, comme d’habitude, tout finit par aller de travers, son entraîneur le quitte sans raison, Beckie se fait plus absente et disparaît, son meilleur ami s’éloigne et ses espoirs de bourses pour sa prochaine entrée à l’université deviennent de plus en plus hypothétiques... même s’il fait quand même la Une des journaux et multiplie les victoires. Comme toux ceux qui sortent du rang et veulent poursuivre leur rêve, il doit faire face à l’adversité et son parcours se révèle chaotique . Le doute s’installe en lui et ce d’autant que l’ombre de la guerre du Vietnam le rejoint et avec elle le risque de disparaître définitivement, de voir son combat personnel cesser sans qu’il y puisse rien.
L’appel, c’est l’impulsion du saut mais c’est aussi l’invitation à être soi-même, à se réaliser dans quelque chose de nouveau et qui nous ressemble, à être solliciter par la gloire aussi peut-être ?
Je me suis un peu ennuyé au cours de ce roman même si j’ai apprécié cette lutte de Richard pour un idéal, cette manière de s’approprier quelque chose d’original qui répondait à un défi apparemment impossible à atteindre, qui se bat contre une adversité aux multiples visages et qui finit peu à peu par le dépasser.
©Hervé Gautier http:// hervegautier.e-monsite.com
-
Reste avec moi - Ayòbámi Adébáyò
- Le 26/12/2019
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1417– Décembre 2019.
Reste avec moi - Ayòbámi Adébáyò - Éditions Charleston.
Traduit de l'anglais par Josette Chicheportiche.
Ce titre qui est la traduction française d'un prénom africain résonne comme une incantation, une prière et il faut attendre la fin pour savoir qui la prononcera. Ce roman est l'histoire de deux frères, l'un qui a réussi et l'autre non, mais aussi celle d'un amour malheureux entre deux époux avec tout le poids implacable du destin et la nécessité de l'acceptation de soi-même.
Nous sommes dans le Nigeria des années 1980, ses tensions et ses changements politiques, avec l'insécurité qui règne dans ce pays. Dans ce contexte, l'histoire d'amour entre Yejide et Akin leur rencontre l'université, leur mariage, les premiers temps de leur union paraissent être une sorte de havre de paix. Pas si sûr cependant. Ces deux jeunes gens ont reçu une éducation moderne européenne, sont catholiques, ont chacun une activité professionnelle, mais ils sont d'origine africaine et ne peuvent ignorer le poids des traditions, des coutumes, des croyances fétichistes de ce pays. Il y a dans ce couple une opposition constante entre ces deux cultures. Pour Yejide, il y a certes l'envie de ces enfants qui viendront couronner leur amour mais surtout l'obligation qu'elle a de donner des héritiers à son mari et à sa famille puisque la tradition veut que celui qui en a possède le monde. Elle doit donc être enceinte et pour cela ne recule devant aucune consultation de médecins spécialistes, aucun traitement, jusqu'à la sorcellerie et ses étranges potions. Pourtant quatre ans après son mariage, malgré une longue et douloureuse attente de maternité, elle n'est toujours pas gravide et la solution que trouve Akin, sans toutefois en parler à son épouse, est des plus étonnantes, alors même qu'au départ on a l'impression que tout se passe en dehors de lui. Cela résonne autant comme une preuve d'amour pour son épouse que comme une soumission aux traditions familiales africaines.
Il y a plusieurs manières de lire ce roman. Il est fait de beaucoup d'analepses et d'un discours croisé entre Yejide et d'Akin liés au départ par un authentique amour. Lui, c'est un jeune homme bien sous tout rapport qui ferait tout pour son épouse et sa famille, mais la démarche qu'elle accepte spontanément de la part de son beau-frère, Akin, un joueur alcoolique sans envergure qui trompe sa femme et se soucie peu de sa famille, c'est à dire l'exact contraire de son propre frère, est révélatrice. C'est pourtant avec lui qu'elle choisit de tromper son mari et de trouver du plaisir dans cette relation adultère renouvelée. Elle en conçoit certes de la culpabilité judéo-chrétienne, surtout lorsqu'elle tombe enceinte de cet amant, et ces deux premiers enfants, atteints d'une maladie génétique qui entraînera leur mort est ressenti comme une punition divine notamment à travers l'histoire locale de "l'arbre iroko". Face a une telle situation, elle en appelle à Dieu, pas celui de le jungle mais celui de son baptême mais le destin est implacable pour elle qui déroule sa malédiction comme une sanction. Face à cela, le problème de la rédemption est posé ainsi que celui du pardon.
Au fur et à mesure de cette liaison un peu surréaliste, les relations entre les protagonistes évoluent faites de violence, de non-dits, d'hypocrisie, de mensonges, de remords, de honte, de mépris. Cela nous rappelle que nous ne sommes que les modestes usufruitiers de notre propre vie, que les choses humaines sont fragiles, que l'amour est une chose consomptible et ne dure pas toujours. Ce roman, qu'on peut parfaitement lire comme un témoignage davantage que comme une fiction, est réaliste en ce qu'il évoque l'obligation horrible faite aux parents d'aller aux obsèques de leurs enfants mais aussi en ce qu'il brise aussi la trop facile image d’Épinal de l'homme qui abandonne sa famille et son épouse et en tout ce qu'on ressent comme injustice et solitude au moment de cette séparation. Dans le cas de Yejide on peut aisément opposer sa recherche égoïste du plaisir à la bienveillance de son mari. Il l'est cependant un peu moins à la fin qui ressemble à un "happy end" un peu trop convenu. Ce roman a aussi une dimension documentaire puisque non seulement il explore les langues et mythologies vernaculaires, mais également les coutumes et autres rituels ainsi qu'en attestent les nombreuses notes de bas de page.
Je ne suis vraiment entré dans ce roman que très tardivement, vers la moitié, mais à partir de ce moment, il a constitué pour moi un texte captivant et bien écrit.
©Hervé Gautier http:// hervegautier.e-monsite.com.
-
Une saison de nuits - Joan Didion
- Le 21/08/2019
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1373 – Août 2019.
Une saison de nuits – Joan Didion - Grasset.
Traduit de l'anglais par Philippe Garnier.
C'est le premier roman paru en 1963 de cette auteure américaine née en 1934.
Nous sommes dans les années 1960, une banale histoire sentimentale, un trio presque ordinaire doublé, il est vrai d'un meurtre, ce qui l'est moins. Everett Mac Clellan, le mari, tue l'amant de sa femme Lilly
L'auteure remonte le temps pour nous présenter l'histoire de chacun de ces deux époux avant leur rencontre. Pour Lilly, c'était la Californie avec ses parents qui vivaient d'une grande exploitation agricole dans l'esprit des pionniers américains, la douceur de vivre mais aussi pour elle, l'ennui. Pour Everett, c'est la culture du houblon qui monopolise son attention. C'est un peu de l'histoire de l'Amérique qui est évoquée ici, avec les fantasmes qu'elle suscite, la fièvre de la "ruée vers l'or," l'illusion de l' "el dorado", mais la réalité a changé, des mutations s'opèrent dans la société et face à cela ce couple tente d' exister maladroitement dans ce "rêve américain".
Entre 1938 et 1959 deux enfants naissent, Julie et Knight mais ce n'est pas cela qui ressoude les deux époux dont les relations sont empreintes de non-dits et d'incompréhensions, si bien qu'Everett part pour la guerre qui fait rage en Europe. C'est une sorte de fuite avec au bout peut-être la mort, une manière d'échapper à cette cohabitation devenue un peu trop lourde malgré les apparences. En son absence Lilly le trompe, avorte, s'enfonce doucement dans la dépression et la solitude qu'elle partage d'ailleurs avec sa belle-sœur Martha et ce malgré la présence de Ryder Channing qui rôde autour des deux femmes. Cet homme deviendra l'amant de Lilly et Everett, de retour de la guerre, malgré son couple à la dérive, refuse le divorce et trouvera une autre solution plus radicale. C'est effectivement un coup de feu qui débute ce roman, suivi d'un long analepse, puis un autre qui le conclut, comme la seule solution à cette union manquée que l'adultère de Lilly n'a fait que compliquer. Malgré les années passées Lilly entend toujours ces deux coups de feu qui obsèdent sa mémoire et qui sonnent le glas de tout ce qu'elle a perdu par sa faute, même si cet échec était inscrit en creux dans sa vie bien avant eux La douceur de la Californie n'y fait rien pas plus d'ailleurs que la vaine recherche de la jouissance avec des amants de passage.
Il y a certes le contexte américain qui donne à ce roman un décor tout à la fois grandiose et utopique mais je retiens surtout l'histoire de ce couple qui ressemble à un château de cartes édifié dans un courant d'air, de cet homme attaché à sa famille mais à qui tout échappe sans qu'il y puisse rien et de cette femme qui ne l'aime pas et qui finalement se croit autorisée à tout détruire autour d'elle. Ils se sont unis en faisant semblant de croire qu'ils étaient faits l'un pour l'autre et que c'est un hasard bienveillant qui les a fait se rencontrer parce qu'il ne pouvait pas en être autrement. Comme dans bien des ménages la réalité s'impose qui est bien différente, avec l'usure du temps et l'espoir que chacun peut inverser le cours des choses, un gâchis presque ordinaire dans un rêve social devenu cauchemar, la dramatique histoire d'un homme et d'une femme qui n'auraient sans doute jamais dû se rencontrer, se marier et fonder une famille. Si Everett aimait sa femme, cet amour n'était pas partagé et Lilly n'avait aucun état d'âme à rechercher ailleurs ce qu'elle avait chez elle et ruiner ainsi les espoirs d'un homme qui ne méritait pas cette trahison.
Je ne suis rentré que très tardivement dans ce roman et malgré cette histoire bien écrite et malheureusement bien proche de la réalité quotidienne, à l'exception peut-être des deux coups de feu, je garde de cette lecture une impression mitigée.
©Hervé Gautier.http:// hervegautier.e-monsite.com
-
The hours - Michael Cunningham
- Le 17/07/2019
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1366 – Juillet 2019.
The hours – Michael Cunningham -Harrap’s
Ce roman a fait l’objet d’une adaptation cinématographique en 2002 (scénario de David Hare) à la distribution prestigieuse (Nicole Kidman, Julianne Moore, Meryl Streep) et couronnée par de nombreux prix.
Trois femmes, trois époques, trois destins avec comme fil d’Ariane le roman de Virginia Woolf « Mrs Dalloway » dont le thème et des scènes reviennent dans le roman de Cunnigham et également dans le film. Le roman et le film donnent à voir une journée de ces trois femmes et non une véritable histoire, une sorte de déambulation dans le quotidien de chacune d’entre elles, dans leurs souvenirs et dans l’intimité de leur psychologie. Virginia Woolf elle-même, illustre romancière du début de XX° siècle, entamant son roman « Mrs Dalloway » qui sera un succès littéraire, lutte contre la folie et succombe au suicide laissant une lettre à son mari le remerciant du bonheur qu’il lui a donné. Laura Brown est une mère américaine au foyer dans les années 50, enceinte de son second enfant et qui, ayant lu le roman de Virginia Woolf, souffre elle-aussi de mal-être face à un mari débordant de bonheur. Seul son jeune fils Richard comprend sa détresse mais cette femme, tentée sans doute par la mort, quitte sa famille dans l’espoir d’une autre vie. Clarissa Vaughan, éditrice new-yorkaise du début du XXI° siècle, malgré sa vie en couple lesbien, s’occupe depuis des années de Richard, son ancien amant qui vient d’avoir un prix littéraire prestigieux mais qui est malade du sida. Il est le fils que Laura a abandonné quelques années auparavant, mais il choisit de se suicider avant la réception que Clarissa a organisé pour son prix. Des trois femmes, c’est elle qui incarne le mieux Mrs Dalloway, l’héroïne de Virginia Woolf.
L’histoire terminée, il reste une ambiance délétère avec des interrogations sur la vie à travers le symbole des fleurs, sur la mort, sur la solitude, sur le bonheur dont les hommes ont une bonne fois décrété qu’il existait et donc qu’ils y avaient droit au cours de leur existence, sans se soucier si cela était possible. Elle est ainsi cette vie et on doit l’aimer telle qu’elle est, mais je ne suis pas sûr de partager cette affirmation. Richard, abandonné par sa mère, quitté par Clarissa puis par son ami gay, deviendra écrivain, c’est à dire créera dans son roman et sans doute dans l’ensemble de son œuvre, une ambiance harmonieuse qu’il n’a jamais connue et qui se manifeste sans doute par ces voix qu’il entend, qui le rassurent ou lui font peur, à moins que ces expériences malheureuses ne nourrissent sa créativité. Nous savons tous que la fiction est là notamment pour gommer les imperfections de notre pauvre monde ou pour nous les faire accepter. A ses yeux rien ne peut remplacer l’enfance que cette femme lui a volé, pas davantage la vie en couple dont il n’a eu qu’un mauvais exemple et surtout pas le succès qui a peut-être un peu tardé dans son cas. Laura qui s’ennuie dans un quotidien ménager s’imagine que son bonheur est dans la fuite mais confessera à la fin à Clarissa qu’elle rencontre, qu’elle ne l’a pas trouvé. Elle avait rêvé d’une autre destin et en avait assez de se sacrifier pour une famille qu’elle ne désirait peut-être pas, que les circonstances ou les convenances sociales lui ont imposées et qui n’était pour elle qu’un mensonge. Mais elle s’est crue autorisée égoïstement à briser cette réalité sans se soucier des autres membres de sa famille! Clarissa s’est sacrifiée pour Richard, par amour ou parce qu’elle a cru en son talent, mais il ne veut pas de son sacrifice. Virginia s’ennuie ferme loin de Londres et sa consécration littéraire ne lui suffit pas et, n’ayant pas réussi, malgré l’amour que lui porte son mari à s’accepter elle-même et à s’épanouir, choisit sa mort. Seule Laura a préféré la vie sans se soucier de ceux qu’elle a abandonnés mais on imagine ce qu’à été son existence, coupée de sa famille et maintenant chargée de cette culpabilité qui ne la quittera plus. Car c’est bien la mort qui plane sur ce drame. Elle est omniprésente dans l’enterrement d’un oiseau comme dans la défenestration de Richard ou la conclusion choisie par Virginia, dans l’hospitalisation de la voisine de Laura qu’on imagine atteinte d’un cancer. Elle est simplement la fin de notre parcours individuel, une délivrance peut-être et imaginer autre chose après est un mirage.
Cette fiction, au-delà de l’impression un peu malsaine qui s’en dégage, me paraît être une image bien réelle de cette vie qui est imposée à chacun, à charge pour lui d’en faire quelque chose d’honorable pour la collectivité dont il fait partie, en se débrouillant avec le hasard, avec son destin s’il existe, la malchance qui peut le frapper, le poids de son atavisme, les avanies que les autres, et particulièrement ses proches peuvent lui imposer, tout en faisant semblant, avec une bonne dose d’hypocrisie toujours renouvelée, de croire que la liberté individuelle existe réellement et autorise tout, que notre vie nous appartient, que le bonheur est possible, que la solitude est un poids que la vie en couple et l’amour qui devrait aller avec, ne guérissent pas, que la vie est belle…
©Hervé Gautier.http:// hervegautier.e-monsite.com
-
L'envol du moineau - Amy Belding Brown
- Le 16/03/2019
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1334 – Mai 2019
L'envol du moineau – Amy Belding Brown – Cherche midi éditeur.
Traduit de l'anglais par Cindy Colin Kapen.
Tout d'abord je remercie Babelio et les éditions du Cherche midi de m'avoir fait parvenir ce roman.
Ce livre est la véritable histoire, certes romancée, de Mary Rowlandson, cette anglaise, mère de trois enfants élevés selon les préceptes de la Bible, épouse pieuse et loyale qui a vécu sur la côte est de ce qui n'était pas encore les États-Unis, en 1672. Cette contrée est en guerre contre les indiens qui défendent leur territoire, c'est donc dans une atmosphère de conflit sanglant que ce déroule cette fiction. Avec l'hiver, les indiens massacrent cette communauté et Mary est capturée, a la vie sauve, mais est néanmoins transformée en esclave, tout comme le sont les noirs qui servent sa communauté, ce qui pour elle inverse brutalement les rôles. Elle ne peut y voir que la volonté de Dieu en qui elle met son espoir de libération, avec la prière et la soumission à sa volonté. Pourtant elle est secourue par une famille indienne dont elle est la servante et qui se révèle alternativement bienveillante et brutale avec elle, et elle doit supporter l'humeur changeante de sa maîtresse. Elle marche avec ses ravisseurs à travers une nature hostile et glacée, travaille comme une bête de somme ou reste parfois oisive, mais jamais sans surveillance, comme une prisonnière qu'elle est. Souvent elle craint la mort, redoute le viol mais Mary, même esclave, sera respectée dans son intégrité physique et maintenue en vie alors que d'autres anglais sont massacrés. Pourtant elle adopte facilement le mode de vie de ces « sauvages » même si, au regard de sa foi, c'est un péché. L'instinct de survie de cette femme est exceptionnel, tout comme sa volonté de recouvrer sa liberté originelle, de retrouver ses enfants et son mari, avec il est vrai , une bonne dose de chance. Elle doit en effet sa survivance au fait qu'elle est l'épouse du pasteur, qu'elle a les cheveux roux, ce qui plaît bien aux Indiens, qu'elle est probablement belle et surtout qu'elle sait coudre des vêtements et tricoter des bas. Son attachement à la vie est humain comme l'est aussi le chagrin dû à la perte de sa fille, le sentiment d'abandon et d'injustice qu'elle ressent mais elle garde foi en Dieu. Elle fait preuve d'un grand sens de l'adaptation, apprend même leur langue, correspond avec eux, certains d'entre eux parlant anglais, est attentive à leurs rituels, à leur culture au point de devenir une vraie indienne, même si elle ne sera jamais vraiment acceptée au sein de cette tribu. Elle prend conscience que sa vie parmi les Indiens est plus libre et égalitaire que celle qu'elle menait dans sa communauté anglaise d'origine et, bien qu'attachée aux indiens, la réintégrera, mais à contrecœur.
A la lumière d'une transaction un peu sordide mais finalement maîtrisée par Mary, elle s'aperçoit qu'elle n'aime pas son mari mais qu'elle lui est soumise par principe comme sa condition de femme l'exige et pour cela elle accepte de renoncer à l'amour qu'elle éprouve pour un indien. Auparavant, elle avait vécu, comme les autres femmes de la communauté sous la dépendance des hommes sans avoir voix au chapitre et les préceptes de la religion gouvernaient cette société où elle n'avait qu'un rôle mineur essentiellement consacré à la famille et au foyer. Elle s’aperçoit en effet que le christianisme est une entrave et que ses dogmes, ses rituels, ses interdits, ses mensonges élevés au rang de révélations divines génèrent une rigidité puritaine et une morale étouffante. Elle a toujours vécu sous l'autorité de son mari comme le commande le protestantisme qui est omniprésent dans la vie quotidienne de cette communauté venue d'Angleterre. L’intolérance, l'esprit culpabilité par rapport au sempiternel péché des hommes sont tels que tous les événements néfastes qui interviennent sont considérés comme des châtiments divins que la prière et le soumission à Dieu sont seules capables d'exorciser. Mary se rend compte petit à petit que le puritanisme dans lequel elle vit et qui lui est imposé est incompatible avec la vraie vie, même si elle ne peut renier ni sa foi ni sa religion.
Tout ce roman baigne dans une sorte de mysticisme où toutes les choses de la vie de cette communauté anglaise est inspirée par la volonté de Dieu et par sa parole. Pourtant quand Mary souhaite arriver à ses fins, elle n'hésite pas à s'approprier cette croyance. Hypocrisie ou conviction ? Elle ne fait en cela qu'adopter l'attitude des autorités de la communautés qui enveloppent leurs décisions dans la volonté divine. Son mari, Joseph, fait de même quant il prétend s'occuper des affaires du Seigneur et pour cela déserte sa famille toutes les nuits ! Face à cela l'auteure ne magnifie pas pour autant la société indienne et on est loin du mythe du « bon sauvage » cher aux philosophes des Lumières mais on ne peut pas ne pas ressentir un sentiment d'injustice faite non seulement aux Indiens par les Anglais mais aussi aux femmes par cette société par trop austère. Elle s'aperçoit très vite également que sa captivité chez les indiens fait d'elle un personnage controversé, mais surtout qui suscite la jalousie de son mari qui voit ainsi son autorité diminuer, l'envie de savoir et surtout les ragots et les médisances des autres membres de sa communauté.
L'allégorie commence avec un moineau que les enfants de Mary ont maintenu longtemps en cage et qu'ils libèrent face à la violence indienne. C'est à travers le chant et l'image de cet oiseau qu'elle se remémore sa vie passée et apprécie la fuite du temps. Elle est associée par l'auteur à l'image de la liberté que Mary n'a jamais connue ailleurs que chez les indiens. Quand ils sont vaincus et qu'elle a obtenu en secret la grâce de celui qu'elle aime au prix d'un travail d'écriture dont s'est inspirée Amy Belding Brown pour son roman, il lui est signifié qu'elle doit reprendre son rôle traditionnel d'épouse dévouée et même si sa vie se transforme par un second mariage à la suite de la mort brutale de Joseph.
Au-delà de l'histoire passionnante et fort bien écrite, j'ai choisi de lire une sorte de roman philosophique où la vie sauvage est évoquée à travers la violence mais aussi à travers la nature, j'y ai lu une critique de l'espèce humaine capable du meilleur mais surtout du pire, une diatribe contre cette société engluée dans une religion qui complique inutilement les choses de cette vie qui l'est déjà bien assez.
©H.L.
-
Mon désir le plus ardent - Pete Fromm
- Le 21/12/2018
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1304
Mon désir le plus ardent – Pete Fromm – Gallmeister.
Traduit de l'américain par Juliane Nivelt.
C'est l'histoire d'amour de Maddy et de Dalton, deux adolescents américains, qui commence dans les rapides du Wyoming. Ils sont persuadés d'êtres faits l'un pour l'autre et que leur rencontre tient du miracle d'autant plus que Maddy s'était promis de ne jamais choisir un garçon de son âge, encore moins un guide de rivière comme elle. Pourtant il en a été tout autrement et elle a même abandonné Troy pour lui préférer Dalton. La nature et la liberté les accompagnent, tissent autour d'eux un bonheur unique dont ils entendent bien profiter. Ils forment un couple fusionnel, ont la vie devant eux, ils sont jeunes, beaux, se font mutuellement des serments de fidélité, font des projets, vont se marier, avoir des enfants et fonder une entreprise de rafting dans l'Oregon puis une activité de pêche. Il y a cette symbolique de l'eau vive et pure où ce couple évolue au début. Elle se réfère à leur amour et l'image est parlante. Comme rien n'est jamais parfait en ce monde, c'est la sclérose en plaques qui se déclare chez Maddy et va durablement bouleverser sa vie et celle du couple. C'est d'autant plus terrible que cette maladie se manifeste au moment où elle se croit enceinte, attribuant ses vertiges à son état de future mère, une manière d'opposer la douleur et la maladie à la vie à venir. Cela commence par le tremblement d'une main, puis se prolonge par une fatigue générale qui lui enlève la possibilité de tenir normalement sa maison, puis viennent les pertes de sensations tactiles de plus en plus fréquentes, une détérioration durable de son corps, la marche avec une canne, l'usage du fauteuil roulant manuel puis électrique, l'invalidité qui s'installe de plus en plus...
Ce que je veux retenir ici, c'est le destin de ces deux personnages pour qui tout paraissait idyllique et qui, tout d'un coup, sont frappés par le malheur sous la forme d'une maladie que la médecine peine à soulager et surtout à guérir. D'ordinaire c'est plutôt la lassitudes, l'usure des choses, les rencontres extérieures, la certitude qu'ailleurs c'est mieux que chez soi... qui mettent fin à l'amour et à un des piliers de notre société qu'est le mariage. Ici l'auteur choisit de réveiller le bagage génétique que nous portons tous en nous et qui peut se révéler destructeur. La maladie peut détruire un couple mais dans leur cas elle le soude, le renforce parce que ensemble ils ont résolu de faire triompher la vie, d'avoir des enfants malgré le risques de transmission héréditaire. Dalton abandonne le rafting et la pêche pour devenir charpentier et ainsi être aux côtés de son épouse, aménage pour elle leur maison, s'occupe des enfants, Pourtant c'est la naissance de leur premier enfant qui révèle le mal que Maddy porte en elle, un peu comme si cette naissance faisait triompher la vie sur la douleur et la mort qu'elle sous-tend.
Le lecteur suit passionnément cette histoire vécue et racontée par Maddy. Il y a une dualité dans ces deux personnages. Elle est forte et fera face courageusement à cette épreuve, choisit même d'en rire, fait ce qu'elle peut pour éviter les maternités mais, par amour pour Dalt qui veut avoir des enfants, elle cède et Atty et Azzy naîtront. Lui est amoureux fou de sa femme, prêt à tout pour elle, même à abandonner sa passion de la rivière pour se consacrer à elle, la soigne comme il peut, se consacre à sa famille. L'auteur nous montre un couple plus fort que l'adversité, qui résiste à la tentation de la séparation. Quand Maddy parle à son mari de divorce parce que sa vie à lui n'est pas terminée et qu'il peut encore être heureux avec une autre femme en bonne santé, celui-ci lui rétorque que même s'il a pensé un instant à la mort, la sienne, il ne conçoit pas la séparation avec elle, mais finit par détester l'homme qu'il est devenu. La séparation de leurs parents qui bien souvent, pour les enfants, fait de la famille la pire chose de leur vie est ici balayée d'un revers de mains, un peu comme si la maladie de Maddy était, pour eux, une raison supplémentaire de resserrer les liens familiaux, un peu comme si la fuite du temps n'avait aucune prise sur eux, comme s'ils avaient décidé une bonne fois pour toute que pour eux la vie a été belle, qu'ils ont été chanceux de se rencontrer et de vivre ensemble et ce malgré le temps qui passe, les enfants qui quittent la maison et la mort qui viendra inévitablement.
Le récit de Fromm se joue du temps et de la chronologie, chaque chapitre pouvant pratiquement être lu presque séparément du roman, faisant fi de maladie qui n'est plus dès lors mentionnée que sous le sigle SP, comme une sorte de déni.
J'avoue que je ne sais quoi penser à une époque où le mariage se termine de plus en plus souvent par le divorce et ce pour des raisons bien plus futiles, ce qui fait largement douter de la solidité des liens qu'on dit devoir exister toute une vie. Nous sommes certes dans une fiction et surtout dans une histoire intime et je suis partagé entre cet univers qui le temps d'un roman, transporte le lecteur dans une autre dimension, et la réalité. J'avoue n'avoir vraiment ressenti de l'émotion qu'à la fin.
Je ne connaissais pas Pete Fromm avant que le hasard ne me fasse croiser son œuvre. Son style direct, abrupt même et sans véritable recherche évoque la maladie dans sa cruauté, dans les difficultés qu'elle sous-tend pour cette famille. Je me suis un peu forcé pour croire à cette histoire d'amour qui défit et triomphe de la maladie et du le temps qui passe.
©Hervé GAUTIER – Décembre 2018.http://hervegautier.e-monsite.com
-
Un petit boulot - Iain Levison
- Le 06/11/2018
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1289
Un petit boulot – Iain Levinson – Liana Levi.
Traduit de l’américain par Franchita Gonzalez Battle.
Nous sommes dans l'Amérique profonde, une petite ville qui vient de perdre son unique usine qui donnait du travail à la plupart des habitants. Pour compléter le décor, c'est l'hiver et le froid est rude. Jack est de ces chômeurs qui, bien entendu, a tout perdu en plus de son travail, même sa petite amie. Il ne survit que grâce à son allocation chômage et la bière dont il fait une consommation exagérée, mais bien des dettes restent impayées. Pour y faire face et ne pas perdre l'estime de lui-même, il est prêt à accepter n'importe quel boulot et Ken, un dealer et un bookmaker à qui il doit de l'argent lui propose de tuer son épouse qui le trompe. Lui qui jusqu'à présent était quelqu'un de bien, accepte et devient donc tueur à gages ! Non seulement d'autres contrats s'ajoutent au premier mais sa nouvelle fonction l'aide à régler ses comptes personnels. Il tue d'ailleurs avec une étonnante facilité pour quelqu'un qui n'a pas à priori l'usage ordinaire des armes, apprend vite les ficelles et devient même inquiétant pour son patron qui a suscité cette nouvelle activité. Il n'est quand même pas aussi buté qu'un porte-flingue ordinaire puisqu'il se fait engager dans une station-service pour un salaire de misère de manière à avoir ainsi une couverture. On a beau être aux États-Unis, tous ces morts dans une petite ville dépeuplée, ça commence à faire beaucoup et la police va s'intéresser à lui et à ses relations avec Ken. La situation d'homme de main suppose la solitude et l'absence de femmes commence à lui peser et c'est précisément au commissariat où il est convoqué qu'il va en croiser une. C'est une sorte de paradoxe pour lui, mais elle lui fait vraiment beaucoup d'effet ! Et puis si les flics ont de graves soupçons à son sujet, ils n'ont aucune preuve contre lui. L'air de rien, Levinson transforme ce roman en véritable triller, entretenant jusqu'au bout le suspense à propos de Jack devenu bizarrement sympathique et de ses aventures un peu rocambolesques.
Son nouveau métier qui pourtant lui rapporte de l'argent commence-t-il, à la longue à secouer son sens de la moralité, il rêve de racheter la station-service qui l'emploie et fait des projets d'association parfaitement légale avec un autre salarié de l'entreprise. La chance lui sourira quand même dans une fin assez inattendue pour un assassin !
L'auteur nous brosse un portrait bien peu flatteur de ce pays, de son mode de vie qu'on associe au « rêve américain » ce qui reste encore pour le vieux continent un parangon. Il le fait sur un mode mi- humoristique mi-sérieux et dénonce les travers d'un système économique où l'être humain ne compte guère, qu'il soit un simple salarié qu'un petit chef pointilleux a décidé de licencier, parfois pour une broutille, ou qu'il soit l'objet d'un contrat mafieux. La déshumanisation est la constante de ce contexte.
J'ai découvert avec plaisir l’œuvre de Iain Levison un peu par hasard à la lecture de « Tribulations d'un précaire » (La Feuille Volante n° 1287) et je me suis demandé si, au nom de notre appétit de modèles, surtout quand ils sont mauvais, nous ne serions pas nous aussi en train de copier nos amis Américains dans ce qu'ils ont de plus déshumanisé. Certes tous les licenciés ne deviennent pas tueurs à la solde d'un caïd, mais la nécessaire reconversion, y compris en traversant simplement la rue, peut amener à des situations surréalistes. Jack devient vraiment compétent dans son nouveau métier et la police est soit malchanceuse soit vraiment pas très curieuse. Les circonstances de ces différents meurtres semblent être à ce point détachées de la réalité que s'en est un peu suspect. Je ne suis pas fan des épilogues tragiques, mais celui-ci, je le trouve vraiment idyllique.
Ce roman a été adapté à l'écran en 2016 avec Romain Duris et Michel Blanc.
© Hervé Gautier – Octobre 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Tribulations d'un précaire - Iain Levison
- Le 02/11/2018
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1287
Tribulations d'un précaire - Iain Levinson – Liana Levi.
Traduit de l'américain par Franchita Gonzales BatlLe .
La recherche d'un travail a toujours été vital pour l'homme, c'est même un droit humain fondamental parce qu'avec un emploi stable on peut envisager de construire quelque chose, une vie, une famille.. mais actuellement cela ne court pas les rues. Pourtant, à. en croire certains, il suffirait de traverser tout simplement la rue pour en trouver un ! Pourtant, si on considère le nombre de chômeurs qui ne cesse d'augmenter, on pourrait légitimement croire que ce n'est pas aussi facile, ou alors nous manquons de rues ! Et puis à traverser la rues comme cela, constamment, on devient un « travailleur itinérant », tout comme le narrateur et ce n'est pas sa licence de Lettres, obtenue après une dépense de 40.000 dollars, qui peut lui procurer un emploi pérenne. Comme nous sommes à l'échelle des États-Unis, c'est carrément tout le pays qu'il traverse ! Alors , faute de mieux, il devient ce travailleur précaire à la recherche de petits boulots, en attendant mieux, même si ce « mieux » n'arrive jamais. Donc pas question pour lui de faire des projets, d’avoir une famille et une vie normale … Il reste célibataire et sa copine va voir ailleurs. Il devient, au hasard des petites annonces et surtout de la chance, vendeur dans une poissonnerie, marin-pêcheur en Alaska, électricien… Tous ces emplois furtifs lui donnent à voir le côté hypocrite de la société, les non-dits, la hiérarchie tatillonne et les règles non-écrites qui ont cours dans l'entreprise ainsi que des pratiques contestables de la part des collègues qui pourtant sont comme lui. Heureusement il est bricoleur, débrouillard et sait se rendre indispensable.. Pourtant, il vit dans le pays le plus riche du monde, celui du « rêve américain », qui pour le monde entier est une référence.
Parfois on le sent à l'aise dans ce contexte qui lui permet de changer d'employeur quand il le souhaite, au gré de ses envies ou de ses intérêts, Il ne manque pas de se poser des questions sur cette société américaine, se demandant si devenir mendiant ; c'est à dire marginal, ne serait pas la solution,tant la motivation, ce mot magique qui permet de vaincre toutes les difficultés et d'atteindre les sacro-saints objectifs fixés par d'autres, lui manque de plus en plus. En outre il finit par comprendre que les possibilités de carrière et les « postes à responsabilités » qu'on lui fait miroiter pour le décider, ne sont que des leurres. Dans ce contexte il en est réduit a effectuer des travaux les plus dangereux, les plus sales, donc les plus dévalorisants et évidemment les plus mal payés, ce qui n'encourage pas. De plus, sa position dans l'entreprise fait qu'il n'est pas en situation de se défendre quand il est victime d'injustices de la part de ses collègues ou de son employeur qu'il ne peut combattre efficacement. Quand il revient dans le monde quotidien, c'est à dire pour lui hors de l'exercice d'un de ces jobs, Internet, malgré les facilités qu'il offre, ne le convainc pas. Sa posture de travailleurs itinérant lui permet de poser sur le monde du travail un regard critique qui certes s'applique prioritairement au contexte des États-Unis et donne lieu à des poncifs bien sentis, mais a une portée universelle tant ce pays a toujours été pour nous une sorte de modèle. Ses remarques sont frappées au coin du sens commun et on le sent vraiment désabusé.
J'ai abordé l’œuvre de Iain Levison un peu par hasard notamment à la lecture de son roman « Pour services rendus » (La Feuille Volante n° 1279)où il dénonce le pouvoir politique et ses connotations coupables avec l'argent. Il me paraît être, cette fois encore et dans un autre registre, un observateur pertinent de la société américaine et ses remarques peuvent parfaitement être transposables dans la nôtre.
© Hervé Gautier – Octobre 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Noblesse oblige - Donna Leon
- Le 29/09/2018
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°660– Juillet 2013.
NOBLESSE OBLIGE – Donna Leon - Calman-Lévy.
Traduit de l'anglais par William Olivier Desmond
Tout près de Venise, on vient de découvrir le squelette d'un jeune homme qu'on identifie seulement grâce à la chevalière qu'il porte. Elle arbore les armoiries des Lorenzoni, une grande famille de Venise qui a appartenu à l'histoire. Pourtant, pendant la deuxième guerre mondiale, l'un de ses membres, le comte Picho Lorenzoni a livré aux SS le nom de tous les juifs de Venise dont beaucoup sont morts assassinés. Le corps qu'on vient de retrouver, apparemment exécuté d'un balle dans la tête, serait celui de Roberto Lorenzoni, un jeune homme d'une vingtaine d'années, kidnappé deux ans auparavant sous la yeux de sa fiancée dans les environs de Trévise. Deux demandes de rançon furent formulées mais rien ne fut payé pour cet unique enfant du couple mais après un temps, on n'eut plus de ses nouvelles. Devant l'éventualité d'une erreur sur la personne ou d'un canular, Brunetti qui n'avait pas à l'époque été chargé de cette enquête, se documente avec précisions sur les circonstances de cette affaire. Il interroge, évidemment, la signorina Elettra, la toujours aussi efficace secrétaire de la questure mais, s'agissant d'une famille noble vénitienne, le commissaire se souvient opportunément que sa belle famille qui est également aristocrate pourrait bien lui fournir de précieux renseignements sur les Lorenzoni. Le comte Falier, son beau-père accepte de lui dire ce qu'il sait. Les Lorenzoni étaient dans les affaires mais Roberto distrait, distant, superficiel, semblait moins doué pour cela que son père, tout comme il semblait peu versé dans les disciplines intellectuelles. Il n'était employé par le conte que dans le domaine de la représentation, des voyages. En revanche son cousin Maurizio, de deux ans son aîné et qui vivait dans sa famille, avait davantage de dispositions pour le commerce. Il aurait très bien pu avoir un rôle dans cet enlèvement. En effet, se positionnant comme véritable héritier, il avait un intérêt à la disparition de son cousin.
Dans le courant de ses investigations, le commissaire prend contact avec la petite-amie de Roberto qui a assisté à l'enlèvement ; elle est maintenant mariée et mère de l'enfant d'un autre homme, il s'assure de la véritable identité du cadavre et reprend en quelque sorte l'enquête initiale puisque, d'un simple enlèvement, il s’agit maintenant d'un assassinat. En fait Roberto était assez mystérieux mais Maurizio est lui-même un personnage assez énigmatique. Puis les événements se précipitent remettant en cause et les belles certitudes de Brunetti. Toute cette histoire devient logique, met en évidence un trafic international, la cupidité des hommes, le non respect des membres de cette famille, l’inconscience de tous...
J'ai moins aimé ce roman, à cause sans doute de ses longueurs mais il reste quand même un bon moment de lecture.
-
Pour services rendus - Iain Levison
- Le 29/09/2018
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1279
Pour services rendus - Iain Levison – Liliana Levi.
Traduit de l'américain par Franchita Gonzalez Batle.
Fremantle , chef de la police du Michigan, devait se dire que c'était un poste de fin de carrière et que la retraite était pour bientôt. Il ne s'attendait sûrement pas à voir débarquer deux avocats désireux d'obtenir son témoignage et encore moins l'objet de celui-ci. Ce qu'on lui demande d'évoquer remonte à quarante-sept ans, mais pourtant, il n'a rien oublié ! Ancien sergent dans un régiment de l'armée américaine au Vietnam, il avait eu sous ses ordres une nouvelle recrue inexpérimentée, Drake, qui est maintenant candidat à sa réélection au poste de sénateur dans l'état du Nouveau Mexique. Durant sa campagne, Drake a cru bon, pour s'attirer les voix des vétérans, de vanter sa conduite militaire au Vietnam et de s’approprier des faits d'armes dont il n'était pas l'auteur. L'ennui pour lui fut que ces faits ont été contestés et les avocats engagés par Drake sont chargés de convaincre Fremantle de confirmer, en qualité d'ancien sous-officier de cette section, les paroles du candidat sénateur, au cours une interview télévisée. Il devra simplement confirmer les propos de Drake, c'est à dire pas vraiment mentir par affirmation mais seulement omettre de dire toute la vérité sur la façon de servir du candidat pendant cette période. En retour, après la réélection, il obtiendra des crédits pour financer son commissariat dont la gestion financière est des plus problématique. Il pourra donc léguer à son futur successeur une situation saine. L'ancien sergent accepte donc.
Pour Fremantle, cette période de sa vie qui est encore bien présente à sa mémoire et des souvenirs qu'il croyait évanouis lui reviennent et dérangent quelque peu le témoignage qu'il a promis d'apporter. En réalité il ne parle que de la guerre qui peut plaire, une version édulcorée en quelque sorte et surtout pas des atrocités qui s' y déroulaient. Nous sommes ici dans le domaine politique et s'il en est un aux États-Unis qui est incompatible avec le mensonge, c'est bien celui-là. Ainsi, pour grappiller quelques voix, d'ailleurs pas forcément indispensables à sa réélection compte tenu de son parcours parlementaire antérieur et pour se donner une dimension glorieuse d'ancien combattant toujours appréciée outre-atlantique, Drake s'est enfermé volontairement dans un mensonge, petit au départ , qui a malgré lui et avec le temps pris des proportions qui ont fini par lui échapper et qui n'ont pas manqué d'être exploitées par ses détracteurs. Pourtant Fremantle n'est pas vraiment à l'aise dans ce mensonge, lui qui, pourtant, en tant que policier, en entend tous les jours de la part des prévenus, puisqu'il retrouve des anciens camarades de combat qui connaissent la vérité, Mais la politique déroule son jeu avec ses prébendes, ses trahisons, ses artifices. Existe-il vraiment une justice immanente mais, comme le disaient les Anciens, « la roche tarpéienne est proche du Capitole », une réalité qui s'impose à Drake et la morale est sauve comme cela arrive parfois dans la vraie vie. Cet événement en tout cas fait prendre conscience au policier qu'il a vieilli et que l'heure de la retraite a sonné pour lui,
C'est donc non seulement une critique de cette Amérique démocratique et censée être vertueuse que nous prenons comme modèle qui est ici menée. Elle est pourtant inféodée au pouvoir de l'argent et l'hypocrisie, la palinodie, la flagornerie sont choses quotidiennes comme elles le sont dans nos sociétés occidentales qui s’accommodent du mensonge, de la trahison, des apparences, C'est évidemment une diatribe contre le monde politique où tous les coups foireux sont permis pour accéder au pouvoir, où les promesses les plus fantaisistes ont droit de cité. Ce milieu qui devrait être celui de l'évolution des choses au profit du plus grand nombre n'est en réalité qu'un creuset où se développent les inutiles, les incompétents, les arrivistes qui deviennent très vite des parasites. plus soucieux de leur enrichissement personnel et de leur parcours que du bien commun. C'est aussi une satire contre l'espèce humaine, toujours plus prétentieuse et désireuse de reconnaissance, avide d'avantages , et à laquelle nous appartenons tous .
© Hervé Gautier – Septembre 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Mensonges et vérités - James Comey
- Le 18/07/2018
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1264
Mensonges et vérités – James Comey – Flammarion.
Traduit de l'américain par Laure Joanin et Laurent Barucq.
D'ordinaire, je prise peu les écrits de nature politique. Ici j'ai fait une exception à la lecture de la quatrième de couverture, non pas tant à cause de la personnalité peu attirante de Donald Trump que parce que ce président atypique qui passe son temps à dire et faire n'importe quoi, bousculant au passage les usages diplomatiques et les alliances traditionnelles des États-Unis, au point que son entourage souvent critique doive en permanence expliquer voire rectifier ses prises de position, et dont on dit, par égard au chef du plus grand pays du monde, (respect élémentaire qu'il ne pratique cependant pas lui-même), qu'il est « imprévisible ». En réalité ici il s'agit de « mémoires » et je dois dire qu'au fil de ma lecture, que j'abordais au départ avec quelques réticences, j'ai été convaincu par l'auteur, C'est certes lui qui tient la plume et la tentation est grande, en retraçant son propre parcours, de régler des comptes et d'être son propre thuriféraire mais, le livre refermé, j'ai vraiment eu la certitude d'avoir rencontré un authentique serviteur de l’État dans tous les postes qu'il a occupés dans l'Administration. Né en 1960, avocat, il a exercé différents fonctions dans le secteur privé, mais confie :« le service public me manquait et je regrettais même son mobilier dépareillé et ses faibles émoluments » , Il sert en effet sous l'administration de Georges Bush à qui il s'oppose sur le programme « Stellar Wind » (surveillance, pour lutter contre le terrorisme des communications privées) et sur la torture ce qui provoque sa démission et son retour dans le privé. En septembre 2013 est nommé par Barack Obama, directeur du FBI, organisme qu'il veut, contrairement à Edgar Hoover, un de ses prédécesseurs, indépendant et au service de la protection du peuple américain, dans le respect de la Constitution et de l' esprit des Pères Fondateurs. Tout au long de sa carrière il s'est en effet efforcé de servir l’État d'une manière impartiale et honnête. Nommé statutairement pour 10 ans il pensait pouvoir exercer son action en toute indépendance, ce qu'il fit notamment en 2016 en rouvrant une enquête, sur les courriels d'Hillary Clinton, ex-secrétaire d’État, devenue la candidate favorite du camp démocrate pour les élections présidentielles de 2016.
La nomination de Donald Trump à la magistrature suprême changea la donne dans la mesure il se trouvait en présence d'un être « imprévisible », homme d'affaires aux agissements quasi-mafieux selon Comey, qui considère qu'on gère l’État comme une entreprise privée et qui n'a jamais exercé aucune fonction élective comme c'est la règle aux USA ; Il était en effet peu enclin, lui le républicain, et contrairement à ses affirmations répétées, à maintenir à son poste un haut-fonctionnaire qui avait jusque là servi sous des administrations démocrates. Il l'était d'autant moins qu'il avait exigé de Comey une « loyauté honnête », ce à quoi le directeur du FBI avait répondu en l'assurant de sa parfaite « honnêteté ». Le contexte était en effet difficile car James Comey avait ouvert une enquête sur les agissements personnels de Trump avec des prostituées russes lors d'un voyage à Moscou et surtout sur des éventuelles ingérences de la Russie dans les élections américaines qui avaient porté Trump au pouvoir. Comey , refusant d'abandonner cette enquête comme le lui demandait avec insistance le président fut donc, en mai 2017 , licencié sans ménagement ce qui provoqua un scandale outre-atlantique et sa déposition devant la Commission Judiciaire du Sénat. Cette polémique tournait autour du mensonge réciproque dont s'accusaient les deux protagoniste dans un pays où, on le sait, mentir aux autorités est une faute qui a brisé bien des carrières. Ce licenciement a rendu à Comey sa liberté de parole et les éléments que contient son livre font légitimement craindre pour la survivance de la démocratie surtout sous la magistrature de Trump .
Comey parle abondamment de l'indépendance du FBI par rapport au pouvoir politique, ce qui est un gage de démocratie et une assurance donnée au peuple américain mettant un exergue le douloureux dilemme « parler ou dissimuler ». C'est un ouvrage intéressant, honnête, bien écrit, plein de révélations et qui s'oppose au nom de l'intégrité et de l’honnêteté à toutes les déviations anti-démocrates ainsi qu'à tous ceux qui n'ont comme but que leur réussite personnelle à n'importe quel prix.
© Hervé Gautier – Juillet 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Nocturnes - Kazuo ISHIGURO
- Le 23/03/2018
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1231
Nocturnes – Kazuo ISHIGURO – Éditions des deux terres.
Traduit de l'anglais par Anne Rabinovitch.
Composer un recueil de nouvelles est un art difficile pour un auteur à cause de l'idée commune que le lecteur recherche dans tous les textes qui le composent. Ici le sous-titre est parlant puisqu'il s'agit de « Cinq nouvelles de musique au crépuscule ». Le titre fait penser à Chopin, pourtant absent, mais de musique il est effectivement question dans chacune de ces nouvelles puisque Ishiguro convoque notamment Sarah Vaughan et met en scène un crooner américain sur le retour qui entonne les chansons qui ont fait son succès.
Il y a une dimension crépusculaire dans ces nouvelles, que ce soit ce vieux chanteur américain qui choisit Venise pour pousser la sérénade sous la fenêtre de sa femme qu'il aime, avant de divorcer parce que cela se fait dans son métier ou de ce couple d'anglais dont les relations battent tellement de l'aile qu'il attire un ami dans un traquenard pour essayer sans doute de sauver leur amour. Il s'agit surtout des couples, des subtiles variations des sentiments, du temps qui passe et de l'usure des choses, pour l'amour comme pour le reste (eh oui, l'amour est consomptible et ne rime pas avec toujours contrairement à ce que le dicton à l'eau de rose voudrait nous faire croire), même sur les canaux de la Sérénissime où paraît-il tout est plus romantique. En choisissant ce thème, la mélancolie n'est jamais très loin, le pathétique non plus et ce recueil nous présente les êtres qui font ce qu'ils peuvent pour survivre au quotidien avec leurs états d'âme. Tous les musiciens que nous présentent ce recueil ont un côté « loser » ou, ce sont à tout le moins des êtres qui se cherchent. Le narrateur y parle toujours à la première personne et ne cache rien de ses failles.
Il y a aussi le concept de réussite, si important dans nos sociétés occidentales, de cette réussite qui couronne une vie professionnelle et qui engendre l'estime de soi, parfois l’égotisme et l'admiration d'autrui. C'est d'autant plus révoltant que, dans les cas qui nous sont présentés, ces musiciens ont tout ce qu'il faut pour réussir. Il en est question dans l'histoire un peu surréaliste de ce couple d'anglais comme dans celle de ce vieux crooner qui veut sacrifier son couple pour relancer sa carrière. Il est en effet question de réussite pour ce talentueux saxophoniste dont la carrière n'a pas décollé à cause de sa laideur et qui accepte de se faire refaire le visage avec l'argent de l'amant de sa femme. Une opération esthétique lui viendra en aide… mais ! On ne parlera jamais assez du regard des autres et de ses conséquences néfastes. Cela peut être aussi une carrière pleine d'avenir, une réussite en devenir où on se dit légitimement que rien ne peut venir la contrecarrer comme celle de ce violoncelliste qu'une étrange femme souhaite entendre jouer pour elle seule. Pourtant les choses ne sont pas aussi simples et il ne faut guère camper sur nos propres certitudes. Il n'est pas rare que les illusions les plus solides soient déçues et même si la réussite arrive, il est aussi certain que, comme le disaient les anciens, « la rocheTarpéienne n'est jamais loin du Capitole », ce que le poète redit à sa manière « Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force ni sa faiblesse ni son cœur... »
Que ce soit dans la campagne anglaise, à la terrasse d'une piazza italienne ou dans un hôtel Hollywood, l'ambiance est un peu délétère, émouvante, burlesque, même carrément loufoque et parfois dérangeante, avec toujours en arrière-plan la musique, des mélomanes ou des musiciens.
L'écriture est simple, presque minimaliste et m'a procuré un bon moment de lecture.
J'avoue que je ne connaissais pas cet écrivain anglais d'origine japonaise nobélisé en 2017. Cela a été une découverte pour moi.
© Hervé GAUTIER – Mars 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Dans l'épaisseur de la chair - jean-Marie BLAS DE ROBLES
- Le 19/02/2018
- Dans littérature française et francophone
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1218
Dans l'épaisseur de la chair - Jean-Marie Blas de Roblès - Zulma.
Cette saga familiale commence bizarrement par un chavirage de Thomas, le narrateur, lors d'une promenade solitaire en méditerranée. A la suite d'une altercation avec son père qui lui reproche de « ne pas être un vrai pied-noir » il prend seul la barque familiale et passe par-dessus bord. Ce séjour dans l'eau, rendu assez long par l'impossibilité de remonter dans son « pointu », lui donne l'intuition de sa mort inéluctable. C'est pour lui l'occasion de revoir, un peu sa propre vie comme dit-on celui qui va quitter ce monde, mais, remontant les traces de la mémoire, également celle de son père, la probabilité de la noyade lui rappelant les risques auxquels cet homme a dû faire face pendant sa longue vie. Par le biais de l'écriture, il lui rend un authentique et émouvant hommage et cela donne lieu à de nombreux analepses, sous forme de courts paragraphes, où il égrène les grands et les petits moments de cette famille déchirée entre l'Espagne, l'Algérie et la France. Il y a certes ce témoignage en faveur du père, mais, au fil de ma lecture, j'ai cru comprendre que le narrateur-auteur mena la vie dure à cet homme pendant quelques temps et fut invité par sa mère à plus d'indulgence envers lui, ainsi ce livre peut-il être aussi une manière de rachat. Ainsi il évoque son papa, Manuel Cortes, ancien chirurgien, engagé volontaire au côté des Alliés en 1942 qui, à 93 ans, vit retiré sur la côte d'Azur. Il est fils d’immigrés espagnols établis à Sidi-Bel-Abbès, une ville de garnison de la Légion étrangère, en Algérie, où son père, Juan, tenait un bistrot. C'est donc un roman de « pieds-noirs », plein du soleil de ce pays, des illusions entretenues de son rattachement à la France qui se termineront avec le triste slogan « la valise ou le cercueil », la découverte d'un pays lointain, inconnu et hostile, pas mal de regrets, d'incompréhensions et de trahisons politiques. C'est la petite histoire de cette famille qui se confond avec celle de ce pays, de son époque coloniale et militaire qui s'inspirait selon lui de la conquête romaine, de cette cohabitation cahoteuse entre européens, juifs, musulmans et bien entendu Espagnols, ces erreurs politiques qui ont jalonné la présence française en Algérie et de son issue, des épisodes de la deuxième guerre mondiale du retour au pays. Le lecteur découvre par le menu la libération de l'Italie puis de la France à travers l'épopée personnelle de Manuel, incorporé comme médecin auxiliaire dans un tabor marocain puis dans un régiment de génie, avec blessures, décorations et citations. Il partage les actions d'éclats de ces soldats, déplore leurs exactions sur les populations civiles mais profite aussi aussi ces moments d'exception où l'on oublie la guerre et, au milieu de ces combats, Manuel, avec une baraka insolente, semble immortel, en plus d'être un séducteur impénitent dans la vie ordinaire. Puis ce sont les événements de Sétif qui ont lieu en Algérie et sont le départ de ce processus d'indépendance qui fera de lui et de sa famille des «rapatriés ».
L'architecture de ce roman s'articule comme un jeu de cartes espagnol avec ses figures caractéristiques et différentes des nôtres, « l'as de deniers », le« de deux d'épée », le « trois de bâton » et le « quatre de coupes ». Cette progression symbolise la vie qui s'écoule, mais peut-être surtout ce que le hasard ou la destiné donnent à chacun en lui confiant le soin de le faire fructifier, sans oublier la chance et son contraire, la scoumoune, les événements extérieurs ou l'action des autres qui viennent favoriser ou contrecarrer les projets personnels, une image assez fidèle du parcours individuel en ce bas monde entre liberté, fatalité, erreurs et succès... A l'occasion de ce roman, l'auteur-narrateur remet en cause nombre d'idées reçues sur la guerre et sur la colonisation, mais c'est la nostalgie de ce pays et du temps passé qui transparaît. Il porte sur son histoire un regard critique égrenant les phases qui iront irrémédiablement vers les combats, les attentats, l'indépendance et le départ en catastrophe, un travail d'historien d'une remarquable précision. Ce faisant, il porte aussi un jugement sur la condition humaine.
A titre personnel, je ne lis jamais une saga sans ressentir une sorte de vertige que me procure le temps qui passe et la vie qui s'écoule malgré soi et malgré sa volonté d'y imprimer sa marque. Ce fils de pauvres immigrés espagnols devient, à cause de la guerre, un brillant chirurgien, mais les événements, et aussi ses semblables se chargèrent de briser ses rêves et sa volonté. Il a mené une vie à la fois longue, aventureuse et tellement romanesque qu'on croit lire une fiction.
Thomas est accompagné des railleries de son perroquet qui, bien qu'absent, hante son esprit au point de pouvoir être regardé comme la voix de sa conscience, ce qui donne à ce roman une incontestable dimension humoristique.
J'ai retrouvé avec plaisir le style fluide et agréable à lire que j'avais déjà rencontré dans « Là où les tigres sont chez eux » (La Feuille Volante n°329). J'ai, avec ce roman, à nouveau passé un bon moment de lecture, dépaysant et passionnant.
© Hervé GAUTIER – Février 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com
-
Un mari idéal - Leah MacLaren
- Le 04/02/2018
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1214
Un mari idéal – Leah McLaren – Albin Michel.
Traduit de l'anglais par Clara Lavaste.
Nick et Maya sont mariés. Lui est un important publicitaire et elle, actuellement mère au foyer après la naissance, voici trois ans, des jumeaux Foster et Isla, a renoncé à une brillante carrière d'avocate, mais pas au grand train de vie que lui assure les revenus de son mari. Nick, à peine 40 ans, est déjà lassé du mariage, cultive les aventures et songe à divorcer mais ce ne sera pas facile parce que le droit de la famille était la spécialité de Maya quand elle était avocate, sans compter ce que ça va lui coûter ! Gray, avocat, mais aussi ami du couple depuis longtemps, lui conseille de devenir le mari idéal, le père attentionné qu'il n'a peut-être jamais vraiment été et surtout d'encourager Maya à reprendre son métier d'avocat, ne serait-ce que pour minorer le montant de la pension alimentaire qu'il devra lui verser en cas de divorce. Et tant pis si le mensonge est gros ! De son côté elle qui rêve d'autre chose et au début s'engage entre eux une sorte d'épisode où la séduction le dispute à la comédie, mais Nick se prend au jeu et retombe amoureux de sa femme. Quand il avait souhaité que Maya retravaille, il ne croyait pas si bien dire, parce que, de son côté, c'était son souhait et c'est précisément à Gray qu'elle demande de la réinsérer dans le monde du travail, sans toutefois savoir que l'idée vient de lui. La réaction favorable de Nick est étonnante mais finalement logique puisqu'elle sert ses intérêts, mais Maya s'étonne un peu de voir son mari accepter en même temps la reprise de ses activités professionnelles et son nouveau rôle de père. C'est un peu comme une renaissance de son mariage qui s'enlisait dans le quotidien. Le plus étonnant est qu'elle s'en ouvre à Gray, devenu son collègue de travail, mais, elle ne le sait pas encore, secrètement amoureux d'elle depuis toujours.
J'ai été assez long à entrer dans cette histoire qui bien souvent s'égare en longueurs, mais j'ai cependant poursuivi ma lecture, plus intéressé que vraiment passionné, jusqu'à la fin, ne serait-ce que pour découvrir un épilogue qui tardait un peu. Elle tient sa réalité d'une idée un peu bizarre d'un ami du temps de l’université qui ressemble à un coup de poker et qui révèle la vraie nature de cette amitié. Cela n'est pas vraiment une nouveauté tant l'espèce humaine se démasque à travers le mensonge, l'hypocrisie, l'envie, la volonté de ne pas laisser passer une opportunité quel que soit par ailleurs le prix à payer pour cela et ce malgré tous les serments, les bons sentiments affirmés, les apparences derrière lesquelles on se retranche souvent. Elles sont trompeuses, l'actualité judiciaire nous le rappelle opportunément, et quand il s'agit du couple, c'est encore pire. Les portes refermées sur son intimité cachent parfois des évidences qui étonnent les proches et les révélations sur chacun des conjoints prennent une dimension surréaliste tant elles sont différentes de cette réalité qu'on croyait établie. J'ai longtemps craint, tout au long de ma lecture, d'avoir affaire à un de ces scénarios connus d'un couple en instance de séparation, avec, dans l'ombre, le tiers, plus ou moins amoureux qui attend son heure, un de ces romans à l'eau de rose qui font le bonheur des lecteurs d'ouvrages publiés par certaines maisons d'édition spécialisées. Le titre et la couverture en donnaient des prémices inquiétantes. Nous sommes dans une société nord-américaine de la classe supérieure où traditionnellement les épouses ne travaillent pas et font de parfaites femmes d'intérieur qui se chargent des enfants et participent à des activités hors de leur foyer. Que Maya qui choisit de rompre cet équilibre en reprenant un travail qui la passionne, en ressente de la culpabilité, je peux l'admettre, à condition qu'elle ne se sente pas fautive en permanence comme cela semble être le cas, d'autant qu'elle est, sans le savoir, à la fois l'objet de cet arrangement où l'argent n'est pas absent, l'enjeu de cette idée finalement très intéressée et finalement la personne qui permet à Nick de redevenir ce mari idéal que son quotidien avait quelque peu masqué.
Je n'ai pas vraiment senti « l'humour ravageur » dont parlent la quatrième de couverture et les nombreux commentaires que j'ai pu lire, pas apprécié non plus le style assez ordinaire. J'ai trouvé un peu légère cette idée saugrenue, mais pas innocente, de Gray et la facilité avec laquelle Nick l'acceptait. Le fait qu'elle se retourne contre son auteur me parait tenir du « happy end » un peu facile qu'on ne rencontre pas toujours dans la vraie vie. J'ai plutôt vu une certaine critique de la société nord-américaine qui fait prévaloir l'argent, celle du mariage, la prise en compte de l'usure du couple et l'illusion de chercher ailleurs ce qu'on a chez soi, une étude de personnalités face à un tournent dans la vie personnelle, bref quelque chose d'assez peu original. Cependant, je ne regrette pas d'avoir poussé à son terme ma lecture de ce roman que Babelio et les éditions Albin Michel m'ont fait parvenir, ce dont je les remercie, même si je l'ai fait sans véritable passion.
© Hervé GAUTIER – Février 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
La symphonie du hasard (Livre 1) - Douglas KENNEDY
- Le 19/12/2017
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1195
La symphonie du hasard (livre 1) – Douglas Kennedy – Belfond.
Traduit de l'américain par Chloé Royer.
Quand j'ai reçu cet ouvrage de la part de Babelio et des éditions Belfond que je remercie, je me suis dit que le titre ne pouvait que me parler. J'ai en effet toujours affirmé que le hasard gouverne nos vies bien plus souvent que nous voulons bien l'admettre. Il nous fait naître dans un milieu donné, il provoque la rencontre de gens qui favorisent ou non notre avenir, il s'invite dans notre quotidien et la mort interrompt notre vie au moment et dans des circonstances qui bien souvent nous échappent. Ici, c'est une famille américaine des années 70, les Burns, qui sert de fil conducteur à cette saga. Les voies de la génétiques sont comme celles du Seigneur, impénétrables. Ainsi, une même ascendance a-t-elle engendré trois enfants différents, Peter, sérieux et puritain, Alice, éditrice new-yorkaise, et Adam, ex-jeune loup de Wall Street, qui lui est actuellement en prison. Est-ce l'univers carcéral ou les révélations divines toujours miraculeusement présentes dans les prisons américaines, lors des visites hebdomadaires d'Alice, Adam va faire à sa sœur des révélations familiales qui vont accréditer cette affirmation « chaque famille est une société secrète ». Du coup Alice va y aller de ses confidences et c'est son parcours à elle que le lecteur va suivre, sur son enfance, sur son adolescence, sur le début de son cursus universitaire, le tout sur fond de puritanisme vieillissant, de guerre du Viet-Nam, de coup d'état au Chili, de scandale du Watergate, de charme discret des vieilles provinces du nord-est. On n'échappe pas au portrait de ses parents, un couple bancal, mal assorti et agressif («Ma mère et mon père me paraissaient terriblement seuls. Surtout lorsqu'ils étaient ensemble. ») qui pratique volontiers le mensonge et l’hypocrisie, bien digne de ses racines juives du côté de sa mère et catholiques irlandaises du côté paternel, en fait une famille toxique qu'elle va fuir. Elle est très attachée à son père, réactionnaire et un peu alcoolique qui peine à voir grandir cette fille cadette qui de plus en plus lui échappe surtout quand elle choisit, malgré sa situation transitoire d'étudiante, une vie de couple apparemment heureuse, peut-être parce que la sienne ne l'est pas.
Le plus étonnant sans doute c'est que dans ce premier livre où il est question d'Alice, une jeune fille de 17 ans, Douglas Kennedy se glisse avec beaucoup de facilité… dans la peau de ce personnage, lui qui a 60 ans, même si ce n'est pas vraiment la première fois qu'il choisit quelqu'un du sexe féminin comme héro. L'auteur renoue avec le thème du hasard autant qu'avec celui des rapports entre hommes et femmes, du bonheur conjugal impossible, des états d'âme et des difficultés qu'il suppose, dans un contexte de mensonges, de trahisons, de secrets, d'alcool, de drogue, sans oublier la culpabilité judéo-chrétienne, un autre de ses thèmes favoris. Cette famille est à l’image de l'Amérique et de sa volonté de réussite, en même temps qu'elle existe dans un contexte religieux du rachat perpétuel de ses fautes. En réalité, on apprend beaucoup dans ce roman sur les années 70 et d'autres thèmes comme l'anti-sémitisme, l'homophobie, le racisme sont aussi abordés. C'est parfois un peu long et détaillé et on perd le fil de cette fiction mais si nos références sociales et culturelles françaises sont différentes, nous appartenons tous à l'espèce humaine qui montre des caractéristiques communes qui ici sont bien analysées.
Peut-être ai-je tort mais il se peut que ces sujets soient aussi des préoccupations personnelles de l'auteur, ce qui en fait de cette trilogie un roman largement autobiographique. C'est sans doute par dérision qu'il déclare, paraphrasant Flaubert, qu'Alice, c'est lui ! Il y a certes la différence de sexe et d'âge mais le parcours de cette jeune femme ressemble étrangement à celui de l'auteur. Il y a sa famille qui devait sans doute ressembler à celle d'Alice mais aussi le personnage de son père qui fut un agent de la CIA et joua un rôle dans le coup d’État de Pinochet au Chili. Le fait d'insérer cet épisode dans ce roman en dit assez long sur la gêne qui peut être la sienne et peut-être aussi une certaine forme de culpabilité. Il y en a un, un peu secondaire il est vrai, qu'est celui de ce professeur de l'université où étudie Alice qui veut écrire un livre mais ne parvient pas à s'y mettre. Est-ce la révélation d'une difficulté réelle, d'une paresse, d'une volonté affichée de procrastination ou l'aveu de ses propres limites ? Cette prise de conscience de son inutilité personnelle, cette perte de l'estime de soi qui débouchent sur la mort volontaire du Pr Hancock, sont-elles révélatrice d'une sorte de malaise personnel ? Pourtant Douglas Kennedy a toujours été un auteur prolifique.
Comme toujours j'ai apprécié l'analyse psychologique des personnages, le déroulement des faits, la qualité du style, direct et efficace, ce dont cette chronique s'est souvent fait l'écho. Il y a des longueurs certes, mais, bizarrement peut-être et malgré ces 360 pages, je ne me suis pas ennuyé, ce fut un réel bon moment de lecture et ce premier tome augure bien de la suite.
© Hervé GAUTIER – Décembre 2017. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Dans la forêt - Jean Hegland
- Le 16/12/2017
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1194
Dans la forêt – Jean Hegland – Éditions Gallmeister
Traduit de l'américain par Josette Chicheportiche.
Nell et Eva sa sœur, dix-sept et dix-huit ans, vivent maintenant, livrées à elles-mêmes dans la forêt californienne parce tout manque dans cette société désorganisée où il n'y a plus ni électricité, ni internet, ni essence, ni trains… Elles survivent comme elles peuvent en rationnant tout surtout depuis la disparition de leur mère à cause d'un cancer et de la mort accidentelle de leur père. Ce sont deux jeune femmes seules et orphelines qui survivent face à la famine, à l'insécurité, aux risques d'agression dans une région que les gens fuient vers un avenir meilleur et surtout deviennent dangereux et oublient leur humanité. Elles se rappellent les bons moments avec leurs parents, quand le bonheur était quotidien, que tout était facile, qu'elles avaient des projets, la lecture, les études à Harvard pour Nell, la danse pour Eva. Maintenant tout cela appartient au passé et il faut survivre, redécouvrir les gestes des premiers colons, la culture du potager, la valeur nutritionnelle des plantes sauvages, se méfier de tout et de tout le monde. Les deux sœurs restent ensemble dans cette maison isolée plutôt que de céder au réflexe de fuir. Cela ne va pas sans heurts, sans hostilités entre elles parce que, en arrière-plan la mort et la solitude sont une réalité. Certes, la forêt qui là aussi est un personnage central de ce livre, fournit de quoi se nourrir, mais à condition de renoncer à la facilité des produits préparés industriellement, de revenir à une vie plus simple, mais aussi à un respect de cette nature qui peut parfois se révéler hostile et dont on a un peu oublié l'importance et la valeur. L'épilogue est révélateur de cet volonté de vivre en osmose avec elle. Les deux sœurs se l'approprient petit à petit, découvrent son mystère et sa diversité et Nell se concentre sur la lecture de l'encyclopédie qui contribue à lui donner une explication du monde. Face à l'effondrement de la civilisation, c'est pour ces deux jeunes femmes tout un réapprentissage de la vie, des gestes oubliés ou appartenant aux anciens indiens de Californie et de l'instinct naturel, avec pour seul but de ne pas mourir.
J'ai vu dans ce roman, non pas tant une fiction mais bien une histoire pas si irréelle que cela. Nous vivons dans une société axée sur la consommation dont nous pillons sans vergogne les ressources naturelles au point de l'appauvrir durablement sans même nous apercevoir que c'est notre propre avenir que nous hypothéquons. Nous sommes conscients des risques écologiques que nous prenons, mais dans une sorte d'inconscience collective, nous persévérons dans cette attitude (« Notre maison brûle mais nous regardons ailleurs » selon la phrase déjà ancienne d'un président de la République). Pourtant nous savons bien que cette société qui est la nôtre est d'une grande fragilité, basée seulement sur le profit, sur le rendement, puisque une simple grève générale suffit à la désorganiser. C'est un peu comme si nous faisions semblant de croire que, malgré notre conduite collective irrationnelle, tout finira bien par s'arranger ou plus simplement qu'il est urgent de ne rien faire. J'ai lu dans ce roman, plus qu'une fable écologique, une invitation à une prise de conscience collective indispensable à notre survie à tous. Dans ce contexte économique caractérisé par l'abondance, le gaspillage et la facilité, chacun devient égoïste, violent et oublieux des autres qui sont aussi nos semblables. C'est aussi un roman plein d'espoir avec l'arrivée d'une vie, certes non désirée, mais qui symbolise la pérennité de l'espèce humaine, même dans l’extrême difficulté, une sorte de volonté de vivre.
La présentation de ce texte sous forme de paragraphes indépendants qui l'assimile à une sorte de journal, lui donne un rythme et une ambiance caractéristiques.
© Hervé GAUTIER – Décembre 2017. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Moi, Harold Nivenson - Sam Savage
- Le 02/08/2017
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1154
Moi, Harold Nivenson – Sam Sauvage – Notabilia.
Traduit de l'anglais (États-Unis) par Marc Amfreville
Même si la lecture de ce roman ne nous révèle pas l'âge d'Harnold, on comprend très vite qu'il est vieux. D'ailleurs, comme tous les vieux, il ressasse ses souvenirs et jette sur le monde un regard désabusé. Il est face à sa fenêtre et il nous décrit ce qu'il voit, l'agitation du dehors, ses voisins qu'il espionne plus qu'il ne les regarde et qui vivent leur vie au quotidien et il se laisse aller à des réflexions acerbes et aigries sur sa vie personnelle autant que sur l'art et sur les artistes dont il note de beaucoup sont devenus fous ou se sont suicidés. Il nous livre ses impressions depuis sa fenêtre, autant dire qu'il est en dehors du monde et le regarde à travers le filtre des vitres. On comprend très vite que c'est un artiste raté qui nous confie ses réflexions sur l'art mineur et les artistes minuscules dont il avoue faire partie mais aussi qu'il a joué, à un moment de sa vie, la comédie du connaisseur inspiré et du collectionneur qu'il n'a jamais été. Il vit dans un quartier maintenant peuplé de « bobos » mais qui auparavant a été populaire et industrieux, il habite une maison délabrée qui a jadis été belle mais qu'il a laissée à l'abandon, un peu comme sa propre vie. Il semble avoir vécu sans travailler grâce à une fortune personnelle. Auparavant, il était à la fois un écrivain mineur et une sorte de mécène qui y abritait des peintres plus ou moins parasites. On découvre son amitié avec le peintre Peter Meininger qui exerçait sur lui une véritable fascination mais dont il était véritablement jaloux, au point de partager avec lui la même femme. Il en profite pour égratigner au passage les experts qui viennent chez lui examiner et évaluer les toiles de cet artiste. A cette période pourtant, il croyait encore en lui, en ce destin brillant qu'il attendait pour lui-même mais qui n'a pas été au rendez-vous, soit qu'on ne lui ait pas donné sa chance, qu'il n'ait pas su la saisir ou tout simplement qu'il n'ait pas eu de talent. Maintenant, il s'est mis dans la tête d'écrire un « Manifeste », sans savoir lui-même de quoi il sera question. Il revoit sa triste vie et se laisse aller à des remarques déplaisantes sur ses parents qui n'ont pas su lui donner une jeunesse heureuse, sur ses frères et sœurs qui le torturaient, sur ses contemporains et sur lui-même qui petit à petit est devenu misanthrope et même dégoûté de sa propre personne, se méfiant de tout et de tous. Il avoue volontiers qu'il est d'une grande de indifférence aux autres, à en devenir méchant, même s'il dépend de Moll, une sorte de gouvernante qui s'occupe de lui et qui figure sur les tableaux de Meininger, parce que son fils ne veut pas se charger de lui. On a même du mal à s'imaginer qu'il a pu avoir une famille mais pourtant c'est vrai et il la méprise, comme tout ce qui l'entoure. Du temps où il était encore vivant, seul son chien semblait avoir de l'intérêt à ses yeux. Il sent venir la mort, mais apparemment elle ne lui fait pas peur. Il la voit comme une délivrance face à l'échec de sa vie. Je ne suis pas vraiment spécialiste de l'art mais certaines de ses remarques sont pertinentes. Quant à ses commentaires sur sa vie ratée, je les trouve plutôt sains simplement parce que je suis toujours agacé par ceux qui, suffisants, passent leur temps à se regarder le nombril et à se tresser des lauriers.
Par ce roman pris au hasard sur les rayonnages d'une bibliothèque, j'ai été assez surpris à cause de l'atmosphère déprimée et glauque qu'il distille.Les remarques du narrateur ne correspondent peut-être pas tout à fait à celles que je pourrais faire moi-même mais certaines d'entre elles ma paraissent quand même justes et pertinentes. Elles sont certes désabusées mais correspondent à ce qu'un homme en fin de vie peut penser d'un parcours personnel entaché par l'échec et par la solitude qui en résulte. Sur le plan du style, le texte se lit bien mais il assez décousu parce que divisé en paragraphes où le passé se mêle au présent et où ses remarques sont comme jetées sur le papier, comme des « pensées » ou des pièces d'un puzzle qui laissent parfois la place à des longueurs inutiles.
© Hervé GAUTIER – Juillet 2017. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Firmin - Sam Savage
- Le 02/08/2017
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1159
Firmin – Autobiographie d'un grignoteur de livres – Sam Savage – Actes Sud.
Traduit de l'américain par Céline Leroy – Illustrations Fernando Krahn.
Avec une couverture pareille- un rat feuilletant un livre- et un tel sous-titre, je ne pouvais que lire ce roman. Firmin , c'est un rat exceptionnel, malchanceux, dernier d'une portée de treize qui, ne trouvant pas de tétine, se rattrape en mâchonnant les livres d'une vieille librairie d'occasion dans le quartier de Scollary Square, à Boston où il est né dans les années 1960 et où vit toute sa famille. Il y prend rapidement goût d'autant que le papier remplace agréablement le lait un peu frelaté de sa mère alcoolique. Oui, vous avez bien lu, Flo, sa mère rate, est une vraie pochetronne. Au début, c'était pour se nourrir mais rapidement il se met à les lire et même à jouer de la musique sur un piano miniature, même si on peut se demander comment il a pu apprendre mais nous sommes dans une fable, n'est ce pas ? Et, Firmin n'est pas n'importe quel rat ! Du coup, le papier qui était pour lui un aliment, devient une source de connaissances et notre rat, un lecteur assidu, fort cultivé et curieux de tout, un « rat de bibliothèque » atteint de « biblioboulimie ». Il en conçoit une sorte de folie et même de fantasmes; on nous a bien dit que la lecture est un vice ! Pour assurer sa subsistance, il explore le cinéma voisin, le Rialto, à cause des restes de pop-corn abandonnés par les spectateurs mais surtout parce qu'on y passe des films pornos auxquels il prend goût. Il n'est pas insensible à la beauté des femmes qu'il voit défiler, dénudées sur l'écran. Du coup, débrouillard comme il est, il partage la vie de Norman Shine, le libraire qui exploite cette échoppe puis, celle de Jerry Magoon, un écrivain marginal dont il devient le compagnon. Il est donc complètement étranger à la communauté ratière dont il ne partage pas l'instinct grégaire. Il voudrait bien parler avec ces deux camarades mais ses cordes vocales ne le lui permettent pas, pas plus d'ailleurs que l'usage de la machine à écrire et que le langage des signes. C'est dommage, je suis sûr qu'ils auraient pourtant eu beaucoup de choses à se dire. Du coup, il livre ses impressions intimes au lecteur en le prenant comme confident. La vie pourrait se passer ainsi, mais le quartier va être rasé, la librairie et le cinéma détruits, ce qui bouleverse tout le monde et Firmin en conçoit des états d'âme existentiels qui le font de plus en plus ressembler à un humain (et pas seulement à cause des films pornos). La cohabitation avec Norman et Jerry fait cependant qu'il ne prend de l'espèce humaine que les côtés paisibles mais dépressifs et ne connaît ni la méchanceté ni la vengeance mais ressent plutôt de la mélancolie, un certain sens critique, un sentiment de solitude et d'impuissance... Du coup, pour exorciser tout cela, il va confier son désarroi à la feuille blanche en écrivant sa biographie. Le papier qui était pour lui précédemment un aliment devient un confident, même si je ne suis plus très sûr de l'action cathartique de l’écriture. Il va donc devoir quitter son nid douillet pour être précipité dans la vie extérieure qui est une véritable foire d'empoigne et où il devra s'adapter s'il veut faire son trou, qui ne sera pas « un trou à rat ». Souhaitons lui bonne chance mais souvenons-nous que c'est un rat d'exception pour lequel il ne faut pas trop se faire de bile. Cela nous donne un roman frais, bien écrit, passionnant du début à la fin où j'ai vraiment tout aimé, l'histoire malicieuse de cet animal hors du commun qui d'ordinaire inspire plutôt du dégoût, les illustrations qui donnent de Firmin une image sympathique et attachante, le dépaysement digne d'une fable que cela procure et cette occasion que nous donne l'auteur de voir autrement les choses et pourquoi pas d'en rire...
J'ai découvert Sam Savage un peu par hasard, comme souvent et l’œuvre de ce jeune auteur de 77 ans, dont c'est ici le premier roman, m'a bien plu (La Feuille Volante n°1154 pour « moi, Harold Nivenson »- n°1157 pour « La complainte du paresseux »). Ici, j'ai apprécié à nouveau son humour, son style libre et agréable à lire avec lequel il nous confie un peu de son expérience personnelle.
© Hervé GAUTIER – Août 2017. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
La complainte du paresseux - Sam Savage
- Le 27/07/2017
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1157
La complainte du paresseux – Sam Savage – Actes Sud
Histoire principalement tragique d'Andrew Whittaker, réunissant l’ensemble irrémédiablement définitif de ses œuvres complètes
Traduit de l'américain par Céline Leroy
Ce roman s'ouvre sur une citation de Fernando Pessoa, ce qui, pour moi, ne pouvait être qu'un bon présage.
Andrew Whittaker est un geignard impénitent et tout lui est bon pour râler et se plaindre dans les lettres qu'il envoie à l'entour. Ce sont les les travaux dispendieux et les loyers de son petit patrimoine immobilier qui ne rentrent pas, les invectives qu'il envoie à la banque où il ne peut s'empêcher de raconter sa vie dans les plus petits détails et quand il s'adresse à un correspondant, les termes de ses courriers oscillent entre la mythomanie, les rodomontades et les menaces. Il n'omets jamais de parler de sa revue poétique moribonde, « Mousse », dont il se baptise pompeusement « rédacteur en chef » alors qu'il est seul à la rédiger (et sans doute à la lire) et dont il tente d'assurer la survie en multipliant vainement les appels de fonds et en sollicitant de vieux amis auteurs qui ont réussi mieux que lui dans le métier des Lettres, mais en leur précisant qu'ils ne seront pas payés pour leur prestation, ce qui n'est évidemment pas de nature à les motiver. Cette revue est d'ailleurs l'objet de railleries de la part de la concurrence et de l'ignorance des médias! Pour faire illusion, il lui arrive même de se cacher derrière l'identité d'un lecteur inventé et d'écrire à la presse locale pour vanter les qualités littéraires de « Mousse » et la personnalité hors du commun de son directeur, c'est à dire lui-même ! Il se prétend découvreur de talents, mais abuse de sa sacro-sainte « ligne éditoriale » pour refuser tous les manuscrits qu'on lui envoie, ce qui est une manière peu élégante de la part d'une revue miséreuse qui n'a pas les moyens de ses ambitions littéraires. Cela ne l'empêche pas de faire des allusions appuyées à des manifestations culturelles organisées par ses soins et couronnées par une remise de prix minable, et qui n'aura évidemment jamais lieu ! Et Quand il s'invite aux démonstrations culturelles organisées par d'autres, c'est simplement pour y faire scandale ! Quant à la gent féminine, il lui arrive bien plus souvent qu'à son tour de s'adresser à elle, mais avec une goujaterie consommée ! Il déplore aussi sa solitude, sa chère épouse, Julie, s'est envolée, et le souvenir d'une éphémère passade avec une autre femme ne suffit pas à l'apaiser. Puis c'est sa voiture qui va rendre l'âme, sa ligne téléphonique qui est coupée et sa mère qui perd la tête et finalement meurt, quand il ne se répand pas dans des épîtres pleines d'acrimonies pour dénoncer le sort qui est fait à sa revue dont il précise abusivement qu'elle a une « résonance nationale » dans cette Amérique profonde des années 1970. Bref il croit que tout le monde lui en veut et il est devenu complètement paranoïaque, misanthrope, désespéré et écrit tout cela dans des missives pathétiques, des brouillons de romans, des listes de courses, le tout étalé sur quatre mois de sa triste vie. Pour corser le tout il prétend commencer à sentir les effets du vieillissement, alors qu'il n'a que 43 ans ! Ses lettres successives sont un long monologue où, quand il n'est pas cynique, il ne parle que de lui, illustrant à sa manière le solipsisme qui est souvent le propre de l'écrivain, parce qu'il est aussi un écrivain, mais un écrivain raté, comme en attestent les nombreux passages de romans qui ne paraîtront jamais parce qu'ils ne s'inscriront pas dans une intrigue, ne seront jamais suivis de développements et d'épilogues. Quant au monologue qui est la conséquence de son isolement prolongé et sans doute définitif, l'écriture, qui est l'essence même du soliloque, n'est là que comme un pis-aller où le surréalisme comique le dispute au sérieux le plus consommé au point qu'on se demande s'il ne croit pas lui-même à sa propre comédie. Pourtant, il ne reçoit apparemment pas de réponse puisque cet ouvrage n'en fait pas état, ses correspondants devant depuis longtemps être lassés de ses incessantes jérémiades, ce qui aggrave son état de déréliction. En fait, j'ai découvert une sorte d'ours, malheureux, malchanceux et que menace la folie peut-être parce qu'il a passé sa vie à rêver à quelque chose qui ne se réalisera jamais, ou il veut a toute force se jouer à lui-même une bouffonnerie où il a une importance qu'il n'aura jamais. Cet Andrew est vieux avant l'âge mais je dois admettre qu'il incarne tous ceux, et ils sont nombreux, qui voulaient vivre de leur talent mais qui n'ont pas connu le succès. En se dessinant de cette manière, à petites touches, il évoque lui-même le paresseux auquel il dit ressembler ; cet animal placide et solitaire, qui porte le nom de « aïe », lui correspond bien, lui qui passe son temps à se plaindre ! Et la comparaison ne s'arrête pas là.
Le style est débridé, parfois humoristique voire caustique, parfois ironique mais étonnamment vivant et je ne me suis pas ennuyé au cours de cette lecture. A l'instar de Rabelais qui voulait qu'on brisât l'os pour en goûter la substantifique moelle, j'ai choisi de dépasser cette dimension caricaturale pour rencontrer un personnage torturé qui attend la mort comme une délivrance parce que sa vie n'a été qu'une succession d'échecs. En attendant cette échéance, il farde ses accès de révolte sous le rire (ou le sourire), ce qui lui permet de supporter le tragique de sa propre existence et on hésite entre quelqu'un qui a effectivement perdu la tête ou au contraire un homme qui, dans un étonnant excès de lucidité, choisit de siffler lui-même la fin de cette récréation dramatique.
J'ai bien ressenti l'empreinte de Pessoa dans ce roman original dans sa présentation et aussi une certaine empathie pour Andrew... et peut-être aussi pour ce jeune auteur (de 77 ans !) rencontré par hasard (La Feuille volante n° 1154 à propos de « Moi, Harold Nivenson ») dont c'est le deuxième roman traduit en français et qui nous livre peut-être, à travers ses livres, un peu de son parcours personnel.
© Hervé GAUTIER – Juillet 2017. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
La Fille du train - Paula Hawkins
- Le 25/05/2017
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1138
LA FILLE DU TRAIN – Paula Hawkins – Sonatine.
Traduit de l'anglais par Corinne Daniellot.
Rachel prend le train deux fois par jour, mais c'est un train très lent qui s'arrête souvent à cause des travaux ce qui lui donne l'opportunité de regarder chez les gens qui habitent le long de la voie. Elle n'est pas tracassée par son travail, puisqu'elle a été licenciée pour ivrognerie mais, pour tromper sa logeuse, continue de faire semblant d'aller travailler à Londres. Elle vit mal son divorce ,sa stérilité, son désir d'enfants et s'abîme dans l'alcool qui est une sorte de consolation. Elle est un peu indiscrète et la solitude qu'elle connaît depuis son divorce avec Tom a sans doute développé chez elle une imagination débordante. Chaque jour elle passe devant la maison d'un couple à qui elle prête une vie idyllique qui n'est pas la leur. Elle les a baptisé Jess et Jason, alors qu'en réalité ils s'appellent Mégane et Scott qui sont voisins de son ancienne maison où Tom, son ex, vit avec Anna, sa nouvelle femme et leur petite fille. L'imagination de Rachel n'a rien à voir avec la réalité puisque Mégane trompe allégrement son mari, finit par disparaître et on retrouve son cadavre.
Le livre refermé j'ai un sentiment diffus et confus à la fois, celui d'avoir assisté, certes à une fiction, mais peut-être pas si éloignée que cela de la réalité tant l'espèce humaine, à la quelle nous appartenons tous, est perverse et complexe. C'est sans doute une déformation personnelle, mais j'ai lu ce roman, pas exactement comme un thriller, mais comme une étude de personnages, leur psychologie, leur comportement les uns par rapport aux autres, ce qui depuis longtemps a nourri la littérature et ce livre n'y fait pas exception. L'action de la police est ici fort discrète ce qui est assez rare dans un roman policier mais le suspens est entretenu jusqu'à la fin grâce à une progression dans le temps, un éclatement des lieux et surtout un dévoilement progressif de la personnalité des principaux protagonistes, trois femmes, Rachel, Anna et Mégane qui racontent leur histoire à la première personne, un peu comme si elles confiaient à un journal intime leurs espoirs, leurs peurs, leurs obsessions... L'auteure elle-même adopte ce ton dès la première page en interpellant son lecteur.
Rachel qui est coutumière d'absences éthyliques, de pertes de mémoire et de conscience, se demande si elle a vu quelque chose au sujet de cette disparition et même si elle n'est pas responsable de cet assassinat, ce qui décuple sa culpabilité. Les investigations policières pataugent, la presse et les réseaux sociaux s'en mêlent, se font l'écho d'accusations et Scott est soupçonné du meurtre de sa femme. Rachel est persuadée du contraire, a même une idée précise sur la question, mène elle-même sa propre enquête, se rapprochant des différents protagonistes, surtout des hommes, mais son addiction à l’alcool fait d'elle un personnage peu fiable que personne ne croit. Ainsi, sans doute pour se déculpabiliser, elle se rapproche de Scott en même temps que d'Anna et de Tom. Rachel est pourtant de bonne volonté mais retombe toujours son penchant pour l'alcool. Elle n'est pas seulement malheureuse, elle est mythomane, hystérique, nymphomane, violente, jalouse du bonheur des autres et incapable d'en avoir pour elle-même, harcèle Tom et sa nouvelle compagne. C'est un personnage complexe, à la fois idéaliste et pervers. Elle est née sous une mauvaise étoile, attire la malchance et fait le vide autour d'elle ce qui exacerbe son imagination et sa culpabilité. Elle est victime des événements, se débat face à l'image peu fiable qu'elle donne d'elle parce qu'elle ne peut se libérer de l'alcool et son imagination l'aide à refaire le monde autour d'elle .
Mégane n'est pas la femme idéale que Rachel a imaginée. Elle se vautre dans l'adultère sans vergogne. Scott est désespéré. Non seulement on l'accuse d'avoir tué sa femme mais il vient de prendre conscience qu'il avait épousé quelqu’un qu'il ne connaissait pas vraiment, qu'elle le trompait sans raison, sans doute pour le plaisir de lui faire du mal et à l'évidence il ne méritait pas cette épreuve. Le lecteur apprend que cette Mégane est une femme bien peu recommandable, qui n'en n'est pas à son coup d'essai et qui fait bien peu de cas de la loi et de la morale.
Anna est maintenant avec Tom et mère d'Evie mais elle regrette le temps où elle était une femme libre, une séductrice qui aimait être désirée, capable de choisir ses amants de passage. Elle est allée avec Tom et a sûrement eu plaisir, en devenant sa maîtresse, à profiter de la vie mais aussi à détruite le ménage et la vie de cet homme pour prendre la place de son épouse, même si Rachel ne l'était déjà presque plus. Pour cela elle ne ressent aucune culpabilité mais on sent bien que son statut de mère de famille ne lui convient pas. Elle aura une sorte de vengeance à la fin puisque petit à petit elle devient elle aussi un peu alcoolique, suspicieuse. A la limite de la paranoïa, elle craint la présence de Rachel et aussi pour son bonheur et pour sa fille. Dans ce catalogue de perversités où chacun espionne et trompe l'autre, je m'omettrais évidemment pas les hommes qui ont leur part de responsabilité.
Le thème du train est particulièrement bien choisi. C'est un lieu de passage obligé pour qui doit chaque jour aller à son travail. On y côtoie des gens qui nous sont étrangers mais qui finissent par nous devenir familiers à force de les rencontrer, mais chacun poursuit sa route, forcément différente de celle de son voisin. C'est l'image de notre société caractérisée à la fois par le mouvement mais aussi par le brassage de populations. Rachel a choisi de regarder par la fenêtre de son compartiment et ce qu'elle voit excite son imagination mais les événements vont la détromper. C'est que l'espèce humaine à la quelle nous appartenons tous est ainsi faite, inspirée davantage par l'hypocrisie, le mensonge et la trahison que par la volonté de faire le bien, elle est soucieuse d'entretenir les apparences qui sont bien souvent trompeuses et qui génèrent et nourrissent suppositions et fantasmes. Ce qui m'a intéressé dans ce roman ce sont les relations au sein du couple. Quand on choisit quelqu'un pour bâtir avec lui des projets dans le cadre d'une famille, on commence par des promesses et des serments auxquels on peut croire de bonne foi mais qui sont bien souvent balayés par le hasard ou la volonté de connaître autre chose, l’excitation de transgresser des tabous et des interdits, la certitude que tout nous est permis, que c'est mieux ailleurs ou la volonté de détruire ce qu'on a mis si longtemps à bâtir, pour le simple plaisir furtif ou celui, plus insidieux de faire du mal à ceux qui ne le méritent pas et dont on veut se débarrasser. Ainsi va-t-on chercher ailleurs ce qu'on a chez soi, bouleversant le fragile ordre des choses sans souci de ceux qu'on laisse derrière soi, les enfants, qui eux pâtissent de la faute des adultes. Seul reste l'être humain dans sa complexité, son individualité, sa solitude, sa volonté de se laisser porter par les événements ou celle au contraire d'y imprimer sa marque, en parvenant à se convaincre que celui à qui on avait juré fidélité et qu'on croyait connaître, n'est là que temporairement et qu'il doit laisser la place.
Le style est vif mais pas très recherché, un peu comme celui d'un polar mais ce que je retiens c'est l'étude psychologique des personnages. Ce fut un moment le lecture un peu mouvementé mais une découverte bienvenue de cette auteure dont c'est le premier roman
© Hervé GAUTIER – Mai 2017. [http://hervegautier.e-monsite.com
-
L'affaire Isobel Vine - Tony Cavanaugh
- Le 21/04/2017
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1128
L'affaire Isobel Vine – Tony Cavanaugh- Éditions Sonatine.
Traduit de l'anglais (australie) par Fabrice Pointeau.
Darian Richard, un ancien inspecteur principal qui a démissionné quatre ans plus tôt et qui s'est réfugié en ermite au bord d'un lac perdu, est retrouvé par le commissaire Copeland Walsh, chef de la police de Melbourne, son ancien patron. Sa démarche est simple, il veut la coopération de Darian pour élucider, par une enquêta rapide, la mort d'Isobel Vine, une jolie jeune fille de 18 ans, morte à la suite d'une fête donnée chez elle à Melbourne, une affaire pourtant « classée sans suite » pour éviter de trancher entre meurtre et suicide, sans doute à cause de la présence de quatre jeunes policiers qui participaient à cette soirée. L'ennui c'est que cette affaire remonte à 25 ans, qu'il y a des connotations politiques, qu'Isobel a été retrouvée nue et étranglée, semant des doutes sur les circonstances de cette mort, que le père de la victime a toujours cru à un assassinat à cause de la présence d'un riche trafiquant et que les flics suspects, devenus des citoyens respectables ont tous été promus, dont un qui espère succéder à Walsh en qualité de commissaire et qu'il faut, sur demande du ministère, laver de tout soupçon ! Ces nominations correspondent-elles au déroulement normal de leur carrière ou à une volonté délibérée d’oublier cet épisode de leur passé ? Tout cela risquait d'être compliqué, l'enquête initiale avait été bâclée, beaucoup de questions étaient restées sans réponse, le fait qu'elle ait été trouvée nue pouvait laisser penser un un jeu érotique qui aurait mal tourné, sans compter qu'elle avait auparavant et naïvement participé à un trafic de cocaïne à l’instigation d'un de ses professeurs qui était aussi son amant, ce qui justifiait la présence des policiers qui poursuivaient leur enquête. Pourtant, par amitié pour Copeland, Darian accepte, parce qu'il penche pour l'assassinat et qu'en découvrir l'auteur, même après tout ce temps, l'excite. Il constitue donc son équipe avec la belle Maria et Isosceles, l'as de l'informatique et des écoutes téléphoniques. La rapidité souhaitée par le commissaire incitera Darian et Maria à prendre des libertés avec la procédure et même avec la légalité...
Les embûches de tous ordres, les difficiles investigations après vingt-cinq ans de silence, la mort du coroner et de son adjoint, la rivalité entre les différents services de police, la corruption, le manque de preuves, les nombreux suspects, les rebondissements, les tentatives d'intimidation, voire d'élimination physique de ces policiers, la perte de mémoire naturelle ou volontaire et la version officielle apprise par cœur de ses événements par les différents témoins, vont rendre cette enquête à retardement difficile mais passionnante, baignée de suspense jusqu'à la fin. J'ai bien aimé les descriptions, les nombreux analepses et le style qui colle bien avec ce genre de thriller agréable à lire. Je l'aime bien aussi ce Darian, un vieux solitaire, misanthrope, rebelle, obstiné et méticuleux, autoritaire quand il le faut, épris de justice, fidèle en amitié mais aussi plein de blessures intimes et qui perd au cours de cette enquête ses dernières illusions.
Je remercie Babelio et les éditions Sonatine de m'avoir permis de croiser cet auteur que je connaissais pas et dont ce roman est le premier traduit en français.
© Hervé GAUTIER – Avril 2017. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Les étoiles s'éteignent à l'aube - Richard Wagamese
- Le 11/02/2017
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1110
Les étoiles s'éteignent à l'aube – Richard Wagamese - ZOE
Traduit de l’anglais par Christine Raget.
Nous sommes à l'ouest du Canada, dans une nature sauvage. Franklin Starlight tout juste âgé de seize ans part avec sa jument à la rencontre de son père, Eldon, quelque part dans un endroit sordide, des retrouvailles au crépuscule de sa vie. Franklin a été élevé par un vieil homme qui lui a tout appris de cette vie sauvage, de cette vie patiente de chasseur, un étranger à qui Eldon l'a confié alors qu'il était enfant. Il n'a que rarement rencontré son père et n'a jamais connu sa mère. Rongé par l'alcool son père va bientôt mourir et veut que son fils l'enterre dans la montagne, comme un guerrier qu'il n'est cependant pas, c'est à dire d'une façon honorable ce qui, dans la tradition indienne lui permettra de connaître la paix dans l'au-delà. Après bien des hésitations, Franklin qui ne sait rien de sa famille interroge son père qui lui révèle des secrets. Eldon profite de des derniers moments pour dire à son fils ce qu'il lui cachait depuis longtemps. Franklin presse de vieil homme de questions, notamment sur sa mère, ne le ménageant pas, discutant ses décisions d'alors, le jugeant gravement un peu comme s'il voulait régler des comptes avec lui. En fait ce dernier voyage en compagnie d'un père qu'il ne connaît pratiquement pas a des accents de parcours initiatique pour le garçon. Il a une attitude contrastée avec le vieil homme, veillant à ce qu'il ne manque de rien mais aussi cherchant à en savoir un peu plus sur cet homme qui lui aussi veut se confier, lui dire ce qu'à été sa vie, son parcours vers l'alcool, ses regrets, ses remords , ses trahisons, ses douleurs intimes, ses obsessions. Cela prend des accents de confession ultime, une quête de pardon.
Les dialogues sont économes en mots, les descriptions empreintes de réalisme, de simplicité et de poésie ; Elles imprègnent le lecteur parce que la nature est le véritable personnage de ce roman. Elle est tour à tour foisonnante, luxuriante, nourricière mais aussi hostile et dangereuse et Franklin a appris du vieil homme à en vivre et aussi à y survivre. ;Au-delà de l'histoire, distillée avec de nombreux analepses, l'intrigue est bien construite et tient le lecteur en haleine jusqu'à la fin sans que l'ennui ne s'insinue dans sa lecture. C'est un roman poignant et émouvant, riche en évocations qui révèlent ce que fut la vie d'Eldon, une succession d'échecs mais aussi de trahisons, comme s'il était marqué par un destin funeste dont il ne pouvait pas se défaire, avec au bout, la déchéance de l'alcool, la solitude, la peur de ne pas pouvoir effectuer ce dernier devoir. Un des thèmes soulevé par ce récit est aussi le métissage, les deux hommes appartiennent à la tribu indienne ojibwé mais ce que je retiens c'est la quête du pardon et les hésitations d'Eldon pour en arriver là, l'amour pour une femme et l'impossible bonheur avec elle, le silence et le secret entretenus pendant toutes ces années autour de la naissance de Franklin. Il y a autour de ce roman une sorte de mystère à l'image des peintures rupestres que le jeune homme croise en emmenant son père pour son dernier voyage, mystère de l'origine du garçon, de son abandon par son père, de la volonté de ce dernier de s'autodétruire face à sa mauvaise étoile, puis de retrouver in extremis son enfant et lui confier le soin de sa sépulture..
© Hervé GAUTIER – Février 2017. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
La musique du hasard - Paul AUSTER
- Le 06/02/2017
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1109
LA MUSIQUE DU HASARD - Paul Auster – Actes sud
Traduit de l’américain par Christine Le Bœuf.
Après avoir hérité une coquette somme d'un père perdu de vue depuis longtemps, Nash, ex-pompier divorcé, entreprend un long voyage sur le territoire des États-Unis, en voiture, seulement guidé par le hasard. Il est libre puisqu'il vient de confier sa fille Juliette dont il a été longtemps séparé, à sa sœur. Après avoir donné un grand coup de balai dans sa vie, son but est de voyager jusqu'à son dernier dollar. Ce qu'il souhaite surtout c'est emprunter les routes peu fréquentées, comme s'il voulait complètement fuir ce monde et confier au seul hasard son itinéraire et ses rencontres. Il y a la musique de Mozart et de Verdi, les femmes et il croise par hasard Jack Pozzi qui est un champion de poker nomade momentanément ruiné mais qui propose à Nash d'investir le reste de son argent dans une partie de poker contre deux milliardaires farfelus que bien entendu il plumera. Parce que les choses ne tournent pas exactement comme prévu, nos deux compères sont sommés de construire un mur pour leurs créanciers. Ces travaux étant presque réalisés Jack s'enfuit, est retrouvé à moitié mort et Nash, en proie à une sorte de folie, finit par se tuer en voiture. Tel est le synopsis de ce roman.
Au départ, j'avoue que je m'attendais à autre chose, avec le titre et la quatrième de couverture, je me serais bien laissé entraîner dans un autre univers créatif. Le hasard tient, si on veut le voir ainsi, une place dans le déroulé de cette tranche de vie de Nash mais ici j'ai pourtant vu beaucoup plus de libre-arbitre que de fatalité véritable. Nash jouit de beaucoup de liberté, symbolisé dans la première partie du roman par la route, à moins que cela ne soit qu'une illusion mais dans la deuxième partie c'est plutôt l'absence de cette liberté qui prévaut (addiction au jeu, obligation de construire le mur puis de rembourser la nourriture) sans que le hasard puisse être vraiment invoqué. Il faut cependant prendre en compte que nous sommes dans une fiction où l'auteur tient la plume et le destin de ses personnages [On pourrait ici parler également de le liberté des personnages de roman mais c'est un autre sujet]. C'est vrai aussi que nous avons là tout l’univers d'Auster où le réalisme le dispute à l'imaginaire et que c'est un terrain sur lequel je suis, à titre personnel, tout prêt à le suivre. De plus, j'accorde une grande place au hasard et contrairement à nombre de mes contemporains, je crois beaucoup à l'impact qu'il peut avoir sur chacune de nos vies. Les deux milliardaires enrichis ont chacun une obsession : Pour l'un c'est un château acheté en Irlande qu'il veut faire rebâtir pierre par pierre chez lui en Amérique, pour l'autre c'est une « cité du monde » une maquette qu'il construit et reconstruit en permanence. Deux folies, deux obsessions où le hasard ne me paraît pas avoir une grande place...Face à cela, il y a cette partie de poker que Nash et Pozzi sont sûrs de gagner mais, est-ce le hasard qui pèse sur les événements et en modifie le cours ou simplement la suffisance et l’assurance un peu trop grande de Pozzi et de Nash? Ce qui m'a frappé aussi c'est la solitude des personnages, Nash et Pozzi et leur rencontre, certes hasardeuse, ne fait pas d'eux des complices. Ils restent seuls jusqu'à la fin, c'est à dire face à la mort. Est-elle l'émanation de notre liberté, du hasard ou du destin, cette question reste posée.
Le contexte de ce roman est très américain. Il y est question d’argent, de poker, de liberté, de grandes réalisations, mais ce roman m'a semblé laisser beaucoup de questions en suspens sur le destin et la liberté individuelle qui sont des sujets philosophiques qui n'ont pas fini de nous interroger. J'ai retrouvé avec plaisir l'art du conteur de Paul Auster ce qui fait de lui, à mes yeux, un romancier majeur. La fin brutale de cette histoire m'a cependant un peu déçu je le trouve un peu convenue, presque prévisible, un véritable suicide d'où le hasard me paraît bien absent.
© Hervé GAUTIER – Février 2017. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
Un bon garçon - Paul Mcveigh
- Le 31/01/2017
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1105
Un bon garçon – Paul McVeigh – Éditions Philippe Rey.
Traduit de l'anglais par Florence Lévy-Paoloni
Mickael Donnelly, dit Mickey, qui est aussi le narrateur, est un garçon de 10 ans, espiègle et surtout bon élève, dans cette Irlande de Nord catholique des années 80. Il est content parce qu'il va quitter l'école primaire et aller dans une « Grammar school », c'est à dire faire le premier pas vers la réussite qu'on lui prédit, et des rêves, il en a plein la tête. Cela lui permettra au moins d'échapper à la misérable réalité qui est son quotidien. Mais sa joie n'est que de courte durée puisqu'il ne tarde pas à apprendre qu'il doit renoncer à ce projet simplement parce que son père a dépensé l'argent de sa scolarité pour satisfaire son penchant pour la boisson. Il ira donc à St Gabriel's, un collège ordinaire fréquenté par ses copains.
Les ennuis de Mickey ne s'arrêtent pas là puisque, depuis toujours il est différent des autres. Il préfère la compagnie des filles mais seulement pour partager leurs jeux, est toujours dans les jupes de sa mère, est très attaché à sa petite sœur Maggie, ce qui le fait passer auprès des garçons pour une « pédale » ce qui n'arrange pas les relations qu'il a avec eux. Malgré ses manières efféminées, sa sensibilité à fleur de eau, sa grande propension à rêver, il fait bien ce qu'il peut pour donner le change avec les filles mais n'a pas plus de chance avec la blonde Martine que pourtant il aime beaucoup ... Il lui reste son chien, son véritable complice et témoin de ses jeux, de ses peurs et de ses fantasmes d'enfant, avec la télépathie et le reste … mais tout n'est pas si simple et la mort s'invite dans ce décor.
Durant les vacances qui le séparent de la rentrée, neuf semaines, il pose un regard d'enfant sur un pays en guerre, occupé par les Anglais et tourmenté par les protestants, une atmosphère de violence urbaine avec l'ombre de l'IRA, bref, la mort omniprésente en menace ou en réalité. Il est sympathique ce petit Mickey, perdu dans un monde hostile et marqué par la pauvreté, constamment sur ses gardes et qui se réfugie chaque fois qu'il le peur dans un ailleurs qui ressemble à L' Amérique, à l'avenir. L'atmosphère qui règne au sein de sa famille ne vaut guère mieux, avec ce père qui finira par s'enfuir, son frère qui le malmène et l'enfant qu'il est se tourne vers Dieu pour un surréaliste et cruel monologue avec Lui. Mais Il restera sourd et muet devant ses aspirations et ses espoirs. Dans cette Irlande catholique il est directement sujet à cette culpabilisation judéo-chrétienne qui le taraude et pourrit chaque moment de sa vie.
C'est une réalité dure et violente vue à travers un regard d'enfant mais la manière de l'écrire m'a un peu dérouté.
© Hervé GAUTIER – Janvier 2017. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
Au fond des bois - Karin Slaughter
- Le 12/01/2017
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1100
AU FOND DES BOIS – Karin SLAUGHTER – Harper Collins Noir.
Traduit de l’américain Emmanuel Plisson.
Léna Adams est policière à Macon (Géorgie-USA) Un soir, elle est agressée à son domicile et Jared Long, son mari également policier, est touché gravement et son pronostic vital est engagé. Léna, perdant tout contrôle, tue un de ses agresseurs. Une telle agression entraîne une enquête interne sur Léna et Jared et elle pourrait bien trouver son explication dans les affaires traitées par Léna ou par son mari et notamment cet assaut contre la maison d'un mafieux auquel a participé Léna. Les investigations s'annoncent difficiles d'autant que tous ne disent pas la vérité, gardent le secret sur leurs informations au lieu de partager et on pense que tout est de la faute de l’enquêtrice. Ce n'est que ce n'est pas la première fois qu'elle fait l'objet d'une telle procédure et c'est un peu comme si elle provoquait la mort de ceux qui l'approchaient. Il se trouve que celui a qui a déjà enquêté sur elle, Will Trent, un flic qui agit sous couverture, était présent sur les lieux de cette agression et a empêché Léna de tuer le deuxième assaillant. Les recherches s'orientent vers celui qui se fait appeler Big Whitley, un pédophile, proxénète et trafiquant de drogue, une vieille connaissance de Will et dont le repère se situe au fond des bois. Les personnages qui hantent ce récit sont multiples [une liste aurait sans doute été opportune en début de récit], leurs liaisons, leur histoire personnelle et professionnel se croisent et s'entrechoquent avec la mort qui parfois les emporte. Ceux qui restent vivent leur deuil comme ils peuvent et la résilience n'est pas forcément au rendez-vous.
Tout y passe, les scène gores, les techniques policières avec les détails médicaux ainsi qu'un minutage précis de l'agression, les références à la Bible si prisée des Américains, les analepses un peu déroutants pour le lecteur, les luttes d'influence et les oppositions entre les différents protagonistes, les ripoux, des trafics, l'opposition manichéenne incontournable ... L'accent est mis sur le couple Léna-Jared, leurs relations sont difficiles, un peu comme celles d'un vieux couple que la venue d'un enfant pourrait ressouder. Léna est un personnage complexe, à la fois forte et fragile, inconsciente face au danger, imprévisible, seule et rongée par la culpabilité, toujours tentée de faire « cavalier-seul » dans son travail et là c'était Jared qui avait payé, un peu comme si les assaillants avaient voulu la frapper à travers l'homme qu'elle aimait, mais elle n'aimait réellement personne ! Elle a un peu l'impression de revivre, toutes choses égales par ailleurs, l'épisode qui a coûté la vie à Jeffrey, son coéquipier et le mari de Sara, médecin hospitalier et ancien légiste, il y a cinq ans. Les rapports entre les deux femmes sont difficiles à cause de ce passé délétère. Elles le sont aussi pour Will qui a partagé la vie de Sara après la mort de son époux.
Je remercie Babelio et les éditions Haper Colins de m'avoir permis de découvrir l'univers créatif de Karin Slaughter et ce roman qui se lit bien, un thriller violent dans le style comme dans les dialogues mais où se mêle des passages agréablement écrits. Il distille jusqu'à la fin un suspens de bon aloi mais qui laisse cependant la place à une réflexion personnelle sur le pardon et la culpabilité, ce qui donne à ce roman une dimension différente et inattendue.
© Hervé GAUTIER – Décembre 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
Aux portes du royaume animal. - Amy HEMPEL
- Le 10/08/2016
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n°1061– Août 2016
AUX PORTES DU ROYAUME ANIMAL – Amy Hempel – Éditions Cambourakis.
Traduit de l'américain par Simone Manceau.
Il m'arrive de choisir mes lectures au hasard laissant à ce dernier le soin de me faire découvrir un auteur inconnu. Ce jour là, ce fut un recueil de nouvelles d'Amy Hempel, auteure américaine dont je ne savais absolument rien. D'autre part, j'aime bien l'univers des nouvelles, elles distillent une atmosphère parfois un peu mystérieuse à travers un thème traité et illustré souvent avec une étonnante diversité. La préface de Véronique Ovaldé faisait allusion à Chuck Palahniuk , auteur également américain, roi, selon elle, de « la fiction illimitée » et qui a permis, aux États-Unis de faire découvrir Amy Hempel. Grâce à cette « filiation », elle caractérise l'écriture de notre auteure par « la science de l'exagération et du mensonge », ce qui est un thème de réflexion intéressant et bien de nature à engager ma lecture. La préfacière voit dans l'écriture d'Amy Hempel une science délicate, la compare à des « conversations d’insomniaques ». Ses personnages sont presque toujours des femmes ce qui peut sans dénoter davantage d'êtres perdus, blessés, hantés par quelque d’obsédant. Cela dit, le phénomène de l'écriture est en effet complexe, combinant dans les proportions parfois étonnantes l'évocation du réel et les fantasmes les plus inattendus, l'imagination la plus décousue , le tout enveloppé dans un délire verbal... Reste la création qui, si on veut le voir ainsi, peut parfaitement être regardée comme un mensonge. L'inspiration, d'où qu'elle vienne, prend effectivement des libertés avec la réalité, avec la vérité objective, mais il n'y a rien là d'extraordinaire puisque c'est en quelque sorte son domaine privilégié.
Ma découverte a été totale, comme d’ailleurs ce genre d'écriture débridée qui caractérise ses seize nouvelles. On croit entrer dans une histoire, s'y intéresser, mais, rapidement, celle-ci part dans un autre sens qu'on a peut-être un peu de mal à découvrir au début puis à suivre ensuite tant le cheminement est compliqué et peut-être exagéré. Est-ce l'attrait de la nouveauté, peut-être aussi l'espoir un peu fou de découvrir un fil conducteur des textes lus, j'ai poursuivi ma lecture jusqu'à la fin parce que j'ai fait ce que je pouvais pour que ce livre ne me tombe pas des mains, histoire de voir combien de temps mon appétit de découverte allait durer. J'ai été intrigué par une phrase d'une des nouvelles où l'auteure fait dire à un de ses personnages «J'exagère pour que vous appreniez à me connaître plus vite ». Même après réflexion, cela ne me paraît pas forcément être un chemin de la connaissance bien fiable, à moins que … et cette façon de manier le mensonge, de camoufler ce qui peut être la réalité sous des dehors quelque peu exubérants est peut-être une manière de cacher une fêlure...
Je ne suis pas pour autant de ceux qui sont prompts à s'extasier devant une œuvre d'art au seul motif qu'ils n'y ont rien compris et qu'il convient, pour sortir du lot des amateurs parfois dubitatifs mais qui se veulent inspirés, de la porter aux nues. Mais quand même, je n'ai pas compris grand-chose à toutes ces histoires échevelées, je n'en ai pas retenu grand chose non plus à part peut-être le sentiment d'être passé à côté de quelque chose qui m'a complètement submergé par son mystère, son imagination créatrice et sa manière de les exprimer. Mais après tout on s'extasie bien devant les tableaux surréalistes même si j'ai du mal cependant à être de ces admirateurs !
Le livre refermé, il me reste un grand point interrogation sur l'auteure d'abord dont je n'ai sûrement pas été capable de goûter le génie créateur, sur moi-même ensuite, sans doute trop habitué par mes lectures à n'apprécier que ce qui est classique ou prétendu tel. Je ne sais pas.
Peut-être reviendrai-je vers cette auteur, peut-être pas ?.
© Hervé GAUTIER – Août 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com
-
Nature morte - Louise Penny
- Le 17/04/2016
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n°1032– Avril 2016
NATURE MORTE– Louise Penny – Actes Sud.
Traduit de l'anglais (Canada) par Michel Saint-Germain.
Three Pines est un petit village québécois bien tranquille où il ne se passe rien. Pourtant un jour d'automne, le dimanche de Thanksgiving, on y retrouve le cadavre de Jane Neal, 76 ans, enseignante à la retraite et peintre du dimanche. Cela a beau être la période, il est rapidement évident que ce n'est pas un accident de chasse. Le plus étonnant est sans doute que le meurtre a été commis avec une flèche qui n'a cependant pas été retrouvée. Jane était bien la dernière personne qu'on aurait voulu assassiner, elle connaissait tout le monde, on l'aimait bien au village et elle dirigeait une association locale liée à l'église anglicane. C'est bien ce que s'est dit l'inspecteur-chef Armand Gamache de la Sûreté du Québec à qui a cette enquête a été confiée. Il est assisté de l’inspecteur Beauvoir et de l'agente Yvette Nichols. Certes, quelques jours avant, il y avait eu une sélection pour une exposition de peinture et une toile de Jane avait fait scandale, mais quand même, on n'exécute pas quelqu'un pour un tableau ! Quoique ! C'est vrai que si elle avait peint tout au long de sa vie, elle n'avait jamais voulu qu'on vît ses œuvres et « Jour de foire », sa toile sélectionnée pour l'exposition, à la fois innocente et naïve dans sa facture, était la première ainsi révélée au public. Elle comportait peut-être un message ? Il y a des investigations policières et tout le village y passe. Le lecteur fait ainsi connaissance de ses habitants entre un couple d'homosexuels, des artistes Clara et Peter, amis de Jane, un rentier, des adolescents … le lecteur pénètrent ainsi leurs secrets intimes mais ils sont tous, aux yeux de Gamache, des suspects potentiels. On soulève des questions d'intérêt, d'héritage, de trahison, de malveillance, de vengeance , bref tout ce que la condition humaine a de plus sordide, avec cette évidence contenue dans l’Évangile de Matthieu X, 36 « On aura pour ennemis les gens de sa famille »
Au long de ce roman, on s'attend à ce que l'auteur de ce meurtre bien mystérieux soit un chasseur étranger à cette commune ou peut-être un enfant du pays. On balance entre l’accident de chasse et un tir intentionnel ou bien encore une vengeance d'adolescents que Jane aurait réprimandés… Certes j'ai apprécié d'en apprendre un peu plus sur les coutumes et le mode de vie québécois, sur cette rivalité ancestrale entre les communautés anglophones et francophones, j'ai goûté l'humour de l'auteure et ses descriptions de la nature mais surtout il m'a semblé qu'il y avait beaucoup de longueurs, des pistes volontairement embrouillées ce qui entretient certes le suspens, mais je me suis un peu ennuyé à la lecture de ce roman. De plus cet inspecter Gamache ne me plaît guère non seulement j'ai eu un peu de mal à suivre son raisonnement mais surtout je n'ai guère apprécié son attitude à l'endroit de l'agente Yvette Nichols, sa subordonnée.
C'est vrai que dans ce petit village tout le monde s'observe et on connaît facilement les secrets de l'autre. La thématique du tableau renfermant un mystère était plutôt une bonne idée, mais je m'attendais à autre chose. Je respecte infiniment le travail d'écriture et de recherche de l'auteur mais j'ai quand même été un peu déçu.
Je voudrais cependant noter la dernière phrase des « remerciements » qui m'a paru émouvante, même si elle n'a rien à voir avec cette intrigue : « Il fut un temps dans ma vie où je n'avais aucun ami, où le téléphone ne sonnait jamais et où j'ai cru mourir de solitude. Aujourd'hui, je sais que la véritable bénédiction n'est pas d'avoir fait publier un livre, mais d'avoir autant de personnes à remercier »
Ce roman a été adapté sous forme d'un téléfilm canadien en 2013.
© Hervé GAUTIER – Avril 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
Edward Hopper - Les 100 plus beaux chefs-d’œuvre
- Le 04/03/2016
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n°1020– Mars 2016
Edward Hopper - Les 100 plus beaux chefs-d’œuvre – Rosalind Ormiston – Larousse.
Cet ouvrage richement documenté retrace la biographie d'Edward Hopper (1882-1967) qu'on retrouve dans tous les livres qui lui sont consacrés. Son originalité vient sans doute de la rétrospective effectuée par thèmes avec des illustrations.
C'est en France, lors de son premier séjour qu’il prend l'habitude de peindre en extérieur, à cause, selon lui, de la lumière parisienne, différente de ce qu'il avait connu jusque là. Quand il revient à New-York ce sont pour autant des scènes d'intérieur qui monopolisent sa palette où le spectateur joue, malgré lui, le rôle d'un indiscret. Le décor intérieur est pratiquement inexistant, soulignant l'impression de vide. Il reviendra cependant aux scènes extérieures à partir de son installation à Greenwich village, représentant des paysages urbains, les cafés notamment, avec la lumière du soleil sur les bâtiments. Je note que bien qu’ayant longtemps habité New-York, il n'a que très rarement représenté les gratte-ciel, préférant les immeubles de style victorien. Il développera ce thème lors de ses fréquents séjours au cap Cod, peignant des maisons basses et renouant avec son inspiration de jeunesse pour les bateaux, les bords de mer et les phares qui sont peut-être pour lui un symbole de liberté. Il y réside souvent au printemps ou en été, y fait construire une maison et favorise des vues de la campagne ou du littoral. Il voyagea beaucoup avec son épouse, notamment dans le sud et au Mexique d'où il rapportera des toiles et des aquarelles de paysages. Ses voyages ont suscité chez lui un thème particulier que sont les trains, les voies ferrées et les routes. Pourtant, si ce sujet peut être l'invite au départ, voire à la fuite, il n'en porte pas moins un message de solitude et de vide caractéristique de sa peinture. Il s’intéressera également à la vie moderne à travers toiles, aquarelles et aussi eaux-fortes mais il se dégage toujours des personnages qu'il choisit de représenter une sorte de morosité et d'ennui. Architecturalement, il représente ce qu'il voit, c'est à dire un décor essentiellement américain, mais les maisons qu'il donne à voir sont souvent vides et très rarement complétées par une représentation humaine.
Il peint des nus féminins, souvent dans le huis-clos d'une chambre, mais ces tableaux n'ont rien d'érotique et cela tient sans doute à son éducation puritaine. Son épouse sera d’ailleurs son seul modèle pendant toute sa vie. Quand il représente des femmes, habillées ou non, elles souvent seules, peut-être dans l'attente de quelqu’un ou de quelque chose, actrices d'un récit inachevé… Les hommes seuls sont plus rarement représentés, quant aux couples, il s'en dégage une atmosphère pesante qui était sans doute l'image de celui qu'Edward formait avec Joséphine, son épouse. Quand Hopper choisit de peindre des groupes de personnes, on sent imperceptiblement qu'il exprime surtout la distance qui existe entre eux.
Il s'intéressera, notamment à partir de 1942 et de son tableau «Les oiseaux de nuit » (son préféré, à la vie nocturne mais vue à travers des fenêtres ou des devantures de cafés, avec une sorte de tendance marquée pour le voyeurisme. On a déjà souligné que ses toiles tiennent beaucoup de l'instantané photographique ( Il semblerait d’ailleurs que Hopper ait beaucoup travaillé à partir de photographies) mais elles distillent cependant une lourde sensation de solitude et de vide bien qu'elles représentent des paysages urbains qu'on s'attendrait à voir peuplés de gens et de mouvement.
L'étonnant est que Edward Hopper ait traversé, sans les assimiler et sans qu'elles ait laissé la moindre trace sur sa façon de peindre, les périodes de la peinture expressionniste abstraite, du cubisme et du pop'art. Seul impressionnisme français l'a un temps inspiré, sans oublier le réalisme de Courbet, de Rembrandt et la pratique de son métier de d'illustrateur de magazines (activité alimentaire qu'il détestait cependant). Après avoir recherché le succès, il se présenta enfin, faisant de lui un artiste reconnu, emblématique de la peinture réaliste américaine. Son influence sera cependant déterminante sur les peintres américains tels que Andrew Wyeth (1917-2009) ou Eric Fischl notamment. On sait aussi que le cinéaste Alfred Hitchcok (1899-1980) s'inspira de certains de ses tableaux (notamment de « Maison près de la voie ferrée » dans son célèbre thriller « Psychose »). A titre personnel, je note également que l’écrivain français Philippe Besson fait souvent référence à Edward Hopper dans son œuvre et notamment dans son roman « L'arrière saison » [La Feuille Volante n° 604 -Décembre 2012] où il s’inspire du tableau intitulé « Les oiseaux de nuit ».
Pour autant, le mystère qui entoure son œuvre austère, simple et surtout figurative et réaliste, invite à l'interprétation toujours difficile et ce d'autant plus que Hopper était un adepte de Baudelaire qui privilégiait la « vision intérieure », issue de l'imagination. Ses séjours en Europe et l'étude qu'il fit de ses peintres ne sont pas étrangers à son style original. Cet ouvrage abondamment documenté et très pédagogique apporte un éclairage intéressant sur l’œuvre d'Edward Hopper que personnellement je ne me lasse pas de découvrir.
© Hervé GAUTIER – Mars 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
Edward Hopper - Gerry Souter
- Le 04/03/2016
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n°1019– Mars 2016
Edward Hopper - Gerry Souter – Parkstone international.
Traduit de l’américain par Aline Jorand.
Je ne sais pas pourquoi, moi qui ne suis pas spécialiste de la peinture en général, et de la peinture américaine en particulier, je ressens pour Edward Hopper (1882-1967) une véritable fasciation. Aussi bien quand je découvre un livre qui lui est consacré, je ne manque pas de le lire avec intérêt.
L'auteur le présente à travers sa biographie, insistant sur ses origines modestes et sur le rôle de ses parents, de sa mère surtout qui a su favoriser sa vocation artistique. Son éducation a été fortement marquée par les femmes (sa mère et sa grand-mère) et cela se retrouvera dans son œuvre. Il note que son éducation victorienne complétée par une empreinte puritaine et religieuse (son arrière-grand-père, le révérend Griffiths a fondé l'église baptiste de la petite ville de Nyack (État de New York) où il est né – Edward ira à l'école privée) qui prône une vie austère, recommande de s'éloigner des plaisirs de la sexualité et des comportements immoraux. Cela développera une timidité naturelle qui, bizarrement, sera contrebalancée par un réel sens de l'humour. Cette formation ne sera pas sans influencer sa peinture et quand il représente des femmes, même si elles sont nues, il n'y a pas de dimension érotique. Je note également que après son mariage avec Joséphine, celle-ci sera son unique modèle. Dans certaine de ses toiles, surtout celles où il représente des chambres ou des bureaux il y a cependant une sorte de voyeurisme.
S'il a fréquenté des écoles de dessins, et notamment la New York School of Art, s'il s'est perfectionné par l'étude des impressionnistes français présents dans les musées américains et en France même où il fit trois séjours, il commença son apprentissage en copiant de façon empirique, très jeune, des couvertures de magazines. Ses séjours à Paris ne se confondent d'ailleurs pas avec la vie de bohème qu'on peut imaginer chez un jeune peintre et il en rapporte nombre de tableaux dans la manière impressionniste qui n'apparaissent malheureusement pas dans les illustrations de cet ouvrage.
Ce que je retiens ce sont les débuts difficiles de Hopper et toute sa vie sera rythmée par l’alternance du succès et de l'échec, l'obligation de gagner sa vie comme illustrateur, ainsi que de la sécheresse artistique passagère ce qui ne sera pas sans influencer son équilibre personnel. Il sera en effet souvent sujet à la dépression. A partir de 1923 cependant, date à laquelle il rencontre Joséphine qui va devenir son épouse, la chance semble lui sourire et, petit à petit, il devient un peintre connu et reconnu. Pourtant sa vie sentimentale sera des plus agitée, émaillées par de violentes disputes avec sa femme qui pourtant choisira de mettre sa carrière artistique personnelle entre parenthèses mais en ressentira une sorte de complexe d'infériorité. Edward semble ne pas avoir été heureux en ménage et il en concevra une profonde solitude qui ressort sur la plupart de ses toiles, notamment au niveau des personnages et des paysages. Les époux voyageront pourtant souvent ensemble, notamment au Mexique mais cet ouvrage ne publie aucune des toiles réalisées dans ce pays. Ils achèteront une maison au cap Cod et Edward renouera alors avec l'inspiration de la mer et des bateaux qui avait été la sienne, très jeune, à Nyack quand il fréquentait les chantiers navals et le « Boys Yacht Club ». Ce thème du voyage, incarné par les bateaux, les trains et les routes me semble également dénoter une sorte de volonté de départ, de fuite, l'envie d'un ailleurs qu'on ose cependant pas pas tenter. Les phares auront aussi une grande influence sur sa peinture.
Il affectionne également les paysages urbains, les trains ou les maisons isolées mais je note que s'il vécu et travaillé à New York, il ne représenta que peu de gratte-ciel pour se concentrer plutôt sur les maisons de style victorien avec toujours, peu ou prou, cette impression de solitude, de vide, d'attente de quelque chose qui n'arrivera peut-être pas. Cette idée d'isolement persiste même si le tableau représente un groupe de personnages et se retrouvera dans les oeuvres qu'il consacrera aux salles de théâtres ou de cinéma, aux chambres ou aux halls d’hôtels. Je ne suis pas spécialiste de ce peintre mais je ressens sa peinture comme une activité de compensation face à une vie qu'il supporte plus qu'il ne l'apprécie. Sa dernière toile, « deux comédiens », semble vouloir nous dire qu'il a fait son parcours aux côtés de son épouse, comme s'il avait joué un rôle, grimé en acteur, et trouvé dans celui-ci une raison d'exister.
Hopper est un peintre figuratif qui n'a guère changé de style. Il a du également lutter contre l'expressionniste abstrait très en vogue à son époque mais son style n'a jamais vraiment varié si on excepte sa période impressionniste.
Cet ouvrage complète l'étude entamée depuis de nombreuses années sur ce peintre emblématique américain. Il m'a prêté un bon moment de lecture.
© Hervé GAUTIER – Mars 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
La villa - Peter Nichols
- Le 29/02/2016
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n°1018– Février 2016
La villa - Peter Nichols - Éditions Nil.
Traduit de l’américain par Sarah Tardy.
Malgré son récent AVC, Lulu Davenport ne fait pas ses 80 ans et paraît encore jeune. Elle tient encore son petit hôtel, la villa « Les Rochers » à Majorque fréquentée par des habitués. Gérald Rutledge est écrivain, ne fait pas vraiment dans le best-seller et vivote de sa production d'olives. Il est en moins bon état mais leurs différences ne s'arrêtent pas là. Ces deux-là, s'ils se sont évités pendant cinquante ans se retrouvent ici par hasard et vont mourir ensemble, un peu bêtement d’ailleurs : Nous sommes en 2005. Tel est le point de départ de ce roman qui, bien qu'il se passe au soleil de Majorque et évoque la légèreté et farniente, les bougainvilliers et les oliviers, va promener le lecteur dans les lourdes arcanes du temps.
A l’aide de nombreux analepses qui déroutent un peu le lecteur, l'auteur va recomposer la vie de Lulu et de Gérald qui ont jadis été amoureux l'un de l'autre, se sont mariés en 1948 puis ont rapidement mis fin à leur bref mariage tout en demeurant à Majorque. Nous ne saurons qu'à la fin ce qui a motivé une si brève union mais franchement je n'ai pas vraiment ressenti le suspens qui aurait pu être entretenu tout au long de ce roman tant les apartés sont multiples qui diluent un peu l'intérêt tissé a départ.
La 4° de couverture annonce la couleur « Sexe, mensonges et Martini... » C'est à peu près le résumé de ce roman où tout semble être artificiel et superficiel. Ici, les individualités, les désirs, la luxure, l'adultère et le destin s'entrechoquent. Alors qu'entre les autres personnages c'est plutôt une ambiance de légèreté qui prévaut, il y a beaucoup de non-dits, de secrets de famille en suspens depuis un demi-siècle entre Lulu et Gérald, une atmosphère lourde et sombre qui n'a fait qu'enfler avec le temps, cette impression malsaine de quelque chose qu'on regrette, des erreurs ou des malentendus, un abcès qu'on n'a pas crevé et qui ont fait d'eux des ennemis intimes. Tout cela tranche évidemment avec les paysages ensoleillés de l’archipel. Il y a eu leur vie après leur divorce, leur mariage respectif, la personnalité de leur conjoint, le deuxième divorce de Lullu et le veuvage de Gérald, les enfants qu'ils ont eu séparément puis les enfants de ces enfants et les relations qu'ils ont entretenues ensemble. Il y a Luc, le fils de Lullu, un cinéaste un peu rêveur mais bien mal inspiré, un époux pas très fidèle cependant, Aegina, la fille de Gérald, femme d'affaires efficace avec Charlie, son fils adolescent. Pour Luc, Aegina qui est assurément amoureuse de lui est la seule femme qu'il ait jamais aimée, mais il est à la fois maladivement timide et par trop maladroit, à cause peut-être de ce qui s'est passé jadis entre Gérald et Lullu. Ces deux enfants ont un passé commun mais qui n'a rien à voir avec l'histoire de Lullu et de Gérald.
Il y a beaucoup de personnages dont l’histoire nous est racontée ici sur trois générations. Cela pouvait donner l'occasion d'une saga passionnante mais j'ai noté pas mal d’apartés (notamment l'accident de Luc, passé par dessus bord qui, s'il est un peu émouvant au début, n'en est pas mois assez invraisemblable) qui, à mon sens, sont autant de touches inutiles. Cela a rendu ma lecture laborieuse et même carrément ennuyeuse, seulement motivée par l'engagement que j'avais pris de fournir un commentaire à la suite de l'envoi gracieux de Babélio et des éditions du Nil que je remercie de m'avoir sélectionné. Pourtant, vers le milieu du livre (le roman fait quand même près de 500 pages) mon attention a été attirée par le personnage de Gérald. C'est un écrivain fasciné par l’Odyssée d'Homère et dont le livre « Le chemin vers Ithaque » évoque le voyage initiatique d'Ulysse qui met dix années d'épreuves avant de revenir vers son île après la fin de la guerre de Troie. C'est aussi une véritable tragédie qui examine les conséquences d'un instant sur les générations suivantes. Gérald est aussi un marin qui a pas mal bourlingué en Méditerranée et qui a débarqué un jour à Majorque pour ne plus la quitter à cause du magnétisme que cette île opère sur lui. Il reste en effet attaché à ces quelques arpents d'une oliveraie qu'on veut lui faire vendre en vue d'une opération immobilière juteuse où, évidemment il laissera des plumes.
C'est le second roman de Peter Nichols, inconnu de moi jusqu'à ce jour. Il se peut que je sois passé à côté d'un chef-d’œuvre mais, le livre refermé, je dois dire que j'ai été assez déçu par ma lecture.
© Hervé GAUTIER – Février 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
VIVANT, OÙ EST TA VICTOIRE ? - Steve Toltz
- Le 24/01/2016
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
La Feuille Volante n°1007– Janvier 2016
VIVANT, OÙ EST TA VICTOIRE ? Steve Toltz – Belfond.
Traduit de l'anglais (australien) par Jérôme Schmidt.
D'emblée, le titre m'a évoqué un roman de Daniels Rops (« Mort, où est ta victoire? »), mais ce roman publié en 1934 n'a rien de commun avec celui que Babelio et les Éditions Belfond m'ont fait parvenir, ce dont je les remercie. Liam Wilder est un flic cynique, égaré dans la police parce qu'il faut bien vivre surtout quand on est chargé de famille et qu'on a manqué sa vocation d'écrivain. Les gens pressés appellent cela «un écrivain raté » et la société, même en Australie où se déroule ce roman, en compte beaucoup. Cela ne l'empêche pas d'avoir des amis dont un en particulier, Aldo Benjamin, « vieille connaissance de lycée », qui est pour le moins encombrant, mais l'amitié, surtout dans son cas est un lien sacré ! Pourtant, Liam prend son ami comme prétexte littéraire mais l'inspiration qui pourrait prendre sa source dans leur vieille amitié, tarde à venir. Il est vrai que, comme modèle de farfelu et de guignon, Aldo, est vraiment un parangon. Dès son adolescence, la malchance qui sera la compagne de toute sa vie, se signale et s'incruste. Il est accusé de viol alors qu'à l'évidence, il est encore puceau, plus tard, il sera à nouveau accusé de viol, mais sur la personne d'une pensionnaire de bordel ! Toute sa vie il sera d'ailleurs un lamentable amant, celui dont ses partenaires féminines n'aimeront pas se souvenir, même si lui, au contraire est plutôt sujet aux fantasmes en ce domaine. Puis il deviendra le chef de nombreuses entreprises dont les buts commerciaux étaient des plus surréalistes et dont la courte vie n'eut d'égal que l'impécuniosité… Aucune n'échappa à la faillite et cet ancien taulard qui rate décidément tout ce qu'il entreprend, y compris évidemment son mariage, s'est mis en tête, alors qu'il est paraplégique, de faire su surf et de s'exiler volontairement sur un îlot solitaire ! Même son unique tentative de suicide est un échec, elle le cloue sur un fauteuil roulant mais aussi tue un enfant, ce qui l'envoie en prison. La deuxième partie du roman est consacrée à la démonstration faite par Aldo devant le tribunal qu'il n'a pas pu tuer son amie Mimi comme il en a été accusé alors qu'il était en libération conditionnelle. Décidément, ce pauvre Aldo n'est pas à sa place en ce monde !
De son côté Liam fait le point sur sa vie, et lui, l'artiste manqué, en épelle les détails, depuis son mariage précipité par le hasard et qui s'est révélé désastreux, jusqu'à ce regard désabusé qu'il porte sur l'écriture dont il sait qu'elle ne lui apportera pas le succès, ausculte son histoire pourtant banale et la biographie d'Aldo qui elle l'est un peu moins pour y puiser son inspiration mais finalement, après pas mal de doutes et de tentatives ne rencontre que la catastrophe et s'insère, un peu malgré lui dans la vie active... comme officier de police, travail honni, mais qui lui permet de faire vivre sa famille ! Cela nous réserve pas mal d'aphorismes bien sentis sur sa vie ratée et sur l'art.
C'est vrai que nos deux compères se ressemblent, sont deux authentiques losers, qui, l'un comme l'autre accumulent les échecs, je devrais même dire en font la collection. Rien d'étonnant donc que ses deux-là se soient rencontrés. Dès les premières pages, le dialogue entre Liam et Aldo est pour le mois surréaliste et sans vraie suite, mais est réellement jubilatoire. Cela déconcerte mais atteste de l'imagination débordante et de drôlerie de l'auteur qui s'est fait connaître pour cela lors de ses romans précédents, notamment « Une partie du tout »[2009]. C'est un texte un peu déjanté, riche en rebondissements, mais ce que je retiens de ce roman c'est la noirceur et la cruauté de la vie, de la condition humaine, l'hypocrisie d'une société déshumanisée, l'enfer des prisons au quotidien. Certains passages, celui où Aldo converse avec une voix censée être divine, organe d'un improbable dieu bien lointain et bien étrange, m'ont paru, certes pertinents, mais surtout un peu fastidieux. Alors, au vu de ces deux exemples, la vie est-elle belle, comme on nous en rebat les oreilles bien trop souvent et cela vaut-il le coup de la faire prévaloir sur la mort. On peut se poser la question ainsi que semble le faire le titre de cet ouvrage !
© Hervé GAUTIER – Janvier 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
FEMME AU FOYER - Jill Alexander Essbaum
- Le 06/12/2015
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°996– Décembre 2015
FEMME AU FOYER – Jill Alexander Essbaum – Albin Michel.
Traduit de l'américain par Françoise du Sorbier.
Anna est une jeune zurichoise d'origine américaine, mère de famille de 37 ans un peu déracinée, perdue dans une Suisse adoption, dépressive mais qui s'occupe de ses trois enfants et de Bruno son mari, par ailleurs banquier, bref « une bonne épouse, dans l'ensemble ». Elle passe donc sa vie dans une sorte de cocon confortable même si celui-ci génère pour elle une sorte d'ennui, de solitude, une forme de bovarisme que la psychiatrie peine à guérir et à expliquer à travers l'interprétation de ses rêves et les révélations qu'Anna distille avec parcimonie. Cela c'est pour les apparences qu'on aime, en Suisse comme ailleurs, faire prévaloir surtout si elles cachent quelque turpitude, ni plus ni moins que de l'hypocrisie.
C'est que, quand une femme a ce qu'elle peut espérer de la vie, elle cherche évidemment autre chose et souvent cela prend la forme classique d'un amant, souvent un inconnu qui ne fera qu’un bref passage dans sa vie. Anna n'échappe pas à cela, elle dont la jeunesse était peuplée de fantasmes érotiques, de volonté de séduction et dont le mariage s'est peu à peu enlisé dans la routine, la facilité et la dépendance financière ; Cet épisode sonne donc comme un point de passage obligé, inévitable. Ici on sent bien que tous ces amants n'ont aucun attachement sentimental pour Anna. Ils ne ressentent rien d'autre pour elle que des envies bestiales [il y a dans ce roman des images, des scènes à la limite de la pornographie]. De son coté, Anna est passive et on a l’impression qu'elle vit ces relations, non pour se donner l'illusion de la jeunesse et de la séduction retrouvées, mais pour pimenter une vie familiale étouffante, pour se dire qu'elle a tout simplement des amants, qu'elle vit des situations dont toute femme mariée rêve parce qu'elle transgresse un interdit, qu'elle veut se faire peur, souhaite inconsciemment être découverte ou simplement veut explorer un terrain inconnu et peut-être fascinant. A aucun moment, je n'ai senti Anna vivant ces toquades dans le seul but de changer radicalement de vie et d'épouser ses amants. D'ailleurs le destin de telles liaisons amoureuses est de s'inscrire dans un temps très court, d'être vouées au seul plaisir sexuel mais dans le secret espoir qu'elles ne bouleversent pas par un divorce puis un remariage une vie établie. C'est un peu comme si Anna, ayant tourné la page de ces « moments », souhaitait revenir au bercail, comme si rien ne s'était passé. Il est évident qu'une telle séquence ne peut pas ne pas laisser de traces et qu'il est évidemment tentant de faire porter à son mari la responsabilité de ses propres trahisons, surtout si elle n'a rien de véritablement important à lui reprocher et si elle fait bon marché de sa culpabilité. Dès lors on se perdra en conjectures sur les raisons d'une telle attitude adultère. Est-ce la volonté de tout détruire autour d'elle, de ridiculiser un mari trop amoureux d'elle ou trop confiant au point de ne rien voir de son cocuage, de se singulariser par rapport à la famille traditionnelle, d'hypothéquer l'avenir, de faire dans la provocation, de vivre quelque chose de différent, d'entrer de plain-pied et de s'installer dans une situation délétère qui ne peut, à terme, que se retourner contre elle et saper durablement l'avenir de ses propres enfants ? Il est évidemment préférable de ne rien expliquer et de poursuivre cette attitude nuisible, en se disant que seules comptent sa propre liberté et son envie de jouir de la vie et que le reste n'a aucune importance même si tromper son mari c'est aussi se moquer de ses propres enfants. Cette situation met certes Anna en face de son dégoût d'elle-même, de ses faiblesses, de sa passivité, de sa volonté irrationnelle de sanctionner ses proches et la révèle telle qu'elle est, un nymphomane prête à écarter les cuisses pour le premier venu et à en garder le secret, exactement l'inverse de l'image de la mère de famille qu'elle souhaite donner à voir. Quand, grâce au hasard, le dieu des malchanceux qui finit toujours par se manifester, Bruno ne pourra plus rien ignorer de la vie de gourgandine d'Anna, même s'il s'était fait une autre idée de cette femme, il en sera jaloux, ressentira de la honte pour lui-même mais surtout méprisera celle qu'il a choisie pour être son épouse et la mère de ses enfants et qui l'a si facilement trompé. Il s'en voudra lui-même de ce choix, autant pour lui que pour les autres, souhaitera sauver les apparences en privilégiant l’hypocrisie, demeurer auprès de ses enfants qu'il aime, que sais-je ? Mais sa réaction sera à la hauteur de sa déception. Bien entendu il aura des doutes sur sa paternité, se sentira atteint dans son ego, sortira de cette épreuve meurtri voire détruit, se demandera ce qu'il a bien pu faire pour mériter une telle sentence et en plus devra faire face aux arguties de cette femme qui cherchera par tout moyen à taire, à nier, ou à minimiser ses fautes, jusque et y compris en lui en imputant la responsabilité.
Ce roman qui se déroule sur trois mois mais avec de nombreuses analepses, va plus loin qu'une histoire sentimentale ou qu'un banal adultère. L'auteur y introduit une dimension dramatique qui n'emprunte malheureusement pas son déroulement à la seule imagination, comme si la morale ou une quelconque divinité aveugle réclamait réparation de cette faute répétée sans se soucier de ceux qui, malgré leur naïveté, leur innocence, paieraient également un péché pour lequel ils ne sont pour rien.
Je n'ai pas vraiment adhéré aux considérations de l'analyste dont le discours jungien est plein de nuances et de questions puisque Anna a la volonté de vivre ces passades sans vraiment vouloir les lui révéler ni les expliquer même si la personne de Steve ou plutôt son fantôme, hantait ses séances d'analyse. Je n'ai pas non plus goûté les subtilités grammaticales de la langue allemande que je ne parle malheureusement pas, non plus que les variations sur la mort, l'enfer avec ses flammes et le paradis avec son lénifient et contestable discours religieux qui sont censés y succéder. Elles sont pourtant intimement liées à cet ouvrage et éclairent cette part d'obscurité que chaque être porte en lui. Ce roman au style direct, réaliste et sans fioriture est aussi une longue variation sur l'amour et le désir sexuel, la famille et les passades, les amitiés de façade et la solitude. On ne sait pour autant pas pourquoi le mariage d'Anna et de Bruno est un échec au point qu'elle l'exorcise à travers une telle activité sexuelle de contrebande ni pourquoi elle est à ce point contradictoire et ambivalente. Cela peut s'expliquer par la génétique, la volonté de faire souffrir, de régler des comptes anciens et inavoués ou simplement par l'envie d'être différente ou d'ignorer son entourage. D'autre part, il y a toujours le regard extérieur, celui de sa belle-mère, Ursula, dont on comprend vite qu'elle a des doutes sur la fidélité de sa bru, celui de la psychanalyste aussi qui devine tout, malgré les révélations laconiques d'Anna mais qui finalement ne fera rien pour elle.
Le livre est un univers douloureux et l'écriture est souvent revêtue par l'auteur de fonctions cathartiques, de contrition voire de rédemption. On peut toujours donner une dimension autobiographique à un tel texte qui m'a paru passionnant, pertinent du début à la fin dans l'analyse de personnages, des situations, des sentiments décrits. La lecture des « remerciements » m'a paru révélatrice. Alors ? Anna est-elle vraiment « une bonne épouse, dans l’ensemble » ?
Avant que Babelio dans le cadre de « Masse critique » et les éditions Albin Michel ne me fassent parvenir cet ouvrage, ce dont je les remercie, je ne connaissais pas cette auteure américaine dont c'est le premier roman. Cette lecture passionnante du début à la fin m'incite à explorer son œuvre à venir.
Hervé GAUTIER – Décembre 2015 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA DETTE - Mike Nicol
- Le 14/11/2015
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°987– Novembre 2015
LA DETTE – Mike Nicol – J'ai lu.
Tome 1 de la trilogie « Vengeance »- Traduit de l'anglais (Afrique du sud) par Estelle Roudet.
Mace Bishop, le blanc et Pylon Buso le noir sont les deux héros de ce polar gore qui se déroule au Cap. Ce sont deux anciens mercenaires et trafiquants d'armes pour le compte de l'ANC qui se sont reconvertis pour une retraite tranquille dans la protection d'amateurs de safaris chirurgicaux fortunés. Autant dire qu'ils ont oublié l'emploi de la kalachnikov qui fut longtemps leur outil de travail. Tout aurait été pour le mieux dans le meilleur des mondes s'il n'y avait eu une vieille affaire de dette d'honneur et aussi un petit chantage autour d'un magot planqué aux îles caïmans, ce qui va les obliger à reprendre du service. Ils sont contactés par un ancien compagnon de route, Ducky Donald, le bénéficiaire de cette fameuse dette, dont le fils, Matthew est gérant d'un boite de nuit qui est une plaque tournante de la drogue. Il est menacé par la « Pagad », une association qui lutte contre le trafic de stupéfiants et que représente Sheemina February, une avocate énigmatique et un peu sulfureuse qui est une vieille connaissance de Mace et qui lui rafraîchira la mémoire sur un passé qu'il espérait définitivement enfoui. Tel est point de départ de ce polar rugueux et noir où la violence éclate à chaque page et le suspens est distillé à travers un style minimaliste et un rythme effréné. C'est aussi un portait sombre de cette société sud-africaine pas vraiment meilleure que les autres, loin des clichés touristiques ordinaires. Pourtant la description du Cap est convaincante avec d'un côté les riches quartiers blancs et de l'autre les ghettos où vivent les noirs, pauvres et souvent malades du SIDA. Bref une lecture prenante, dynamique, bien dans le style polar noir que j'ai découverte grâce à Babelio (« Masse Critique ») et aux éditions « J'ai lu » que je remercie. Peu familier de ce genre, j'ai quand même été un peu surpris mais je respecte la travail de l'auteur.
Les personnages ne manquent pas durant ces 600 pages, ce qui nuit un peu à l'intérêt de ce volume et rend un peu laborieuse sa lecture. Je retiens surtout les femmes et si l'une d'elles est douce maintenant, les autres ne sont pas des plus tranquilles, à la fois déjantées, troublantes, dangereuses ou sexy. Avec eux nos deux lascars vont aller au devant d'ennuis divers qui sont directement issus de leur passé fangeux dont souhaite se souvenir Sheemina. L'auteur nous embarque donc dans des affaires variées depuis l'enlèvement d'enfant jusqu'aux trafics d’armes, de drogue et de diamants mais aussi, pour que le panel soit complet, meurtres, règlements de compte et affaires louches, contrats qui tournent mal y compris la gestation pour autrui au profit de deux homosexuels italiens fortunés, guerre civile, carnaval et terrorisme islamique... ce qui dilue un peu l'attention du lecteur mais maintient le suspens. Nos deux héros étaient des brutes sans scrupules mais l'auteur nous donne maintenant à voir une toute autre image de Mace, ex-baroudeur lovelace devenu père de famille, amoureux de son épouse et qui culpabilise pour l'état de sa fille paralysée.
Quant à cette dette dont on nous parle tout au long de ce roman, nous le saurons qu'à la fin ce qu'il en est, mais partiellement seulement puisque nous avons en mains le premier tome de cette trilogie. Ce serait plutôt une forme de vengeance. C'est quand même une performance d'avoir réussi à parler à son lecteur d'une chose pendant si longtemps et de ne lever partiellement le voile qu'à la fin.
Hervé GAUTIER – Novembre 2015 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
CELLES DE LA RIVIERE - Valérie Geary
- Le 08/11/2015
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°985– Novembre 2015
CELLES DE LA RIVIERE – Valérie Geary – Éditions Mosaic.
Traduit de l'américain par Marylin Beury.
Sam, une jeune fille tout juste sortie de l’adolescence et Ollie, encore enfant, jouent au bord de la rivière Crooked. Elles découvrent le cadavre d'une femme flottant entre deux eaux. Les deux sœurs ne s'attendaient guère à ce spectacle qui les bouleverse d'autant plus que cette morte leur rappelle leur mère disparue quelques semaines plus tôt. Depuis, Sam est perdue sans elle mais Ollie est depuis devenue complètement muette comme elle l'avait été quatre ans auparavant à la mort de sa tante Charlotte. A la suite de la découverte du cadavre de la rivière, une enquête et ouverte, menée par l'inspecteur Talbert et dans le pays on se méfie de leur père, un être marginal, surnommé « Ours », qui vivait ans un tipi, ayant abandonné femme et enfants. Pour la police et aussi pour la population de cette petite ville pétrie de préjugés et de rancœurs, il fait figure de coupable idéal. En effet la situation familiale des deux filles était un peu compliquée puisqu'elles n'habitaient plus chez leur père depuis deux ans même si leurs parents n'étaient pas officiellement séparés. Depuis la mort de leur mère elles étaient revenues vivre avec lui. A certains indices les deux enfants finissent par penser que leur père est responsable de l’assassinat de cette femme trouvée dans la rivière et ce d'autant qu'il n'a sûrement pas tout dit. Pour ne pas le perdre comme elles ont perdu leur mère et pour ne pas aller vivre chez leur grands-parents à Boston, elles décident de mentir pour le protéger bien qu'il ait été arrêté comme principal suspect.
Avant que le éditions Mosaic, que je remercie, ne me fassent parvenir ce roman, je ne connaissais pas l’œuvre de Valérie Geary. J'avoue que ce livre m'a quelque peu déconcerté. La page de garde annonce effectivement qu'il s'agit d'un roman mais le premier chapitre donne plutôt à penser que le lecteur va avoir affaire à un « policier ». D'une certaine façon, c'est un peu le cas puisqu'il y a un meurtre, sauf que les fonctionnaires de police font montre d'une particulière inexistence. Les investigations, d'ailleurs fort rocambolesques, sont menées par Sam elle-même qui ne croit pas à la culpabilité de son père, avec toute la naïveté et la spontanéité de l’adolescence dans laquelle elle entre. Et bien entendu en toute illégalité ! Elle est, en cela soutenue, un peu malgré elle cependant, par Ollie qui, bien que muette est adepte des sciences paranormales correspond avec des fantômes et des esprits. Elle voit et entend des choses que les autres personnes autour d'elle ne perçoivent pas. Le roman est assez bizarrement construit qui donne la parole alternativement à Sam et à Ollie et c'est à travers leurs yeux et leurs craintes intimes, leurs rêves, leurs visions que se déroule ce récit. Je veux bien que ceux qui ont perdu un être cher soient l'objet d'hallucinations mais quand même ! Le lecteur découvrira ce récit émaillé de mensonges, de secrets, de on-dit et de non-dits, ce qui épaissit grandement le mystère qui entoure la personnalité d'Ours...
La lettre d'accompagnement indique que ce roman doit beaucoup à la propre histoire de l'auteure. J'avoue que ce détail me laisse dubitatif, entre autobiographie et imagination créatrice. Je note cependant que ce roman m'a tenu en haleine jusqu'à la fin avec un sens particulier et vraiment peu ordinaire du suspens. Il est bien écrit (bien traduit?) et procure une lecture fluide et fort agréable. Au début, certes l'auteure présente les personnages et définit l'intrigue mais il y a des longueurs dues notamment à des descriptions de la nature environnante, des abeilles, ce qui dilue un peu l'attention. J'ai lu ce roman comme un récit initiatique dramatique pour les deux filles qui ainsi quittent l'enfance et entrent de plain-pied dans le monde brutal des adultes. C'est aussi une sorte de deuil de la famille, l'absence de leurs parents que cette histoire raconte pour les deux filles. A titre personnel, je communie à ce genre d'épreuve qui marque durablement l'existence future de ceux qui la vivent. Pour autant l'épilogue lui aussi m'a un peu déconcerté.
Hervé GAUTIER – Novembre 2015 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
NEVERHOME - Laird HUNT
- Le 05/11/2015
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°983– Novembre 2015
NEVERHOME – Laird HUNT - Actes sud.
Traduit de l'américain par Anne-Laure Tissut.
Nous sommes pendant la guerre de Sécession aux États-Unis et Constance, habite avec son mari Bartholomew dans une ferme de L’Illinois où ils vivent ensemble un bonheur tranquille. Cette guerre réclame la présence sous les armes de cet homme, faible de constitution et qui n'a vraiment rien d'un soldat. Parce qu'elle est dotée d'une forte stature, qu'elle n'a peur de rien, qu'elle sait tirer au fusil, elle se travestit en homme, revêt la tunique bleue de l'armée du Nord et part sous le nom de Ash Thompson. Cette femme est présentée comme un être robuste et son mari comme quelqu’un de fragile.
C'est là une décision qu'elle prend pour remplacer Bartholomew qu'elle aime à la folie. Elle va donner le change dans cet univers de combattants masculins, acquiert même le surnom de « Gallant Ash », Ash le galant, pour avoir donné sa veste à une jeune fille dont le corsage était déchiré, va rencontrer le fantôme de sa mère morte avec qui elle entretient une conversation permanente et intime, gagnera l'estime de tous ces hommes, souvent des soudards, qu'elle surpasse largement en valeur humaine et en qualités militaires, mais toujours en tant « qu'homme ». Elle se révèle en effet être un excellent « soldat », rusé et courageux et sa bravoure va même jusqu'à être connue dans le camp d'en face où on sifflote « La ballade de Galland Ash ». Tout au long du récit, elle va raconter à son mari resté à la ferme, dans des lettres, son épopée guerrière avec ses scènes de combat et ses drames.
Dans les armées de cette époque, il y a toujours eu des femmes qui suivaient les régiments dont elles assuraient l'intendance comme cantinières ou blanchisseuses. Ici, c'est différent et j'avoue que, au début, je n'ai pas tellement cru à cette mascarade d'une femme qui se fait passer pour un homme et combat sous l'uniforme pendant cette guerre civile sans que personne ne s'en aperçoive. Compte tenu des circonstances, on ne devait pas être très regardant sur la procédure d'incorporation, particulièrement sur la visite médicale, et tout engagement était bon à prendre. Pourtant, il semblerait que selon les recherches effectuées, d'autres femmes firent cette guerre, déguisées en hommes. Le roman indique en effet que Constance en rencontre quelques-unes. Pourtant cette situation n'était pas vraiment idyllique et il fallait que ces femmes soient effectivement solides parce que non seulement elles affrontaient les balles, la faim, la peur, mais quand elles étaient découvertes, quand leur subterfuges était dévoilé, elles étaient lourdement punies comme ce roman le révèle. On accuse en effet Constance d'être une espionne, on l'emprisonne, on l'humilie par des corvées dégradantes et on menace même de la pendre. Ce livre est donc un hommage qui leur est rendu d'autant que l'histoire, les hommes, ont cherché à effacer ces actions individuelles dans la mémoire collective. Après tout, même si la guerre est traditionnellement une affaire d'hommes, dans tous le conflits les femmes ont su prendre leur part en luttant pour leurs convictions.
J'ai lu ce roman comme une épopée mais aussi comme une formidable histoire d'amour de cette femme pour son mari. Non seulement elle le remplace dans ce conflit, risque sa vie dans cette lutte fratricide, mais cet acte héroïque n'est pas une fuite puisqu’elle entretient avec lui une correspondance suivie et lui renouvelle à chaque fois son attachement et son amour.
Hervé GAUTIER – Novembre 2015 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
Black Whidah - Jack Küpfer
- Le 05/10/2015
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°967– Octobre 2015
Black Whidah – Jack Küpfer – Olivier Moratelle Éditeur.
Ce roman peut être qualifié d'historique et, à ce titre, il faut le remettre dans son contexte. Il se déroule en 1808 au Brésil puis sur la côte de Guinée, dans le royaume imaginaire de Whidah. Le narrateur, Gwen Gordon, est un aventurier écossais, polyglotte, qui, deux ans avant les faits qu'il relate, a abandonné Sigrid, une Norvégienne et les deux jumeaux qui sont ses enfants. Désireux de s'enfuir, il a été recruté comme interprète par Watkins, un vieux pirate alcoolique qui a terminé sa vie au bout d'une corde. Au début du roman, Gordon est à Recife au Brésil où il tente de cacher sa ruine financière sous les traits d'un honnête marin français. Ainsi fait il la connaissance de Jorge Porteiro, un capitaine au long cours qui sympathise avec lui et l'engage sur l'Antares, son navire dédié au commerce du sucre, du café et du coton et à destination du port de Whidah. C'est plutôt une bonne aubaine pour Gordon qui ignore cependant que Porteiro en sait d'avantage sur son compte qu'il ne se l'imagine. Aussi devra-t-il obéir aveuglement aux ordres de son commandant qui a besoin de ses compétences.
Gordon est certes un forban, et s'il est aussi un homme de bonnes manières et d'une délicate culture, ce qui tranche un peu avec son statut de pirate, il n'en est pas moins un peu naïf et Portiero ne va pas manquer de lui révéler la véritable nature de de son commerce, la traite des noirs. Il va même la justifier d'une manière hypocrite en prétextant que, depuis toujours, le roi de Whidah, perpétuellement en guerre avec ses voisins, vendaient ses prisonniers aux négriers au lieu de les dévorer. Ainsi les trafiquants blancs donnaient-ils une chance supplémentaire de survie aux vaincus ainsi que, par leur conversion, une occasion unique de sauver leur âme en pays catholique puisque, employés dans les mines d'or du Brésil, ils pouvaient ainsi se préparer par leur travail à la vie éternelle. Dieu d'ailleurs, qui était bien entendu du côté des blancs, ne pouvait voir cela que d'un bon œil ! Le capitaine portugais n'insiste évidemment pas sur le fait qu'un esclave sur trois parvenait à bon port après avoir voyagé à fond de cale dans des conditions effroyables et que leur espérance de vie ne dépassait ensuite pas douze ans. Cela indigne Gordon qui s'insurge au point de se faire des ennemis parmi des occupants du fort de Whidah qui calment vite ses ardeurs mais il ressent aussi la peur du Vaudou, des Zombis et des légendes de la forêt africaine. Il reste quand même un être sensible, capable de s'amender et ce voyage en terre africaine, avec ses mystères, ses malédictions et ses cultes secrets, va bouleverser sa vie. Les rencontres qu'il fait pendant ce périple influent largement sur son caractère, contribuent à le remettre dans le droit chemin d'où la fougue de la jeunesse, la soif d'aventures et la fascination de la mer l'avaient quelque peu écarté.
J'ai aimé le souffle de l'aventure qu'on ressent tout au long de ce roman, même si l'épilogue emprunte un peu trop au happy-end. Le texte est agréable à lire, dépaysant, poétique même…
Black Whidah est le premier tome d'un cycle romanesque intitulé « Les vies d'azur ».
Hervé GAUTIER – Octobre 2015 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
UN ETE 63 - Tracy Guzeman
- Le 03/05/2015
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°899– Mai 2015
UN ETE 63 – Tracy Guzeman – Flammarion.
Traduit de l'anglais par Simone Davy
Natalie et Alice Kessler sont sœurs mais sont bien différentes. La première, l'aînée est aussi têtue et manipulatrice que la seconde est rêveuse, poète et attentive à la nature. Pendant l'été de l'année 1963, Alice, qui est la plus belle des deux, tombe amoureuse de Thomas Bayber, un jeune peintre alors complètement inconnu.
Quarante ans plus tard Thomas, devenu célèbre, est maintenant un artiste mondialement reconnu dont l’œuvre a été étudiée et commentée, mais depuis 20 ans il traverse une crise de création, n'a plus touché un pinceau, vit en marge de la société et tente de se détruire à petit feu ; il est d’ailleurs très malade. A son ami Dennis Finch, historien d'art et critique qui lui est toujours resté fidèle, il propose un de ses tableaux resté inconnu qu'il veut vendre par l’intermédiaire de Stephen Jameson, un ancien expert en perte de vitesse qui travaille actuellement dans une officine de ventes aux enchères. Ce tableau représente « les sœurs Kessler » mais il est incomplet puisque l'orignal est un triptyque dont les deux autres panneaux ont été offerts à Alice et à Natalie et ont disparu. Va donc s'engager une recherche de ces deux éléments, confiée à Finch et à Jameson par Thomas lui-même qui, en posant ainsi le problème, se révèle machiavélique car le lecteur ne tarde pas à se rendre compte que cette quête n'est qu'un prétexte et que ce que l'auteur souhaite retrouver c'est la trace des deux sœurs et ce dans un but bien précis. Dès lors c'est à une véritable enquête policière que nous assistons.
Dans l'univers protecteur de l'enfance, les deux sœurs étaient très liées et n'imaginaient pas que ce lien puisse un jour être distendu. Pourtant le hasard, la destiné, la vie, selon le nom qu'on veut bien donner, allaient se charger de faire changer ces choses qu'elles croyaient immuables. Non seulement elles ont croisé la fuite du temps, la maladie et la mort mais des événements sont intervenus qui allaient révéler définitivement les personnalités, mettre chacun dans un rôle qui, avec le temps se figera. Non seulement une rivalité va naître entre Alice et Natalie mais la position de chacune d'elles par rapport à l'autre va devenir progressivement une domination puis une véritable haine, avec tout son cortège de non-dits, de mensonges, de dissimulations, de secrets que la mort de Natalie dévoilera brutalement. A l’aide de nombreux analepses l'auteur remonte le temps pour révéler le parcours d'Alice et de Natalie depuis cet été 63, pour analyser les relations de plus en plus difficiles entre elles, évoquer les rencontres qui vont bouleverser le cours de leur existence, l'aînée prenant le pas définitivement sur la cadette. Dès lors, par la force des choses et avec une certaine énergie d'ailleurs assez inattendue de sa part, Alice qui avait toujours vécu dans l'ombre de sa sœur à cause de la maladie, tente de prendre en mains sa vie, entre étonnement et culpabilité, d'en explorer les recoins et les failles, jusque là savamment occultés, avec, il est vrai l'aide attentive de Phinneaus. Le voyage qu'elle fait volontairement seule à destination de Santa Fe depuis le Tennessee est révélateur ainsi que sa volonté d’aller au devant de révélations, fussent-elles destructrices.
Au fur et à mesure du récit, le lecteur découvre non seulement tout ce que cette histoire de tableau cachait mais aussi la personnalité de chacun des personnages principaux, leur refus des choses, par égoïsme ou fuite de leurs responsabilités, leur jalousie, leur abnégation, leur joie de vivre et leur confiance en l'avenir aussi avec, en toile de fond, cette dernière chance qu'il fallait saisir avant que la mort n'anéantisse tout. Thomas avait volontairement brouillé les pistes, ajoutant l’image toujours présente de l'oiseau, symbole de liberté, mais aussi avait joué sur la lumière du portrait central et des panneaux adjacents, signifiant par là un message bien précis. Ce que vont découvrir nos deux enquêteurs va bouleverser bien des vies, bousculer des certitudes établies, révéler le vrai visage de ceux qu'on croyait connaître, faire en sorte que le but recherché soit finalement atteint.
J'ai découvert Tracy Guzeman que je ne connaissais pas avant le que les éditions Flammarion en m'envoient ce roman, ce dont je les remercie. J'observe que dans cet ouvrage les personnages, Thomas Bayber, Stephen Jameson sont inhibés, torturés comme si l'art était une malédiction au lieu d'être un bienfait. Alice se complaît dans sa maladie qui fait d'elle une assistée et sa sœur une ombre protectrice un peu envahissante, tandis que Finch poursuit avec sa défunte épouse un dialogue surréaliste. Ce roman où les destins s'entremêlent, est compliqué à l'envi mais avec talent. C'est, en tout cas une belle étude de caractères.
Le style est agréable à lire, les descriptions précises et évocatrices même si on rencontre des notations techniques sur la peinture un peu fastidieuses et des longueurs parfois déroutantes en apparences... Mais tout cela n’occulte pas le bon moment de lecture que fut ce roman.
©Hervé GAUTIER – Mai 2015 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
ANGEL BABY - Richard Lange
- Le 22/03/2015
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°883– Mars 2015
ANGEL BABY – Richard Lange- Albin Michel.
Traduit de l'américain par Cécile Deniard.
Rien en va plus entre Luz et Rolando dit « El Principe » (Le Prince), un cruel narcotrafiquant à Tijuana (Mexique). Depuis plus de 3 ans, il la tabasse, la drogue, la viole, la tyrannise et elle décide donc de s'enfuir sur un coup de tête avec pour tout bagage une poignée de dollars dérobés dans le coffre et un colt 45. Dans sa fuite elle tue même deux personnes à la solde de cet homme qui lance un tueur à sa poursuite. C'est qu'elle l'a épousé tout en lui cachant l'existence d'Isabel, sa fille restée à Los Angeles chez sa tante Carmen. Elle n'a qu'une idée en tête, traverser la frontière toute proche et la rejoindre. Cela commence donc sur les chapeaux de roues, un peu comme dans un film américain. Même si sa vie avec Rolando a été un enfer et que ses hommes de main la poursuivent, Jéronimo, dit l'Apache, un truand tout dévoué à Rolando et Tracker, un flic tordu et corrompu mais qui de plus en plus regrette de s'être laissé entraîné dans cette affaire, elle a quand même la chance de rencontrer dans sa fuite, Malone qui lui fait traverser la frontière. C'est un personnage à la fois intéressé, sympathique mais aussi énigmatique, poursuivi par son passé et dépendant de l'alcool. Il représente dans tout ce panel de déjantés, partagés entre l'argent et le meurtre, la seule note réconfortante dans cette aventure.
Le lecteur vibre au rythme de ce roman échevelé, craignant pour la vie de Luz mais aussi sympathisant avec Malone, finalement aux petits soins pour elle et désireux de l'aider jusqu'au bout.
Angel Baby, c'est le titre de la chanson qu'elle chantait à Isabel, sa fille. C'est peut-être plus que cela en réalité puisque, au cours de ces 300 pages, le lecteur qui aurait volontiers prit Luz pour une femme facile, opportuniste, plus volontiers attirée par l'argent, va rencontrer une femme bien différente, prise entre la pauvreté la peur et le désespoir. Depuis qu'elle a abandonné Isabel aux bons soins de Carmen, elle est partagée entre le remords et les illusoires prières pour qu'il ne lui arrive rien et qu'elle puisse la retrouver. Ce roman est d'ailleurs plus qu'un thriller, comme la couverture suggestive le donne à penser, c'est une véritable étude de caractères menée à travers des personnages qu'on aurait tôt fait de mal cataloguer et le lecteur pénètre malgré lui dans le monde un peu obscur de Richard Lange. Ce roman pourrait être regardé comme une chasse à l'homme (à la femme) effrénée et impitoyable, aux multiples rebondissements, comme dans les meilleurs romans noirs américains, faits de trahisons, de chantage, de dollars, de violence, de drogue et de sexe, mais il est entrecoupé de moments pleins de souvenirs, de complicité et de tendresse surtout entre Luz et Malone.
D'ordinaire, j'avais, par goût, par culture, par réaction, que sais-je, l'habitude de me réfugier dans l'art et plus spécialement dans les livres, face à un monde de plus en plus déshumanisé. Cela constituait mes lectures habituelles plutôt paisibles. J’avoue que je ne connaissais pas cet auteur ni ce livre ni son atmosphère glauque et gore, avant que « Masse critique » ne contribue à cette ouverture sur une autre littérature[merci aux Éditions Albin Michel de me l’avoir fait parvenir directement]. Pour en faire partie, nous savons que l'espèce humaine n'est pas fréquentable. Que la littérature prenne en compte cette caractéristique, qu'elle peigne la société telle qu'elle est, qu'elle montre un changement rapide, surtout dans le mauvais sens, je ne vois pas ce qu'il y a d'anormal. Après tout, depuis que le monde existe, les hommes n'ont eu de cesse que de s’entre-tuer, de se trahir, de s’autodétruire. La société dans laquelle nous vivons, celle des États-Unis mais aussi la nôtre, est de plus en plus faite de violences, d’escroqueries, de trahisons, de meurtres, d'hypocrisies et elle ne fait rien contre cela puisqu'elle en est bien souvent l'organisatrice, l’instigatrice ou même la complice et je comprends assez mal dans ces conditions le concept de « vivre ensemble » dont on nous rebat les oreilles en toutes occasions. En réalité je ne regrette pas cette lecture même si mes goûts vont plutôt vers autre chose, une écriture plus poétique par exemple, que je n'ai pas vraiment retrouvée ici.
Quoiqu'il en soit, je respecte ce parti-pris d'auteur qui me donne sûrement envie de redécouvrir d'autres œuvres de Richard Lange.
©Hervé GAUTIER – Mars 2015 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
UN COEUR BIEN ACCORDÉ - Jan-Philipp Sendker
- Le 14/03/2015
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°881– Mars 2015
UN COEUR BIEN ACCORDÉ – Jan-Philipp Sendker – JC Lattès.
Traduit avec l'autorisation de l'auteur à partir de la version anglaise de Kevin Wiliarty par Laurence Kiefé.
Julia Win, la narratrice, d'origine birmane, la quarantaine, est une brillante avocate à Manhattan. Elle est aussi une femme épanouie mais solitaire avec une seule amie, Amy Lee, artiste peintre. Elle se met a entendre une voix féminine étrange qui lui posent des questions pour le moins personnelles sur sa vie. Il n'en faut pas davantage pour la troubler durablement au point qu'elle manque d'entrer dans la folie. Elle pense qu'un retour en Birmanie peut lui apporter une réponse et elle y retrouve son frère, U Ba. Là, c'est un autre monde, des gens bien différents de son quotidien et dix ans se sont écoulés depuis son dernier voyage dans ce pays. Seules quelques lettres échangées avec lui ont entretenu cette relation. Sous la conduite de ce frère pourtant malade, Julia apprend la vie tragique de Nu Nu, une femme poursuivie par le malheur mais aussi celle de Thar Thar, son fils. Ce sont deux êtres dont on dit qu'ils sont nés sous une mauvaise étoile, que malgré eux, ils attirent le malheur et qu'ils sont l'objet, jusque de la part de leurs proches, d'une volonté de destruction. Et pourtant ils survivent alors qu'on imaginerait qu'autant d’épreuves ne peuvent que se conclure par la mort qui serait pour eux une libération. Ce récit est réellement pathétique et aucun détail en nous est épargné. Hasard des rencontres, Julia croise un homme qui pourrait bien être Thar Thar. Il n'est pas un moine comme il en a l'apparence mais réalise à sa manière une sorte de syncrétisme entre le christianisme et le bouddhisme, se consacre aux plus défavorisés que la société rejette. Il pratique, à travers le pardon et l'amour, un sorte de dévotion à un dieu universel autant qu'un art de vivre. La métaphore du cœur désaccordé, comme le serait un instrument de musique, prend alors tout son sens. L'auteur met en avant l'amour mais aussi le pardon qui génère la liberté pour celui qui le prononce [« Pour pardonner, il faut aimer et être aimé. Seuls ceux qui pardonnent peuvent être libres. Quiconque pardonne n'est plus prisonnier. » déclare-t-il].
C'est un peu comme si la voix qu'elle entendait sollicitait à travers elle le pardon de Thar Thar. A travers son exemple et son enseignement, Julia en tire des leçons pour elle-même, réfléchit sur le destin, accepte de mener une vie différente de celle qu'elle avait à New-York, de prendre son temps, de vivre au quotidien comme une Birmane à travers des gestes simples, de remettre en question ses certitudes, de perdre ses repaires américains et ses valeurs occidentales, de retrouver peut-être ses croyances religieuses oubliées… Comme elle, le lecteur reçoit cette leçon de sagesse orientale et explore les arcanes du cœur humain. Du coup, Julia accepte de confier à cet homme l'objet de sa quête et la voix qui torturait sa vie se tait, lui procurant une sorte de plénitude intérieure. Entre eux naîtra une sorte de complicité basée sur la connaissance commune, un amour même mais qui n'a rien à voir avec une de ces passades new-yorkaises que Julia a pu connaître dans sa vie d'avant. Ce qui les unit est de nature quasi-religieuse et procure à Julia une certaine paix de l'âme qui naît autant de la vie spartiate qu'elle mène pendant ces quelques semaines birmanes que de la découverte de ce frère qu'elle n'avait jusqu'alors qu'entraperçu. Ce bouleversement intervenu dans sa vie donne à penser que non seulement elle abandonnera ici le fardeau qu'elle porte mais qu'on imagine pas qu'elle puisse vivre ailleurs désormais.
C'est un roman dépaysant mais surtout une sorte de voyage initiatique que Julia mène comme une quête personnelle même si je peux personnellement avoir une notion différente du pardon. En ce qui concerne le récit de la vie de Nu Nu puis celle de Thar Thar, cela peut paraître appartenir à une fiction, l'auteur noircissant le trait pour servir l’histoire et ainsi apitoyer le lecteur. En réalité le malheur existe qui s'accroche à certains êtres sans aucune raison et martyrise leur vie alors qu'il en épargne d'autres. Trop d'épreuves imméritées qu'on a du mal à justifier autrement que par un mauvais karma, peuvent effectivement bouleverser les plus solides.
Avec un art consommé du suspens et une écriture fluide,[même si le texte original a pu être écrit en allemand et a dû passer par une version anglaise avant d'être traduite en français] l'auteur entretient l’attention et l’intérêt de son lecteur jusqu’à la fin. Je suis personnellement entré complètement dans ce roman notamment dans le récit des destinées de Nu Nu et de Thar Thar. Cela m'a paru appartenir à une réalité différente de celle parfois faussement idyllique qu'on rencontre dans les romans.
J'ai eu plaisir à découvrir à cette occasion un auteur jusqu'à là inconnu.
©Hervé GAUTIER – Mars 2015 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA BALLADE DE WILLOW - Jamie Ford
- Le 23/02/2015
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°871– Février 2015
LA BALLADE DE WILLOW – Jamie Ford – Presses de la Cité.(2013)
Traduit de l’américain par par Isabelle Chapman.
Avec deux « l », ce qui donne, dès le titre la dimension poétique de l'ouvrage. La traduction du titre original « Songs of Willow Frost » est bien rendue.
Nous sommes en 1934 à Seattle, aux États-unis. William Eng est pensionnaire depuis cinq années dans la très stricte institution du Sacré-Chœur où sa mère, Lui Song l'a abandonné au plus fort de la crise économique. Il avait alors 7 ans. Il n'est d'ailleurs pas le seul et pas mal de ses camarades d'infortune ont connu le même sort. Pour eux, seule une adoption peut leur permettre d'échapper à cet enfermement ou le très hypothétique retour de leur parents. Devant le peu de nouvelles, le garçon avait fini par se faire à l'idée que sa mère était morte. Les distractions sont rares dans l’établissement et un jour, par hasard, au cinéma, il reconnaît le visage de sa mère dans la bande annonce, ce qui bouleverse le gamin. Elle se fait appeler maintenant Willow Frost et a entamé une carrière de danseuse après avoir été chanteuse de rues puis de danseuse dans un speakeasy, activités brusquement interrompues par un internement dans un asile psychiatrique. Il décide donc de s'échapper pour la rejoindre.
L'auteur nous balade dans Chinatown et dans Seattle dont il nous détaille l’histoire et la géographie évoque les traditions chinoises et la crise de 1929 qui ressuscita les instincts mortifères de certains et qui obligea les familles pauvres à se séparer de leurs enfants devenus une charge. Il ne nous épargne rien du parcours difficile de Lui Song devenue Willow Frost, de l’impossibilité de vivre une vraie histoire d'amour avec Colin, un chinois, future vedette de cinéma, qui est éperdument amoureux d'elle mais qui sera lui aussi victime des traditions et des obligations familiales. Nous assistons à son combat de « fille-mère » ce qui à l'époque était fort mal vu dans une Amérique puritaine et dans la société chinoise, surtout quand cela touchait les gens du spectacle. Il nous parle de l'amitié qui existe entre William et Charlotte, la petite aveugle de l’orphelinat qui finira par refuser son départ avec son père. En réalité il nous fait partager le destin de Willow et de son fils, tous deux marqués définitivement par la malchance qui amène la mère à se sacrifier pour garder son fils mais qui est quand même forcée de l'abandonner. Il dénonce les mauvais traitements infligés aux enfants dans cet orphelinat par des religieuses désireuses sans doute de leur faire payer les erreurs de leurs parents et surtout désireuses de se débarrasser de leur pensionnaires quand un opportunité se présente. Du point de vue documentaire, ce roman est intéressant, précis dans ses descriptions et ses évocations, en revanche, je n'ai guère retrouvé la dimension poétique promise par le titre. J'ai même mis quelques temps à entrer dans l'histoire et ce n'est que vers la fin que les images décrites m'ont paru plus touchantes, plus émouvantes, que ce roman est véritablement devenu bouleversant. L'auteur mérite cependant d'être regardé comme un véritable conteur.
Une question est soulevée par ce roman, c'est celle de la culpabilité que peuvent ressentir les enfants ainsi abandonnés par leurs parents. Cette vision judéo-chrétienne, cultivée pendant des siècles par la religion catholique, dans le seul but de déstabiliser les hommes et de compliquer leur vie qui l'est déjà assez, m'a toujours paru hors de la réalité et pour tout dire inutile. Cette affirmation qui n'ajoute rien à l'existence des humains qui ne font ici-bas qu'un bref passage, mérite d'être combattue.
Un autre thème est celui de la malchance qui accable certains et en épargne d'autres. Cela me rappelle ce mot de Blaise Cendras « La chance on ne l'apprend pas, on l'a ». Ce roman me paraît l'illustrer parfaitement. On y donne bien entendu l'explication qu'on veut !
Un autre point soulevé par ce roman est le pardon, d'ailleurs à peine esquissé. Pour être accordé il doit être sollicité et Willow ne fournit à William qu'une explication sur sa conduite, pas une véritable demande d'absolution. Certes son fils lui pardonne mais elle ne le sait pas. Seule la suite nous le laisse deviner. Le roman se termine sur cet « happy end » qui tombe bien mais ne correspond malheureusement pas toujours à la réalité de la vraie vie, mais nous sommes dans une fiction, n'est-ce pas ?
.©Hervé GAUTIER – Février 2015 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
CODE 1879 - Dan Waddell
- Le 30/01/2015
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°555 – Février 2012
CODE 1879 – Dan Waddell - Éditions Rouergue noir.
Traduit de l'anglais par Jean-René Dastugue.
Cela commence plutôt mal en ce matin d'hiver pour l'inspecteur principal Grant Foster et pour son assistante, le lieutenant Heather Jenkins : on vient de trouver, près d'un cimetière londonien, le cadavre d'un homme poignardé et qui, apparemment, a eu les mains amputées avant de mourir. De plus, le meurtrier a pris la précaution de graver sur le corps de sa victime une inscription énigmatique faite de chiffres et de lettres dont notre limier ne tarde pas à s'apercevoir qu'elle fait référence à la généalogie. De plus, sur son portable, le dernier numéro composé est : 1879. Il n'y a pourtant pas de mobile apparent mais les recherches menées à partir de l'indication tailladée sur la peau du mort font entrer en scène Nigel Barnes, un généalogiste professionnel, personnage étonnant et surtout désargenté ! Peu de temps après, d'autres meurtres tout aussi mystérieux et rituels donnent à penser qu'ils sont le fait du même assassin et qu'ils en évoquent cinq autres également mystérieux, perpétrés dans les bas-fonds du Londres victorien de 1879. On songe à un remake de Jack L'éventreur !
A force de dépouiller les archives et les journaux de l'époque, ce qui ne fut pas un mince travail puisque les premières étaient imprécises et les seconds trop marqués par leur époque, les enquêteurs en arrivent à la conclusion que, par delà le temps, non seulement le meurtrier leur lance un défi mais surtout un avertissement : D'autres meurtres sont à venir et la police, pour peu que ses investigations et ses raisonnements soient pertinents, détient la clé de l'énigme ! Un peu comme s'il avait lui-même enclenché un compte à rebours macabre. Pire peut-être puisque peu à peu l'idée selon laquelle « le passé explique le présent » s'impose. Ainsi établit-on que la police de l'époque a, pour masquer son incompétence, largement contribué à faire condamner et exécuter un innocent par la justice victorienne pour les cinq crimes non élucidés. Il se pourrait donc bien qu'un descendant du condamné revienne pour le venger en s'en prenant aux membres actuels de la famille de ceux qui, à l'époque, avaient contribué à cette erreur judiciaire ! D'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas de doute à ce sujet, le meurtrier prend bien soin d'évoquer par des similitudes les meurtres de 1879. Une vengeance hors du temps en quelque sorte !
Foster ne pouvait guère s'imaginer, au début de cette enquête, qu'il y serait mêlé de si près.
Je dois bien admettre que l'écriture est quelconque et proche des romans de ce genre, mais peu importe puisque le suspens est bien au rendez-vous de ce polar palpitant. Les personnages ressemblent sans doute à ceux qu'on s'attend à rencontrer dans un roman policier, flic un peu marginal à l'histoire personnelle mouvementée et même accro à l'alcool et au tabac, jeune femme délurée, généalogiste fauché mais érudit ... Cependant l'originalité de cette œuvre tient sans aucun doute à l'introduction de la généalogie alors que, aujourd'hui, on s'attend davantage à rencontrer des méthodes de police scientifique. Elles existent certes au cours de cette enquête, comme existe la drogue (le GHB pour être précis) mais la généalogie y tient une place à part.
Entre les atermoiements, les difficultés et même les erreurs des policiers londoniens contemporains, le lecteur entre facilement dans ce jeu où on lui propose des allers et retours entre le XIX° siècle et aujourd'hui autant qu'une plongée dans cette Angleterre victorienne des bas-fonds. Je songe aussi au travail sans doute long et difficile que l'auteur a dû accomplir non seulement pour réunir de la documentation mais aussi pour distiller ainsi le suspens et retenir, jusqu'à la fin, l'attention de son lecteur.
J'ai bien aimé cette œuvre, la première traduite en français, d'un auteur que je ne connaissais pas mais dont je lirai assurément les suivantes.
© Hervé GAUTIER - Février 2012.
-
LES NOUVELLES AFFAIRES DU JUGE TI - Zhu Xiao Di
- Le 18/11/2014
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°829 – Novembre 2014.
LES NOUVELLES AFFAIRES DU JUGE TI – Zhu Xiao Di – 10/18.
Traduit de l'américain par Anne Krief.
Il y a quelques années, j'ai fait la « connaissance » du juge Ti (de son vrai nom Ti Jen-tsie 630-700)à travers les écrits de Robert Van Gulik et de Frédéric Lenormand et je me suis félicité de cette rencontre. Chaque roman était un grand moment de lecture tant le parcours de cet homme qui a réellement existé était passionnant. Comme il l'auteur le dit lui-même dans ses « remerciements », il était bien normal que ce fût un Chinois, même de nationalité américaine qui s'approprie ce personnage que la télévision chinoise fait régulièrement revivre.
A travers ces nouvelles, j'ai eu plaisir à retrouver cet étonnant magistrat, homme de son temps, vivant avec ses trois épouses et personnalisant la justice chinoise dans ses procédures et ses sanctions (bastonnade, torture et mise à mort). Il se révèle être un homme de bon sens, un enquêteur efficace, un fonctionnaire intègre, un confucianiste convaincu, un être cultivé, motivé par son seul devoir et soucieux de rendre une bonne justice au nom de l'Empereur. Il deviendra plus tard ministre de la justice. Il mène ses enquêtes et ses interrogatoires avec un pragmatisme qui n'a d'égal que sa volonté de déjouer les crimes et les délits les mieux dissimulés tout en ne s'en laissant pas conter. Il incarne l'autorité qui doit émaner du tribunal qu'il dirige. Nous le voyons évoluer dans la société chinoise de cette époque, avec ses rites, ses règles, ses coutumes qui régissent la vie sociale autant que la famille dans cette Chine fascinante.
©Hervé GAUTIER – Novembre 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
ET RIEN D'AUTRE - James Salter
- Le 08/10/2014
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°813 – Octobre 2014.
ET RIEN D'AUTRE – James Salter – Éditions de l'Olivier.
Traduit de l'anglais par Marc Amfreville.
C'est le sixième roman de James Salter, âgé de 89 ans, autant dire une sorte d'inventaire des thèmes qu'il a par ailleurs traités dans son œuvre et auxquels il mêle des références autobiographiques. Il met en scène Philip Bowman, ex-officier subalterne de la marine, ayant survécu à la guerre dans la Pacifique, jeune homme de la classe moyenne américaine du New-Jersey. Du conflit, il est revenu plein d'illusions sur la société et un rien rêveur. Dans ce New-York de l'après-guerre, après avoir rêvé du journalisme il devient un éditeur respecté, rencontre l'amour avec Vivian, fille d'un riche propriétaire terrien mais ce mariage qu'il voulait parfait, à l'image de sa réussite professionnelle, ne tarde pas à se déliter. Elle s'en va pourtant, non sans lui dire ce qui est pour elle une évidence : ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, autant dire que, dans leur choix ils s'étaient trompés ! Ensuite ce sera pour lui qui est un amoureux des femmes, une succession de passades ou de liaisons torrides et passionnées qui émailleront sa vie avec leurs moments d'intense jouissance qui succéderont à d'autres marqués par le renoncement, la lassitude, le découragement. Des femmes, libres ou mariées se succèdent dans son lit et parfois dans sa vie mais du véritable amour dont il rêvait, il n'aura rien. A son tour il sera trahi et bien sûr lui aussi trahira. Finalement, cette vie n'est pas autre chose qu'une succession de moments forts, la guerre, l’amour et la folie qu'il inspire, le sexe, l’alcool, les voyages, et de moments faibles, le quotidien émaillé des de réceptions ennuyeuses, d'inévitables désillusions et de bavardages sans intérêt souvent autour des livres et des auteurs. Cela donne, dans son ensemble, une impression d'inaccompli, de répétions monotones, autant dire d'échecs.
Ce texte est une invitation à méditer sur le temps qui passe, à la nostalgie de la vie la recherche et finalement l'inexistence du grand amour. On en parle beaucoup dans les rapports entre les gens et le mariage est presque un point de passage obligé et normal dans la vie d'un être humain. Mais le divorce vient bien souvent brouiller les choses et la solitude qui en résulte est d’autant plus dure à supporter. Ce roman est émaillé de ces exemples de couples qui se sont brisés, de ces êtres qui se sont plusieurs fois mariés, un peu comme si l’expérience matrimoniale désastreuse ne leur suffisait pas où que leur vie serait une perpétuelle recherche. Dans cette vie chaque homme n'est que de passage, il souhaite donc y être.heureux en amour, réussir dans son métier et être considéré, laisser une trace dans la société et se dire que sa vie a été belle mais tout cela se révèle vain. Ce roman est celui du souvenir intime de l'acteur de ce drame qu'est sa vie puisqu’elle est une recherche vaine du bonheur.
Ce que je retiens à titre personne, c'est le style fluide, descriptif jusque dans les moindres détails. C'est finalement cela qui a motivé ma lecture. Pour autant , je dois bien avouer avoir lu ce roman davantage pour aborder l'univers jusque là inconnu de James Salter. En le lisant, j'ai un peu pensé à l'ambiance des romans de Scott Fitzgerald …Alors ? L'amour (le bonheur?) et rien d'autre !
Sans être déçu, je dois dire que j'en ressors une impression mitigée, pas vraiment mauvaise mais pas non plus enthousiaste comme l'a été la presse en général.
©Hervé GAUTIER – Octobre 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
AMERICAN EXPRESS- James Salter
- Le 01/09/2014
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°797 – Septembre 2014.
AMERICAN EXPRESS- James Salter – Éditions de l'olivier.
Traduit de l'américain par Lisa Rosenbaum.
Les nouvelles de James Salter ont un goût de nostalgie, celle du temps qui passe inexorablement et sans que nous y puissions rien, ce même temps qui impose à chacun son rythme et sa marque. Les choses se font et se défont malgré nous ainsi dans « vingt minutes » le drame que connaît Jane Vare ou le mystère qui entoure la baby-sitter d' « Autres rivages », l'escapade nocturne de Fenn dans « Akhnilo » ou encore la solitude de Mrs Chandler face à un ancien amant. C'est une atmosphère de passage inexorable qui s'impose à travers ces textes, la nuit succède au jour, l'âge adulte à l'adolescence, la mort à la vie... L'ambiance qui gouverne ce recueil est plutôt mélancolique et tient à peu de choses, des situations en demi-teinte, des détails, une image furtive vite remplacée par une autre qui va combler le vide laissé par la précédente, des traces de sueur sous les aisselles, des relents du cuisine, une odeur de transpiration un peu forte, les vêtements négligés d'un homme, les seins d'une femme, des détails d'un visage ou la certitude d'une absence d'avenir dans la vie. C'est la solitude qui prédomine dans ces nouvelles. Pour souligner ce vide, les chutes sont étonnantes, déconcertantes même et pour le moins inattendues. « Am stende von Tanger » se termine par la mort d'un canari, « vingt minutes » par celle d'une cavalière, « Via negativa » par une appréciation portée sur les seins d'une femme rencontrée par hasard, « Akhnilo » par l'évocation d'une douloureuse insomnie solitaire que les mots ne parviennent pas à soulager, autant d'échecs, d'espoirs déçus.[« En fait pour lui l'échec était romantique. Il en avait presque fait son but »] qu'on perçoit aussi dans « La destruction du Goeotheanum ».
Dans « Fils perdu », il se souvient avec nostalgie qu'il a été officier de l'armée de l'air et c'est sans doute un peu de son expérience personnelles qu'il livre à son lecteur de même qu'il note ses observations sur les écrivains dans « Via negativa ». De toute manière et malgré une prose fluide, il reste une sorte de silence pesant qui peu à peu s'installe entre poésie et mysticisme. [« Couché dans son lit tel un étudiant pauvre - combien la vie changeait peu depuis le début jusqu'à la fin - il s'endormit, agrippé à ses rêves. Les fenêtres étaient ouvertes. L'air froid se déversait sur lui comme la mer sur un marin aveugle, le trempant jusqu'aux os, inondant la pièce. Il était allongé, les chevilles croisées comme un martyr, le visage tourné vers Dieu ».] Il a aussi été scénariste, en évoque le métier, l'ambiance qui règne sur les plateaux de tournage et au sein de la profession, la vie des acteurs dans « le cinéma » et à cette occasion il se révèle un peu voyeur. De Mrs Chandler il dit « C'était une femme... qui avait de belles jambes ». Il y a souvent des figures de femmes qui elles aussi passent et qui sont évoquées à travers une image érotique « Elle a de petits seins et de grands mamelons. Et aussi, comme elle le dit elle-même un assez gros postérieur ».
Il n'a pas de lieu privilégié pour l'auteur et il place ses « actions » (je devrais dire ses inactions tant les scènes qu'il évoque semblent banales) dans des villes emblématiques comme Barcelone ou Paris, des contrées d'Italie, d'Amérique du nord ou les bords du Rhin.
De toute cela résulte une atmosphère un peu dérangeante.
©Hervé GAUTIER – Septembre 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
BANGKOK - James Salter
- Le 31/08/2014
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°796 – Août 2014.
BANGKOK- James Salter – Éditions des 2 terres.
Traduit de l'américain par Anne Rabinovitch.
Un recueil de nouvelles est parfois composé de textes disparates réunis sous un même titre mais pas forcement avec un thème commun. Ici, avec ces six textes, l'auteur reprend des sujets favoris, l'amour, la perte, le gâchis qui caractérisent la vie. Il met en scène souvent des hommes, parfois des militaires comme il l'a été pendant une partie de sa vie, qui ont été trahis par leurs épouses (l'inverse est évidemment vrai) et qui souhaitent non pas oublier cette triste époque mais en tourner la page en évitant de pardonner à celle-là même qui vient le solliciter. Mais refait-on réellement sa vie après un échec, après l'opprobre intime de la tromperie, peut-on refaire confiance à l'autre, qu'il soit le même ou qu'il soit différent sans penser que cette histoire peut parfaitement bégayer ?
Les relations intimes hommes-femmes sont au centre de ce recueil. Le couple est en effet examiné par l'auteur à un moment critique où tout est devenu possible pour chacun de ses membres, malgré les années de vie passées ensemble. L'amour, la confiance ont certes existé entre eux mais le temps a passé qui les a modifiés. La routine s'est installée, les illusions se sont dissipées pour laisser place aux regrets, aux remords et parfois aussi à la rancœur et la poursuite du bonheur s'est arrêtée presque naturellement : Un couple est sur le point de se séparer à cause d'une relation homosexuelle de l'un des deux, une ancienne maîtresse refait soudain surface et aguiche son amant maintenant marié à une autre, un homme aide sa femme, gravement malade à mourir mais se laisse aller avec sa maîtresse pendant l'agonie supposée de son épouse, dans la pièce à côté... C'est comme cela, l'amour qui a été si intense au début n'existe plus mais se reporte sur un autre ou une autre... Ils sont parfois restés ensemble pour sauver les apparences ou les convenances et parfois non. Ce sont de petits accommodements avec la vie, des mensonges, des hypocrisies qui peuvent passer pour de la tolérance mais c’est assurément de silences, de souffrances qu'il s’agit. Ce sont « ces petits riens qu'on ignore au début mais qui, à la longue vous exaspèrent ». Salter passe le couple à la fois à l'épreuve du quotidien et du temps. Les femmes sont toujours belles d'une beauté discrète mais attirante. Il les habille sobrement et cette sobriété ajoute à leur charme mais il fait naître des désirs secrets et bien souvent inassouvis, fantasmes ordinaires. Ses textes nous renvoient assurément une image de nous-mêmes pas forcément flatteuse. Son écriture est directe, simple, dépouillée, agréable à lire.
Salter a passé une partie de sa vie dans l’armée américaine comme pilote de chasse. Il a quitté l'uniforme pour se consacrer à l'écriture. Ses nouvelles ne cachent rien de la vie, de l'amour, de la séparation des couples, de la mort, de la vie en société, une vérité de chaque jour, de chaque instant. Je découvre l’œuvre de Salter à l'occasion de ce recueil pris au hasard. Je pense que je vais poursuivre.
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
CINQ JOURS - Douglas KENNEDY
- Le 25/08/2014
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°794 – Août 2014.
CINQ JOURS - Douglas Kennedy - Belfond .
Traduit de l'américain par Bernard Cohen.
Saint Augustin conseillait qu'on se méfiât de l'homme d'un seul livre. Je n'ai pas lu tout Douglas Kennedy, tant s'en faut, mais le thème du mariage est un de ceux qu'il affectionne particulièrement. Je dois bien avouer que, à l'heure où la pérennité de cette institution est de plus en plus malmenée par le divorce, c'est bien là un thème de société qui peut effectivement être abordé.
L'intrigue est simple, basée comme toujours sur le hasard qui fait bien plus souvent partie de notre vie que nous voulons bien l'admettre. Laura et Richard sont deux inconnus l'un pour l'autre, ils ne se sont jamais rencontrés. Elle est technicienne en radiologie, aime ce qu'elle fait mais un peu moins son contexte familial où elle ne s’épanouit guère avec un mari chômeur puis nanti d'un emploi précaire et dévalorisant, peu prévenant, avec qui elle n'a pas vraiment de points communs et deux enfants qui peinent à sortir de l’adolescence. Lui est assureur et ne trouve dans son métier comme dans son couple aucune vraie raison de vivre une vie heureuse. Une conférence à Boston va provoquer leur rencontre qui n'avait pourtant aucune chance de se produire. Bien sûr, cela va être coup de foudre entre eux, un peu comme s'ils s'y étaient déjà individuellement préparés sans même le savoir et cela va durer cinq jours pendant lesquels ils vont se découvrir mutuellement et s'aimer d'un amour passionnel. C'est une situation que nous avons tous connue, soit parce que nous l'avons vécue personnellement, soit parce que nous l’avons rencontrée dans notre entourage. Dès lors des questions se posent, peut-on s'échapper d'une vie qui, à la longue devient, sinon insupportable, à tout le moins difficile à vivre ? Que sera cette nouvelle existence, le moment de passion gommé ? Ne risque-t-elle pas, elle aussi, de devenir routinière, avec en prime, le regret d'avoir peut-être fait un nouveau mauvais choix ? A-t-on le droit, à l'occasion de cette poursuite du bonheur qui par ailleurs est légitime, de compromettre la vie de ceux qui dépendent de soi ? Doit-on forcément se sacrifier pour eux ? Peut-on faire durer artificiellement des situations sentimentalement délétères alors qu'on peut par ailleurs changer de vie et se donner une nouvelle chance ? Peut-on tout bouleverser au nom d'un amour qui ne durera peut-être pas et l'infidélité d'un moment, même si elle est tentante et forcément exaltante s’inscrira-t-elle dans la durée ? Mais peut-on réellement et définitivement répondre à ce questionnement sans fin dans un contexte forcément émotionnel, ce qui induit à terme assurément de la déception, de la détresse et des larmes comme seul rempart contre le malheur. C'est en tout cas une réflexion sur l'existence qui a le mérite d'être ainsi formulée, même si l’épilogue qu'il propose n'est pas de l'ordre du « happy-end » qui ne se rencontre que dans les livres et jamais dans la vraie vie. Il met en évidence, une nouvelle fois les compromissions de la condition humaine, les petits arrangements avec la vie qui nous la font accepter.
Ce texte écrit à la première personne par Laura elle-même est un témoignage émouvant, même s'il peut passer au départ pour une banale entreprise de séduction, une simple envie de profiter d'un moment de liberté. Au début j'y ai vu des longueurs, une première partie assez longue et hésitante puis, au fur et à mesure de ma lecture, le texte a imposé son rythme et l'approche entre Laura et Richard, faite nécessairement d’hésitations et de confidences parfois intimes sur leur parcours, s'est justifiée d'elle-même. Ils ont tous les deux la quarantaine, une expérience matrimoniale réelle, des espoirs déçus, des regrets et des remords mais quand même des plans d'avenir encore possibles, des enfants à épauler parce qu'il faut bien continuer à vivre. La lenteur des dialogues et des postures est devenue inhérente à cette passion naissante qui s'affirme de page en page. Il y a cette empathie réciproque des deux personnages qui n'est pas du tout surfaite telle qu'elle est présentée. Chacun écoute l'autre, comprend ses difficultés au sein du ménage et de la famille qu'il a créé, communie à ses projets et à ses échecs, s'unit à l'autre à travers sa propre connaissance du couple qui est le sien. Elle est faite, comme pour tout le monde, de déceptions, de mensonges et parfois de trahisons, de routine, d'espoirs d'autant plus utopiques que le temps y a imprimé définitivement sa marque. On est davantage dans la confidence mutuelle que dans la « drague » classique et cette période d'attente et même parfois de doute, imposée par le roman, non seulement distille une sorte de suspens mais aussi ajoute à l'intérêt que j'ai personnellement ressenti à cette lecture. Cela donne une dimension plus humaine et authentique à ce roman qui ressemble de plus en plus au fil des pages non plus à une fiction mais à un véritable témoignage. Cela passe par une complicité des instants passés ensemble, par les confessions de chacun, les retours à la réalité à travers les textos que Laura reçoit sur son portable, par la transformation physique de Richard sous l'impulsion de Laura qui n'aurait à l’évidence pas pu avoir lieu sans elle, des projets d'avenir un peu fous, des étreintes pleines de fougue. Dès lors non seulement une passade est possible mais sans doute aussi une décision définitive de changer de vie, à condition de le faire ensemble, malgré tout ce que cette décision peut avoir de bouleversant dans la vie de chacun, entre culpabilité et volonté d'être soi-même et de profiter de l'instant, entre renoncement à une certaine sécurité dans la routine et saut dans l'inconnu avec, en toile de fond, ce mythique « rêve américain » qui pourrait, dans leur cas, se révéler possible. Reste la question, à la fois pertinente et abrupte que pose Kennedy :« Sommes-nous libres de choisir le bonheur ? »
Cela donne l'occasion à l'auteur de livrer à son lecteur, outre ce roman émouvant, des aphorismes bien sentis qu'il puise assurément dans son expérience personnelle, l'écriture prenant ici sa véritable fonction cathartique. Je garde à la mémoire, le livre refermé, une de ses remarques puisée dans un autre ouvrage « Dans mes livres, je rôde toujours autour de l'idée que chaque homme est très doué pour construire sa propre prison, le mariage étant la prison la plus commune. Le couple, rongé par le sentiment confus de culpabilité est l'un de mes thèmes obsessionnels ». Je terminerai ce commentaire par une remarque personnelle. Je ne sais si je dois cela à la fascination qu'exerce sur moi le peintre américain Edward Hopper mais j'ai lu les dernières pages de ce roman avec, dans ma mémoire, certaines de ses toiles, à cause sans doute de la solitude qu'elles distillent et que j'ai ressentie sur la fin.
Dans cette chronique j'ai déjà eu l'occasion de parler de Douglas Kennedy dont je découvre l’œuvre avec curiosité et un réel plaisir. Autant par l'écriture et le style que par l'histoire mais aussi par la pertinente analyse psychologique des personnages, j'ai vraiment apprécié ce roman qui m'engage à poursuivre la découverte des autres ouvrages de cet auteur.
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
UN ETE 42 - Herman Raucher
- Le 23/08/2014
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°792 – Août 2014.
UN ETE 42 - Herman Raucher. - (Traduit par Renée Rosenthal)
En cet été 1942, Pearl-Harbor a déjà eu lieu et les États-Unis sont en guerre, mais les opérations miliaires se déroulent loin du territoire national. Sur une petite île de la Nouvelle-Angleterre des familles viennent passer des vacances. Ici, trois copains, Orcy, Hermie et Benji, tous âgés d'une quinzaine d'années, s'y ennuient un peu et pour eux tous les jours se ressemblent. Cette période est sans doute comme les vacances de tous les garçons à peine sortis de l'enfance qui regardent le monde des adultes sans trop savoir ce qu'il leur réserve, avec envie et appréhension, en tuant maladroitement le temps. Pour jouer aux grands, ils commencent à regarder les filles mais les abordent gauchement. Orcy remarque une jeune femme dont le mari est à la guerre et en tombe amoureux... mais elle a à peu près le double de son âge ! Il l'aborde quand même, il n'est pour elle qu'un garçon serviable et sympathique, mais elle ne pense qu'à cet homme de sa vie qui se bat au loin. Quand elle apprend la nouvelle de sa mort, tué en opération, sa vie bascule et, une seule fois, accorde ses faveurs à Orcy pendant une seule nuit au terme de laquelle elle disparaîtra pour toujours, laissant à d’adolescent le souvenir indélébile d'un premier amour impossible, accompagnant ainsi son passage dans l'age adulte.
Je ne peux évoquer ce livre sans me souvenir du film qui a été réalisé par l’Américain Robert Mulligam en 1971. Je l'ai vu pour la première fois avec émotion il y a bien longtemps, à sa sortie sans doute, et il est resté dans ma mémoire avec précision malgré le temps. Est-ce à cause du sujet traité, de cette période de l'adolescence perturbée de trois garçons, de l’étonnante beauté de l'actrice Jennifer O'Neill, des images sobres et des paysages qui rappellent tellement les tableaux d'Edward Hopper pour qui j'ai, sans me l'expliquer, une véritable fascination ou pour la somptueuse musique de Michel Legrand (Oscar de la meilleure musique) ? Pour tout cela sans doute avec en plus la nostalgie qui s'attache aux souvenirs du temps passé, des choses qu'on aurait dû faire et qu'on a pas faites, par timidité, par peur, en me remémorant mes émois d'adolescent où, face à une jeune fille plus âgée, on souhaiterait avoir quelques années de plus...
A l'origine, ce roman a été écrit par Herman Raucher pour rendre hommage à son ami d'enfance, Orcy, tué pendant la guerre de Corée. Ils passaient ensemble des étés sur l'île de de Nantuket pendant la Seconde Guerre mondiale. Le narrateur s'en souvient longtemps après et évoque ce souvenir. La scène la plus marquante est sans doute celle où la jeune femme, bouleversée par la mort de son mari, entre désespoir et résignation, accorde une nuit d'amour à l'adolescent. Les images sont sobres, sans dialogue, avec seulement le bruit des vagues au loin et la merveilleuse musique de Michel Legrand, si discrètement distillée.
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
MURMURER A L'OREILLE DES FEMMES - Douglas KENNEDY
- Le 15/08/2014
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°787 – Août 2014.
MURMURER A L'OREILLE DES FEMMES - Douglas Kennedy- Belfond.
Traduit de l'américain par Bernard Cohen.
Sacré Douglas Kennedy ! Je ne connais pas sa biographie et encore moins sa vie intime mais si ces douze nouvelles en sont le reflet, puisqu'elle sont écrites à la première personne, même sous le masque d'autres personnages, je me dis que soit c'est une sorte de don Juan, soit c'est un sacré vantard. Car qu'il se cache sous la masque d'un modeste comptable, d'une brillante avocate d'affaires ou d'un professeur respecté, il puise sans doute autant dans son imagination que dans son expérience les modèles qu'il met en scène, même s'il alterne, pour la crédibilité de la lecture sans doute, les hommes et les femmes, l'écriture permettant cette fiction. Ça l'aurait même pris de bonne heure, cette attirance pour l'autre sexe, dès l'âge de 7 ans, à l'entendre, à l’occasion d'une simple rencontre, puis ensuite il aurait connu le grand amour, à supposer bien sûr qu'il existe. Il pourrait même se dire qu'il a été « l’homme de la vie » d'une ou de plusieurs femmes, ce qui est plutôt flatteur et il est de bon ton pour un homme de se vanter de ses succès féminins ou de laisser planer un doute sur ses performances sexuelles! Pour un homme comme pour une femme, c’est tentant de pouvoir se dire « qu'ils sont faits l'un pour l'autre » et que par conséquent ils doivent passer leur vie ensemble. Alors on fait rimer « amour avec toujours », on parle de destin et si on y croit, de Dieu, cela ne coûte rien, mais finalement tout cela est bien artificiel et résiste bien rarement à l'épreuve des faits, du temps et de l'usure des choses, bien des mariages se concluent par un divorce... . Il a sûrement rencontré des femmes avides de se marier et ardemment désireuses de devenir mères mais l'amour est sans doute le domaine qui révèle le mieux la part d'ombre de chacun. Ici elle se nomme lâcheté, trahison, mensonge, adultère quand ce n'est pas, pour briser la routine matrimoniale destructrice ou l'illusion de la sécurité, pour accéder à cette envie de liberté, céder à l'espoir bien souvent déçu de faire fortune ou obtenir la notoriété, de satisfaire à ce désir inextinguible de tout jeter par-dessus les moulins et changer de vie pour l'inconnu ou les fantasme de la nouveauté, la folie quoi ! Le mariage, surtout s'il succède à une déception amoureuse antérieure ne peut que se conclure par un échec[je suis frappé dans ces nouvelles par la facilité avec laquelle les conjoints ou les amants se séparent, souvent pour des raisons sentimentales mais sans oublier la dimension financière cependant]. Sans doute le charge-t-on de trop d'espérances mais je ne suis pas sûr que l'écriture, dénonçant ce désastreux état de choses, en constitue le baume, pas plus d'ailleurs que tous les produits excitants extérieurs... Quant aux relations extra-conjugales, elles ne valent guère mieux et la déconvenue en est souvent l'issue. De quoi êtres vraiment désespéré ! [« Est-ce que ça se passe toujours comme ça ? Vouloir ce que l'on n'a pas, avoir ce que l'on ne veut pas. Pensez qu'il existe une autre vie « là-bas » et redouter de perdre celle qui est ici. Ne jamais être sûr de ce que l'on poursuit... » et puis aussi « Rappelle-toi, petit, on est seul, toujours seul »].
Il y a aussi cette certitude qu'ont certains de n'être pas faits pour être heureux, à côté de qui le bonheur passera toujours... sans s'arrêter et pour qui le choix dans cette matière sera toujours mauvais quoiqu’ils fassent.
C'est vrai que la condition humaine est un spectacle à la fois changeant et constant et quand on choisit l'aspect amoureux des relations entre les gens, le mariage qui épuise l'amour pourtant si ardemment promis et qui transforme les époux en véritables étrangers l'un pour l'autre, quand ce n'est pas pire, avec au bout du compte bien souvent la résignation... ou l'irréparable ; c'est là un sujet inépuisable pour qui veut en parler et je crois de Douglas Kennedy le fait bien. Il promène un regard désabusé sur les hommes et les femmes qui composent cette chose étrange qu'on appelle la société avec ses convenances, ses règles, son hypocrisie. Le fait que ce recueil se termine par un improbable conte de Noël veut-il il cependant dire que tout espoir n'est pas perdu ou au contraire que ce monde n'existe que parce que nous y instillons de temps en temps des choses qui n'arrivent que dans les livres ?
Si, dans ces textes, il fait simplement œuvre d’écrivain, non seulement c'est bien observé mais aussi c'est bien écrit. Je ne sais pas si c'est grâce à son style ou à la traduction mais le texte est agréable à lire.
J'ai déjà dans cette chronique l'intérêt que je porte aux romans de Kennedy. L'univers de la nouvelle est très particulier et j'avoue une attirance pour ce genre littéraire. Là je n'ai pas été déçu .
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
INCONNU A CETTE ADRESSE - Katrine Kressmann Taylor
- Le 14/07/2014
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°762 – Juillet 2014.
INCONNU A CETTE ADRESSE – Katrine Kressmann Taylor – Éditions Autrement.
Traduit de l'américain par Michèle Lévy-Bram
Le titre ressemble à la mention qu'on peut lire sur une enveloppe qui n'a pas atteint son destinataire. Il ne s'agit en effet pas d'un roman au sens traditionnel du terme comme on peut le lire sur la couverture mais d'une succession de lettres, correspondance fictive échangée entre deux hommes, Martin Schulse, un Allemand et Max Eisenstein, un juif américain, propriétaires d'une galerie de tableaux à San Francisco. Ils sont liés par des liens amicaux, presque fraternels. Nous sommes en 1932 et Schulse décide de retourner à Munich pour y élever ses enfants laissant Max dans une solitude affligeante. Là commence cet échange de lettres qui fait allusion à la liquidation de leur société et la nouvelle vie de Martin. La République de Weimar vient d'expirer et le nazisme est en marche. Au départ, Martin se définit comme un libéral, favorable à la paix. D'amicaux au début, le termes de ces missives vont devenir enflammés de la part de Martin qui rapidement fait siennes les thèses du national-socialisme au point que cette amitié du départ se mue en haine viscérale, intense, destructrice. Bien entendu Martin devient antisémite, ce qui, dans le cadre de ce livre est révélateur et il renie l'amitié qui jadis le liait à Max.
C'est, certes l'illustration d'une manipulation des gens, un lavage de cerveau à grande échelle, l'endoctrinement des Allemands mais aussi des peuples conquis ce qui donne à penser que les thèses développées par ce régime sont sans doute latentes chez chacun d'entre nous et n'attendent pour se manifester et se développer que ce genre d'occasion. Les masses populaires sont dans l'attente d'un chef et si celui-ci manœuvre habillement, si les circonstances lui sont favorables ou le contexte politique et économique difficile comme s'était le cas dans l'entre-deux guerres tout devient possible et l'instinct grégaire fait le reste. Dans l'esprit de Martin, Hitler est un sauveur et il faut lui faire confiance, le suivre aveuglément.
J'ai lu passionnément ce livre non parce qu'il est une énième évocation (prémonitoire) du nazisme et de son action dévastatrice sur le monde mais surtout parce qu'il est l'illustration de la fragilité des relations qui existent entre les êtres humains. On les dit indestructibles et les serments ne manquent pas pour proclamer leur pérennité, leur indestructible solidité puis le hasard, la marche des choses, l'évolution des idées quand ce n'est pas simplement les intérêts gomment simplement tout cela. C'est une façon de rappeler que l’oubli, la trahison, l'opportunisme font partie de l'espèce humaine, la caractérise au même titre que l'humanité, la culture, la tolérance et autres qualités dont on se plaît à la parer et dont je suis de plus en plus sûr qu'elles ne peuvent s'appliquer qu'à un nombre infime d'individus et non au plus grand nombre.
C'est un texte bref(une vingtaine de lettres) mais d'une extrême intensité, une sorte de miroir qui nous renvoie une image de nous-mêmes sans complaisance à travers une fiction historique originale. C'est un texte très actuel.
L'auteure, écrivain américaine d'origine allemande (1903-1996) est principalement connue pour cette nouvelle écrite en 1938 et publiée sous le pseudonyme masculin de Kressmann Taylor en 1939, donnant à penser qu'un tel écrit ne pouvait émaner que d'un homme ! Interdite en Allemagne, elle fait l'objet d'une adaptation cinématographique en 1944. Rééditée en 1995 pour le 50° anniversaire de la libération des camps de concentration, cette nouvelle a été traduite en 20 langues.
©Hervé GAUTIER – Juillet 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
11 NOVEMBRE - Paul Dowswell
- Le 18/05/2014
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°751 – Mai 2014.
11 NOVEMBRE – Paul Dowswell.- Éditions Naïve.
Traduit de l'anglais par par Christine Auché.
Nous sommes le 11 novembre 1918, à quelques heures de l'armistice et parmi tant d'autres, trois jeunes gens sont au front. Bien entendu ils ne savent pas qu'ils vivent les dernières heures de ce conflit et continueront de se battre parce que c'est leur devoir. L'un est allemand, Alex, l'autre anglais, William, ils sont fantassins, quant au troisième c'est Eddy, un officier, pilote de chasse américain. Tous les trois sont jeunes et pleins d'illusions, de peur aussi. L'auteur nous fait découvrir leur vie antérieure au conflit, leur famille, leurs aspirations, leurs projets...
Il y a des rumeurs de mutineries dans le camp allemand, le conflit avait duré longtemps et avait été gourmand en vies humaines puisque maintenant des adolescents combattent au côté de vieillards. L'Allemagne a tout sacrifié pour une victoire qui maintenant lui échappe, pourtant il est impossible que ce pays perdre la guerre !
Les fantassins allemands et anglais connaissent la dure vie des tranchées, les gaz, les charges meurtrières, la mauvaise nourriture, les missions périlleuses, les tireurs embusqués, l'odeur des cadavres, le terrain gagné puis reperdu, le devoir d'obéissance aveugle aux ordres... Pour eux l'obsession c'est la mort brutale et rapide ou au contraire lente et douloureuse au point qu'ils souhaiteraient, malgré l'instinct de survie, que la Camarde abrège leurs souffrances s'ils venaient à être grièvement blessés. C'est aussi un simple geste, un réflexe qui peut parfaitement être interprété comme une volonté de désertion et punie de mort par sa propre armée. C'est la certitude de vivre « dans un monde sans gouvernail », seulement guidé par la chance.
Alors que les combats au sol sont meurtriers et aveugles, que les bombes et la mitraille tuent anonymement, les affrontements aériens ont encore une sorte de dimension chevaleresque. Certes il y a les bombardements aériens, mais en plein ciel, quand on affronte son ennemi, le combat est singulier, on respecte l'autre pilote et quand il est vaincu on lui laisse la vie sauve s'il s'est battu loyalement. C'est en quelque sorte une manière de se battre différente au sein d'un même conflit. Pour Eddy ce qui compte c'est d'abattre son cinquième avion ennemi pour mériter le titre d' « as de l'aviation » et rentrer au pays auréolé de cette gloire alors qu'il sait parfaitement que le conflit touche à sa fin.
Signé à 5 heures du matin, l’armistice devait être effectif à 11 heures mais la nouvelle n'en a pas été connue de tous en même temps. Cela signifiait que, de chaque côté, de nombreux hommes allaient mourir pour rien à cause de malentendus, de tirs d'artillerie isolés, de mines ou d'obus non encore explosés.
Cette guerre avait déjà montré des moments de fraternité entre ennemis où l'on oubliait pour un temps les combats qui reprenaient après, mais ici, à la suite d'un épisode qu'on ne voit que dans les romans, ces trois hommes qui ne se connaissaient pas et qui n'avaient en commun que la volonté de se battre pour leur Patrie et de sauver leur vie vont se rencontrer et faire taire leur rancœurs parce que toute cette boucherie qui a duré quatre années est enfin terminée et qu'il faut faire prévaloir la vie. C'est Eddy qui apprendra à Axel, lors de cette improbable rencontre que l'armistice est enfin signé, mais il le fait en allemand parce que, s'il est un vrai américain, ses parents ont émigré d'Allemagne aux États-Unis quelques quarante ans auparavant. Cette entrevue a quelque chose de surréaliste, un dilemme cornélien autant qu'un piège mortel entre deux hommes que tout oppose.
Les détails techniques et historiques sont précis, l'atmosphère des combats est réaliste mais le style n'a pas vraiment retenu mon attention. Il m'a fallu du temps pour entrer dans ce roman, non pas qu'il soit inintéressant bien au contraire, mais peut-être parce que, en cette année où l'on célèbre le centenaire de la Grange Guerre beaucoup d'ouvrages sont déjà parus sur ce sujet. Pourtant l'intérêt n'est vraiment venu que dans les dernières pages parce que les choses reprennent leur vraie place, la dure loi de la guerre sa logique implacable avec ses miracles et ses horreurs, ses injustices et son spectacle de désolation.
.
©Hervé GAUTIER – Mai 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
ACCORDEZ-MOI CETTE VALSE- Zelda Fitzgerald
- Le 03/04/2014
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°738 – Avril 2014.
ACCORDEZ-MOI CETTE VALSE- Zelda Fitzgerald- Robert Laffont.
Traduit de l'américain par Jacqueline Remillet.
Zelda (1900-1948)est l'épouse du romancier américain Scott Fitzgerald. Ce livre est son unique roman écrit en trois semaines en 1932 qui est le pendant ou peut-être une forme de réponse à « Tendre est la nuit »(La Feuille Volante n°721) mais vu par une femme au destin tragique. Il fut boudé par la critique à sa sortie mais Scott lui-même en corrigea les épreuves. Elle avait été une jeune fille séduisante mais excentrique et capricieuse, élevée avec ses sœurs dans une famille rigide mais heureuse du Sud. Elle était l'objet de l'attention des hommes qui la désiraient et dont elle se jouait à l'occasion en multipliant les flirts. En épousant Scott, ils formaient un couple mondain, emblématique de cet âge d'or de l'entre-deux-guerres. Cette union fut cependant orageuse, ponctuée par la lente décrépitude de Scott miné par l’alcool et par la folie de Zelda qui périt dans l'incendie du pavillon où elle était soignée.
Il s'agit là d'un roman autobiographique où elle apparaît sous le nom d'Alabama Beggs qui épousa un jeune artiste peintre promis à un brillant avenir, David Knight, alors lieutenant de réserve. David devient rapidement célèbre et le couple s'étourdit dans des fêtes où l’alcool coule à flots. Ils s'installent à New-York où David pourra davantage s'épanouir mais à cause de la prohibition, ils partent pour la France et ce sera Paris et la côte d'Azur, ses palaces et sa douceur de vivre. La naissance de Bonnie fait d'eux un couple accompli. A cette époque Alabama rencontre un jeune aviateur français, mais ce qui est présenté comme un simple flirt révèle déjà une fêlure dans le couple et Alabama est délaissée. Ils reviennent à Paris puis David, torturé par la jalousie, s'installe en Suisse avec leur fille Bonnie et Alabama s’initie à la danse, part pour Naples et commence à prendre des tranquillisants peut-être pour combattre sa culpabilisation de s'occuper mal de sa fille, peut-être aussi pour exorciser l'échec de sa carrière de ballerine puisqu'un accident y met brutalement fin. Ce roman se termine par la mort du père d'Alabama.
Tout au long de ce roman, Alabama cherche à se mettre en valeur par rapport à David qui lui devient de plus en plus un artiste célèbre. Elle choisit la danse et la travaille d'une manière effrénée pour devenir une grande ballerine mais le hasard s'en mêle et c'est un échec. C'est bien une femme blessée qui nous est présentée ici et qui cherche désespérément à combattre la célébrité de son mari en s'exprimant elle aussi par l'art. Qui fut donc réellement Zelda ? Une femme qui a vécu sa vie comme un rêve ou un être qui a poursuivi des chimères et existé dans l'ombre de son époux jusqu'à en devenir folle.
J'avais lu « Alabama song » de Gilles Leroy (La Feuille Volante n° 337) qui est une entrée en matière, d'autant que l'auteur y présentait Zelda comme une sorte de victime de Scott et qui devait lutter contre lui pour exister. Le style de « Accordez-moi cette valse » est parfois déconcertant, laborieux même et m'a un peu gêné mais la post-face peut peut-être apporter une explication. Il semblerait d'ailleurs que ce texte ait été visé par Scott lui-même et que de cette correction ait donné un roman moins personnel. Ce style peu attirant veut probablement traduire un mal-être qui est celui de l'auteure. J'ai choisi de lire ce roman parce qu'il était complémentaire de celui de Scott Fitzgerald dans l'univers créatif de qui je ne suis pas jamais parvenu à entrer pleinement. Ce livre de Zelda m'a carrément déçu.
©Hervé GAUTIER – Avril 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA POURSUITE DU BONHEUR - Douglas KENNEDY
- Le 28/02/2014
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°729 – Février 2014.
LA POURSUITE DU BONHEUR – Douglas Kennedy – Belfond.
Traduit de l'américain par Bertrand Cohen.
Tout commence le jour des obsèques de Dorothy, la mère de Kate Malone à New-York. A cette occasion, comme toujours, toute la famille est réunie. Il y a là Charlie, le frère de Kate, au parcours un peu cahoteux, pas vraiment ravi est surtout pressé de repartir, Meg, une tante alcoolique et bien entendu Kate et son fils Ethan, bref une fratrie désunie où de vieilles querelles mal digérées refont surface. Le père Jack Malone est mort depuis longtemps et Kate se surprend à penser « Ça y est. Orpheline, enfin ! ». Une vieille dame qui lui est complètement inconnue assiste à la cérémonie cherche à se rapprocher d'elle. Elle se nomme Sara Smythe et, fait tout ce qu'elle peut pour entrer en contact avec elle au point même de brusquer un peu les choses et finalement pour lui donner un album de photos et lui révéler que son père, Jack, fut le grand amour de sa vie. Kate va donc découvrir l'histoire de sa propre famille à partir de cet épisode. Dès lors, Douglas Kennedy va user de l'analepse qu'il affectionne pour nous conter une histoire d'amour hors du commun. Elle sera bien entendu malheureuse, émaillée de moments intenses mais aussi de déprimes profondes. Si les parents de Kate n'ont pas été heureux ensemble, ceux de Sara ont vécu la même union dénuée d'amour et leurs enfants n'ont eu de cesse de fuir cette famille, tout en recopiant le modèle ! La vieille dame va raconter à Kate ce que fut sa vie, pas vraiment traditionnelle, plus axée sur la liberté professionnelle et sentimentale, sa rencontre avec son père, leur amour fou né d'un premier regard - hasard ou destin. Nous étions en 1945 à New York et après une nuit torride et des serments échangés, Jack, alors reporter dan l'armée américaine, part pour l'Europe. Dès lors ce sera le silence de cet homme dont elle avait décidé d'attendre le retour, la désolation, la dépression, le désespoir puis le ressaisissement, apparent seulement, le mariage avec un autre homme n'étant qu'une lamentable et courte erreur !
L'auteur va se lancer dans une saga qui va des années 50 à nos jours pour nous faire partager la vie de la famille de Sara ou plus exactement le destin croisé de Kate et de Sara, deux femmes qui sont pourtant différentes l'une de l'autre et qui ne se connaissaient pas avant l'enterrement.. C'est que la vie de Sara a été illuminée par deux hommes, Eric d'abord, son frère, dandy, homo, ancien membre du parti communiste dans sa jeunesse qui a toujours été là pour elle, surtout dans les moments difficiles et Jack Malone. Son frère était tout pour elle, leur complicité était complète, mais sa vie à lui s'inscrit dans le maccarthysme, cette épisode sombre des États-Unis plus connu sous le nom de « chasse aux sorcières » qui poursuivit non seulement les communistes mais aussi au homosexuels. L'auteur ne se prive pas de la critiquer. Ses méthodes n'avaient rien à envier à celles en usage au-delà du Rideau de Fer. Les événements auront raison de lui. Pour Jack Malone, c'est un peu différent, puisque, militaire dans l'armée américaine quand elle l'a rencontré, il a simplement choisi de profiter de cela pour l'abandonner, et pour fonder une famille, sans elle ! Si la liberté, l'indépendance, les voyages ont caractérisé la vie de Sara à une époque où la femme américaine était plutôt cantonnée dans un rôle traditionnel d’épouse et de mère de famille, Kate au contraire, à cause sans doute d'un parcours sentimental agité a toujours recherché la sécurité du foyer et du mariage. Ce fut pour cette dernière la rencontre avec Matt et la naissance d'Ethan, leur fils. Cela a simplement mal tourné pour elle et le divorce a été au bout du chemin, encore un échec ! Sara elle aussi a connu des déboires sentimentaux et même un éphémère mariage avorté qui étaient dus dans doute à ce Jack qu'elle ne parvenait pas à oublier. Elle a eu une vie trépidante cependant mais avec l'écriture comme exutoire, comme compensation à toutes ces désillusions. Si au départ elle doute, se rendant responsable de sa sécheresse littéraire, son talent créatif s'affirme au fur et à mesure que sa liberté se confirme. Sauf que rien n'est simple, dans la vie comme dans les fictions et un jour d’hiver, par hasard, à Central Park,, elle rencontre Jack quatre ans après leur nuit torride. Bien sûr il est marié et père de famille, bien sûr il y a plus tard, avec Sara, une explication et tout est remis en question parce que, pour lui aussi, le mariage n'est pas vraiment une réussite et que tout redevient possible avec elle.... Mais ce serait compter sans les vicissitudes de la vie, la culpabilisation, le temps qui passe, les deuils, les départs qu'on voudrait sans retour, le pardon toujours possible ...,
Comme à chaque fois, l'auteur excelle dans l'analyse psychologique des personnage qu'ils nous présente alternativement et leurs réactions face à l'Amérique puritaine et hypocrite de cette période. Il semble nous dire que ce bonheur est inatteignable simplement parce que l'homme et la femme, qu'ils forment un couple mariés ou qu'ils soient simplement amants, sont pleins de contradictions qu'ils mènent cette quête impossible avec une apparente sincérité et des serments qui se veulent définitifs mais que celle-ci ne pèse rien face à la trahison, au mensonge, aux autres tentations auxquelles ils se dépêchent de succomber, aux nombreuses compromissions qui émaillent leur vie, parce qu'il faut payer pour ses fautes [« Il n'y a pas d’actes sans conséquence s. Des fois on a la chance d'y échapper mais des fois il faut payer »] et que le hasard fait partie du jeu, que l'instant pèse sur notre décision... Sara et Jack se débattent dans une liaison qui semble sans issue, avec ses moments d'intense bonheur et de profondes dépression. Elle ne se sera vraiment interrompue que par la mort de Jack, Eric qui soutient constamment sa sœur se verra lui aussi reprocher par le maccarthysme son ancienne adhésion au communisme et son homosexualité, une façon aussi de faire échec à son bonheur, mais aussi d'entacher quelque peu des relations fraternelles qu'il entretient avec Sara.
Kennedy nous offre ce roman, selon son habitude, avec un talent de conteur que nous lui connaissons, avec un style que ne trahit pas la traduction. Il réussit à émouvoir son lecteur attentif simplement parce celui-ci, pour peu qu'il ait un peu vécu, ne peut pas ne pas se reconnaître !
©Hervé GAUTIER – Février 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
L'ANTARCTIQUE - Claire KEEGAN
- Le 20/02/2014
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°727 – Février 2014.
L'ANTARCTIQUE – Claire Keegan – Sabine Wespierser Editeur.
Traduit de l'anglais par Jacqueline Odin.
J'avais lu « Trois lumières » avec émotion(La Feuille Volante n° 724)et « A travers les champs bleus »(La Feuille Volante n°725) avec curiosité ; Ce recueil m'a laissé un goût un peu différent. J'y ai retrouvé avec plaisir le style poétique et simple de Claire Keegan, en revanche, les thèmes traités dans ces quinze nouvelles m'ont paru de prime abord variés voire assez confus.
Il y a toujours les amours malheureuses et contrariées. « L'amour dans l'herbe haute » parle d'une liaison impossible et avortée entre une jeune fille et un homme plus âgé qui ne quittera pas sa famille pour elle. Neuf années après cette passade, elle n'a pas oublié mais cela ne change rien. Dans « Drôle de prénom pour un garçon », nous voyons une narratrice qui revient annoncer à un homme avec qui elle a passé six nuits furtives pour Noël qu'il est père de l'enfant qui va naître, qu'elle va le garder sans l'obliger à se marier avec elle (j'ai lu ce texte comme un long poème tant il est musical). On ne sait pas ce qui adviendra de cette première rencontre entre Roslin et Guthrie qui ont fait connaissance à partir d'une annonce et qui conviennent de passer cette première journée dans une fête foraine (« Osez le grand frisson ») et peut-être au motel voisin. « L’Antarctique » nous conte l'histoire d'une femme mariée, mère de famille à qui il prend l'idée folle de coucher avec un autre homme inconnu qu'elle choisit au hasard dans un bar et qui se demande, en fin de compte comment va se terminer cette toquade et si elle reverra sa famille. C’est aussi cette envie d'ailleurs que pratique par habitude Cora avec Smethers, le facteur (« La caissière chantante ») pour finalement y mettre fin. Dans « Le sermon à la Ginger Rogers », la narratrice, une très jeune fille qui se présente elle-même comme quelqu’un qui a « le goût des sucreries et une attirance pour les hommes » se glisse dans le lit de Jim Slapper lequel choisit ensuite de mettre fin à ses jours.
Les relations familiales difficiles sont également illustrées comme dans « Les sœurs » qui met en scène Betty, la vielle fille pauvre qui est restée à la ferme avec son père et Louisa, sa sœur, mariée et mère de famille qui vit richement à la ville. Une période de vacances passée à la ferme maintenant habitée seule par Betty va faire ressurgir de vieux différents. La famille est un thème de prédilection pour l'auteure avec ses relations difficiles voire impossibles entre les différents membres de la parentèle (« Les palmiers en flammes » - « La soupe au passeport » où un mère accuse son mari de la disparition de leur fille) ou lorsque la folie d'une mère produit des ravages irréversibles sur ses enfants (« Brûlures »- « Orages »). « On n'est jamais trop prudent » s'inscrit dans l'anecdote avec cependant un contexte d'adultère et d'assassinat et « Le parfum de l'hiver » évoque la destruction d’une femme après un viol.
Après la lecture de ce recueil, j'ai retenu la multiplicité des thèmes, ils illustrent la fascination de la mort, une certaine désespérance qui engendrent la folie d'un moment ou d'une vie, ils sont axés sur les relations difficiles entre les êtres, que cela soit en termes amoureux ou au sein d'une même famille. L'auteur analyse finement, le plus souvent à travers les yeux d’une femme, ce que sont ces rapports qui régissent leur existence individuelle ou collective leurs joies et leurs épreuves. Je me suis alors rappelé la dédicace qui fait, comme le texte des nouvelles, partie du livre et en dit parfois aussi long que lui mais en termes plus laconiques « Pour P.H. qui m'a secourue dans des moments difficiles ». Soudain, il m'est apparu une explication possible de ces thèmes apparemment si douloureux. L'écriture n'est pas seulement pour l’auteure l'occasion de raconter une histoire, certes bien écrite, à son lecteur pour le distraire ou pour faire naître son intérêt personnel. Écrire ne consiste pas non plus, même pour un écrivain, à aligner des mots pour faire des phrases puis des textes, pour le seul plaisir de donner libre court à son imagination. Elle est aussi pour lui une manière d'exorcisme face aux vicissitudes que la vie lui impose. Comme chacun il les supporte et les combat mais en ce qui le concerne, mettre des mots sur ses maux est une autre manière de s'opposer à leur action dévastatrice . Dès lors, au-delà de l'histoire qu'elle raconte, ces nouvelles prennent un sens différent et peut-être aussi un intérêt pour moi. C'est à tout le moins l'explication que je choisis de donner.
Comme à chaque fois, ces nouvelles ont été pour moi un bon moment de lecture.
©Hervé GAUTIER – Février 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA DANSE DES OMBRES HEUREUSES - Alice Munro
- Le 19/02/2014
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°726 – Février 2014.
LA DANSE DES OMBRES HEUREUSES – Alice Munro – Rivages
Traduit de l'anglais par Geneviève Doze.
Ce recueil de sept nouvelles date des années soixante dix. Il n'est donc pas vraiment récent mais comme je l'ai déjà dit dans cette chronique, la nouveauté ne saurait être le seul critère d'intérêt pour un livre.
« Le cowboy des frères Walker » met en scène un père de famille qui a dû, après de mauvaises affaires comme éleveur de renards se reconvertir comme représentant. Un jour il amène ses enfants avec lui en tournée et dépasse un peu son secteur rural pour rencontrer Nora qu'apparemment il connaissait déjà. J'ai le sentiment qu'il regrette sa vie d'avant, et peut-être son mariage. Avec « La danse des ombres heureuses » qui donne son titre au recueil nous voyons une vieille dame, Miss Marsalles, professeur de piano qui donne chez elle sa séance musicale annuelle avec ses élèves. C'est tous les ans le même rituel et cela ne s'arrange guère mais cette année un groupe d'enfants un peu attardés venus d’une autre école participent au spectacle. Parmi eux une jeune fille se met au piano pour interpréter une pièce inconnue jouée par elle passablement. Miss Marsalles s'en déclare satisfaite mais cet épisode montre à toute l'assistance que le vieux professeur n'est décidément plus de son temps. « La carte postale » évoque Helen, une jeune fille qui reçoit une carte de Clare, un garçon de douze ans son aîné, parti en Floride et dont elle attend le retour. Elle en parle avec sa mère et se souvient qu'il a eu un temps l'envie de l'épouser mais elle a refusé, préférant Ted Forgie, au grand dam de sa mère. Or il s’avère que Clare est allé en Floride pour se marier et Helen prend cela comme un coup de massue. Elle pète même carrément les plombs quand il revient en ville. « Images » relate une étrange anecdote où il est question d'une infirmière célibataire qui est aussi la cousine de la narratrice. Cette dernière fait avec son père une promenade dans la nature afin de relever des pièges et il rencontrent un homme un peu sauvage qui vit dans une cave avec un chat alcoolique ! « Quelque chose que j'avais l'intention de te dire » met en scène deux sœurs Ette et Char qui reviennent sur leur passé commun. Char était amoureuse d'un jeune homme, Blaikie Noble, au point qu'elle avait même tenté de se suicider en apprenant son mariage avec une autre femme. Elle a ensuite, par dépit, épousé Arthur, un professeur d'histoire plus vieux qu'elle mais Ette est restée célibataire. A la mort de Char (peut-être volontaire et réussie cette fois), cette dernière s'était rapprochée d'Arthur et avait l’intention de lui faire des révélations sur Char avant de mourir mais elle hésitait encore. A cette lecture, on a l'impression qu'elle ne le fera jamais parce qu'Arthur est resté amoureux de Char, même dans la mort. « La vallée de l'Ottawa » est une somme d'anecdotes familiales et « Le matériau » relate l'histoire d'une femme qui a eu une fille avec un homme de Lettres, Hugo, qu'elle n'a pas épousé. Elle s'est mariée ensuite avec un ingénieur et lit par hasard une nouvelle Hugo qui s'inspire d'une anecdote dont elle se souvient du temps où elle vivait avec lui. Ainsi, il transforme en personnage de roman une modeste voisine. Maintenant qu'elle n'est plus avec lui, la narratrice confesse qu'elle n'a jamais cru au talent d'Hugo et se retrouve envieuse de sa réussite. C'est, à titre personnel, la nouvelle qui m'a le plus parlé.
Ces nouvelles nous sont contées par une narratrice aussi simplement qu'elle nous raconterait une histoire, presque sur le ton de la confidence, avec cependant un grand souci du détail et une écriture agréable à lire. Pour autant on a l'impression qu'il ne se passe rien et que l'ambiance de chaque texte est un peu morne, que les personnages sont un peu falots et sans grand relief. L’auteure reprend ici des thèmes favoris, celui de la véritable personnalité parfois complexe de ses personnages derrière leur masque et leur volonté de garder intacts leurs secrets et peut-être leurs illusions, de fuir aussi pour continuer à vivre simplement même si cette vie n'est pas exaltante. Elle est aussi attentive aux relations entre parents et enfants et reste fidèle à l'implantation géographique canadienne. Il est souvent question de ménage raté, d'amours contrariées, de temps perdus, de regrets et de remords. Au moyen d'analepses, elle évoque le temps qui passe, rendant compte de la fragilité de la vie dont chacun de nous n'est que l’usufruitier. J'avoue que j'ai été un peu déçu par ce recueil, pas vraiment passionné par ce que j'ai lu.
L'univers de la nouvelle est toujours délicat à aborder pour un lecteur. De plus, à l'évidence, cette auteure que je ne connaissais pas avant l'attribution de son Prix Nobel en 2013 mérite toute mon attention. Cette distinction prestigieuse m'invite a poursuivre ma découverte cependant.
©Hervé GAUTIER – Février 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
A TRAVERS LES CHAMPS BLEUS - Claire KEEGAN
- Le 14/02/2014
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°725 – Février 2014.
A TRAVERS LES CHAMPS BLEUS – Claire KEEGAN – Sabine Wespieser Éditeur
Traduit de l'anglais par Jacqueline Odin.
Ces nouvelles de Claire Keegan sont le reflet de l'Irlande traditionnelle solitaire, sauvage, profondément catholique, pleine des traditions populaires et religieuses. Elles mettent en scène des êtres le plus souvent volontairement retirés du monde comme Margaret de « La nuit des sorbiers » qui vit seule dans une maison de la côte, dans le souvenir de sa jeunesse passée et de ses espoirs déçus. Solitaire aussi cette auteure de « La mort lente et douloureuse » qui se retrouve en résidence dans la maison d'un ancien Prix Nobel pour y trouver une inspiration qui ne vient pas et, dérangée par un fâcheux, se venge en le transformant en héro de roman et lui prête un cancer qui le fera mourir à petit feu.
Avec « Le cadeau d'adieu », la narratrice part pour New-York dans le seul but de fuir une famille rurale un peu bizarre et surtout tourner la page de l'attitude incestueuse de son père. Elle a été un peu abandonnée par cette famille, livrée à elle-même et elle part donc sans regret vers une nouvelle vie et surtout sans retour [c'est aussi une allusion à la forte émigration irlandaise vers les États-Unis]. Solitude encore que celle de ce brigadier volage de « Renoncement » qui voit s'enfuir son amour. [« L’espoir est toujours la dernière chose à mourir »]. C'est aussi une forme d'isolement que celui de ce prêtre de « A travers les champs bleus », amoureux d'une femme qu'il ne peut épouser simplement parce qu'il ne veut pas renoncer à la prêtrise et à un Dieu qu'il ne verra jamais mais dont il doute. Seul curé de la paroisse, il doit même la marier à un autre homme et cela le bouleverse.
Il y a beaucoup de prêtres dans ces nouvelles. Ils existent soit comme des fantômes, comme dans « La nuit des Sorbiers » soit comme des personnes réelles dans « A travers les champs bleus ». Leur point commun est l'amour, mais pas celui de Dieu, celui de femmes qu'ils ne pourront jamais avoir vraiment à cause de la mort ou de leur état de prêtre auquel ils ne veulent pas renoncer. Il est de même beaucoup question d'amours impossibles dans ce recueil et pas seulement chez les ecclésiastiques. Dans « Chevaux noirs » des hommes ordinaires rêvent à des femmes inaccessibles, ou elles-mêmes se résolvent au mariage et à l'enfantement parce que c'est le destin d'une femme et qu'il ne faut pas laisser passer une dernière chance(« L’époque l'imposait. C'est ce que je croyais. Je pensais ne pas avoir le choix »). Pour cela Martha accepte d'épouser Victor, un robuste travailleur mais le trompera sans vergogne lui donnant un enfant qui se révèle être adultérin. Les relations entre les gens d'une même famille semblent impossibles, tout est gouverné par le patrimoine qu'il faut conserver, la bière brune, le whiskey, les apparences qu'il ne faut surtout pas trahir, la messe à laquelle il faut assister hypocritement faute de quoi on est rejeté de cette communauté... Il n'y a pas seulement les liens entre époux qui sont distendus voire inexistants, il y a aussi ceux entre parents et enfants qui sont rendus impossibles par les circonstances (« le cadeau d'adieu », « la fille du forestier », « Près du bord de l'eau »). N'oublions pas que nous sommes dans une société rurale où le poids des traditions existe (« La nuit des sorbiers »] mais aussi celui des superstitions, celui de l'hypocrisie.
J'ai récemment fait connaissance avec l’œuvre de Claire Keegan. J'en apprécie le style à la fois simple et poétique.
©Hervé GAUTIER – Février 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LES TROIS LUMIERES - Claire KEEGAN
- Le 10/02/2014
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°724 – Février 2014.
LES TROIS LUMIERES – Claire KEEGAN – Sabine Wespieser Éditeur
Traduit de l'anglais par Jacqueline Odin.
Parce que sa mère est enceinte une nouvelle fois, qu'elle représente une charge pendant cette période et que sa fratrie est bien trop grande pour cette famille irlandaise rurale trop pauvre, la narratrice encore enfant est confiée par un père pas très futé et aussi pas mal alcoolique, à la garde d'une famille voisine, les Kinsella. On ne sait combien de temps durera ce séjour, six mois, peut-être davantage, mais c'est décidé. « Elle mange mais vous pouvez la faire travailler » dit le père comme il est d'usage à la campagne mais l'enfant est bien accueillie et il n'est pas question de l'exploiter « Hors de question, cette petite aidera Edna dans la maison, rien de plus ».
En ce jour d'un été brûlant, elle débarque donc avec son père dans cette ferme et celui-ci, sans doute distrait, oublie sa valise dans le coffre de sa voiture. Il faut donc que la petite fille, baptisée Pétale, se change. En attendant d'aller à la ville voisine pour lui acheter des vêtements, on l'affuble de ce que l'on a c'est à dire d'effets masculins un peu trop grands pour elle. Elle s'adapte donc à sa nouvelle vie en aidant comme elle le peut Edna, la mère et John, le père qui la considèrent d'emblée comme leur propre fille. Au début, elle est un peu dépaysée, le décor est nouveau pour elle, les gens aussi sans doute et la fillette pose des questions. Edna la met en confiance avec cependant une réponse qui lui paraît peut-être un peu sibylline « Là où il y a un secret, il y a de la honte et nous n’avons pas besoin de honte ». Cette nouvelle famille fait ce qu’elle peut pour la rendre heureuse mais elle est toujours un peu sur la défensive et dans son for intérieur il y a toujours une partie d'elle qui pense différemment, qui est en retrait. Le temps s'écoule pourtant dans ce nouveau décor où elle se rend utile, où elle est peut-être heureuse.
Dans cette ferme, on est loin des événements extérieurs, des gens qui font la grève de la faim volontairement et en meurent pour s'opposer au gouvernement. Pétale ressent un bien-être intérieur et se demande inconsciemment quand tout cela se terminera. La vie s'étire lentement au rythme de la campagne, des travaux domestiques, la confection des confitures, les parties de cartes, la messe du dimanche et même une veillée funèbre. On lui achète des vêtements de fille, on lui offre des friandises (« N'est-elle pas là pour qu'on la gâte ? » confie John, heureux d'avoir un enfant sous son toit) mais c'est une voisine un peu trop pipelette qui lui raconte l'histoire de cette famille sans enfant, lui parle de son deuil.
Le séjour prend fin parce que la naissance attendue dans sa famille est arrivée et qu'il lui faut retourner en classe. La parenthèse estivale se ferme donc et Pétale se prépare à retourner chez ses parents. Au dernier moment elle tente de rester avec les Kinsella, d'être cette « troisième lumière » qui leur manque tant, d'être aimée vraiment...
Un temps j'ai eu l'impression d'être dans une nouvelle de Maupassant quand des paysans pauvres vendaient leurs enfants à des gens riches sans descendance et ainsi assuraient leur avenir. Ce court récit est à la fois émouvant et poétique et m'encourage à poursuivre la découverte de l’œuvre de Claire Keegan.
©Hervé GAUTIER – Février 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
AMIE DE MA JEUNESSE - Alice Munro
- Le 08/02/2014
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°723 – Février 2014.
AMIE DE MA JEUNESSE – Alice Munro – Albin Michel. [1990]
Traduit de l'américain par Marie-Odile Fortier-Masek.
L'auteure, écrivain canadien née en 1931 est essentiellement connue pour ses nouvelles. Elle a reçu le Prix Nobel de littérature en 2013.
Ce livre rassemble dix nouvelles qui semblent se dérouler dans les années 60 soit dans l'Ontario, soit sur un bateau ou en Europe. Pour la plupart ce sont des histoires de femmes ordinaires que l'auteure évoque et dont elle analyse les états d'âme ou les névroses. Celle de Fora (« Amie de ma jeunesse ») nous montre une femme qui a choisi d'accepter son sort sans se plaindre avec pour seul secours une religion puritaine et rigoriste. Dans« Five points », Brenda entretient une passion adultère avec Neil, son jeune amant à l’insu de Cornelius son mari. C'est une femme libérée qui, à l’invite de Neil qui a voyagé sur la côte ouest, use de la drogue. II lui raconte l'histoire de cette jeune croate du quartier de « Live points », Maria, peu avantagée par la nature, à qui ses parents font confiance pour la tenue de l'épicerie familiale mais qui n'hésite pas à puiser dans la caisse de la boutique et payer ses copains pour lui faire l'amour. Jusqu'au jour où c'est la faillite ! Dans cette nouvelle elle évoque les relations entre les êtres toujours un peu difficiles, faites de moments d’inconscience, de risques pris inutilement au mépris des plus élémentaires précautions, du mépris des autres, d'agressivités, d'indifférence, comme dans la vie courante ! « Maneseteung », c'est le nom d'un recueil de poèmes éponyme, le nom d'un fleuve. La nouvelle met en scène une femme solitaire qui en est l'auteure, une poétesse comme le dit la gazette locale qui espère qu'un notable va s'intéresser à elle. Malheureusement elle meurt avant. Dans « serre-moi contre toi, ne me laisse pas aller » Hazel, une veuve canadienne d'une cinquantaines d'années cherche à revoir les lieux et les gens que son mari décédé depuis a connu pendant la guerre, en Écosse, alors qu'il était encore célibataire. Se sentant exclue de cette partie de la vie de Jack, elle se pose des questions sur le bonheur des hommes. Avec « Oranges et pommes », qui tire son titre d'un jeu pour enfants, l'auteure aborde un thème récurrent dans son œuvre qu'est la relation hommes-femmes notamment au sein du mariage avec le spectre de l'adultère né de rencontres de passage, de pulsions sexuelles et de la destruction d'une union apparemment solide. Barbara est une jeune fille courageuse et belle qui épouse le fils d'un commerçant dont les affaires périclitent. Pour autant et malgré ses deux enfants elle se laisse séduire par un amant de passage. Cette passade laisse un goût de trahison inacceptable dans l'esprit de son mari. « Image de glace » évoque la seconde vie d'un septuagénaire qui, après avoir pris sa retraite de pasteur, envisage de nouveau le mariage avec une jeune femme à Hawaï. Cette nouvelle m'a un peu déconcerté. Son successeur qu'il a sauvé tourne au fanatisme. Voilà pour le décor mais la réalité est toute autre et la femme de ménage, ex-épouse du successeur, a compris le fin mot de tout cela.
Ave « Grace et bonheur » il est aussi question d'un dernier voyage, effectué par bateau vers l'Europe, d'une chanteuse qui a connu son heure de gloire il y a bien longtemps. Elle est accompagnée de sa fille et flanquée d'un vieux professeur et d'une galerie d'autres personnages dont le capitaine qui évoque comment il s'est débarrassé un jour d'une défunte en la jetant par dessus bord. Dans « A quoi bon? » on peut lire tout le fatalisme que la vie impose à ceux qui la vivent, à cause des deuils, des séparations, des divorces. C'est une de ces comédies qu'on aime se jouer pour faire semblant de croire à l'amour. Dans « Différemment » c'est la communauté des anciens hippies rattrapés par la vie bourgeoise qui est évoquée. C'est à la fois la fuite du temps, la remise en cause et l'adaptation des gens qui voulaient que leur vie soit différente de celle des autres et en faisaient une règle. Ayant vieilli, ils rentrent dans le rang, montent éventuellement dans l'échelle sociale avec parfois des états d'âme, mais pas toujours. « Perruque, perruque » nous donne à voir deux jeunes filles, Anita et Margot, différentes malgré leur origine sociale rurale et leurs déboires sentimentaux.
C'est un narrateur extérieur qui explique au lecteur les situations de chaque nouvelle qui se déroule au Canada ou en Écosse. L'ambiance générale de ces textes me semble être baignée par une religion puritaine ce qui n'exclut cependant pas le mensonge, la luxure, l'adultère ou l'avortement et tout cela dans une atmosphère d'hypocrisie parfaitement humaine. C'est une réflexion un peu désabusée sur la condition humaine et plus précisément sur la classe moyenne canadienne dans ce qu'elle a d’ordinaire, de banal dans ces années d'après-guerre qui correspondent à une émancipation économique et sexuelle. Elle parle des rêves enfouis au fond des mémoires, des regrets et des remords que chacun porte en soi. A l'occasion d'histoires différentes les unes des autres, Alice Munro est une observatrice attentive de la vie des gens, spécialement des couples et des dangers qui les guettent non seulement du point de vue sociologique mis aussi psychologique. Elle explore les rapports compliqués qui existent entre hommes et femmes en s'arrêtant plus spécialement sur elles, leurs névroses, leurs rêveries. Ces relations sont faites de contradictions et de fantasmes, d'amour et de haine, de passions et de patience, de volonté de construction et de destruction, de domination, de rapports charnels et de conflits d'intérêts, de fatalisme et de désespoir, d'hypocrisies et de fuites, de passades et de velléités de liberté ou d'échecs à la solitude, de plaisirs sexuels ou d'envies d'enfants... La mort reste présente en filigranes un peu comme si Eros était suivi en permanence par Thanatos parce que la vie est une recherche déprimante et vaine du bonheur. Chaque texte paraît être une sorte de variation sur un même thème, parfois assez longue mais toujours agréable à lire avec une réelle profondeur dans l'analyse des personnages et de leurs sentiments et une grande précision dans les descriptions, ce qui encourage le lecteur à poursuivre jusqu'à l’épilogue. L'écriture est concise, faite d'images poétiques, ce qui m'a incité à pousser ma lecture jusqu'à la fin malgré une attitude un peu réticente au début.
Je ne connaissais pas cette auteur avant l’attribution de son Prix Nobel. Je n'ai pas été déçu par cette première approche.
©Hervé GAUTIER – Février 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
CHEVAL DE GUERRE- Michael Morpurgo
- Le 01/02/2014
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°722 – Février 2014.
CHEVAL DE GUERRE- Mickael Morpurgo – Folio Junior.
Traduit de l'anglais par André Dupuy.
Au moment où nous célébrons le centenaire de la Première Guerre mondiale, où les livres qui paraissent sur le sujet sont inspirés ou rendent compte des témoignages de poilus, j'ai trouvé assez original de donner la parole à un cheval qui, lui aussi avait participé aux combats. Il s'agit donc d'un roman écrit en 1982 et adapté au cinéma par Steven Spielberg en 2011 où un cheval raconte sa vie à la première personne.
Elle commence à la veille de la Grande Guerre, il est acheté par un fermier alcoolique dont le fils âgé de 13 ans, Albert, s'attache à lui, le baptise Joey, le monte chaque jour, le fait travailler. Il devient rapidement une belle bête. Cependant la guerre éclate et l'armée achète le cheval qu'Albert ne peut suivre, trop jeune pour s'engager. De cheval de ferme, il devient donc monture de cavalerie mais le régime n'est pas le même et Joey rencontre Topthorn, un autre étalon. Ils partent ensemble pour la France et le théâtre des combats. Le capitaine Nicholls qui l'avait pris en amitié au point de la peindre, avait promis à Albert de s'occuper personnellement est tué lors d'un affrontement et Joey est confié au soldat Warren qui s'attache à lui. L'art de la guerre qui excluait maintenant les charges de cavalerie le transforme en bête de trait pour l’artillerie, toujours en compagnie de Tophorn mais ils tombent tous les deux aux mains des Allemands qui les versent dans le service de santé. Les voilà chevaux d'ambulance. Après pas mal d'errements, il revient dans le camp anglais mais sans Tophorn qui a trouvé la mort et termine la guerre comme un véritable soldat. Notre cheval survit à la mitraille, à la maladie et même à une mort annoncée, et tant mieux si cela tient du miracle. C'est vrai que c'est une bête d’exception [« Je te le dis mon ami, dans un cheval , il y a quelque chose de divin, particulièrement dans un cheval comme celui-ci »] et cela mérite bien un happy-end.
C'est l'occasion pour l'auteur de glisser pas mal de réflexions sur l'absurdité de la guerre et sur la folie des hommes. C'est donc une sorte de fable, un peu dans ma manière de La Fontaine, la rime et la morale en moins mais l'émotion en plus. C'est donc une fiction qui emprunte autant à la réalité qu'à l'imagination de son auteur Joey quelque soit l'endroit où il est, réussit à s'attacher les hommes qu'il côtoie, militaires ou civils , à ne laisser personne indifférent. Il y a entre eux une véritable complicité et même davantage. L'auteur prête à ce cheval décidément hors du commun une vie d'homme mais quand il est sur le champ de bataille on a des égards pour lui, on ne lui tire pas dessus parce qu'il n'a pas d'uniforme mais aussi parce qu'un cheval est précieux et c'est sans doute ce qui lui sauve la vie quand tant de ses congénères trouvent la mort dans la tourmente, comme les hommes d'ailleurs.
C'est un conte pour enfants et comme tel il doit bien se terminer parce qu'ils ne comprendraient pas qu'il en soit autrement. Il faut laisser à l'enfance tout le merveilleux qui va avec, ils auront bien le temps, quand ils auront grandi, de comprendre et peut-être d'admettre que tout cela est faux mais après tout, cela n'a pas beaucoup d'importance !
©Hervé GAUTIER – Février 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
TENDRE EST LA NUIT- F. Scott Fitzgerald
- Le 30/01/2014
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°721 – Janvier 2014.
TENDRE EST LA NUIT- F. Scott Fitzgerald- Belfond.
Traduit de l'américain par Jacques Tournier.
Ce roman a connu un accouchement difficile. Commencé en 1925 il n'a été terminé qu'en 1934 ; Il paraît d’abord en feuilleton puis en librairie mais la critique se montra assez réservée et le public plutôt indifférent. Il disparut même des rayonnages et à la mort de Fitzgerald en décembre 1940 il n'en existait plus aucun exemplaire. Ce retard dans l'écriture est surtout dû à la santé chancelante de Zelda, son épouse, soignée pour des troubles psychiatriques et aux deuils qui ont frappé le couple. C'est le quatrième roman de l'auteur qui est pourtant considéré comme son chef-d’œuvre.
Nous sommes sur une plage du sud de la France dans les années 20 avec ses palaces, son farniente, sa population étrangère riche et désœuvrée faites de jolies femmes, de don juan, de snobs plus ou moins puritains, de bellâtres à la conversation inintéressante et frivole. Rosemary Hoyt, jeune actrice américaine de cinéma y prend quelques vacances en compagnie de sa mère. Elles ne devaient y passer que quelques jours mais finalement les deux femmes y restent. Rosemary y fait la connaissance de Nicole et Dick Diver, personnages flamboyants originaires d'outre-atlantique, entourés d'amis et la comédienne s'y attache au point qu'elle tombe amoureuse de Dick tout en témoignant beaucoup d'admiration à Nicole. Pourtant Dick est amoureux de sa femme mais n'est pas indifférent aux avances de Rosemary au point que cette dernière, mais sans sa mère, suit le couple à Paris et devient sa maîtresse. L'histoire du couple est assez étonnante. A l'origine, Dick est un séduisant médecin psychiatre qui se marie avec Nicole Warren, une riche héritière dont il tombe éperdument amoureux. En l'épousant, il épouse aussi son argent ce qui lui permet de fonder une clinique psychiatrique en Suisse pour riches patients. Il ne doit pas laisser passer cette opportunité et c'est pour lui une réussite sur le plan sentimental mais aussi sur le plan professionnel. Ils forment ensemble un couple parfait, avec deux merveilleux enfants qu'ils aiment, l'image d'une réussite familiale et professionnelle. Il est maintenant un praticien riche et célèbre. Parce qu'elle a subi de nombreux traumatismes dans son enfance (décès de sa mère, inceste) Nicole se révèle schizophrène et Dick le sait en l'épousant ; il la soignera puisqu’il l'aime. Fitzgerald révèle à son lecteur, à l'aide de la technique de l'analepse, ce parcours un peu cahoteux. Ce médecin représente cependant une formidable occasion pour cette famille riche de guérir Nicole de sa maladie mentale. Cette union, même si elle est gouvernée par l'amour que Dick éprouve pour Nicole n'empêche guère celui-là de désirer Rosemary tout en voulant éviter à son épouse fragile la moindre souffrance. En fait, il tient à la fois à sa situation et à cette actrice. C'est, si l'on veut le voir ainsi, l'illustration de la fragilité de l'amour que les hommes et les femmes se portent mutuellement.
Il y a peut-être un autre thème, c'est celui de la culpabilisation et de l'intuition ressentie par Dick de ne plus être capable d'apporter le bonheur à une femme (« Parce que je suis une Peste Noire, je ne suis plus capable d'apporter le bonheur à quelqu'un »]. Il se révèle en effet incapable de répondre à l'amour de Rosemary et, à cause de ce blocage, il s'adonne à l'alcool , plaisir plus facile à obtenir, plus délétère aussi puisqu'il le précipite peu à peu sur cette pente descendante qui le met, mais sur un autre plan, au niveau de Nicole. Dick est attirant et le sait., il a sur les femmes un ascendant certain et Nicole « se sert de sa maladie comme d'une arme pour asseoir son pouvoir » sur son mari. Cette fêlure dans ce couple aussi apparemment parfait n’échappe pas à Rosemary devant qui cette belle façade se délite petit à petit.
C'est un roman très autobiographique, même si l'auteur semble faire le compte-rendu comme un témoin étranger. Il y transparaît son penchant pour l’alcool à travers le personnage de Dick Diver, être sensible et fragile, autant que la schizophrénie de sa femme, la vie facile de cette époque pour les expatriés riches et souvent américains, les fêtes, l'alcool et même les duels. Le couple que forment Nicole et Dick se fissure au cours du récit et cela n'est pas sans rappeler la rupture de celui de Scott et de Zelda. C'est pourtant une génération perdue entre le désir impossible d'oubli de cette guerre mondiale qui a endeuillé les nations civilisées et la recherche un peu vaine d'une vie facile et désœuvrée,
Ce roman est une sorte de chronique américaine de riches expatriés sur la Riviera française, à Paris et en Suisse qui cherchent à échapper à l'éphémère en faisant un usage immodéré du champagne, du caviar, des fêtes folles, des nuits et des grands hôtels. Il illustre un mal de vivre de toute une génération surtout que ce que l'auteur veut nous présenter c'est l'image même de la perfection qui fait de ce couple séduisant une sorte de modèle qu'on ne peut pas ne pas admirer. Pourtant la réalité se révèle bien différente. Rosemary devient rapidement le personnage central de ce récit puis Nicole prend le relais dans la troisième partie. C'est effectivement un roman d'amour ou plus exactement un roman sur l'amour apparent que se portent deux êtres présentés comme exceptionnels, or, les véritables histoires d'amour n'existent pas ou ne résistent pas à l'usure du temps . Elles tiennent aux circonstances les favorisent mais au moindre accroc les masques tombent et ce qu'on croyait indestructible se dissout rapidement sous les coups du boutoir du quotidien, du hasard, du mensonge, de la trahison. L'amour se mue rapidement en indifférence voire en haine, les serments s'oublient très vite et même si les apparences subsistent, ce n'est finalement qu'un décor un peu triste dont on se demande quand et comment il s'effondrera. C'est donc un roman sur la réalité ordinaire du couple même si cette dernière est habillée des apparences un peu trompeuses de l'argent et de la vie facile qu'il permet. On peut faire durer les choses et les artifices mais c'est alors le bonheur qui est absent !
Le roman s'achève au même endroit où il avait commencé cinq ans avant, sur cette plage de la Côte d'Azur française mais les choses ont bien changé[« Le couple qu'elle formait avec Dick lui apparaissait désormais comme une ombre, imprécise, changeante, entraînée dans une sorte de danse macabre »] Dick est devenu alcoolique et se détruit lentement. Nicole, apparemment guérie, vit pleinement une liaison avec son amant qu'elle finit par rejoindre et épouser. Ce roman divisé en trois parties semble se terminer sur la disparition annoncée des membres de ce couple pourtant présenté au début comme séduisant et parfait. Nicole se remariera et regardera de loin Dick s'enfoncer petit à petit dans l’anonymat dans la solitude et dans l’alcool, un peu comme si sa présence aux côtés de ex-mari était indispensable à ce dernier. Dès lors qu'elle n'est plus là, il n'existe plus. C'est sans doute ce qui fait dire à l'auteur, reprenant les mots de John Keats « Avec toi maintenant ! Combien tendre est la nuit... »
J'ai toujours eu un peu de mal a entrer dans l'univers littéraire de Scott Fitzgerald et ce roman ne fait pas exception à cela même si j'ai goûté les descriptions poétiques des paysages et l' analyse psychologique des personnages.
©Hervé GAUTIER – Janvier 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE CHEVALIER A L'ARMURE ROUILLEE – Robert Fischer
- Le 07/01/2014
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°715 – Janvier 2014.
LE CHEVALIER A L'ARMURE ROUILLEE – Robert Fischer – Ambre Éditions.
(Traduction de Béatrice Petit).
Quand j'ai choisi ce livre, j'avais dans la tête, je ne sais pourquoi, le poème d’Edgar Poe, « Eldorado », à cause du chevalier sans doute et aussi de son éternelle quête, comme s'il devait être le seul à chercher quelque chose et aussi le seul à être dépositaire des valeurs traditionnelles véhiculées par la littérature. Celui de ce roman n'a pas échappé à la règle. Comme il est chevalier il se doit d'être « bon, gentil et plein d'amour » et c'est effectivement ce qu'il est, enfin, c'est le rôle qu’il veut jouer puisqu’il ne conçoit pas que les choses puissent être autrement. Il est donc toujours là, répond à cet appel intérieur quand il y a un dragon à tuer, une guerre à faire ou des jeunes filles à sauver. Il est toujours prêt à partir en croisade pour en découdre avec un ennemi nécessairement mauvais, quant aux jeunes filles, que cela leur plaise ou non, il les sauve, tant pis pour elles ! Comme tout bon chevalier, il possède un cheval et bien entendu une armure grâce à laquelle il est célèbre et qui brille. Il était donc normal qu'il rêvât de devenir le premier chevalier du royaume et, pour être à la hauteur de sa légende qu'il a lui-même tissée, il est toujours disponible ! Mais cette disponibilité l'a coupé de sa propre famille, de sa femme et de son fils au point qu'il ne leur parlait plus et qu'il s'enfermait dans cette fameuse armure au point de s'y recroqueviller et ce qui devait arriver arriva c'est à dire qu'il ne put plus la retirer, que la visière du heaume ne put plus s'ouvrir et que l’alimentation quotidienne devenait un véritable problème.
Il lui fallait donc faire quelque chose puisque, au lieu d'être un rempart, cette armure devenait une véritable prison pour lui. Comme nous sommes dans un conte, il va donc devenir un chevalier errant et se met en quête d'un sauveur. Bien entendu il croise un château mystérieux aux portes d'or, un miroir compatissant, un bouffon facétieux, des animaux qui parlent, un roi lui aussi en recherche et évidemment Merlin L’Enchanteur sans qui il n'y aurait pas de véritable conte merveilleux. Il mène sa quête allégorique à travers « le Chemin de la Vérité », « Le Château du Silence » celui « de la Connaissance », « de la Volonté et de l'Audace » et tout cela dans un espace-temps assez élastique. Bref, il perd tous les repères du chevalier traditionnel. Pendant tout ce périple, sa chère armure se met à rouiller, à se désagréger par petits morceaux et il parvient à s'en libérer complètement. Il trouve même son double, « Sam », sa conscience qui l'aide à revenir sur ses idées reçues, ses certitudes, la perception qu'il avait de la vie et des siens, lui montre une voie différente et notre chevalier, au terme de ce voyage initiatique finit par se regarder lui-même avec des yeux critiques, par s'amender, par reconnaître la puissance de l'amour.
A la lecture d'un tel conte, on ne peut pas ne pas penser à Saint-Exupéry perdu dans le désert et qui rencontre le Petit Prince ou à « Jonathan Livingstone le goéland » de Richard Bach et sa passion pour la liberté. Je dois être imperméable à tout cela, à ce message, à ce conte moralisateur et aussi didactique que ceux que le Moyen-Age savait produire mais le livre refermé, je suis resté sur mon chevalier de Poe et son Eldorado inaccessible. A cause de mon expérience des choses et de l'espèce humaine, de la réalité plus forte que la fiction sans doute ?
©Hervé GAUTIER – Janvier 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
JE TE RETROUVERAI – John Irving
- Le 14/10/2013
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°685– Octobre 2013.
JE TE RETROUVERAI – John Irving – Le seuil
Traduit de l'américain par José Kamoum et Gibert Cohen-Solal.
C'est une histoire à la fois simple et banale et même un peu triste que celle de cette famille monoparentale. Alice Stronach, écossaise, fille d'un tatoueur d'Aberdeen, tombe amoureuse de William Burns. Bien entendu elle tombe enceinte et bien entendu il l'abandonne. Son destin est donc d'élever seule son fils Jack. Ce qui l'est peut-être moins c'est qu'elle décide de poursuivre ce séducteur qui, bien entendu brouille les pistes. Quand elle arrive quelque part croyant le trouver, il est déjà parti et cela dure et le monde est vaste ! De Toronto, il s'embarque pour l'Europe. Ce William n'est pas seulement un séducteur impénitent, il est aussi un talentueux organiste mais qui profite de son passage dans une paroisse pour séduire les jeunes filles de la chorale. Il a aussi pris l'habitude de se faire tatouer des notes de musiques dans toutes les villes où il passe. Autant dire que son corps entier est une véritable partition ! Or, il se trouve qu'Alice à appris de son père, le métier de tatoueur. Elle même est tellement douée dans cet art qu'elle a acquis le surnom de « Fille de la persévérance ». Tatoueuse, elle espère donc retrouver son amant fugueur à la faveur des habitudes de ce dernier.
Tout juste âgé de quatre ans, Jack l'accompagna dans ses recherches. Elle débuta ses investigations par un port de la Baltique puis chercha dans ceux de la mer du Nord mais malheureusement, de chambre d’hôtel en chambre d'hôtel, elle perdit la trace de William. Elle ne lésina pourtant pas sur les recherches, hantant les bars en quête de clients pour ses tatouages, les paroisses et parfois les quartiers chauds pour retrouver la trace du père de son fils . Sa spécialité semble être les fleurs... et les cœurs brisés. Toutes les femmes qui l'avaient connu disaient à Jack combien il ressemblait à son père. Ainsi, même si sa mère ne lui en parlait jamais, l'enfant l’avait toujours à l’esprit. Après une vaine recherche, Alice et son fils reviennent à Toronto où Jack, à cause de son jeune âge, va intégrer une institution réservée aux filles, Saint-Hilda. Ainsi le jeune garçon va-t-il se retrouver « dans cet océan de filles » et bien entendu parmi elles, certaines ont connu son père et elles se demandent si décidément le fils ne va marcher sur les traces de son père. Il n'est pas le seul garçon à Saint-Hilda mais la cohabitation avec des filles surtout plus grandes que lui ne va pas sans problèmes d'autant que l'aspect confessionnel de cet établissement n'arrange rien dans l'esprit de l'enfant. Une pensionnaire plus âgée, Emma Oastler, va donc faire son éducation sexuelle ce qui sera pour lui le prélude à bien d'autres conquêtes féminines surtout chez les femmes plus âgées que lui.
Alice était bien jeune pour avoir un enfant qu'elle n'a peut-être pas désiré. Elle s'y prend d'ailleurs très mal pour l'élever puisqu’elle ne lui parle jamais de son père et ainsi l'éloigne de ce dernier qu'inconsciemment il cherche à connaître et à imiter et ce d'autant plus que toutes les femmes qui ont connu son géniteur s'ingénient à leur trouver des point communs. Ce faisant et sans qu'elle le veuille, les relations mère-fils se dégradent. Elles ne s'amélioreront pas avec le temps et la mort d'Alice viendra mettre fin à ce dialogue manqué. Jack va donc s'attacher à Emma qui va se révéler être une meilleure mère qu'Alice mais ne pourra cependant pas la remplacer. Leurs relations qui ont duré dix années seront des plus ambiguës, entre érotisme amoureux et protection maternelle puisque Emma n'a jamais été véritablement sa maîtresse. La mort d'Emma sera ressentie par Jack comme un vide immense. Pourtant, elle fait ce qu'elle peut pour le défendre devant l'adversité, l'épisode de Mrs Marchado est significatif et si cette dernière l'initie effectivement aux joies de l'amour elle n'en abuse pas moins de lui. Ainsi, privé de père, Jack va-t-il se détacher peu à peu de sa mère qui, par ailleurs, a une vie sexuelle très libre. Il est un peu perdu dans cette famille atypique aussi bien regrette-t-il de quitter Saint-Hilda quand sa mère le décide. Il sera envoyé dans une école pour garçons dans le Maine où il trouve enfin sa place.
Devenu adulte, il a le plus grand mal à envisager une relation durable avec une femme, le mariage et la paternité sont deux mots qui ne font pas partie de son vocabulaire, en ce sens qu'il craint de ressembler à ce père qui l'a abandonné. Pourtant la gent féminine l'apprécie particulièrement. C'est peut-être pour cela qu'il multiplie les conquêtes féminines et donc ressemble de plus en plus à William. Alice a bien fait ce qu'elle pouvait pour l'élever dignement mais ses efforts n'ont pas été couronnés de succès. Pour autant, les recherches personnelles de Jack lui permettent de faire la part des choses sur son père autant que sur sa mère. Pour autant, cette vie mouvementée l'oblige à entamer une psychothérapie pour tenter de se reconstruire ; Féru de théâtre, il deviendra quand même un star d'Hollywood, avec Oscar à la clé, mais dans les rôles de travestis uniquement ce qui est sans doute la conséquence de son manque de repères aussi bien maternel que paternel.
La quête de Jack finit par être récompensée, il retrouve son père et aussi sa demi-sœur qu'il ne connaissait pas.
L'aspect autobiographique de ce roman, le onzième de John Irving n'est pas contestable. l'auteur est né hors mariage et sa mère a toujours refusé de lui parler de son père ce qui a provoqué chez lui un traumatisme que l'écriture lui a sans doute permis d'exorciser. Il ne retrouvera cet homme qu'après la mort de ce dernier alors que lui-même était âgé d'une soixantaine d'années.
L’auteur est sans doute un spécialiste du tatouage puisque, tout au long de ce texte, il donne des détails techniques sur cet art et sur ceux qui y ont recours. Il n'oublie pas non plus la lutte dont il a été un ardent pratiquant non plus d'ailleurs que de l'érotisme. Irving a de l’imagination, fait volontiers dans le détail parfois inutile, a la plume facile, évoque beaucoup de personnages furtifs et pratique beaucoup (trop) les rebondissements dans ce texte. Cela donne un roman de près de neuf cents pages parfois assez indigeste et à mon sens trop long, que j'ai eu bien du mal à suivre et dans l'univers duquel j'ai eu beaucoup de difficultés à entrer. Je ne suis pas très sûr de vouloir en lire un autre.
© Hervé GAUTIER - Octobre 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
Quelques mots sur John Irving
- Le 29/09/2013
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°678– Septembre 2013.
Quelques mots sur John Irving
A la suite de la lecture du numéro spécial du Magazine littéraire d'août 2013 consacré aux « 10 grandes voix de la littérature étrangère », j'ai choisis parmi ces écrivains la figure de John Irving.
Ce romancier et scénariste américain est né en Mars 1942. Sa naissance a été pour lui et pendant de nombreuses années une sorte d’interrogation qui a nourri son œuvre romanesque. L'un de ses roman « Je te retrouverai » est marqué par ce thème et beaucoup d'autres mettent en scène des femmes seules qui élèvent leurs enfants. Sa mère, Helen Winslow, descendante d'une des plus vieilles familles de Nouvelle-Angleterre, l'a mis au monde hors mariage, refusant obstinément de lui révéler le nom de son père. Il ne connaîtra que très tardivement le nom de son géniteur lorsque celui-ci sera mort. Plus tard, elle se mariera avec avec Colin Irving, un professeur d'une prestigieuse université et il donnera son nom à son beau-fils. Il fit des études à l' Exter Academy mais y fut un étudiant médiocre à cause d’une dyslexie diagnostiquée tardivement et obtint son diplôme de littérature. Il fut cependant un lutteur passionné et talentueux ce qui lui permit de compenser , dans ce pays où le sport est roi, une scolarité difficile. Il obtint ensuite une bourse, partit pour l'Autriche.
Sa carrière littéraire démarra à 26 ans avec la publication d'un premier roman « Liberté pour les ours » mais le succès ne fut pas au rendez-vous. « L'épopée du buveur d'eau » et « Un mariage poids moyen » connurent le même sort mais ce ne fut que son quatrième roman, « Le monde selon Garp » qui fut un best-seller international porté à l'écran en 1982 par Georges Roy Hill. Cet ouvrage le fit littéralement sortir de l'anonymat.
A partir de 1985, il publia des romans diversement accueillis par la critique mais où l'influence de Charles Dickens se fait sentir. Il confesse lui-même ne pas avoir été attiré par les grands noms de littérature américaine comme Faulkner, Fitzgerald ou Hemingway. « Le XIX° siècle m'a toujours parlé » ou « J'avoue que je suis un écrivain du XIX° siècle » ; C'est aussi un écrivain engagé, militant pour la tolérance, le respect des différences notamment en faveur des minorité sexuelles, comme dans « A moi seul bien des personnages », son dernier roman. Ses romans sont souvent volontiers polémiques et sont porteurs de débats. Il est aussi un adepte des romans longs, faisant porter ses intrigues souvent sur l'adolescence et le passage à la vie d'adulte.
Il reste un exceptionnel raconteur d'histoires qui passionne son lecteur et ne le libère qu'une fois le livre refermé.
© Hervé GAUTIER - Septembre 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
CHRONIQUE D'HIVER – Paul Auster
- Le 25/09/2013
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°661– Juillet 2013.
CHRONIQUE D'HIVER – Paul Auster – Actes Sud.
Traduit de l'américain par Pierre Furlan.
Ce n'est pas la première fois que Paul Auster écrit un roman autobiographique. Il a déjà publié des ouvrages qu'on peut regrouper sous ce vocable [« Invention de la solitude » – « Le diable par la queue » – « Le carnet rouge »], mais, peut-on vraiment parler d’autobiographie puisque, de son propre aveu, quand il écrit, sous sa plume, elle le dispute à la fiction, comme une tentation en quelque sorte.
Ce qui frappe le plus, dès l'abord, c'est l'emploi de la deuxième personne. D'ordinaire soit l'auteur emploie le « Je », soit il se cache sous les traits d'un personnage qu'il met en scène comme un peintre réalise un « trompe-l’œil ». Le tutoiement est sans doute ici une incitation au partage avec le lecteur, comme s'il y avait un autre témoin qui s'adressait à l'écrivain, qui lui racontait sa propre histoire. Mais cet artifice, car c'en est un, est-il vraiment nécessaire voire indispensable pour que le lecteur s'approprie ainsi un texte ? Les souvenirs personnels que l’auteur égrène sont-ils de nature à faire ressortir du néant ceux du lecteur ? Certes, Montaigne rappelait que tout homme porte en lui la marque de la condition humaine et nous la partageons donc tous. Quand Auster paie son écho au sexe, à l'enfance, aux premiers émois amoureux de l'école maternelle, à ses premières tentatives d’adolescent maladroit, quand il nous parle du quotidien, de ses sensations, de ses impressions, qu'il évoque ses propres peurs devant la mort, celle de sa mère qui préfigure la sienne, la vieillesse qui vient, les agressions que son propre corps a subi, cela peut parfaitement réveiller quelque chose en nous ! La mort, justement, elle est présente en filigranes dans tout ce texte mais c'est bien naturel puisqu'elle est le terme normal de la vie, même s'il s'émeut de sa survenue dans toutes les existences qu'ils évoque. C'est sans doute là une vaste question et il est légitime qu'un auteur souhaite entrer en communion avec celui qui le lit, lui montrer que finalement il n'est pas vraiment différent ! J'ai plutôt eu l’impression que cela fonctionnait bien et le texte m'a vraiment, par moment, donné l’impression de se dérouler sur le ton de la confidence. Je ne sais si cela tient à moi mais au fil de ma lecture, j'ai eu le sentiment, bien que ma vie soit fondamentalement différente, que quelqu'un s'adressait à moi, me parlait de quelque chose que je connaissais. Cette complicité avec son lecteur a sans doute ses limites puisqu'il avoue lui-même« qu'il est bénéfique pour la santé mentale d'un écrivain de ne pas savoir ce qu'on dit de lui. ». C'est un rappel à la réalité, une découverte pour moi qui ait largement et depuis longtemps pris la liberté de commenter son œuvre mais je reste persuadé qu'un écrivain est attaché à l'image qu'il donne à ses lecteurs. Parfois aussi, j'ai eu la certitude qu'il en faisait un peu trop notamment quand il nous parle de la prostituée parisienne qui, après son office, citait Baudelaire ! En outre, la liste exhaustive de ses différentes résidences, aux États-Unis où en France ne font que mesurer le temps et son parcours dans ce monde et à mon sens n'ajoutent rien d'autre.
Dans ce récit, il est beaucoup question du corps, du froid, de la faim, et ce qu'Auster décrit peut parfaitement éveiller en nous des réminiscences. Pour un créateur, la vie reste le moteur de l'écriture et il y puise souvent ses meilleurs pages, que celles-ci lui soient inspirées par le bonheur ou la misère la plus noire. Il ne manque pas d'auteurs pour célébrer l'instant exceptionnel et disséquer ce que ce moment unique révèle pour lui. Les sentiments qu'ils expriment leur sont éminemment personnels, n’appartiennent qu'à eux. Parfois aussi, ces moments intimes vont au-delà du souhait de l'auteur. Ce dernier nous raconte une histoire qui peut nous passionner ou nous laisser de glace. Si le lecteur est aussi un artiste ou simplement s'il entre dans le texte au point de le faire sien simplement parce qu'il est évocateur, cette appropriation peut se muer en intérêt particulier pour l'écrit, se transformer en recréation... La plupart du temps cela se fait dans le plus strict secret mais pour un auteur, transformer une vie, l'embellir, la bouleverser, et ce dans le plus strict anonymat, reste sans doute pour lui, s'il est un authentique créateur, un but ultime dont cependant il ne connaîtra jamais le résultat.
La crise économique, la société telle que nous la connaissons, de plus en plus déshumanisée et peut-être éloignée de la culture peuvent considérer le roman ou l'art en général comme inutiles. Il n'en reste pas moins que cela résulte du travail de son auteur. Que cela suscite à ce point l'émotion de quelqu'un qui, l'instant d’avant ne connaissait pas l'existence de l’œuvre, illustre le formidable pouvoir des mots, des idées des images et des sons. Pourtant, à titre personnel, ce que je recherche dans un texte écrit par un étranger ce n'est pas tant de retrouver mes propres souvenirs que de profiter de son style, d'apprécier une belle description, d'entrer dans l'histoire, d'affermir ma propre culture, de prendre une leçon d'écriture, de goûter un dépaysement salutaire, d'approfondir un thème de réflexion...
Ici, Paul Auster raconte sa propre histoire, mais il le fait d'une manière désordonnée, sans le moindre souci de la chronologie. Au début d'une page il peut avoir 5 ans et à la phrase d'après il en a 50. Ce n'est guère dérangeant. A cet égard, le titre « Chronique d'hiver » est révélateur. Le récit s'ouvre sur l'hiver new-yorkais fait de glace, de neige, de vent et de tempêtes. Les éléments qui se déchaînent sont peut-être le moteur de son inspiration. Elle ne prévient pas, se manifeste de la manière la plus inattendue et quand l'impulsion de l'écriture est donnée, la faculté créatrice se déclenche et ne s'achèvera que lorsque les mots l'auront épuisé. Dans ce thème, je vois personnellement la marque du temps qui s'impose à l'auteur. Né en 1947, il a 66 ans, ce n'est pas très vieux mais ce n'est plus vraiment la jeunesse et l'hiver est ici synonyme de la dernière phase de la vie. Écrire est le métier de l'écrivain et le temps pèse sur lui davantage sans doute que sur le commun des mortels puisqu'il a quelque chose à dire et qu'il souhaite le faire rapidement « Parle tout de suite avant qu'il ne soit trop tard » est-il écrit au début, parce que le livre qu'il vient de commencer doit impérativement être terminé et ce qu'il porte en lui être exprimé, de peur d'être, comme chacun d'entre nous happé par la mort qui frappe sans prévenir. La camarde signifie pour l'écrivain plus que pour tout autre le silence.
Finalement, le livre refermé, il me reste personnellement une impression plutôt bonne comme celle déjà éprouvée lors de mes lectures précédentes, pas vraiment enthousiaste cependant, un moment le lecture agréable dû au style de l'auteur ou au talent du traducteur, une sorte de sentiment de complicité que je ne saurais moi-même pas très bien caractériser ni expliquer, quelque chose d'humain, de personnel, de nostalgique.
© Hervé GAUTIER - Juillet 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
SOUS L'OEIL DE DIEU – Jerome Charyn
- Le 27/07/2013
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°665– Juillet 2013.
SOUS L'OEIL DE DIEU – Jerome Charyn - Mercure de France
Traduit de l'anglais par Marc Chenetier.
J'ai l'impression que ceux qui, comme moi, abordent pour la première fois un roman de Jerome Charyn, sont un peu perdus. La 4° de couverture indique qu'on ne résume pas un tel roman, mais quand même ! Heureusement que cette 4° de couv. conseille de se laisser entraîner là où le comique côtoie le tragique, je ne sais pas mais j'ai quand même essayé.
Le commissaire Isaac Sidel a été chef de la police de New-York, puis maire de cette ville et le voilà maintenant en passe de devenir vice-Président des États-Unis, ou peut-être plus ! Cependant, il est plus populaire que J.Mickael Storm c'est à dire le Président démocrate lui-même et cela évidemment pose un problème et suscite des jalousies. C'est sans doute pour cela qu'on cherche à éliminer celui qu'il est connu sous le nom de « Monsieur Sidel » mais aussi« le Citoyen » ou « le Gros Type » et sans doute aussi pourquoi celui-ci ne quitte jamais son Glock. Il est vrai qu'il à la détente facile, peut-être autant que la larme. Il est vrai qu'il reste avant tout un flic et le restera, même si d'autres fonctions lui incombent. « L’œil de Dieu », est le nom que s'est donné le tueur chargé de cette besogne, mais, heureusement, Dieu est sans doute avec Sidel, puisqu'il échappe à la mort. Il ne perd pourtant rien pour attendre puisqu'il est toujours une cible, entre la protection des agents du FBI, ceux de la CIA, de la police de New-York et l'ancien président républicain Calder Cottonwood, encore en poste pour quelques semaines et pour qui tous les coups sont permis. Il entend bien exploiter les informations qu'ils détient sur J.Mikael Storm, ancien gauchiste, ancien joueur de base-ball mais surtout mouillé dans des scandales financiers. Le Nouveau Président est tellement effacé qu'on songe de plus en plus à Sidel pour prendre sa place.
De plus il y a toujours un certain délai entre l'élection et l'installation de l'élu à la Maison Blanche et c'est justement ces quelques semaines que choisit Sidel pour se singulariser. Et pas n'importe comment : il tombe follement amoureux d'Inez, alias Trudy Winckleman qui a un passé un peu louche et deux enfants qu'Isaac veut adopter. Cela ne va évidemment pas arranger sa carrière politique nouvelle et pas non plus le parti démocrate. Peu importe, il s'installera auprès d'elle à l'Ansonia, un hôtel de Manhattan cher à son cœur, au même endroit où habite David Pearl, ex-lieutenant d'Arnold Rothstein, banquier mais aussi un caïd new-yorkais. Le cadre, c'est New-York, la « grosse pomme », « la ville qui ne dort jamais », une ville mythique, mais j'y ai plutôt vu une ville ou règne la pègre et la corruption. Le Bronx va être rasé pour y construire un complexe militaro-industriel. Là aussi il y a un enjeu que ne veut pas manqué Sidel.
Aux côtés de Stidel, il y a aussi Mariana, douze ans, la fille du futur Président, accroc aux petit gâteaux au beurre et aux épices et qui ne laisse personne indifférent.
Je crois que je suis passé complètement à côté de cette histoire rocambolesque et déjantée, aux multiples personnages. Elle ne m'a pas vraiment passionné, mais j'ai continué à lire, pour voir.
© Hervé GAUTIER - Juillet 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LES ROMANCIERES AMERICAINES
- Le 20/07/2013
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°662– Juillet 2013.
LES ROMANCIERES AMERICAINES – Le Magazine Littéraire n° 532 -Juin 2013.
Je fais partie de ceux, nombreux sans doute, pour qui la littérature américaine est surtout un univers d'hommes. Certes il y avait Harriet Beecher Stone [« La case de l'oncle Tom »51852)] et Margaret Mitchell [« Autant en emporte le vent »(1937)] mais elles faisaient en quelque sorte figure d'exception. Le dossier du Magazine Littéraire fait une liste non exhaustive de femmes de lettres qui ont enrichi par leur créativité et leur diversité la culture d'Outre-atlantique. Certaines sont nées au XIX° siècle telles Edith Wharton (1862-1937), traduite en français et dont un roman, « Le temps de l'innocence » a été porté à l'écran par Martin Scorsese aussi classique que Gertud Stein (1874-1946) était une adepte du modernisme, célébrant à la fois Matisse et Picasso. Toutes deux ont vécu en France, ont admiré Proust et Henry James mais se sont superbement ignorées. Dorothy Parker (1893-1967) poète, romancière et critique qui se caractérisait par un esprit aiguisé et subtil, rendra compte de la littérature américaine de son temps. Cela lui vaudra aussi d'être victime du maccarthysme. Hitchcock fit de Patricia Hightsmith (1921-1995), et un peu malgré elle, un auteur de roman policier à succès (« L'inconnu du Nord-Express »). C'est le cinéma qui a aussi apporté la célébrité à Annie Proulx (née en 1935) avec « Le secret de Brokeback mountain », une nouvelle portée à l'écran en 2005, mais c'est William Faulkner qui adouba Willa Carther (1873-1947) malheureusement mal connue en France. Nombre de ses romans ont pour cadre les grandes plaines des États-Unis.
Moins paisible est sans doute, sinon l’œuvre, à tout le moins la vie de la sulfureuse Anaïs Nin (1903-1977) dont le « Journal », commencé à l'âge de 11 ans explore certes le « moi », mais surtout l'érotisme, hésitant parfois entre diariste et fiction, rend compte de sa vie privée très riche en rencontres et en liaisons amoureuses.
Avec Eudora Welty (1909-2001), c'est le sud qui est mis en scène. Célèbre pour ses romans (Prix Pulitzer 1975 pour « La Fille de l'optimiste »), mais aussi pour ses nouvelles, elle s'interroge sur la vie, sur la mort, sur le racisme et toutes les formes de violences qu’elle associe au Mississipi notamment pendant la période de la « Grande Dépression ». Avec Kay Gibbons ( née en 1960) c'est toujours le sud dont elle est un peu la mémoire qui revient sous sa plume. Ces deux auteurs écrivent un peu dans l'ombre de William Faulkner. Carson McCullers (1917-1957) incarne aussi ce sud avec son racisme, sa géographie, son climat mouvementé mais aussi la solitude de cette société très compartimentée et, la lutte qu'elle mena contre la maladie qui l'emporta. Ses romans sont volontiers provocateurs. Chez Flanery O'Connors(1925-1964) qui elle aussi était minée par la maladie, c'est la Géorgie qui est mise en scène dans une œuvre réduite mais lucide avec un style lapidaire, caustique et une violence contenue. Elle est considérée comme une voix importante de la littérature américaine.
Avec Alison Lurie (née en 1926), à la fois prix Pulitzer 1984 et Prix Fémina étranger 1988, écrivain et universitaire, c'est le nord qui est évoqué dans ses romans, avec des personnages petits, ambitieux mais timorés. Elle se moque volontiers des enseignants et des écrivains dont elle fait partie. Le tableau serait incomplet s'il ne comportait aussi la figure de Toni Morrison (née en 1931), afro-américaine qui, à son tour traque les fantômes de l’esclavage. Insoumise et volontiers provocatrice elles est reconnue comme un écrivain national bien qu'elle se sente exclue de cette société majoritairement blanche et gouvernée par des hommes. Son style est cinglant, décrit la misère des noirs du début du XX° siècle et le ségrégationnisme américain tout en explorant les registres du merveilleux, du fantastique et de l’irrationnel. Son œuvre a été couronnée par le prix Pulitzer en 1988 et le Prix Nobel en 1993. Louise Erdrich (née en 1954) quant a elle est d'origine indienne et est souvent comparée à Toni Morrison. Elle parle de la spoliation des indiens, de leur perte d'identité et de leur culture, de l’alcool. Elle est d'une profonde tendresse et son style est alternativement dramatique et humoristique. Joan Didion (née en 1934) est davantage journaliste que romancière et ses œuvres n'ont reçu Outre-Atlantique qu'une consécration tardive. A 78 Ans elle fait pourtant autorité, incarnant véritablement l'écrivain californien. Elle se concentre sur l'observation d'elle-même, de l'Amérique et de ses habitants. A titre personnel son introspection porte aussi sur les deuils qu'elle a subi à la suite de la mort de son mari et de celle de sa fille. Elle parle de la solitude, de la maladie, de la mort à venir, raconte sa vie, ses périodes dépressives qui ont fait suite à des phases plus fastes. Face à ses épreuves, l'écriture est pour elle une sorte de baume contre l'adversité. C'est à peu près la même démarche à laquelle se livre Joyce Carol Oates (née en 1938). Brillante universitaire et écrivain à succès, elle aussi parle d'elle, de sa vie, des faites divers mais il lui semble difficile de connaître ceux qui l'entourent et qui sont pour elle une énigme angoissante. Elle parle de l'enfance malheureuse, de la séduction exercée par les adultes, de l'échec conjugal mais aussi peint l'Amérique de l'ouest sans ménagement et sans rien cacher de la violence, de l'alcool, de la drogue, de la sexualité, des trafics... Pour elle aussi, l'écriture est un bouclier. Enfin Susan Minot (née en 1956) est surtout scénariste et n' a écrit que 4 romans. Elle obtenu le Prix Fémina étranger en 1987 mais n'a rien publié depuis 2003. Elle a choisi d'évoquer des scènes familiales dans la Nouvelle-Angleterre fortement teintées d'autobiographie entre révoltes soumissions, affrontements, jalousies et joies simples. Les personnages, surtout celui du père et de la mère sont caractéristiques mais le portrait qu'elle fait de la famille symbolise toutes les familles du monde.
Il s’agit d'un catalogue certes incomplet, d'un tableau rapidement brossé tant les femmes de lettres sont nombreuses Outre-atlantique. Leurs romans ont été couronnés notamment par le prestigieux prix Pulitzer mais pas seulement et le rayonnement de leurs œuvres a largement dépassé les frontières du pays. Ce numéro du Magazine Littéraire fait sur cette question un point intéressant et suscite l'intérêt du lecteur.
© Hervé GAUTIER - Juillet 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE MEILLEUR DE NOS FILS – Donna Leon
- Le 14/07/2013
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°659– Juillet 2013.
LE MEILLEUR DE NOS FILS – Donna Leon - Calman-Lévy.
Traduit de l'anglais par William Olivier Desmond
A l'académie militaire San Martino à Venise, un jeune cadet, Ernesto Moro, vient de se suicider. Dès le début de l'enquête, le commissaire Brunetti ne croit pas à cette version. Le jeune homme était en bonne santé, ne présentait aucun signe dépressif, autant de bonnes raisons pour que notre policier remette en doute ce qui, de plus en plus, passe pour la thèse officielle. Il ne tarde pas à s’apercevoir que cette école est en fait réservée aux enfants de la grande bourgeoisie et de l’aristocratie du pays, d'ailleurs, la victime était le fils du Dottor Fernando Moro, un éminent oncologue qui s'était fait élire parlementaire. Il avait marqué son passage dans la vie politique italienne par ses enquêtes sur les hôpitaux publics et surtout par une grande probité, ce qui est plutôt rare dans ce domaine. Il avait ensuite démissionné de son poste de député d'une manière un peu brutale et inattendue pour reprendre une clientèle privée. Les investigations de Brunetti révèlent que les époux Moro vivaient séparément depuis de nombreuses années et qu'il y avait des périodes inexpliquées dans la vie de la mère qui d'ailleurs reste introuvable.
Il ne faut pas longtemps au commissaire pour convaincre le vice-questeur Patta, son supérieur hiérarchique, de creuser un peu son idée sur le suicide douteux d'Ernesto Moro. En effet, conclure un peu vite son enquête sur cette cause officielle de décès risquerait d'amener l'ex-député à attaquer le possible classement sans suite de cette affaire, ce qui, aux yeux de Patta, toujours aussi timoré, serait inadmissible puisque cela ternirait l'image de la police vénitienne qu'il dirige. Pourtant, il n'est pas non plus question de trop chercher les causes de ce suicide puisque cela va immanquablement amené la police à enquêter sur la vie privée du Dottor Moro qui est aussi un notable dont Patta souhaite la protection. Telle est donc l'enjeu de ce récit.
La vie de ce couple est une énigme. Les époux Moro travaillent séparément et leur séparation est intervenue bizarrement à la suite d'un accident de chasse dont a été victime la mère, Frederica à Sienne, deux ans plus tôt. On lui a tiré dessus mais la chose est pratiquement passée inaperçue à l'époque. Ils le sont pas officiellement divorcés, ni l'un ni l'autre ne paraît avoir de liaison, mais ils ne communiquent entre eux que par avocats interposés. Brunetti rencontre l'un et l'autre, séparément bien sûr. Avec Madame, le commissaire veut revenir sur son accident qui effectivement pose encore des interrogations restées sans suite pour la victime. En ce qui concerne le suicide de son fils, elle est formelle, cela ne peut être vrai. Brunetti à la chance d'avoir sa secrétaire, Elletra, qui est une mine de renseignement obtenus d'ailleurs un peu trop facilement, mais également son épouse Paola qui connaît bien des potins de Venise. Elle lui révèle que l'école de San Martino n'a rien de militaire, mais est au contraire un repère de jeunes snobs de la bonne société qu'on entretient dans la certitude de leur supériorité.
Les investigations de Brunetti le conduisent à mettre en évidence pas mal de zones d'ombre dans ce dossier, aussi bien des informations contradictoires sur les faits qui se sont déroulés dans l'école avant le suicide, la rétention d'informations de la part des cadres, la menace sur les cadets, le viol d'une jeune fille dans l'enceinte de l'académie militaire quelques temps auparavant mais dont l'information a très tôt été supprimée des journaux, la vie pas si séparée que cela des Moro, la certitude que l'accident de chasse dont avait été victime Frederica Moro n'était pas un accident et que sa vie était peut-être encore menacée, qu'ils avaient une fille, Valentina, bizarrement absente, que la mère du Dottor a été victime d'un accident de la circulation. Il parvient à expliquer que, durant ses fonctions de parlementaire, Fernando Moro s'était notamment intéressé d'un peu trop près aux contrats d'approvisionnement de l'armée, mettant en évidence prévarications et favoritisme, le tout aux dépends du Trésor Public, c'est à dire du contribuable. Bien entendu, le vice-questeur Patta, toujours désireux de donner de la police, mais surtout de lui-même, une image favorable aux notables locaux, souhaite que la thèse du suicide d' Ernesto soit favorisée et bien entendu l'affaire classée. Pourtant, elle évolue vers la mise en cause de plusieurs cadets et à cette occasion des noms de famille de notables pourraient être révélés et peut-être salis.
Cette affaire, faite de menaces, de couardise, de renoncements, d'erreurs, de faux-témoignages, de mensonges, de révélations embarrassantes, de mises en cause, de mises en scène se termine. Brunetti qui est policer mais aussi père d'un garçon de l'âge de la victime n'a cessé de penser à ce jeune cadet mort trop tôt en songeant que cela pourrait bien lui arriver à lui aussi.
Brunetti est un bon enquêteur mais il est, dans cette affaire secondée efficacement par Elletra, la secrétaire, qui lui obtient des renseignements avec plus de facilité qu'un fin limier.
-
MORT EN TERRE ETRANGERE – Donna Leon
- Le 12/07/2013
- Dans Littérature anglo-américaine
- 1 commentaire
N°658– Juillet 2013.
MORT EN TERRE ETRANGERE – Donna Leon - Calman-Lévy.
Traduit de l'anglais par William Olivier Desmond
Un cadavre vient d'être découvert aux petites heures du matin, apparemment poignardé et flottant dans les eaux noires d'un canal à Venise. Le commissaire Guido Brunetti se charge naturellement de cette affaire. Très vite il s'aperçoit que la victime est un Américain, plus exactement le sergent Foster de la base de Vicence. Il lui faudra donc travailler avec une armée étrangère ce qui ne lui facilitera pas les choses. Elles sont d'ailleurs suffisamment compliquées comme cela au quotidien avec son supérieur hiérarchique, le vice-questeur Patta qui n'est jamais aussi satisfait que lorsqu'il ne se passe rien à Venise puisque toutes les formes de délinquance, et particulièrement un crime de sang, sont synonymes de baisse de la fréquentation touristique dans la ville. Il faut dire que ce hiérarque est le type même du chef de service incompétent, ignare, profiteur à l'occasion, autant dire inutile, mais imbu de lui-même, de sa supposée importance et dont on se demande comment il a bien pu faire pour parvenir à ce poste.
Un peu macho quand même ce Brunetti quand il s'étonne de la présence des femmes, surtout officier et médecin, dans l'armée américaine, franchement italien aussi quand il oublie ses fonctions officielles de policier pour faire dans la combinazione, Vénitien avant tout quand il éprouve le besoin de décrire sa ville aux étrangers en sa compagnie ; il faut dire que la Sérénissime ne laisse personne indifférent. Il est amoureux de son épouse et attentif à sa famille mais ne dédaigne pas, à l'occasion, la compagnie des femmes, même si elles portent l'uniforme. Pourtant, il reste les réactions bizarres de cette femme, le capitaine médecin Peters et supérieur hiérarchique de Foster au service de la santé publique quand elle le voit à la morgue et qu'elle apprend la manière dont il a été assassiné. C'est peut être assez pour que le commissaire la soupçonne, ce qui ne simplifiera pas l'enquête de la police italienne ! Au début, tout paraît lisse dans la vie de Foster, mais une visite dans son appartement révèle la présence de cocaïne et une possible relation intime avec cette supérieure. Ainsi que pouvait bien justifier le meurtre de ce militaire, le vol, la vengeance, la jalousie ou une simple agression de rue ? Pourtant, les jours suivants révèlent la mort par overdose du capitaine Peters alors que cette dernière n'était pas toxicomane ! Autant dire que, malgré les ordres de sa hiérarchie, Brunetti a bien l'intention de poursuivre son enquête originelle.
Le vice-questeur, toujours aussi flagorneur, timoré mais surtout désireux de ne pas faire de vagues préfère traiter cette affaire comme une agression de rue qui aurait mal tourné et commande au commissaire de se consacrer à un cambriolage survenu dans un palais du Grand Canal appartenant à un important industriel milanais de l'armement. Au moins, comme cela, il se fera bien voir d'un important notable. Ainsi Brunetti abandonne-t-il cette affaire, officiellement seulement puisque contrairement aux apparences, il pense que ces deux enquêtes pourraient bien être liées. En effet, notre commissaire ne tarde pas à mettre à jour un trafic de déchets avec création de décharges sauvages à cause de la corruption des hommes politiques, du laisser-aller des autorités italiennes face aux Américains notamment en matière d'écologie, des différentes réglementations à l'intérieur des pays de la communauté européenne et de l'ombre de la Mafia.
Je ne connaissais pas cette auteure au nom à consonance européenne, née dans le New-Jersey mais qui a choisi la cité des doges pour lieu de résidence permanente. En revanche la série télévisée allemande qui a contribué au succès des enquêtes de son commissaire fétiche m'a encouragé à lire les vrais romans. Je n'en suis pas déçu, le voyage extraordinaire dans cette cité mythique autant que l'intrigue policière, malgré quelques longueurs, ont été pour moi l'occasion d'un bon moment de lecture.
-
LES VIEUX GARCONS DE BROKEN HILL- Arthur UPFIELD
- Le 06/05/2013
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°647– Mai 2013.
LES VIEUX GARCONS DE BROKEN HILL- Arthur UPFIELD - 10/18
Traduit de l'anglais par Michèle Valencia.
Décidément, l'inspecteur Napoléon Bonaparte qui préfère de loin qu'on l'appelle Bony, aime parler de lui comme étant le meilleur flic d'Australie. C'est un peu vrai puisque, une fois encore il doit quitter sa circonscription du Queensland pour venir élucider, pendant 15 jours, en Nouvelle-Galles du Sud un double assassinat au cyanure que la police locale peinait à résoudre. Ce délai peut paraître court, mais notre policier, sûr de lui, se fait entière confiance pour mener à bien cette mission dont il "consent" à s'occuper. Il n'envisage même pas l'ombre d'un échec. Unique, il l'est à plus d'un titre et entend une nouvelle fois être à la hauteur de sa réputation. Pour plus d'efficacité, il œuvrera encore une fois incognito et donc sous un faux nom dans cette ville de Broken Hill, petite ville minière calme et prospère. Il se met donc à la disposition du chef de la police locale, le commissaire Pavier, qui favorisera ses recherches en lui adjoignant le personnel commandé par le sergent Crome.
Lors de la précédente enquête menée par l'inspecteur Stillman venu de Sidney, ce dernier avait, dans son rapport, pointé les insuffisances du sergent, rudoyer quelque peu les témoins et même laissé dans son sillage un mauvaise image, mais sans pour autant élucider l'affaire. Cet inspecteur était à l'évidence incompétent mais avait le talent de rejeter ses propres carences sur les autres comme cela se voit souvent dans le monde du travail en pareilles circonstances. Les choses se présentent donc mal pour tout le monde, mais Bony s'attache d'abord à rassurer le sergent. Pour autant les deux meurtres sont apparemment sans mobile, sans témoins, les deux victimes n'ont aucun lieu de parenté et aucun point commun entre elles si ce n'est qu'ils sont tous les célibataires, âgés, bien en chair et mangeant salement, des vieux garçons donc ! Une affaire comme il les aime : compliquée !
Pourtant, il y a urgence car les deux meurtres pourraient bien être suivis d'autres tout aussi mystérieux. Effectivement, d'autres crimes sont perpétrés, un autre par empoisonnement au cyanure et un dernier sur la personne de la secrétaire du commissaire, poignardée. Heureusement Bony, bien qu'il n'ait aucune parenté avec Socrate et qu'il soit conscient de la fragilité des témoignages, a une façon très personnelle de s'adjoindre l'aide de la population et même de la presse locale, ainsi que d'accoucher les esprits et sa maïeutique se révèle bigrement efficace.
Dans cette petite ville, Bony rencontre aussi Jimmy Nimmo, dit le Casseur, une veille connaissance, un petit malfrat et un cambrioleur notoire, retiré à Broken Hill parce qu'il est tombé amoureux d'une femme qu'il souhaite épouser mais celle-ci n'y consentira que s'il rentre dans le rang et obtient un emploi régulier dans une mine. Pour lui qui est un as dans sa spécialité, c'est presque une déchéance. Tout l'art de Bony sera de le recruter pour que, encore une fois, il mette en œuvre ses talents... mais exclusivement au service de la Police !. Notre inspecteur déploie donc ses talents d'enquêteur, à la satisfaction de ses collègues, de la hiérarchie locale et même de la population qui ne regrette pas le sinistre inspecteur Stillman. Bony, avec son traditionnel thé et ses cigarettes horriblement mal roulées, traîne derrière lui une réputation de mauvais flic, non parce qu'il échoue dans ses enquêtes, mais bien au contraire parce qu'il n'est que trop indépendant voire marginal et que ses méthodes sont des plus originales et peut-être un peu en marge de la procédure légale. Il n'est pas dans le moule, ce qui lui vaut régulièrement d'être licencié de son poste... pour y être immédiatement réintégré !. Cette fois encore, il n'échappe pas aux bassesses dont le monde du travail est si friand et qui met régulièrement en scène les incompétents, les flagorneurs et les arrivistes, ces défauts se retrouvant souvent dans les mêmes personnes. Sur ordre de sa hiérarchie, il va être dessaisi du dossier qu'il avait pourtant bien contribué à faire évoluer dans le sens de la vérité. C'est Stillman qui n'a guère digéré son échec précédent qui débarque à nouveau dans l'affaire mais Bony n'entend pas en rester là. Un peu comme à chaque fois, et au dernier moment, les choses reviennent à leur vraie place, pour le plus grand plaisir du lecteur, même si cette fois épilogue est un peu inattendu.
© Hervé GAUTIER - Mai 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA MORT D'UN TRIMARDEUR - Arthur Upfield
- Le 24/04/2013
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°645– Avril 2013.
LA MORT D'UN TRIMARDEUR - Arthur Upfield - 10/18
Traduit de l'anglais par Michèle Valencia.
La muraille de Chine n'existe pas uniquement dans l'Empire du Milieu. Elle est présente au sud-est de la Nouvelle Galles du Sud, en Australie, mais c'est une formation géologique naturelle. C'est à l'ombre de celle-ci qu'a été retrouvé mort un gardien de troupeaux. Ce crime, parce que c'en est un, a attiré ici l’inspecteur Napoléon Bonaparte, dit Bony, qui laisse dire avec une certain détachement qu'il est le meilleur flic du pays, et ce d'autant plus que la police locale a quelque peu peiné dans le déroulement de l'enquête. Il ne conçoit sa présence sur place que dans la mesure où une affaire est comme il les aime : compliquée ! Selon sa bonne habitude, et pour être plus efficace dans ses investigations, il évite de se recommander de sa qualité de policier, se fond dans la population en buvant de petits verres de gnôle au bar et en fumant des cigarettes effroyablement mal roulées. Ici, il se fera passer pour un ouvrier agricole qui cherche du travail. Les policiers locaux sont tellement abusés par sa mise en scène qu'ils l'enferment au poste, mais pour quelques temps seulement. Pour faire bonne mesure et pour donner le change à la population, il va même jusqu'à se faire condamner par le tribunal local à une peine de principe cependant. Sa présence tombe plutôt bien puisqu'on vient de découvrir, après une autre mort fort suspecte, dans la même cabane que précédemment, un deuxième cadavre, celui d'un trimardeur, apparemment sans rapport avec le premier mais les constations du médecin légiste concluent à un meurtre déguisé en suicide : tout à fait une affaire pour Bony qui va ainsi profiter de son stratagème pour enquêter plus librement et recueillir les commentaires de la population.
Bony est un homme avisé et un policier intelligent et surtout atypique qui s'en tient rarement aux évidences et sait tout aussi bien lire dans "le grand livre de la brousse" que de faire parler les moindres indices. Ici, c'est un banal jeu de morpion qui retient son attention mais lui y voit bien autre chose qui pourrait bien fournir une explication à cette série de meurtres. Bizarrement peut-être, il a une philosophie assez originale au regard du crime et prétend que le mal ne triomphe jamais. Il est vrai que, selon ses dires, il n'a jamais connu l'échec ! Il sait aussi, de part son expérience et sa faculté de déduction, que ce double meurtre est forcément le fait d'un habitant de ce village et a déjà, grâce à la chance ou, comme il le dit, à la Providence, compris les grands traits de son caractère. Il sait aussi que lui, Napoléon Bonaparte, n'est pas le seul à pouvoir changer de nom et d’apparences et que les plus flagrantes sont parfois trompeuses. Il n'y a en effet pas que les policiers d'élite qui peuvent se cacher derrière une fausse identité. La société peut, elle aussi, offrir aux criminels un décor dans lequel ils peuvent aisément disparaître et ainsi se dérober à la vigilance de tous. Mais cela non plus n'a pas échappé à Bony !
Il est par ailleurs certain que notre inspecteur n'a aucune parenté avec Don Quichotte, mais cette histoire de moulins à vent le tracasse d'autant que la fille du sergent qui l'a accueilli, c'est à dire qui a été de connivence avec lui pour son incarcération, a été enlevée et laissée pour morte dans la cabane où les victimes ont été retrouvées. Tout cela complique un peu cette enquête qui traîne en longueur mais finalement, et comme à l'accoutumée notre fin limier parviendra a expliquer tout cela et à confondre le coupable.
La lecture d'un roman d'Upfield est toujours pour moi un bon moment de lecture.
© Hervé GAUTIER - Avril 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE MONSTRE DU LAC FROME - Arthur Upfield
- Le 15/04/2013
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°643– Avril 2013.
LE MONSTRE DU LAC FROME - Arthur Upfield 10/18
Traduit de l'anglais par Michèle Valencia.
Dans une exploitation du sud de l'Australie, près du lac Frome, un visiteur, Éric Maidstone, s'était présenté comme professeur en vacances et passionné de photographie. Il souhaitait réaliser un reportage sur les animaux de la région, le lac lui-même et les puits artésiens qui entourent l'exploitation de Quinambie. Cette dernière est située du côté de la clôture qui sert de protection contre les chiens sauvages et aussi sur la frontière qui sépare trois états de l'Australie méridionale. Pendant son temps de vacances il souhaitait habiter temporairement la maison du lac Frome, c'est à dire loin de tout. Pourtant, l'éloignement, le désert, n'étaient pas les seuls problèmes puisque les aborigènes parlaient d'un monstre qui hantait les lieux, un chameau meurtrier, mais ce n'était peut-être qu'une légende ! Les autochtones le craignaient parce que, disait-on, il s'attaquait à tout ce qui ressemblait à un homme. On suivit les traces de Maidstone qui devinrent de moins en moins visibles et on retrouva son cadavre percé d'une balle. Cette mort ne pouvait donc accréditer la fable du chameau mais il s'agissait bien d'un crime !
L'inspecteur Napoléon Bonaparte qui souhaite surtout se faire appelé Bony, fut donc chargé de cette enquête, mais, pour être plus efficace dans la recherche des indices, et pour mieux pénétrer ce milieu des travailleurs de la clôture, il va se faire embaucher comme l'un d'eux, mais sous le nom de Ed Bonnay, c'est à dire cacher sa fonction de policier. S'il s'était annoncé de cette manière il aurait été repoussé voire éliminé parce que, il s'en rend vite compte, les flics ne sont pas les bienvenus dans cette région d’Australie. Pour autant, l'affaire se présente mal, pas d'indices, pas de mobile et évidemment pas de témoins mais c'est là une enquête difficile, comme Bony les affectionne, d'autant que la police locale n'était pas vraiment parvenue à l'élucider.
Il a beau être à moitié aborigène, savoir lire les traces laissées sur le sable, connaître les légendes et les coutumes des autochtones, il n'est pas forcement accepté dans ce milieu très fermé de ces hommes durs à la tâche, souvent marginaux, plus ou moins repris de justice et surtout friands de leur liberté. Il a beau s'être fait passer pour un travailleur, ceux qui redoutent la présence des étrangers le soupçonnent de n'être pas exactement ce qu'il prétend être. Bony n'oublie pas non plus que les aborigènes sont un peuple mystérieux qui pratiquent des rites magiques comme la technique de "l'os pointé" qui est chez eux une véritable condamnation à mort et d'autres aussi comme notamment la transmission de pensée que les blancs ont depuis longtemps oubliée. Il se peut que le professeur ait vu ou fait quelque chose de contraire à leurs traditions pour avoir mérité la mort mais la présence d'une balle n'est pas vraiment dans leur culture. Et puis le désert rend fou ceux qui y restent trop longtemps !
Fidèle à ses habitudes, et surtout après avoir réfléchi posément, longuement et observé les choses et les gens, Bony en arrive à la conclusion logique que les aborigènes savent qui a tué le professeur, mais n'en diront rien puisqu’ils détiennent un secret. Il craint aussi pour sa vie puisqu'il pourrait bien, lui aussi être leur prochaine victime mais, heureusement sait comment se libérer de leur emprise. Il sait aussi que la mort de Maidstone peut n'être qu'un simple accident puisqu'on ne lui a rien volé et que son matériel est intact, mais la région désertique favorise également le vol de bétail qui est fréquent mais difficile à empêcher.
Tel est le thème de ce roman d'Arthur Upfield, passionnant, dépaysant, fort bien écrit et chargé en suspens, comme toujours ! J'ai découvert cet auteur il y a peu et j'avoue ne rien regretter. La lecture d'un de ses romans est à chaque fois une découverte ainsi qu'en atteste les nombreux articles que cette revue lui a consacrés.
© Hervé GAUTIER - Avril 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA LOI DE LA TRIBU - Arthur Upfield
- Le 11/04/2013
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°642– Avril 2013.
LA LOI DE LA TRIBU - Arthur Upfield 10/18
Traduit de l'anglais par Michèle Valencia.
Nous sommes dans le nord de l'Australie, à la frontière du désert. Dans "le lit de Lucifer" , c'est à dire dans un cratère creusé dans la bush par un météorite voilà de nombreuses années, on vient de retrouver le cadavre d'un homme blanc, un étranger. Bien entendu, l'inspecteur Napoléon Bonaparte, autrement dit Bony, est désigné par le gouvernement fédéral pour faire toute la lumière sur cette affaire criminelle. Pourtant aucun étranger n'a été signalé dans les exploitations les plus proches et le mystère s'épaissit avec le silence qui entoure cette affaire. La seule hypothèse avancée est qu’il serait tombé d'un avion, mais elle ne tient pas et le policier devra déterminer ce qu'il faisait avant sa mort et surtout la raison pour laquelle cet homme a pu pénétrer le territoire de la tribu sans que personne ne s'en rende compte. Bony est un sang-mêlé et à ce titre connaît bien les aborigènes et les noirs sauvages du désert et il sait donc que cet homme n'a pu traverser la région sans que les autochtones le sachent. Tout son talent va donc être de leur faire dire ce qu’ils savent, interpréter leur silence, lire les traces laissées sur le sable du désert... et il est sûrement le seul à pouvoir le faire.
Dans ce roman, les relations parfois difficiles entre les communautés, blancs et aborigènes, sont juste esquissées. Ici, la ferme où se passe l'intrigue est tenue par un couple de blancs et les aborigènes semblent avoir du mal à les accepter. De plus, au cours du récit, le lecteur a un peu l'impression que la recherche de la vérité à propos de ce cadavre est parfois un peu oubliée .
Dans ce récit, notre inspecteur donne toute sa mesure de la connaissance du pays profond, des tribus, de leurs lois, de leurs légendes, de leurs coutumes et de leurs habitudes autant qu'il se révèle un fin connaisseur de la psychologie des blancs et un audacieux joueur de poker puisque sa démarche d'enquêteur inclue aussi le pari. Bony démêle donc ce mystérieux meurtre et détermine sans difficulté les auteurs de ce crime lié à la politique expansionniste des pays voisins. Sans oublier bien sûr "l'amour qui fait marcher les étoiles et le soleil".
Arthur Upfield quant à lui, établit une nouvelle fois, qu'il est le talentueux auteur de romans policiers ethnologiques. Il distille jusqu'à la fin le suspens avec des descriptions poétiques toujours appréciées.
D'ordinaire, j'aime bien les romans d'Arthur Upfield mais ici, je dois avouer que le dénouement m'a un peu déçu. Cependant je reste attentif à l'atmosphère si particulière des romans d'Upfield.
© Hervé GAUTIER - Avril 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA BRANCHE COUPEE - Arthur Upfield
- Le 06/04/2013
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°641– Avril 2013.
LA BRANCHE COUPEE - Arthur Upfield - 10/18
Traduit de l'anglais par Michèle Valencia.
Cela fait trois années que la sécheresse sévit dans cette région désolée de la Nouvelle Galles du sud. Les Downer père et fils tentent d'y survivre avec un troupeau de plus en plus diminué et songent même à cesser leur activité d'éleveurs. En rentrant chez eux, après leur traditionnelle soûlerie annuelle, ils trouvent un inconnu mort et constate que leur employé, Carl Brandt a disparu. Rapidement, il apparaît que la première victime est Dickson, un prisonnier évadé et et Brandt a, lui aussi, été retrouvé mort apparemment assassiné. Devant ce double meurtre, Bony se perd en conjectures d'autant que les circonstances et les indices qu'il constate épaississent le mystère qui les entoure. Il doit faire appel à sa connaissance du terrain autant qu'à celle des hommes. En cela il est aidé, si on peut dire, par les toiles peintes par Robin Pointer, une jeune fille voisine des Downer qui souhaite épouser Eric, le fils, et aussi l'aider dans son combat contre la sécheresse. L'observation et surtout la compréhension de son art lui seront d'un grand secours dans la conclusion de son enquête. Comme l'endroit est quasiment désert, l'inspecteur Bony va s'installer chez Les Pointer et observer les lieux.
Comme nous sommes en Australie, il y a aussi des aborigènes qui campent à proximité des habitations des éleveurs. Ils sont censés détenir le secret de la pluie et donc du renouveau de la région et c'est effectivement ce qui se produit. La pluie en tombant va aussi révéler des traces que la poussière du désert cachait jusqu'à présent. Bony n’oublie pas qu'il est un aussi sang-mêlé et donc qu'il détient au moins une partie de la clé de ce mystère dans la mesure où il peut lire dans la psychologie de ce peuple auquel il appartient. Il en connaît les rites et les coutumes et sait interpréter utilement un détail qui se révèle essentiel mais à côté duquel un enquêteur blanc passerait sans le voir. Mais il sait aussi lire, bien mieux qu'un blanc, dans le grand livre de la Brousse et comprendre ce peuple que les colons ont un peu trop tendance à considérer comme de arriérés ou des primitifs. Il est aussi réceptif à l'esprit des lieux, et apparemment, il est bien le seul. Héritier de deux cultures, il sait comprendre les éleveurs, leur psychologie, leurs aspirations, leur fierté aussi, le sens du moindre de leurs gestes. Comme le fait dire l'auteur à l'un des personnages, Bony est réellement quelqu'un qui est "hors du commun", un policier capable de démêler efficacement les fils compliqués d'une affaire criminelle.
Cela donne encore une fois un roman fort bien écrit [les descriptions poétiques ont toujours retenu mon attention surtout quand elles s'inscrivent dans le cadre d'un roman policier], plein de rebondissements et qui tient, dans un dépaysement complet son lecteur en haleine jusqu'à la fin. Je n'oublierai pas non plus l'amour sans lequel aucun bon roman n'est possible. Comme nous le révèle la 4° de couverture reprenant un article de presse : "On commence à lire et, doucement, le récit tisse autour de vous une aura paisible, le bonheur dans la lecture"..
© Hervé GAUTIER - Avril 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
Quelques mots sur Arthur Upfield (1888- 1964)
- Le 04/04/2013
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°640– Avril 2013.
Quelques mots sur Arthur Upfield (1888- 1964)
Drôle d'existence que celle d'Arthur Upfield. Né dans un milieu bourgeois aisé d'Angleterre, mais ayant échoué dans ses études, il est envoyé par ses parents en Australie à l'âge de 19 ans. Là, il découvre l'île-continent, les grands espaces et la vie sauvage. Pendant dix années, coupé de ses racines familiales il va voyager dans le pays et pour subsister, exerce divers petits métiers comme trappeur, manœuvre, chercheur d'or. Cela lui permet de se familiariser avec la culture aborigène, ce qui lui servira par la suite...En 1914 il part pour la guerre, combat en France et en Égypte et se marie. Il revient en Australie à la fin du conflit mondial.
Alors qu'il était cuisinier en Nouvelle-Galles du Sud, il rencontre Tracker Léon, un métis avec qui, quelques années auparavant, il avait sillonné la côte. L'histoire de cet homme a quelque chose d'original : Fils d'un colon blanc et d'une aborigène exclue de sa tribu, il a fini par trouver un emploi dans la police du Queensland. Il est ainsi l'héritier de deux cultures mais a parfaitement assimiler l'apport occidental au point d'avoir une véritable passion pour la lecture. Au moment de se quitter, les deux hommes échangent des livres et Arthur hérite d'une biographie de l'empereur Napoléon 1°. Upfield qui avait déjà fait des débuts littéraires sans succès sut, à ce moment-là quel serait son véritable métier : Il deviendra écrivain ! D'après la biographie d'Upfield que sa compagne publia après sa mort, le personnage de l'inspecteur Bony lui a été inspiré par un authentique pisteur rattaché à la police et qu'il aurait rencontré lors de ses errances. Ainsi est né, probablement vers 1929, son personnage emblématique nommé Napoléon Bonaparte qui se fait appeler par tous Bony même s'il est en réalité la synthèse de différents aborigènes qu'il a rencontrés au cours de sa vie errante. Avec le publication de ses premières enquêtes en 1928, le succès est au rendez-vous.
Tout l'art d'Upfield réside dans l’intrication étroite entre fiction et réalité. En 1931, Upfield avait écrit un roman "Les Sables de Windee". Il avait en effet travaillé long d'une clôture anti-lapins qui protégeait les champs de blé de ce prédateur. Son travail consistait à l'inspecter à cheval. Autour de cette expérience, Upfield avait imaginé un roman où on ferait disparaître un cadavre sans laisser de trace et un éleveur itinérant s'en servit pour perpétrer un crime. Cet épisode assura à Upfield une relative notoriété.
Il tenta de vivre de sa plume, devint journaliste, ses romans policiers étant publiés sous forme de feuilletons. Ce n'est qu'en 1943 et après son divorce et la publication de ses romands aux États-Unis qu'il connut réellement la notoriété et une relative aisance financière. Ensuite, de retour en Australie, il devint scientifique et se consacra à l'exploration du nord et de l’ouest de l'île. Il se retira en Nouvelle-Galles du Sud où il mourut en 1964.
Il est un personnage qui apparaît dans la plupart de ses romans à partir de 1920; c'est l'inspecteur Napoléon Bonaparte qui préfère qu'on l'appelle Bony. C'est certes un personnage de fiction mais il doit son existence à un ou plusieurs policiers bien réels et mérite de figurer parmi les grands détectives. tels que Sherlock Holmes, Hercule Poirot et le juge Ti [Mon lecteur pourra se référer au nombreux articles de cette revue au sujet de ce dernier enquêteur emblématique].
Upfield a écrit une trentaines de romans qui sont publiés en langue française.
Écrire des romans policiers et bel et bon mais l’originalité d'Upfield réside sûrement dans le fait qu'il a su tirer partie de son expérience pour mettre en œuvre un style policier particulier basé sur l’ethnologie. En effet, Bony qui est un sang-mêlé, ne manque jamais de faire référence à ses origines aborigènes et de s'en servir dans ses enquêtes.
Des écrivains ont salué l'apport d'Upfiel à la littérature policière et l'Américain Tony Hillerman [1925-2008] a reconnu avoir été inspiré par l'Australien notamment par son travail sur l'ethnologie.
© Hervé GAUTIER - Avril 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
BONY ET LA BANDE A KELLY - Arthur Upfield
- Le 03/04/2013
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°639– Avril 2013.
BONY ET LA BANDE A KELLY - Arthur Upfield - 10/18
Traduit de l'anglais par Michèle Valencia.
Dans une région connue sous le nom de Cork Valley, en Nouvelle-Galles du Sud, les autorités ont depuis longtemps constaté nombre d'activités illicites sans pour autant pouvoir y mettre de l'ordre. Cette vallée toute entière dédiée aux clans irlandais vivait donc en vase clos et entendait bien continuer ainsi. Aussi bien était-elle soumise, par ses habitants eux-mêmes, au contrôle constant de tous les intrus qui étaient systématiquement soupçonnés de venir troubler leurs petits trafics. Cette communauté était foncièrement attachée à sa liberté et aux idéaux de ses ancêtres, se rebellait en permanence contre le monde politique et administratif composé à leurs yeux de profiteurs et de parasites. Le refus des taxes était leur manière à eux d'y manifester leur opposition. Il y avait eu différentes disparitions et notamment le meurtre d'un contrôleur des contributions qui traquait la production et le trafic d'alcool clandestin et les fraudes aux redevances de télévision. Il s'était fait passer pour un géologue. L'inspecteur Bony fut donc désigné pour enquêter mais à sa manière, c'est à dire en immersion complète dans ce milieu et sans lien avec l'extérieur. Pour cela et surtout pour se faire accepter dans cette vallée habitée par des Irlandais, les Kelly et les Conway, il se fait passer pour Nat Bonney, un voleur de chevaux en fuite et réussit à se faire engager comme ramasseur de pommes de terre dans une ferme habitée par les Conway, retors à tout ce qui est légal et spécialement aux impôts et taxes. Bien que loin du bush qu'il connaît bien, Bony parvient à se faire accepter par cette communauté et c'est plutôt favorable au succès de sa mission.
Il joue même tellement bien son rôle, il entretient tellement régulièrement l'illusion qu'il est un voleur de chevaux en délicatesse avec la loi et la police qu'il est carrément adopté par les Conway et qu'il est regardé comme l'un des leurs, bien qu'il ne soit pas Irlandais. Son entreprise de séduction auprès des différents membres de cette communauté est telle qu'il participe volontairement à des activités de contrebande pour mieux donner le change. De fait, personne ne semble se méfier de lui d'autant qu'il a donné à plusieurs reprises des marques d'attachement à ces Irlandais. Son enquête ne peut que profiter de cette ambiance de confiance.
Le 1° juillet approchait et cette date anniversaire célébrée par la communauté allait aussi attirer du monde dans cette vallée. Cette fête qui devait durer 3 jours retraçait la disparition de "la bande à Ned Kelly" en 1880. Elle avait été exterminée dans le "Glenrowan hotel" par la police à la suite d'une erreur 'appréciation, mais c'était d'autant plus inacceptable pour eux que ces policiers étaient d'origine irlandaise ! Certes, Bony se sentait bien au sein de cette communauté, mais, en bon policier, ne perdait pas de vue sa mission : faire toute la lumière sur la disparition du contrôleur des contributions. Les préparatifs de la fête allaient immanquablement relâcher quelque peu l'attention, l'alcool délier les langues et favoriser les confidences et donc les investigations de Bony. Malheureusement pour les Irlandais, l'histoire bégaie .
Je suis toujours attentif aux enquêtes de Bony, à la fois bien menées, bien écrites et ménageant le suspens jusqu'à la fin, mais là, j'avoue que ce roman manque un peu de souffle et s'égare un peu dans des détails un peu inutiles.
© Hervé GAUTIER - Avril 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
Quelques mots sur Tenessee Williams[1911-1983]
- Le 01/04/2013
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°638– Avril 2013.
Quelques mots sur Tenessee Williams[1911-1983]
Mort oublié dans une chambre d'hôtel new yorkais , Tennessee Williams est un écrivain américain, auteur de nombreuses pièces de théâtre dont la plupart ont été portées à l'écran. Il a également écrit des romans, des poèmes et des nouvelles mais il est plus spécialement connu en tant que dramaturge. Connu, ce n'est pas si sûr puisque si les films qui ont été réalisés à partir de son œuvre, qui ont fait le tour du monde et dont les titres restent dans la mémoire collective ["Une chatte sur un toit brûlant", "Soudain, l'été dernier", "Un tramway nommé désir", "La nuit de l’iguane"], son nom est bien souvent passé sous silence au profit de metteurs en scène célèbres [ Richard Brooks, Joseph Mankiewicz, Elia Kazan] et surtout d'acteurs [Élisabeth Taylor, Katherine Hepburn, Vivian Leigh, Paul Newman, Marlon Brando, Burt Lancaster ]. Il doit sa notoriété au cinéma mais, paradoxalement peut-être, il déclarait volontiers qu'il n'aimait guère les adaptations cinématographiques de ses œuvres.
En France, il a été évoqué dans la très belle chanson [paroles et musique] de Michel Berger interprétée par la voix cassée et pour une fois mélancolique de Johnny Hallyday. Pourtant, si on ne prête pas attention aux paroles pourtant explicites, beaucoup de nos contemporains ont tendance à n'y voir qu'une allusion... à un état des États-Unis !
Thomas Lainer Williams [son surnom de Tennessee ne viendra que plus tard en hommage à son sud natal] est né dans l’État du Mississippi. Il passe son enfance avec sa mère et sa sœur Rose chez ses grands parents maternels. Son père, alcoolique et joueur et qu'il déteste, est le plus souvent absent . Thomas tombe gravement malade à l'âge de 5 ans et commence à écrire sous les encouragements de sa sœur. En 1928, il est alors adolescent, il effectue avec son grand-père maternel qu'il adore un voyage en Europe. Pendant ce périple il prend conscience de son homosexualité [Déjà son père l’appelait "Miss Nancy" parce que, rescapé d'une diphtérie, il était chouchouté par sa mère] mais aussi de sa vocation d'écrivain. En 1937, après que la schizophrénie de Rose ait été diagnostiquée et qu'elle eut subi une lobotomie qui l'a laissée très diminuée, il rompt avec sa famille, part pour New-York où il exerce divers petits métiers qui lui laissent du temps pour écrire. En 1943, à l'entrée en guerre des États-Unis, il est réformé pour homosexualité, alcoolisme et troubles nerveux et cardiaques. Il tente alors sa chance à Hollywood comme adaptateur de romans chez MGM à laquelle il propose une de ses œuvres où il met en scène sa mère et sa sœur. C'est un échec. Il réécrit ce texte qui devint une pièce autobiographique, "La ménagerie de verre" qui, montée à New-York, aura un succès inattendu et consacrera sa notoriété. Il a alors 34 ans. Puis suivront une vingtaine de pièces, toutes montée à Broadway. Ce sera, en 1948 "Un tramway nommé désir" que met en scène Elia Kazan et qui consacrera un nouvel acteur, Marlon Brando. Cette œuvre sera adaptée en France par Jean Cocteau. Avec ce film en 1948 puis avec "Une chatte sur un toit brûlant" en 1955 il remporte par deux fois le Prix Pulitzer.
Son œuvre met en scène des personnages marginaux, écorchés-vifs, frustrés, fragiles, solitaires et en butte contre la société comme il l'était lui-même. Ses personnages sont souvent coincés entre la réalité et leurs illusions["Cette force qui nous pousse vers l'infini y a un peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit"] leurs fantasmes sexuels["Un tramway nommé désir"], leur mémoire ["La ménagerie de verre"] "l'inconscience de leurs désirs.["Cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui"].
Ses pièces de théâtre font toutes référence à sa biographie et il y parle bien entendu de l'homosexualité, mais à mots couverts ("Une chatte sur un toit brûlant"). Tennessee Williams était homosexuel, pourtant, les personnages de ses pièces ne le sont pas ouvertement, ou ils sont morts avant le lever de rideau. Il est vrai qu'il ne fallait pas choquer la très puritaine Amérique des années 50. Il semblerait même qu'il n'aurait pas été favorable à un militantisme homosexuel. Pourtant, il n'affichera sa préférence sexuelle qu'à la fin de sa vie, menant une relation longue avec Franck Merlo. Sa mort en 1963 le laissera définitivement meurtri, s'adonnant sans frein à l'alcool et à la drogue. Pourtant, il est un fait que toute la vie de Williams a été vouée à tous le excès. Michel Berger évoque très bien cela " Le corps en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie". Il lui survivra cependant mais il s'éteindra à New-York en 1983 dans un relatif anonymat. .["Comme une étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autre s'aiment à la folie, sans aucun éclat et sans un bruit, sans un seul amour et sans un seul ami, ainsi disparut Tennessee"].
Il a, comme chacun d'entre nous, fait son parcours original et douloureux sur terre. Son œuvre en a gardé la mémoire, témoigne de ses espoirs, de ses fantasmes, de ses peurs, de ses échecs ["Cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui." "A certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie"]. Il reste, aux États-Unis en tout cas, un auteur majeur.
On ne peut, évidemment, limiter l'évocation d'un écrivain aussi considérable que Tennessee Williams aux paroles d'une chansons si belle soit-elle, mais j'ai voulu, dans ce court article lui rendre ce modeste hommage, en prélude peut-être au trentième anniversaire de sa mort, cette année.
Montaigne l'a dit autrement mais cette chanson garde son empreinte, celle de la condition humaine qui nous est commune " On a tous en nous quelque chose de Tennessee".
© Hervé GAUTIER - Avril 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
THE MELBOURNE CUP MYSTERY – Arthur Upfield
- Le 29/03/2013
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°637– Mars 2013.
THE MELBOURNE CUP MYSTERY – Arthur Upfield - Éditions de l'Aube.
Traduit de l'anglais par Michèle Valencia.
Le festival de course de printemps d'Australie est un événement international en matière de courses de pur-sang. La coupe de Melbourne en est le moment le plus attendu et les courses de chevaux font partie intégrante de la culture australienne. Ce roman connu sous le nom du "Pari fou à la course de Melbourne" met en scène deux amis, Roy Masters et Dick Cusack, qui sont amoureux de la même femme, la belle Diana Ross. Diana est non seulement jeune et jolie, mais elle est aussi l'héritière d'une immense fortune bâtie sur le commerce avec la Chine. Cette dernière, ne voulant choisir entre eux, avoue leur préférer un homme exceptionnel comme un constructeur de ponts ou un homme politique célèbre. Or l'un est éleveur et l'autre commerçant. Elles leur laisse cependant une chance infime : elle épousera celui des deux dont le cheval gagnera la Melbourne Cup. Tout cela est bel et bon, mais si ses deux prétendants sont effectivement propriétaires, ils ne possèdent que des chevaux de fiacre. Pour ne pas paraître ridicules, ils acceptent donc tout en se disant que la solution de leur problème réside peut-être dans le dopage de leurs champions, mais ils ont du mal à accepter cette éventualité. Malheureusement il y a un troisième larron, l'argentin José Alvery, un homme riche et beau qui va concourir pour Diana dans les mêmes conditions que Dick et Roy, sauf que son cheval à lui est un crack ! Pour autant rien n'est sûr et la jeune femme laisse planer un doute quant à son éventuel mariage que son tuteur ne souhaite pourtant pas pour des raison affectives.
Pourtant, ce qui n'est qu'un pari ridicule va prendre des proportions inattendues, le cheval de Roy est victime d'un dopage criminel visant à le détruire et il y a même une tentative nocturne de même nature dans les jours qui suivent. Alvery, quant à lui, semble en savoir beaucoup sur Diana. A mesure que le cheval de Roy s'améliore grâce à son jockey et menace de gagner, les ennuis continuent. Le jour de la Melbourne Cup, les événements se précipitent, des chevaux de Roy et de Dick sont tués et de vielles histoires qu'on croyaient oubliées depuis longtemps refont surface mais aussi des questions d'intérêt et de gros sous où la pègre a, bien entendu, sa place.
Je ne sais pas pourquoi mais le thème du départ, à savoir ce pari dont une femme était, de sa propre volonté, l'enjeu ne m'a pas accroché. Je le trouvais un peu artificiel. D'autre part, la première partie du roman qui tourne autour de l’entraînement des chevaux de courses et des inévitables trafics qui s'ensuivent m'a un peu rebuté. Ce n'est que vers la fin que ce roman prend sa véritable dimension policière et donc aussi son intérêt, même si le happy-end amoureux, toujours un peu convenu, m'a aussi un peu déçu.
Ce roman a été inspiré par la mort, en 1932, de Phar Lap, un des plus célèbres chevaux de course australien, à la suite de l'absorption d'une grande quantité d'arsenic. En 1930, il avait remporté la Melbourne Cup et on tira sur lui sans que la police puisse identifier le coupable. Ce roman date de 1933 et fut écrit pour être publié en feuilleton et ne fut édité en France qu'en 1996, soit trente ans après la mort de son auteur. A cette époque Upfield était employé comme rédacteur au journal "The Herald", à Melbourne et avait déjà commencé à publier quelques romans dont "Les sables de Windee" qui lui avait, un peu malgré lui, apporté la notoriété puisqu'un meurtrier s'était inspiré de cette œuvre policière.
"The Melbourne Cup mystery" est le premier roman d'Arthur Upfield que je lis où Bony, l'emblématique inspecteur Napoléon Bonaparte, n'est pas mis en scène. J'avoue que j'aime mieux l'ambiance du bush, que je ne connais cependant pas, et la personnalité singulière de ce policier. Il reste que l'écriture de Upfield est originale et sa manière de distiller le suspense est unique.
© Hervé GAUTIER - Mars 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
L'EMPREINTE DU DIABLE – Arthur Upfield
- Le 26/03/2013
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°636– Mars 2013.
L'EMPREINTE DU DIABLE – Arthur Upfield - 10/18.
Traduit de l'anglais par Michèle Valencia.
Parce que le "Chalet du Panorama" offre le calme d'une belle pension dans l'état du Victoria, l'inspecteur Bony s'y rend pour une courte période de vacances. Est-ce lui qui attire les ennuis, en tout cas on découvre au matin le cadavre en robe de chambre de M. Grumann, un autre pensionnaire. Le même jour, l'officier de police local venu faire les premières constations est assassiné par un homme qui se prétend l'ami de M. Grumann et qui, après son forfait, prend la fuite. Cela fait un peu beaucoup et surtout que ce n'est pas une bonne publicité pour cette petite pension réputée calme et dirigée par Mlle Jade.
En réalité, si Bony est sur place, c'est moins pour prendre des vacances que pour surveiller, et ce pour une fois pour le compte de l'armée, ce M. Grumann qui en réalité est un général allemand, officiellement mort à la fin de la 2° guerre mondiale, et qui détient des secrets militaires. Pour corser le tout, les bagages de ce général ont disparu et celui qui l'a assassiné, Marcus, s'avère être un dangereux trafiquant de drogue international. Bony évoque même à son sujet un auteur de romans policiers local.
A la suite de péripéties, notre limier finit par récupérer ce que détenait l'ex officier allemand sous forme de micro-films. Sa mission officielle est donc terminée. Bony reste cependant un policier et bien qu'il n'en soit pas chargé et qu'il ne soit pas dans sa circonscription, souhaite éclaircir le mystère de la mort de ce général. Dans ce but, il revient au chalet terminer ses "vacances" tant le séjour lui est agréable, à moins que ce ne soit le charme de son hôtesse ! Le battage fait autour de ce double meurtre a attiré d'autres pensionnaires et, avec la collaboration active de Bisker, un homme à tout faire du chalet, il entreprend des recherches qui tournent autour d'empreintes laissées par un homme qui chausse... du 46 et qu'il soupçonne d'être pour quelque chose dans le meurtre de Grumann. Les empreintes laissées sur la pelouse sont attribuées ... au diable, tant elles sont étranges.
Pour autant Bony ne perd pas de vue son idée et son histoire de chaussures devient presque obsédante au point qu'il observe maintenant tous ceux qu'il croise... et la dimension de leurs pieds ! Je ne parle même pas des traces qu'ils laissent sur le sol en se déplaçant puisque ce détail n'échappe pas au demi-aborigène qu'il est aussi. Au cours de ses investigations, il apprend que Clarence Bagshott, l'écrivain local, par ailleurs bien bizarre dans son comportement et dans son histoire, chausse du 46 !
Tout cela finira par s’éclaircir, mais laborieusement quand même et les explications fournies ramène le lecteur à la Seconde Guerre mondiale et ses activités d'espionnage.
Comme toujours, j'ai trouvé ce roman passionnant du début à la fin non seulement à cause du suspense lentement distillé mais je n'ai pas été insensible non plus aux descriptions des paysages..
© Hervé GAUTIER - Mars 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
CRIME AU SOMMET – Arthur Upfield
- Le 25/03/2013
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°635– Mars 2013.
CRIME AU SOMMET – Arthur Upfield - 10/18.
Traduit de l'anglais par Michèle Valencia.
Cinq mois plus tôt, deux randonneuses ont disparu dans les montagnes australiennes du Grampians et le jeune inspecteur Price, parti à leur recherche, a été retrouvé mort, tué par balle. Napoléon Bonaparte, alias Bony, inspecteur de police de son état, va donc mener son enquête mais, pour protéger sa vie se fait passer pour John Parkes un éleveur modeste d'une autre région qui prend des vacances pour la première fois de sa vie. Il descend bien entendu dans l’hôtel de Baden Park, là où les deux jeunes filles ont été vues avant leur disparition.
L’hôtel est à peu près désert à cette période de l'année et Bony y rencontre le patron, Jim Simpson et sa sœur, le père de ces derniers, infirme, alcoolique et un peu malveillant qui parle un peu trop au goût de ses enfants et notamment d'un cadavre qui serait dans le cellier. Le policier y rencontre aussi un perroquet bien bavard et quelque peu irrespectueux. L'esprit toujours en éveil de Bony ne manque pas d'être impressionné par le patron, Jim, et sa curieuse habitude de jouer de l'orgue mais surtout de porter des vêtements élégants, de rouler dans une voiture luxueuse, ce qui est plutôt surprenant dans ce coin perdu. Toujours à l’affût, il sympathise avec le père du patron qui lui parle d'un employé, Ted O'Brien, viré parce qu'il fréquentait d'un peu trop près le cellier, mais seulement après la disparition des deux jeunes filles. Il a été remplacé par Glen Shraron, un américain, accessoirement lanceur de couteaux.
Bony ne manque pas de mener discrètement des investigations dans les alentours de l'établissement mais le vieux Simpson se révèle plus matois et hâbleur qu'il ne l'aurait cru. Le policier remarque cependant qu'il existe des contradictions et même des zones d'ombre dans le rapport d'enquête et ne laisse d'être intrigué par les voisins de l'hôtel mais aussi par Jim qu'il découvre vantard et menteur et par son employé américain. Apparemment tous les deux s'intéressent à lui et notre policier subodore un trafic de moutons, de pierres précieuses et s'interroge sur la raison de cette clôture qui protège la propriété des voisins de l'hôtel. Puis les choses s'accélèrent et Bony doit quitter l'hôtel en catastrophe, prié de déguerpir par le patron lui-même. L'enquête que Bony a entamée ayant ainsi quelque peu été contrariée, il n'est pas homme à se laisser décourager et, pour mener à bien sa mission, il opéra une transformation au terme de laquelle, en se fondant dans la nature, il renouera en quelque sorte avec ses gènes. Il est en effet un métis qui a vécu dans sa jeunesse chez les aborigènes du bush et sait parfaitement maîtriser une telle situation. Il sera secondé par la chance qui lui procurera un allié inattendu, vivra bien des rebondissements et parviendra à reconstituer le cheminement criminel et, bien entendu, par mener à bien sa mission qui est de libérer les deux jeunes filles.
Bony est vaniteux, très conscient de sa supériorité qu'il tient d'un mélange de logique occidentale et de bon-sens aborigène, mais cela ne le rend pas antipathique pour autant. Je note cependant que dans ce roman, il est mis en présence d'un cadavre, ce qui suffit à la déstabiliser durablement. C'est sans doute très étonnant dans le cas d'un inspecteur de police de sa qualité mais, sur le plan de l'écriture, j'ai particulièrement apprécié l'évocation de cette scène autant que la description des paysages grandioses. J'ai goûté ce roman qui se lit facilement grâce au style agréable, au découpage en courts chapitres et à la subtile distillation du suspense. En outre, je ne dirai jamais assez l’importance de la traduction qui, ici offre un texte fluide et un grand confort de lecture. L'intrigue, même si elle évoque à la fin un trésor de guerre et prend donc une dimension internationale, a au moins l'avantage de solliciter l’imagination du lecteur.
Je suis volontiers entrer de plain-pied dans l'univers de cet auteur que je ne connaissais pas. Je ne regrette pas !
© Hervé GAUTIER - Mars 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE MEANDRE DU FOU – Arthur Upfield
- Le 22/03/2013
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°634– Mars 2013.
LE MEANDRE DU FOU – Arthur Upfield - 10/18.
Traduit de l'anglais par Michèle Valencia.
Une maison isolée, au centre d'une grande propriété dédiée à l'élevage des ovins, celle de Madden, est construite sur le méandre d'un fleuve maintenant à sec à cette saison. Nous sommes dans la région de Quennsland (Australie). Cette maison est habitée par Bill Lush, le second mari de Mme Madden, ancien ouvrier devenu éleveur par son mariage, par sa femme et par Jill, 19 ans, sa belle-fille.
Un soir où Bill rentre soûl comme à son habitude, un drame se joue dans cette maison et Mme Madden meurt le lendemain des mauvais traitements qui lui ont été infligés par son mari pour une sordide question d'argent. Le lendemain, Bill est introuvable, ce qui inquiète les autorités. L'inspecteur Napoléon Bonaparte, Bonny pour ses amis qui sont nombreux, et qui se préparait à partir en vacances se charge lui-même de cette enquête. John Lucas, le gendarme local sera son adjoint. Il y a peu d'indices, la porte d'entrée, neuve, a été remplacée en catastophe par une plus ancienne puis brûlée, à la demande de sa mère pour éviter le scandale. Jill avait tiré dans sa direction avec sa carabine pour éloigner Bill qui commençait à la défoncer avec une hache et menaçait ses occupantes. De plus, il y a un trou dans le plafond qui correspond au calibre de l'arme de Jill et c'est à peu près tout. Bony envisage toutes les hypothèses depuis le fuite de Lush ou un banal accident jusqu'à son assassinat par Jill qui a d'ailleurs pas mal de raisons pour cela. Au cours de son enquête il apprend à mieux la connaître ce qui tranche avec son impression première.
D'autre part, ses investigations lui apprennent que Lush était un sale type que beaucoup aimeraient voir mort, ce qui multiplie les suspects. Il n'en manque pas parmi tous ceux, trimardeurs ou gens du coin, tous avec un casier judiciaire plus ou moins chargé, qui, le soir de la disparition de Bill, étaient dans le coin. Malheureusement pour lui, le mobile lui échappe et semble même inexistant. Bony s'installe donc dans cette maison dans l'attente éventuelle venue de Bill qu'il veut arrêter pour le meurtre de sa femme puis dans celle des voisins, les Cosgrove. Dehors la crue du fleuve menace et la pluie s'est mise à tomber. Tout cela va faire disparaître les rares traces qui subsistent encore. Le temps presse donc d'autant que le lit du fleuve, maintenant plein d'eau, entrave son enquête. Elle prend un tour nouveau par la découverte du corps de Bill atteint d'un balle mortelle mais qui cependant pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses.
Décidément, je le trouve bien ce Bony ! C'est une sorte d'Hercule Poirot qui prend son temps pour démêler le nœud gordien d'une enquête compliquée, fait bon marché de la procédure et des règlements, méprise la hiérarchie. Bref, c'est un enquêter un peu atypique, qui agit à son rythme et selon ses méthodes, accepte de se remettre en question et combat autant les évidences que ses inclinations naturelles. Il est têtu, tenace et même, à l'occasion un peu joueur. Ici le lecteur sent qu'il aime bien Jill et qu'il la soupçonne fortement d'être la meurtrière de son beau-père. L'important est que tout cela débouche sur une réponse satisfaisante. Malheureusement ici, son allié traditionnel qu'est le temps lui fait faux bon et il n'aura pas trop de son talent, de sa capacité de déduction et surtout de son indéfectible chance pour conclure.
©Hervé GAUTIER – Mars 2013.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA MAISON MALEFIQUE - Arthur Upfield
- Le 16/03/2013
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°633– Mars 2013.
LA MAISON MALEFIQUE - Arthur Upfield - 10/18.
Traduit de l'anglais par Michèle Valencia.
Étrange affaire dont le titre rappelle un peu un "Agatha Christie" pour le non-moins étrange inspecteur Napoléon Bonaparte, Bony pour les amis, qui s'est volontairement chargé de cette enquête. De quoi s'agit-il donc ? On a retrouvé, flottant sur l'étendue d'eau qui entoure la magnifique maison des Answerth, le cadavre étranglé de la mère, 69 ans, seconde épouse de Jacob Answerth qui s'est lui-même suicidé d'une balle dans la tête, il y a quelques années alors que sa situation financière était prospère et qu'il n'avait aucune raison particulière pour cela. Ce n'est pas la première mort suspecte constatée dans le coin puisque un boucher du nom de Ed Carlow a subi le même sort quelques mois auparavant et il y aura même, durant l'enquête, une tentative avortée suivie d'un autre meurtre.
Dans la maison-île vivent les trois héritiers de cette famille : Mary, 44 ans, la terreur de la maison, aussi hommasse et violente que Janet, sa sœur de 41 ans est douce et artiste, et Morice, 27 ans, leur demi-frère, attardé mental mais athlétique et demeuré en enfance. Avec eux vivent deux employés, le cuisinier et ancien chef des gardiens de troupeaux, Albert Blaze et Mrs Leeper, également cuisinière et dédiée à la bonne tenue de cette grande maison. Elle a cependant a été infirmière en chef dans un hôpital psychiatrique et rêve d'ouvrir son propre établissement.
Il reste donc à notre fin limier, venu tout exprès de Brisbane (Australie), à enquêter et découvrir l'origine de la fortune, semble-t-il douteuse de Ed Carlow qui aurait peut-être un rapport avec le meurtre de Mrs Answerth d'autant que cette famille s'est enrichie pendant des générations en massacrant les aborigènes, spoliant les gens et détruisant la nature. Il y sera aidé par ses origines puisqu'il est un métis australien, élevé dans une tribu du bush qu'il connaît bien et qu'il partage avec ces peuplades l'amour de la nature. Il témoigne d'une bonne dose de pragmatisme, use de psychologie, de patience, de méthode, met en œuvre des idées originales qui, à ses yeux, justifient un meurtre et recherche inlassablement dans le passé, dans les secrets de famille, ce qui peut l'expliquer. Il a décidément beaucoup de flair et cela ne s'applique pas uniquement à sa capacité de déduction et à son sens des réalités.
Il se moque de la hiérarchie, de la bureaucratie et de la "politique du résultat", assemble patiemment tous les morceaux du puzzle, remettant sans cesse en question les évidences et les apparences. Il obtient souvent des renseignements là où d'autres échouent. Il en conçoit même une certaine suffisance, ce qui ne le rend pas antipathique pour autant.
Reste cette "Maison Maléfique" où règne une atmosphère étrange. Elle tire son surnom du malheur qui s'accroche à elle et à ses habitants ou peut-être à cause de "l'os pointé" par les aborigènes sur ceux qui les ont exterminés, une sorte de malédiction dont l'eau qui entoure ce manoir n'est que la marque visible...
J'ai trouvé ce roman passionnant du début à la fin, le suspense y étant lentement distillé au rythme des investigations de cet inspecteur décidément attachant.
J'avoue que je ne connaissais pas Arthur Upfield [1888-1964], reconnu comme le père du polar ethnologique et qui est un auteur prolifique puisqu'il a publié 33 romans. J'ai apprécié l'ambiance de ce roman, la manière tout en nuances de procéder de Bony autant que le dépaysement né des évocations poétiques de ces paysages. Cet ouvrage est pour moi l’invitation à explorer davantage l'univers de cet auteur.
©Hervé GAUTIER – Mars 2013.http://hervegautier.e-monsite.com
-
La dactylographe de Mr James – Michel Heyns
- Le 20/01/2013
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°619– Janvier 2013.
La dactylographe de Mr James – Michel Heyns- Éditions Philippe Rey.
Traduit de l'anglais (Afrique du sud) par Françoise Adelstain
Le grand écrivain américain Henry James (1843-1916) engagea en 1907 Theodora Bosanquet (1880-1961) en qualité de secrétaire. Elle le restera jusqu'à la mort de l'écrivain. Son travail consistait à taper à la machine sous la dictée de James. Elle ne se contenta pas de ce travail assez ingrat et écrivit elle-même « Henry James à l'ouvrage »(1924) où elle porte témoignage à la fois de l'homme et de l'écrivain. D'autre part elle publia également son journal ce qui fit d'elle un auteur reconnu.
L'auteur, Michel Heyns, s'empare de cette relation professionnelle authentique pour faire de Theodora, rebaptisée Frieda Worth, alors âgée de 23 ans, un personnage de roman. Tel est le prétexte de ce récit bien documenté, fort bien écrit, plein d'humour délicat, de descriptions agréables, d'analyses psychologiques. Il est en tout cas fort bien traduit (notamment avec un grand souci du mot juste) qui mêle la fiction à la réalité, créant lui-même pour les besoins de son récit des faits qui n'ont pas existé où qu'il déplace dans le temps et dans l'espace, s'inspirant de théories qui nourrissent son écriture, comme il s'en explique dans une note à la fin de l'ouvrage. Le texte distille une musique qui plonge le lecteur dans une ambiance surannée et un dépaysement agréable.
Sous la forme d'un récit chronologique qui va de novembre 1907 à juillet 1909, le narrateur décrit une époque où la femme est un citoyen de seconde zone dans un monde d'hommes mais où se développent cependant des mouvements d'émancipation. Frieda, jeune femme cultivée, discrète et vive d'esprit, promise à un avenir de mère de famille traditionnelle, cherche cependant à s'émanciper par le travail. Elle est toute disposée à se mettre au service de M. James avec compétence et réserve, même si elle considère que, pour gagner sa vie, elle mérite mieux que cet emploi subalterne. Elle s'installe donc à Ry, petite ville guindée du Sussex et s’acquitte de sa tâche. Il s'agit de préparer une édition complète, corrigée et commentée de l’œuvre de James. Dans cette maison de « Lamb house » vivent, autour de M. James des domestiques discrets, des invités parfois exubérants et extravagants et même le chien Max qui complète agréablement le tableau. Frieda y rencontre a romancière américaine Edith Warthon (1862-1937), Morton Fullerton, journaliste américain, correspondant du Times à Paris, amant de cette dernière et ami de M. James. Avec lui elle noue une relation cordiale et respectueuse au début, la promesse d'une future vie commune et même une relation amoureuse même si cette dernière, par sa rapidité, est quelque peu en contradiction avec le puritanisme de l'époque. En réalité c'est plutôt un marché autour de lettres jugées compromettantes pour lui qu'elle est chargée de récupérer, même si pour cela, et contrairement à l'éducation qu'elle a reçue de sa mère, elle doit trahir le naïf M. James. Elle le fera par amour mais le déroulement des événements lui révélera le cynisme de M. Fullerton et finalement orientera sa vie future.
De son propre aveu, l'auteur précise qu'il prend des libertés avec la personnalité de Miss Worth, encore qu'on peut aisément imaginer qu'elle ait pu obéir à l'invitation de M. James de profiter de la vie[« Profitez de la vie autant que vous le pouvez, c'est une erreur de ne pas le faire ». Ce qui est sûr en revanche c'est que Theodora Bosanquet a eu après la mort de M. James des communications avec lui par le biais du spiritisme, ce qui, en quelques sorte prolongea la fonction de dactylographe de cette dernière. L'auteur la rend également réceptive à la télépathie pratiquée, par l’intermédiaire de sa Remington, avec le même M. Fullerton ! Cela peut paraître un peu fantaisiste mais Heynz a choisi de rendre compte, par ce biais de l'intérêt que portait Thoedora Bosanquet aux phénomènes paranormaux. En réalité, Frieda prend de plus en plus d'importance au sein même de cette famille puisque, au départ, on considérait qu'une simple dactylographe ne fournissait qu'une prestation, n'était pas obligée de comprendre ce qu'elle tapait et n'était que le simple prolongement de sa machine. Au fur et à mesure du récit, et notamment à l'invitation de la nièce de M. James, elle s'impose également, loin des esprits frappeurs, des guéridons et autres séances d'invocation, comme une sorte de médium entre cette dernière et une tante décédée. Sa machine va donc devenir une sorte d'instrument de « l'écriture automatique » et Frieda un truchement indispensable dans ce phénomène. Aux yeux de M. James, elle prend aussi une autre dimension qui décide de sa vie future. En revanche, elle ne va pas tardé à s'apercevoir de la duplicité, de l'hypocrisie et de la trahison qui animent les différents membres de ce microcosme comme toutes les sociétés humaines qui en sont friandes. M. James, lui, semble à part, comme dans une bulle, uniquement préoccupé par son écriture.
Ainsi l'auteur en profite-t-il pour parler de la mort, de la vie, de la notoriété, de la renonciation, en les relativisant (« La vie nous trahit, seul l'art ne déçoit pas »). Dans ce lieu un peu à part, le lecteur voit peu à peu apparaître des thèmes consacrés aux suffragettes et au spiritisme et aux techniques nouvelles, traduisant des préoccupations en vogue à l'époque victorienne mais aussi des comparaisons entre l'ancien et le nouveau monde, William James, le frère d'Henry résidant avec sa famille aux États-Unis.
Miss Worth est donc le témoin privilégié d'un monde auquel elle n'appartenait pas au début mais qu'elle parvient cependant à maîtriser. La scène finale, dans le brasier qui se consume est révélatrice et Frieda n'est plus un simple secrétaire, elle devient l'égal de James face à la vie. C'est un peu comme s'il lui passait un relais de l'écriture. Quant à Heyns, sans tomber dans le plagiat, il rend fort bien l'ambiance des œuvres de James. L'hommage qu'ainsi il lui rend est de qualité.
J'avoue volontiers que, malgré quelques remarques sur la vraisemblance de certains épisodes, ce roman m'a procuré un bon moment de lecture.
©Hervé GAUTIER – Janvier 2013.http://hervegautier.e-monsite.com
-
Quelques mots sur James Joyce (1882-1941)
- Le 02/12/2012
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°602– Décembre 2012.
Quelques mots sur James Joyce (1882-1941).
James Joyce est l'un des écrivains les plus emblématiques du XX° siècle,à la fois romancier, nouvelliste et poète et j'avoue bien volontiers que dans ma bibliothèque idéale, il tient une place de choix.
Il est l'aîné d'une famille catholique de douze enfants dont deux mourront en bas âge. Sa mère, née Mary Jane Murray est une jeune femme douce qui ne vit que pour son foyer et ses enfants. Son père, collecteur d'impôts, s'adonne régulièrement à la boisson ce qui fera rapidement péricliter les biens familiaux.
Dès 1888, il entre chez les jésuites qui reconnaissent en lui un élève très doué. Il en sort pourtant quatre ans plus tard, son père ne pouvant plus payer ses études. Il l'inscrit chez les frères de la doctrine chrétienne mais le Belveder Collège de Dublin tenu par les jésuites accueille gratuitement James et son frère Stanislaus. Il semblerait que ce « cadeau » fait par le directeur de l'école ait eu pour but de faire entrer James dans l'ordre des jésuites mais il refuse. Cependant il commet une composition favorable à Byron qui est jugée hérétique. Il entre donc en conflit avec son école et aussi avec le catholicisme en devenant agnostique. En 1991, Charles Parnell, homme politique irlandais, figure du nationalisme, qui convaincu d'adultère, meurt abandonné de tous et James en fait le symbole du héros trahi par la multitude. Ce thème reviendra souvent dans son œuvre. Cette tragédie fera de lui un écrivain antinationaliste, anticlérical et antiféministe.
En 1898, il entre à l'University College de Dublin pour y étudier les lettres et les langues et à partir de cette date s'implique dans la lecture, l'écriture et la participation active dans les activités littéraires de cette université. En 1903 le voilà à Paris pour étudier la médecine mais où il dilapide le peu d'argent qu'il possède en beuveries. Après la mort de sa mère, il gagne petitement sa vie en écrivant, en enseignant et même en chantant. Il se fait même pion, comme Stephen dans Ulysse. A l'âge de 22 ans, il commence la rédaction d'un long roman, tombe amoureux de Nora Barnacle alors femme de chambre et part avec elle pour Trieste où l'école Berlitz lui offre un poste d'enseignant mais à la suite d'un malentendu se retrouve à Pula dans l'actuelle Croatie. Il n'y reste qu'une année et s'installe à Trieste où il enseigne l'anglais pendant 10 ans. Giorgo , son fils né en 1905 et c'est à cette période qu'il commence à souffrir de problèmes oculaires graves qui finiront par le rendre presque aveugle.
En 1906, il part pour Rome où il a obtenu un poste d'employé de banque mais ni l'emploi ni la ville ne lui plaisent et il retourne à Trieste en 1907, date de naissance de sa fille Lucia qui deviendra schizophrène. Il publie son premier livre de poèmes, Chamber Music. En 1909 le voici à Dublin où il publie Gens de Dublin, un recueil de nouvelles qui est une photographie ironique et parfois cruelle des habitants de sa ville natale. Suivent des allers et retours entre Trieste et Dublin où il est un temps représentant pour les propriétaires de cinémas, il repart pour l'Italie où il donne des conférences et rédige des articles pour les journaux. En 1915, il doit quitter Trieste où il avait envisagé de se faire importateur de tweed et s'installe à Zurich où il enseigne. Sa notoriété littéraire grandit ce qui lui permet de recevoir des dons en argent et de rencontrer un mécène en la personne de l'éditrice féministe anglaise Harriet Shaw Weaver qui le soutiendra jusqu'à sa mort ce qui lui permettra de soigner sa cécité grandissante et la schizophrénie de sa fille. En 1920, il s’installe à Paris où il restera pendant 20 ans, y rencontrant des écrivains français de renom comme Marcel Proust ou Valéry Larbaud. C'est ici qu'un an plus tard il termine Ulysse qui est considéré comme son chef-d’œuvre, Ce roman qui établit sa notoriété. En 1939, il quitte Paris à cause de l'occupation allemande. Il meurt à Zurich en janvier 1941.
Son œuvre est le reflet de sa vie personnelle, ainsi le personnage de sa propre mère se retrouve sous les traits de Mme Dédalus dans « Ulysse ». Quand la famille s'installe à Bray près de Dublin et qu'il tombe amoureux de sa voisine, la jeune Eillen, ce détail se retrouve dans « Portrait de l'artiste en jeune homme » (Dédalus ). Léopold Bloom et Buck Mulligam, tous deux personnages d'Ulysse sont directement inspirés d'hommes que Joyce a croisés dans sa vie. Son œuvre s'inscrit dans la ville de Dublin qu'il voit davantage comme une citée idéale, mystique et allégorique bien qu'il ait passé la plus grande partie de son existence nomade à l'étranger. Cette ville où pourtant il est né et qu'il et en scène dans « Ulysse », il la renie et la fuit pour se réfugier transitoirement ailleurs sans pouvoir s'y poser durablement, à part peut-être à Paris, ville ô combien symbolique d'une vie de « la belle époque ». Sa vie est un véritable labyrinthe et ce n'est pas un hasard s'il choisit le nom de « Dédalus », Dédale, architecte de la prison du Minotaure.
Sa propre existence est un voyage, une véritable prison dont il ne pourra se libérer que par l’ivresse, par l'écriture et dont la seule issue sera la mort (Il évoque ce thème dans la dernière nouvelle des « gens de Dubin » et dans « Finnegans Wake »), à la fois redoutée et désirée. Dans « Finnegans Wake », le dernier ouvrage de Joyce (il n'a plus que quelques mois à vivre, sa santé est de plus en plus fragile et il est presque aveugle et sa fille est devenue folle), la mort est présente comme dans une sorte de rêve oùToute son existence sera un exil et il sera lui-même un déraciné, un éternel réfugié toujours en partance. Quand la guerre éclate dans un pays, il le quitte pour la neutralité de la Suisse et lorsque l'Irlande combat l'Angleterre, il s'exile. C'est pourtant lui que la littérature reconnaît comme le plus emblématique des écrivains irlandais. Il aura en revanche l'attribut de cette errance : l'indépendance et la liberté, celle de refaire le monde et d'abolir le temps, celle aussi de triturer la phrase, les mots et l'histoire même en y instillant du rêve, en imprimant au texte sa marque, originale et parfois inattendue au point de détruire le langage en le réinventant. L'effet produit est à la fois poétique et inquiétant.
Il a été cet écrivain aux yeux qui, avec le temps se sont des plus en plus éteints, comme si le regard qu'il jetait sur l'expérieur lui échappait, un idéaliste détaché de ce monde où pourtant il survit difficilement, un esprit brillant, un intellectuel polyglotte, un des écrivains les plus commentés. Ses romans sont des labyrinthes pleins d'allusions littéraires et mythologiques ce qui rend la lecture parfois difficile et qu'il faut parfois faire au deuxième degré. Chez Joyce, il ne faut pas craindre les symboles, les allégories et la lecture entre les lignes.
©Hervé GAUTIER – Décembre 2012.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA VIE EN SOURDINE-David Lodge – Éditions Rivages.
- Le 21/06/2012
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°583– Juin 2012.
LA VIE EN SOURDINE – David Lodge – Éditions Rivages.
Traduit de l'anglais par Maurice et Yvonne Couturier.
Desmond Bates est un ancien professeur de linguistique à la retraite dans une petite ville du nord de l'Angleterre. Il est veuf, sexagénaire et remarié avec Winfred dont il est très amoureux. Elle est de quelques années sa cadette mais sa vie mondaine et professionnelle est assez débordante. S'il a choisi une retraite anticipée c'est qu'il a un grave problème d'audition. Il n'est pas complètement sourd, mais plutôt malentendant et se sent maintenant inutile[« Que vais-je faire de moi aujourd’hui ? », question à laquelle il se trouvait confronté chaque matin en se réveillant depuis qu'il était à la retraite »], surtout devant la réussite professionnelle de sa femme. C'est sans doute pour cela qu'il accepte une tournée de conférences en Pologne alors que rien ne le justifie. Comme tous ceux qui souffrent d'un tel désagrément, il est isolé du monde extérieur, malgré les appareils auditifs avec lesquels il semble avoir pas mal de difficultés. Il se réfugie dans la lecture quotidienne du « Guardian » et les visites qu'il fait à son père, seul, vieux et sourd lui aussi. A l'occasion, il ne dédaigne pas un petit verre !
Les activités culturelles de son épouse l’entraînent souvent dans des manifestations où il s'ennuie d'autant plus qu'il entend mal. Dans l'une d'elles, il fait la rencontre d'une jeune étudiante américaine, Alex Loom, qui lui tient un long discours auquel il n'entend goutte, et pour cause! Elle le relance pourtant le lendemain en lui demandant de l'aider dans sa soutenance de thèse... avec pour thème une approche particulière sur le suicide, le lecteur comprendra pourquoi par la suite. Le sujet intéresse Bates, mais ce qui le gêne c'est que ce travail se fera dans le dos d'un de ses collègues encore en poste et surtout qu'une relation équivoque commence à se nouer entre la jeune fille un peu fantasque, affabulatrice et aguicheuse et le vieux professeur. Finalement, elle repartira en Amérique sans avoir mené ses recherches universitaires à leur terme. Son départ illustrera une nouvelle fois son côté cynique et manipulateur.
Le récit prend la forme d'un journal intime tenu par Desmond lui-même, donc à la première personne mais, bizarrement, il change et écrit « Je me sens pris par une brusque envie d'écrire à la troisième personne » pourtant il emploie le « je » dans la presque totalité du récit. Ce texte est la narration d'une tranche de vie d'un vieil homme qui s'ennuie dans sa récente retraite et qui collationne ce qui lui arrive, ses réflexions sur la mort, sur l'amour qu'il porte à sa jeune épouse et ses états d'âme sur une passade possible avec Alex.
Au départ je trouvais que la relation du quotidien de Desmond procurait une lecture fastidieuse, notamment ses tribulations avec son appareil auditif, ses fantasmes personnels et sexuels quelque peu échevelés, ses démêlés avec Alex , ses cours de lecture labiale, les difficultés avec son père aussi sourd que lui, veuf et atteint par la maladie d’Alzheimer. Il excelle pourtant dans la description des moindres gestes, des plus petits détails et s'attache son lecteur qui, grâce à son humour subtil, a envie d'en savoir davantage, même si parfois ses digressions prennent une dimension dangereusement universitaire. Il réussit à rire de lui-même, trouvant dans son infirmité matière à plaisanter(«la surdité est comique, la cécité est tragique », « Il y a au moins une chose que nous autres les sourdingues réussissons à faire dans une réception, c'est de déclencher le rire des gens avec nos bourdes, et ils n'ont pas se plaindre de moi en la circonstance »), et ce malgré le fait qu'il associe la surdité à la mort. Le titre anglais lui-même [Deaf Sentence] est un jeu sur le mot deaf (surdité) et death (mort). L'hospitalisation de son père consécutive à une attaque et son décès lui rappellent celui de sa propre mère, « organisé » par son entourage.
En fait, Desmond est à a recherche du bonheur qu'il pensait avoir trouvé en épousant Winfred. Mais cette femme plus jeune que lui, se dérobe de plus en plus à ses sollicitudes sexuelles, lui échappe et il note qu'elle se conduit par rapport à lui « comme une étrangère » plus soucieuse de de son travail que de son mari... et lui l'attend toute la journée à la maison. Sa visite solitaire au camp d'Auschwitz en est l'allégorie, de même que le plaisir qu'il ressent à rester dans le silence qui le protège des agressions du monde extérieur. Il ne profite même pas de la présence d'Alex qui pourrait représenter pour lui une foucade. C'est tout le problème des hommes qui ont épousé des femme plus jeunes et qui désirent le rester et Desmond se prépare à reproduire l'exemple de son père dont il s'occupe pourtant avec patience. On imagine très bien ce qu'il adviendra de lui dans quelques années et la déréliction qui en résultera.
C'est donc un roman doux-amer que nous livre ici cet auteur à la fois érudit et drôle bien qu'il traite de la maladie, de la vieillesse, de la dégradation physique, de la fin de vie et de la différence grandissante qui existe entre un homme vieillissant et une épouse plus jeune que lui et je ne parle pas de de la valse- hésitation de Desmond face à Alex, ses interrogations, ses craintes pour l'avenir, sa phobie de la mort ...
J'avais lu avec plaisir « Jeux de maux » du même auteur (La Feuille Volante n° 330). Encore une fois, je n'ai pas été déçu, David Lodge est vraiment passionnant.
©Hervé GAUTIER – Juin 2012.http://hervegautier.e-monsite.com
-
Sur la route - Jack Kerouac
- Le 25/05/2012
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°579– Mai 2012.
SUR LA ROUTE – Jack KEROUAC (1957) - Gallimard
Traduit de l'américain par Jacques Houbard.
Il est des artistes comme des produits de grande consommation, leur nom suffit à évoquer leur pays. Jack Kérouac (1922-1969) est de ces écrivains emblématiques des États-Unis qui ont caractérisé un style, un mode de vie, qui ont inspiré toute une génération à la quelle il sont imprimé leur marque, parfois malgré eux. Ce roman fut le texte fondateur de la « Beat génération » et dans ce domaine le nom de Kérouac est associé à celui de Allen Ginsberg.
C'est un roman écrit à la première personne ce qui laisse à penser qu'il est autobiographique. Il met en effet en scène un écrivain, Sal Paradise, en quête de nouvelles expériences :« Quelque part sur le chemin je savais qu'il y aurait des filles, des visions, tout quoi ; quelque part sur le chemin on me tendrait la perle rare » Ainsi donc, en juillet 1947, il part de New York à destination de la côté Ouest par Chicago, c'est à dire par la route du nord. Il accomplit son périple en car puis en auto-stop, fait des rencontres extraordinaires, des hommes mais surtout des femmes, fait des petits boulots dans les champs de coton ou dans les vignes pour survivre, atteint San Francisco puis revient à New-York par le sud. Il effectuera ainsi plusieurs voyages en 1949 et 1950, notamment dans le sud et au Mexique mais toujours devant lui il y aura la route et ses promesses d'aventures,(« Mais qu'importait, la route, c'est la vie ») des occasions de visiter des « paradis artificiels ».
Il raconte son récit comme une épopée, sans recherche de style, d'une manière spontanée et rapide (« La prose spontanée »), inspirée semble-t-il du rythme de jazz Be Bop qu'il aimait. On pourra objecter que certains passages sont longs et monotones, mais ils traduisent ainsi ce que peut-être un tel voyage en voiture. Le personnage central de ce roman est Dean Moriarty, à la fois héros romantique, « pauvre gosse », « saint truqeur » et « ange de feu », animé par une rage de vivre, l'amour de la vitesse et du jazz. C'est un texte brut, écrit, selon une légende remise en cause, en trois semaines sur un rouleau de téléscripteur de 36 mètres de long mais refusé par les éditeurs à cause de son côté non conventionnel. Ce tapuscrit fut cependant vendu aux enchères en 2001 pour un prix exceptionnel et, une décennie après sa rédaction, ce roman a été reconnu comme un chef-d’œuvre, adapté au cinéma, notamment par Walter Salles en 2012 (film actuellement en compétition au festival de Cannes 2012) et à la radio (Radio France en 2005). Il influencera aussi le genre cinématographique connu sous le nom de « road movie ».
Kerouac, bien qu'il soit issu d'une famille canadienne-française aux origines bretonnes, incarne l'Américain confronté aux changements de son époque et amoureux des grands espaces qui sont l'apanage des États-Unis, mais aussi, et peut-être paradoxalement, c'était un homme qui avait du mal à se positionner dans cette société, en rejetait les valeurs traditionnelles, les certitudes mais aussi le mensonge social qui l'étouffaient, ces écrits donnant naissance à la « Beat génération ». Est « Beat » celui qui rejette le passé et même le futur, celui qui voit sa vie au quotidien comme un mélange d'alcool, de sexe, de drogue, vitesse en voiture, de voyages, et, dans le cas de Kérouac, également de spiritualité, l'exact contraire de la société américaine de son époque ! On ne peut pas ne pas penser à James Dean en lisant ce livre où il y a la marque de Louis -Ferdinand Céline et de Rimbaud. Il fut un précurseur et ses romans qui inspirèrent d'autres auteurs américains furent à l'origine du bouleversement social de la jeunesse et du pacifisme des années 60, déclarant qu'il fallait préférer l'amour à la guerre. Il fut pourtant, à cause notamment de sa vie marginale mais aussi de son style littéraire personnel, en proie à de violentes critiques dans les médias et de la part des auteurs reconnus.
C'est le roman le plus connu de Kerouac, mais ce n'est pas le seul. Il ne cessera d'ailleurs d'écrire, de la prose comme de la poésie toute sa vie malgré les vicissitudes qu'elle lui réservera et trouvera dans la création littéraire notamment un moyen d'exorciser son mal de vivre.
Il fut un personnage controversé, refusant la célébrité, inspirant des auteurs notamment dans le domaine de la chanson et du cinéma, trouvant sa consolation dans l'alcool qui aura raison de sa vie, aux opinions parfois changeantes qui l'éloignèrent quelque peu de son image primitive. Il fut un auteur qui ne laissa pas indifférent de son vivant et qui étend encore son ombre sur notre société contemporaine.
-
cité de verre - Paul AUSTER
- Le 15/02/2012
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°506 – Février 2011.
CITE DE VERRE – Paul AUSTER – Actes Sud.
Traduit de l'américain par Pierre Furlan.
C'est le 1° roman de la trilogie new-yorkaise de Paul Auster (la Feuille Volante n° 497 et 500). Bizarrement, j'ai l'impression qu'il faudrait en commencer la lecture par la fin. En effet, c'est un étrange récit raconté par un narrateur qui écrit : « Je suis rentré en février de mon voyage en Afrique... J'ai téléphoné à mon ami Paul Auster...(il) m'a expliqué le peu de choses qu'il savait de Quinn puis il a continué à me décrire l'étrange affaire dans laquelle il il avait été fortuitement impliqué ».
Un lecteur attend d'un roman qu'il lui raconte une histoire, mais comme souvent chez Auster, cela ne se passe pas exactement comme cela. Ici l'histoire existe, certes, mais elle est non seulement compliquée, fait intervenir des personnages inattendus, parfois furtifs, parfois quasi-réels que l'auteur abandonne, explore des thèmes de réflexion intéressants, brouille parfois le jeu... Ici le narrateur prend la parole en premier, évoque Daniel Quinn, écrivain new-yorkais de romans policiers. Il a 35 ans, a perdu son épouse et son fils et vit seul, modestement et sans grandes ambitions. Il signe ses romans policiers du nom de William Wilson [C'est le nom d'une nouvelle d'Edgar Poe écrite sur le thème du double]. Ce n'est pas là une simple fantaisie d'auteur puisque puisqu'il nous est dit que « Même s'il n'était qu'une invention, s'il était né de Quinn, il menait désormais une vie indépendante ». Quinn met également en scène dans ses romans un personnage fictif du nom de Max Work, détective privé, mais qui, avec le temps prend de la consistance au point que Quinn voit le monde à travers lui [il est intéressant de s'attarder sur le jeu de mots qui nous est offert entre « I » et « eye »]. Il peut donc s'agir d'un prétexte qui joue sur le dédoublement d'un même personnage.
En pleine nuit, Quinn reçoit un coup de téléphone et l'interlocuteur demande à parler au détective privé du nom de... Paul Auster ! Il ne peut donc s'agir que d'une erreur. Pourtant la voix se fait convaincante, parle de danger de mort et Quinn accepte de rencontrer une femme énigmatique, Virginia Stillman, mariée à Peter, jeune homme mystérieux qui prétend que son père qui l'a torturé pendant toute son enfance veut l'assassiner. Peter se révèle étrange, tient des propos désordonnés sur la vie, sur son épouse, sur Dieu et émet des doutes sur son propre nom. Quinn accepte un chèque à l'ordre d'Auster pour protéger Peter, découvre le père Stillman (qui s'avère, dans un premier temps être deux personnages), mène son enquête en notant ses remarques sur un cahier rouge. Il suit donc Stillman à travers New-York, reconstitue ses itinéraires aléatoires, en donne des interprétations qui se révèlent être erronées, étudie ses habitudes... Cet homme souhaite inventer un nouveau langage [« Un langage qui dira enfin ce que nous avons à dire. Car les mots que nous employons ne correspondent plus au monde »].
Quinn fait des rapports téléphoniques réguliers à Virginia Stillman et, à l'instar de son héros Max Work, se met à désirer ardemment cette femme. Quinn finit, sous son vrai nom par rencontrer le père Stillman. Chacune de leurs rencontres est quelque peu surréaliste, soit il est question de la quête d'objets hétéroclites, soit Quinn se fait passer pour le fils de Stillman que celui-ci ne reconnaît pas, soit Quin qui se présente comme étant Henry Dark. Il se trouve que ce nom, choisi par hasard par Quinn correspond au personnage d'un roman que Stillman a écrit autrefois. [ Et les initiales H.D. lui évoquent Humpty Dumpty, personnage en forme d'œuf du roman de Lewis Caroll « De l'autre côté du miroir » !]
Puis Stillman disparaît (nous saurons plus tard qu'il s'est suicidé en se jetant du pont de Brooklyn), Quin rencontre le vrai Paul Auster qui lui avoue être écrivain et non détective,et lui donne le chèque libellé à son nom. Ensemble ils parlent littérature et évoquent Don Quichotte et Cervantes, dissertant à la fois de la folie du chevalier, du bon sens de Sancho Penza et surtout de la façon dont a été écrit le fameux roman puisque Cervantes prétend en avoir trouvé le manuscrit dû à l'auteur arabe Cid Hamet Ben Engeli au marché de Tolède. C'est une manière comme une autre de parler de ce roman dans le roman, de cette mise en abyme tant prisée par Auster, de cet ouvrage où le lecteur se perd et où les noms se mélangent sans qu'on ne sache plus très bien qui est qui.
Puis Auster abandonne sans crier gare l'intrigue initiale autour de Stillman. En effet Quinn constate que le téléphone ne répond plus, que le chèque qu'il avait reçu au non d'Auster est sans provisions... Il décide donc de changer de vie, devient marginal, reprend la rédaction du fameux « cahier rouge » qu'il avait un peu abandonné, revient à son ancien appartement maintenant habité par une femme, puis investit celui de Peter Stillman dont il n'a aucune nouvelle et qui a définitivement disparu. Dans l'état où il se trouve, il constate que William Wilson et Max Work sont morts et que lui-même disparaît petit à petit du décor que les ténèbres envahissent. Le cahier rouge n'a d'ailleurs plus de pages. C'est un peu comme si cette histoire s'était révélée transitoire « Cette affaire avait servi de pont vers un autre lieu de sa vie, et maintenant qu'il l'avait franchi, Quinn en avait perdu le sens. Il ne s'intéressait d'ailleurs plus à lui-même. Il parlait des étoiles, de la terre, de ses espérances pour l'humanité. »
Quant au cahier rouge, la dernière phrase qui y est inscrite est « Que sa passera-t-il quand il n'y aura plus de pages dans le cahier rouge ? » Un familier de l'œuvre d'Auster notera opportunément que dans un autre roman (« La nuit de l'oracle »), l'auteur accorde aussi une grande importance à un cahier bleu !) ]. De plus, le narrateur, qui prétend s'être brouillé avec Auster à cette occasion, termine par ces mots « Pour ce qui est de Quinn, il m'est impossible de dire où il se trouve actuellement. ». Une manière comme une autre de laisser son lecteur libre d'imaginer une fin qui lui convienne.
Dans ce roman, il faut noter une nouvelle fois l'art de la narration labyrinthique qui est allié à une imagination débordante? Cela étourdit le lecteur et c'est sans doute l'effet recherché. C'est en effet une sorte de vertige qui ne peut pas ne pas le prendre à la lecture d'un tel roman. Je ne suis pas sûr cependant d'avoir bien tout compris, mais j'ai poursuivi ma lecture jusqu'à la fin, et avec plaisir !
Est-ce une remise en cause du langage et du sens des mots ? Est-ce que Auster s'interroge sur les concepts d'identité ? Veut-il, à l'occasion d'un roman à la fois s'attacher son lecteur et ne pas lui imposer complètement un texte en le laissant libre d'imaginer ce qu'il veut ? Explore-t-il ici une forme de folie qui peut s'emparer des hommes des grandes villes tentaculaires (New-York ?) ou des écrivains qui créent autour d'eux un univers de fiction et des personnages qui peuvent finir par leur échapper ? A chacun de répondre !
©Hervé GAUTIER – Février 2011.http://hervegautier.e-monsite.com
-
La nuit de l'oracle - Paul AUSTER
- Le 14/02/2012
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°504 – Février 2011.
LA NUIT DE L'ORACLE – Paul Auster – Actes Sud.
Traduit de l'américain par Christine Le Boeuf.
Le jeune écrivain new-yorkais d'origine polonaise, Sidney Orr revient chez lui après une longue hospitalisation. Il est marié à une femme, Grace, qui l'aime et il est heureux avec elle. Cette période a été cependant difficile pour lui puisqu'il semble avoir perdu tous ses repères « Quand arriva le jour de ma sortie de l'hôpital, c'est à peine si je savais encore marcher, à peine si je me rappelais qui j'étais censé être. ». Il est à nouveau désireux d'écrire et commence à rédiger une histoire dont le personnage principal, Nick Bowen, est à la fois romancier et résident à New-York [comme Auster lui-même]. Sydney Orr commence donc l'histoire de Nick tout en la rapprochant de la sienne propre, esquissant les ressorts complexes qui existent dans la création romanesque. Dans l'histoire du narrateur, Nick qui est aussi éditeur, reçoit le manuscrit d'un roman inédit attribué à Sylvia Maxwell par l'intermédiaire de sa petit-fille, Rosa Leigthman et qui s'intitule « la nuit de l'oracle ». Ce roman met en scène Lemiel Flag, un héros aveugle qui a de pouvoir de deviner l'avenir. Nick manque d'être tué par la chute d'un objet, quitte sa femme sans raison et part au hasard pour Kansas City.
Résumer un roman a toujours quelque chose de frustrant. Dans le cas de Auster, l'intrigue n'est jamais simple et il balade son lecteur dans les arcanes d'un récit plein de rebondissements. Il se trouve que l'auteur introduit également dans son texte un autre personnage, John Trause, écrivain lui-même qui conseille à Orr de s'approprier le personnage [Flitcraft] d'un autre roman [« le faucon maltais »] dont il n'est pas l'auteur et de le mettre en situation dans sa création personnelle. De fait, les deux histoires se rejoignent sous la plume d'Orr. Cette mise en abyme est peut-être un peu difficile à suivre mais elle met en évidence le hasard et le poids qu'il a sur la vie des hommes. Cela a toujours été pour moi un thème de réflexion intéressant et pas seulement du point de vue littéraire. Pour autant, le narrateur révélera à la fin de ce roman les liens qui l'unissent à Trause. Orr reste le maître de ce récit jusqu'à la fin, nous décrivant sa vie parfois mouvementée avec Grace.
On peut aussi s'interroger sur le processus créatif au terme duquel un personnage de roman, nécessairement fictif, prend vie sous la plume d'un créateur, ce qu'il doit à la culture de ce dernier à ses fantasmes. D'où vient ce Ed Victory, chauffeur de taxi que rencontre Nick, mais aussi collectionneur d'annuaires téléphoniques de Varsovie dans les années 30 ? Dans ces bottins Nick retrouvera trace du patronymes de la famille de Orr. Ed est un personnage secondaire mais qui va prendre de l'importance dans la vie de Nick au point qu'il pourrait parfaitement devenir le héros... d'un autre roman !
A l'occasion de cette histoire labyrinthique et pleine de mises en abyme ainsi que Auster les affectionne, l'auteur engage une réflexion sur l'écriture et sur la création artistique en général et les rapports qu'un écrivain peut entretenir avec la réalité. A quel point cette dernière peut-elle influencer l'œuvre qui est du domaine de l'irréel, de la fiction ? [« Perdu dans les affres du chagrin il se persuada que les mots qu'il avait écrits au sujet d'une noyade imaginaire avaient provoqué une noyade réelle, que sa fiction tragique avait donné lieu à une tragédie réelle dans le monde réel. »]. Après tout, ce n'est pas un hasard si on parle aujourd'hui de l'auto-fiction comme un moteur de la création littéraire. Il note jusqu'à l'obsession l'existence de ce petit carnet bleu de fabrication portugaise que vend son ami Chang et qui recueille ses mots. Mieux, il les suscite ! Pourtant il finit par le détruire. Grâce à cela, il invente l'histoire de John Trause qui est lui-même écrivain et de son éditeur, Nick Bowers à qui il prête des pérégrinations pour le moins fantastiques, mélange judicieusement le roman de Sylvia Maxwell et que sa petite-fille Rosa Leigthmann souhaite voir publier par Bowers, met en situation des différents personnages de ces fictions, leur prête des aventures extraordinaires qui ont pour seules limites l'imagination de l'auteur qui est aussi le narrateur...
Je suis un peu surpris par le nombre et surtout par la longueur des notes de bas de page. Elles participent largement aux digressions chères à Auster et entretiennent cette impression d'égarement que ne manque pas de ressentir le lecteur. On se perd d'autant plus facilement dans l'histoire principale que le narrateur y introduit des évocations secondaires. Dans celles-ci, il inclut toute une arborescence de personnages qu'il crée et qu'il abandonne, toute une série de situations qui complètent et éclairent l'intrigue mais qui pourraient tout aussi bien être le départ d'une nouvelle fiction. Cela rompt sans doute le processus narratif mais nourrit l'imaginaire du récit.
Cela met en évidence une caractéristique du style de Auster qui est le culte du détail dans la narration. On pourrait le rapprocher du « pointillisme » en peinture... D'autre part, le lecteur ne sera pas sans remarquer de Trause est l'anagramme de Auster, ce qui accentue les ressemblances entre eux. Ces deux écrivains ont traversé une période de sécheresse analogue [symbolisée sans doute par une période d'hospitalisation] et le narrateur, dans une sorte de dialogue improvisé et improbable entre lui et Trause, s'interroge sur la couleur bleue de ce carnet qu'ils ont en commun [« Le carnet était fermé et posé sur un petit dictionnaire et, sitôt penché pour l'examiner je constatais que c'était le double exact de celui qui se trouvait chez moi, sur ma table »] autant que sur leur rôle dans la société [« Ça ne veut rien dire Syd, sinon que tu as le cerveau un peu fêlé. Je suis tout aussi fêlé que toi. Nous écrivons des livres, non? Que peut-on attendre de gens comme nous ? »]. Il tente d'analyser le processus créatif que l'imagination mais aussi la réalité et le hasard alimentent, mais aussi ce simple assemblage de feuilles vierges et reliées sous la forme de ce fameux « carnet bleu » qui est une invitation forte à l'écriture. Le narrateur prend en compte que l'inspiration peut parfaitement manquer tout d'un coup au plus prolixe des écrivains !
Paul Auster s'interroge sur la démarche des écrivains en général par rapport à leurs personnages. Qu'ont en commun ces créations fictives et donc inventées et le vécu de celui qui les invente. Peuvent-il s'échapper du moule que l'auteur leur a assigné ? Sont-ils libres de leurs mouvements (et de leur destin ?) à l'intérieur d'une histoire inventée par un auteur. Je goûte à titre personnel cette sorte d'introspection et le questionnement d'un auteur sur lui-même autant que sur ces personnages me paraît être une démarche intéressante et révélatrice à la fois pour le lecteur et pour l'auteur lui-même. Comme on le voit chez Auster, l'histoire peut assez facilement passer au second plan au profit de ses interrogations personnelles.
J'ai bien conscience de m'être un peu perdu dans le dédale la lecture de ce roman comme sans doute le seront tous les lecteurs. Je n'ai peut-être pas tout compris tant la démarche créatrice d'Auster est labyrinthique, mais j'ai pris du plaisir à entrer dans cet univers narratif auquel la traduction doit probablement beaucoup. Il m'a tenu en haleine jusqu'à la fin et c'est sans doute ce qu'un lecteur peut demander à un roman.
©Hervé GAUTIER – Février 2011.http://hervegautier.e-monsite.com
-
Tombouctou - Paul AUSTER
- Le 14/02/2012
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°503 – Février 2011.
TOMBOUCTOU – Paul Auster – Actes Sud.
Traduit de l'américain par Christine Le Boeuf.
Le titre d'abord. Il évoque une ville mythique, à la fois mystérieuse et lointaine dont l'origine serait, selon la légende, rattachée à un puits et à une femme. Elle reste dans notre inconscient ou peut-être dans notre histoire une cité qui a été explorée par René Caillié en 1828.
Mais, avec Paul Auster, on est jamais au bout de ses surprises et la lecture d'un de ses romans est toujours un moment d'exception, plein de curiosités pour le lecteur attentif. C'est que ce récit commence par l'évocation de Willy, un personnage un peu bizarre, à la fois vagabond et rimailleur qui se prend pour l'assistant du Père Noël. Il erre dans la ville de Baltimore en compagnie de son chien, Mr Bones, un authentique bâtard. Pourtant cet animal n'est pas le commun des canins, il est plein de sensibilité et son maître ne le tient pas pour un inférieur mais au contraire pour un véritable ami. L'animal est même animé d'aspirations métaphysiques ! Willy va mourir, il le sait, mais avant de faire le grand saut, il tient à assurer à son compagnon un nouveau gîte en lui conseillant d'éviter la police, la fourrière... et les restaurants chinois ! Le mieux serait qu'il le confie à Bea Swanson, son ancienne professeur d'anglais. Il veut aussi assurer un avenir à ses écrits consignés sur soixante quatorze cahiers. Ce sont des poèmes mais aussi les premiers balbutiements d'une longue épopée « Jours vagabonds » où il évoque ce qu'a été sa vie personnelle. Las, il meurt misérablement avant d'avoir mené à bien ce dernier projet. Ainsi, happé par la mort, il doit bien se résoudre à faire une croix sur ses légitimes et littéraires ambitions !
Mr Bones se retrouve donc seul, orphelin, et recherche vainement l'ancien professeur de Willy. Il va donc errer et rechercher un maître. Après un long voyage « à pattes » qui peut, si on veut le voir ainsi, ressembler à une démarche labyrinthique (et que Paul Auster affectionne) analogue à celle de son maître, il trouve enfin une famille qui l'adopte, s'occupe de lui et l'aimera... Poursuivant ses préoccupations philosophico-religieuses, l'animal, qui rêve parfois à son maître et entreprend avec lui des dialogues d'outre-tombe, s'imagine que cet homme réside maintenant dans un lieu de félicité paradisiaque qu'il a du mal à situer sur la carte du monde et qu'il nomme Tombouctou ! Willy lui parle, lui donne des conseils sur la façon de survivre...
C'est que cette fable romanesque, pleine de sensibilité où les hommes portent des noms d'animaux et vice versa, donne la parole à ce brave chien qui va faire part de ses remarques sur sa vie devenue aussi vagabonde que celle de feu son maître. Perdu dans ce monde, il se révèle un peu naïf, parfois malchanceux mais se montre plus humain que bien des hommes. Il mènera à son terme sa quête personnelle pour, le pense-t-il, retrouver Willy dans cet ailleurs
Ce roman a la caractéristique, rare à mes yeux, de capter l'intérêt du lecteur dès la première ligne, de le prendre par la main en quelques sorte et de ne l'abandonner qu'à la fin sans que l'ennui se soit insinué dans sa lecture. Paul Auster s'y révèle encore une fois un narrateur exceptionnel. Son style fait d'humour, de tendresse et de réflexions parfois grinçantes sur la vie a quelque chose d'attachant, de magique même !
J'ai vraiment bien aimé et je continue d'explorer l'univers tissé par cet auteur qui ne cesse de m'étonner.
©Hervé GAUTIER – Février 2011.http://hervegautier.e-monsite.com
-
La chambre dérobée - Paul AUSTER
- Le 14/02/2012
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°500 – Février 2011.
LA CHAMBRE DÉROBÉE - Paul AUSTER– Actes sud.
Traduit de l'américain par Pierre Furlan.
Ce roman s 'ouvre sur l'écrivain américain Fanshawe, où plus exactement sur son fantôme. Cet homme semble avoir disparu et probablement est mort puisque sa femme Sophie contacte le narrateur, qui est aussi critique littéraire, mais également l'ami d'enfance de son défunt mari, pour qu'il juge si son œuvre demeurée inédite, est digne d'être publiée. En cela elle exécute une de ses dernières volontés explicitement exprimées. Non seulement les poèmes, romans et pièces de théâtre de Fanshawe sont éditées et sont un succès, mais le narrateur, sur la demande expresse de son ami, épouse sa femme et adopte son fils. Il lui propose en quelque sorte une vie par procuration ou, si l'on veut, une certaine forme d'imposture. Par la suite, non seulement le narrateur apprend que son ami n'est pas mort, mais ce dernier lui enjoint de n'en rien dire à Sophie et surtout de ne pas chercher à le retrouver. S'ouvre donc avec son épouse une période de vie commune qui sera heureuse bien que fondée sur le mensonge. Devant la réussite littéraire de la publication posthume, on demande au narrateur de rédiger une biographie de Fanshawe. A partir de ce moment, il va découvrir un être différent du garçon qu'il a connu enfant et prendre conscience qu'il a fait une erreur en acceptant ce travail qu'il finira par abandonner. Derrière l'élève brillant qu'il admirait, il découvre un jeune homme distant de ses parents, abandonnant ses études pour fuir sa famille et qui refuse d'éditer ses écrits pourtant prometteurs. Dès lors, il ne sait plus si Fanshawe est toujours vivant où s'il se confond avec l'image de la mort. A la fin, il lui révèle son existence qui ressemble à une fin de vie en lui confiant un cahier manuscrit passablement abscons « Tous les mots m'étaient familiers, mais ils semblaient pourtant avoir été rassemblés bizarrement , comme si leur but final était de s'annuler les uns les autres... Chaque phrase effaçait la précédente, chaque paragraphe rendait le suivant impossible. » . C'est un peu comme si le narrateur et probablement Auster lui-même, considéraient l'écriture comme une impossibilité !
Il est curieux que le nom de Fanshawe donné à cet écrivain soit en réalité le nom d'un roman écrit par Nathaniel Hawstorne, auteur américain [1804-1864] dont il est question dans « Revenants » qui est le deuxième roman de cette « Trilogie New-Yorkaise ». Son épouse se prénomme Sophie, tout comme celle de Hawstorne. Cela dit, Auster, avec ce roman labyrinthique écrit à la première personne, avec ses fréquentes digressions, tisse un suspens qui confine à l'interrogation, à tout le moins en ce qui me concerne. Au cours de ce récit, Auster lui-même (le narrateur?) lors d'une de ces parenthèses qu'il affectionne, révèle que ce roman se rattache à sa « Trilogie new-yorkaise », précisant « Ces trois récits sont la même histoire, mais chacun représente un stade différent de ma conscience de ce à quoi elle se rapporte... Si les mots ont suivi, c'est que je n'ai pu faire autrement que de les accepter. Mais cela ne rend pas les mots nécessairement importants. Il y a longtemps que je me démène pour dire adieu à quelque chose, et, en réalité, seule cette lutte compte. ». Que doit-on comprendre ici ? Que les mots sont un simple outil pour exprimer la pensée, qu'ils peuvent se dérober, que l'écriture est un moment de sa vie qu'il souhaite peut-être abandonner ? Est-ce une fascination pour la mort ou pour la quête perpétuelle d'une chose impossible à atteindre ? Est-ce une interrogation métaphysique sur le sens de la vie [« Les vies n'ont pas sens. Quelqu'un vit puis meurt et ce qui se passe entre les deux n'a pas de sens »], sur la destinée, sur la solitude, sur la quête que quelque chose dont on porte la réponse en soi-même ?[« Cette chambre, je m'en apercevais à présent, était située sous mon crâne »].
Ce roman qui clôt la série de la « Trilogie new-yorkaise » est d'une lecture facile mais m'a quand même laissé dubitatif. Pour autant, je continuerai à explorer l'univers de l'auteur à cause d'une attirance que je ne m'explique pas moi-même.
©Hervé GAUTIER – Février 2011.http://hervegautier.e-monsite.com
-
SEUL DANS LE NOIR - Paul AUSTER
- Le 14/02/2012
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°499– Janvier 2011.
SEUL DANS LE NOIR- Paul AUSTER– Actes sud.
Traduit de l'américain par Christine Le Bœuf.
August Brill, critique littéraire à la retraite, contraint à l'immobilité à la suite d'un accident de voiture se réfugie dans le Vermont, chez sa fille divorcée qui héberge également sa propre fille. La solitude, les insomnies, l'inaction suscitent chez lui un retour sur lui-même avec ses regrets, ses remords ... Pour fuir le noir de la nuit, il se recréé un monde imaginaire dans une Amérique qui n'aurait connu ni le 11 septembre ni la guerre en Irak [ On peut penser qu'il nie cet épisode historique parce que l'ex-compagnon de sa petite-fille Katia a été tué en Irak. Elle aussi se réfugie, aux côtés de son grand-père, dans le visionnage de vieux films], mais qui serait déchirée par une sorte de deuxième guerre de sécession. Dans ce décor surréaliste, Brill place son personnage principal, Owen Brick, magicien professionnel, la trentaine, chargé de tuer un homme qu'il ne connaît pas mais qui est présenté comme le seul responsable de ce conflit. Cet homme se révèle être Brill lui-même, l'inventeur de toute cette histoire. Son élimination physique mettra fin aux combats. Pour l'inciter à mener à bien cette mission, Brick fait l'objet d'un chantage : s'il n'élimine pas August Brill, c'est lui et son épouse Fortuna qui seront tués. Et tout cela, bien qu' imaginé par Brill lui-même, prend l'aspect d'une réalité. Pire peut-être, Auster n'imagine pas que Brill puisse renoncer à cette histoire [« Or Brill ne peut en aucun cas renoncer puisqu'il doit continuer à raconter son histoire, l'histoire de cette guerre dans cet autre monde qui est aussi ce monde-ci, et il ne peut se laisser arrêter par rien ni par personne. »]
Brill, déroule donc son histoire. Il permet à Brick de rencontrer une multitude de personnages dont pas mal de femmes. Ils ont tous leur place dans ce monde parallèle qu'il imagine ! Dans ce processus « d'histoire dans l'histoire », l'auteur mélange allègrement réel et virtuel et la nuit favorise cette « création » ! Dès lors cette introspection fait défiler dans sa tête toutes sortes de scénarii, des plus vraisemblables aux plus échevelés, allant même jusqu'à évoquer le suicide de Brick, pour éviter un sort tragique à son épouse.
Ce roman est composé un peu comme un patchwork un peu déroutant pour le lecteur. Cela commence par une référence à Giordano Bruno, ce moine philosophe du XVI° qui fut brûlé par l'inquisition italienne pour avoir soutenu qu'il existait d'autres mondes analogues au nôtre. Dans un texte gigogne, Auster mélange plusieurs fictions, juxtapose des morceaux de textes, passe brutalement d'une narration écrite à la première personne par Brill à un épisode du parcours de Brick. On a même parfois l'impression d'être carrément dans l'irréalité d'un conte de fée. Le narrateur évoque son enfance, sa rencontre avec sa défunte épouse, Sonia, son divorce, son remariage, le divorce de sa fille, parle longuement avec sa petite fille... Tout cela au cours d'une seule nuit d'insomnie !Ce pauvre vieil homme qui revient sur sa vie, la raconte à sa petite-fille, est en réalité en train de se distraire lui-même [« Je me suis surtout raconté une histoire, c'est ce que je fais quand je ne peux pas dormir. Je reste couché dans l'obscurité et je me raconte des histoires »]
Mais « Ce monde étrange continue de tourner » comme l'écrit le poète. La nuit se termine, le jour se lève, l'imagination s'arrête, l'inspiration se dissipe, la magie prend fin... Auster cesse tout d'un coup les « aventures » de Brick et aussi la rédaction de son roman !
Paul Auster est vraiment un écrivain étonnant à plus d'un titre. Sa créativité semble ne pas avoir de bornes, mélangeant autobiographie et chimères, jouant avec les mises en abymes, il tisse lentement un univers kafkaïen et labyrinthique. Non seulement il raconte une histoire, mais aussi il en profite, dans la seconde partie, pour s'interroger sur le rôle de l'écrivain par rapport à ses personnages, mène une réflexion sur la guerre et sur l'engagement américain, compare livre et film [« Un livre vous oblige à échanger avec lui, à faire travailler votre intelligence et votre imagination , alors qu'on peut regarder un film dans un état de passivité décérébrée. »], se livre à une analyse assez longue de certains longs-métrages [ Renoir, de Vittorio de Sica, Ray...], parle, sous forme d'aphorismes de Dieu, de la bonté, l'éducation, de la culpabilité [ Katia pense que le départ de son ex-compagnon pour l'Irak où il sera tué est la conséquence de leur rupture], met en perspective la douleur et la création artistique, sa genèse aussi parfois. Un écrivain doit souffrir pour créer[Brill vit « dans une maison d'âmes en peine, blessées » et sa fille, également meurtrie par la vie, écrit, elle aussi]ou simplement laisser aller son imaginaire ? Sa propre création est-elle un baume à la douleur, tant le monde extérieur est peu attirant. L'imagination serait-elle une antidote à la vie et pourquoi pas au temps qui passe ?
Je ne sais pas pourquoi, mais je continue avec plaisir à explorer l'univers de Paul Auster.
©Hervé GAUTIER – Janvier 2011.http://hervegautier.e-monsite.com
-
REVENANTS - Paul AUSTER
- Le 14/02/2012
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°497– Janvier 2011.
REVENANTS – Paul AUSTER– Actes Sud.
Traduit de l'américain par Pierre Furlan.
Trois personnages principaux à qui l'auteur donne des noms de couleurs : Bleu, Blanc, Noir. Un lieu : New-York près du Pont de Brooklin. Une année : 1947. voilà pour le décor. Le narrateur de cette histoire demeure inconnu.
Blanc demande à Bleu de surveiller Noir et pour cela lui loue un appartement depuis les fenêtres duquel il peut voir Noir et observer ses faits et gestes. Il devra seulement, contre paiement, établir des rapports hebdomadaires qu'il déposera dans une boîte postale. C'est donc un travail facile d'autant que Bleu est détective privé. Ce qu'il voit au début, c'est que Noir écrit beaucoup. Cela semble être sa seule activité. Cette filature monopolise tout le temps de Bleu qui ainsi néglige sa fiancée a point de ne plus lui téléphoner. Cela laisse pour lui la place aux craintes, voire aux fantasmes... A force de rédiger ses rapports qui n'entrainent aucun commentaire, Bleu en vient à douter du bien-fondé de sa tâche. Suivre Noir lui paraît inutile tant il lui semble que sa vie ne recèle aucun secret. A partir de ce moment, il se libère lui-même de son travail en s'accordant des répits, mais lors d'un de ces moments de liberté il s'aperçoit que sa fiancée lui préfère un autre homme. Il l'interpelle, lui apparaît « comme un revenant » et prend conscience qu'il a perdu toute chance de vivre heureux. Il se rabat sur Violette, une prostituée qui lui donne du plaisir. Il va aussi au cinéma parce qu'il aime les salles obscures et parce que « les images à l'écran ont une certaine ressemblance avec les pensées qui défilent dans sa tête ». Est-ce le fait d'assister à la projection du film « la griffe du passé » qui lui fait remonter le temps et revenir à l'histoire du pont de Brooklin et à la vie de son propre père ? Il en déduit que les vivants sont entourés de « revenants » puisqu'il est aussi question au cours de ce texte des écrivains américains tels que Walt Withman ou de Nathaniel Hawthorne
En même temps que cette révélation, Bleu prend conscience que les mots qu'il utilise dans ses rapports sont insuffisants, inexpressifs pour parler complètement de Noir. Il décide donc, pour mieux sérier sa personnalité de faire ce qu'il fait, de lire ce qu'il lit... De même il s'aperçoit que cette tâche lui paraît bizarre et même impersonnelle. L'appartement est loué au nom de Blanc mais occupé par Bleu, les paiements se font par mandat et non par chèque. Est-ce là la certitude de vivre sa vie par procuration, comme si celle de Bleu se confondait avec celle de Noir ? Le temps passe ainsi sans que rien ne se produise et par une sorte de jeu de miroir, Bleu s'aperçoit qu'il n'est plus maître de cette activité d'observation. D'observateur, il devient observé, et par Noir lui-même, et ce d'autant plus que, nous l'apprendrons plus tard, Noir est lui-même un détective privé, chargé, dans les mêmes conditions d'établir des rapports sur les activités de Bleu. Ce dernier en vient à douter de sa propre personne, de sa propre tâche. Il en vient à penser qu'il est, en quelque sorte, désincarné, dépossédé de lui-même par cet homme qui joue ainsi un double jeu sans qu'il comprenne bien pourquoi.[« Car en épiant Noir de l'autre côté de la rue, c'est comme si Bleu regardait dans un miroir, et au lieu de simplement observer quelqu'un d'autre, il découvre qu'il s'observe aussi lui-même »]. Est-ce un message sur la précarité de l'identité, sur l'angoisse inévitable que génère pour un homme le fait de n'être rien, de ne servir à rien ? C'est un peu comme si, en rédigeant des rapports sur Noir, Bleu écrivait sur lui-même, comme si l'écriture avait le rôle progressif du bain révélateur dans le processus du développement photographique.
Ce livre est présenté comme le deuxième volume d'une trilogie new-yorkaise[« la cité de verre » - « La chambre dérobée »]. On peut le lire comme un thriller. Moi, j'ai choisi de le voir comme un « roman à énigme » dont nous n'aurions même pas, à la fin, la moindre explication. Elle serait même laissée à la seule imagination du lecteur. (La dernière phrase est ainsi rédigée « A partir de ce moment-là, nous ne savons plus rien. »). Cela me paraît être révélé par le procédé de « mise en abyme » qui est inhérent à ce récit. Le lecteur s'aperçoit que les annotations qu'a faites Bleu sur Noir et qui sont consignées sur des feuilles, servent de trame au roman qu'il vient de lire. [« Ça à l'air d'un gros livre » dit Bleu à Noir quand il aperçoit une liasse de feuilles posées sur sa table]. Ce n'est autre que les rapports qu'il a lui-même adressés à Blanc sur les activités de Noir !
Les personnages eux-mêmes ont la transparence et la consistance d'un ectoplasme, une sorte de non-existence [ils portent des noms de couleurs primaires] qui déstabilise le lecteur tout comme les nombreuses digressions qui émaillent le récit. Par une sorte de jeu de miroir, il est est complètement perdu, se demandant qui est qui et qui fait quoi ! Bleu et Noir sont devenus interchangeables au point que la personnalité de l'un éclaire celle de l'autre, ou la complique...
Paul Auster pose des questions existentielles et, malgré les apparences, n'offre nullement une histoire policière dont nous aurions la solution à la fin. Je choisis d'y voir une méditation sur la solitude, sur la condition humaine, sur sa propre identité dans un monde de plus en plus déshumanisé et anonyme, et même sur le rôle de l'écriture et de l'écrivain [« L'écriture est une occupation solitaire qui accapare votre vie. Dans un certain sens un écrivain n'a pas de vie propre. Même lorsqu'il est là, il n'est pas vraiment là. »]. C'est un peu comme si lui, qui est le maître de cette fiction, avouait qu'il en est en réalité étranger, peut-être seulement le simple transcripteur, le transitoire et transparent témoin, seulement là pour livrer au lecteur ce qu'il voit, ce qu'il croit voir ou ce qu'il imagine. D'une certaine façon, il est un de ses personnages, aussi mystérieux qu'eux !
Paul Auster évoque avec ce court roman un univers kafkaïen à la fois cauchemardesque, oppressant et absurde. Cela me plait bien et me donne envie d'en explorer les arcanes.
©Hervé GAUTIER – Janvier 2011.http://hervegautier.e-monsite.com
-
SUTTREE – Cormac Mac Carthy
- Le 18/07/2011
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°531– Juillet 2011.
SUTTREE – Cormac Mac Carthy – Actes Sud
Traduit de l'américain par Guillemette Belleteste et Isabelle Reinharez.
Il est des romans qui possèdent en eux un souffle émotionnel unique. Suttree est de ceux-là. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si son auteur a mis vingt ans à l'écrire en puisant dans sa vie personnelle. C'est le propre des écrits à ce point intimes que d'être laborieux, comme si les mots ne voulaient pas sortir alors que l'auteur porte en lui, dans sa chair et dans sa vie, les morceaux de cette histoire.
Nous sommes dans le sud des États-Unis pendant les années 50. Cornélius Suttree vient de sortir de prison et tente comme il peut de survivre sur les bords de la rivière Tennessee en pêchant. Il mène dans la banlieue de Knoxville une vie de marginal sur une péniche délabrée. Il a tourné le dos à sa famille, à sa femme et à son fils. Pour cette raison, elle le considère comme un raté, un moins que rien. Le roman s'ouvre sur une sorte de poème en prose où les mots s'entrechoquent en altérations surréalistes. Pour en goûter toute la musique, il faut le lire à haute voix. Il s'adresse à un inconnu, au lecteur peut-être, comme une sorte d'avertissement et dessine un décor un peu glauque mais surtout réaliste [« Nous voici arrivés dans un monde au cœur du monde »]. Pour que son interlocuteur comprenne bien, il poursuit par une scène assez sordide où on sort un noyé de l'eau, un suicidé ! Tout le reste de ce long roman sera baigné par une sorte de souffle épique où la mort, la souffrance, la violence et la pauvreté sont omniprésentes. Mac Carthy, tout au long de ce texte, alterne avec bonheur les passages poétiques et les scènes d'un réalisme cru et pathétique qui décrivent les bas-fonds et leur faune désespérée. Suttree donne l'impression d'être victime de sa vie, un paria, et, à travers diverses analepses, l'auteur nous le présente comme soumis à une malédiction qui pèserait sur lui, comme cet épisode de la mort de son fils aux obsèques de qui il ne peut assister que de loin.
A travers une histoire initiatique, Mac Carthy donne à voir, et sans aucune concession, la descente aux enfers puis la relative renaissance de Suttree et à travers lui la vie des laissés-pour-compte de cette Amérique profonde qui est bien loin du rêve américain. Suttree, comme les personnages de « La Route » (La Feuille Volante n° 530) poursuit un chemin ou plutôt erre dans un décor hostile. La rivière Tennesse fonctionne comme une sorte de miroir qui renvoie une image de la vie de cette ville mais aussi celle de l'âme de ce personnage un peu étrange. lI y a de la compassion dans ces évocations de déshérités, dans cette lumière qui baigne ces scènes sans compromis où la misère voisine avec la violence. Les autres personnages de ce roman ne sont pas en reste, à la fois décalés et sordides, dans ce tableau. De décor dans lequel évolue Suttree donne asile à tout une faune de marginaux, ivrognes, chômeurs ou repris de justice, putains... Son histoire est celle d'un désespéré, un de ces blessés de la vie qui, pour se consoler, fréquente les prostituées, les sorcières et les diseuses de bonne aventure, des femmes qui peuvent lui faire croire, l'espace d'un instant, que la vie est non pas exactement belle mais viable, malgré les épreuves. C'est quelqu'un qui ne se suicidera pas, peut-être à cause de l'espoir un peu fou de voir les choses s'arranger, que la chance puisse lui sourire enfin, avec alcool et patience. Ces êtres supportent la vie avec abnégation et fatalisme et leur stoïcisme plonge ses racines dans les replis insondables du mystère. Autour de lui il y a la mort, omniprésente qui le guette et il le sait, mais il poursuit son chemin. Il supplie même Dieu de le délivrer de ce fardeau qu'est sa vie. Le thème du parcours cahoteux est récurrent dans ce livre. Il est spectateur de sa vie comme de celle des autres qu'il croise comme on croise des fantômes, un peu comme si tout cela n'était qu'une vision, un décor de théâtre, mais un décor agressif. Quand il rencontre l'amour, qu'une femme lui fait l'hospitalité de son corps et qu'il peut envisager l'avenir sous un meilleur jour, la mort est forcement au bout du parcours. Tout cela fait de lui un malheureux définitif. Il y a aussi un retour vers l'enfance, le paradis perdu comme dans « La Route » et avec lui la mesure de la fuite inexorable du temps, la misère, la marginalité, la mort. La mort, signe indélébile de la condition humaine est encore présente dans la disparition de Wanda, l'amante de Suttee, écrasée par un effondrement. La solitude aussi, autre pendant le cette « humaine condition » dont chaque être porte en lui la marque comme le disait si bien Montaigne, A la fin, il y a une sorte d'apaisement, de nouvelle vie possible pour Suttree...
Comme dans tous les romans de Mac Carthy, on peut voir une symbolique religieuse. Suttree m'évoque tous ces prophètes que Yahweh a abandonné pour les éprouver. Le printemps pluvieux fait inexorablement penser au déluge et son fragile esquif à l'arche de Noé voguant sur une tempête liquide. La typhoïde (l'évocation du délire est fantastique) qui lui vaut l'extrême-onction fournit une sorte de transition vers une vie meilleure. Pourtant, son approche de Dieu n'a rien de religieu .
Je reste fasciné par le souffle poétique de ce long roman, par son réalisme pathétique. Ils doivent sans doute beaucoup à une traduction somptueuse. L'univers de l'auteur, sa démarche d'écriture entre gouaille populaire et authentique poésie, tissent pour le lecteur, un attachement et même une sorte de complicité. L'image qu'il donne de l'homme nous est familière, soit que nous la connaissions, soit que nous la déplorions, mais elle est réelle.
©Hervé GAUTIER – juillet 2011.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA ROUTE – Cormac Mac Carthy
- Le 12/07/2011
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°530– Juillet 2011.
LA ROUTE – Cormac Mac Carthy – Éditions de l'olivier. [Prix Pulitzer 2007]
Traduit de l'américain par François Hirsch.
Le décor est dantesque, un spectacle de fin du monde ou plus exactement un monde détruit en presque totalité par quelque chose comme une explosion nucléaire ou un cataclysme qui auraient anéanti une grande partie de la planète. Dans ce décor apocalyptique où tout est réduit en cendres encore fumantes, où les seuls humains qui restent sont devenus anthropophages, un père et son fils cheminent sans vouloir s'arrêter dans le froid et la nuit. Ils n'ont pas de nom, comme pour signifier que ce monde est à ce point déshumanisé. L'auteur les appelle respectivement « l'homme » et « le petit ». Ce dernier est un enfant de cinq ou six ans qui pose sans cesse des questions inquiétantes sur les gens qui les entourent ou qu'ils rencontrent au gré de leurs pérégrinations. Ils sont devenus de véritables bêtes. Nos voyageurs n'ont pour seul bagage qu'un caddy de supermarché qui contient toute leurs richesses de survie, couvertures et nourriture. Un sac à dos recevra ce contenu en fin de parcours. Un révolver leur sert de protection illusoire.
Doit-on voir là la métaphore d'un paradis perdu [« Autrefois il y avait des truites de torrents dans les montagnes... Elles avaient un parfum de mousse quand on les prenait dans la main. Sur leur dos il y avait des dessins en pointillé qui étaient des cartes du monde en son devenir. Des cartes et des labyrinthes. »], d'un monde qui est le nôtre et qui court inévitablement à sa perte, du retour de l'homme à l'état sauvage, de l'instinct de survie, de l'abandon de tout ce qui a fait l'humanité et l'humanisme, du retour de la barbarie, de sa solitude ? Les personnages qu'ils rencontrent dans cette fuite sont eux aussi en recherche de quelque choses. Eux aussi marchent vers un lieu différent mais qui est censé leur servir de refuge. Ils sont souvent hostiles et fantomatiques, en instance de mort, ou simplement des cadavres. Je note que malgré tout, l'homme et l'enfant marchent sans désemparer vers une destination inconnue, au sud, mais qui semble les attirer inexorablement. Quand ils atteignent la mer, ils errent dans un paysage désolé et hostile dans lequel « l'homme » finira par perdre la vie parce que la maladie le mine. Peut-on y voir une explication sombre et désespérée qui serait par exemple celle de l'inutilité d'une action inutilement répétée, une sorte de mythe de Sisyphe, [la route est forcément un horizon sans fin], l'image de la condition humaine qui est promise à la souffrance et à la mort ? Le père est malade et l'enfant, dénutri, au bord de l'épuisement et, apparemment, cette marche inexorable dure depuis longtemps et a des chances de se poursuivre... Jusqu'à quand ? L'homme mourra mais ce ne sera cependant pas une mort violente, simplement un sorte de passage, comme s'il se dissolvait dans ce décor macabre. A la fin, l'enfant, livré à lui-même trouvera un autre homme et sa femme qui lui serviront de parents, ce sera pour lui, comme un nouveau départ. Il n'oubliera cependant pas celui qui fut son père et qui le guida. Doit-on y voir la marque de l'espoir, d'une certaine confiance en quelque chose qui pourrait ressembler à une divinité, à un improbable salut ? Les deux protagonistes « portent le feu », sont des « gentils », comme le couple qui recueillera l'enfant mais le monde autour d'eux est peuplé de « méchants ». On songe, évidemment que la mort est au bout de ce chemin, même si l'enfant peut, en lui-même, incarner le renouveau, un espoir pour cette humanité en perdition, le relais qu'un père passe à son fils. C'est un livre hautement symbolique sur la vie humaine, transitoire, qui porte en elle à la fois la destruction et la transmission.
J'ai choisi d'y voir l'évocation, certes romancée et habillée différemment, de notre monde au quotidien voué à la réussite personnelle, à la destruction par l'homme de son prochain au mépris de tout ce qu'on a pu nous dire sur sa supposée grandeur ! J'ai toujours cru que les hommes sont les destructeurs de la planète qu'ils habitent et qui pourtant est irremplaçable et unique. Ils sont eux-mêmes les plus grands prédateurs de leur espèce et ce ne sont pas des entreprises individuelles louables mais promises à l'échec qui peut racheter leurs méfaits.
De ce roman initiatique, je retiens aussi la chaine humaine et la vie qui se transmet de génération en génération.
Les dernières lignes se veulent porteuse d'espoir, mêlant Dieu au souvenir de ce père qui a guéri son fils et l'a amené vers l'âge adulte. [« Il essayait de parler de Dieu, mais le mieux c'était de parler de son père et il lui parlait vraiment et il n'oubliait pas. La femme disait que c'était bien. Elle disait que le souffle de Dieu était encore le souffle de son père bien qu'il passe d'une créature humaine à une autre au fil des temps éternels. »] Je ne suis donc pas sûr qu'il s'agisse réellement d'un roman de science-fiction, bien au contraire !
J'avoue que j'ai été très décontenancé par cette écriture volontairement sèche et brève dans les dialogues et très économe dans les descriptions autant que par l'histoire elle-même. C'est pourtant un livre fascinant ou l'auteur s'attache son lecteur jusqu'à la fin.
©Hervé GAUTIER – juillet 2011.http://hervegautier.e-monsite.com
-
La ligne de partage – Nicholas EVANS
- Le 23/01/2011
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°496– Janvier 2011.
La ligne de partage – Nicholas EVANS- Albin Michel.
Traduit de l'américain par Françoise du Sorbier.
Le roman s'ouvre sur la découverte par deux skieurs du cadavre d'une jeune fille emprisonné dans la glace à « Goat Creek ». Les recherches, difficiles au début, révèlent son identité: il s'agit d'Abbie Cooper recherchée par le FBI.
Ainsi débute une histoire aux multiples rebondissements que le lecteur va découvrir grâce à la rétrospective. Derrière ce titre un peu sibyllin, il faut entendre « la ligne de partage des eaux » Cette histoire commence en effet il y a quelques années dans un hôtel de l'état de Montana aux États-Unis. En réalité cet établissement est un ranch, nommé « la Ligne » qui reçoit des hôtes et qui est situé « au sommet d'une vallée tortueuse ». A cet endroit précis, la rivière se divise en deux. D'un côté « Lost Creek », dont « l'existence est aléatoire » et de l'autre « Miller's Creek » dont le cours est impétueux. De chaque côté de cette colline, le paysage est bien différent et le filet d'eau d »une rivière ne donne vie qu'à une végétation maigre tandis que l'autre permet une flore luxuriante. Dans ce ranch, plusieurs familles se retrouvent chaque été. Sarah et Benjamin Cooper, les parents d'Abbie et de Josh, Les Bradstock, les Delroy. Apparemment ces couples sont satisfaits de se retrouver chaque année avec leurs enfants et Abbie, encore adolescente, s'imaginait que ses parents étaient heureux de vivre ensemble. Effectivement, leur vie est simple et normale, mais ils n'ont pas échappé à l'usure du couple, au temps qui passe, à l'envie de l'inconnu... Abbie vit sa vie d'adolescente et profite de ses amours de vacances en même temps qu'elle tombe amoureuse de la nature sauvage du Montana où habite Ty.
C'est dans ce décor que Benjamin, que tout le monde appelle Ben, tombe amoureux, six mois auparavant, de Eve Kinsella ce qui acheva l'histoire du couple qu'il formait avec Sarah. Les deux époux se séparent ce qui bouleverse Abbie, mais laisse apparemment indifférent son frère Josh. Est-ce pour cela que la jeune fille devenue étudiante, se passionne au rythme de ses rencontres et de ses aventures amoureuses, pour l'écologie, pour la contestation et même pour la révolution ? Elle rencontre Ty, le jeune fils d'un couple d'agriculteurs dont la propriété est ravagée par des forages de gaz. Elle prend conscience des choses, s'engage dans le militantisme et la défense de la nature, s'émancipe en même temps qu'elle finit par admettre, malgré sa révolte, la séparation de ses parents incapables d'êtres heureux ensemble. Ce qui est vécu par elle comme un échec [a-t-on le droit, quand on a fondé une famille, de la sacrifier au nom d'un nouvel amour ?] est pour son père un nouveau départ. Avec Eve « il se sent revivre » tandis qu'Abbie bascule petit à petit dans un monde marginal qui menace de la broyer. Elle participe, au côté de Rolf, devenu son mentor mais aussi son amant à un incendie criminel contre ceux qui s'enrichissent en détruisant la nature. Ce malheureux épisode se solde par la mort d'un homme. Abbie et Rolf sont donc recherchés par la police. Il mènent ensemble une vie de traqués, un peu comme Bonny et Clyde. En fait Abbie est victime du syndrome de Patti Hearst (syndrome de Stokholm) : Une jeune femme, issue d'un milieu aisé tombe, à l'occasion d'une période difficile de sa vie, sous l'influence d'un homme charismatique, plus âgé qu'elle. Il parvient à la convaincre que le système d'éducation sous lequel elle a vécu jusqu'à présent est pervers et il l'entraîne dans une vie où le crime est à la fois une obligation morale et une nécessité romanesque. Elle devient donc une « eco-terrorisme » poursuivie. Sa fuite éperdue et son désir de se livrer à la police lui font à nouveau croiser la route de Ty qui fut un temps inquiété comme éventuel complice d'Abbie. L'idylle avec Rolf tourne court malgré la future maternité d'Abbie et le piège se referme sur elle.
A travers cette histoire se mêlent le traumatisme du Worl Trade Center, les préoccupations écologiques et un drame familial. Les Cooper se déchirent sous les yeux de leurs deux enfants qui tentent comme ils peuvent de se raccrocher à leur vie et d'y donner un sens. Même si Sarah et Ben réussissent à refaire leur vie chacun de leur côté, même si Josh, muri par cette épreuve, parvient à s'insérer dans la société, il reste que l'éclatement du couple me semble responsable de la dérive d'Abbie et de sa fin tragique. La question de la responsabilité reste posée [autant que celle de la culpabilité !] et du hasard qui met les gens en situation et pèse sur leur choix. Je ne partage que très difficilement l'apaisement de l'épilogue et je doute que chacun puisse, après un pareil malheur, retrouver le bonheur perdu. En ce sens le roman me paraît un peu superficiel et semble privilégier une manière de « happy end » qui ne m'a guère convaincu.
Malgré quelques longueurs et de nombreux personnages, parfois furtifs, l'auteur, grâce à des descriptions poétiques des grands espaces américains et un suspens savamment entretenu, tient le lecteur en haleine jusqu'à la fin.
©Hervé GAUTIER – Janvier 2011.http://hervegautier.e-monsite.com
-
La femme du V° – Douglas Kennedy
- Le 15/01/2011
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°495– Janvier 2011.
La femme du V° – Douglas Kennedy- Belfond.
Traduit de l'américain par Bernard Cohen.
Nous sommes quelques jours avant Noël dans un Paris un peu glauque où Harry Ricks vient de débarquer. Il y a quelques mois, il était encore enseignant dans une université américaine et vivait aux État-Unis avec sa femme et sa fille. Désargenté, en instance de divorce et radié à vie de l'université à cause d'une aventure amoureuse et tragique avec une étudiante, il arrive à Paris avec pas mal d'illusions. Il les a pourtant perdues définitivement quand il a appris que son épouse filait le parfait amour avec le doyen de la faculté dont il a été expulsé. Paris représente pour lui un nouveau départ et reste, dans son esprit, la ville de tous les fantasmes d'autant qu' il habite « rue du Paradis »! Il se retrouve pourtant au fin fond du X° arrondissement, dans une chambre de bonne lugubre. Ici, il a vraiment la certitude « d'être tombé plus bas que terre ». Les toilettes sont d'une propreté plus que discutable. C'est là un obsessionnel leitmotiv qui me paraît révélateur.
Il ne trouve son salut que dans l'écriture d'un roman, dans un travail un peu mystérieux mais bien payé de veilleur de nuit, dans la fréquentation des cinémas, celle d'un cybercafé... et surtout celle d'une faune interlope. Jusqu'au jour où il rencontre un peu par hasard une hongroise d'âge mûr, un peu mystérieuse, Margit, dont il tombe, bien entendu, amoureux. Leurs relations deviennent rapidement torrides et chacun raconte son histoire. La sienne est tragique et ils se retrouvent chez elle, dans le V° arrondissement de Paris. Si elle accepte de le rencontrer régulièrement, elle y met cependant une condition bizarre mais sine qua non qu'il accepte : Elle ne le verra que tous les trois jours de cinq heures à huit heures ! Caprice ou nécessité ? Pourtant cette liaison « lui donne l'illusion d'échapper à la banalité de sa vie ». Harry saura par la suite que ce « contrat » est pour lui à la fois vital... et viager ! Il respectera cependant cet « accord » et ne cherchera pas à repartir pour les États-Unis, malgré la présence de sa fille. Margit alterne passion et réserve, souffle le chaud et le froid, paraît en savoir beaucoup sur lui, pilote sa vie et parfois celle des autres. Elle est pour lui un véritable ange gardien.
Dans le même temps, Harry est l'objet d'un chantage, il est soupçonné de meurtre, se rend compte qu'il est constamment surveillé, se retrouve carrément dans un monde parallèle qui lui échappe mais qui semble lui envoyer des messages, se demande en quoi consiste exactement son travail et qui est ce « M. Monde »[une référence à Siménon qui figure aussi en exergue du roman] que viennent voir nuitamment ses visiteurs mystérieux, s'interroge sur tout les « événements » qui l'entourent et dont il est le témoin, sur cette femme-fantôme décidément bien énigmatique.
J'ai bien aimé les évocations érotiques de Kennedy.[je ne lis pas encore cet auteur dans le texte mais je pense que le traducteur ne trahit pas l'auteur] autant que l'alternance des expressions crues violentes ... En revanche, je ne suis pas sûr d'avoir apprécié ses développements et digressions parfois pénibles sur la culpabilité très judéo-chrétienne, même si c'est là un thème récurrent dans son œuvre. En cela il est un digne Américain puritain et austère qui pourtant dénonce cette société manichéenne que, apparemment, il n'aime guère. Pourtant, cette histoire de quatrième dimension, cette Margit fantôme qui apparaît et disparaît opportunément au gré des besoins du roman et sait prévoir l'avenir me paraît un peu forcé. Pour accréditer cette idée, l'auteur oppose intuition et raison... Je veux bien que nous soyons dans une fiction, mais quand même, recourir dans un polar aux forces surnaturelles ![A moins que Paris soit pour Dougal Kennedy un lieu à ce point magique et envoutant que rien n'y est comme ailleurs ?- Alors, la femme du V° arrondissement ou celle de la 5° dimension ?]
J'ai goûté avec plaisir ses remarques sur le mariage raté de Harry et sur les circonstances qui l'ont fait capoter, sur la petitesse et la mesquinerie des personnages mis en scène. C'est apparemment un thème qui lui est cher et dont il parle souvent avec gourmandise. En cela il est le témoin de son temps qui est aussi celui des divorces et des échecs matrimoniaux, de l'hypocrisie mais aussi de la vengeance. Il paraphrase opportunément Alexandre Dumas quand ce dernier prétend que les chaines du mariage sont si lourdes à porter qu'il faut parfois s'y mettre à plusieurs !
Il faut y voir aussi le regard sans concession d'un étranger sur Paris qu'il connaît bien et sur la France. Kennedy a simplement voulu nous dire que ce n'est pas une ville aussi belle que cela, que la liberté n'y est pas aussi complète, qu'on et bien loin du Paris d'Hemingway, des artistes, et de celui de Gershwin.
C'est un roman plein de suspens et un polar très noir, une sorte de texte gigogne, un peu trop surnaturel quand même mais qui tient en haleine son lecteur jusqu'à la fin.
Ce livre illustre une nouvelle fois une de ses phrases « Dans mes livres, je rôde toujours autour de l'idée que chaque homme est très doué pour construire sa propre prison, le mariage étant la prison la plus commune. Le couple, rongé par le sentiment confus de culpabilité est l'un de mes thèmes obsessionnels »
©Hervé GAUTIER – Janvier 2011.http://hervegautier.e-monsite.com
-
Piège nuptial – Douglas Kennedy
- Le 12/01/2011
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°494– Janvier 2011.
Piège nuptial – Douglas Kennedy- Belfond.
Traduit de l'américain par Bernard Cohen.
Nick, le narrateur, est journaliste en poste dans la province américaine du Maine. Fasciné par l'Australie, il décide de tout plaquer pour y aller. Curieux, il se dit que Darwin, au nord du continent, serait un point départ opportun pour une exploration.
Après une rencontre avec un « révérend », ministre du culte et apparemment seul adepte de « l'Église apostolique de la foi inconditionnelle » à qui il achète son minibus Volkswagen, il se lance sur la route en solitaire. Après avoir percuté nuitamment un kangourou, il fait la connaissance, par le plus grands des hasards, d'Angie, belle plante autochtone qui se présente à lui comme une jeune vierge. Les présentations faites et fier de sa bonne fortune, Nick ne tarde pas à s'apercevoir que sa conquête ne correspond pas tout à fait à l'image qu'elle voulait donner d'elle. Amatrice de bière, de bagarre et dévoreuse d'hommes, elle n'a pas vraiment les manières d'une blanche pucelle. Pourtant, elle sera sa compagne de route puisque Nick a choisi de descendre vers le sud.
Nick n'est pas vraiment un tombeur mais il profite de la compagnie d'Angie. Un peu malgré lui, les choses évoluent et il se réveille en plein désert, au milieu de nulle part et apprend qu'il a demandé la main d'Angie à son père et que cela a été suivi aussitôt d'une cérémonie nuptiale. Bref, il se retrouve marié malgré lui d'autant plus qu'il aurait donné son consentement après avoir été préalablement drogué. Il est « l'amerloque » un peu paumé qui va faire connaissance de sa nouvelle belle-famille, des gens complètement déjantés, que les événements qu'il apprendra plus tard, ont amené ici, dans une ville fantôme, rayée de la carte à la suite de l'incendie d'une mine d'amiante. Ils ont fondé ici une communauté familiale alcoolique, violente et marginale qui, pour éviter la consanguinité, recherche activement des mâles qui feraient office de géniteurs. Sans le savoir Nick s'est donc retrouvé pris au piège, mais il s'est refermé sur lui ... en plein désert ! Pour un célibataire explorateur, c'est un comble ! Il a beau n'être qu'un étranger, il représente une opportunité que les membres de ce clan ne veulent surtout pas laisser s'échapper. Il apprend d'ailleurs que ses prédécesseurs qui s'y sont aussi essayés ont tous connu un destin tragique !
Il fait véritablement connaissance de sa femme (elle se révèle « aussi tendre qu'un demi de mêlée »), de sa belle famille aux habitudes néandertaliennes et apprend du même coup qu'Angie est enceinte. Tant bien que mal il essaie de s'adapter à sa nouvelle situation de captif tout en songeant à fuir ce microcosme désert et oublié. Malheureusement pour lui, on a pris soin de lui confisquer son passeport et son argent, ce qui compromet encore davantage ses velléités de départ.
Il s'aperçoit vite que la seule façon de s'en sortir est de donner le change et pour faire davantage illusion il simule la dépression qu'il soigne comme il peut malgré les dangers que cela représente puisqu'il s'aperçoit qu'il est soumis à une surveillance constante. Il fait cependant la connaissance de la seule personne qui n'a pas été contaminée par ce clan. Il s'agit de Krystal qui se trouve être sa belle-sœur, institutrice de cette ville fantôme, animée elle aussi de velléités de fuite. Avec elle, il met au point un plan laborieux mais qui malheureusement tournera mal pour elle.
J'ai bien aimé ce roman au style, certes peu académique et même argotique mais quand même un peu drôle. Le texte qui se lit facilement entraîne le lecteur passionné dans une aventure ou le suspense et le dépaysement sont garantis.
Avec ce roman un peu cauchemardesque par moments, paru précédemment sous le titre « Cul-de-sac », Kennedy poursuit sa quête du bonheur impossible comme il l'avait fait avec « Quitter ce monde »(la feuille volante n° 485 ) Ces personnages se débattent comme ils peuvent dans des mariages improbables. J'aime assez cette peinture originale de la condition humaine et son style est toujours aussi attachant.
©Hervé GAUTIER – Janvier 2011.http://hervegautier.e-monsite.com
-
Thriller – Iegor Gran
- Le 11/01/2011
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°493– Janvier 2011.
Thriller – Iegor Gran- P.O.L.
Norman Mayfield est maintenant professeur d'économie à l'université de Berkeley. Il ne songe qu'à une chose : résoudre l'équation de l'économie sociale. Suzanne est son épouse « qui serait jeune dans sa tête... mais qui fait bien ses quarante six balais, peut-être même davantage. » Ils forment ensemble un couple classique et un peu superficiel d'Américains. Avec le temps (vingt ans de vie commune) ils se sont installés dans la routine, il est content de lui mais elle s'ennuie un peu malgré son emploi, toutes les marques extérieures de cette réussite et elle lui reproche une certaine forme d'immobilisme. Pour palier cette situation qu'elle juge délétère, elle prend un amant en la personne de Lorch, « le doyen... un peu soporifique ... qui s'accroche à son poste comme à son cardiogramme », et cela fait dix ans que cela dure ! Au cours du récit, il sera présenté comme un vieux-beau, infatué de lui-même, divorcé, tombeurs de ses étudiantes et fervent lecteur du Kama Sutra. C'est pourtant lui que choisit Suzanne, mariée et mère de famille, pour s'encanailler. Ils se plaisent réciproquement, deviennent amants et vivent une liaison régulière et enflammée sans que Norman ne se doute de rien, passionné qu'il est par son travail et ses recherches.
Le tableau se complète par La Fayette, un ami de Norman et Syd, l'adolescent féru d'informatique et enfant du couple.
Cette histoire commence par une salade au saumon consommée chez Norman et le rappel d'un épisode oublié de la vie de ce dernier. Il aurait dérobé un portefeuille à un clochard, ce qui, pour un professeur d'université n'est guère reluisant. Il prétend ne pas s'en souvenir et d'ailleurs, au cours de cette fiction, la mémoire semblera lui manquer douloureusement. L'épilogue en donnera la raison. Dans le même temps, une femme blonde est étranglée sur un terrain vague près de chez les Mayfield.
Jouant sur cette amnésie que le lecteur peut supposer feinte, Lorch, désireux sans doute de justifier sa propre turpitude, fait naître dans l'esprit de Suzanne l'existence d'une passade entre une étudiante et son mari. Non seulement elle y croit, mais soupçonne Norman d'être l'auteur du crime du terrain vague. L'installation de caméras de surveillance dans l'enceinte de l'université, présentée un temps comme devant établir la faute de Norman, se révèle être un leurre mais fait, un temps, illusion. Désireuse sans doute de masquer son adultère, Suzanne apparaît comme une mythomane un peu déjantée, accusant son mari du crime du terrain vague, sans doute pour mieux d'en débarrasser. Tout cela trouvera son explication à la fin même si l'épilogue est à la fois surprenant et un brin artificiel.
Le style peu académique, incisif et caustique, plein d'apartés que je préfère appeler longueurs, ne sert pas le suspense qui est censé baigner le récit. Quant aux notes de bas de page relatives à l'économie, elles n'apportent rien de pertinent ni d'intéressant pour un lecteur ordinaire. L'intervention du narrateur baptisé « le psychopathe » vient seulement compliquer les choses mais sûrement pas rendre le récit plus passionnant. Quant à l'existence du « journaliste bidonneur » et du docteur Lane...
Finalement tout rentrera dans l'ordre, Norman, après une opération au cerveau, retournera à ses travaux (sa tumeur au cerveau lui occasionnait des pertes de mémoire), Suzanne mettra fin à son aventure amoureuse en se consacrant à sa famille et à son mari, Lorch prendra enfin sa retraite et Cyd s'installera dans la société de consommation. Tout sera « pour le mieux dans le meilleurs des mondes » en quelque sorte. Ou, pour parler plus simplement : beaucoup de bruit pour rien !
Je ne connaissais pas cet auteur. Ce n'est pas avec ce roman, qui sans doute se veut drôle, que je continuerai à le lire.
©Hervé GAUTIER – Janvier 2011.http://hervegautier.e-monsite.com
-
QUITTER LE MONDE – Douglas Kennedy
- Le 18/12/2010
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°485– Décembre 2010.
QUITTER LE MONDE – Douglas Kennedy – Belfond.
Tout commence par une scène de ménage ordinaire entre époux qui ne s'aiment plus et qui choisissent le jour du treizième anniversaire de leur fille unique, Jane Howard, pour se jeter à la figure les griefs qu'ils ont accumulés pendant de longues années de mariage. Pour que l'effet soit complet, l'adolescente déclare à ses parents « qu'elle ne se mariera jamais et qu'elle n'aura jamais d'enfant ». Le lendemain, le père alcoolique notoire, quitte la maison pour ne plus jamais y revenir en laissant une lettre d'explications qui fait allusion à la remarque péremptoire de l'adolescente. Dès lors s'installe entre la mère et la fille une atmosphère de culpabilisation où s'insinue la traditionnelle question que chacun se pose sur son propre destin. En est-on maître ou s'impose-t-il à nous ?
Plus tard, sa mère qui a choisi elle-aussi l'alcool pour mourir à petit feu, accepte la mort comme une délivrance tout en rappelant à sa fille devenue une femme ses paroles d'adolescente. Pourtant, Jane a une vie normale, bousculée seulement par des aventures mal vécues et une relation adultérine interrompue par la mort de l'amant. Après un séjour rapide dans un fonds de pension ou elle connaît la vie trépidante d'un trader, elle prend un poste dans une université de Nouvelle Angleterre, devint mère d'une petite fille et s'aperçoit que son compagnon, dont elle se sépare, la trompe et l'escroque. Elle apprend que son père qui ne s'était guère occupé d'elle a été non seulement un aigrefin mais aussi un collaborateur du régime chilien de Pinochet et prend conscience, à la mort de sa mère que celle-ci ne l'a jamais aimée. Seule sa fille est une source de joie pour elle alors qu'elle se rend compte que tout autour d'elle l'abandonne. C'est pourtant cette même Jane qui avait juré ne pas vouloir d'enfant !
On ne dit pas assez que la mort fait partie de la vie et quand elle frappe ceux qui nous sont chers et plus spécialement nos enfants cela devient insupportable. Comme si sa vie n'avait pas été un assez long chemin de croix, comme si le destin devait s'acharner sur ceux qu'il a choisis, Jane croise encore une fois le malheur et sa fille périt dans un accident. Face à cela, la vie de Jane s'arrête, il ne peut d'ailleurs en être autrement et le tentation est grande de « quitter ce monde » où elle n'a décidément plus rien à faire. Après une telle épreuve, rien ne peut plus être comme avant. Cela commence par la volonté de se marginaliser elle-même simplement parce qu'à partir de ce moment-là, elle n'est plus comme les autres gens. Ils ne peuvent rien pour elle et souvent l'évitent, pour leur confort personnel. Il n'est facile ni de comprendre et à plus forte raison d'aider ces malheureux parents en deuil qui n'admettrons jamais l'absence définitive de leur enfant. Pour eux l'enfer est bien dans ce monde et non dans une hypothétique vie post-mortem. La culpabilisation d'être encore vivant face à ce malheur est une réalité et le contexte judéo-chrétien qui baigne nos sociétés occidentales ne fait que rajouter à l'horreur. Quant au message de la religion, il ne pèse rien face à cette douleur !
Jane se réfugie alors dans les médicaments et l'alcool mais aussi dans la parole toujours difficile à formuler, dans le travail, dans le dépaysement. Cela la protège du monde extérieur, met en évidence la tentation du suicide momentanément écartée parce qu'impossible, cette incompréhensible ressource de l'être humain face à la vie qui pourtant ne pèse plus rien. « Il faut continuer, je ne peux continuer, je vais continuer » dit Samuel Beckett, illustrant toute l'ambiguïté et la complexité de cette situation.
Elle suit alors un parcours un peu cahoteux qui la mène au Canada où elle croise à nouveau la mort et l'injustice, mais dans le cadre d'une intrigue policière où elle joue un rôle primordial mais qu'elle souhaite anonyme (ce détail prend une importance capitale), de découverte du coupable. Bizarrement, cela commence par par une intuition féminine qui va à l'encontre des certitudes des enquêteurs et de la vindicte publique mais agit comme un véritable miroir de sa propre souffrance. Elle se jette seule, avec une énergie longtemps refoulée par son deuil, dans des investigations qui vont mettre à mal sa réputation et vont menacer sa vie. Finalement son action solitaire et un peu désespérée fera éclater la vérité et bousculer pas mal d'idées reçues sur la religion et ses ministres ! C'est en réalité un combat pour la vie qui reprend le dessus et avec lui une acceptation des malheurs qu'elle n'as pas souhaités et qui ont peuplé son parcours,. Elle doit y faire face et les assumer parce que cela est sa destinée et qu'elle ne peut rien faire contre elle. Elle restera pourtant définitivement différente des autres, imperméable au bonheur humain !
Malgré des longueurs, Douglas Kennedy se révèle être un excellent illustrateur de la condition humaine dans ce qu'elle a de plus intimement sordide. Il parle avec justesse des rapports qui existent entre les gens, à l'intérieur même d'une famille, la confiance qu'on peut faire aux autres et les mensonges, les trahisons qu'ils peuvent nous faire subir, de l'hypocrisie qui règne en ce monde, des épreuves et des deuils qui pourrissent la vie de certains d'entre eux, choisis arbitrairement par le destin ou le hasard.
Il est aussi un bon critique des idées reçues qui sont souvent opportunément entretenues, même si les valeurs de charité et d'amitié, de solidarité si volontiers proclamées, en sortent quelque peu écornées.
Kennedy poursuit dans ce roman sa quête du bonheur impossible. Finalement Jane semble choisir de demeurer dans ce monde qu'elle souhaitait quitter mais en restera en marge parce que c'est sa façon de s'en protéger.
©Hervé GAUTIER – Décembre 2010.http://hervegautier.e-monsite.com
-
L'HOMME QUI VOULAIT VIVRE SA VIE – Douglas KENNEDY
- Le 09/12/2010
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°481– Décembre 2010.
L'HOMME QUI VOULAIT VIVRE SA VIE – Douglas KENNEDY- Éditions Belfond.
Le moins que l'on puisse dire est que Ben Bradford, la trentaine, a réussi, à tout le moins au sens social du terme. Pour faire plaisir à son père, il est devenu avocat d'affaires, travaille dans un prestigieux cabinet de Wall Street. Marié à Beth, une jolie femme, quoiqu'un peu superficielle, deux enfants, il vit fort confortablement dans une banlieue riche de New-York. Cela devrait suffire à sa vie puisqu'il a tout pour être heureux, comme on dit, mais en apparence seulement ! Il se trouve qu'il n'aime pas le rythme routinier de son existence. D'ailleurs Beth elle-même n'y met pas beaucoup du sien et les hurlements de Josh, leur petit-dernier, n'arrangent rien. Quant aux exigences d'Adam, l'aîné, ce n'est guère mieux. Le thème de l'insatisfaction peut paraître banal chez un être à qui la vie semble avoir tout donné, pourtant, ce qu'il aurait voulu, c'est être photographe. C'est un rêve de jeunesse qu'il n'a jamais vraiment abandonné autant qu'un défi lancé par sa petite-amie d'alors, Kate Bryner, devenue correspondante de guerre à CNN. Cela se complique un peu quand il constate que tout s'y met pour lui pourrir la vie, les absences répétées et sans raison de son épouse... et sa froideur récente au lit qu'il ne peut raisonnablement pas mettre sur le seul compte de la dépression post-natale. Elle a bien changé ces derniers temps, est devenue distante, presque étrangère. Des disputes éclatent entre les deux époux à propos de rien de sorte qu'il parvient rapidement à détester sa propre maison... et ses habitants ! Et pourtant, il aime sa femme; l'usure du couple est aussi un sujet éculé jusqu'à la trame. Pour que le tableau soit complet, il découvre qu'elle le trompe avec un moins que rien, un minable, un inconnu qui ne lui arrive même pas à la cheville, un photographe-amateur un peu mythomane du nom de Garry Summers. La certitude de s'être trompé avant de l'avoir été prend possession de lui.
La trahison, le mensonge, l'adultère débouchent nécessairement sur un divorce annoncé, la perte de tout ce qui faisait sa vie. Non seulement Beth se révèle sous son vrai jour mais surtout, pour Ben, cela va correspondre à la séparation d'avec ses enfants qu'il ne peut se résoudre à admettre. Face à cela, le désespoir se dessine et avec lui le suicide comme une solution...
C'est pourtant mal connaître notre avocat, qui est avant tout un être intelligent et organisé et qui, pour avoir été ainsi bafoué et humilié, choisit de se débarrasser définitivement de l'amant de sa femme. Il met au point un scénario qui ressemble au manuel du parfait petit assassin ou, si l'on préfère, au mythique « crime parfait » !
Il convient donc de mettre à profit cette opportunité pour « vivre enfin sa vie », organiser sa propre disparition pour mieux réapparaître ailleurs, sous une autre identité, pour une autre existence plus conforme à ses désirs, avec un niveau de vie plus modeste, bref devenir Garry Summers ! C'est le début d'une course anonyme, d'autant plus effrénée qu'elle ne mène nulle part si ce n'est vers ce qu'il a toujours rêvé : devenir photographe. Le hasard sert ses projets un peu malgré lui, dans le Montana où il rencontre la notoriété et l'amour, avec en toile de fond le mensonge, la supercherie, puisqu'il est désormais célèbre, mais sous un faux nom !
Je ne dévoilerai pas l'épilogue, mais ce roman, tissé de mort, de vie et de renaissance, de rebondissements inattendus, de notoriété, de succès et d'oubli, m'a conquis par le réalisme de ses descriptions (notamment l'incendie) autant que par la pertinence de ses remarques sur le système, sur la réussite, sur la condition humaine autant que la précision de son scénario et un grand souci du détail.
J'observe que les personnages de Kennedy, même les plus secondaires, ont plus ou moins subi l'échec du mariage ou côtoyé la mort. C'est certes un roman policer plein de suspense, mais que le lecteur passionné finit par oublier au profit d'une authentique et émouvante histoire d'amour, la victoire de la vie.
Alors, problème de recherche de sa propre identité, interrogations sur le sens de la vie, sur la fuite en avant, sur le refus de voir les choses ? C'est aussi une réflexion sur la renommée éphémère et son cortège inévitable d'argent, de reconnaissance et d'oubli, sur la peur de la réussite et l'angoisse de la perte, sur la fragilité des choses humaines ou l'invitation à se méfier de l'inconstance des femmes que la présence d'un conjoint et d'enfants ne dissuade pas de l'adultère ? Pourquoi pas ? « Ça te conduit à penser que tout est fragile, que tout n'a qu'un temps. Tu finis par douter du bonheur, douter que ça puisse exister. Et chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de bien dans ta vie, tu sais que ça ne restera pas, qu'on va te le reprendre à un moment ou à un autre... »
J'ai bien aimé le style délié, parfois jubilatoire, l'humour et le rythme de ce roman. Au début, l'auteur réussit à faire sourire le lecteur avec une situation matrimoniale certes classique, mais qui n'amuse que lorsqu'elle arrive aux autres, sur une scène de théâtre de boulevard ou au cinéma. En prime nous avons aussi un résumé de « l'American way of Life » qui, malgré son côté futile et sa consommation effrénée de whisky et de médicaments, deviendrait presque sympathique. Je ne parle pas des procédures de licenciements brutales et inhumaines dont l'Europe s'est malheureusement inspirée. Puis vient l'invitation à réfléchir...
Tout cela donne un roman passionnant, agréable à lire où l'auteur tient en haleine son lecteur jusqu'à la fin.
©Hervé GAUTIER – Décembre 2010.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA PESTE ÉCARLATE et autres nouvelles – Jack London
- Le 06/11/2010
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°472– Novembre 2010.
LA PESTE ÉCARLATE et autres nouvelles – Jack London - Phébus Libretto.
Le seul nom de Jack London évoque l'aventure, la nature, la liberté.
Dans la première nouvelle, qui est plutôt un court roman et qui donne son nom au recueil, un vieillard qui fut jadis professeur évoque pour ses petits-enfants sauvages et illettrés ce qu'était, soixante ans plus tôt la vie en 2013, date de l'apparition de la peste écarlate, ainsi nommée parce qu'elle colore le visage en rouge. Elle décima la population de la terre et réduisit les humains pourtant civilisés et cultivés, à l'état d'êtres égoïstes, défendant le seul bien qui leur reste : leur vie ! Nous sommes donc en 2073 et l'ex-professeur Smith raconte ce qu'était la société civilisée et organisée et comment, épargné par la pandémie, il a survécu dans ce monde hostile redevenu sauvage où les opprimés d'alors ont réussi à s'affirmer grâce à leur brutalité et à prendre le pas sur leurs oppresseurs d'avant. Ses petits-enfants ne peuvent se figurer ce qu'il décrit pour eux mais il place son espoir dans les livres et la clé de lecture qui permet de les déchiffrer. Il a caché le tout dans une grotte et espère que l'espèce humaine retrouvera, grâce à cela, sa splendeur passée.
La seconde nouvelle, intitulée « Le dieu rouge » évoque la croyance d'une tribu sauvage en un dieu extraterrestre matérialisé par une sphère rouge qui émet un son. Un blanc, perdu dans la forêt, tente de percer ce mystère qui ne peut s'expliquer qu'au prix de la vie.
La troisième intitulée « Qui croit aux fantômes ?» met en scène deux rationalistes qui se sont donnés rendez-vous dans une maison hantée. Ils vont se trouver « possédés » par deux fantômes qui reviennent pour disputer une partie d'échecs dont leur vie dépendra.
« Mille morts » parle d'un fils de famille parti sur les mers et récupéré par un navire commandé par son père. Ce dernier va se servir de ce fils pour mener à bien des expériences où la mort est suivie de résurrections successives. Mais le fils ne saurait, jusqu'au bout être son cobaye.
L'auteur change de registre avec« la seconde jeunesse du major Rathbone » où il analyse, sur le mode humoristique, les conséquences des tentatives de rajeunissement du corps et de l'esprit d'un vieillard. Il faudra quand même compter avec Déborah, son ancien amour de jeunesse qui, elle aussi, bénéficia de cette expérience.
L'architecture d'un recueil de nouvelles n'est pas chose facile. Avec celui-ci, paru en 1912, Jack London (1876-1916) passe du registre tragique à l'humour, au moins en apparences. Avec la première nouvelle, publiée peu de temps avant sa mort, il semble nous avertir d'une possible fin du monde, provoquée par la maladie. Songeait-il à la Grande Guerre qui allait bouleverser le monde? Peut-être? Encore qu'il nous confie que les survivants restent capables de le reconstruire au moyen des livres refaire et de la connaissance que le Professeur Smith a sauvegardés. Il explore ici un registre plus mystérieux voire apocalyptique, jouant à la fois sur le fantasme de la fin du monde, de la mort, de l'éventuelle résurrection, l'anéantissement de la vie et la responsabilité humaine dans ce cataclysme ?
Avec la se seconde nouvelle, c'est clairement l'angoisse de la mort et une certaine désespérance qui transparaissent ici. La couleur rouge rappelle celle de la peste du premier texte et les mots évoquent une certaine perfection des formes et des sons, comme quelque chose qu'on découvre enfin après l'avoir tant recherché. Ce qui est ici suggéré c'est à la fois l'attrait de l'inconnu et la fascination et l'acception de la mort, une sorte de sérénité devant elle, le terme du parcours qui fut le sien durant sa vie et que l'écriture magnifia. Même la présence de Balatta n'y fera rien. Il la repoussera faisant prévaloir Thanatos sur Eros. Rappelons-nous que ce texte a été écrit quelques mois avant sa disparition.
Avec les deux autres textes, il semble présenter les choses sous un angle différent, peut-être plus léger? Voire. Celui où il évoque la présence de fantômes et qu'il écrivit à dix-neuf ans, doit sans doute beaucoup à Edgar Poe dont il fut le lecteur attentif. C'est la fascination de l'étrange qui habite la condition humaine avec son cortège de névroses, de perversions, de dérèglements... la mère de l'auteur était une spirite convaincue et celui qui fut son père et qui les abandonna tous les deux, versait lui aussi dans l'ésotérisme. Voulut-il régler ainsi, par l'écriture et l'imaginaire, ses comptes personnels avec eux? Quand il choisit le thème des expériences sur l'humain, sur le vivant, on songe à un médecin fou mais le registre ici est le fantastique. Derrière des considérations techniques difficiles à suivre, il évoque des expériences un peu déjantées qui procurent la mort mais aussi qui redonnent la vie. C'est certes de la pure fiction, mais c'est aussi une autre forme de réflexion sur la mort. N'oublions pas que Jack London est avant tout un athée, lecteur de Marx et que donc l'idée de Dieu est absente de ces textes.
On peut aussi y voir une forme de victoire de l'homme sur les événements qui pèsent sur sa vie, le triomphe du pessimisme, du défaitisme. Au dernier moment il réagit et fait prévaloir sa liberté. Le héros de « Mille morts » s'échappe, le vieux major redevenu jeune convole avec son amour de jeunesse,
Avec ce recueil, Jack London qui fut un auteur prolifique de plus de 50 livres qui, pour la plupart évoquent l'aventure explore ici un registre différent. Encore une fois, sa vie personnelle ses expérience ont nourri son écriture, mais celle-ci a joué pour lui un rôle d'exorcisme, mais c'est aussi le sien!
©Hervé GAUTIER – Novembre 2010.http://hervegautier.e-monsite.com
-
L'ÉTÉ OÙ IL FAILLIT MOURIR– Jim Harrison
- Le 11/09/2010
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°452 - Septembre 2010
L'ÉTÉ OÙ IL FAILLIT MOURIR– Jim Harrison - Éditions Christian Bourgois.
Ce sont de nouveau trois longues nouvelles que nous propose ici Jim Harrison.
La première qui donne son titre au recueil met en scène « Chien Brun », un métis indien pas très intéressant, un peu marginal, menteur, buveur, obsédé par le sexe et qui se croit irrésistible. A la suite d'ennuis judiciaires, il a été contraint à un mariage un peu surréaliste qui ont fait de lui le père adoptif de deux enfants, Red et Baie, une petite fille originale qu'il tente de sauver de l'action des services sociaux qui veulent l'éloigner en la qualifiant d'handicapée mentale. Elle a en effet subi le traumatisme d'une mère qui a continué de boire pendant sa grossesse. Maintenant il travaille, mais par intermittence, cuisine, mais sa spécialité l'amène à confectionner des plats pas très ragoûtants. Il n'a cependant rien abandonné de son goût pour la pêche, l'alcool et les femmes. La nouvelle s'ouvre sur une rage de dents qui sera l'occasion d'une passade avec la dentiste qui le soigne et qui est comme lui obsédée sexuelle. Elle nous narre également ses aventures et son amour pour une assistante sociale lesbienne, la persistance de la pêche à la truite et une sorte d'obsessionnelle présence, par intermittence, d'un petit serpent noir et de la cueillette des morilles!
La seconde intitulée « Épouses républicaines », l'auteur met en scène trois femmes américaines riches, mariées et oisives dont l'une d'elles a tenté de tuer son amant, un écrivain gauchiste suffisant et inintéressant qui a été également l'amant des deux autres. Elle parlent à tour de rôle de cette histoire...A-t-il voulu dénoncer le vide de la vies de ces trois femmes ou le dégoût qu'il ressent pour cette Amérique des années 50 et 60 qu'il rejette?
La troisième, intitulée « Traces » a des accents autobiographiques d'une enfance dominée par la chasse et la pêche dans le pays qui a servi de cadre à son enfance.
Ces trois nouvelles ont pour cadre la péninsule du Nord Michigan dont l'auteur est originaire, une nature que Harisson célèbre avec plaisir, les plaisirs de la vie, les femmes et la bonne bouffe. Il y met en scène ses obsessions, notamment sexuelles mais aussi son penchant pour l'alcool. Pourtant, je suis plus particulièrement attentif aux personnages, Gretchen, travailleuse sociale et homosexuelle, Delmore, oncle possible des enfants, avare impénitent, Baie qui communique volontiers avec les oiseaux. Ce côté anti-héros me plait bien...Cependant les trois femmes américaines me laissent un peu indifférent, quant à « Traces », je trouve cela sans grand intérêt si ce n'est d'apprendre des détails biographiques sur l'auteur.
J'avais apprécié « Légendes d'automne » (La Feuille Volante n° 451) mais ici j'avoue que j'ai eu un peu de mal à accrocher avec ces trois nouvelles. Pourtant cet auteur passe pourtant pour un écrivain majeur!
© Hervé GAUTIER – Septembre.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LÉGENDES D'AUTOMNE-Jim Harrison
- Le 06/09/2010
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
LÉGENDES D'AUTOMNE– Jim Harrison - Éditions Robert Laffont.
Ce sont trois longues nouvelles que nous livre ici Harrison( même si la préface de Serge Lentz qui est aussi le traducteur préfère le terme de roman).
Dans la première, intitulée « vengeance », c'est une histoire d'amour qui nous est contée, celle de deux hommes qui sont à la fois amis et amoureux d'une même femme. L'un d'eux Cochran est ancien pilote de chasse ayant combattu dans la Navy, l'autre, Mendez, dit Tibey, est un ancien souteneur. Ils vont donc se battre pour l'amour de Miryea, la femme de Tibey dont Cochran va tomber éperdument amoureux et qui partira avec lui. Le début s'ouvre sur son corps abandonné en plein désert autour duquel tournent déjà chacals et vautours. Ce combat qui est aussi une course-poursuite ne va pas se dérouler seulement entre ces deux hommes, mais aussi contre cette femme, véritable enjeu de ce conflit qui ne peut que mal se terminer.
Le décor est celui du Mexique avec tout ce qu'on attend de ces paysages écrasés de chaleur, l'alcool, les bordels, les meurtres, cette chanson de Guadalajara que Miryea aimait tant mais aussi et surtout la vengeance qui broie chacun de ces trois personnages, cette femme d'abord mais surtout ces deux anciens amants qui sont comme réunis autour d'un cadavre sans qu'aucun d'eux puisse reprendre le cours normal de leur vie.
La deuxième nouvelle « L'homme qui abandonna son nom » entraine le lecteur dans un tout autre contexte, celui plus conventionnel d'une famille établie et aisée. Le père a épousé la collégienne qui, adolescent le faisait rêver, mais, après 18 années de mariage, une vie sentimentale qui est devenue une routine et la naissance d'un enfant, le couple décide de se séparer. L'homme veut changer radicalement de vie et découvre que même celle-ci ressemble à une longue léthargie.
C'est, et de loin, le récit que j'ai préféré.
La troisième qui donne son titre au recueil met en scène trois frères du Montana qui partent, au début du XX° siècle, faire la guerre en Europe. L'un deux, Samuel, ne reviendra pas et sa disparition provoque l'effondrement de la famille. Tristan, bouleversé par cette disparition, entame un voyage épique qui le mènera autour du monde. Dans ce récit, écrit par moments en termes poétiques, se mêleront mysticisme, meurtres et une incroyable aventure humaine où la vengeance, le doute et la rédemption ont aussi leur place.
Le point commun de ces trois nouvelles est la violence sous quelque forme qu'elle se présente, qui fait partie de la condition humaine. Elle est une nécessité vitale, se joue des frontières et des époques mais elle est également maudite comme le souligne la préface et n'est en rien gommée par la civilisation dont l'homme aime à se parer. Ce qui nous est montré ici est une évidence, la civilisation n'est qu'un mot, un vernis, une apparence dont les hommes se satisfont et parfois se recommandent pour justifier leurs actions les plus inavouables, leurs compromissions les moins acceptables. Les grandes et généreuses idées savamment distillées et qui flattent sont chaque jour occultées et remises en cause par la réalité quotidienne. C'est donc à une prise de conscience urgente que nous invite cet auteur américain.
le style est simple, précis, dépouillé même, poétique parfois mais assurément terrifiant. Il livre au lecteur, une image de l'homme bien éloignée des grands discours humanistes. Les personnages de Harrison sont humains, pas généreux et humanistes, mais sont l'incarnation de l'homme avec ses pulsions, ses grandeurs comme ses bassesses.
Comme l'indique Yann Quefellec « Les romans d'Harrison font entrevoir en chacun d'entre nous l'ombre portée du criminel, du tricheur et du saint. Au surplus, le style est à lui seul un chef-d'œuvre, une leçon pour les auteurs français, plus habiles à sodomiser les mouches de la ponctuation, à sacraliser les arguties qu'à livrer une inspiration urgente. Jim Harisson est un écrivain passionné, donc il nous passionne !».
© Hervé GAUTIER – Septembre.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA BÊTE QUI MEURT - Philip Roth
- Le 06/06/2010
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°432– Juin 2010
LA BÊTE QUI MEURT – Philip Roth - Gallimard.
David Kepesh, 62 ans, professeur d'université, critique littéraire à la radio et à la télévision mais aussi séducteur impénitent va tomber amoureux d'une de ses étudiantes, Consuela Castillo, une jeune femme de 24 ans d'origine cubaine. D'évidence, ils n'appartiennent pas au même monde. Cette situation, sans être originale n'a rien d'exceptionnel, sauf que cet homme vieillissant va transformer, malgré lui sans doute et à cause de son âge, cette passion en véritable culte à la beauté, à la jeunesse, à la grâce féminine. Au début, leurs relations ont quelque chose de culturel et Consuela n'est pas exactement une étudiante comme les autres, ni d'ailleurs une femme puisqu'elle incarne pour lui la beauté par excellence. Lui qui a connu moult femmes et aussi la révolution sexuelle des années 60 aux USA, est en admiration béate devant ses seins. Là où cela devient du délire c'est lorsqu'il va jusqu'à se prosterner devant elle, contempler et même déguster son flux menstruel...
Bien entendu, malgré le fait qu'il ne soit jamais attaché à la moindre conquête féminine, il va connaître les affres de la jalousie et la peur de la perte, de la séparation qui pourtant va intervenir. Huit ans plus tard, après que les deux amants se furent perdus de vue, c'est à nouveau Consuela qui fait irruption dans sa vie, mais pas dans le même registre! Si elle est encore la belle jeune femme qu'il a connue et follement aimée, elle porte en elle désormais et dans ce qu'il a plus apprécié chez elle, la souffrance et la mort!
Ce bouleversement survenu dans la vie de David va provoquer la confidence, un long monologue (tout le récit se décline sur ce ton, il a alors soixante dix ans et parle avec nostalgie de cette femme à un témoin dont nous ne connaîtrons même pas le nom) où le vieil homme se livre sans fard, avec parfois des détails crus, dérangeants même (épisode des règles par exemple, mais pas seulement). Parfois aussi, il se laisse aller à des développements que son expérience lui inspire, sur l'adultère par exemple, ce qui n'est franchement pas le plus intéressant!
L'auteur qui prend volontiers et comme toujours la place de son personnage reprend ses thèmes favoris, la vieillesse, la maladie, la mort, la fuite du temps, les années qu'on ne rattrape pas, l'homme qui, parvenu à la fin de sa vie, va faire le grand saut dans le néant, inexorable, inévitable pour chacun d'entre nous. Il n'oublie cependant pas la femme, peut-être la seule consolation de l'homme dans ce monde où tout est perdu d'avance. Consuela qu'il évoque en poses érotiques et même pornographiques est pour lui, en quelque sorte une ultime conquête qu'il n'oubliera cependant pas malgré le temps, la séparation, la souffrance... Chez lui c'est un peu Éros qui danse avec Thanatos. D'ailleurs est-ce une danse ou un combat?
Je connais mal l'univers de l'auteur, mais cela pourrait passer pour quelque chose de monothématique, à tendance obsessionnelle même, mais au fond, non. Il y a le sexe qui est omniprésent dans ce livre, c'est incontestable (avoir une obsession pour la beauté des femmes me paraît être plutôt un bon signe et il me semble que l'auteur se pose ici en contradiction avec le puritanisme américain et anglo-saxon en général), mais cela me paraît surtout être une méditation de bon aloi sur la condition humaine dans tout ce qu'elle a de plus transitoire. L'auteur va analyser, disséquer même l'univers sensuel des femmes, ce que leur beauté, leur corps, leur jeunesse suscitent chez un homme vieillissant, l'émotion, l'attachement, l'attirance, le désir, les subtils rapports de domination, de soumission, de séduction et de capitulation...
Je pense que je vais continuer à explorer le monde de cet auteur qui nous donne à voir une image de cette condition humaine que nous partageons tous.
© Hervé GAUTIER – Juin 2010.http://hervegautier.e-monsite.com
.
-
UN HOMME- Philip Roth
- Le 06/06/2010
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°430– Juin 2010
UN HOMME- Philip Roth – Gallimard.
L'histoire commence dans un petit cimetière juif un peu délabré où un homme va être enterré. Cette petite cérémonie réunit sa fille, née d'un second mariage qui l'adore et qui prononce quelques mots sur sa tombe, mais aussi deux fils, nés d'une première union houleuse, qui le méprisent parce qu'il a abandonné leur mère, son frère aîné, une infirmière qui s'était occupé de lui avant son décès et quelques collègues... Cet enterrement n'a cependant rien d'exceptionnel, juste quelques poignées de terre jetées sur le cercueil, quelques paroles puisées dans le chagrin et le souvenir mais aussi des marques d'indifférence, de soulagement, de rancœur même...
Par une classique analepse, l'auteur va retracer la vie de cet homme, dont nous ne connaîtrons pas le nom. Enfant de santé fragile, il avait été l'objet des soins attentifs de ses parents. Il est devenu un homme torturé par des affections cardio-vasculaires mais il envie et même déteste ce frère aîné, à cause de sa bonne santé... Il ne reprit pas la profession de son père, bijoutier juif, mais devint un publicitaire célèbre puis s'est mis à la peinture pendant ces années de retraite. Ses trois mariages se soldèrent par autant de divorces entrecoupés de quelques liaisons amoureuses ...
C'est une vie banale qui nous est ainsi livrée par le narrateur comme s'il nous prenait à témoin, celle d'un homme ordinaire, pleine de poncifs, de désillusions, de frustrations, avec son lot de joies, d'épreuves, d'amours et de rêves brisés, d'erreurs, de prises de conscience que les choses changent, que le temps perdu ne se rattrape pas... Lui qui fut un amant ardent, il connaît maintenant la perte du désir, l'impossibilité de séduire ..., Roth reprend devant nous, à l'occasion de cette histoire, tous les truismes habituels loin des préoccupations intellectuelles et philosophiques, avec la hantise ordinaire à tout humain, celle de la vieillesse, de la solitude, de la mort. Cet homme n'attend rien d'un hypothétique autre monde ou d'une vie éternelle, les choses s'arrêtent avec celle-ci, et tant pis si toute cette agitation n'a servi à rien et ne débouche que sur le néant.
Sa vie n'aura donc été qu'un vaste gâchis qu'il a lui-même tressé, remettant en cause ce qu'il avait pourtant patiemment construit. Dans notre société, il est sûrement une sorte de parangon, lui dont la réussite professionnelle a été avérée, dont la vie familiale a été un savant mélange d'adultères, de mensonges, d'hypocrisies et de complicités malsaines et même coupables, d'humiliations imposées aux siens, comme si son existence ne se résumait qu'à une recherche effrénée de la jouissance sexuelle, du plaisir animal à tout prix, dût-il lui sacrifier la stabilité de sa famille, sa respectabilité, la vie et l'amour de ses enfants... Après tout il doit être comme un homme, cet être qui est en permanence habité par la folie de tout détruire autour de lui pour un peu de ce plaisir quêté dans une rencontre avec une inconnue!
Face à ces renoncements successifs, il lui reste la peinture que pratique comme une sorte d'exorcisme ce Don Juan insatiable, toujours à la recherche de femmes qui lui procureront du plaisir, mais qui, à présent, ne peut plus que les suivre du regard en fantasmant sur leur corps, en espérant qu'elles lui feront l'aumône d'une étreinte. Quant au maniement du pinceau, cet exercice artistique devient lassant et il n'en retire plus rien...
C'est un récit un peu mélancolique, un rien désabusé, un peu tragique aussi si on estime que vivre de la naissance à la mort en acceptant de n'être plus ce qu'on a été, est aussi participer à une sorte de tragédie. C'est assurément dramatique aussi d'accepter sans peur la réalité de la mort, cet inévitable saut dans le néant, parce que, quand on a goûté à la vie, on ne peut la quitter sans regret ni terreur.
Le titre anglais (evryman : n'importe quel homme) résume assez bien le but de l'auteur; il s'agit de la vie de chacun d'entre nous qui est esquissée ici. Ce n'est donc pas exactement une fiction, mais la copie plus ou moins conforme dans sa diversité du parcours de chacun d'entre nous sur cette terre.
Le style est dépouillé et atteint son but, celui de nous donner à voir « cet homme » sans nom, (et cela doit aussi valoir pour les femmes?), un véritable quidam, un être ordinaire dont on nous raconte la vie également ordinaire, celui de nous faire partager, avec cet art consommé du conteur, son passage sur terre plein de fougue mais finalement aussi plein de désillusions et de bassesses.
Une véritable image de la condition humaine!
Hervé GAUTIER – Juin 2010.http://hervegautier.e-monsite.com
-
SEUL DANS LE NOIR - Paul AUSTER
- Le 25/10/2009
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°374– Octobre 2009
SEUL DANS LE NOIR – Paul AUSTER- Actes Sud.
Le cadre tout d'abord: August Brill, soixante douze ans, veuf, critique littéraire à la retraite, immobilisé par un accident de voiture, vit dans le Vermont chez sa fille, Miriam qui ne peut se libérer de la blessure que lui a infligé son divorce même si cela fait cinq ans que ce mariage a été dissout. Elle a recueilli sa fille, Katya, anéantie elle aussi par la mort de Titus qu'elle avait quitté et qui a perdu la vie dans des circonstances atroces en Irak. Elle est rongée par la culpabilité et s'accuse de cette mort absurde qui, à ses yeux, est motivée par leur séparation. Ce sont donc trois membres d'une même parentèle que la vie a meurtri et qui sont enfermés dans le microcosme de cette maison, chacun avec ses remords.
Une nuit, pour échapper a ce quotidien autant qu'à ses souvenirs, Brill se réfugie dans l'imaginaire pour meubler ses insomnies. Dans ce monde, le 11 septembre n'a jamais eu lieu, la guerre en Irak n'existe pas mais les États-Unis sont en proie à une seconde guerre civile, et lui change de peau et d'identité, devient Owen Brick, le héros un peu irréel d'une histoire qui ne l'est pas moins et qui doit tuer l'instigateur de ce conflit. Dès lors, il craint pour sa vie et il devient lui-même l'enjeu de ce « contrat ».
Petit à petit, au fil de la nuit, imagination et réalité viennent à se confondre et l'auteur mêle à son parcours imaginaire le sien propre et celui de ses proches, pratiquant, peut-être à l'excès les mises en abyme, s'inventant des passades amoureuses dont il n'aurait pas été capable dans la vraie vie. Il émet des considérations personnelles sur les livres, sur les films mais aussi sur la bonté et l'éducation comme pour questionner l'individu au regard de sa propre responsabilité.
Puis August Brill met fin unilatéralement et brutalement à cette histoire de monde parallèle pour déboucher, à la fin, sur un dialogue intime entre le grand-père et la petite fille qui est un peu frustrant pour le lecteur.
J'avoue que lorsque j'ai entamé la lecture de ce livre, j'étais plus intéressé par la puissance imaginative de l'écrivain, par cette faculté qu'il a, plus que tout autre sans doute, d'imaginer les choses et de s'identifier personnellement à elles, par les frontières qui existent entre l'imaginaire et le réel et par les ponts qui enjambent ces deux mondes, le pouvoir des mots, le talent narratif et évocateur de l'auteur. Il s'ensuit la création d'entités qui s'interpénètrent, des engrenages qui s'entrainent entre eux et broient. C'est là une quête dont les arcanes me passionnent que j'ai plaisir, parfois, à explorer pour moi-même, à entrer, virtuellement bien sûr, dans cette spirale où la pataphysique a sa place. Le parcours des autres sur ce thème m'intéresse aussi, ne serait-ce que pour éprouver si ce que je fais est digne d'intérêt. C'est aussi le mécanisme de la création artistique qui est étudié ici et son pouvoir sur les vicissitudes quotidiennes du monde.
Pourtant, cet univers m'a paru inquiétant et comme à chaque fois que j'aborde un roman de Paul Auster, j'ai eu beaucoup de mal à entrer dans son écriture.
©Hervé GAUTIER – Octobre 2009.http://hervegautier.e-monsite.com
-
JEUX DE MAUX - David Lodge [traduit de l'anglais par Michel Courtois-Fourcy] - Rivages.
- Le 31/03/2009
- Dans Littérature anglo-américaine
- 0 commentaire
N°330– Mars 2009
JEUX DE MAUX – David Lodge [traduit de l'anglais par Michel Courtois-Fourcy] - Rivages.
L'actualité de l'Église brésilienne avec ses excommunications aussi anachroniques que révoltantes, l'attitude d'un Pape, ancien Grand Inquisiteur, oublieux du message de l'Évangile dont il est pourtant porteur, et qui soulève un tollé de protestations jusque dans les rangs de la hiérarchie épiscopale française, défraient actuellement la chronique. Nous vivons vraiment une époque formidable! Le hasard fait que j'ouvre le roman de David Lodge, qu'il monopolise mon attention et que je le lis avec avec plaisir, avec gourmandise même. Non, ce livre écrit en 1980 n'a pas vieilli, bien au contraire!
Voilà un ouvrage qui parle, avec un humour de bon aloi, d'une « religion », le catholicisme, qu'on nous a fait passer pour la seule possible, parce que la seule vraie et incontournable en occident, mais qui a assurément provoqué, au moins chez les jeunes gens des années 50, fantasmes, terreurs intimes, renoncements, scrupules et sacrifices en tous genres qu' adultes ils ont largement eu le temps de regretter. Il parle de l'hypocrisie, des tabous qu'elle a engendrés, des culpabilisations qu'elle a entretenues dans les jeunes esprits autour de la masturbation féminine et masculine, de la virginité et de la manière de s'en débarrasser, de la jouissance sexuelle et de la découverte du plaisir qui étaient forcément bannis, mais aussi de la nature de Dieu, au passage un peu écornée, de la confession, de la transsubstantiation, de la communion, la peur de l'enfer [et de la dépression nerveuse qui pouvait aller avec], bref de l'Église, de ses rituels et de ses pompes largement entretenus par des générations de parents et une hiérarchie catholique attentive... Autant de thèmes qui ont interrogé, torturé, bouleversé les jeunes d'alors au point que certains d'entre eux [de plus en plus nombreux si j'en crois les statistiques], émettent des doutes sur le message, oublient le chemins des églises... ou se tournent vers d'autres religions!
C'est vrai, j'ai lu ce livre avec plaisir. Il dénonce sur un mode plaisant et parfois badin, mais jamais caricatural, l'impact pesant de l'Église face à l'éveil d'adolescents à la vie et les embûches variés que la hiérarchie catholique a su y mettre au nom de la morale, des bonnes mœurs et surtout de l'organisation figée d' une société puritaine et autoritaire dont elle a toujours été l'alliée intéressée et que les jeunes fidèles, plus contestataires, ont su remettre en question quand ils sont devenus adultes. L'immobilisme dogmatique de l'Église catholique face aux grandes interrogations de l'humanité, de la procréation, du respect de la vie, de la contraception, du plein épanouissement de la sexualité individuelle reste une question d'actualité. Nous le voyons bien actuellement.
A travers plusieurs personnages et leur vie sexuelle et familiale parfois difficile et en tout cas rendue avec force détails parfois amusants, l'auteur règle ses compte avec l'Église catholique, ses dogmes et ses interdits absurdes qui déstabilisent inutilement les individus. Cette atmosphère un peu délétère entretenue par elle au regard du péché, dont on nous rappelle à l'envi qu'il s'agit, en ce qui nous concerne d'un état permanent, n'est peut-être pas autre chose que la peur de l'enfer, la nécessaire obéissance aveugle aux paroles de Pape et leurs inévitables interprétations à la fois variées, hypocrites et partisanes qui nourrissent cet état de choses avec lequel chacun finit, un jour ou l'autre, par prendre ses distances.
L'auteur prend soin de rappeler qu'il nous raconte une histoire, que nous sommes ici dans une fiction, que les personnages ne sont pas réels[bizarrement, il s'adresse directement à son lecteur et prend même congé de lui à la fin], mais le contexte dans lequel il les fait évoluer leur donne une virtualité bien actuelle! Il prend des références historiques citant abondamment l'encyclique « Humanae Vitae » ou le concile Vatican II... Il a cependant soin, et c'est sans doute nécessaire, de nous rappeler que ce n'est pas un roman comique. Dont acte!
La société qui nous est proposée est anglaise, un petit groupe d'étudiants catholiques dont il suit le parcours, mais la transposition est aisée et même bénéfique car si cette église est universelle, comme on nous en a largement rebattu les oreilles, la réaction que peut faire naître son enseignement et son exemple ne l'est pas moins.
Finalement l'auteur paraît appeler de ses vœux une église libérale, mais les événements actuels ne semblent pas aller dans ce sens et nous donnent à penser qu'il peut s'armer de patience!
Hervé GAUTIER – Mars 2009.http://hervegautier.e-monsite.com