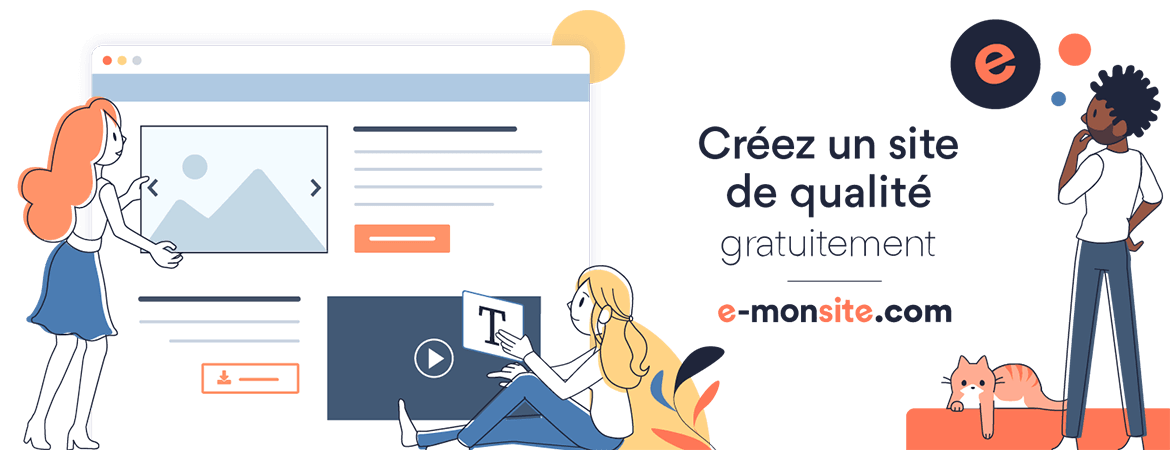Littérature hispanique et ibérique
-
Les trois sœurs qui faisaient danser les exilés – Aurélia Cassigneul-Ojeda
- Le 10/01/2026
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1472 – Juin 2020.
Les trois sœurs qui faisaient danser les exilés – Aurélia Cassigneul-Ojeda – Ateliers Henry Dougier.
Je remercie l’éditeur de m’avoir fait parvenir cet ouvrage.
Quand on achète une vieille maison, on acquiert aussi un peu de son histoire, de celle des gens qui l’ont habitée, surtout si on y découvre de vielles photos, des souvenirs cachés, de vieux cahiers, autant de jalons, de bribes de souvenirs laissés par les anciens occupants. C’est ce qui arrive à Gabriele, la quarantaine, fraîchement divorcé, fils de pauvres immigrés italiens des Pouilles, qui vient de faire l’acquisition, un peu par hasard d’une vieille bâtisse où il vit seul, à Cerbère, cette ville coincée entre la mer et la montagne, à la frontière espagnole. On appelle cette maison rose « La maison des Fleurs » parce ses dernières habitantes, trois sœurs espagnoles bien différentes les unes des autres, parties depuis longtemps, s’appelaient Bégonia, Rosa et Flora et y vivaient avec leur père Diego Sevilla, un artiste peintre. Après leur défaite en 1939, les républicains, fuyant à pied le franquisme, y ont été accueillis, une façon pour elles de gommer la culpabilité d’avoir été épargnées par cette guerre fratricide et meurtrière, alors que la France, « pays des droits de l’homme », les recevait si mal. Gabriele retrouve des clichés, des lettres, des carnets, des traces de cette période de la « Retirada », rédigés par Flora, l’aînée, qui témoignent de la détresse, du désespoir de ces pauvres gens qui ont tout abandonné, un peu comme ses parents partis des Pouilles. C’est comme un livre de bord qui témoigne de l’histoire de Clara, d’Alfredo, Eleidora, Raoul, Pedro qui ont passé ici quelques jours, cachés, pour repartir ensuite dans des camps indignes de la France, « les camps de la honte » a-t-on pu dire, avec la misère et la mort ou vers un autre destin d’exilés. Ils ont marqué leur passage dans cette maison et les « Fleurs » en ont gardé la mémoire. Plus tard, après la déclaration de guerre, ce seront des juifs en fuite, les maquisards et la Résistance, malgré les Allemands et l’Occupation, (plus tard des rapatriés d’Algérie s’y retrouveront) et toujours cette chronique en pointillés, entre témoignages, confidences et non-dits. Bien sûr, au cours de cette période troublée, les « Fleurs » ont connu l’amour, la peur, la cruauté, la trahison, le désespoir, la honte, le deuil, la lâcheté, la solitude et finalement ont quitté chacune leur tour cette bâtisse, son histoire, ses fantômes pour un ailleurs… Grace à ces vies qu’il a connues, en quelque sorte, par effraction, Gabriele s’est retrouvé lui-même à travers les carnets de sa mère qu’il n’avait pas pu lire auparavant .
Plus qu’un roman, c’est une évocation de cette période qui a déchiré l’Espagne et qui s’est prolongée par une dictature de quarante années, privant pour longtemps les républicains de leur pays, les contraignant à s’établir ailleurs où ils n’ont été que des étrangers, condamnés plus que les autres à réussir leur vie en oubliant leur langue et leurs racines pour s’intégrer à leur nouvelle patrie. Cette obligation d’exil rejoint, mais dans un autre contexte, celle des parents de Gabriele qui eux aussi ont été des « ritals » à leur arrivée en France, un peu trop vite qualifiée de « pays de la liberté ». Cet ouvrage est d’une brûlante actualité quand les immigrés frappent encore aujourd’hui à nos portes.
C’est une réflexion sur la mémoire, sur la vie de ces trois femmes qui ont vu dans cette maison se dérouler sous leurs yeux une page d’histoire, une réflexion sur la manière dont on mène sa propre vie, à la recherche légitime du bonheur, concept un peu vague construit intimement à coups de certitudes personnelles, de rêves de jeunesse, d’espoirs et d’illusions, qui peut être un rendez-vous manqué sans qu’on n’y puisse rien parce que des événements extérieurs ou simplement les autres sont venus bousculer cette quête et en ont fait une impossibilité définitive, douloureusement frustrante. Flora, l’auteur de ces carnets fait en quelque sorte le bilan de leurs vies aussi contrastées qu’elles ont été différentes et cela consacre l’effet cathartique de l’écriture, des mots écrits qui conservent la mémoire, qu’on ne garde plus pour soi et qu’on confie au fragile support du papier pour exorciser sa souffrance intime.
C’est un témoignage poignant fort bien écrit avec des descriptions poétiques somptueuses. Cela fut pour moi un bon moment de lecture et un réel plaisir. ©Hervé Gautier http:// hervegautier.e-monsite
-
La harpe et l'ombre
- Le 16/11/2025
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°207
Juillet 1999
LA HARPE ET L’OMBRE - Alejo CARPENTIER - Éditions Gallimard.
Je dois bien l’avouer à mon improbable lecteur, tout ce qui concerne la papauté m’intéresse. Je ne sais pas pourquoi, mais c’est ainsi. Le livre d’Alejo Carpentier ne pouvait donc me laisser indifférent.
De quoi s’agit-il donc sinon d’une parcelle de l’histoire qui n’est peut-être pas restée dans la mémoire collective comme un fait majeur. Au tout début du roman est évoquée la personnalité d’un prélat franciscain : Giovani Maria Mastïa qui avait choisi de servir l'Église autant, nous dit-on par déception amoureuse qu’en raison de la pauvreté de sa famille pourtant de haute lignée. Il se fit pourtant remarquer par ses prêches aussi ardents qu’ éloquents mais cela ne pouvait raisonnablement lui laisser espérer une ascension rapide dans la hiérarchie catholique. Il fut cependant désigné pour accompagner un prélat dans une mission apostolique en Argentine et au Chili. Celle-ci ne fut pas couronnée de succès mais il en est revenu avec l’idée que la découverte des Amériques avait été l’événement capital des temps modernes.
Plus tard, devenu pape sous le nom de Pie IX il était toujours possédé par cette idée au point de décider d’ouvrir le procès en béatification, qui est le préalable à la sanctification, de Christophe Colomb!
L’auteur nous propose les portraits croisés de ces deux personnages, le pape et le marin qui finit par convaincre, après moult pérégrinations, Isabelle la Catholique de financer son expédition.. Mais qui était-il donc, ce navigateur, un génie, un aventurier, un imposteur, un mystificateur, un arriviste qui ne reculait devant rien pour parvenir à ses fins? Alejo Carpentier nous restitue ce qu’il imagine être l’ambiance de cette époque, en plaine reconquista mais aussi pendant l’expulsion des juifs d’Espagne. Il fait du génois l’amant de sa royale protectrice qui finit par lui faire confiance autant par exercice de l’autorité que par la volonté de trouver des richesses pour porter contre les Maures la guerre en Afrique.
A partir de documents d’archives l’auteur nous donne à entendre la voix même de Colomb, en quelque sorte la manière dont il aurait lui-même jugé son entreprise et dont il se serait jugé lui-même. Il nous fait partager ses hésitations, ses doutes. Il se révèle menteur quand il promet de trouver de l’or et des épices aux Indes qu’il recherche, cynique quand il envisage de faire le commerce des esclaves à la place des richesses qu’il n’a pas rapportées... Mais tout ce qu’il avait espéré découvrir reste introuvable et le commerce des esclaves est interdit par ordre du roi. Alors il met en avant les âmes des indigènes qu’il faut sauver et c’est le spirituel qui prend le pas sur le temporel qui pourtant était la vraie raison de son expédition.
En fait Christophe Colomb fut rejoint par son destin, rattrapé par ses forfaitures et dépassé par son exploit. Le luxe a pâli ainsi que les ors à l’heure du jugement et c’est un pauvre homme sans richesse, honni par l’Espagne, moqué par les hommes qui s’apprête à rendre des comptes. Lui, le découvreur de l’Amérique a, en fait, apporté à ce continent vierge si semblable au paradis terrestre la cupidité, la luxure, le vice, le péché, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes. Il est loin, si loin de sa légende!
Restait le décret pontifical introduit « par voie d’exception » qui ouvrait le procès en béatification. « Disputant doctores »... et pour cela, par la magie de l’imaginaire le romancier convoque pêle-mêle, pour témoigner, Victor Hugo, Lamartine, Jules Vernes; Bartholomé de las Casas...
Il reste un roman qui ou l’humour et le style, sans doute servis par une traduction de qualité, m’ont fait passer un agréable moment de lecture.
©Hervé GAUTIER
-
Rendez-vous d'amour dans un pays en guerre
- Le 05/11/2025
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°334– Avril 2009
RENDEZ-VOUS D'AMOUR DANS UN PAYS EN GUERRE – Luis SEPULVEDA– Métailié.
(Traduit de l'espagnol par François Gaudry)
Je ne dirai jamais assez l'attachement que j'ai pour les écrivains sud-américains, d'expression espagnole en particulier, et, en général, pour l'atmosphère d'exception que tissent les nouvelles.
J'ai aussi plaisir à célébrer le 29° anniversaire de cette revue en compagnie d' un écrivain d'exception.
Ici, Luis Sepulveda, dont cette chronique a déjà mentionné l'œuvre, revient avec un recueil de 27 nouvelles où le style est fluide, précis, simple, poétique, érotique aussi parfois et où l'auteur s'attache son lecteur jusqu'à la fin.
Il y est question de ces rendez-vous manqués qu'on a, au cours de sa propre vie, avec soi-même, avec les autres, avec l'amour, l'amitié, avec le temps... Ce sont autant d'actes manqués, de situations qu'on regrette amèrement plus tard mais pour lesquelles on n'est pas forcément pour quelque chose, des moments où la malchance nous accable ou nous paralyse, bloque en nous des mots qu'on n'ose pas dire, de gestes pourtant simples que la timidité nous interdit de faire, qui compromettent à jamais notre vie, la recouvrent de ces remords dont on ne peut se débarrasser et qu'on traine toute son existence.
Que ce soit ces femmes qu'on n'a pas pu aimer, qui nous ont échappé, ces paysages de bout du monde comme seule la Terre de feu en offre, ces fantasmes d'une enfance qui s'en va sans retour, ces peines jamais éteintes, ces envies jamais vraiment assouvies, le mystères des autres, celui qu'ils ont ou celui qu'on leur prête, leur charme, leur charisme, tout cela laisse des traces indélébiles dans notre âme, avec, en plus une cicatrice invisible, intime mais bien réelle, que nous sommes seuls à connaître et qui nous torturent. Il y a aussi ces moments anodins d'une vie, sublimés par l'écriture, ces petites parcelles d'existence qui, sans elle, s'évanouiraient dans l'oubli, des instants d'une conscience ou d'une absence que le quotidien, la routine et l'usure des jours rendraient transparentes, ces souvenirs qui vous reviennent en pleine figure à propos de rien et qui soulignent nos renoncements, nos compromissions parfois, ce hasard néfaste qui s'attache à nos pas et qui fait de nous, sans que nous y puissions rien, une victime expiatoire de quelque chose que nous ne maitrisons pas, parce que d'autres êtres se sont insinués dans notre vie, s'y sont installés et pèsent de tout leur poids sur notre destin, cette envie légitime que tout cela change dans un autre sens, que cesse cette chape d'incompréhension, de mystères qui nous étreignent et qui finissent par faire de notre vie quelque chose d'insupportable au point que nous ne pouvons plus nous débarrasser de nos obsessions, de nos phobies, de nos paris fous sur l'avenir immédiat. Ce sont bien ces mots dérisoires qui résument notre histoire, notre cheminement sur cette terre, nos souvenirs, nos repentirs impossibles, tous ces non-dits, ces qui pro quo, des possibles devenus maintenant impossibles... Notre histoire personnelle, que l'Histoire ignore parce que nous ne sommes pour elle que des numéros et des êtres sans importance, fait foi de ce parcours qui n'est bien souvent pas sans faute, nous, nous le savons! C'est aussi ces amours chimériques ou usés durablement par le quotidien et qui n'auront jamais plus le lustre d'antan, à jamais enfouis, détruits, parce qu'il n'y a plus rien à dire, plus rien à faire, bref qu'on n'est plus rien et qu'on n'est plus bons qu'à attendre la mort, parce qu'elle, au moins, elle voudra bien de nous, ces amours si improbables que seul la fuite est la solution et avec elle l'oubli, la quête des ombres qui envahissent notre inconscient, ces amours qui nous font croire à nous-mêmes que nous sommes uniques et exceptionnels, ces amours qui nous tombent dessus sans crier gare à cause d'un simple regard, ces amours qui se font urgentes quand la mort rode, que la vie se fait avare de son temps ou fréquente un peu trop le danger, l'indifférence, le dégoût de soi-même, et que l'ennui de l'autre devient soudain insoutenable et qu'on a envie d'autre chose.
Les choses changent pour chacun, d'entre nous, génèrent l'exil, le bonheur ou quelque chose d'indicible que parfois nous ne voulons ni voir ni exprimer parce que ainsi cela perdrait de sa substance et peut-être nous détruirait, ferait renaître en nous le désespoir et nous obligerait à vivre avec l'absence de quelqu'un ou de quelque chose.
Parfois pourtant, on entraperçoit, l'espace d'une fraction de seconde, le bien fondé de cette existence qui est autre chose que la somme des jours sans joie qui constituent notre quotidien, et on admet que tout cela justifie cette attente parfois angoissée et paie largement nos désespérances.
-
Le vieux qui lisait des romans d'amour
- Le 05/11/2025
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N° 166 - Septembre 1993.
LE VIEUX QUI LISAIT DES ROMANS D’AMOUR - Luis SEPULVEDA - Editions Métaillé.
Je dois avoir un faible pour les écrivains sud-américains mais ce roman de Sepulveda parvenu entre mes mains par hasard m’a, comme à chaque fois, procuré ce dépaysement un peu surréaliste d’une contrée perdue au bord d’un fleuve, unique voie de communication qui la relie à la civilisation. Il apporte à ce village nouvelles et vivres, et, bien entendu il émerge de ce petit peuple de « peones » et de « jivaros » des personnalités fortes qui s’imposent par leur seule présence.
El Idilio, petit village de l’Equateur est situé dans la forêt au bord du fleuve. Antonio José Bolivar Proano y vit ou plutôt y survit dans une solitude tout juste égayée par la lecture laborieuse de romans qui parle de l’amour, le vrai, celui qui fait souffrir... C’est sa manière à lui d’oublier qu’il vieillit. Il a tout abandonné, sauf peut-être la chasse qu’il va reprendre une ultime fois contre un ocelot qui menace le village. Il n’aura pas trop de toute la science que lui ont enseigné jadis les indiens Shuars pour déjouer ses pièges et en venir à bout. Mais le combat qu’il livre contre la bête est sans haine, un peu comme le dernier avant de basculer dans la mort. Il tue le fauve pour réparer les erreurs et la barbarie des hommes qu’il hait définitivement mais surtout pour protéger ce petit coin de terre où il a choisi de mourir.
© Hervé GAUTIER
1 vote. Moyenne 5 sur 5.
-
Un nom de torero
- Le 05/11/2025
- 0 commentaire
N°338– Mai 2009
UN NOM DE TORERO – Luis SEPULVEDA– Éditions MėtaIlliė. - Traduit de l'espagnol par François Maspero.
Nous le savons, le domaine du romancier c'est la fiction. Drôle de nom pour caractériser un récit, une histoire qui est racontée au lecteur, avec un début, un développement et une fin où s'entremêle réalité et imaginaire , où les personnages existent et croisent dans un décor dû au seul pouvoir de l'auteur, mais qui, parfois, se laisse déborder par la vie qu'il leur insuffle. Le milieu de prédilection de Sepulveda, c'est le voyage et le monde qui lui offre sa vaste étendue, mais c'est aussi l'histoire immédiate de l'humanité qui se confond avec sa propre expérience, ses propres pérégrinations, ses désillusions aussi...
L'histoire donc. Elle met en scène deux hommes, Juan Belmonte, ancien guérillero de toutes les guerres perdues d'Amérique Latine et Frank Galinsky, ex membre de la Stasi qui sont engagés par des parties adverses pour retrouver un mystérieux trésor composé de 63 pièces d'or appartenant à la collection du « Croissant de Lune Errant » originellement dérobé par les SS. L'histoire a pesé sur ces deux hommes qui ont dû revenir sur leur idéaux politiques et qui, pour mener à bien leur mission doivent se livrer à un duel sanglant en Patagonie. Belmonte, qui porte un nom de torero, le même que celui d'Hemingway, est mandaté par « la Lloyde Hanséatique » qui a sur lui un moyen de pression idéal : soit il mène à bien sa mission, soit il perd Véronica, sa seule raison de vivre, brisée par la torture.
Comme son titre ne l'indique pas, il s'agit d'un roman noir [le couleur de la couverture le laissait cependant penser], un véritable duel sanglant sur fond de désillusions, mais de désillusion politiques, celle de la démocratie chilienne assassinée par Pinochet, celle des idéaux communistes trahis par Staline, celle aussi des espoirs déçus de la réunification allemande.
Il y a le personnage de Véronica, absent, muet, autiste, mais incroyablement présent, une sorte d'obsession de la mort, de la souffrance, de la nuit dans lequel elle survit, de l'exil, du mal de ce pays envoûtant qu'est la Patagonie, comme il le dit, la Terre de Feu est un pays de légendes, de trésors cachés. Il est fascinant par son climat, ses paysages, sa solitude. Il y a aussi la figure de Belmonte, perdant définitif dans cette société où il ne se reconnaît plus, qui a manifestement évolué sans lui et qui le laisse, lui, au bord du chemin sans possibilité de lui tendre une main secourable. C'est un roman de la réconciliation impossible d'un homme avec son pays qui veut surtout oublier ce qui fut la dictature de Pinochet, le roman d'un éternel exilé, un roman d'amour aussi...
Sepulveda fait ici un travail de remise en cause personnel, de confidences faites à son lecteur. Il est un fameux conteur dont cette chronique n'a pas manqué de célébrer le talent. J'y ai dit le plaisir que j'ai éprouvé à la lecture de certains de ses romans. Ici, j'ai retrouvé tout ce qui fait l'intérêt traditionnel que suscite d'ordinaire ses récits. Cependant, et je ne saurais dire pourquoi, j'ai moins accroché à ce roman, et je me suis un peu forcé à lire jusqu'à la fin, parce que c'est lui!
© Hervé GAUTIER – Avril 2009.http://hervegautier.e-monsite.com
-
Le monde du bout du monde
- Le 05/11/2025
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°336– Avril 2009
LE MONDE DU BOUT DU MONDE – Luis SEPULVEDA– Métailié.
(Traduit de l'espagnol par François Maspero)
Dans ce récit se mêlent des bribes d'enfance d'un garçon de 16 ans qui vient passer ses vacances d'été à bord d'un baleinier des les eaux désolées des canaux de Patagonie parce qu'il a lu « Moby Dick » mais aussi les romans de Francisco Coloane, et le combat écologique en faveur des baleines de ce même garçon qui, ayant grandi, s'engage au côté de « Greenpeace » contre la pêche industrielle japonaise d'un bateau-usine dont on cherche à cacher l'existence et l'activité, et le soutient de ceux qui ont choisi de mener ce combat..
C'est donc un roman militant qui veut porter témoignage.
Comme à son habitude, l'auteur se livre à l'évocation de personnages hauts en couleurs comme le capitaine Nielssen, sculpté par l'aventure et la vie en mer, fils d'un marin danois et d'une indienne Ona, qui veut finir sa vie ici, malgré le climat rude, dans ce décor sauvage « parce que ces milliers d'îles, d'îlots et de rochers sont ce qu'il y a de plus proche du moment de la création ». C'est l'occasion pour lui de dénoncer aussi l'extermination par les Chiliens des minorités indiennes qui peuplaient originellement ce pays devenu terre d'émigration.
Il rappelle le génocide oublié de ces peuples de la mer maintenant disparus, la déforestation de la Cordillère, les ravages des Japonais, la corruption des militaires au pouvoir au Chili qui ont encouragé et fait perdurer cette œuvre de destruction, les trafics en tous genres et l'absence de contrôles et de sanctions qui qui favorisent cette politique... Il rompt le silence sur la surexploitation de la mer dans ces contrées, le massacre aveugle de la faune par les Japonais mais également à l'époque (nous sommes en 1984) par les États-Unis, la Russie et l'Europe.
C'est aussi un texte qui évoque ces vaisseaux-fantômes qui font partie de la mythologie nationale, qui décrit les paysages grandioses du sud du Chili où les récifs écorchent la mer et les tempêtes sèment la mort, ces récits de piraterie où la légende se mêle à l'histoire, cette fable (mais en est-ce une vraiment) ou les baleines et les dauphins se défendent eux-mêmes contre les pêcheurs criminels venus les exterminer.
Je ne sais pas pourquoi mais, malgré les images et les évocations poétiques qui émaillent ce livre, ce qui est aussi un manifeste écologique m'a moins plu que ceux que j'ai déjà lus.
©
-
Le neveu d'Amérique
- Le 05/11/2025
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°335– Avril 2009
LE NEVEU D'AMERIQUE – Luis SEPULVEDA– Métailié.
(Traduit de l'espagnol par François Gaudry)
Cela commence par un geste iconoclaste, où l'anticléricalisme le dispute à l'anarchisme, d'un petit garçon qui, à l'invite de son grand-père, va pisser sur la porte d'une église de Santiago, tout aussitôt suivi, à propos d'un livre à lire, par une promesse de voyage, à un grand voyage, celui d'aller dans un village d'Andalousie d'où est originaire sa famille et peut-être aussi d'en faire un qui ne mènera nulle part! Nulle part, oui, peut-être mais avec pas mal d'étapes dont le point de départ obligé se situe dans un pays, le Chili, qui a accueilli jadis sa parentèle comme des émigrants, mais qui maintenant le rejette à cause de Pinochet , de ses exactions, de ses exécutions...
Dans ce récit autobiographique, l'auteur entraine son lecteur dans un périple picaresque qui le conduira des geôles chiliennes à la Terre de Feu, à travers toute l'Amérique Latine, dans un itinéraire compliqué, hésitant et en pointillés qui ressemble à une fuite, un exil, une quête de quelque chose d'indistinct. Son but initial, c'est la liberté, mais pour lui, les détours se multiplient, l'entrainent toujours plus loin, mais c'est pour revenir sur cette terre sud américaine qui est la sienne. C'est aussi un parcours initiatique de l'aventure d'un infatigable voyageur à qui il arrive les choses les plus incroyables depuis l'atmosphère fétide des prisons jusqu'aux paysages grandioses de la Patagonie en passant par des projets avortés où la bonne fortune n'a d'égal que le refus de se fixer définitivement, où la volonté de bouger s'apparente vraiment à la conjugaison du verbe « partir. ».. à tous les temps!
C'est pour lui l'occasion de rencontres d'exception d'hommes et de femmes que seul le voyage permet de croiser, des gens qui vivent leur vie sans entraves, des gens au grand cœur, insoumis, anarchistes qui ont en commun ce goût de la liberté et le refus d'obéir à l'ordre établi, une certaine attirance pour le bonheur, quel que soit le prix qu'il faut payer pour cela « Sur cette terre nous mentons pour être heureux. Mais personne ici ne confond mensonge et duperie »; C'est toute une galerie de portraits qui défile devant nous.
Et l'écrivain n'est jamais très loin qui, mêlant légende et réalité, fait la chronique de tout cela, autant pour en conserver la mémoire intime que pour, grâce à son imagination autant qu'à son souvenir, enthousiasmer son lecteur ainsi transformé en passager clandestin, caché entre les pages du livre, témoin silencieux de ce parcours .
Il n'oublie pas de nous faire partager la beauté de ces paysages grandioses des terres australes auxquels répond ce village andalous écrasé de soleil où il a ses racines lointaines et qui est le terme de cette pérégrination, le respect de cette promesse qui, en quelque sorte, le fait revenir « au point de départ du long voyage entrepris par (son) grand-père », lui, « le neveu d'Amérique » qui ainsi est revenu.
Le style est humoristique et alerte, captivant, comme bien souvent celui des écrivains sud-américains, et Sepulveda, en merveilleux conteur, entraine son lecteur presque malgré lui dans le sillage dépaysant de ces contrées autant que dans les méandres de ses aventures d'éternel nomade.
-
Initiales
- Le 05/11/2025
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°567 – Avril 2012
INITIALES (Association des libraires) – Dossier n°26.
Fiction et mémoire, la guerre civile espagnole.
Pour aborder un thème historique il est deux manières. L'une tient à la fiction et l'autre à l’étude classique. Pourtant, certains faits, surtout s'ils sont baignés par la violence, résistent à l'écriture, quelle que forme qu'elle prenne. Soit cela résulte d'un parti-pris de l'auteur (on songe aux rescapés des camps de concentration qui ont choisi de se taire volontairement, faisant prévaloir la vie sur la mort), soit les événements interdisent qu'on en parle. La Guerre civile espagnole (guerre incivile disent certains) est de ceux-là. Pendant son déroulement, elle inspira pourtant de grands écrivains, Hemingway ou Malraux, mais sans vouloir minimiser leurs témoignages, ils en ont surtout donné une version lyrique, nourrissant l'imagination des étrangers au conflit, donnant une vision romantique de la guerre, côté républicain. Puis ensuite plus rien à cause de la censure franquiste qui imposa près de quarante années de silence, de répression, d'exil et de mort pour les vaincus.
A partir de 1975, des écrivains espagnols, qui bien souvent n'ont pas connu le conflit ont décidé de s'emparer de cette mémoire, d'en faire l'axe de leur œuvre mais aussi de ranimer la culture historique collective que le franquisme avait efficacement confisquée aux Espagnols. Alfons Cervera (né en 1947) s'est approprié cette période d'après-guerre . L'oubli, si savamment orchestré est tellement grand dans l’inconscient collectif qu'il se produit parfois, par le miracle de l'écriture, une sorte de réminiscence, en ce qui le concerne puisée dans son histoire familiale. On ne dira jamais assez combien la création artistique est une alchimie et combien l'auteur peut, au premier chef, être surpris par le résultat. Comme tout écrivain, il a d'abord cherché à raconter des histoires mais s'est très vite aperçu qu'il existait « des territoires de la mémoire à explorer » et a donc fait sien ce vaste et complexe espace historique qui va de la seconde république à la démocratie retrouvée en passant par la dictature, la transition... Ainsi cette période, « pleine de lumières et d'ombres » s'est-elle imposée à lui comme un thème de réflexion et de création. Ainsi l'écrivain, à travers son histoire familiale faite de soumission, de silence, prend-il en charge la mémoire collective qui avait longtemps été dédiée à l'oubli, dénonçant par l'écriture ce que fut le régime franquiste, se faisant ainsi le porte-parole des vaincus et leur rendant leur dignité. Pourtant, ce besoin de ne pas oublier et de témoigner avait existé malgré la dictature et même pendant la période de transition pendant laquelle on prônait le principe officiel de « ni vainqueurs ni vaincus ». On n'avait pourtant pas ouvert toutes les fosses communes et les condamnations prononcées par les tribunaux franquistes n'étaient pas toutes effacées. Restait aussi la mémoire familiale, nécessairement pudique et silencieuse de ces ouvriers et de ces paysans pauvres qui s'étaient dressés contre l’invasion fasciste. Nombreux furent les témoins qui se manifestèrent par l'écrit, se faisant l'écho de ce conflit à la fois absurde et sanglant qui mit en perspective la délation, le déchirement familial, donna à cette guerre son visage horrible, montra la folie des hommes et révéla, une nouvelle fois, la véritable nature humaine.
Puis vinrent les auteurs contemporains qui, en quelque sorte, prirent ce relais malgré le risque du « radotage », de la redite devenue peut-être inutile. C'est que, une guerre civile ne ressemble pas à un conflit armé traditionnel et porte en elle une dimension manichéenne. De plus, on a eu tendance à oublier que la république avait été démocratiquement élue alors que Franco était le rebelle putschiste. Puis il y eut le reste, les faits d'armes de chaque camps, les atrocités des deux côtés, mais bénis par l’Église catholique quand ils étaient franquistes, le combat inégal, les républicains soutenus par les communistes et surtout par les Brigades internationales, les nationalistes trouvant leur soutien parmi les puissances fascistes, le déchirement interne des républicains, les défections anglaise et française, les camps de concentration français pour les vaincus... Comme le dit Tony Cartano, l'Espagne reste, aujourd'hui encore divisée « entre ceux qui prêchent l'oubli et ceux qui réclament justice contre les crimes franquistes ». L'expérience du juge Garzon est sans doute là pour le prouver. Pourtant, la libération de l'Espagne passe à n'en pas douter par la parole ! Elle porte la mémoire individuelle d'un parent qui devient collective, a travers la honte de la retirada , l'exil en France, la résistance au maquis contre le nazisme, le rêve avorté de reconquête de l'Espagne, l'exil durable pour les combattants et leurs familles.
Ce numéro rend également hommage aux femmes, romancières contemporaines qui font elles aussi entendre leur voix mais surtout ces combattantes, soit figure emblématiques de la république, comme Dolorès Ibarruri, soit ministre de la santé comme Federica Montseny ou photographe comme Gerda Taro, la compagne de Robert Capa, tuée en 1937 à la bataille de Brunete.
Ce conflit qui pourtant ne déborda pas l'Espagne eut un retentissement mondial non seulement à cause de Guernica que Picasso immortalisa, mais aussi parce que des intellectuels, et pas seulement eux, s'engagèrent dans les Brigades internationales pour défendre la liberté ainsi attaquée, parce que des écrivains étrangers de toutes les nationalités prirent parti pour un camp ou pour un autre, médiatisant ce conflit à en faire une légende, faisant qu'à l'extérieur au moins il ne tombe pas dans l'oubli.
© Hervé GAUTIER - Avril 2012.
-
les roses d'Atacama
- Le 05/11/2025
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
Les roses d'Atacama
Par ervian
Le 29/11/2014
0 commentaire
N°836 – Novembre 2014.
Les roses d'Atacama – Luis Sépulveda- Métailié
C'est une sorte de carnet de voyage que nous offre l'auteur, le compte rendu de belles rencontres avec des gens dont il nous raconte l'histoire. Ce sont de gens ordinaires dont personne ne parle, 34 portraits, 34 esquisses inspirée par la sensibilité humaine. Dans ces nouvelles, il met en scène des hommes, des marginaux, qui ont choisi de se battre avec des armes dérisoires contre un pouvoir violent et barbare tel que les dictatures savent en enfanter, des petites gens qui font chaque jour leur métier avec passion, même si celui-ci leur apportera la mort. C'est aussi pour l'auteur l'occasion de se révolter contre l'exploitation meurtrière de la forêt en Amérique du sud ou la disparition programmée des baleines en Méditerranée. Sepulveda sait que ces combats sont perdus d'avance mais son action de témoin est une sorte de devoir moral pour que ces instants passés avec eux, que ces luttes, même vouées à l’échec, soient gravés dans nos mémoires, pour que ces injustices soient dénoncées comme une aberration dans l'histoire du monde, que l'oppression sous toutes ses formes soit ainsi révélée, pour que l'hypocrisie et le mensonge qui sont l'apanage des sociétés humaines bien pensantes soient dévoilés. C'est qu'il n'est pas autre chose qu'un témoin qui, à travers ses mots rend la parole à tous ces laissés pour compte que l'histoire officielle a oubliés, pour que tous ceux qui se sont un jour levés contre la barbarie ou qui ont simplement fait ce qu'ils estimaient être leur devoir, ne soient plus des fantômes. Il leur redonne leur nom, remet des mots sur leur action et c'est ainsi un peu de leur dignité qu'il leur rend. Il le fait simplement, sans faire dans le pathos, sans noircir le tableau, comme le scribe attentif et scrupuleux qu'il est.
Il évoque sa démarche en décrivant ce militant politique qui se penche sur les éphémères roses qui poussent dans le désert salé d'Atacama au nord du Chili. Elles sont toujours là, redonnent vie et couleurs à cette terre ingrate, ne fleurissent qu'une fois l'an, ponctuellement, sont aussi vieilles que le monde et des générations d'hommes qui sont passés par ici les ont vues. Elles sont le symbole de la permanence dans ce milieu hostile, de la vie qui disparaît mais toujours renaît tel un phénix, une sorte de miracle comme seule la nature sait en faire pour attester sans doute que rien n’est perdu, que l’humanité est capable de résister, comme les hommes dont il témoigne de l'humanisme, de l'altruisme, de la solidarité...
Le style est agréable, émouvant, une évocation simple mais pleine d'humanité, sans fioriture mais aussi sans concession. L'écrivain révolté voyageur et militant qu'il est trouve ici un thème particulièrement bien choisi pour que ses lecteurs prennent conscience des réalités et n'oublient rien de ce qui fait notre commune histoire et défendent ce patrimoine dont nous ne sommes que les usufruitiers.
Il réussit, selon le mot de l'éditeur « à transformer la tendresse des hommes en littérature »
©Hervé GAUTIER – Novembre 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
Electre à La Havane
- Le 22/10/2025
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
La Feuille Volante - N° 2021– Octobre 2025.
Électre à La Havane – Leonardo Padura- Éditions Méitailié.
Traduit de l‘espagnol par René Solis et Maria Hernandez.
Dans les bois de La Havane, on a retrouvé le corps étranglé d’Alexis Arayàn, le fils d’un important diplomate cubain. Pour corser le mystère, non seulement la victime ne semble pas s’être défendue, ce qui pouvait laisser penser à une forme de suicide, mais l’homme dont il s’agit était vêtu d’une longue et belle robe rouge... avec deux pièces de monnaie dans l’anus. A priori il ne pouvait s’agir que d’une affaire de prostitution masculine, d’autant que, selon les premiers renseignements, l’orientation sexuelle de la victime n’était pas vraiment du goût de son père et Alexis avait déserté la belle résidence familiale pour habiter la maison délabre d’Alberto Marqués, homme de théâtre marginalisé à la réputation sulfureuse, devenu un simple bibliothécaire, exilé dans son propre pays par le régime et surtout homosexuel notoire, dernière catégorie que n’aime guère le lieutenant Condé qui, bien qu’il soit suspendu temporairement, est chargé pour des raisons d’effectifs de cette enquête dans la touffeur de l’été cubain. Évidemment il accepte tout en sachant que la hiérarchie l’observe dans le but de le faire tomber. Le problème c’est que notre policier a la mauvaise habitude de rechercher dans chacune de ses affaires ses propres obsessions. Or le meurtre d’Alexis a eu lieu un 6 août, le jour de la Transfiguration du Christ dans la liturgie catholique et qu’il est persuadé d’être ici en présence d’un transformiste et non d’un pédéraste ou d’un travesti pris dans un banal jeu sexuel. D’autre part il apprend que la robe dont était revêtu Alexis était celle qui avait été conçue par Marqués pour le personnage d’ « Électra Garrigo » une authentique pièce de théâtre de Virgilio Piňera, mise en scène par Marqués mais qu’il n’a jamais pu monter. Conde apprit de la bouche de ce dernier qu’Alexis était certes homosexuel mais aussi catholique et possédait un évangile, ce qui faisait de lui un travesti mystique et qui compliquait les choses puisque cette religion bannit à la fois l’homosexualité et le suicide. Je ne suis pas certain d’avoir goûté les investigations de notre lieutenant en ce sens et qui m’ont paru quelque peu superflues. De même, sont évoquée également, dans les années 60 des rencontres parisiennes, avec des intellectuels français. En revanche pour mener son enquête Conde se rapproche de Miki, son ami et écrivain et ainsi comprend que dans cette société castriste l’hypocrisie est de mise, que chacun porte un masque et chacun est observé scruté dans le seul but de découvrir ses failles et de s’en servir contre lui. Des vérités lui seront ainsi révélées, sur cette société, sur le mort, sur sa famille et son entourage et aussi sur un passé que la révolution cubaine veut effacer. Grâce à Marqués, et non sans réticences, il va réussir à entrer dans le milieu homosexuel où il se présente entre autre comme un écrivain-alcoolique ce qui lui permet de cacher sa profession de flic tout en s’adonnant à une effrénée consommation de rhum et de bières et en payant agréablement de sa personne.
L’épilogue de ce roman est assez inattendu, le suspense y est distillé avec parcimonie avec une médaille, des restes de cigares et un témoignage capital.
Conde est certes un flic intègre mis c’est également un écrivain refoulé qui a fini par abandonner l’écriture, déçu sans doute par les rebondissements de sa vie. Cette enquête qui lui permet de renouer avec cette vielle discipline qu’il n’a jamais vraiment oubliée au point de confier une nouvelle à sa vieille machine à écrire, ce qui correspond au renouveau de notre policier. Même si les remarques que Padura prête sur ce sujet à notre lieutenant sont loin des préoccupations policières, je les ai particulièrement appréciées parce qu’elles correspondent un peu aux miennes ; D’autre part, les romans de Padura sont aussi l’occasion de se livrer à une critique du régime castriste qui ne favorise pas vraiment son talent. Il n’en demeure pas moins dans son pays sans lequel il ne peut écrire alors qu’il pourrait résider en Espagne dont il a la nationalité. Cette caractéristique que je retrouve, à travers ses différents personnages qui apparaissent dans nombre de ses romans , me parait également notable.
J‘ai, comme d’habitude apprécié la qualité du style notamment dans les descriptions ce qui met notamment en valeur le travail des traducteurs qu’il convient aussi de saluer.
-
la transparence du temps
- Le 13/10/2025
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
La Feuille Volante - N° 2013 – Septembre 2025
La transparence du temps – Leonardo Padura – Métaillé.
Traduit de ‘espagnol par Elena Zayas.
Mario Conde qui a quitté la police depuis vingt cinq ans va fêter ses soixante ans, pas vraiment au mieux de sa forme et combat comme il peut sa mélancolie avec du rhum, du café et des cigarettes tout en se livrant au commerce aléatoire de livres anciens. Un appel téléphonique lui fait reprendre contact avec Bobby, un ancien camarade de lycée devenu un marchand d’art et ... homo qui, se souvenant que Mario avait été flic dans une vie antérieure, le charge, au nom de leur ancienne amitié mais aussi, contre une confortable somme d’argent, de retrouver une mystérieuse statue de la Vierge noire dérobée avec beaucoup d’autres valeurs, des bijoux notamment, par Raydel, son amant indélicat. L’importance du montant proposé lui fait accepter cette mission qui lui permettra de sortir d’une gêne financière et, ce d’autant qu’il compte sur l’appui de son épouse Tamara, de ses traditionnels copains et de son chien. Faisant appel à son instinct, Conde s’aperçoit que cette statue, une vierge noire, présentée par son copain comme une relique familiale, avait en réalité une très importante valeur marchande et historique et peut-être même des pouvoirs miraculeux.
Ses investigations vont amener Conde a côtoyer l’extrême pauvreté de certains quartiers autant que le milieu plus riche des marchands d’art et la fuite des œuvres cubaines à l’étranger. Il porte ainsi sur cette île qu’il aime un regard désenchanté face aux promesses égalitaires non tenues du castrisme ce qui entraîne un exil massif des Cubains que déplore notre ex-policier. Cette recherche de statue est l’occasion de retrouver ses origines qui remonteraient au siège de Saint Jean d’Acre en 1291 avec peut-être le concours des chevaliers du Temple et qu’elle aurait voyagé jusqu’en Catalogne , autant dire un long voyage dans les siècles et c’est une occasion pour Conde de méditer sur la fuite du temps, sur la vieillesse qui s’empare peu à peu de lui. Le délabrement tout relatif de notre ami qui mesure ainsi les ravages d’une vieillesse à venir qu’il redoute n’est pas atténué par le somptueux destin d’anniversaire d’entrer dans la soixantaine. Il répond comme en écho à la dégradation d’un peu tout à Cuba, les routes, les bidonvilles le niveau de vie...pendant que les meurtres s’accumulent autour de cette statue
Comme à chaque fois, Padura glisse dans ses romans des critiques non voilées contre le castrisme qui le lui rend bien en l’écartant des médias nationaux alors qu’il bénéficie d’une bonne notoriété à l’international. Pour autant, et bien qu’il ait la nationalité espagnole et qu’il pourrait vivre dans ce pays, il reste à Cuba parce que, sans son île, il ne pourrait écrire.
Le style est, comme toujours agréable à lire, plein de nuances et d’érudition mais un peu long cependant pour maintenir l’attention jusqu’à la fin.
-
Adios Hemingway
- Le 03/10/2025
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
La Feuille Volante - N° 2017– Octobre 2025.
Adios Hemingway – Leonardo Padura- Métailié.
Traduit de l’espagnol par René Solis.
Le lieutenant Marion Conde qui a depuis quelques années quitté la police pour devenir écrivain et marchand de vieux livres est sollicité par un de ses anciens collèges. A La Havane, une tempête a déraciné un arbre dans la propriété d’Ernest Hemingway dont la maison est devenue un musée et on a retrouvé un corps enterré depuis quarante ans et qui portait une insigne du FBI. Un tel mystère menace d’entacher sa mémoire de l’écrivain américain d’autant que le policier nourrit à l’endroit d’Hemingway des sentiments contradictoires d’admiration pour l’écrivain et de rejet pour l’homme. L’admirateur de l’écrivain ne pouvait supporter qu’on lui mette sur le dos un meurtre qu’il n’avait peut-être pas commis et l’ancien flic qu’il est ne pouvait pas ne pas laisser passer cette occasion d’enquêter en solitaire sur cette affaire, même si cela devait s’inscrire dans l’indifférence générale.
En réalité, plus qu’une investigation policière, c’est plutôt une réflexion sur Hemingway, sur son œuvre, sa psychologie, son côté expansif, les différents sites qu’il a fréquentés, ses failles, la construction par lui-même de son propre mythe qui ont nourri toute sa démarche de création, à laquelle se livre Conde. Padura y ajoute une rencontre érotique avec Ava Gadner. invente cette traque du FBI, par ailleurs parfaitement possible, qui aurait provoqué ce meurtre, se hasarde à expliquer son suicide par la perte de sa traditionnelle vitalité due au vieillissement, son choix d’une vie exaltante et parfois violente qui peu à peu le trahissait, la culpabilité latente d’avoir quelque peu délaissé la littérature au profit de son amour de la vie et ce malgré son prix Nobel. Pour cela Conde choisit de approcher ceux qui ont bien connu l’écrivain vers la fin de sa vie. Même si l’œuvre d’ Hemingway est détaillée avec précision, j’ai été assez peu convaincu par le résultats des investigations et leurs conclusions qui n’étaient qu’un prétexte pour côtoyer l’image de l’écrivain surnommé familièrement « Papa ».
Léonardo Padura explique dans une note que son éditeur lui avait demandé de participer à une série sur « la littérature ou la mort » et que le nom de Hemingway s’est naturellement imposé à lui . Il avait donc résolu d’intégrer Conde dans une fiction et de lui prêter ses propres émotions. Même si ce petit ouvrage où la réalité se mêle à la fiction, n’est pas un grand roman, c’est bien écrit et bien documenté, deux choses qui au mois donnent envie de se replonger dans l’œuvre de l’écrivain américain.
-
L'homme qui aimait les chiens
- Le 01/10/2025
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
La Feuille Volante - N° 2016– Octobre 2025.
L’homme qui aimait les chiens – Leonardo Padura- Métailié.
Traduit de l’espagnol par René Solis et Helena Zayas.
Cet long ouvrage s’ouvre sur le début de l’exil de Léon Trotski (1879-1940) décrété par Staline et qui dura dix ans et le début de la vie de son assassin, le militant communiste espagnol devenu agent du NKVD , Ramón Mercader (1913-1978). Il s’agit là de deux personnages connus auxquels s’ajoute un troisième, parfaitement fictif celui-là, Ivàn Cardenàs Matrurell, vétérinaire à Cuba mais surtout écrivain manqué, muselé par le régime castriste et donc parfaitement inconnu de tous. Il revient, en 2004, après la mort de sa femme Ana, sur sa rencontre datant de 1977, par hasard sur une plage de La Havane , avec un vieil homme solitaire, Jaime Lopez, et ses deux lévriers barzoï qui lui parle avec précisions du meurtrier de Trotski, lui donnant des détails même sur sa vie intime , détaillant tous les préparatifs de cet assassinat sur fond de fin tragique de la guerre d’Espagne, du pacte germano-soviétique, de l’invasion de la Pologne... Lors de plusieurs rencontres il va avouer à Ivàn que non seulement il a été l’ami de Ramon Mercader mais aussi s’épanche sur les inepties, les, les injustices flagrantes et les crimes, les procès truqués, les exécutions sommaires, les disparitions, les camps sibériens décidés par Staline, décimant son peuple jusque dans les rangs de ses propres partisans. Il dénonce des mensonges qui, à force de temps et de propagande deviennent des réalités, prévoyant peut-être la fin de l’utopie communiste. Le livre refermé, ce que je retiens de cette lecture édifiante c’est le mensonge, le mépris, la peur et la mort.
Ce sont donc trois destins qui se dessinent, celui de Trotsky, promis à un bel avenir en Russie communiste mais que le dictateur Staline , dans sa volonté de se maintenir seul au pouvoir, a condamné à la déportation au Kazakhstan puis à l’exil au nom de sa supposée traîtrise à la révolution, une longue errance de dix années entre la Turquie, la France, la Norvège et le Mexique où il trouvera la mort assassiné par Mercader. Celui-ci, emporté par la débâcle et la confusion des troupes républicaines à la fin de la Guerre civile est recruté par Moscou, dissimulé sous diverses identités, pour exécuter Trotski. Sa tâche accomplie, il connaîtra lui aussi une autre sorte d’errance, jusqu’à sa mort. Le troisième destin, celui d’Ivàn , le narrateur, est bien différent des deux autres, plus modeste et anonyme qui fait le lien entre le passé et le présent, un témoin attaché à sa fidélité au régime castriste malgré les difficultés des Cubains au quotidien. Il écoutera son vieil interlocuteur, mémorisera, prendra des notes et, après la disparition de Lopez aura la certitude d’avoir rencontré l’authentique meurtrier de Trotski tout en se demandant pourquoi il a été choisi pour recevoir ces confidences qui ébranlaient quelque peu ses convictions et sa vie même. Il releva un détail qu’il avait noté chez Lopez ,que cet amour des chiens était partagé par Trotski … et aussi un peu par lui-même puisqu’il est vétérinaire. Il parle également de lui-, de sa vie intime dévastée par un divorce à l’initiative de sa femme, déçue par son côté perdant et de la séparation d’’avec ses enfants, de la fuite des cubains sur des radeaux de fortune pour gagner les États-Unis , de la mort de son frère.. . D’une certaine façon il est essentiel et avec son témoignage, ils prend réellement une dimension de l’écrivain qu’il a toujours voulu être, quelque peur qu’il ait pu avoir pour écrire ce livre. Il avait en effet été muselé par le régime castriste et s’était tu par crainte. Cet épisode fait renaître en lui cette faculté d’écrire, de témoigner.
C’est un roman historique fascinant, particulièrement bien argumenté, documenté, une somme de travail, de commentaires et de création extraordinaires où la fiction se mêle à l’Histoire et qui s’attache son lecteur jusqu’à la fin de cet ouvrage pourtant long (670 pages). Ce roman est aussi, selon une note de l’auteur, une réflexion sur les perversions de cette grande utopie du XX° siècle dont la renaissance menace actuellement nos démocraties.
-
L'éloge de la marâtre
- Le 14/04/2025
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
En hommage à Mario Vargas LLOSA qui vient de nous quitter.
N°279 – Août 2007
L'ELOGE DE LA MARATRE – Mario VARGAS LLOSA - Gallimard Editeur.
Loin du registre qui a fait sa notoriété, l'auteur explore un univers familial particulier, celui, vu à la fois avec les yeux d'adulte et ceux d'un enfant, d'une femme, non seulement épouse mais aussi maîtresse, en ce qu'elle est la complice active des jeux de l'amour, mais surtout la belle-mère. Cette dernière emprunte son lien de parenté au mariage, c'est à dire qu'elle apparaît un peu par hasard dans la vie de gens qui n'ont rien fait pour la connaître. Elle est souvent l'intruse, le mauvais côté de l'image de la femme. Ici, il s'agit de la marâtre, terme un peu péjoratif qui désigne la deuxième femme du père, souvent plus jeune que lui, à la suite de cette détestable habitude qu'ont les hommes d'épouser, surtout en secondes noces, des femmes-enfants! Ils puisent en elles leur vitalité retrouvée, la volonté de combattre les affres de la vieillesse qui vient et parfois l'échec de leur premier mariage. Elle est porteuse de symboles mais aussi de promesses qu'elle ne doit pas décevoir. Pour l'enfant, dit « du premier lit »elle remplace la mère disparue ou partie, sans pour autant prendre sa place, bien au contraire. Il l'accueille souvent mal et s'engage entre eux un combat fait de subtils attaques ou d'affrontements violents peut-être parce que le complexe d'œdipe s'habille ici d'autres apparences, que chacun marque son territoire et tient à ses prérogatives parfois durement acquises...
Mais le titre nous indique qu'il s'agit d'un éloge et donc que vont être battues en brèche les idées reçues que le sujet génère. Il s'agit d'une mise en perspective d'un trio, le père, Don Rigoberto, jouisseur-esthète et fort amoureux de Lucrecia, sa deuxième épouse, marâtre de son fils Alfonso. On pourrait croire qu'il va s'agir du théâtre d'une lutte entre ces trois personnages. D'ailleurs, l'auteur sollicite à la fois la culture et l'attention de son lecteur, par l'évocation qu'il fait de tableaux aussi différents que ceux de Jacob Jordeans, du Titien, de Fra Angélico ou de Fernando de Szyszlo. Les époques et les écoles s'y mélangent, comme le figuratif et l'abstrait. Vargas Llossa y livre sa lecture de ces œuvres où se retrouve toujours un trio, et, en filigrane, une histoire d'amour. Cet amour est à la fois chaste et jouisseur, emprunt de retenue ou de licence, humain et divin. Le corps de la femme y est alternativement montré et caché, mais aussi joliment évoqué avec des mots choisis. Un troisième personnage vient souvent s'immiscer dans le tableau, soit qu'il y est déjà et parle, soit qu'il en est le commentateur extérieur qui, à la manière du chœur antique traduit pour le lecteur-témoin les pensées de la femme ou se charge de débroussailler le subtil écheveau de ses désirs secrets, oscillant entre lubricité et vertu parce qu' ainsi va la vie et que le plaisir procède de ces deux facettes.
En même temps, la femme, prétexte aux désirs masculins est présentée alternativement comme objet mais aussi comme sujet de l'action amoureuse, à la fois passive et active. L'auteur nous rappelle, à travers ces fables écrotico-esthétiques, en réalité de longs poèmes, que l'amour n'est pas un acte bestial, voué à la seule procréation ou a l'assouvissement d'instincts animaux, la démarche, et ce qu'il en résulte est au contraire toute en nuances, faite de prolégomènes et de soins des apparences sans lesquels la séduction spontanée paraît impossible. En filigrane, je souhaite voir l'image de la mort, pendant de celle de l'amour et qui en est parfois la conséquence comme l'est paradoxalement la vie avec tous les fantasmes inhérents aux relations ambiguës hommes-femmes, mais aussi enfants-adultes.
Je choisis de voir dans ce texte, non un éloge comme l'indique le titre, mais une vengeance subtilement accomplie du beau-fils qui amène habillement sa marâtre à se compromettre et grâce à un écrit anodin, sorte de mise en abyme du livre de Vargas Llosa, à dénoncer l'adultère, à amener son père à se séparer de cette épouse infidèle ainsi démasquée, à le forcer peut-être à rester fidèle à son ancienne épouse, même si, pour cela, il doit perdre sa joie de vivre retrouvée et pénétrer de plain-pied dans la mort. C'est probablement une manière de retrouver son père et peut-être aussi de le détruire, tant les relations entre les humains sont complexes, faites d'amour et de haine, de luttes et d'apaisements, de sincérité et de mensonge.
-
la lucarne - José Saramago
- Le 19/03/2023
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°1726 – Mars 2023
La lucarne – José Saramago – Seuil.
Traduit du portugais par Geneviève Leibrich.
Ce roman écrit entre 1940 et 1950, qui est le deuxième d’un jeune auteur alors inconnu, fut refusé par l’éditeur portugais à qui il avait été envoyé et qui ne prit même pas la peine de lui répondre. On imagine la frustration de ce jeune homme qui avait mis dans cet ouvrage tous ses espoirs et aussi sans doute pas mal d’illusions. Ce ne fut qu’en 1989 que ce même éditeur, prétextant un déménagement et la découverte fortuite de ce manuscrit, en proposa l’édition, ce qui fut refusé par l’auteur qui maintint sa décision jusqu’à sa mort. L’ouvrage ne fut publié qu’à titre posthume, mettant notre auteur, toutes choses égales par ailleurs, dans la même posture que Fernando Pessoa, son illustre prédécesseur, qui confia une partie de son œuvre à une vielle malle avant son décès. Il n’est pas inutile de préciser que José Saramago (1922-2010) avait entre-temps acquis une vraie notoriété et fut plus tard, en 1998, couronné par le Prix Nobel de littérature. Cela n’est pas sans rappeler la mésaventure littéraire de Marcel Proust qui vit son roman « Du coté de Chez Swan » refusé par Gallimard mais obtint l’année suivante, en 1919, le Prix Goncourt pour « A l’ombre des jeunes filles en fleurs », deuxième tome de « A la recherche du temps perdu ». La même péripétie est arrivée à Mathias Enard pour « Boussole » qui reçut le Goncourt en 2015 ! Tout cela n’est pas sans poser question sur la fonction d’éditeur dont le rôle principal est la découverte de talents ! Ça n’a pourtant pas été simple pour Saramago, né dans un milieu quasi analphabète et qui dû très tôt exercer des métiers ingrats avant de voir son talent reconnu.
Ce roman se passe dans un immeuble de Lisbonne où vivent six couples avec ou sans enfants où chacun connaît son voisin, lui parle, l’observe, le juge, se limitant à des rapports de voisinage sans plus. L’auteur commence par les présenter pour ensuite décliner leur histoire personnelle alternativement au cours des chapitres suivants et ainsi affiner chaque portrait. Dans ce microcosme Saramago observe les familles, jeunes et vieilles, qui connaissent des difficultés financières, recherchent le bonheur mais aussi qui sont minés par le malheur, l’envie, la crainte du quand dira-ton, le désir sexuel et la frustration qui va avec, la jalousie, l’autoritarisme, la critique, les adultères, les bassesses, la morale, l’hypocrisie, les haines ordinaires, communes à tous. Il complète le tableau en évoquant une jeune femme entretenue par un homme plus vieux et plus riche et la tromperie qui va avec, la fin d’une idylle et la naissance d’une autre, le désamour entre parents et enfants, le vice et la délation, l’usure du couple et avec lui tous les regrets que suscite cet amour qui, bien entendu, ne rime jamais avec toujours... Il y a ce jeune homme qui se pose des questions sur lui-même et sur sa vie future et qui doit bien avoir quelques ressemblances avec l’auteur ! Chacun rêve d’une vie meilleure, fait ce qu’il peut pour échapper à son quotidien par la lecture ou la musique mais il n’y a rien là d’extraordinaire puisque cette recherche nous est commune à tous dans cette comédie humaine.
A travers cette lucarne, l’auteur nous donne à voir la photographie d’une société en raccourci, qui se bat au quotidien contre la misère, les ennuis quotidiens, quelque chose de très semblable à toutes les sociétés humaines populaires et désargentées. Pour cela il se fait un peu voyeur, indiscret et curieux, nous détaillant par le menu ce qui fait la vie de chacun, jusque dans les détails les plus anodins voire des plus intimes d’un couple. Il s’ensuit une série de réflexions pertinentes sur l‘espèce humaine, ses secrets et ses fantasmes, le sens de la vie et de la solitude qui nous est commune à tous. Pour autant tout cela baigne dans une sorte d’ambiance de suspicion et de retenue, de secrets qui est due à la dictature de Salazar à moins que cela ne soit la marque de la « saudade », cette nostalgie où se conjugue le passé et le présent, mâtinée du désir de ce qui manque et de l’espoir de le trouver un jour, une sorte de mal de vivre, un état d’esprit si propre à l’âme lusitanienne et dont l’homme de Lettres portugais ne peut manquer de se faire l’écho.
-
Celle qui parle
- Le 20/01/2023
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°1708– Janvier 2023
Celle qui parle – Alicia Jaraba – Grand angle.
Cette histoire romancée est inspirée par une femme réelle du XVI° siècle, mais mal connue, « la Malinche », rebaptisée dans cet ouvrage Malinalli, Malintzin ou Doňa Marina par les Espagnols, fille d’un cacique déchu, devenue esclave, c’est un personnage controversé dans le Mexique d’aujourd’hui qui voit en elle soit le symbole de la traîtrise puisqu’elle a préféré collaborer avec les Espagnols dans la conquête de son propre pays, soit celui de la victime consentante, soit le mère du peuple mexicain, bref une figure à la fois symbolique et légendaire.
Ce qui n’est pas encore le Mexique est habité par différentes tribus qui se font des guerres sanglantes et qui parlent différents dialectes. La Malinche, douée pour les langues, a servi de traductrice aux Espagnols qui se sont imposés en jouant sur ces rivalités. Elle aurait même eu un rôle de conseil grâce à sa connaissance des mentalités locales. Elle est présentée comme une jeune femme qui prend la parole pour sortir de la condition d’esclave où l’avait mise les luttes ethniques. Elle est donc « celle qui parle », c’est à dire la traductrice mais aussi celle qui refuse sa condition de femme destinée à satisfaire les hommes et à faire des enfants. C’est un parti pris de l’auteure qui est respectable. Cette jeune fille a été la maîtresse de Cortès, un capitaine espagnol pauvre venu ici conquérir des territoires et faire fortune. Elle lui a même donné un fils.
Le livre refermé je me dis que cet épisode ne correspond pas exactement a ce que nous savons sur la conquête du Mexique, surtout si on se réfère à la fresque de Diego Rivera au Palais National de Mexico qui montre la violence qui a présidé à cette conquête. Cette violence est seulement évoquée brièvement par le massacre de la ville de Cholula. Cet ouvrage met en scène un prêtre au rôle ambigu, paisible et un peu bizarre qui semble rendre aussi un culte à Tlăloc, le dieu de la pluie. Le rôle de l’Église catholique a été bien différent puisque sa mission visait surtout à évangéliser ces peuples. Elle a accompagné et même béni les atrocités commises, les exterminations et la disparition de leur civilisation.
Les couleurs chaudes et le graphisme sont expressifs, quoique un peu sombres sur certaines planches.
-
Le fil de l'horizon - Antonio Tabucchi
- Le 11/08/2022
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°1664 - Août 2022
Le fil de l’horizon – Antonio Tabucchi – Christian Bourgois Éditeur.
Spino travaille à la morgue d’une ville portuaire italienne. Il passe donc une grande partie de son temps avec des cadavres autopsiés, vivant parmi les morts. Il tente d’apprivoiser cette ambiance morbide en donnant à ses clients des noms d’acteurs de cinéma ou de personnages et partage sa vie avec Sarah qui rêve de voyages. Cette cohabitation l’invite à la réflexion sur le passage de la vie à la mort mais le personnage de Sarah reste en filigrane dans ce texte . Or il se trouve qu’en ville un jeune inconnu vient d’être assassiné mais le mystère autour de cette mort est si grand que Spino se croit obligé d’enquêter à titre personnel, cela à cause peut-être de sa solitude et aussi peut-être parce que cet inconnu n’intéresse personne. La police se perd en conjectures mais lui veut en savoir plus sur lui surtout pour des raisons philosophiques tenant au destin, à la nécessité de ne pas mourir dans l’anonymat ce qui, à ses yeux, est pire que la mort.
Il se lance dans des investigations incertaines qui le promènent au rythme du hasard dans des contrées assez étranges à partir d’objets comme une photo ou une veste ayant appartenu au mort, où l’identité de cet homme se dérobe et il finit par oublier ce qu’il cherche. C’est une sorte de quête labyrinthique dont l’épilogue semble s’éloigner de lui au fur et à mesure qu’il avance dans ses recherches. C’est aussi mystérieux qu’un texte de Borges. En réalité Spino qui se transforme en détective privé bénévole cherche quelque chose qui n’existe pas et ses investigations finissent par dérailler, ce mort reste inconnu et c’est finalement sur lui-même qu’il enquête. Il y a un peu de ce « jeu de l’envers » pour reprendre le titre d’un autre roman de l’auteur, dans la mesure où, dans cette quête, il est à la recherche de lui-même et l’épilogue dans sa dimension de mort pourrait bien signifier le but si recherché et enfin atteint par lui, la référence à Hécube qui selon la tradition se jette à la mer, étant significative. Il mène son enquête dans des endroits improbables où la logique semble être oubliée, un peu comme s’il était dans un monde parallèle, se perd dans des détails au point qu’on a l’impression, peut-être fausse, qu’il en oublie sa véritable mission.
A propos de Spino qui n’est qu’un parfait quidam, un solitaire, je n’ai pu lire ce texte sans penser à Fernando Pessoa dont Tabucchi était non seulement le traducteur mais aussi l’admirateur. Comme lui Spino pourrait dire qu’il n’est rien, qu’il ne sera jamais rien mais porte sûrement en lui tous les rêves du monde. La police hésite beaucoup sur l’identité et les activités du mort et finit par lâcher un nom possible- « Nobody »- qui ressemble aussi à Spino) Comme lui peut-être Tabucchi prenait-il le relais de Pessoa dans la mesure où l’écrivain recherche lui aussi quelque chose, le fait d’écrire, de tracer des mots sur la feuille blanche, de les faire vivre, de planter un décor trompeur, de dérouler pour son lecteur une histoire qui n’a peut-être jamais existé, de se laisser porter par les personnages qui peu à peu conquièrent leur liberté d’exister et que l’épilogue peut être parfaitement différent de celui qu’il avait imaginé, est aussi une quête intime, nourrie peut-être par cette « saudade » qui fait tellement partie de l’âme lusitanienne. L’écriture est à la fois un miracle et une subtile alchimie et ce qui en résulte est parfois une découverte pour l’auteur et une sorte de mystère, un peu comme cette ligne qu’on appelle l’horizon et qui, plus on avance plus elle nous échappe et que ce mouvement ne s’arrêtera jamais. C’est peut-être aussi le sens de cette référence érudite à Spinoza, dont Spino est le diminutif ?
-
Terra alta
- Le 31/07/2022
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°1655- Juillet 2022
Terra Alta – Javier Cercas – Actes sud.
Traduit de l’espagnol par Aleksandar Grujičič et Karine Louesdon.
Dans une petite ville de Catalogne, Gendesa, capitale de la Terra Alta, un meurtre atroce vient d’être commis, le massacre avec tortures et mutilations d’un vieux couple de riches industriels dans une villa isolée, les Adell. Lui, malgré ses quatre vingt dix ans dirige encore une importante cartonnerie, des riches dans une région pauvre. Pourtant l’affaire se présente plutôt mal sans indices ni traces d’effraction, même s’il apparaît que, malgré son catholicisme militant, ce patron parti de rien, sorte de potentat arriviste exploitait ses ouvriers et suscitait des envieux. Ce n’était pas cependant une raison suffisante pour le tuer. On pense même à un meurtre rituel à cause de leur appartenance à l’Opus Dei. L’enquête vite classée ne tient que grâce à l’entêtement de Melchor Marín. C’est en effet lui qui, muté temporairement dans cette région éloignée de Barcelone pour sa sécurité, va être chargé de l’enquête. C’est surtout l’occasion de faire connaissance avec lui. Fils sans père d’une prostituée, il a grandi dans les bas-fonds de Barcelone et la pègre qu’il a très vite fréquentée l’a amené en prison où la nouvelle de l’assassinat sordide de sa mère et la lecture des « Misérables » ont fait de lui un révolté et l’ont déterminé à faire des études pour devenir… policier, ne serait-ce que pour découvrir son vrai père mais surtout pour découvrir les assassins de sa mère, un justicier obsédé par les injustices de ce monde, un homme tiraillé entre les figures emblématiques hugoliennes de Valjean et de Javer ! Malheureusement pour lui, il va s’apercevoir que la recherche effrénée de la justice peut mener aux pires injustices et que, sur cette terre catalane, le souvenir de la Guerre Civile espagnole n’est pas éteint.
Sa mutation dans cette région isolée où d’ordinaire il ne passe rien va certes être pour lui l’occasion de se ranger en rencontrant Olga sous l’égide des livres, en l’épousant et en lui faisant un enfant, mais cette affaire de meurtre va bouleverser durablement sa vie et son séjour ici
.
Roman original, qui n’est pas sans soulever des questions philosophiques, morales et de conscience, agréablement écrit (traduit?) et qui ménage le suspense jusqu’au bout en associant cette fiction à l’Histoire du pays. Je l’ai lu passionnément et sans désemparer avec le souvenir tragique de cette Guerre Civile qui ensanglanta l’Espagne de 1936 à 1939, des assassinats sommaires pratiqués des deux côtés et de celui des Républicains et des brigades internationales sur le rythme entraînant de « Viva la quinta brigada », chant emblématique de ces volontaires qui luttèrent vainement pour liberté et contre le fascisme.
En Espagne, sous la dictature de Franco, le souvenir de la guerre civile a été complètement occulté. Sous le régime suivant, plus démocratique, on a cherché à oublier toutes ces atrocités. Ce n’est que lors de la génération suivante, qui n’a évidemment pas connu ce conflit, que les jeunes écrivains espagnols s’en sont emparés, se le sont même approprié et l’ont intégré à leur œuvre, comme pour en exorciser toutes les horreurs. Javier Cercas, né en 1962 est de ceux-là. Je vais poursuivre la découverte de son œuvre.
-
A petites foulées
- Le 31/07/2022
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°1659- Juillet 2022
A petites foulées – Javier Cercas – Actes sud.
Traduit de l’espagnol par Elizabeth Beyer et Aleksandar Grujičič.
Mario Rota est un jeune universitaire italien assez médiocre, divorcé, solitaire, un peu sauvage, en poste dans une université américaine. Sa vie tient beaucoup de la routine, des cours qu’il dispense sans grande conviction, de sages soirées entre collègues qui lui ressemblent et de vagues pensées érotiques pour une jeune femme dont il dirige la thèse. Rien de bien folichon donc. Il n’est pas vraiment chanceux avec les femmes, pas « donnaiollo » comme disent si joliment nos amis italiens et son seul exercice physique consiste en un jogging dominical, mais il s’est récemment foulé une cheville lors de cette séance. Pour banal et temporaire qu’il soit cet épisode et surtout la semaine qui va suivre, vont prendre une importance énorme dans sa vie. A l’université, il s’aperçoit que les choses changent pour lui, mais surtout que tout est contre lui, les femmes qui l’entourent se désintéressent de lui, on réduit ses heures de cours et donc son salaire, on lui affecte un bureau beaucoup moins confortable et un nouveau professeur plus prestigieux arrive qui lui fait de la concurrence sur tous les plans, bref on le pousse dehors parce qu’il est indifférent à tout et que sa médiocrité professionnelle va à l’encontre de la volonté d’améliorer le niveau du département de linguistique où il travaille, à commencer par celui des professeurs. Il s’enfonce petit à petit dans cette atmosphère où il se sent l’objet d’une persécution qui ressemble à une descente aux enfers.
Ce court roman, un de ses premiers livres, est bien antérieur aux « Soldats de Salamine » qui a fait la notoriété de son auteur. J’aime bien lire Javier Cerca depuis que je connais ses œuvres, parce que c’est bien écrit (bien traduit?)et même si celui-ci a eu sur moi son habituelle attraction, il m’a paru assez lent au début. L’épilogue est surprenant, quoique sans doute plus courant qu’on pourrait le penser concernant nos sociétés humaines. C’est certes une critique de l’université américaine mais aussi sans doute du monde du travail et de la société en général où la règle est d’affaiblir l’autre pour prendre sa place, le déstabiliser ou s’enrichir à ses dépends, une sorte d’évocation d’une forme de schizophrénie, mais j’y ai surtout vu une observation pertinente de l’espèce humaine dans tout ce qu’elle a de plus mesquin, de plus hypocrite. L’antihéros de Cercas a quelque chose de fragile, de simplement humain.
-
A la vitesse de la lumière
- Le 31/07/2022
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°1658- Juillet 2022
A la vitesse de la lumière – Javier Cercas – Actes sud.
Traduit de l’espagnol par Elizabeth Beyer et Aleksandar Grujičič.
Un jeune espagnol qui ressemble fort à Cercas lui-même, qui veut devenir écrivain, comprend que pour cela il lui faut voyager, rencontrer des gens, faire des expériences. Alors pourquoi pas les États-Unis ? Sauf que ce fut Urbana, ville universitaire certes, mais triste et perdue au fond de l’Illinois, pas vraiment de quoi nourrir son rêve américain ! Il y croise par hasard Rodney, un vétéran du Vietnam au comportement bizarre . Pas très original non plus ! Mais cette rencontre a vraiment lieu quelques années plus tard, surtout par l’intermédiaire des lettres que Rodney envoyait à son père pendant les hostilités et qu’il confit au narrateur. Elles parlent de la violence et de l’absurdité de cette guerre et à son retour il se sent étranger dans son propre pays, a du mal à assumer sa qualité d’ancien combattant malgré ses médailles à cause des massacres perpétrés au Vietnam notamment sur des femmes et des enfants innocents. Il est bouleversé et culpabilisé et ne puise la raison d’une vie décousue que dans l’alcool, la drogue et une forme de marginalité inexpliquée. Notre apprenti écrivain condamne certes cette attitude meurtrière, y voit l’opportunité d’un roman à écrire, mais hésite longtemps notamment à cause du mutisme de Rodney qui se refuse à collaborer. Plus tard, quand ce dernier reprend une vie normale et rangée, le projet d’écriture revient et avec lui, la parole de Rodney qui accepte, malgré ses réticences, d’évoquer ses souvenirs comme pour les exorciser et s’en libérer, parce que c’était la guerre, les ordres, la logique des choses, la terreur qu’il fallait entretenir chez l’ennemi, mais ce qu’il n’ose dire c’est qu’il a ressenti une certaine jouissance à tuer parce que l’impunité était la règle et qu’il ressentait une impression de puissance dont aujourd’hui il a honte. D’ailleurs officiellement il ne s’est rien passé et le procès qui a évoqué le massacre se traduit par un classement vite oublié.
De son côté l’écrivain décrit son parcours, règle quelques comptes et la galère du début laisse place petit à petit à la notoriété, au succès, à l’argent facile et aux conquêtes féminines. Cette célébrité, ce parcours brillant et cette consécration font qu’il néglige sa famille au profit de sa carrière et lui donne la certitude que tout lui est permis et, toutes choses égales par ailleurs, il ressent cette même impression de toute puissance qui était celle de Rodney au Vietnam. En une sorte de fulgurance (à la vitesse de la lumière) il en prend conscience et se sent responsable de la mort accidentelle de sa femme et de son fils. Pour lui comme pour son ami, son impression de toute puissance, Rodney avec son arme, lui avec sa plume, leur donnent l’impression d’être des Dieux. Rodney était obsédé par ceux à qui il avait donné la mort face à la fragilité de la vie, la narrateur se sent coupable de la disparition des siens parce qu’il les a négligés. En tout cas les deux ressentent un terrible sentiment de solitude face au poids de leur passé qui les rend haïssables et méprisables à leurs propres yeux, qui leur ôte le goût de vivre, qu’ils combattent avec alcool et drogue. Ce qui les a uni, bien des années après, ce sont les larmes, celles du deuil pour Cercas et du remords et de la révolte pour Rodney. L’écrivain se découvre lui-même comme un véritable zombi, un fantôme en état d’hibernation, au bord du gouffre de la mort et évoque cette « porte de pierre » qu’il ne pourra jamais franchir, un assassin qui espère sans trop y croire dans le rôle rédempteur de l’écriture. Il écrira pourtant son livre, mêlant son destin à celui de son ami, pour maintenir en vie les morts, témoigner de leur passage sur terre mais aussi, à titre plus personnel, pour se faire pardonner ses trahisons, pour se sortir du piège dans lequel il s’était lui-même enfermé et faire échec à sa propre mort.
Comme toujours j’ai apprécié cette lecture non seulement parce que le texte est bien écrit et évidemment bien traduit, parce que, dès lors que j’ai ouvert un des romans de Cercas, il m’est difficile de le lâcher, mon attention étant maintenue en éveil jusqu’à la fin. Non seulement il parle, malgré quelques longueurs, de l’écriture, du métier d’écrivain avec ses grandeurs, ses servitudes et ses illusions, de l’impossibilité d’exprimer le message qu’il entend faire passer, à cause de la hantise de la page blanche mais aussi de la perpétuelle envie de remettre à plus tard ce devoir d’expression. Il pose de problème de la notoriété, du succès littéraire, de la vertigineuse euphorie du succès qui vous font passer pour un intellectuel, c’est à dire un être à part qui, après des années de galère, mène une vie différente d’avant, même si celle-ci le précipite dans la marginalité et le désespoir. Il analyse avec force détails son parcours, ses succès, ses échecs dans la publication de ses œuvres, ses périodes d’abattement de doute, d’humilité parfois forcée,
Il s’agit d’une sorte de mise en abyme, un roman qui s’écrit à l’intérieur même d’un autre roman où se mêle autobiographie avec une foule de détails personnels sur ses livres et sa vie et une fiction inspirée d’autres expériences. L’auteur évoque une guerre qu’il n’a évidemment pas faite mais il choisit, comme souvent, d’en dénoncer les violences et les atrocités mais se retrouve aussi face à lui-même. Le lecteur ne tarde pas à s’apercevoir qu’il s’agit moins d’un roman au sens traditionnel du terme que d’une réflexion de Cercas sur lui-même, sur son métier d’écrivain, ses romans. C’est vrai que chaque auteur puise dans sa vie et dans ses expériences la matière de son œuvre, c’est ce qui en fait la valeur et l’originalité même s’il tombe dans un solipsisme parfois dérageant. Ici je ferai difficilement la part des choses entre le roman, c’est à dire l’imagination et la réalité qui relient la guerre du Vietnam et ses atrocités à la mort d’un enfant et d’une épouse.
J’ai lu ce livre comme une longue réflexion sur le sens de la vie humaine, où destiné et liberté se conjuguent et s’affrontent, se rejoignent parfois sans qu’on sache très bien laquelle prend le pas sur l’autre, la vanité des choses humaines, leur aspect transitoire, la faculté de trahir les siens et l’hypocrisie de vivre ainsi, éternelles interrogations et compromissions de l’homme.
-
Les soldats de Salamine
- Le 31/07/2022
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°1656- Juillet 2022
Les Soldats de Salamine– Javier Cercas – Actes sud.
Traduit de l’espagnol par Élisabeth Beyer et Aleksandar Grujičič.
Le titre du roman fait allusion à la victoire de la flotte grecque sur les navires perses beaucoup plus nombreux, en 480 av J-C . Ce récit traite bien d’une guerre (ou d’un épisode de celle-ci), mais elle est plus contemporaine. Il s’ouvre en effet sur l’exécution manquée de l’écrivain-poète-journaliste espagnol Rafael Sanchez Mazas (1894-1966), un des fondateurs de la Phalange, par les Républicains vaincus qui fuyaient. Il eut en effet la chance d’être épargné par les balles du peloton et se cacha dans la forêt. Retrouvé par un milicien, ce dernier déclara à ses chefs n’avoir rien vu et lui sauva donc volontairement la vie. Ce genre d’épisode romanesque existe sans doute dans tous les conflits mais Mazas s’en est fait l’écho au point d’en faire une sorte de légende, voire une supercherie, savamment entretenue par lui-même de son vivant puis après sa mort par sa famille.
Javier Cercas entreprend d’écrire cette histoire à partir de cette anecdote et auparavant d’en vérifier son authenticité à travers différents témoignages disponibles mais cette recherche le transforme rapidement en biographe de Sanchez Mazas, c’est à dire ses origines familiales, son parcours littéraire et politique à l’intérieur de la Phalange, mais il ne s’interdit pas, devant les lacunes des documents à sa disposition et la confusion qui baigna cette période troublée, mais aussi face à l’insolente chance de Mazas, d’imaginer ce qu’il ne sait pas. Ainsi mêle-t-il dans son récit l’imaginaire du romancier à la précision de l’archiviste. La fin de vie de Mazas fut moins glorieuse, plus indolente et égoïste, davantage consacrée à la politique qu’à la littérature, plus mélancolique et désabusée aussi et l’oubli acheva de recouvrir les quelques traces qu’il laissa de son passage sur terre. Restait pour l’écrivain qu’est Javier Cercas, et surtout pour conclure son livre, à identifier le milicien anonyme qui sauva Mazas, ou à l’inventer. Il n’y avait à priori rien de commun entre eux et même toutes les raisons pour que cet homme le dénonce ou le tue, les troupes républicaines étant à l’agonie. .
Dès lors quel est le lien entre Mazas et les soldats de Salamine ? Mazas aurait eu l’intention de relater cette histoire d’exécution manquée et de donner ce titre à son récit, titre qui a été repris par Cercas pour le sien. Écrire un livre est toujours une aventure et comme beaucoup d’écrivains Cercas fut victime de son livre c’est à dire de la propre vie de ce dernier, de son indépendance, de sa liberté, à moins qu’il n’ait lui-même et inconsciemment manqué son but. Bref il était déçu de son travail . Il n’avait pour ce récit que la version nationaliste de Mazas, il considérait donc qu’il lui fallait pour être complet la version républicaine mais il voulait surtout mettre un visage, et peut-être un nom sur le fantôme de ce milicien. Le hasard voulut qu’il rencontra un survivant républicain de la Guerre Civile avec qui il évoqua ses derniers moments dans l’armée républicaine, sa fuite vers la France et le camp d’Argelès, son engagement dans la division Leclerc, sa folle équipée africaine puis française et l’imagination créatrice de Cercas ne put s’empêcher de relier à l’aventure de Mazas à celle de ce milicien anonyme qui lui sauva la vie.
Je voudrais en aparté évoquer le sort de ces républicains contre qui la France n’était pas en guerre mais qui les accueillit d’une façon honteuse, bien indigne du pays des droits de l’homme et de la liberté qu’elle est censée être. Dans le camp d’Argelès comme dans bien d’autres, des êtres humains sont morts faute de soins et même des plus élémentaires actes de simple humanité. Après avoir été connu l’opprobre de la défaite ils eurent à souffrir des exactions injustifiées des troupes coloniales françaises. Ils ne nous en voulurent cependant pas puisque les survivants s’engagèrent dans la légion étrangère pour combattre le nazisme. Faut-il rappeler que les premiers militaires à libérer Paris furent ceux de la 2°DB de Leclerc et plus précisément la compagnie du capitaine Dronne, « La Nueve », composée principalement … de républicains espagnols qu’on choisit d’ailleurs d’oublier une seconde fois en ne les citant pas parmi les troupes libératrices.
Je me suis très tôt passionné pour cette guerre d’Espagne mais je n’ai abordé l’œuvre de de Javier Cercas dont j’ignorais l’existence, qu’à la faveur d’un prêt amical de livre (« Terra Alta »). Je n’ai pas été déçu par ce que j’ai lu et je dois avouer que lorsque j’ouvre un de ses livres, j’ai beaucoup de mal à m’en détacher à cause du style clair (servi sans doute par une bonne traduction) et ce malgré quelques longueurs que je lui pardonne volontiers. L’intérêt qu’il a suscité m’a incité à poursuivre la découverte de son univers créatif et ce d’autant plus que j’ai ai apprécié cette invitation à réfléchir sur la dimension morale et philosophique du récit offert à la lecture. J’ai par exemple toujours été scandalisé qu’on oublie le sacrifice de quidams, souvent des étrangers, qui sont morts pour que les générations suivantes d’un pays qui n’était pas le leur soient libres et parlent le français et qu’on ne retiennent, le plus souvent, que les noms des dirigeants emblématiques.
Ce roman a été adapté au cinéma en 2003 par David Trueba.
En Espagne, sous la dictature de Franco, le souvenir de la guerre civile a été complètement occulté. Sous le régime suivant, plus démocratique, on a cherché à oublier toutes ces atrocités. Ce n’est que lors de la génération suivante, qui n’a évidemment pas connu ce conflit, que les jeunes écrivains espagnols s’en sont emparés, se le sont même approprié et l’ont intégré à leur œuvre, comme pour en exorciser toutes les horreurs. Javier Cercas, né en 1962 est de ceux-là. Je vais poursuivre la découverte de son œuvre.
-
Le monarque des ombres
- Le 31/07/2022
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°1657- Juillet 2022
Le monarque des ombres – Javier Cercas – Actes sud.
Traduit de l’espagnol par Karine Louesdon et Aleksandar Grujičič.
Celui qui se cache derrière ce titre, c’est Manuel Mena, le grand oncle maternel de l’auteur, sous-lieutenant phalangiste, mort à dix-neuf ans à la bataille de L’Ebre en 1938. Cette mort héroïque d’un jeune homme fut une sorte de fierté familiale dans ce village désolé d’Estremadure malgré l’avènement de la République et la tragique guerre civile. L’oubli reste une des grandes énigmes de l’espèce humaine, même au sein des familles et l’auteur, après avoir longtemps refusé d’évoquer l’histoire de ce parent, a résolu de le faire, pour lui mais surtout pour sa famille, comme un devoir de mémoire, une obligation morale et personnelle, parce que rien n’avait été fait auparavant au sujet de cet homme et que les choses écrites non seulement perdurent plus longtemps mais surtout ont une apparence de vérité. Il va donc, un peu malgré lui, parler de sa famille et de cet aïeul, et ce faisant, rouvrir les plaies de cette guerre civile que la génération précédente avait voulu oublier. Il va parler de cet homme, mort jeune pendant ce conflit fratricide qui divisa même les familles, évoquer le rapide passage sur terre de quelqu’un qui a combattu les armes à la main pour défendre l’idée qu’il se faisait du destin de son propre pays. Il va donc se rendre dans cette maison familiale désormais vide, dans ce village d’Estremadure qu’il a quitté depuis longtemps où une rue porte le nom de ce sous-lieutenant, avec le risque d’apprendre sur lui des choses qui ne vont pas forcément dans le sens du souvenir qu’il a laissé. En effet Javier Cercas a une sensibilité de gauche et parler ainsi de ce grand oncle qui a combattu volontairement dans les rangs franquistes, c’est à dire fascistes, tient un peu de la gageure. Il va rencontrer des membres de sa famille qui l’ont connu, retrouver des anciennes lettres, de rares photos, évoquer son souvenir, rafraîchir la figure un peu oubliée de ce garçon tout juste sorti de l’adolescence, enthousiaste à l’idée de combattre, animé d’un esprit de sacrifice, mort en pleine jeunesse les armes à la main pour défendre une certaine idée de son pays qui lui av ait été forgée par ses parents, même s’il eût été plus logique qu’il se tournât vers l’idéal républicain et ses réformes, dans cette famille modeste d’une province pauvre et désolée aux mains de grands propriétaires terriens. Cercas le fait avec un certain sentiment de culpabilité, ravivant le deuil de ceux qui l’ont aimé et ont survécu, même s’il retisse et nourrit la légende de Manuel qui ne vieillira pas, ne sera jamais la victime du temps, ne connaîtra jamais la vieillesse avec ses altérations physiques, ses regrets, ses remords, ses phobies... Qu’on le veuille ou non, il y a une certaine aura à mourir jeune. Puis, petit à petit, cette statue se lézarde, cette silhouette un peu fantomatique d’un jeune garçon enthousiaste et idéaliste, trop tôt mûri par les événements tragiques qu’il a été amené à vivre et qui le dépassaient, s’affine pour laisser place à un homme mélancolique et solitaire qui portait sur ce monde qui l’entourait un regard à la fois désabusé et fataliste, se rendant compte de la réalité absurde des choses qui l’avaient amené là où il était.
Cela commence un peu laborieusement sous forme de biographie qui mêle l’histoire de cette famille et de ce village, à celle de l’Espagne devenue républicaine, avec des souvenirs d’école, des remarques sur la passivité et l’inconstance des gens qui votent en fonction des circonstances et surtout contre leur intérêt, un projet de livre puis de film avec David Trueba. Le texte est un peu bizarre puisqu’il évoque l’histoire de cette famille en parlant de l’auteur, Javier Cercas, alternativement à la troisième personne mais aussi en lui donnant la parole. Il refait, avec la précision d’un historien, le parcours de certains de ses membres entre engagements républicains et franquistes (ou phalangistes) dans la grande tourmente de cette époque dont Antoine de Saint-Exupéry, alors reporter, a pu dire « ici on fusille comme on déboise ». Le grand oncle de l’auteur ne vécut de douze mois dans son grade d’officier, mais il le fit intensément comme un combattant convaincu de la justesse de la cause qu’il défendait. Cette évocation brise un peu la légende et conte la véritable histoire de Manuel, malgré les erreurs des documents administratifs régimentaires et comptes-rendus de mouvements des troupes. Cela prend même par moments la forme ennuyeuse d’un rapport militaire sur les attaques, les contre-attaques, les positions perdues puis reprises, le décompte des morts et des blessés, les distinctions obtenues, les remarques sur la stratégie et ses conséquences … Je m’interroge également sur la qualification de « roman » donné au livre alors que, plus j’avançais dans ma lecture plus j’avais la certitude de ne lire qu’une chronique d’où l’imagination était absente et qui dessinait petit à petit le vrai visage de ce jeune homme oublié. L’épilogue, s’il ne doit rien à la fiction, a cependant son pesant d’émotions qui fait de ce texte autre chose qu’un simple récit.
Reste le titre un peu énigmatique comme c’était déjà le cas dans un précédent livre (« Les soldats de Salamine »). Manuel Mena a été après sa mort idéalisé par la mère de l’auteur, il est pour elle à l’image d’Achille dans l’Iliade d’Homère, combattant pour une cause qui le dépasse et qui meurt au combat, l’homme d’une vie brève et d’une mort glorieuse en pleine jeunesse qui couronne une belle vie et le fait accéder à l’immortalité, qui règne sur les défunts, « le monarque des ombres », l’idéal grec, l’exact contraire d’Ulysse qui, vivant, connaît la vieillesse.
Cette démarche littéraire enfin aboutie a quelque chose d’extraordinaire, non seulement parce qu’elle tire de l’anonymat et raconte l’histoire de ce jeune homme entraîné dans la tourmente de cette horrible et meurtrière guerre civile, mais aussi parce qu’elle parle de lui comme de quelqu’un qui a été amené à combattre pour les intérêts des autres, contre les siens propres mais qui l’a fait avec l’enthousiasme de la jeunesse et y a perdu son unique bien, sa vie, avec l’illusion que la cause pour laquelle il se battait était juste. Qu’aurait-il pensé, s’il avait survécu, de la quarantaine d’années de dictature qui s’ensuivit ?
Il y a aussi la démarche de l’auteur dans l’écriture de cette histoire. Au terme de ce saut dans le passé de sa famille, de réticent au départ, il se sent obligé de la transcrire parce qu’il est écrivain, seul sans doute parmi sa parentèle capable d’écrire une telle chose, mais aussi parce que, désormais dépositaire de ces révélations jusqu’alors secrètes, il en devient responsable, et, l’écrivant, il s’en libère aussi parce que l’écriture a ceci de miraculeux que les mots ont à la fois ce pouvoir de partage et de résilience au terme duquel celui qui tient la plume se révèle à lui-même, et ce bien que je ne partage pas tout à fait sa vertigineuse prise de conscience culpabilisante à la fin.
En Espagne, sous la dictature de Franco, le souvenir de la guerre civile a été complètement occulté. Sous le régime suivant, plus démocratique, on a cherché à oublier toutes ces atrocités. Ce n’est que lors de la génération suivante, qui n’a évidemment pas connu ce conflit, que les jeunes écrivains espagnols s’en sont emparés, se le sont même approprié et l’ont intégré à leur œuvre, comme pour en exorciser toutes les horreurs et tous les mensonges. Javier Cercas, né en 1962 est de ceux-là. Je lui sais gré de sa démarche si bien exprimée et incitatrice de réflexions.
-
L'imposteur
- Le 31/07/2022
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°1660- Août 2022
L’imposteur – Javier Cercas – Actes sud.
Traduit de l’espagnol par Elizabeth Beyer et Aleksandar Grujičič.
Enric Marco (né en 1921 en Catalogne) est connu pour avoir été militant anarchiste pendant la guerre d’Espagne, exilé en France, déporté par les nazis et grand témoin de la déportation des Espagnols, anti-franquiste, syndicaliste, jusqu’à ce qu’un journaliste espagnol démontre la supercherie en 2005. Il ne pouvait donc qu’être un sujet d’étude et aussi un personnage pour Javier Cercas, observateur attentif de l’espèce humaine. Pourtant, si une telle imposture provoque à priori des réactions contradictoires compte tenu du contexte, notre auteur est tenté de faire de lui un héro de roman simplement parce que sa vie elle-même est un roman et qu’un écrivain de son importance, qui est habitué à manier la fiction dont personne n’est dupe, peut avoir ainsi l’occasion d’un best-seller. Cependant cette démarche peut parfaitement accréditer les affirmations de Marco et ainsi nourrir la légende qu’il a lui-même construite. Pourtant, Cercas, à la suite de ce journaliste, dans une enquête minutieuse qui se révèle parfois un peu fastidieuse pour le lecteur, s’attache à démonter toutes les pièces de ce dossier qui se révèle mensonger. Il s’ensuit une longue réflexion sur la démarche de Marco, sa personnalité, son parcours, ses raisons d’agir ainsi dans un contexte de mémoire de la Shoah, l’appropriation de la guerre civile, du combat des républicains pour la liberté et des crimes du franquisme par une génération qui ne les a pas connus. Ce livre peut être regardé comme un paradoxe puisque Cercas s’insurge contre la duperie de Marco mais en même temps celui-ci exerce sur lui une sorte d’attirance. En effet, de même que l’écrivain de fiction transforme sa propre existence en créant des personnages et des situations qui n’existent pas, Marco qui n’est qu’un quidam, se révolte contre sa vie minable, la réinvente à la manière d’un créateur de fiction en se prêtant à lui-même des rôles qu’il n’a jamais eus.
D’une manière générale, mentir est mal, c’est à tout le moins ce qu’on nous enseigne dans notre enfance, mais tout être normalement constitué s’aperçoit très vite que le mensonge est vital si on veut mener une vie apparemment normale au quotidien. Non seulement on ne compte plus ceux qui, de leur vivant, ont tressé et nourri leur propre légende pour s’imposer dans la société, soit pour en tirer des avantages, soit pour impressionner leur auditoire, soit simplement par orgueil personnel… et ont fini par y croire eux-mêmes mais aussi ceux qui passent leur temps à s’auto-encenser. Le mensonge sous toutes ses formes, de la simple cachotterie d’enfance au scandale d’État en passant par la tromperie banale, la trahison ordinaire ou l’adultère, fait donc partie intégrante de l‘espèce humaine et ceux qui s‘obstinent à la pratique de la sincérité sont de plus en plus rares et le font pour des motifs moraux ou religieux. Avec les promesses électorales non tenues, les palinodies et les tricherie des hommes politiques qui entretiennent l’anti parlementarisme, les « fake news » des réseaux sociaux, les propos révisionnistes,.. nous sommes servis. D’autre part, concoctez une petite escroquerie bien léchée en essayant de penser à tout, ça ne prend pas et vous vous heurtez à la dénonciation et à la critique, mais bâtissez un énorme canular sans nuances ni même sans vraisemblance et il est d’emblée accepté sans contestation, surtout quand les temps sont troublés par des guerres ou des périodes agitées où les informations ne sont que parcellaires. C’est bien connu, plus le mensonge est gros plus il prend !
Cercas, après avoir longtemps hésité à écrire ce livre, mène donc à cette occasion, en dehors de toute fiction, une réflexion sur la mémoire historique où réalités et imaginaire s’entremêlent, s’appropriant cette meurtrière guerre civile qui ensanglanta l’Espagne et ses conséquences, dénonçant autant l’amnésie que la naïveté qui font partie de la nature humaine. Il s’interroge sur le cas de cet homme qui aurait normalement dû resté inconnu mais qui a pris une dimension internationale inattendue grâce à ses couches successives d’affabulations, dans un contexte romantique de martyr laïque comme survivant des camps de concentration et de lutte pour la liberté. Le canular a certes été démonté, les contradictions révélées et la réalité reconstruite, mais l’histoire, toujours écrite par les vainqueurs, nous a légué des vérités officielles qui perdurent toujours et s’encrent dans le temps.
Cercas montre Marco tel qu’il est, narcissique, mythomane, manipulateur, amoureux de lui-même, désireux de refaire sa morne vie à sa manière mais si « la fiction sauve, la réalité tue » parce que, selon Faulkner, le passé n’est qu’un élément du présent et finit toujours par vaincre ceux qui veulent le manipuler. La morale est sauve en quelque sorte… Pour une fois !
Je trouve que Cercas s’en tire bien parce que le sujet était ardu et à priori difficile à traiter face à une opinion publique facile à abuser. En ce qui concerne Marco, il contribue à remettre les choses à leur vraie place et peut-être à inviter à contester les vérités les plus établies et entretenues par la mémoire collective à propos de certains de nos contemporains.
Depuis que je lis les œuvres de Javier Cercas j’apprécie qu’il soulève à l’occasion d’un livre des questions importantes. Ici , comme d’ailleurs dans l’enquête du journaliste espagnol auparavant, ce qui est dénoncé a peut-être (peut-être seulement) contribué à libérer Marco de la bulle dans laquelle il s’était lui-même enfermé et où il finissait par être un peu à l’étroit.
-
Ode maritime - Alvaro de Campo
- Le 14/03/2022
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°1631 - Mars 2022
Ode maritime– Fernando Pessoa (Alvaro de Campos) – Éditions Fata Morgana.
Ce sont des poèmes parus en 1915 dans le deuxième et dernier numéro de l’éphémère revue « Orpheu » dirigée par Pessoa. Ils sont signés d’Alvaro de Campos, un hétéronyme proche du grand écrivain portugais. Ce personnage quelque peu anglo-saxon malgré sa naissance est une création de Pessoa a eu une vie (1890-1935), un horoscope, il est un ingénieur naval à monocle, a navigué, notamment en Orient puis est revenu à Lisbonne où il est mort. C’est un poète d’avant-garde qui est à la fois semblable et différent de son créateur, chantre du modernisme et un auteur pétri de fantasmes et de mystères. Dans ces poèmes Pessoa se cache et se dévoile alternativement comme il le fait également avec ses autres hétéronymes. C’est autant une manière de s’exprimer qu’une manière d’être, une façon de se dédoubler en s’analysant lui-même, en semant des interrogations dans l’esprit de ses lecteurs tout autant que de donner volontairement une réalité à son esprit multiforme, aussi original qu’inattendu.
C’est une poésie à la fois simple, complexe et tourmentée, avec des accents quasi surréalistes, quelque peu masochistes et parfois violents, qui ressemble à une longue litanie et parfois même à une épopée, tournée ici principalement vers le mystère que génèrent la distance, l’inconnu, le voyage avec ses départs et ses arrivées. C’est un long poème de plus de mille vers que j’ai eu plaisir à lire à haute voix pour partager la magie des mots. Il parle de la mer, du large, des navires et donc du port qui en est le point de démarrage. Voir le bateau qui quitte le quai est une invitation au rêve de découvertes et de rencontres pour celui qui part et de mélancolie pour celui qui reste à terre et se contente de voir le sillage et la fumée du navire qui disparaît. C’est une facette de cette « saudade » qui fait tellement partie de l’âme lusitanienne dont le destin est fait de voyages, d’exils et d’ailleurs.
Puis c’est le retour à la réalité, l’acceptation de l’existence anonyme et oubliée, celle des quidams qui sont condamnés à regarder partir les autres et à rester seuls avec leurs regrets et leurs remords. Il y a dans ces textes, les premiers vers qui évoquent le retour d’un bateau, une idée très portugaise du retour, celle du « sebastianisme », du nom de Sébastien 1° roi du Portugal (1554-1578) qui mourut au cours d’une bataille au Maroc et dont la tradition veut qu’il ait survécu et qu’il revienne un jour au Portugal.
La distance s’analyse aussi dans le temps, à travers la mémoire du passé, le souvenir de l’enfance heureuse et calme, accrochée aux murs d’une maison aimée .
De tout cela je retire un sentiment de solitude, de tragique, sans oublier le mystère qui réside dans le personnage même de Pessoa.
-
poèmes païens - Alberto Caeiro - Ricardo Reis
- Le 04/03/2022
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°1630 - Mars 2022
Poèmes païens – Alberto Caeiro et Ricardo Reis - Christian Bourgois éditeur.
Pessoa est un cas à part dans l'histoire de la littérature. Il a passé sa vie dans un bureau comme un discret employé aux revenus modestes, n'a pratiquement rien publié de son vivant sous son nom propre et est mort pratiquement inconnu, laissant le soin à ceux qui le suivraient de découvrir ses poèmes écrits parfois au dos de vieilles factures et déposés dans une malle ou éparpillés sur des feuilles et de les publier, ce qu’ils firent. Il est pourtant considéré comme un des plus grands écrivains portugais, à l'égal de Camões
Ces deux auteurs n’ont jamais existé autrement que dans l’imagination et sous la plume de Fernando Pessoa (1888-1935). Ils sont parmi ses nombreux hétéronymes (on en dénombre 72) les plus importants. Ce terme n’est pas un simple pseudonyme, pas non plus un artifice littéraire ou une manière de se cacher, d’avancer masqué . Il y a ici une idée d’opposition entre tous ces personnages qui lui permet d’analyser et d’exprimer les arcanes de son « moi », une façon pour lui « d’être un autre sans cesser d’être lui-même » et peut-être aussi une forme de thérapie face à une vie solitaire d’écorché-vif. C’est l’occasion de révéler son style à la fois prolifique et protéiforme, sa modernité, son anti-conformisme, sa volonté de révolutionner l’art et de le marquer son empreinte comme il l’a fait dans son éphémère revue « Orpheu ». En effet, Pessoa les a crées, leur a prêté une vie, et parfois une mort, une sensibilité, une personnalité, un horoscope, a écrit pour eux une œuvre différente de la sienne et qui ne se ressemblent pas non plus à celle des autres hétéronymes.
Parmi tous ses nombreux hétéronymes, Ricardo Reis a une place de choix. Selon Pessoa lui-même, cet « auteur » se serait imposé de lui-même. Ricardo Reis est un lettré, éduqué chez les jésuites portugais, son style est emprunt d’une rigueur stoïcienne et d’un épicurisme sobre à la manière d’Horace, c’est un humaniste, un intellectuel au vocabulaire choisi (« les odes »), un poète de l’instant fugitif, respectueux de la stricte règle prosodique. Cela est dû à la formation classique où prédominait le latin, reçue par Pessoa lors de sa scolarité en Afrique du sud. Il est médecin, monarchiste, ce qui fera de lui un exilé au Brésil quand la république sera instaurée au Portugal. Il y a chez lui un certain fatalisme face à la vie et à la mort.
Alberto Caeiro(1889-1915) est une sorte de berger (« Le gardeur de troupeaux ») sans grande éducation dont la poésie est simple et spontanée, tournée vers la terre et les sens. Son écriture bucolique, sobre et dépouillée, et parfois même lourde, est à contre-courant du classicisme portugais de cette époque (1914) . On peut même y voir un certain humour. Il est le poète de la simplicité, de la nature, des choses vues et vécues. Il regarde le monde avec des yeux presque naïfs, se méfiant des intellectuels et de leur créations fantasques et éthérées, des mystiques et des espoirs fous qu'ils insinuent dans l'esprit des autres hommes. Il a conscience de n’être rien en ce monde, de n’être ici que de passage et évidemment voué à l’anonymat et à la disparition silencieuse. Il est celui qui prône l'indifférence face au monde des grandes idées qui le bouleversent et lui oppose un monde plus sensuel du quotidien.
Ces poèmes sont dits païens parce qu’ils sont tournés vers les sens, les sensations, l’inverse du mysticisme, peut-être aussi parce qu’ils sont écrits d‘une manière irrévérencieuse au regard de la religion chrétienne, qu’ils célèbrent la vie qui n’a pour issue que la mort.
C’est toujours un plaisir de relire Pessoa. Il reste pour moi un écrivain fascinant parce qu’il a été et parce ce qu’il a écrit.
-
Les Vilaines - Camila Sosa Villada
- Le 18/01/2022
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°1621 - Janvier 2022
Les vilaines – Camilla Sosa Villada - Métailié
Traduit de l'espagnol par Laura Alcoba
Dans le Parc Sarmiento de la petite ville de Cordoba (Argentine) où travaillent les trans, on vient de trouver un nourrisson. Aussitôt adopté par la communauté il sera donc arraché à une mort certaine et vivra dans ce milieu d'hommes devenus femmes. C'est l'occasion de faire connaissance avec un membres de ce groupe à la fois solidaires et agressifs dont Tante Encarna, un femme authentique et malheureuse, qui en est la figure tutélaire et une véritable mère pour elles. C'est elle qui prend cet enfant sous son aile, le défend, le protège pour qu’il conserve le plus longtemps possible sa joie de vivre dans un univers qui se veut festif mais qui est pourtant est fait de douleur et de rejet. Le but sera de l'en mettre à l’abri. C'est d'abord Camilla qui raconte sa vie quand elle s'appelait encore Cristian, un garçon efféminé qui vivait dans un petit village entre une mère soumise et un père alcoolique et violent. C'était alors un garçon qui voulait devenir une fille et en adoptait toutes les apparences, surtout en cachette de ses parents. Il était la honte de cette famille, stigmatisé par son père. Les circonstances de sa vie l'amènent à la prostitution qui lui permet une indépendance financière, une nouvelle vie par rapport à la pauvreté de ses parents et donc à plus de liberté, mais aussi qui lui fait connaître la pire facette de la société respectable de ses contemporains. Suivent une galerie de portraits plus désespérés et dévastés les uns que les autres, entre fantasmes et exubérances, tendresse et folies, des parcours d'êtres mal dans leur peau, qui aspirent à être autre chose que ce que la nature a fait d'eux, que la société en apparence honorable rejette, moque, bannit et éventuellement détruit tout en s'en servant pour assouvir des pulsions sexuelles les plus secrètes et violentes. Ceux qu'on appelle les "trans" sont cantonnés pour survivre dans la clandestinité et la solitude, dans cette frange sociale qui ressemble à un esclavage qui ne dit pas son nom. Ici plus qu'ailleurs la misère, la souffrance, le sida, l’alcool, la drogue et la mort font partie du décor, du quotidien et guettent leurs proies faciles. Cette volonté d'humiliation, c'est un peu comme si leur présence réveillait ce qu'il y a de pire dans l'être humain ordinaire, un peu comme si les trans étaient le catalyseur des refoulements et des peurs que les autres portent en eux.
J'avoue que je suis assez partagé face à ce premier livre de Camilla Sosa Villada qu'on présente comme un roman alors qu'il s'agit d'un témoignage. Il a la fougue d'une première œuvre, la volonté de dire les choses crûment, sans fard littéraire, avec des mots aussi bruts que les nombreuses anecdotes dont est fait ce livre mais cette lecture m’a paru un peu fastidieuse. Il montre une facette peu glorieuse de la société évoquée, faite surtout d’hypocrisies et de tabous mal assumés, mais qui est. Toutes choses égales par ailleurs, parfaitement transposable à la nôtre. Cette communauté qui est sans doute la plus mal connue, sert d'exutoire à la société officielle et respectable, tolérée par un morale officielle et une religion bien pensantes mais qui en profite en secret.
J'ai lu cet ouvrage jusqu'au bout à cause de sa sélection à un prix littéraire pour lequel il est en lice mais ces propos ont tissé un malaise qui met en exergue des tranches de vie partagées entre tendresse et terreur, peur et humiliation, rires et larmes, ivresse et culpabilité pour cacher, une autobiographie poignante qui bouscule l'univers ordinaire de l’écriture souvent inscrit dans l'imaginaire ou le merveilleux.
-
l'année de la mort de Ricardo Reis - José Saramago
- Le 01/09/2021
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°1578 - Août 2021
L’année de la mort de Ricardo Reis – José Saramago – Éditions du Seuil.
Traduit du portugais par Claude Pages.
L’œuvre de Fernando Pessoa (1887-1935) qui est assurément l’écrivain portugais le plus célèbre, est originale a plus d’un titre et notamment parce qu’il a attribué ses propres écrits à des personnages fictifs, les hétéronymes, qui, à la fois lui ressemblaient partiellement mais étaient différents entre eux. Il s’agit d’un groupe d’écrivains imaginaires auxquels le poète portugais a non seulement donné une vie littéraire mais à qui il a insufflé une personnalité et un destin propres. Ricardo Reis est l’un de ces hétéronymes, médecin de son état, 48 ans (soit un de plus que Pessoa), il est aussi le poète de la fuite du temps, un « épicurien triste ». Il revient du Brésil en décembre 1935, averti par Alvaro de Campos, un autre hétéronyme, soit un mois après la mort de Pessoa, après un exil de 16 années pour raisons politiques. Il évoque sa mémoire et son œuvre poétique, cite d’autres hétéronymes, Alvaro de Campos, Careiro et le poète portugais Camões, lit les journaux, arpente la ville. Il se domicile à l’hôtel Bragança où il mène une vie une vie solitaire, entame une liaison ordinaire avec Lidia puis un autre beaucoup plus romantique avec Marcenda, c’est à dire est en quelque sorte fidèle à son personnage, bref, une sorte d’anti-héros. Plus tard il prendra un appartement ce qui changera quelque peu sa vie. Il regarde le spectacle de l’Europe après sa longue absence, fait l’objet de filatures policières, rencontre le fantôme de Pessoa et devise avec lui de l’actualité d’alors, de la dictature de Salazar, de la montée des périls fascistes, de la guerre qui se déroule en Espagne et surtout de la ville de Lisbonne qu’il arpente sur les traces de l’écrivain dont l’ombre semble l’accompagner dans une cité labyrinthique, comme Virgile accompagne Dante aux Enfers… En réalité cette intrigue selon Saramago est assez simple, répétitive et peut-être considérée comme ennuyeuse. J’y vois, pour ma part, une certaine manière de traduire « la saudade », cette forme de nostalgie qui fait partie de l’âme portugaise.
Reis est la créature de Pessoa et le fait que Saramago s’en empare n’est pas sans créer une certaine ambiguïté. En effet un personnage fictif ne vit qu’autant que son auteur le décide. Ici Pessoa est mort alors que Reis est encore « en vie » et Saramago se l’approprie. Il joue de ces deux non-existences, celle de Pessoa, dont le nom signifie personne, et qui passa la sienne dans un quasi anonymat et celle de Reis qui se retrouve « abandonné » et qui devient ainsi un personnage de Saramago. Il prend le contre-pied de cette lusitanité en ce sens que les Portugais sont un peuple de voyageurs qui quittent leur pays sans y revenir (mythe du « sébastianisme ») mais Reis revient par la mer, dans son pays pour y mourir. Cette appropriation peut être regardée comme un mensonge en ce sens que, pour Saramago, Reis n’est pas qualifié à proprement parlé d’hétéronyme mais il devient un personnage qui va vivre sa vie pendant près de neuf mois dans le cadre de cette fiction, sous la plume de Saramago.
Ce roman est donc une fiction dans la fiction, une sorte de mise en abyme, avec jeux de miroirs ou trompe l’œil, un peu comme on pouvait le voir dans les anciens compartiments de chemin de fer où des glaces disposées en face l’une de l’autre produisaient une image multipliée à l’infini. Saramago, auteur majeur de la littérature contemporaine, couronné par le Prix Nobel en 1998, reste fidèle à son style à la fois simple et énigmatique , labyrinthique parfois et dont l’architecture peut instiller une ambiance assez lourde par moment. Ricardo Reis est, avec Alberto Caeiro, Alvaro de Campos et Bernardo Soares un des principaux hétéronymes de Pessoa (En réalité ils sont bien plus nombreux, on en dénombre un peu plus de 70, chacun avec sa propre personnalité). Saramago se l’approprie tout en précisant ce qui, selon lui faisait la philosophie et la vie de son sujet. Il lui fait arpenter les rues de Lisbonne ainsi que le faisait Pessoa lui-même et c’est aussi un hommage au poète de « Mensagem », à juste titre célébré comme un des plus grands écrivains portugais.
On peut se demander pourquoi Saramago a voulu ainsi faire revivre un personnage fictif ? Etait-ce pour prendre la place de Pessoa et donner à Reis une fin comme Pessoa l’a fait pour les autres hétéronymes?(Alberto Caeiro est mort en 1915 à 26 ans, Alvaro de Campos est mort en 1935 à 45 ans ) Peut-être ? Saramago nous le dépeint comme un homme désabusé, bien seul et dénué de tout sentiment, surtout après son voyage avorté à Fatima et qui songe soit à repartir pour le Brésil soit à s’installer comme médecin à Lisbonne. Marcenda qui est repartie pour Coimbra lui a en quelque sorte échappé, seule Lidia reste à ses côtés mais il regrette Marcenda qui était une jeune fille de bonne famille alors que Lidia n’est qu’une domestique quasiment analphabète. L’ennui est que cette dernière est enceinte mais il ne l’épousera pas et ne reconnaîtra même pas son enfant. Le fantôme de Pessoa, et peut-être Saramago avec lui, fustige cette attitude avant de disparaître définitivement. Veut-il ainsi montrer le vrai visage de Reis, un lâche qui refuse de prendre ses responsabilités, comme il n’a pas voulu soutenir Lidia face à la mort de son frère? Il nous rappelle que les hommes ne sont rien, surtout au moment du début de l’insurrection franquiste dans l’Espagne voisine et un commencement de mutinerie à Lisbonne .Saramago veut-il par le biais de cette fiction s’inscrire dans la lignée des grands écrivains portugais Camões (souvent cité et dont il pastiche un vers à la fin) et Pessoa ? Pourquoi pas, après tout il est lui-même prix Nobel de littérature et a honoré les lettres portugaises.
-
Une malle pleine de gens - Antonio Tabucchi
- Le 17/05/2021
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
Une malle pleine de gens – Antonio Tabucchi – Christian Bougois éditeur.
Parmi tous les auteurs qui ont publié leurs œuvres au cours des siècles, certains deviennent écrivains mais peu marquent leur temps et leur art de leur empreinte. Fernando Pessoa est de ces poètes majeurs, moins sans doute par ce qu’il écrivit sous son nom que par ce qu’il publia sous celui de ses nombreux hétéronymes (On n’en décompte à peu près 72), une fiction au terme de laquelle « il était un autre sans cesser d’être lui-même » selon la formule consacrée. Lui qui publia peu sous son propre nom (des chroniques, des articles, des essais et quelques recueils de poèmes dont beaucoup sont posthumes), s’exprima vraiment à travers eux, mais cette pratique est bien différente du pseudonyme très en vogue chez les écrivains et bien différente d’un simple artifice littéraire. Pessoa créa ainsi des personnages, des écrivains, en leur donnant un état-civil, une date de naissance et une mort, (parfois un horoscope) une personnalité, une œuvre, un style… différents pour chacun. (Antonio Tabucchi analyse finement les principaux d’entre eux en insistant sur les différences et les ressemblances avec Pessoa). Cette sorte de dédoublement est unique dans l’histoire de la littérature si on excepte Rimbaud (« Je est un autre ») et dans une moindre mesure Nerval qui n’ont jamais été aussi loin dans l’exploration de ce « Moi » intérieur. C’est la marque d’un génie autant que celle de la folie et on peut dire que Pessoa a tenté ainsi d’exorciser sa solitude, son mal de vivre et l’analyse de cette thérapie mériterait sans doute une étude psychologique voire psychanalytique. C’est entre autre chose cela qui m’a toujours passionné chez Pessoa, autant l’homme, un quidam humble et modeste, égaré dans la vie qui cachait un écorché vif solitaire et tourmenté, mais aussi un génial créatif comme peu d’hommes de Lettres l’on été. Il eut sa période pauliste mais reste marqué par « la saudade » qui est la grande caractéristique du peuple portugais.
Il était un modeste traducteur commercial employé d’une entreprise d’import-export et sa vie se déroula dans la « Baixa » à Lisbonne entre chambres meublées, bureau et cafés, avec juste une petite idylle vite interrompue avec Orphélia Queiros(on peut lire en fin d’ouvrage quelques-unes des lettres qu’il lui écrivait), n’abandonnant pour héritage qu’une malle pleine de manuscrits attribués à ses hétéronymes, parfois écrits au dos de factures, laissant au hasard le soin de les révéler au public.
J’ai apprécié l’étude menée par Tabucchi, richement documentée et érudite et une démonstration qui éclaire un personnage encore aujourd’hui énigmatique.
-
l'Aleph
- Le 18/02/2020
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
 N° 1431 - Février 2020.
N° 1431 - Février 2020.L’Aleph – Jorge Luis Borges – Gallimard.
Traduit de l'espagnol par Roger Gallois et et René LF Durand.
Le titre tout d’abord évoque la première lettre de l’alphabet hébreux, elle-même issue de l’écriture phénicienne et on peut y voir une idée de début de quelque chose puisque, dans les autres alphabets cela aurait donné le A. En mathématiques c’est « Le nombre d’éléments d’un ensemble infini », une sorte d’idée d’α et d’ω. Dans cette nouvelle éponyme l’auteur nous confie que c’est « l’un des points de l’espace qui contient tous les points… le lieu où se trouvent sans se confondre, tous les lieux de l’univers ». Pour Borges on pourrait le définir comme le concept d’un savoir impossible où se croisent toutes les disciplines. Plus simplement c’est un ensemble de 17 nouvelles fantastiques, écrites par Borges à différentes périodes de sa vie dont chacune raconte une histoire distincte, soit à la première personne sur le ton de la confidence, soit sous la forme d’une histoire narrée par un témoin, avec des symétries, des antinomies, des préoccupations obsessionnelles propres à l’auteur. Le concept d’oxymore est d’ailleurs présent dans ce recueil. Il est un écrivain réputé difficile qui donne à réfléchir, mais on y retrouve ses thèmes métaphysiques favoris, l’immortalité, la notion d’infini, l’existence de Dieu et sa difficile connaissance par l’homme, le bien et le mal, la vie, le labyrinthe en même temps que la dualité de l’homme, sa folie, ses obsessions, son destin parfois brisé, parfois surprenant voire contradictoire et qui le met souvent dans des situations ambiguës, sa mort dans la violence, la trace qu’il laisse, souvent ténue et vite oubliée dans la mémoire des autres hommes, autant dire des questions existentielles que tout homme est capable de se poser. Argentin, Borges y ajoute une certaine admiration pour les gauchos, leur mode de vie et leur liberté, leurs absence d’attaches, le tout enveloppé dans une immense érudition de nature notamment mythologique, théologique et philosophique, une grande culture et dans un style parfois diffus mais agréable à lire. Il nous rappelle que la vie est une quête, un combat avec beaucoup de cruauté et de vengeance, qui se termine inéluctablement par la mort. Chaque texte demanderait un commentaire approfondi mais je voudrais mettre l’accent sur le miroir dont l’exemple revient souvent dans ces textes. Il met en exergue cette notion de la double nature que l’homme porte en lui, l’image réelle qui est celle qu’il donne à voir et celle, virtuelle et bien différente parce qu’inversée et située derrière la glace, qu’il est seul à voir et à connaître, lue dans son propre reflet. Cela fait de Borges, certes un conteur d’exception, mais aussi, à travers les personnages qu’il met en scène, un fin observateur de la condition humaine.
L’idée du labyrinthe appelle l’image du Minotaure d’ailleurs évoquée dans une nouvelle. Elle peut sans doute être rapprochée de la lettre « Aleph » qui donne son titre au recueil et qui, dans l’écriture phénicienne, signifie taureau.
Je me suis souvent demandé ce qui pousse quelqu’un à écrire. C’est souvent la volonté de raconter une histoire réelle ou imaginaire, ces deux concepts qui, sous la plume de l’écrivain se conjuguent et se complètent, peuvent parfaitement se contredire, s’inverser ou se renforcer. Dans ce processus narratif et descriptif il y met toute son inspiration, sa sensibilité, son travail, son humanisme, ses convictions, ou laisse libre court à son inconscient comme l’ont fait les surréalistes. Cette volonté d’écrire réside autant dans la faculté d’accepter les épreuves ou de les exorciser dans le huit clos de son intimité que de rechercher la reconnaissance, la notoriété ou de stabilité financière. Il y a aussi, me semble-t-il, de l’utopie, de l’idéalisme à écrire, une volonté d’expliquer le monde dans lequel il vit ou de le refaire à sa convenance, autant dire une constante de la condition de certains hommes d’exception. Cette quête menée dans les arcanes de soi-même me paraît révéler aussi sa propre solitude et c’est, me semble-t-il, ce qui principalement motive l’écriture, et peut-être, pourquoi pas, celle de Borges ?
©Hervé Gautier http:// hervegautier.e-monsite.com
-
Le livre de sable
- Le 10/02/2020
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
 N° 1428 - Février 2020.
N° 1428 - Février 2020.Le livre de sable - Jorge Luis Borges- Folio.
Traduit de l'espagnol par Françoise Rosset.
C’est une atmosphère bien étrange qui baigne les différentes nouvelles de ce recueil tel Borges qui rencontre un autre lui-même. Il y a d’ailleurs beaucoup d entrevues dans ces textes au nombre de treize [est-ce une allusion au mystère de ce nombre? L’auteur précise lui-même qu’il est le fruit du hasard ou de la fatalité], le narrateur est toujours un sud-américain d’un certain âge qui croise, d’ailleurs fortuitement et sans suite pour l’avenir, un interlocuteur (ou trice) plus jeune. Le conteur, qui ressemble à l’auteur tant les détails biographiques donnés le concernent (certains de ses personnages ont en effet des problèmes de vue), est toujours seul voire solitaire malgré quelques rencontres amoureuses mais qui ne durent pas. Les textes où le rêve tient un grande place sont souvent labyrinthiques, inquiétants, mystérieux, fantastiques avec des connotations d’horreur. Il est souvent fait allusion à d’autres écrivains de la même inspiration. Refusant d’écrire une préface à son propre livre Borges lui préfère un épilogue dans lequel il s’explique ou donne des clés de ces différentes fictions. Il souhaite que les rêves qu’elles ne manqueront pas de susciter continuent à nourrir l’imaginaire de ses lecteurs.
C’est sans doute la caractéristique d’un esprit quelque peu dérangé mais je dois bien avouer que je suis entré de plain-pied, sans le comprendre complètement peut-être, dans cet univers que je caractérise moi-même d’énigmatique et je souscris à la remarque de notre auteur faite au début de la nouvelle qui donne son titre au recueil. Il y écrit « C’est devenu une convention aujourd’hui d’affirmer de tout conte fantastique qu’il est véridique ». Cette remarque m’évoque à la fois celle de Boris Vian dans la préface de « l’écume des jours » : « L'histoire est entièrement vraie puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre. » ou, à contrario , le tableau de Magritte «Ceci n’est pas une pipe ».
Ce recueil illustre bien le parti-pris d’écriture qui fut celui de Borges. Il est en effet connu pour être un nouvelliste privilégiant le fantastique et l’aspect infini des choses comme peut l’indiquer la référence au sable qui figure dans le titre donné à cet ouvrage.
Je retiens aussi cette citation de Borges signant également la 4° de couverture « Je n’écris pas pour une petite élite dont je n’ai cure ni pour une entité platonique adulée qu’on surnomme la Masse. Je ne crois pas à ces deux abstractions, chères aux démagogues. J’écris pour moi, pour mes amis et pour adoucir le cours du temps ».
©Hervé Gautier http:// hervegautier.e-monsite.comN° 1423 - Janvier 2020.
-
Le tango de la vieille garde
- Le 22/11/2019
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1411– Novembre 2019.
Le tango de la vieille garde - Arturo Perez-Reverte - Seuil.
Traduit de l'espagnol par François Maspero.
Ce roman tourne autour de deux personnages qui vont se croiser plusieurs fois dans leur vie à partir de 1928. Au début, Max Costa a été danseur mondain dans les cabarets et les transatlantiques de luxe, autant dire un bellâtre suffisant, chasseur de femmes fortunées et qui danse merveilleusement le tango. Bien sûr, il ne sera jamais, malgré las apparences parfois trompeuses, qu'un petit voleur minable, un monte-en-l'air perceur de coffres-forts, un frimeur qui vivote de larcins. Mecha Inzunza est la très riche épouse d'un compositeur célèbre, devenue plus tard la mère d'un jeune joueur d’échecs prometteur qui est venu à Sorrente pour disputer une partie contre un Russe. Nous sommes alors en Italie dans les années 60 et Mecha et Max se retrouvent par hasard et c'est l'occasion pour eux, malgré les cheveux gris, la tavelure des mains et les désillusions de la vie, d'évoquer leur parcours respectif, de vivre une dernière aventure. Il y a dans leurs propos des relents de mémoire mais aussi de la lassitude à cause de la fuite du temps et de ses aléas. Si pour elle l'existence a été agréable, sensuelle et même jouissive, pour lui, ce fut l'itinéraire aventureux d'un gigolo sans le sou, parfois flamboyante mais surtout celle d'un fourbe opportuniste.
Chacun joue une sorte de partition hypocrite à demi-mots, avec des regrets et des souvenirs de leurs amours torrides mais épisodiques, vouées aux circonstances. Ils ne se sont pas oubliés mutuellement même s'ils ont été séparés et le hasard les a déjà réunis par deux fois, à Buenos Aires en 1928 où Max accompagne Meche et son mari, désireux de s'encanailler dans les bas-fonds de cette ville, puis à Nice, dix ans plus tard autour de lettres compromettantes à propos du coup d’État de Franco et d'un livre sur les échecs. Leurs relations amoureuses ont été comme une partie perpétuellement ajournée, des amours en pointillés, contrariées par les circonstances de la vie de chacun d'eux mais aussi par l'Histoire. Meche trouve Max fascinant, se sert de lui à l'occasion et son désir physique le dispute à la méfiance qu'elle a de lui, de ses trahisons, parce qu'il reste à ses yeux un petit malfrat cynique. Ils n'appartiennent pas au même monde et ils ne feront que se croiser, ce qui donne la leur rencontres une ambiance un peu malsaine. Lui ce n'est pas autre chose qu'un profiteur ingrat qui n'existe que grâce aux femmes qui sont capables de tromper leur mari pour lui et qui lui-même les trahira et les oubliera. Il a cependant ses propres failles que les évènements révéleront, comme la vie de Meche, différente et peut-être plus frivole, mettra en évidence la part sombre d'elle-même, fera de lui une victime, le juste retour des choses en quelques sortes. Les rapports entre Max et Meche sont étranges depuis leur rencontre fortuite, entre désir physique et véritable amour mais ce qui compte le plus pour lui, malgré la mélancolie, est de rester en vie avec la tentation de revivre pour un moment ses folles années maintenant révolues.
Il y a des descriptions très réalistes et parfois érotiques, une ambiance de tango et un suspense que j'ai particulièrement appréciés mais aussi, et malheureusement, quelques longueurs notamment autour des échecs. Cette évocation nous réserve pas mal d'analepses où le bluff côtoie la trahison. Tout le monde ment dans cette histoire un peu compliquée, mais c'est aussi une caractéristique de la nature humaine.
Je sais que c'est un roman avec des femmes splendides, de la classe, des bonnes manières, des salons avec leur ambiance, la fumée de tabac et le reflet de leurs miroirs, et je me suis laissé gagné, au fil des pages, par cette atmosphère surannée mais captivante qui transporte le lecteur dans des lieux et des périodes révolues. Ça a été, comme d'habitude, un bon moment de lecture.
©Hervé Gautier http:// hervegautier.e-monsite.com.
-
Eva, une aventure de Lorenzo Falco
- Le 03/11/2019
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1407– Novembre 2019.
Eva - Une aventure de Lorenzo Falcó - Arturo Perez-Reverte - Seuil.
Traduit de l'espagnol par Gabriel Iaculli.
Je remercie Babelio et les éditions Seuil de m’avoir fait découvrir ce roman.
Lorenzo Falcó est un ancien trafiquant d'armes reconverti en agent secret de la République espagnole et travaillant maintenant pour Franco. Autant dire que seul l'argent compte pour lui et que ce ne sont pas les scrupules qui l'étouffent. Il correspond à l’image traditionnelle de l'espion de cette époque, dans la force de l'âge, costume bien taillé, chapeau, trench-coat, browning, alcool, cigarettes, faux passeports et évidemment des femmes, mariées ou non, belles, désirables et consentantes qu'il n'apprécie que dans son lit, image d’Épinal, pas vraiment dans l'air du temps. Son rôle est clair, s'assurer d'un cargo républicain, le Mount Castle, transportant l'or de la banque d'Espagne à destination de la Russie afin qu'il échappe aux nationalistes en cas de victoire. Le bâtiment est réfugié dans le port de Tanger et les franquistes entendent bien s'approprier sa cargaison pour financer la guerre civile. Il est bien entendu surveillé par deux destroyers espagnols des deux camps et fait l'objet de nombreuses tractations internationales. Bien sûr cette mission n'est pas sans risques et elle est émaillée de pas mal de luttes sanglantes, de rebondissements et de cadavres. La ville est un nid d'espions et d'assassins et l'argent achète tout, même peut-être le capitaine du navire républicain résolu à faire son devoir face à un autre capitaine, nationaliste celui-là, tout aussi déterminé à l'envoyer par le fond dans les eaux internationales s'il résiste à l’arraisonnement. Il y a de belles femmes avec parfois leur lot d'érotisme, de vieux loups de mer à la peau tannée, des tapis verts, des tueurs à gage, des nuits blanches, des cigarettes américaines, de l'excellent whisky, du kif, des exaltés qui voient dans cette guerre civile une occasion de vivre leur passion de tueurs ou leurs illusions politiques, des bagarres de bouges, des putes, des inconnus qui changent de noms, des aventuriers qu'aucune trahison n'arrête, des exécutions sommaires que les circonstances exigent... Mais le plus gênant pour Falcó c'est que Eva Neretva , une Russe communiste à qui il a naguère sauvé la vie et qui lui a rendu la pareille et qui est à bord du Mount Castle. Cela va évidemment compliquer sa tâche d'autant que chacun des deux capitaines, celui du cargo républicain et celui du destroyer nationaliste, sont déterminés à faire leur devoir. Eva n'est pas vraiment son genre de femme, certes il l'a aimée et continue de la désirer, mais elle reste pour lui une énigme, quelqu'un qu'on ne peut manipuler ni acheter. Animée par la foi communiste, c'est une idéaliste, pleine d'illusions sur Staline et son régime dictatorial et capable de se sacrifier elle-même, ou de tuer Falcó si on lui en donne l'ordre. Lui, au contraire, est imperméable à tout engagement idéologique, véritable mercenaire travaillant pour le plus offrant. Il y a donc entre entre eux un jeu macabre, une sorte de danse entre Eros et Thanatos!
Le roman se lit bien et même rapidement, est agréablement écrit avec de belles descriptions parfois pleine de sensibilité et de belles nuances, avec beaucoup de réalisme dans le récit des affrontements, entre coups de feu et de couteau, ce qui rend cet ouvrage passionnant jusqu'à la fin. Le suspens est au rendez-vous dans le décor de cette ville neutre, cosmopolite et mystérieuses où chacun est à la solde d'un autre, voire de plusieurs, où la survie d'un espion est gravement menacée à chaque instant et où la vie de chacun ne tient qu'à un fil, avec en toile de fond ce cargo et sa cargaison d'or, les protagonistes de cette histoire, entre obéissance aux ordres et réalisme. Je n'attendais pas Perez-Reverte dans ce registre par rapport à ce que j'ai déjà lu de lui. J'avoue que je suis un peu partagé à propos du personnage de Falcó que je trouve un peu trop caricatural et ses aventures un peu trop conventionnelles dans le cadre de ce genre de roman auquel il est vrai je suis assez peu habitué. Il a peut-être de beaux yeux gris, les cheveux brillantinés et un charme ravageur de beau gosse, je le trouve quand même un peu trop "donnaiollo" comme disent nos amis Italiens, mais ce fut quand même un bon moment de lecture.
©Hervé Gautier.http:// hervegautier.e-monsite.com
-
Livre(s) de l'inquiétude
- Le 22/08/2019
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1374 – Août 2019.
Livre(s) de l'inquiétude - Fernando Pessoa.
Traduit du portugais par Marie-Hélène Piwnik.
Nous connaissions déjà "Le livre de l'intranquillité "(paru en 1990) de Fernando Pessoa mais que l'auteur avait attribué lui-même à Bernardo Soares, un hétéronyme, c'est à dire un des nombreux doubles de lui-même puisqu’il n'a que très rarement signé ses œuvres de son propre nom et qu'il n'a pratiquement pas connu la notoriété de son vivant. Voici cet ouvrage qui inclut les œuvres inédites du Baron de Teive et de Vicente Guedes à celles de Bernardo Soares, chacun de ces "auteurs" vivant en quelque sorte sa propre vie et écrivant dans son propre style. Ces textes ont été réunis par Térésa Rita Lopez, universitaire portugaise spécialiste de l’œuvre de Pessoa. C'est le résultat d'un travail difficile puisque l’œuvre de l'écrivain Lisboète était non seulement composée de feuilles éparses mais aussi parce que l'édition française de 1990 limitait le texte au seul Bernardo Soares ("Livro do desassossego" por Bernardo Soares). C'est un triptyque, un soliloque à trois voix, une sorte de miroir qui nous renvoie une image virtuelle de Pessoa, caché de l'autre côté de la glace, une façon bien personnelle de se faire l'écho de ce qu'il est, de ce qu'il voit et de ce qu'il ressent. Dans cette version, d'ailleurs un peu différente du"Livre de l'intranquillité" on retrouve cette impression de l'impossibilité de trouver la quiétude dans ce monde, une sorte de trouble permanent, un désagrément, un mal de vivre.
Toute sa vie Pessoa s'est ingénié à brouiller les pistes puisqu'il n'a presque jamais publié de son vivant, laissant le soin à ses contemporains, après sa mort, d'explorer la multitude de textes déposés (27000) par ses soins dans une malle sous forme de feuilles séparées et attribuées à de nombreux auteurs, comme autant de petits cailloux destinés à un jeu de piste. C'est une manière pour lui d'explorer son "moi" multiple et complexe autant que de demander à son lecteur éventuel de ne pas chercher à le comprendre. Vicente Guedes est un être décadent et désargenté, une sorte d'intellectuel de la pensée, un modeste employé de commerce, un penseur impénitent qui aime à analyser ses rêves dans un style recherché mais parfois un peu trop intellectuel, le baron de Teive est un aristocrate stoïcien que le suicide fascine et pour qui l'action est un paradoxe et qui s'exprime dans un style austère, quant à Bernardo Soares, aide-comptable employé de bureau comme lui, c'est un éternel promeneur solitaire, arpentant les rues de Lisbonne ou regardant de sa fenêtre les gens passer dans la rue et qui en parle avec une certaine ironie à laquelle il mêle des remarques personnelles désabusées sur sa vie au quotidien; j'avoue de cet hétéronyme à ma préférence à cause de sa vision des choses de l'existence et la manière qu'il a de l'exprimer. Je ne suis pas un spécialiste, mais à chaque fois que je lis Pessoa, il me semble que pour lui l'écriture, et cette forme particulière qui consiste à prêter son talent à un autre en s’effaçant derrière lui et en s'excusant presque d'exister, est pour lui une sorte d'antidote à sa vie de subalterne anonyme. Par le rêve jusques et y compris s'il ne mène nulle part ou n'enfante que des chimères et surtout par l’écriture, les mots qu'il trace sur le papier, il se réfugie dans un monde imaginaire, tisse autour de lui et pour lui seul, un univers différent, habite même un autre corps et un autre destin, ce qui l'aide (peut-être) à supporter cette succession de jours qu'il passe pour gagner sa vie dans un sombre bureau. C'est sans doute aussi une forme exprimée personnellement de cette "saudade" qui fait tellement partie de l'esprit lusitanien et que le poète Luis de Camões a défini comme "Un bonheur hors du monde", l'expression d'un manque de quelque chose autant qu'un espoir d'autre chose qui par ailleurs peut-être assez indéfini, une sorte de référence à un passé révolu qu'on voudrait bien voir revivre... C'est étonnant de voir cet homme discret qui, après sa mort sera considéré comme un des plus grands écrivains portugais, confier à des feuilles volantes, c'est à dire un support bien fragile, le cheminement de sa pensée complexe, vivre simplement en ne recherchant pas la notoriété et la consécration comme c'est souvent le cas chez les membres de l'espèce humaine et spécialement chez ceux qui font œuvre de création.
Ce sont donc trois facettes judicieusement révélées de Pessoa lui-même, une autobiographie en trois temps, un journal intime en trois moments à la fois complémentaires et cohérents, où la solitude et l’inaptitude à vivre se lisent à chaque ligne.
©Hervé Gautier.http:// hervegautier.e-monsite.com
-
Monstre aimé
- Le 13/03/2018
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1227
Monstre aimé – Javier Tomeo - Christian Bourgois Éditeur.
Traduit de l'espagnol par Denise Laroutis.
Le sujet de ce roman, bien qu'il n'ait pas été classé ainsi par l'éditeur, et qui a fait l'objet d'adaptations théâtrales facilitées sans doute par des dialogues sur lesquels il repose essentiellement, et dans une ambiance que n'auraient désavoué ni Kafka ni Buňuel, est déconcertant. Dans l'univers clos d'une pièce, il s'agit officiellement, d'une entrevue entre, H. J. Krugger, le directeur des ressources humaines d'une grande banque et un homme d'une trentaine d'années, Juan D. qui souhaite être embauché comme vigile de nuit. Jusque là, c'est plutôt ordinaire, sauf que, d'emblée, le directeur déclare que le candidat devra répondre à toutes ses questions, même les plus intimes. Cela ne ressemble déjà plus à ce qui était annoncé et ce n'est que le début. Ainsi le lecteur apprend-il que Juan a trente ans et souhaite, par ce travail qui sera pour lui son premier emploi, mais qui ne correspond pas du tout ni à ses compétences et ni à ses capacités, s'abstraire de la tutelle de sa mère, une femme abusive et possessive (castratrice?) qui, bien entendu s'oppose à ce changement dans la vie de son fils unique. Ce bureau qui a en principe des fonctions de recrutement ressemble de plus en plus à celui d'un psy tant les questions du directeur sont insidieuses, personnelles, déconcertantes même, puisque de DRH insiste sur des détails apparemment sans importance portant sur la chronologie de faits anodins et qui ont davantage pour but de déstabiliser Juan que d'évaluer ses compétences pour son emploi éventuel. Le recruteur lui tend même des pièges que Juan, cauteleux, déjoue, en répondant à son interlocuteur ce qu'il a envie d'entendre tout en taisant ce qu'il veut garder pour lui. La conversation s'égare parfois sur des sujets qui n'ont vraiment rien à voir avec l'embauche potentielle de Juan. Puis, lui qui était anxieux au départ, prend de l'assurance au point d'être considéré par Krugger, non pas comme un futur employé, mais comme un véritable confident ce qui donne au directeur l'opportunité qu'il attendait sans doute depuis longtemps de parler de sa propre mère. Ce détail les rapproche cependant, Juan désirant enfin couper le cordon ombilical, Krugger vivant dans le souvenir de sa mère décédée quand il avait cinq ans et souffrant de l'absence d'amour maternel. Ces deux histoires parallèles vont donc se décliner, chacun prenant la parole à son tour et suscitant les réponses de l'autre dans un jeu où chacun y va de ses confidences, reprises, commentées et parfois combattues par l'autre. La maïeutique ainsi initiée fonctionne dans les deux sens et même avec une certaine perversité.
Le rapport à la mère est ici traité à travers ces deux discours croisés où chacun cherche, parfois avec violence, à mettre l'autre en difficulté, tout en laissant la parole à la mère de Juan. Ces deux figures de mères sont différentes mais sont un réel problème pour ces deux hommes, l'une étant absente et l'autre trop présente, ce qui n'est pas sans conséquences sur leurs vies respectives. Ils sont tous les deux restés célibataires et leur relation aux femmes est définitivement altérée, provoquant probablement l'’homosexualité et assurément un profond traumatisme.
Je connaissais déjà Javier Tomeo (1932-2013) à travers « Le château de la lettre codée » (La Feuille Volante n° 83). J'ai retrouvé ici, cette dimension absurde et surréaliste, à la fois du côté de Krugger qui veut s'affirmer comme quelqu'un d'important dans cet établissement, que de la part de Juan qui est resté, jusqu'à l'âge de trente ans, bien à l’abri dans sa tour d'ivoire maternelle, une illustration du complexe d’œdipe chez l'un et un combat contre l'infériorité chez l'autre.
Cela dit, le livre refermé, ce texte m'a laissé quelque peu perplexe. Juan rentrera chez lui après cet entretien et retrouvera sa mère qui continuera de veiller sur lui comme elle l'a toujours fait, une illustration de la solitude qui est une constante dans l’œuvre de Tomeo. Il continuera de l'aimer comme avant, regrettant peut-être sa tentative d'émancipation. Krugger lui continuera d'aimer cette mère qui lui a tant manqué et sa décision à propos de la demande d'emploi de Juan me paraît justifiée non pas tant à cause de ce dialogue long et parfois labyrinthique, mais à cause de l'accusation violente et infondée de Juan. Krugger aime sa mère comme Juan aime la sienne, avec leurs défauts et qualités, et c'est là une facette paradoxale de l'amour humain. L'amour d'une mère ne se discute pas même si on n’'adhère pas forcément à cette réalité. Ces femmes sont-elles des monstres ? Assurément dans l'esprit de l'auteur mais cette manière de présenter les choses, restrictive et misogyne, ce qui n'est guère dans l'air du temps, me paraît pouvoir être élargie à l'espèce humaine en général tant elle est critiquable. Tomeo joue sur la dualité « absence/prégnance » mais à la fin, chacun des deux personnages reprendra sa place dans cette ville imaginaire, comme si cette parenthèse n'avait jamais eu lieu et n'avait pas secoué leurs certitudes. En sortiront-ils indemnes ? je n'en suis pas sûr cependant mais notre société n'est pas idéale comme ne le sont pas non plus nos destins qu'on accepte ou qu'on refuse, en nous demandant quand toute cette comédie va se terminer, espérant qu'elle ne se transforme pas en tragédie. La patience, l'abnégation, le fatalisme voire la curiosité ou le masochisme font aussi partie de ce jeu que nous jouons au quotidien pour que la vie existe et perdure. L'amour d'une mère, comme l'amour en général, est quelque chose d'irrationnel qui illumine ou détruit nos existences, entre apparences hypocrites et réalités dont on s’accommode, entre compromis et compromission, parce que c'est dans l'ordre des choses, qu'on n'y peut rien ou qu'on trouve avantage à une situation qui s'arrêtera avec la vie.
Je ne suis pas bien sûr d'avoir suivi le cheminement de l'auteur, ni même de l'avoir compris et partagé son voyage dans l'absurde mais ce livre, bâti avec des phrases courtes et simples, fut pour moi un bon moment de lecture et de réflexion.
© Hervé GAUTIER – Mars 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com
-
L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir
- Le 10/02/2018
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1216
L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir – Rosa Montero - Métailié.
Traduit de l'espagnol par Myriam Chirousse.
Les voies de la création littéraire sont bien étranges. Il est déjà difficile d'explorer celles de l'inspiration, mais que dire de l'occasion de présenter l’œuvre d'un autre, ce qui vous entraîne dans d'autres contrées de l'esprit…. Ici, l'auteure, Rosa Montero, Journaliste espagnole à « El Pais » mais surtout romancière reconnue, couronnée par des prix prestigieux, s'est vue sollicitée pour écrire, avant sa publication, la préface du journal que Marie Curie, deux fois Prix Nobel (de physique en 1903 et de chimie en 1911) a tenu après la mort de son époux Pierre, écrasé à 47 ans par une charrette. Au départ, ce n'était qu'un simple texte introductif à cet ouvrage que Rosa Montero a accepté de rédiger pour inviter le lecteur à découvrir cette femme extraordinaire, mais elle ne se doutait probablement pas où ces quelques pages allaient l’entraîner. La connaissance de la vie de Marie Curie l'a conduite non seulement à évoquer son histoire mais surtout à se l'approprier d'une manière originale, puisque les hasards de sa vie à elle l’entraînèrent dans un tourbillon de mots dans lequel elle allait se retrouver et construire, petit à petit et sans peut-être s'en rendre compte au début, son propre livre autour du souvenir de Pablo, l'homme qu'elle a aimé pendant 21 ans et qui venait de mourir. C'est, à tout le moins ce que j'avais entendu à propos de ce livre et cette démarche me semblait intéressante. Le titre était une sorte d'invitation et cette idée ne me semblait pas à moi particulièrement « ridicule ». La douleur, nous le savons, est un moteur de la création artistique et en particulier de l'écriture. Elle est souvent considérée comme une catharsis mais le solipsisme de l’écrivain vient ici brouiller un peu cette piste puisque que, m'a-t-il semblé, l'hommage qu'elle voulait rendre à cet homme qui fut son compagnon, son mari, son complice… me paraît passer rapidement au second plan. La mort est aussi pour nous pauvres humains qui sommes assujettis au transitoire et au temporaire, quelque chose de révoltant, surtout quand elle fauche un de nos proches.
Ce qu'a écrit Marie Curie ressemble à un journal intime d'une vingtaine de pages, non destiné à la publication, une sorte de lettre posthume adressée à Pierre, mais ne fut pas détruit par ses soins. Rosa Montero en cite de nombreux passages. Ce qu'elle écrit n'est pas une biographie au sens strict, comme d'autres l'ont fait, mais une évocation de la vie de Marie, de ses expériences réalisées dans des conditions précaires et d'une manière parfaitement désintéressée (Les Curie ne déposèrent jamais de brevet), pour le bien de l'humanité. L'auteure croise cela avec son expérience personnelle, y ajoute différentes références littéraires, des anecdotes historiques de femmes et même des digressions sur la mort et les morts, l'amour, l'enfance, le deuil, la condition des femmes, la faiblesse des hommes, les coïncidences qu'elle veut significatives et qui ont pu intervenir dans la vie des Curie comme dans la sienne. Elle en profite pour parler d'elle, de sa manière d'écrire, des recherches documentaires qu'elle a pu faire pour écrire ses romans, fait des parallèles entre Marie Curie et elle... Puis elle revient à son sujet, parle à nouveau de Pierre, cite parfois leur correspondance commune, évoque leur rencontre, leurs amours et bien entendu sa mort accidentelle précédée d'une grande fatigue due à ses travaux, de l'inutile culpabilité judéo-chrétienne de Marie… Elle mentionne leur griserie et leur fierté légitime devant leur découverte mais aussi leur inconscience face à la nocivité du radium, puis la folle passion qui s'empara de Marie pour Paul Langevin, quatre ans après la mort de Pierre, le rejet public dont elle fut l'objet malgré ce qu'elle avait apporté au monde, son attitude humanitaire pendant la guerre de 1914 ... Son journal intime n'existe plus à ce moment-là mais des lettres passionnées qu'elle échangea avec son amant prennent sa place et avec elles témoignent d'un amour de la vie..
Avant d'ouvrir ce livre j'avais cru comprendre que l'auteure souhaitait faire un parallèle entre la mort de Pierre Curie et celle de Pablo et confier au lecteur ce que cette absence lui inspirait. C'était un champ de réflexions qui pouvait être intéressant, notamment dans le domaine de l'apprivoisement de la douleur, sur le pouvoir de l'écriture en matière d'exorcisme... A la fin du livre il est mentionné de la part d'un de ses amis « Dans ce livre, il y a Marie et Pierre. Et d'autre part il y a toi. Mais Pablo n'y est pas » ; Je souscris à cette analyse, je n'ai pas noté grand-chose sur Pablo et je me suis souvenu de la fameuse tendance au solipsisme de la part de l'auteure. De ce point de vue, je suis resté sur ma faim et ses arguments pour contrer cette remarque ne m'ont pas convaincu. Je m'attendais simplement à autre chose. Le style m'a paru agréable à lire mais je me suis demandé ce que tous ces # apportaient au texte pourtant bien documenté.
© Hervé GAUTIER – Février 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Mémoire de mes putains tristes
- Le 11/06/2017
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1146
Mémoire de mes putains tristes – Gabriel Garcia Marquez – Grasset.
Traduit de l'espagnol par Annie Morvan.
Drôle d'idée de la part du narrateur : le jour de son 90° anniversaire , il veut s'offrir une folle nuit d'amour avec une jeune prostituée vierge, paradoxe qui tient autant dans la découverte de la fille que dans les possibilités physiques du narrateur. Il y a en effet un âge pour tout ! Célibataire, il confie en effet n'avoir jamais fait l'amour avec une femme, qu'elle fût prostituée ou non, sans la payer pour cela, c'est donc pour lui devenu une habitude. Il a même dressé une liste de ses partenaires. Rédacteur improbable dans un petit journal local, il a eu l'idée de rédiger autre chose que ses articles ordinaires pour leur préférer ses mémoires, d'où le titre du roman.
Mais, revenons à ce qu'il considère comme un cadeau personnel, et même intime, d’anniversaire. On dira ce qu'on voudra et on peut être animé des meilleures intentions du monde, la sagesse populaire a bien raison de proclamer qu'on ne peut être et avoir été. Le malheur pour lui c'est que cette réalité se propage sous forme d'informations dans toute la ville où il est fort connu, ce qui n'est pas fait pour célébrer sa virilité, nonobstant son âge !
Restait donc ce fait, ou ce non-fait, comme un défi que relève volontiers son amie la maquerelle qui se sent obligée de lui trouver un « cadeau » capable de combler les désirs de son amical client, mais celui-ci se dérobe sans pouvoir la toucher. Pourtant la présence d'une de ces jeunes femmes auprès de lui va contribuer à le rajeunir et à le rendre fou amoureux. Ce n'est donc pas une simple histoire de coucheries d'un vieillard libidineux comme on aurait pu s'y attendre mais une véritable renaissance pour lui. Mais ce n'est pas que cela et cet ultime épisode lui renvoie en pleine figure tous les échecs de la vie passée, la nostalgie du temps qui fuit, les affres de la vieillesse, la réalité prochaine de la mort. Nous ne pouvons rien à la fuite du temps et nous sommes tous promis au trépas quoique nous fassions. Nous serons seuls face à la camarde et il est illusoire d'espérer autre chose et se raccrocher à ses souvenirs ne servira à rien. C'est aussi simple et cruel que cela parce que c'est non seulement l'apanage de la condition humaine qu'il en soit ainsi , mais en plus il nous est donné d'en prendre conscience sans pouvoir rien faire contre cela. Tout être vivant est promis à la mort mais la particularité de l'homme est de pouvoir y réfléchir longtemps avant, de l’apprivoiser peut-être mais assurément de la craindre d'autant plus facilement que son existence a été belle et qu'ainsi il sait ce qu'il perd en perdant la vie.
Derrière un titre évocateur, porteur d'érotisme et peut-être davantage, c'est en réalité à une méditation sur la condition humaine à laquelle l'auteur nous convie, aux joies et surtout aux peines, aux grandeurs mais surtout aux décadences, aux mensonges et aux trahisons qui sont bien plus fréquents que l'amitié et l'amour sincères qui accompagnent notre parcours sur terre qui n'est pas un long fleuve tranquille. Tout ici-bas n'est qu'apparences, décor, hypocrisies, mensonges. On peut quand même se jouer à soi-même la comédie mais tout passe, la jeunesse comme la beauté, tout est promis à la décrépitude, même le corps des femmes qui est encore la seule manière d'échapper agréablement à la solitude et à la souffrance.
J'ai apprécié une nouvelle fois le style fluide de Marquez, sa verve mêlant l'humour à la mélancolie, une façon sinon de rire, à tout le moins de sourire de la mort inévitable qu'un vieil homme peut combattre en puisant dans la jeunesse et la beauté d'une femme. Il la présente toujours comme endormie et nue ce qui est sans doute une manière de répondre à la mort prochaine du narrateur et une façon de souligner les ravages que les années ont fait sur son propre corps.
-
Un bel morir
- Le 29/05/2017
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1140
Un bel morir – Alvaro Mutis – Grasset.
Traduit de l'espagnol par Eric Beaumartin.
Cette fois Maqroll a décidé de se domicilier temporaire dans l'improbable port de La Plata avec la projet de remonter le fleuve à la rencontre de ceux qui auparavant avaient partagé avec lui quelques entreprises mirifiques. Pour cela il choisit une chambre bizarrement située en surplomb des eaux boueuses assez loin de l'estuaire (c'est un peu l'image de sa propre vie), dans une auberge tenue par une femme aveugle. Il rencontre un ingénieur belge qui doit réaliser un tronçon ferroviaire au sommet de la cordelière et l'engage pour convoyer du matériel. Il ne tarde cependant pas à s'apercevoir que cette histoire de ligne de chemin de fer devait bien cacher quelque chose d'illégal dans un endroit où les autorité avaient depuis longtemps cesser d'être présentes. Cela paraît bizarre pour cet homme qui est avant tout un marin qui a bourlingué sur toutes les mers du globe mais c'est comme cela et de cette aventure improbable il ne sortira pas indemne. Elle met encore une fois en évidence sa naïveté ordinaire qui le pousse dans des aventures incroyables face à la cupidité d'autrui mais qui nourrit largement son expérience en matière de connaissance des bassesses dont l'espèce humaine est coutumière.
Maqroll El Gaviero (le gabier), est un personnage de fiction dont Mutis (1923-2013), à partir de 1985, a décliné la vie à travers sept romans au point qu'on peut dire qu'il est l'alter ego de l'auteur. Mais l'est-il en réalité. Il y a quelques années, je me suis demandé en quoi Mutis et Maqroll pouvaient être considérés comme des personnages hétéronymes comme ont pu l'être Pessoa et Alvaro de Campos ou Ricardo Reis. C'est toujours un sujet délicat qui amène à réfléchir sur le rôle de l'écriture pour l'auteur lui-même, une manière de rendre compte d'une certaine réalité ou l'occasion de se créer, à travers l'imaginaire, un univers idéal qui compense fictivement un quotidien plus morne.
Maqroll est un marin en perpétuelle errance, un homme au passeport constellé de visas périmés, un solitaire, plus que marginal au regard de la loi, mais un être cultivé, érudit, épicurien, polyglotte, fidèle en amitié cependant, n'hésitant pas à traverser les océans pour répondre à la sollicitation d'un ami (« Le rendez-vous de Bergen ») sans qu'on sache très bien comment la lettre a pu lui parvenir. Il pratique avec modération la fréquentation des tavernes et les passades amoureuses mais que quelques femmes ne parviennent pas à oublier, lui non plus d'ailleurs. Elles ont nom Antonea, Flor Estévez ou Iliona... Le Gabier semble exercer sur les femmes en général une séduction naturelle et l'oubli, cette faculté étonnement humaine, ne parvient pas à entamer la trace qu'il laisse dans la mémoire des gens qu'il croise. Ici c'est Amparo Maria qui succombe à son charme et qui rejoint ainsi ses femmes mythiques. Il n'a pas de véritable projet d'avenir mais, sans qu'il y puisse rien, il a l'art de se mettre, sur terre comme sur mer, dans des situations inextricables, à participer à des affaires douteuses dont il se sort au dernier moment mais où il laisse toujours le peu d'argent qui lui reste. Le temps a fait sur lui et sur ses facultés des ravages ordinaires et il se sent vieux mais se rappelle opportunément ce que furent ses bonnes années, tumultueuses et amoureuses et cela sans doute le maintient en vie, même si les regrets l'accompagnent. Ce n'est d’ailleurs pas la première fois que l'auteur aborde ce thème à travers son héros.
Ce n'est pas première fois non plus que Maqroll côtoie la mort. Dans un précédent roman il l'avait déjà approchée dans les miasmes d'un marigot mais s'en était tiré in extremis. Ici, elle s'invite à nouveau en frappant autour de lui à occasion de cette indéfectible habitude qu'ont les hommes, depuis la nuit des temps, de se battre et de s’entre-tuer. Dans ce roman tout l'art de l'auteur est d'entretenir chez son lecteur un suspens qui pourrait bien se conclure pour Maqroll par un fin tragique. C'est un thème d'autant plus prégnant dans l’œuvre de Mutis que Maqroll n'a jamais eu d'enfant (du moins à sa connaissance) et donc n'a pas assuré sa descendance, mais cela a-t-il de l'importance ? Ce roman a été publié en 1989 dans son édition originale, soit bien avant le décès de Mutis. De plus ce n'est pas son dernier roman où apparaît Maqroll. Dans un appendice à ce récit, Mutis ne laisse pourtant aucun doute sur la disparition de Maqroll et la citation de Pétraque, « Un bel morir tutta la vita onora », qui sert d'exergue à ce roman, vient conclure cette vie aventureuse et tourmentée. C'est en effet une prérogative d'auteur de disposer purement et simplement de l'existence, même fictive, de son personnage.
Comme toujours dans les romans de Mutis, j'ai retrouvé ces descriptions poétiques, ce qui nous rappelle qu'il était avant tout un poète, et ici le lecteur circule avec Maqroll dans la douce fragrance des caféiers autant que dans le danger des sentiers de montagne pleins de brouillard glacé, près des précipices et des torrents… Comme l'a dit fort justement Bernard Clavel « Mutis est un enchanteur ». J'ai apprécié aussi ces évocations subtilement humoristiques, le phrasé délicat, cette délicieuse façon d'exprimer les états d'âme du Gabier et cette nostalgie qui lui colle à la peau comme son ombre. Ma lecture a été passionnée et Mutis a ce talent de transformer une histoire qui aurait pu être une banale aventure en un récit passionnant. Il reste pour moi un génial conteur qui entraîne son lecteur de la première à la dernière page sans que l'ennui ne s'insinue dans sa lecture.
Depuis de nombreuses années cette chronique s'est fait l'écho de l’œuvre de Mutis à travers les tribulations de Maqroll mais cette modeste évocation n'a pas vocation à tout résumer. Alvaro Mutis reste cependant pour moi un auteur majeur dont Octavio paz a pu dire « (qu'il est) un poète dont la mission consiste à convoquer les vieux pouvoirs et faire revivre la liturgie verbale, dire la parole de vie » Maqroll, loin d'être une sorte de mythe, reste malgré tout un personnage assurément humain et attachant.
© Hervé GAUTIER – Mai 2017. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
fragments d'un voyage immobile
- Le 03/12/2016
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1094
Fragments d'un voyage immobile. Fernando Pessoa - Petite bibliothèque Rivages
Traduit du portugais par Rémy Fourcade.
Tout d'abord il s'agit là de la publication de citations de Pessoa, choisies arbitrairement par l'éditeur parmi celles qui ont déjà été publiées ou qui restaient encore inédites, ce qui donne à voir un désordre de textes, mais un désordre apparent cependant. Ces « poèmes » révèlent un Pessoa, certes poète, bien qu'il s'en défende, mais surtout un penseur, un rêveur introspectif qui voisine avec un homme inquiet du quotidien (le manque d'argent) mais aussi l'amour ou plus exactement l'idée qu'il s'en faisait(« La vraie sensualité n'a aucun espèce d'intérêt pour moi »), un être hanté par l'idée de la vacuité de lui-même, bref quelqu'un qui est à la fois banal et extraordinairement hors du commun. Ce sont des textes riches et révélateurs, sans artifice rhétorique, des remarques jetées sur le papier au hasard de l'inspiration ou du désespoir.
Entrer dans l’univers créatif d'un poètes n'est pas chose facile et c'est sans doute encore plus difficile quand il s'agit de Pessoa, un homme qui toute sa vie a fui les honneurs, se cantonnant dans les fonctions de modeste rédacteur de documents commerciaux. Personnalité hors du commun, donc mais aussi poète complexe qui écrivait en son nom mais aussi au nom de personnages fictifs, créés par lui-même, aussi différents de lui-même qu'ils l'étaient les uns par rapport aux autres – C'est ce qu'on a appelé les hétéronymes.
Voila donc 241 fragments, c'est à dire des « pensées » jetées sur de vieilles feuilles de papier, parfois même au dos de factures périmées et déposées dans une malle qui sera retrouvée après sa mort comme une sorte de bizarre testament à l'usage de tous les vivants et des générations à venir. Ce sont des sentences brèves où il nous parle de lui-même, de sa vocation poétique, du plaisir qu'il a à écrire, à inventer des personnages, sa préférence pour la prose, la prééminence de l’imagination et de son impossibilité de créer parfois, face à la page blanche ou face à son besoin de sincérité (« Le poète est un simulateur »). Mais, quid du voyage pour lui qui à part dans son enfance ne quitta pratiquement jamais Lisbonne ? Écrire, s’exprimer avec des mots, c'est comme dans tous les autres arts, faire un voyage à l'intérieur de soi. Cette démarche révèle une solitude intime, certes créatrice et catalysant l'émotion, mais aussi un mal-être où il prend conscience de son absence d'avenir, de la réalité de son échec avec une tendance à la procrastination ou carrément à l'inaction, de l'angoisse qui l'étreint entre des rêves fous pour demain et l'inutilité de sa vie au quotidien et même d'une sorte de déconstruction de lui-même, l'antichambre de la mort, la seule conclusion de la vie qui vaille (« la seule conclusion, c'est mourir »), bref une sorte de « saudade » qui caractérise bien l'esprit lusitanien. Il est en permanence ce, paradoxe, entre le vertige et le néant, la connaissance de soi et la simulation, la feinte voire la supercherie, conscient que son isolement se double d'une véritable déréliction face à une divinité à laquelle il ne croit plus et dans une société où il a du mal à se situer. Même le sommeil n'est plus pour lui une parenthèse bienvenue(« Je ne dors pas, j'entresuis ») c'est tout juste un moment physique obligatoire et la lecture n'est plus un « divertissement » au sens pascalien du terme. Pessoa est un être introverti qui avoue ne pas vouloir parler de lui mais c'est pourtant ce qu'il fait à longueur de pages et à travers différents hétéronymes, ce qui est une manière de s'analyser soi-même. Rien d'étonnant à cela, les écrivains trouvent en eux la vraie nourriture de leur œuvre. Mais à ses yeux, publier ce qu'on écrit, c'est perdre une partie de soi-même.
Comme le fait remarquer Otavio Paz dans un remarquable essai en forme de longue préface, Pessoa signifie « personne » en portugais, qui vient lui-même de « persona » le masque des acteurs romains, cela résume bien l'homme et l'écrivain.
© Hervé GAUTIER – Novembre 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
Barcelona - Daniel Sanchez Pardos
- Le 04/06/2016
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
La Feuille Volante n°1047– Juin 2016
BARCELONA – Daniel Sanchez Pardos – Presses de la Cité.
Traduit de l'espagnol par Marianne Millon.
Nous sommes en 1874 à Barcelone, une ville mystérieuse, à la fois vivante, révolutionnaire, imprévisible et bouillonnante où Gabriel Camarasa vient de revenir après de six longues années d'exil à Londres pour s’inscrire dans une école d'architecture. Il fait la connaissance d'un jeune homme, étudiant comme lui : Antoni Gaudí, féru de spiritisme et de photographie, des projets plein la tête... Nous voyons les deux jeunes hommes devenus amis déambuler dans cette ville, dans ses bas-fonds comme dans ses mondanités, avec en arrière-plan un incendie prétendument criminel, une polémique politicienne au terme de laquelle la famille Camarasa, propriétaire du journal les « Nouvelles illustrées » serait revenue pour renverser la République et restaurer la royauté d'Alphonse XII. Des personnages émergent, Fiona Begg, l'illustratrice principale du journal et détective d'occasion (mais pas seulement), ancien amour de Gabriel et qui fascine aussi Antoni, l'énigmatique journaliste Victor Sanmartin, Sempronio, le père de Gabriel qui semble cultiver le secret, Eduardo Anreu, officiellement marchand d'art ruiné, émergeant du passé avec un scandale à propos d'une photo truquée, Gaudí lui-même, non moins mystérieux dans ses pratiques et fréquentations, Gabriel qui, dans tout cela fait montre d'une grande naïveté ... Quand Anreu est découvert assassiné et que tout accuse Sempronio, ce roman prend la dimension d'un thriller historique, haletant et passionnant où les rebondissements le disputent aux fausses pistes, où les tripotages succèdent au chantage, à l'utopie, à la conspiration politique, à l'anarchisme, à la drogue, aux rendez-vous nocturnes inexpliqués, aux manipulations, distillant ainsi un suspense entretenu par Antoni, sorte de dandy dont le rôle se révèle de plus en plus flou comme chef d'un clan de délinquants, coutumiers de trafics en tous genres mais pas uniquement. Lui-même se révèle un redoutable enquêteur très au fait de la situation, ce qui est inattendu pour un étudiant en architecture venu de la campagne de Tarragone. La mère de Gabriel, Lavinia, quitte à cette occasion son rôle d’épouse soumise et effacée pour faire face aux événements, quant à Gabriel, il est invité à sortir de son oisiveté coutumière, de sa position de « maillon faible » dans cette famille jusqu'alors apparemment bourgeoise. Cet assassinat qui ne sera d'ailleurs pas le seul, permet à chacun de se révéler, de laisser libre cours à son imagination où à ses aspirations face aux interrogations et aux événements mais aussi de prendre conscience des réalités, de se souvenir du passé et de découvrir l'autre qu'il croyait connaître ; bref les apparences, que Gabriel croyait immuables, n'en sortent pas indemnes. Au fur à mesure des chapitres, le lecteur découvre les arcanes d'un roman qui se déroule sur fond d'agitation politique, d'imbroglio policier et judiciaire, de luttes d'influence, de conflits d'intérêts dans ce pays « de poudre et d'encens, de tricornes et de clairons » où la restauration monarchique des Bourbon parait être la seule solution face à la déliquescence de l'éphémère 1° République. Les simples mendiants ont leur importance tout comme les ombres qui peuplent les quartiers interlopes de cette ville décidément bien mystérieuse et qui fourmille d'espions et de complices à la solde d'Antoni.
C'est vrai que nous sommes dans une fiction qui autorise tout, c'est vrai aussi que la jeunesse justifie des positions parfois extrémistes que l'age adulte fait parfois évoluer, mais j'avoue que je n’imaginais pas Gaudí dans ce costume, lui dont l'histoire nous a légué l'image d'un homme valétudinaire et un peu utopique, à l'aspect modeste voire négligé, le catholique fervent et même mystique, l'architecte moderniste, génial et visionnaire qui imposa son talent créatif dans cette ville exceptionnelle, conférant un souffle nouveau à l'art, le futur bâtisseur de la Sagrada Familia … Avoir choisi de de le faire revire, même sous ces traits inattendus, m'a bien plu.
Le texte est agréable à lire, bien écrit, vivant (le texte est écrit à la première personne), plein de descriptions minutieuses et parfois poétiques, l'intrigue est bien construite et je sais gré à Babelio, dans le cadre de « masse Critique », et aux éditions Presses de la cité de m'avoir procuré ce bon moment de lecture.
© Hervé GAUTIER – Juin 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
La neige de l'amiral
- Le 23/11/2015
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
Avril 1992
n°103
La neige de l'amiral – Alvaro Mutis – Éditions Sylvie Messinger .
Sous la forme d'un journal de bord rédigé sur du papier de hasard, El Gaviero nous relate sa remontée rocambolesque du fleuve équatorial Xurando à la recherche de l'argent. Comme toujours, il note sur lui-même son éternelle remarque « Je suis au plus haut point intrigué par la manière dont ma vie est une répétition d'échecs, de décisions erronées au départ, de voies sans issue qui, mises bout à bout seraient tout compte fait l'histoire de mon existence ».
C'est encore une fois l'histoire d'un voyage, c'est à dire d'une fuite aux côtés d'un capitaine alcoolique et désespéré … et, par intermittence la compagnie d'un major énigmatique qui lui sauve la vie mais qui avait choisi d'abréger la sienne en venant vivre dans cette forêt « Ici ou là-bas, c'est la même chose, seulement ici, ça va plus vite ! » dit-il au capitaine qui le comprend.
Le véritable but d'El Gaviero semble être les scieries situées aux sources du Xurando. Autour d'elles se bâtissent des légendes complaisamment entretenues par le lamaneur et le mécanicien du bord… puis, rapidement, tout cela perd de son intérêt.
Dans ce voyage qui ressemble fort à un retour à ses origines inconnues, avec en toile de fond la Cordillère, il croise la mort, la sienne d'abord qu'il réussit à éviter, celle du capitaine ensuite qu'il découvre un matin, pendu… puis le naufrage fatal de l'esquif qu'il venait de quitter quelques heures auparavant.
Dans sa tête demeure l'image d'une femme, Flor Estevez et de « la neige de l'amiral », établissement perdu dans la montagne qu'il retrouve vide et délabré.
Ce livre est une approche supplémentaire du personnage d'El Gaviero, marin énigmatique et solitaire en perpétuelle errance, personnage romanesque mais Ô combien attachant dû au talent à chaque fois renouvelé du poète Alvaro Mutis.
© Hervé GAUTIER.
-
GLOSE
- Le 24/10/2015
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°975– Octobre 2015
GLOSE – Juan José Saer – Le Tripode.
Traduit de l'espagnol par Laure Bataillon.
Nous sommes quelque part dans une ville d'Amérique du sud, le 23 Septembre 1961 et Angel Leto comptable de son état, mal dans sa peau, décide sans raisons apparentes de se promener en ville au lieu de se rendre comme chaque jour à son bureau. Chemin faisant, il rencontre une vague connaissance, le Mathématicien, homme athlétique en costume blanc et fort élégant. Ensemble, ils évoquent l'anniversaire des soixante cinq ans du poète Washington Noriega, fête à la quelle ni l'un ni l'autre n'ont assisté, Leto parce qu'il n'y était pas invité, le Mathématicien parce qu'il était en voyage en Europe. Ce dernier évoque pour Leto cet anniversaire à travers la relation que lui en a fait un certain Bouton. Ainsi chacun cherche-t-il à « gloser », c'est à dire à commenter un fait dont il n'a pas eu personnellement connaissance. En réalité il ne se passe rien d'autre que ces bavardages, parfois médisants au termes desquels, plus on avancera dans la lecture de ce roman, moins on en saura, puisque les événements de cette soirée sont constamment parasités par leurs souvenirs personnels ! Le Mathématicien vit mal ses contradictions de classe et ne prise guère ceux qui appartiennent à la sienne. Leto, quant à lui est obnubilé par le suicide de son père. Dans cette relation pleine d'extrapolations plus ou moins surréalistes, il est un peu question de tout, comme du faux-pas d'un cheval ou de cette histoire de moustiques. Ainsi chacun donne son avis, fait des commentaires personnels, malvellants ou empreints d'une certaine mauvaise foi mais qui n'ont rien à voir avec le sujet qui les occupe puisqu'aussi bien nous avons là une somme de digressions, de résumés, de rappels, de reconstitutions de l'événement. Cela peut être passionnant ou carrément barbant, c'est selon.
A cette heure la ville est particulièrement animée et la circulation est dense et des incidents vont venir troubler la narration des promeneurs. Cela ne les empêche pas de rencontrer Carlos Tomatis, un journaliste vantard qui va également donné sa version des faits et bouleversera les certitudes de nos deux marcheurs. Une autre version sera aussi donnée par un ami du Mathématicien qui lui racontera dix huit ans plus tard dans les rues de Paris, il pense à une autre fête qu'il regrette.
Ce roman s'articule en trois parties qui en correspondent finalement qu'à la distance parcourue par les marcheurs (Les premiers sept cents mètres, les sept cents mètres suivants, les derniers sept cents mètres). Cette partition peut donner l'impression au lecteur qu'il s'agit d'un récit linéaire fort long par ailleurs mais ce n'est qu'une illusion puisque ces 300 pages du roman ne représentent en réalité qu'une heure de la vie de ceux dont il est question . A travers le passé et l'avenir ici évoqués, il est surtout question de la vie de Washington Noriéga à travers l'histoire de l'Argentine… C'est un véritable parcours labyrinthique
Qu'est ce à dire en réalité ? Que la réalité est relative, les témoignages sujets à caution et parfois partiaux et contradictoires. La vie peut être regardée comme quelque chose d'instable, de chaotique et l'imagination quelque chose qui n'a pas de limite. En tout cas ce récit qui n'en n'est pas vraiment un emporte l'adhésion du lecteur par le style débridé des phrases
Est-ce un exercice de style à la Queneau ou un récit aussi déjanté que celui que Perec nous offre dans « Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour » ? Cela m'a paru à moi comme quelque chose que j'aurais peut-être envie de poursuivre, dans une sorte d'écriture aussi déjantée que celle de l'auteur si, bien entendu, j'en avais le talent ou l'imagination, « n'est ce pas », comme dirait l'auteur.
Hervé GAUTIER – Octobre 2015 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE BOXEUR POLONAIS - Eduardo Halfon
- Le 21/10/2015
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°974– Octobre 2015
LE BOXEUR POLONAIS – Eduardo Halfon- Quai Voltaire.
Ce sont deux nouvelles assez courtes qui comportent ce recueil. De l'aveu même de l'auteur, c'est un genre littéraire dans lequel il s'exprime le mieux. Il me paraît important de commencer par la seconde au terme de laquelle cet écrivain guatémaltèque , juif polonais d’origine, ayant faut ses études aux États-Unis est invité à un colloque qui a pour thème « La littérature écorche la réalité ». C'est une formule assez sibylline qui, au milieu des insomnies qu'elle lui procure, lui fait penser à un film de Bergman. Il en vient à s'interroger sur l'interdépendance de la réalité et la littérature et conclue que cette dernière est, à ses yeux, synonyme de destruction puisque l'écrivain, même s'il souhaite en rendre compte avec précision, l'oublie. Cela l'amène à se remémorer une histoire que son grand-père lui racontait alors qu'il était petit. Le vieil homme lui révéla que le numéro tatoué sur son avant-bras était en réalité son numéro de téléphone qu'il ne parvenait pas à se rappeler. Plus tard, alors que son petit-fils a grandi et qu'il l'interviewe, le vieil homme lui parle du camps d’Auschwitz où il devait être exécuté. La veille, le hasard lui fait rencontrer un boxeur polonais qui, pendant toute la nuit, lui indique ce qu'il doit dire et ne pas dire aux Allemands qui le lendemain seront chargés de le juger et qui décideront de sa vie ou de sa mort. Le fait est qu'il a effectivement la vie sauve grâce à ses conseils. L'auteur décide donc, quelques années après, de raconter cette histoire qui fait l'objet de la première des deux nouvelles de ce recueil et qui apparemment lui convient parfaitement. Ce faisant, la littérature lui a donc permis de rendre compte de la réalité et non pas de l'écorcher.
Le hasard, toujours lui, fait que, longtemps après, l'auteur lit, publiée dans un journal guatémaltèque, l'interview de ce même grand-père sur sa détention et sa survie dans les camps de la mort. Le vieil homme révèle qu'il la doit simplement à ses talents de menuisier, les SS privilégiant effectivement les artisans qui leur rendaient des services et qu'ainsi ils sauvaient provisoirement de l'extermination. Il n'est donc plus question de ce proverbial boxeur polonais qui, tel Shéhérazade, a passé sa nuit à lui prodiguer des conseils. Dès lors, il a, en quelque sorte, la réponse à son questionnement sur la réalité et la littérature. Pourquoi son grand-père a-t-il déguisé la vérité derrière une histoire inventée ? L'auteur en conclue que la littérature est « comme le tour d'un prestidigitateur ou d’un sorcier, qui donne corps à la réalité et fait croire qu'il n'y en a qu'une. A moins que la littérature ne nécessite de détruire une réalité pour en construire une autre » Il y ajoute même une réflexion personnelle prétextant que la littérature devrait effectivement rendre compte de la réalité, que cela est à la portée de l'auteur mais qu'il est, peut-être malgré lui, sujet à l'oubli.
Derrière l'histoire relatée dans ces deux nouvelles, le thème de réflexion me paraît pertinent. Je note que, certes l'auteur, a rendu compte d'un souvenir personnel de son grand-père, mais que ce dernier l'a délibérément déguisé, peut-être parce qu'il ne voulait pas évoquer la triste réalité et qu'il préférait la travestir ainsi. D'ailleurs la supercherie de son numéro de téléphone procède de cette même démarche et rares sont les déportés qui ont accepté d'emblée de parler de leur détention dans les camps. On se souvient de la démarche de Jorge Semprun dans « L'écriture ou la vie ». C'est là un oubli volontaire et, quand un auteur choisit de relater ses souvenirs, et au cas particulier ceux de sa famille ce qui est, comme souvent un thème récurrent chez un écrivain, il fait effectivement un tri parmi eux. C'est un parti-pris parfaitement respectable qui ne fait que mettre en lumière sa liberté de création. L'oublie-t-il volontairement pour autant ? Ce n'est pas sûr et il se réserve peut-être le droit d'y revenir plus tard, lors de la rédaction d'une autre œuvre. La mémoire qu'un créateur veut faire revivre avec des mots subit effectivement une forme de choix inconscient du à sa sensibilité ou à sa volonté de prouver quelque chose, étant entendu que c'est lui qui a la main unique du scribe. D'autre part nous savons tous que l'écriture est le domaine de la création et que la fiction vise justement à créer quelque chose qui n'existe pas, pourquoi pas sur les cendres d'autre chose, comme une sorte de phénix .
Je n'ai abordé l’œuvre d'Eduardo Halfon que très récemment (La Feuille Volante n°966 pour Signor Hoffman). J'en ai goûté le style et l'ambiance un peu particulière, à la fois nostalgique et lente qui sourd de ses textes autant que l’invitation à la réflexion sur le rôle de la littérature.
Hervé GAUTIER – Octobre 2015 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
Signor Hoffman - Eduardo Halfon
- Le 04/10/2015
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°966– Octobre 2015
Signor Hoffman – Eduardo Halfon – Quai Voltaire.
Traduit de l'espagnol (Guatemala) par Albert Bensoussan.
Composer un recueil de nouvelles est un exercice difficile. Ici, l'auteur, Edurdo Halfon, un jeune juif d'origine polonaise mais de nationalité guatémaltèque, ce dont peu douter son interlocuteur à cause de son teint trop pâle et son espagnol pas assez tropical, se met lui-même en scène, donnant à l'ensemble du recueil écrit à la première personne une forte coloration autobiographique. Il est invité en Italie pour la reconstitution d'un camp de concentration fasciste en Calabre dans lequel des juifs avaient été internés à partir de 1940. Il doit intervenir dans le cadre de la mémoire de l'Holocauste et c'est pour lui l'occasion d'évoquer son précédent livre et son grand-père, survivant d'Auschwitz. Le hasard de l'actualité fait que son patronyme est, à cette occasion, germanisé pour devenir « Hoffman » parce qu'un acteur connu portant ce nom vient justement de mourir. Pour un jeune juif, entendre son nom qui n'a rien d'allemand, dans le contexte d'évocation de l'Holocauste, c'est plutôt traumatisant même si, par la suite, il a l'intuition que tel était bien son patronyme original. [« Signor Hoffman »]. Ainsi, tout au long de ce recueil, ces deux déclinaisons du même nom se répondent.
Il y a, dans ces nouvelles, une dimension de luttes sociales victorieuses [« Les oiseaux sont revenus »]. Un village nommé La Libertad a dû triompher des conflits armés meurtriers, des malversations, des escrocs, de la crise du café pour conserver la coopérative qu'avaient créer les petits planteurs de café pour lutter contre les multinationales. Dans « Sable blanc, pierre noire », l'auteur est coincé à la frontière du Belize, à la fois par des tracasseries du bureau de l'immigration que par une panne de batterie. C'est étonnant parce qu'il décrit un récit où il ne se passe pratiquement rien, où le temps passe vite malgré l’inaction mais où on ne s'ennuie pas. La vision fugace d'une main étrangère portant une bague où est sertie une pierre noire lui rappelle un autre bijou sans grande valeur mais qui avait appartenu à un grand-père. Cette brève image évoque cet homme qui a survécu aux camps nazis, ceux de sa famille qui y ont péri et tous ceux, inconnus, qui en ont été victime. Par une sorte de fiction, il en vient même à penser que cette bague est celle de son grand-père. C'est que, dans chacune de ses nouvelles, l'auteur donne une dimension autobiographique qui dépasse la simple mise en scène de sa personne. Chacune des nouvelles a donc cette dimension de la mémoire.
Il y a, chez lui, une idée particulière du voyage, unique et sans fin, sans doute une illustration du mythe du juif errant [« J'ai hésité à lui dire que tous les voyages n'étaient en réalité qu'un seul voyage, avec de multiples arrêts et escales. Qu'un voyage, quel qu'il fût, n'était linéaire, ni circulaire, ni ne finissait jamais. Que les voyages n'avaient pas de sens. Mais je me suis abstenu »]. J'y ai vu aussi une sorte d’intranquillité d'un jeune homme qui, perdu dans Harlem ou dans l'ancien ghetto de Łődź, à la recherche improbable des traces de sa famille, trouve un réconfort fugace dans la fumée bleue d'une cigarette. Il rencontre toujours, par une sorte de miracle, quelqu'un pour le guider, mais dans le texte qui résulte de ses nombreuses pérégrinations, il flotte une ambiance bizarre, pas vraiment apaisée et pas vraiment rassurante, une sorte de crainte de quelque chose, de l'oubli peut-être … mais en sourdine [« Survivre au dimanche »]. Il y aussi, presque en permanence, le rappel de la mémoire, celle d'un être mort, peut-être pour redire que nous en sommes ici que de passage, simples usufruitiers de notre propre existence, l'histoire des Juifs étant particulièrement imprégnée de ce caractère transitoire.
Le discours est narratif, linéaire et quand il décrit une scène, même anodine, il le fait avec force détails qui peuvent paraître inutiles, comme s'il décomposait un geste simple, pour le plaisir. J'y ai vu une ambiance quelque peu particulière, une musique un peu lente, nostalgique et pas seulement quand il évoque sa famille. Il y a même un zeste d'humour [« Oh ghetto mon amour »], à la fois subtil presque en filigrane dans ces lignes.
Hervé GAUTIER – Octobre 2015 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA PATIENCE DU FRANC-TIREUR
- Le 04/08/2015
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°948– Août 2015
LA PATIENCE DU FRANC-TIREUR – Arturo Perez-Reverte – Le Seuil.
Le titre donne à penser bien autre chose que ce dont il va être question surtout de la part de Reverte qui, avant d'être un auteur à succès a été correspondant de guerre. Avec ce polar, l'auteur nous fait pénétrer dans le monde des tagueurs et plus exactement de l'un d'eux nommé Sniper, star mondial du graff, à cause de sa signature qui ressemble à un cercle de visée. C'est un personnage mystérieux, invisible mais dont les œuvres, parce qu'elles sont peintes dans des endroits inattendus, véhiculent un discours anti consumériste et provocateur par l’intermédiaire d'internet. Lui-même œuvre souvent à la limite de la légalité. Cela fait de lui l'ennemi des municipalités et de leurs agents de nettoyage et bien entendu l'idole des tagueurs. De plus il lance des défis aux autres qui parfois prennent des risques insensés et y laissent leur vie. Il n'en fallait pas davantage pour qu'un éditeur s'intéresse à son cas et charge, Alejandra Varela, une spécialiste des graffiti, de le retrouver pour lui proposer une édition de luxe et une exposition au Moma. Cela ne se fera pas facilement, bien entendu puisqu'un contrat a été mis sur la tête de Sniper. Le fils d'un millionnaire a en effet perdu la vie en relevant un de ses défis et son père entend avoir sa peau… Mais Sniper est insaisissable !Tel est l'intrigue de de roman
L'auteur mène son intrigue comme il fait toujours, avec brio, en invitant son lecteur au dépaysement, le faisant voyager dans toute l'Europe et surtout en Italie, en n'oubliant pas la personnalité de l’enquêtrice, Alejandra, surnommée Lex, qui est aussi la narratrice, lesbienne, bagarreuse, historienne de l'art urbain dont elle a fait le sujet de sa thèse. L'auteur renoue à cette occasion dans l'évocation de femmes d'exception comme c'est souvent le cas dans ses différents romans
Je n'y connais pas grand-chose à l'art du tag mais je veux bien admettre qu'il constitue une expression artistique propre à notre temps, après tout, s'il ne choisit pas n'importe quel support, il met ce courant à la vue de tous puisqu'il s'agit d'un art de la rue que chacun peut juger. On n'est pas obligé d'aller dans un musée et l'art n'est plus dès lors réservé à une élite qui peut se l'offrir. Cela dit, on peut s’interroger sur la fonction de l'art. Si la peinture est celui de la représentation du réel, au cours de l'histoire, peindre a le plus souvent été la manifestation d'une certaine réaction contre ce qui était considéré comme classique. Ceux qui choisissaient d'enfreindre ce courant, c'est à dire de faire évoluer les choses dans un sens plus moderne, qui cherchaient à imposer leur vues, à laisser une trace personnelle et nouvelle, étaient invariablement rejetés par une société conservatrice. Ce n'est que bien plus tard, souvent après leur mort, qu'éventuellement ils étaient admis parmi les artistes reconnus qu'on caractérisait d'un nom, d'une école, d'un style. Ces mouvements s'inscrivaient en réaction contre ce qui était admis mais connaissaient des destins parfois étonnants. Ce mode d'expression qu'est le graff caractérise notre temps qui est celui de le contestation permanente voire de la rébellion. De là à le considérer comme l'expression de cette révolte, il n'y a qu'un pas que je veux personnellement bien franchir. Le fait que le support choisi soit les murs des villes, le plus souvent gris, serait plutôt bien, à condition bien sûr que cela ne soit pas sauvage.
J'en ai bien entendu appris beaucoup, autant sur le milieu des tagueurs que sur leur technique. Quant à l'intrigue de ce roman à la fois violent et plein de suspens, je l'ai trouvée assez quelconque. Je n'ai pas vraiment retrouvé le souffle du « Maître d'escrime » par exemple.
Hervé GAUTIER – Août 2015 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
Don Quichotte
- Le 09/05/2015
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°903– Mai 2015
Don Quichotte . Miguel de Cervantes
Je viens de relire Don Quichotte, œuvre qu'il est inutile de résumer puisque depuis sa parution on l'a abondamment commentée. Je me suis seulement demandé si cet étrange roman n'était pas toujours d'actualité et si la folie n'était pas un refuge bienvenu surtout dans une société si marquée par la réussite, l'argent, la recherche de la notoriété, du profit, des apparences et si, face à cela qui ne me convient décidément pas, il ne valait mieux pas vivre dans un monde parallèle, si marginal soit-il, pour ne pas vivre selon les critères sus-nommés.
N'est-il pas en effet rassurant de poursuivre des « châteaux en Espagne » (sans mauvais jeu de mots) c'est à dire des choses qui n'ont aucune chance de se produire, ne serait-ce que pour nous aider à vivre dans cette vallée de larmes qu'est la vie. D'aucuns nommeront cela fantasmes, oui, et après ! Poursuivre un rêve, de préférence un peu fou, qu'on peut aussi nommer ambition personnelle n'est-ce pas un peu faire le même parcours que notre pauvre chevalier ? Comme lui on peut toujours rêver de faire quelque chose de notre pauvre vie , de marquer notre passage sur terre et ne jamais y parvenir tant sont nombreux ceux qui ont décidé de nous en empêcher, de nous trahir jusque dans notre immédiat entourage. Il en va de même quand notre pauvre ami décide de faire une confiance aveugle à ceux qu'il rencontre. Dans notre monde où la trahison est presque érigée en règle du jeu, nous savons tous, pour l'avoir expérimenté que s'en remettre ainsi aux autres est une attitude bien risquée. Quant à vouloir à toute force s'improviser redresseur de torts, même si cela témoigne d'une grandeur d'âme, cela ne peut vous attirer bien souvent que des ennuis. L'actualité est riche de ces expériences avortées.
En ce qui concerne la promesse que fait Don Quichotte à Sancho Panza de lui confier le gouvernement d'une île imaginaire, cela me rappelle, toutes choses égales par ailleurs, Don Quichotte n'étant pas susceptible de mauvaise foi, les promesses électorales dont nos élus ne sont pas avares mais qui ont la particularité de ne jamais voir le jour. Un ancien président de la République n'a-t-il pas dit qu'elles n'engageaient que ceux qui les croyaient ? Sauf que dans le cas des politiques il n'y a ni la naïveté ni l'idéalisme du Chevalier à la triste figure.
Quant à se battre contre les moulins, il nous est sans doute arrivé de nombreuses fois dans notre vie de le faire à notre tour sans forcément que l'issue soit semblable à celle qu'a connue notre pauvre chevalier. Cet épisode qu'on retient volontiers, malgré toutes les autres aventures de notre héro, est emblématique et il est évidemment facile de s'en moquer. Pour autant, n'a-t-on jamais fait, sous influence, des choses qui plus tard, la période d'émotion passée, ont heurté notre propre raison et notre propre logique ? Bien malin sans doute qui pourrait affirmer le contraire.
Idéaliser une femme comme le fait Don Quichotte en lui donnant les attributs de la belle Dulcine de Toboso, cela aussi nous l'avons tous fait, et pas forcément pour notre bonheur. Au moins notre chevalier en va-t-il pas jusqu'au mariage, reste-t-il dans son monde et n'est-il pas confronté à la trahison, au mensonge, à l'adultère qui sont souvent les conséquences de cet aveuglement.
Est-ce que cette manière de s'improviser chevalier errant à une période où ils n'existaient plus n'était pas finalement une marque d'originalité, une volonté de se démarquer face à l'instinct grégaire qui veut que chacun ressemble à son voisin ou plus sûrement à des personnages connus ? Plongé dans une société qu'il réprouve et désireux de s'en démarquer, il sera quand même rejoint par ceux qui la font et qui ne manqueront pas de saisir l'occasion d'abuser de sa naïveté et ce malgré la voix de la raison de son bon Sancho qui, à l'occasion, en profite même un peu lui aussi. Et d’ailleurs n'avons-nous pas nous-mêmes parfois saisi de pareilles opportunités au détriment d'êtres plus fragiles pour les mystifier encore davantage.
Quant à la méditation sur la vanité des choses, cela vaut bien tous les messages philosophiques ! Cette histoire sur la relativité des choses humaines est bienvenue. L'homme est naturellement porté vers la puissance, le pouvoir, la richesse. Le fait d'être important un jour et le lendemain n’être plus rien est très actuel et carrément éternel, les Romains ne disaient pas autre chose parlant de la Roche Tarpéienne si proche du Capitole.
Quant à cette période un peu folle qui voit Don Quichotte, hidalgo paisible, se transformer en chevalier errant, c'est sans doute aussi la jouissance intérieure que nous ressentons tous quand le hasard nous prête ce « quart d'heure de gloire » si agréable qui nous fait sortir, forcément provisoirement, de la condition de quidam.
En réalité ce roman, derrière des apparences volontiers critiques voire comiques, me paraît camper à travers Don Quichotte un personnage emblématique de la condition humaine. Ce faisant, Miguel Cervantes a évoqué, comme le feront plus tard Shakespeare, Molière, Victor Hugo ou Céline une part de nous-mêmes.
Une des causes de la folie de Don Quichotte est la lecture effrénée des romans de chevalerie qui lui auraient asséché la cervelle. La lecture aurait donc des effets néfastes sur le cerveau. C'est vrai que même si la chevalerie n'est pas vraiment ma tasse de thé, j'aime bien les romans. Ils me procurent un dépaysement bienvenu et d'autant plus apprécié que mon quotidien se révèle de jour en jour plus délétère. Et je dois avouer que « ce vice impuni » me taraude depuis bien longtemps, cette chronique en est notamment le témoin. Pourtant, je ne me sens pas menacé. Quoique !
©Hervé GAUTIER – Mai 2015 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
TANT DE LARMES ONT COULE DEPUIS
- Le 20/09/2014
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°803 – Septembre 2014.
TANT DE LARMES ONT COULE DEPUIS – Alfons Cervera- La contre allée.
Traduit de l'espagnol par Georges Tyras.
Nous sommes à Los Yesares le jours de l'enterrement de Teresa dont il est question dans « Ces vies-là »(La Feuille Volante n°566). Le narrateur, installé en France, à Orange, avec ses parents depuis de nombreuses années, revient pour assister à cette cérémonie. Comme à chaque fois, dans ce genre de rencontre autour d'un mort, on retrouve famille et amis et c'est l'occasion d'égrener des souvenirs. Les histoires d'amour s'y mêlent à celles des disparus, on évoque la guerre civile, l'exil, la détresse et la survie dans un autre pays que le sien. C'est que ce village a été, comme les autres, marqué par la guerre civile, le franquisme, la crise économique, le déracinement, les vagues successives d'émigration...
Le narrateur alterne son témoignage et les souvenirs d'autres personnages pour réveiller la mémoire. On a parlé « d’écriture chorale » à son propos. Cette histoire s'écrit à travers les vivants et les morts mais en tout cas dans ces « vies insignifiantes » qui se sont déroulées dans le silence, le bruit, les corps et les images qui reviennent au hasard des souvenirs de chacun. C'est une sorte de labyrinthe ou l'oubli parfois cohabite avec le mensonge parce qu'on fait prévaloir le masque rassurant des apparences. Certains sont revenus définitivement, d'autres n'y font que des visites ponctuelles comme le narrateur, mais tous ont en commun une mémoire qui les relie entre eux. Ils ont tous connu, en France où ils sont venus travailler, le rejet, le mépris, le racisme...Tous ces témoignages nécessairement fragmentaires sont comme les morceaux d'un puzzle, ils en ont le mystère et l’hésitation, l’approximation parfois. Ils sont pleins de colère, de douleurs, d’espoirs déçus. Petit à petit cela forme une sorte de tableau, à la fois impressionniste et réaliste, comme si l'écriture faisait échec à l'oubli et peut-être invitait le lecteur à faire sien le sentiment de révolte, de crainte et de douleurs de tous les exilés de tous les temps et de tous les pays. Ils seront toujours les boucs de la population et la cible des extrémistes.
Le style est simple, dépouillé, poétique souvent. Les chapitres sont brefs et des analepses qui mélangent présent et passé laissent une impression de permanence.
Le narrateur nous parle aussi de lui et sème dans son texte des références de ses lectures personnelles où René Char voisine avec Antonio Marchado, Jorge Luis Borges avec William Faulkner.
Alfons Cervera (né en 1947) fait partie de ces écrivains qui se sont appropriés cette période de l'histoire espagnole qui va de la seconde république à la démocratie retrouvée et qui ont voulu, par l'écriture, faire échec à l'oubli qui caractérise tant l'inconscient collectif de nos sociétés humaines. Comme tout écrivain, il a commencé par raconter une histoire familiale, forcément pudique et silencieuse en y mêlant souvenirs et imaginaire mais il s'est aperçu assez vite qu'il y avait « des territoires de la mémoire à explorer » avec ces zones d'ombre et de lumière. Il en a fait un thème de réflexion et de création en y incluant la mémoire collective, en se faisant le porte-parole des vaincus, prenant en compte leur témoignage, leur exemple et leur rendant ainsi leur dignité.
Il devient ainsi non seulement un écrivain classique avec son bagage de rêve et de dépaysement mais aussi le « témoin » d'un monde qu'il n'a peut-être pas connu directement mais qu'il fait revivre en l'évoquant par la mémoire et en nous invitant à y réfléchir.
©Hervé GAUTIER – Septembre 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA GRANDE EMBROUILLE-
- Le 09/06/2014
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°756 – Juin 2014.
LA GRANDE EMBROUILLE- Eduardo Mendoza – Le Seuil.
Traduit de l'espagnol par François Maspero.
Le narrateur n'est autre qu'un ancien détective privé, reconverti en coiffeur pour dames, mais aussi l'ancien compagnon de cellule du beau Romulo du temps où ils étaient ensemble pensionnaires d'un asile psychiatrique. Ce genre de cohabitation crée des liens et c’est sans doute pour cela que lorsque la belle-fille, surnommée « Bout-de-fromage », de son ancien compagnon vient le solliciter pour retrouver son beau-père disparu, il n'hésite pas, laisse tomber ciseaux et peignes et se met en devoir de rechercher cet ami qui n'est en fait qu'un petit malfrat sans la moindre envergure. Il le fait d'autant plus volontiers qu’on évoque alors un enlèvement et pourquoi pas un assassinat, ce qui ne serait pas impossible dans les bas-fonds de cette Barcelone frappée par la crise ! Et d'ailleurs ce n’est pas clientèle de sa petite entreprise qui monopolise beaucoup son énergie ; ce local devient donc son quartier général.
Dans cette quête improbable et puisque toute bonne investigation passe par une surveillance constante, notre ex-détective, passablement désargenté va faire appel à une équipe un peu hétéroclite, une statue vivante des Ramblas, une famille chinoise, une fillette spécialiste des serrures, une accordéonistes de rues, un livreurs de pizzas, un mendiant africain, une famille chinoise...bref une bande de pieds-nickelés dont les aventures se révèlent sans grand intérêt d'autant que la recherche du beau Romulo s'éternise un peu pour déboucher sur un centre de yoga et aussi, et c'est plus inattendu, sur un hypothétique complot terroriste qu'il convient de faire échouer visant à assassiner Angela Merkel, la chancelière allemande ! Je passe sur l'erreur sur la personne et tout le décor de l'attentat manqué et les allusions à la crise économique. Telle est la trame rocambolesque de ce polar picaresque, baroque, loufoque et plein de rebondissements mais qui ne m'a guère passionné. Je suis peut-être encore un fois passé à côté de quelque chose mais je n'ai que très modérément apprécié cette lecture.
Pourtant, même si j'ai parfois un peu apprécié le style de Mendoza (La Feuille Volante n° 750-756), j'ai eu du mal à entrer dans ce roman qui, quoique désopilant et échevelé m'a laissé un goût bizarre, quelque chose qui ressemble à de la déception qui reste quand j'ai refermé ce livre.
©Hervé GAUTIER – Juin 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
CONFITEOR - Jaume CABRE
- Le 05/06/2014
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°754 – Juin 2014.
CONFITEOR- Jaume CABRE – Actes Sud.
Traduit du catalan par Edmond Raillard.
« Confiteor », premier mot latin de l'acte de contrition selon l'ancienne formule du rituel catholique où l'on s'accuse de ses fautes et on en implore le pardon devant Dieu. Le ton est donc donné, ce sera celui de la confession mais sous une forme particulière, celle de l'écriture et ce cérémonial qui allège l'âme est cependant labyrinthique et parfois cahoteux comme la démarche d'un pénitent qui, pressé de se libérer, sollicite ses souvenirs qui se manifestent avec un certain désordre, d'où, sans doute un style haché et quelque peu déconcertant. C'est vrai que les analepses ne manquent pas dans ce roman de près de 800 pages. Il y a non seulement l'histoire de sa famille, de son enfance sous la houlette d' Aigle Noir et du shérif Carson, Barcelone dans les années 50, mais aussi des évocation du nazisme, de l'inquisition, du franquisme, de la république espagnole et les espoirs qu'elle portait, la guerre civile, de l'Italie au XVII° siècle... Le lecteur est quelque peu ballotté d'un pays à l'autre, d'une période à une autre, croise des personnages attachants ( un bûcheron, un fabriquant de violons, Lola Xica ) mais aussi d'autres infiniment moins recommandables (Un colonel SS, un médecin allemand dévoyé, un inquisiteur) avec tout ce qui fait les grandeurs (amour pour Sara, amitié pour Bernat, obsession de l'esthétique, dissertation sur le beau, érudition) et les petitesses de la condition humaine (lutte du bien et du mal, guerre, horreur et haine, folie des hommes, les camps de la mort). Pendant que sa mémoire n'est pas encore mangée par la maladie d'Alzheimer ou par la vieillesse Adria Ardèvol refait à l'envers son parcours sur terre. Jeune, c'est un garçon solitaire brillant et plein de promesses dans qui ses parents, pourtant peu aimants, mettent beaucoup d'espoirs. C'est à cause de cet absence d'amour qu'il va se dédié à l'étude. Il sera un érudit polyglotte et un universitaire célèbre.
Mais, à la mort de son père, cherchant dans cette mémoire encore intacte, il va peu à peu découvrir les origines douteuses de la richesse cette famille qui avait prospéré dans le négoce des œuvres d'art. C'est justement un objet, un violon dont il a parfois joué, pièce unique qu'on convoite de générations en générations qui servira de fil d'Ariane à ce récit.
Dans ce salmigondis de personnages, de lieux et d'époque, je me suis un peu perdu. Que les règles classiques du discours et de la narration soient outrepassées et même parfois violentées pourquoi pas ? Que ce récit prenne parfois des allures de puzzle dont les pièces sont, sans la moindre transition, opportunément éparpillées par l'auteur, soit mais j'ai cependant été un peu déconcerté par ce processus d'écriture.
Ce récit est le théâtre de l'affrontement du bien et du mal autant dire une constante dans la condition humaine et la culpabilisation s'inscrit dans la logique judéo-chrétienne. Quant au pardon, il reste, il me semble, une impossibilité... Ce problème du pardon m’intéresse en tant que thème de réflexion même si j'en donne personnellement une acception assez personnelle et en complète contradiction avec le message du catholicisme.
Je suis peut-être passé à côté de quelque chose mais j'avoue que je ne suis pas du tout entré dans ce roman.
©Hervé GAUTIER – Juin 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LES AVENTURES MIRACULEUSES DE POMPONIUS FLATUS
- Le 22/05/2014
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°752 – Mai 2014.
LES AVENTURES MIRACULEUSES DE POMPONIUS FLATUS – Eduardo Mendoza - Le Seuil.
Traduit de l'espagnol par François Maspero.
A la recherche d'une hypothétique source miraculeuse, Pomponius Flatus, patricien, philosophe-incrédule devant les dieux entreprend un voyage dans l'empire romain ce qui lui provoque de fréquents dérangements intestinaux. Nous sommes au premier siècle de notre ère et il narre ses tribulations voyageuses à un certain Fabius qui le conduisent à Nazareth où un certain Joseph, charpentier de son état, vient d'être condamné à mort pour avoir assassiné un riche propriétaire juif. Il rencontre son jeune fils, Jésus, convaincu de l'innocence de son père qui lui propose de le disculper. Voilà donc notre voyageur précipité un peu malgré lui dans une enquête d’autant plus difficile que ledit Joseph semble vouloir accepter son sort avec résignation et conserver le silence sur les circonstances de cette affaire même si cela doit lui coûter la vie.
Traversant des contrées diverses, il promène sur celles-ci et ceux qui les habitent, sur leurs sociétés, leurs règles, leurs hypocrisies, leurs religions, un regard critique et se transforme ainsi en ethnologue, sociologue et pourquoi pas théologien puisqu'aussi bien il en profite pour donner son avis sur Dieu (et les dieux), sur la Bible, le Coran ou la Vulgate et même pour réécrire à sa manière un autre évangile apocryphe, un de plus ! Comme dans toute enquête policière il y a des meurtres, des mystères et des péripéties inattendues et celle-la ne fait pas exception. Pour l'aider dans ses investigations notre brave Pomponius n'hésite pas à s'adjoindre les services d'un légionnaire dont la force physique n'a d'égal que la naïveté. Il faut dire que, bien qu'en terre d'occupation, Pomponius, parce qu'il est citoyen romain et noble de surcroît, bénéficie de la protection des tribuns locaux ce qui lui confère une certaine liberté
C'est une aimable fable historico-policière où l'auteur amène son lecteur à faire des rencontres un peu surréalistes qui prennent leur source dans son imagination débordante. Dans cette fiction carrément invraisemblable, les gens portent des noms qui ne sont pas le leur, des dieux descendent parmi les hommes, on assiste à un vaste entreprise de mystification collective avec, à la clé des songes dont l’interprétation se veut significative, des zones d'ombre et des affirmations difficiles à admettre, un peu comme tout ce que les religions nous assènent dans leur message !
Le hasard m'a fait connaître les romans d'Eduardo Mendoza et j'avoue bien volontiers que pour une fois il a bien fait les choses [La Feuille volante n°750]. Ici, non seulement j'apprécie l'histoire, le dépaysement mais aussi l'érudition (mais parfois les dialogues en sont un peu trop farcis), l’humour, le suspense, le style jubilatoire... Mais quand même, j'ai été, au fur et à mesure de ma lecture, un peu lassé par les faits rapportés, et même un peu déçu à la fin.
©Hervé GAUTIER – Mai 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
BATAILLE DE CHATS
- Le 14/05/2014
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°750 – Mai 2014.
BATAILLE DE CHATS – Eduardo Mendoza
Traduit de l'espagnol par François Maspero
Le roman s'ouvre sur une rupture amoureuse épistolaire, une lettre un peu lâche écrite dans un train qui conduit à Madrid Anthony Whitelands, un expert britannique en peinture espagnole qui ainsi rend sa liberté à Catherine, sa maîtresse depuis près de trois ans. Nous sommes en mars 1936, l'Espagne est républicaine, l'agitation sociale est à son comble, les grèves sont quotidiennes, l'ordre public est gravement menacé et la guerre civile couve. Il se rend donc à Madrid chez un aristocrate, le duc de la Igualada pour une estimation en vue d'une transaction qui doit restée secrète à cause des événements. L'aristocrate souhaite en effet se défaire de sa collection de tableaux pour financer sa fuite et celle de sa famille. C'est donc pour Whitelands, habitué à la tranquillité des musées, un voyage à hauts risques dans un pays au bord de l'implosion puisqu'il est interdit que des œuvres d'art quittent l'Espagne.
Comme rien n'est simple, il va être rattrapé par ses vieux démons d'une part en la personne de Paquita, la fille du duc avec qui il a quelques affinités et surtout un tableau inconnu de Velázquez appartenant à ce même duc, qu’il juge authentique et d'une inestimable valeur. On ne s'étonnera donc pas trop que notre ami souhaite différer quelque peu son retour en Anglettre. A la suite d'une mésaventure, il contacte l'ambassade d'Angleterre et, dans le même temps se retrouve invité à collaborer avec la sécurité espagnole. Bref, tout cela devient bien confus et même carrément glauque pour cet Anglais un peu naïf et pas mal porté sur la bouteille, d'autant plus que, lui qui n'a jamais fait de politique constate que tout cela finalement le dépasse, lui qui n'était venu ici que dans un but artistique. Il se trouve en effet compromis avec les phalangistes et pour cela poursuivi par la police républicaine. Il découvre comment les tribuns galvanisent la foule de leurs sympathisants et les amène à combattre grâce à des discours, des chants et des saluts emblématiques, le tout dans une ambiance délétère où tous les protagonistes ne rêvent que d'en découdre. Cette période troublée débouchera sur une guerre civile sanglante. Le contexte international explosif, l'achat d'armes, l'espionnage et les rumeurs de coup d'état militaire, la politique étrangère de la Grande-Bretagne et l'équilibre de cette région, les problèmes diplomatiques, les troubles quotidiens et violents entre fascistes et républicains bousculent ce pauvre homme de plus en plus perdu dans cet imbroglio auquel il n'était évidemment pas préparé. C'est un peu comme s'il se trouvait au centre d'un maelstrom sans trop pouvoir comprendre ce qui lui arrive, et de plus le voilà affublé d'une petite prostituée espagnole qui espère gagner l'Angleterre avec lui. Pour des raisons qu'il ne peut encore comprendre Paquita, cette femme énigmatique et dont il est de plus en plus amoureux, lui demande de déclarer à son père que le Velázquez est un faux alors qu'il n'en est rien.
Pour lui, la découverte de ce tableau inconnu de Velázquez (un nu qui n'est guère dans le style de l'époque) serait un tournant favorable dans sa carrière d'expert et d’universitaire mais, à cause de ce fait nouveau le conservateur de la « National Gallery » entre en scène. Ce tableau a pourtant, pour la république et ses opposants politiques une toute autre signification mais l'intérêt personnel et immédiat d'Anthony se trouve contrecarré par cette aventure un peu rocambolesque et qui met surtout en perspective une lutte pour le pouvoir et les magouilles qui permettent de l'obtenir. Sa seule planche de salut serait sans doute de quitter le pays mais les événements autant que l'attirance qu'il éprouve pour Paquita l'en empêchent.
C'est donc à un roman historico-policier palpitant où se mêlent violence, mensonge et amour auquel le lecteur est invité. L'Histoire et ses personnages réels se mêlent à cette cette fiction qui se déroule avec un sens consommé du suspense. On y croise le résumé des événements politiques qui ont bouleversé l'Espagne mais aussi une érudition artistique de grande qualité et une présentation explicative très fine de certains tableaux. J'observe également que l’auteur se livre au cours du récit à une analyse pertinente des faits historiques qui ont précédé la guerre civile et livre également une opinion assez juste des protagonistes principaux de ce conflit et du contexte espagnol. Reste Anthony qui se révèle un séducteur un peu malgré lui et un témoin étonné de toutes ces situations. Il est carrément perdu et même dépassé dans cette lutte d'influences au point qu'il craint pour sa vie d'autant plus qu'autour de lui c'est un jeu de massacre qui accompagne ses aventures avec morts et blessé. A ce sujet, je veux dire que la fiction autorise évidement toutes les mises en scène, que les périodes troublées comme celle que l'auteur a choisie, favorisent les rencontres les plus insolites voire les plus inattendues mais j'ai eu quand même un peu de mal à admettre que ce pauvre Anthony ait pu aussi facilement approcher les principaux protagonistes d'un drame qui va ensanglanter toute l'Espagne.
Finalement, le lecteur connaîtra la vérité sur ce tableau qui est le prétexte à cette affaire et Anthony un peu étourdi aura sans doute un peu de mal à se remettre de cette aventure.
Et les chats dans tout cela ? On n'a guère vu dans ce roman trace de nos compagnons félins qui, bien souvent sont les acteurs un peu involontaires des roman à suspenses. C'est que, sans qu'on sache très bien pourquoi, les habitants de Madrid sont surnommés les « gatos », les chats ; Cette bataille de chats est donc en réalité une bataille de Madrilènes puisque ce roman se déroule dans la capitale de l'Espagne.
©Hervé GAUTIER – Mai 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
REQUIEM - Antonio Tabucchi
- Le 10/05/2014
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°748 – Mai 2014.
REQUIEM – Antonio Tabucchi – Christian Bourgois
Traduit du portugais par Isabelle Pereira.
Nous sommes dans l'Alentejo, une région du sud du Portugal et, dans une maison de campagne, un homme assoupi sous un arbre est transporté en songe à Lisbonne et dans ses environs. C'est une longue hallucination qui va durer douze heures pendant le dernier dimanche de Juillet, torride comme il se doit ici.
Le narrateur qui est Italien va aller, par le biais du rêve à la rencontre de ses souvenirs et dans cette atmosphère comateuse vont se mêler le présent et le passé, des fantômes et des vivants, bref une alliance de réalité et de fantasmes où le passé resurgit à l'occasion d’une rencontre et des dialogues un peu surréalistes se nouent le temps d'un bref échange avec une incursion dans le tableau de Bosch, « la tentation de Saint Antoine ». Il balade donc son lecteur dans un décor sans véritable fil d'Ariane, un peu à la fantaisie de son imaginaire.
A ce récit onirique, l'auteur mêle volontiers nombre de recettes de cuisine portugaises.
Je ne sais pas si je suis passé à côté de quelque chose mais, bien que cet auteur ne soit pas un inconnu pour cette revue (La Feuille Volante n° 206 et 489) qui en a déjà parlé, je ne suis pas entré dans cet univers créatif. Pourtant le contexte de Lisbonne notamment se prêtait parfaitement à un dépaysement de bon aloi. C'est sans doute dommage puisqu'il est très amateur de l’œuvre de Fernando Pessao et que cet auteur majeur m'a toujours bouleversé, autant parce qu'il a été que parce qu'il a écrit. Je ne l'ai pas retrouvé dans cette fiction, même à la fin.
La manière de Tabucchi de donner à son roman une dimension gastronomique qui, à l'évidence le met dans le contexte portugais, n'a pas vraiment retenu mon attention.
Je ne partage donc pas l'enthousiasme de la 4° de couverture.
Je déplore aussi la composition du texte. Cette manière « linéaire » de présenter les dialogues a quelque chose d'un peu dérangeant pour le lecteur et n'apporte rien, à mon avis à la qualité du texte ou de la traduction.
Je poursuivrai cependant la découverte de l'univers créatif de Tabucchi qui m'a toujours semblé valoir la peine d'une lecture.
©Hervé GAUTIER – Mai 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE CAPITAINE ALATRISTE
- Le 27/04/2014
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°745 – Avril 2014.
LE CAPITAINE ALATRISTE – Arturo Perez-Reverte – Le Seuil
Traduit de l'espagnol par Jean-Pierre Quijano
L'histoire de Diego Alatriste y Tenorio, nous est contée par Iňigo, un pauvre petit garçon de douze ans que sa mère, veuve de Lope Balboa, un ami d'Alatriste, lui confia un jour pour être son domestique à cause de la misère qui régnait alors en Espagne. C'est un personnage que cet homme qui n'avait de capitaine que le surnom, rescapé des combats de Flandres et qui survivait en louant son épée « pour quatre maravédis la journée »,c'est à à dire pas grand chose, à ceux qui n'avaient ni le courage ni l'adresse de vider leurs querelles, autrement dit un vulgaire spadassin qui tâtait parfois des cahots du roi, pour dettes évidemment ! Bref, il était maintenant un homme de main à la petite semaine qui vivotait à Madrid mais la réputation de ce rescapé des champs de bataille des Flandes et d'ailleurs, aux états de service prestigieux, était cependant établie. Il fut contacté par deux curieux commanditaires masqués qui lui proposèrent d'agresser, mais sans les tuer, deux voyageurs anglais qui devaient arriver dans la capitale du royaume. Ce « contrat » était d'autant plus bizarre que leur succéda un dominicain de l'Inquisition qui lui demanda d'exécuter ces deux voyageurs en lui adjoignant un comparse italien du nom de Malatesta. Le voilà donc transformé malgré lui en bras armé du Saint-Office. Alatriste, habitué aux ordres simples des champs de bataille se vit donc confronté à une situation qui le dépassait. Cette affaire lui paraissait d'autant moins claire que, le combat une fois engagé, l'un des deux anglais demanda grâce... mais pour son compagnon ! Diego les épargna donc tous les deux et renvoya Malatesta bien décidé à lui faire payer sa forfaiture. Du coup sa vie fut menacée puisqu'il s'était mis à dos l’Église espagnole.
Ce qui aurait pu n'être qu'un simple incident vite oublié prit un tour diplomatique puisque les deux voyageurs n'étaient autres que le duc de Buckingham et Charles Stuart, jeune Prince de Galles et futur roi d’Angleterre venu incognito faire le connaissance de sa futur épouse Doňa Maria, sœur du roi Philippe IV. L'affaire prit donc un tour politique puisque ce mariage entre un hérétique et une catholique était évidemment refusé par l’Église et menaçait l'équilibre précaire de l'Europe. Le prince avait simplement voulu précipiter un peu les choses ! Pourtant, tout n'alla pas pour le mieux dans le meilleur des mondes et les projets capotèrent malgré la liesse populaire. Cela est bel et bon mais n'arrangea pas vraiment les affaires d'Alatriste qui craignait toujours pour sa vie même s'il pouvait compter sur son protecteur le comte de Guadalmedida. On le pressa donc de voyager au loin mais apparemment lui n'était guère pressé de disparaître, échappa à la mort de peu, avec il est vrai un eu de chance.
Mais revenons à Iňigo. Il servit correctement la capitaine jusqu'à risquer sa propre vie pour lui mais il n'échappa pas à la condition du commun des mortels puisqu’il tomba amoureux de la jeune et jolie Angélica d'Alquezar. Cela aurait pu être une bonne chose pour lui mais elle se révélera être son pire ennemi. Dans ce roman, il tient la plume mais aussi l'épée et malgré son jeune âge il sauva la vie du capitaine ce qui fit de lui son compagnon d'armes.
Je l'aime bien cet Alastriste, soldat courageux, fin bretteur, intègre mais tendre à l'occasion, respectueux de la parole donnée mais capable de se remettre en question si sa conscience le lui demande. C'est un homme cultivé aussi qui fréquente Lope de Vega et cite son ami Francisco de Quevedo, fin poète mais aussi prêt à en découdre à chaque occasion, l'épée à la main.
C'est donc dans une Espagne du XVII°siècle, celle du Siècle d'Or, que nous invite l'auteur. Pourtant c'est un pays misérable, noyauté par l'Inquisition où se côtoient une noblesse oisive et imbue d’elle-même, un clergé tout-puissant, un petit peuple misérable et une société interlope, bref un pays corrompu ou tout est à vendre parce que le Trésor est miné autant par la guerre des Flandres que par l'or des Indes. Le roi Philippe IV nous est présenté comme un monarque cultivé qui favorisa les arts mais qui laissa le gouvernement du royaume au Comte d'Olivares. Dans ce court récit passionnant qui tient du roman de cape et d'épée mais aussi un peu du roman picaresque se mêlent personnages historiques et fictifs, l'auteur en profite non seulement pour promener son lecteur dans Madrid et à évoquer l'histoire de l'époque, mais aussi pour donner son avis sur le siècle de Philippe IV, sur la politique qu'il mena, sur les succès qu'il obtient, sur les échecs aussi. Reverte ne se prive d'ailleurs pas d'émailler son propos de citations polémiques ou flatteuses de poètes de l'époque, quand ces derniers ne règlent pas leurs comptes personnels par sonnets interposés.
J'ai retrouvé avec plaisir le style d'Arturo Prerez Reverte, son érudition, le dépaysement qu'il procure à son lecteur et le suspens qui baigne ce texte. Il n'est pas un inconnu pour cette chronique où son œuvre a déjà été largement mentionnée (La Feuille Volante n° 384-385-387-390-735) aussi bien je poursuivrai assurément la découverte de cette saga.
©Hervé GAUTIER – Avril 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE CIMETIERE DES BATEAUX SANS NOM
- Le 24/03/2014
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°735 – Mars 2014.
LE CIMETIERE DES BATEAUX SANS NOM – Arturo Pérez-Reverte – Le SEUIL.
Traduit de l'espagnol par François Maspero
Coy, trente huit ans, ancien officier en second de la marine marchande, suspendu pour 2 ans à cause d'une erreur de navigation, erre dans Barcelone. Le voilà « sac à terre » malgré lui, marin sans navire, l’inaction le mine et il est à la recherche de n'importe quel travail pour survivre. Il est même un peu perdu à terre et règle sa vie à coup de lois pittoresques et sibyllines du genre LRDRH (Loi des rencontres qui ne doivent rien au hasard) Parce qu'il aimait les ventes aux enchères d'objets nautiques, il se retrouve dans un hôtel des ventes à Barcelone et y croise une femme belle et énigmatique, Tanger Soto, qui enchérit pour obtenir un vieil atlas maritime. Il tombe sous son charme et va jusqu'à Madrid pour la retrouver. Rien ne se passe comme prévu malgré tous ses fantasmes amoureux, il ne la séduit pas, enfin pas tout de suite mais se trouve engagé dans une quête que la jeune femme mène depuis longtemps. Il s'agit de retrouver la trace d'un brigantin, le « Dei Gloria », coulé en 1767 au sud de l'Espagne. Cela tombe plutôt bien puisqu'il connaît la navigation et qu'il a plongé, quelque vingt ans plus tôt sur cette côte. Cette jeune femme sait aussi que la recherche des herpes marines commence par la fréquentation des musées, des bibliothèques et par l'étude minutieuse des archives. Coy imagine une chasse au trésor d'autant plus facilement que cette épave semble intéresser nombre d'individus pas toujours recommandables auxquels il se trouve confronté et ces rencontres ne doivent effectivement rien au hasard. Il s'aperçoit très vite que cette course poursuite est pleine de dangers mais le charme de Tanger, l'attrait de l'inconnu et la fièvre de la recherche sont les plus forts.
Il songe bien sûr à un trésor mais il ne tarde pas à apprendre que la cargaison du navire n'était composée que de coton, de tabac et de sucre, rien qui supporte vraiment un séjour dans l'eau de mer de deux siècles et demi ! C'est plutôt un mystère qui entoure cette épave, quelque chose qui ressemble à une fièvre de l'or qui gagne peu à peu Tanger et Coy. Ce qui intrigue le plus, et évidemment complique la recherche, c'est son itinéraire (parti d'Espagne, il est allé en Cuba puis, au retour, a été coulé au large de Cadix par un corsaire), le fait qu'il appartienne en réalité aux jésuites qui ont ensuite été expulsés d'Espagne par Charles III et que le manifeste d'embarquement retrouvé aux archives mentionne la présence à bord de deux passagers en indiquant seulement leurs initiales. Pour être des hommes d’Église dédiés à la prière et à l'évangélisation, ils étaient aussi des hommes d'affaires avisés et parfaitement capables de défendre par la corruption la survie de leur ordre mais aussi des hommes de secret. Le narrateur qui est aussi cartographe donne son avis sur le positionnement du navire naufragé : il est à la fois logique et original. Il ne fait pas non plus de doute dans l'esprit de Tanger que la disparition de ce bâtiment est intimement lié à l'expulsion des jésuites d'Espagne. Elle possède un esprit à la fois intuitif et logique. Comme rien n'est simple, il faut, pour déterminer avec exactitude le lieu du naufrage, tenir compte des nombreux méridiens de référence au XVIII° siècle qui permettaient de faire le point, des différentes cartes en usage à l'époque, des des courants marins... C'est là que l'atlas acheté à Barcelone prend toute son importance. Il faut aussi s'intéresser au corsaire qui l'a coulé, le « Chergui » et qui sombra aussi lors de ce combat naval. Là non plus ce fait ne semble pas laisser une grade place au hasard et ce d'autant plus que les mystères se multiplient et que le lecteur attentif n'est pas au bout de ses surprises ! C’est que, une fois sur place, l'affaire est hasardeuse et surtout risquée compte tenu des autres intéressés, de leur manque de scrupules et surtout que l'épave n'est pas au rendez-vous. Tanger dépend maintenant de Coy et du Pilote, véritable techniciens de l'expédition mais l'échec omniprésent continue de hanter les esprits et des surprises sont toujours possibles !
Sur ce récit plane la beauté fascinante de cette femme, le dévouement de Coy, d'autant plus grand qu'il est nourri par ses propres fantasmes amoureux et sa patience [« Je veux compter ses taches de rousseur...Elle en a des milliers et je veux les compter toutes une à une en le parcourant du doigt comme si c'était une carte marine. »] pour ne pas dire son attachement aveugle. Elle se sert de lui mais il ne s'en rend pas compte ou plutôt se met volontairement à sa disposition, négligeant à l'occasion ses propres intérêts, aveuglé qu'il est par cette jeune femme. Le mystère s’épaissit pour le lecteur au fur et à mesure qu'il tourne les pages et c'est un peu le hasard, encore lui, qui gouverne cette affaire puisque ce qui n'était au départ qu'un travail universitaire de Tanger suivi d'un concours pour entrer au Musée Naval de Madrid et d'une rencontre dans ce contexte avec un chasseur d'épaves pour que cela devienne pour la jeune femme « le rêve de toute une vie » et, malgré la législation en vigueur, elle considère que ce bateau lui appartient. Tout au long de ce roman Tanger apparaît froide, déterminée, uniquement préoccupée par son but alors que Coy n'a d'yeux que pour elle. Elle applique cette maxime en forme d’aphorisme, « Je te mentirai et je te trahirai », bien connue et bien souvent oubliée qui gouverne les relations entre les hommes (et aussi les femmes) mais avoue à Coy « J'ai peur de mourir dans le noir, seule » . C'est une partie de poker-menteur entre Tanger et Palermo autour de cette épave puisque chacun possède des atouts et fait croire à l'autre qu'il en a davantage. C'est aussi un rapport de force entre Tanger qui ne veut pas lâcher son idée et le pauvre Coy parfois un peu trop impulsif et prompt à la bagarre surtout quand il s'agit d'elle. Surtout que lui et le Pilote doutent de plus en plus. En effet, les rebondissements ne manquent pas dans cette quête un peu folle pas davantage d'ailleurs que la galerie de portraits assez pittoresques qui nous est offerte.
Arturo Perez Reverte n'est pas un inconnu pour cette chronique (La Feuille Volante n° 384-385-387-390) Cette fois, j'avoue que j'ai été un peu perdu dans les détails techniques de la navigation mais, comme toujours, je salue ici l'érudition de l'auteur, notamment en matière de langage maritime ; son travail d'historien et d'archiviste autant que son style (servi sans doute par une bonne et fidèle traduction), son sens du suspense tiennent en haleine son lecteur jusqu'à la fin. Le récit réserve des descriptions poétiques et émouvantes, des évocations dramatiques qui consacrent une nouvelle fois (en était-il besoin?) le talent exceptionnel de cet écrivain.
Comme toujours cela a été pour moi un bon moment de lecture.
.
©Hervé GAUTIER – Mars 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LES VIES DE CERVANTES
- Le 16/03/2014
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°733 – Mars 2014.
LES VIES DE CERVANTES– Andrés TRAPIELLO- Buchet-Chastel éditeur.
Traduit de l'espagnol par Alice Déon.
Si j'en crois le titre, Cervantès aurait eu non pas une vie mais plusieurs. C'est généralement ce qu'on dit des gens dont on ne sait pas grand chose ce qui complique quelque peu la tâche de leur biographe. Si on est sûr de la date de sa mort à Madrid en 1616 on l'est en revanche bien moins de celle de sa naissance, à Alcala de Henarès en 1547 (?), il appartenait à une famille pauvre et plus ou moins itinérante à cause de sa mauvaise fortune, apparemment « convertie au christianisme », qu'il a aurait été l'élève des Jésuites à Séville mais qu'il n'a pas fait beaucoup d'études, qu'il était légèrement bègue. Nous le retrouvons à 22 ans, participant à un duel qui tourne mal ce qui fait de lui un fugitif exilé à Rome pour échapper à une condamnation certaine. Il s'est fait camérier chez le cardinal Acquaviva puis s'engagea dans la flotte en 1570 pour aller combattre les Turcs en Méditerranée, séjourna à Naples et à Venise et participa à la bataille de Lépante (1571) où il fut gravement blessé et perdit l'usage de sa main gauche. Il erra en Italie et se retrouva captif des Turcs à Alger pendant 5 ans et ce malgré quatre tentatives d'évasion. Libéré grâce au paiement par ses parents pourtant pauvres d'une rançon, il revint en Espagne, vivota quelques temps puis se lança timidement dans l'écriture sans grand succès. Il aurait eu une fille d'une liaison avec une femme mariée mais rien n'est sûr. En revanche il se maria se qui marqua sans doute son intention de se ranger. C'est probablement le mariage qui le détermina à écrire encore davantage notamment des comédies et des poèmes mais interrompit cette carrière littéraire prometteuse.
Il devint commissaire de réquisition pour l'Invincible Armada ce qui ne lui apporta pas la fortune mais deux excommunications pour avoir voulu toucher aux biens des ecclésiastiques. Il ne fut jamais un homme riche même s'il pratiqua le jeu et peut-être la spéculation, puis pour survivre, il devint collecteur d'impôts mais mal lui en prit, il fut jeté en prison pour mauvaise tenue de ses comptes. Pourtant la chance finit par lui sourire, littérairement parlant. Bien qu'il ne passât, à l'époque, pas pour un écrivain de grand talent, Don Quichotte fut publié en 1604 (c'est à dire à un âge avancé pour Cervantès) et ce roman surprit parce qu'il ne correspondait pas du tout à son auteur. Considéré d'emblée comme un livre drôle, il connut un succès immédiat et fut rapidement l'ouvrage le plus lu non seulement dans toute l'Espagne mais aussi en Europe, au Mexique et au Pérou. Il fut traduit en anglais puis en français, réédité et même piraté. Il fit également l’objet de polémiques. A titre personnel, Cervantès célébra également, dans un écrit de commande, la famille royale mais cela ne lui valut pas la faveur des nobles et ne le rendit pas riche pour autant. Il dût faire face à des problèmes familiaux, devint dévot dans sa vieillesse, même si en cela Don Quichotte différait fondamentalement de lui. Il espérait sans doute profité tranquillement de la notoriété que lui avait conféré la publication du premier tome de Don Quichotte quand, en 1614 parut un roman apocryphe signé Alfonse Fernandez Avellanedas qui l'indigna. Certes le plagiat était courant à l'époque, mais quand même ! On se perdit en conjectures sur la véritable identité du faussaire mais cette publication pirate détermina Cervantès, qui y mêla fiction et réalité, à faire mourir Don Quichotte, sans doute pour éviter qu'on ne le ressuscite.
S'il est principalement connu pour son Don Quichotte, il est également l’auteur de comédies, de romans et de nouvelles. Comme tout bon homme de Lettres, sa vie mouvementée a nourri son œuvre sans pour autant enrichir son patrimoine. Mais aurait-il été un aussi grand écrivain s'il avait été un homme fortuné ?
André Trapiello quitte ici son rôle de romancier (La Feuille Volante n°732) pour se faire le biographe de Cervantès. Malgré pas mal de digressions, c'est assez réussi.
©Hervé GAUTIER – Mars 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
A LA MORT DE DON QUICHOTTE
- Le 13/03/2014
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°732 – Mars 2014.
A LA MORT DE DON QUICHOTTE– Andrés TRAPIELLO- Buchet-Chastel éditeur.
Traduit de l'espagnol par Alice Déon.
Pour être un personnage fictif de roman (et quel roman!)Don Quichotte reste à mes yeux un être fascinant et un personnage emblématique de la littérature espagnole. Son histoire avait été recueillie par Sidi Ahmed Benegeli, savetier à Tolède et à sa mort sa veuve vendit ce livre à Miguel Cervantès qui l'enrichit de quelques épisodes inédits et publia le tout. Ainsi naquit ce roman où Alonzo Chicano, hidalgo espagnol devient Don Quichotte la dernière année de sa vie. Dans le roman de Cervantès présenté en deux volumes, Don Quichotte meurt à la fin. C'est là une volonté de l'auteur puisque, avant la parution du deuxième tome, un roman apocryphe avait été publié par un certain Avellaneda (peut-être Lope de Vega) et Cervantès voulait ainsi qu'il ne fût pas possible de le ressusciter.
Le roman de Traplellio ne viole donc pas cette dernière volonté mais prolonge en quelque sorte la fiction en imaginant non pas une suite à ce roman puisque Don Quichotte est bel et bien enterré, mais une manière de récit complémentaire où les principaux protagonistes ont entre les mains le roman de Cervantès et en prennent connaissance, découvrant à l'occasion de nouvelles aventures. Mais ce qu'ils veulent avant tout c'est réhabiliter leur maître.
Que Don Quichotte fût fou ne fait aucun doute et il devait cela, selon la tradition, à la lecture assidue de romans de chevalerie ce qui lui avait asséché le cerveau et l'avait déterminé à prendre la route pour combattre le mal et protéger les pauvres. Son équipée fut épique et illuminée, en compagnie du naïf Sancho Panza et la tête pleine d'un amour démesuré pour Dulcinée de Toboso, une petite paysanne qu'il ne verra jamais mais à qui, comme tout bon chevalier, il avait juré fidélité. Bref, il vient de mourir à l'âge de 50 ans, en règle avec Dieu et avec les hommes, autrement dit sain d'esprit, entendez par là que le curé du village lui a administré l’extrême-onction et qu'il a rédigé son testament. Cet événement laisse ceux qui l'ont connu dans le désarroi et la désespérance, un peu comme si, lui qui n'avait pas de descendance, laissait quand même des orphelins ! Il y a là sa nièce Antonia, la gouvernant Quitéria, le curé Don Pedro, le barbier mais surtout le bachelier Samson Carrasco et bien entendu son fidèle écuyer Sancho Panza.
Tel est le point de départ de ce roman plein de drôleries. Don Quichotte reçut, lors de ses obsèques l'hommage de tout le village et bien entendu on l'affubla de toutes ces qualités qu'on lui avait si bien déniées de son vivant. Pire peut-être, on regrettait maintenant qu'il ne pût plus commettre d'autres folies. Pourtant, on pouvait penser que ce modeste village de la Manche allait retomber dans sa torpeur habituelle à la mort de ce flamboyant chevalier errant. Que nenni et c'est un peu comme si tous ceux qui l'avait connus s'étaient retrouvés affublés d'un peu de cette folie qui avait fait son originalité ! Qui dit décès dit ouverture d'une succession. Alonzo Chicano n'était pas un gestionnaire et à sa mort ses nombreux créanciers firent valoir leurs hypothèques et autres titres que le vieux notaire Le Mal (le bien nommé) racheta de ses deniers dans le seul but de se rapprocher d'Antonia, maintenant ruinée, qu'il voulait épouser malgré la grande différence d'âge. Elle lorgnait sur le bachelier Samson Carrasco qui venait de raccrocher la soutane au grand dam de son père et opter pour une profession laïque d'administrateur des biens d'un noble local. De son côté le valet Cebadón poussa si bien son avantage qu'il la mit enceinte mais cela resta un secret. Pour corser le tout, Quiteria, la servante de toujours, secrètement amoureuse de son maître Don Quichotte, choisit de disparaître. Bref, chacun était amoureux de celui qu'il ne fallait pas ! Passe encore l'amour mais Sancho qui n'était qu'un domestique illettré s'était lui-même mis en tête non seulement de maigrir et de se départir de sa naïveté proverbiale mais surtout d'apprendre à lire et à écrire et Carrasco, outre ses projets de mariage avec Antonia voulait, de son côté, écrire des aventures imaginaires de Don Quichotte et de Sancho.
La notoriété de Don Quichotte était telle qu'à sa mort des sosies apparurent, plus vrais que lui-même ou des chevaliers et autres personnalités qui prétendent l'avoir connu. C'est l'occasion pour les anciens compagnons du Quichotte de faire acte de repentance pour s'être gaussé de ce pauvre homme ainsi que l'exprime Samson « On l'a tué à nous tous, sans le vouloir ; nous avons sous-estimé son mal et nous ne nous sommes pas conduits en bons chrétiens ». C'est vrai que Carrasco a des reproches à se faire. C'est en effet lui qui s'était déguisé en « chevalier de la Blanche Lune », qui l’avait vaincu et l'avait condamné à déposer ses armes et à se retirer dans son village. Pour eux, c'est aussi l'occasion de venger leur maître et ami de tous ceux qui ont ri de sa folie ou en ont profité, et il n'en manque pas, tels ce duc et cette duchesse qui s'étaient gaussés de Don Quichotte et le brigand Gines de Passemont qui prétend avoir épousé la célèbre Dulcinée, aimée du chevalier à la Triste Figure ! Bien entendu, puisque nous sommes dans une fiction quelque peu déjantée et bien dans l'esprit du roman de Cervantès tout est possible même les choses les plus inattendues... l'épilogue ne m'a cependant pas convaincu, partagé entre un « happy end » et une sauvegarde de la morale.
J'ai lu ce roman, avant tout parce qu'il était question de Don Quichotte. Pourtant ce livre m'a paru un peu confus et comporte à mon avis bien des longueurs qui rendent la lecture fastidieuse, pas mal d'extravagances et d'exubérances qui, même si elles s’inscrivent dans l'esprit du roman de Cervantès finissent par lasser. J'ai été un peu déçu.
©Hervé GAUTIER – Mars 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
L'EMPLOYÉ – Guillermo Saccomanno
- Le 07/11/2013
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°691– Novembre 2013.
L'EMPLOYÉ – Guillermo Saccomanno- Éditions l'Asphalte.
Traduit de l'espagnol (argentin) par Michèle Guillemond.
Nous sommes dans une ville inconnue et lui, c'est un employé sans nom (il sera nommé ainsi pendant le roman), autant dire un quidam. Avec lui il y a un « collègue » et une « secrétaire », tous gouvernés par un « chef ». Nous sommes donc en plein anonymat et dans un bureau d'une entreprise elle-même innomée. Au dehors, la ville non plus n'a pas de nom. Il y tombe des pluies acides, l'atmosphère est polluée, le réchauffement de la planète y est ressenti durement, la révolte gronde, les attentats sont quotidiens et l'armée y fait régner un ordre tyrannique et meurtrier. On ne peut pas ne pas penser aux scènes quotidiennes durant la dictature militaire d'Argentine.
Le travail au sein de cette entreprise est non seulement déprimant, inintéressant, déshumanisé mais aussi soumis à l'arbitraire, aux impératifs de rendement et aux conditions de travail draconiennes. Le contrôle y est permanent, mené par une hiérarchie tatillonne et inhumaine. Chacun peut perdre sa place sans préavis et sans raison. Cela donne des scènes insoutenables où les suicides ne sont pas rares. « L'employé » tente tant bien que mal de se maintenir à son poste en évitant de faire des vagues. Il est un collaborateur docile et même servile. Cet emploi est son gagne-pain et sans lui il ne pourrait plus assurer une vie décente à sa famille. Il travaille avec un « collègue » dont il ne sait rien mais le hasard va l'inciter à le connaître un peu mieux jusqu'à entrer dans une certaine forme d'intimité avec lui... Puis il va disparaître un matin sans qu'on sache ni comment ni pourquoi !
« L'employé » reste souvent tard le soir, bien après l'horaire légal, bravant la nuit et ses dangers. C'est moins par flagornerie que par une certaine nécessité. Il est marié à une matrone qui le domine, l'humilie sans qu'il puisse vraiment réagir et qui règne tyranniquement sur une marmaille hurlante et quémandeuse. Il lui arrive même de rentrer dans la nuit sans éveiller les soupçons de son épouse. Dans sa vie il n'y a plus de place que pour le rêve et ce rêve, il l'a sous les yeux. Il travaille avec « la secrétaire », une jolie femme apparemment célibataire, ce qui ne manque pas de le faire follement fantasmer d'autant plus qu'il s'aperçoit très tôt qu'elle a avec le « chef », par ailleurs marié et père de famille, une liaison peu discrète. Amoureux de cette femme, il devient évidemment jaloux de ce « chef » mais ne peut ni ne veut interrompre leurs jeux érotiques qui ont lieu pendant les heures de travail au sein même de l'entreprise. Il ronge son frein et enrage contre cet homme qui profite de sa situation et pousse son avantage. Par chance pour lui, cette jeune femme aux mœurs légères et libérées accepte ses avances autant qu'elle répond aux assiduités du « chef ». Après tout, pour elle, il y va du maintien de son emploi, des avantages financiers ou somptuaires et peut-être l'octroi d'une promotion. Pourtant, « l'employé » se retrouve dans son lit à son grand étonnement.. Cela fait de lui un autre homme, soudain capable de tout, même des pires choses, même les plus inavouables, pour un peu de considération de ses supérieurs ou pour porter à l'occasion préjudice à autrui. Bouleversé par sa nouvelle vie, il lui avoue son amour et apprend qu'elle est enceinte, mais d'un autre, probablement du « chef » mais il est tout prêt à passer outre et à s'enfuir avec elle. Elle ne répond guère à ses avances que par des passades avec d'autres partenaires. Pourtant cet « autre » lui-même, son double qu'il voit dans le reflet des vitrines des magasins l’écœure et l’inquiète. Il a l'intuition de sa propre déchéance, de sa solitude, de son désespoir.
C'est un texte déprimant mais poétique parfois, une sorte de roman baroque qui distille une ambiance surréaliste. Pour autant j'ai apprécié l'ambiance des bureaux où règne non pas la bonne humeur comme on pourrait le souhaiter mais en permanence l'espionnage, la trahison, le clabaudage, la flagornerie, la délation. Le monde du travail n'est pas idyllique et il est bon de le rappeler, même dans une fiction. Il est l'image de la société individualiste et égoïste !En revanche j'ai peu goûté les scène de flagellations collectives très sud-américaines, les passages où la culpabilisation le dispute à l'horreur et tout cela sous l'égide de la religion. C'est un roman sombre sur la société, le travail et même l'amour .
Une fois le livre refermé, il reste une impression de malaise tant le texte est réaliste. Je l'ai lu dans la version française mais la traduction qui en est faite est particulièrement évocatrice. Je me suis cru dans un de ces romans d'anticipation écrits notamment au cours du XX° siècle. Ils donnaient à voir un futur étrange et inquiétant. Au mieux nous nous disions que c'était une fantaisie d'auteur, au pire que cela pouvait avoir l'effet d'un avertissement, mais, même s'ils retenaient l'attention, nous n'y croyions pas, cela ne pouvait pas nous arriver. C'était de la fiction, rien de plus ! A quoi assistons-nous aujourd'hui ? Nous vivons dans une société à ce point écartelée que la vie des hommes ne vaut plus rien et qu'on peut se débarrasser d'un être humain sans ménagement au nom de la rentabilité ou simplement de l'arbitraire. Les informations quotidiennes sont pleines de cette violence gratuite et de cette délinquance sans limite. Ce n'est pas pour être passéiste et regretter « le bon vieux temps » qui n'a sûrement jamais existé que dans l'imagination et les regrets mais il est un fait que toutes les valeurs qu'on nous a enseignées et qui étaient les piliers de notre société s'effondrent les unes après les autres. C'est le règne de l’égoïsme, de l’indifférence, la famille n'a plus l'importance qu'elle avait, l'amour entre les hommes et les femmes laisse place au mensonge, à la trahison, aux marchandages, les églises se vident, la vie elle-même n'est plus respectée et la société tente de survivre en écrasant l'autre devenu un obstacle. Quand « L'employé » voit son reflet dans la vitrine des magasins, l'image qu'il perçoit l'inquiète et n'est pas si virtuelle que cela. Ce roman, même s'il nous est présenté sous des dehors volontairement violents et inacceptables est la copie conforme de la société dans laquelle nous vivons actuellement où la solitude et l’ingratitude sont la règle. L'espèce humaine n'est décidément pas fréquentable et ce n'est pas les actions humanitaires effectives mais de plus en plus rares qui la rachète.
© Hervé GAUTIER - Novembre 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
Décès d'Alvaro Mutis
- Le 27/09/2013
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°679– Septembre 2013.
Décès d'Alvaro Mutis
J'apprends le décès d'Alvaro Mutis survenu le 22 septembre dernier au Mexique où il vivait. Il avait 90 ans.
Les habitués de ce site, les lecteurs de cette chronique qui date maintenant d'une trentaine d'années ne peuvent ignorer l'intérêt que j'ai très tôt porté à l’œuvre du poète et romancier colombien. La Feuille volante en a largement gardé la mémoire [N°75 ,100, 163...] et je veux ici rendre hommage au talent de cet auteur même si je n'en ai jamais été qu'un simple lecteur anonyme mais passionné.
Il était l'ami de Gabriel Garcia Marquès qui avait su discerner chez lui un remarquable talent de conteur, « L'un de nos plus grands écrivains » avait dit le lui le Prix Nobel ! Il y avait entre eux une sorte de complicité littéraire puisque que Marquès avouait volontiers « Il y a une part importante d'Alvaro dans presque tous mes livres. ». En France Bernard Clavel avait dit de lui « Mutis est un enchanteur ».
Né en 1923 à Bogota, il avait habité en Belgique où son père était diplomate. Il y resta jusqu'à la mort de ce dernier en 1932. Il revint en Colombie pour s'y marier et y exercer des fonctions d'animateur radio et de chroniqueur littéraire. Il orienta ensuite sa carrière dans le domaine de la publicité puis des relations publiques auprès de société pétrolières, d'aviation ou d'assurances. Il fut un temps inquiété pour une affaire de malversation financière qui l'obligea à s'exiler au Mexique où il fut incarcéré. Ensuite il parcourut le monde pour vendre des films pour l'industrie cinématographique américaine. Ses fonctions lui permirent de voyager et ainsi sans doute de concevoir la figure emblématique de son œuvre, celle de Maqroll El Gaviero, Maqueroll le Gabier. Avant cela, il y eut des romans, des poèmes qui n'ont peut-être pas rencontré un vif succès mais dont Otavio Paz n’a pas manqué, dès 1959, de souligner l’intérêt parlant de leur auteur comme d' « Un poète dont la mission consiste à convoquer les vieux pouvoirs, faire revivre la liturgie verbale, dire la parole de vie. » .
Le voyage est au cœur de son œuvre et je voudrais revenir sur le personnage de Maqroll qui l'incarne. Héritier de la marine à voile, le gabier est celui qui, juché en haut du plus haut mât du navire, veille à la manœuvre mais aussi à la marche du bâtiment. La vigie c'est lui, il est le veilleur, celui qui ne dort pas, qui observe. La figure de Maqroll apparaît dès 1953 dans un recueil de poèmes publié plus tard en France sous forme de traduction et intitulé « Les éléments du désastre ». Elle ne quittera plus son œuvre au point qu'on pouvait dire que l'auteur et Maqroll marchaient d'un même pas, mais si c'était au bord de l'abîme que ce pauvre monde incarne. Ce Maqroll n'est rien d'autre qu'un modeste membre d'équipage souvent attaché à un rafiot brinquebalant qui se traîne sur les mers ou sur les fleuves. Il ne pose que très rarement sac à terre mais quand cela lui arrive, le continent lui réserve aussi des surprises souvent pas très bonnes. C'est sans doute pour cela qu'il est notoirement incapable de se fixer quelque part ! Et dans ce sac justement il y a ce qu'on ne s'attend pas à trouver, ce sont souvent des livres rares et précieux qu'il relit jusqu'à satiété. C'est que cet homme, s'il a, à sa manière, des « semelles de vent » est cultivé, c'est un honnête homme qui vous parle volontiers de la guerre de succession d'Espagne, de celles de Vendée, cite par cœur Chateaubriand et tient Louis Ferdinand Céline pour le meilleur auteur français.
Il y a aussi son double, Abdul Bashur, son grand ami, presque son frère. Lui, issu d'une famille d'armateurs levantins est un idéaliste. Il symbolise l'amitié à laquelle Maqroll est par dessus tout attaché. Dans « Abdul Bashur, rêveur de navire », il poursuit cette idée un peu folle de découvrir un navire aux lignes parfaites et, pour se faire, n’hésite pas à rencontrer les personnages les plus louches. "J'ai appris désormais à tirer des rêves jamais réalisés de solides raisons de continuer à vivre et je m'y suis habitué." avoue-t-il. Il y a aussi sa mort, annoncée et prévisible qui fait de sa vie une improbable quête, le rapprochant de son ami Maqroll dont l'existence a été une perpétuelle errance sur les mers. J'ai toujours aimé ce personnage, anti-héros par excellence et « son absence de goût et de projets d'avenirs » et surtout sa prodigieuse aptitude à se mettre dans des situations inextricables qui tournent souvent au fiasco.
Maqroll est aussi fidèle en amitié comme cellE qui le lie au peintre Alejandro Obregon dans « Le dernier visage » ou à Sverre Jensen dans « le rendez-vous de Bergen ».
Maqroll est avant tout un réaliste, une sorte d'Ulysse en perpétuelle errance qui jette cependant sur l'humanité un regard de plus en plus désabusé :« Les hommes changent si peu, continuent d’être perpétuellement eux-mêmes au point qu’il n’existe qu’une seule histoire d’amour depuis la nuit des temps qui se répète à l’infini sans perdre sa terrible simplicité, son irrémédiable infortune. ». Sur la vie aussi dont il nous rappelle qu'elle est transitoire, que nous n'en sommes que les usufruitiers et qu'elle s'arrêtera un jour, souvent sans crier gare, que le but de l'existence sur terre n'est pas forcément la réussite sociale. La Camarde hante l’œuvre de Mutis[« Chaque poème un pas vers la mort/ une fausse monnaie de secours/ un tir à blanc dans la nuit.» in « Les éléments du désastre], elle n'est pas morbide pour autant et même si elle est simple, voire simpliste, j'aime que ce soit ce Maqroll qui me le rappelle à l'envi.
L'amour justement qui fait tellement partie de sa vie qu'il est aussi une perpétuelle quête. Il s'incarne dans des femmes à la fois aimante et énigmatiques qui ont nom Illona, Antonea, Flor Estevez et combien d'autres. Elles sont incontournables de ce personnage de marin qui a une femme dans chaque port mais aussi une insondable solitude, vivant l'amour davantage comme des passades que comme des passions avec cette insatiable envie de départ parce que pour lui le voyage est aussi une fuite. Chacune de ces femmes est à la fois sa maîtresse, sa mère, sa compagne, son amie, son double, bref une nécessaire compagnie qu'il quitte cependant, obéissant à l'appel du large.
C'est vrai que ce Maqroll est aussi un amateur d'alcool, un épicurien et Mutis ne manque jamais l'occasion de glisser dans son texte la recette d'un cocktail. Ses aventures tiennent en haleine son lecteur devenu complice jusqu'à la dernière page du roman.
Ce que je retiens de Mutis, c'est qu'il est un extraordinaire conteur, un magicien des mots. A titre personnel, je l'ai toujours considéré comme un écrivain d'exception par cela sans doute qu'il prend son lecteur dès la première ligne d'un roman et ne l'abandonne qu'à la fin sans que l'ennui ait, à aucun moment, pollué sa lecture. Ils ne sont pas nombreux ceux à propos de qui j'ai pu écrire cela ! C'est à cela sans doute qu'on reconnaît un authentique écrivain !
L'ensemble de son œuvre fut couronné par divers prix en Colombie mais aussi en France [Prix Médicis étranger en 1989 pour « Les neiges de l'Amiral », Prix Roger-Cailloix en 1993] et en Espagne « Prix Prince des Asturies », « Prix Reine Sophie » en 1997 puis « Prix Cervantes » en 2001]. Certaines de ses œuvres comme « La mansion de Araucaima » et « Ilona vient avec la pluie » ont été adaptés par le cinéma colombien en 1986 et 1996.
© Hervé GAUTIER - Septembre 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
MADRID, CETTE ANNEE-LA- Daniel Chavarría
- Le 28/02/2013
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°631– Février 2013.
MADRID, CETTE ANNEE-LA- Daniel Chavarría.
Traduit de l'espagnol par Hélène Gisbert.
Nous avons tous dans notre mémoire des souvenirs qui y sommeillent ou qui y macèrent suivant qu'ils sont bons ou mauvais. Même pour nous, il n'est pas aisé d'y mettre des mots, de les exprimer pour les exorciser, les apaiser et ainsi de nous en libérer, pour qu'ils aillent rejoindre la cohorte des choses qui font notre expérience de cette vie. Cela peut prendre la forme d'un simple aveu intime ou d'une confession publique mais l'émotion est toujours là puisqu'une telle démarche, quelle que forme qu'elle prenne n'est jamais anodine.
La lecture de la quatrième de couverture nous apprend que ce récit est une histoire vraie que Chavarría choisit de faire partager à son lecteur sous la forme d'une fiction avec toutes les modifications que cela implique. Après presque quarante années de silence, il exhume une vision que, même marié et père de famille, il n'est jamais parvenu à oublier. C'était en 1953, il n'était pas très riche, avait alors dix neuf ans, l'âge de tous les possibles, et il avait résolu de quitter sa famille en Uruguay pour aller vivre en Europe et y apprendre l'art, le théâtre... Il s'embarqua donc sur un transatlantique où il rencontra une femme, Gaby, dont il tomba instantanément amoureux. Elle était tellement belle que cette vision tint pour lui de l'apparition Malheureusement, même si elle voyageait seule, elle était mariée et heureuse en amour. Pour corser le tout, lui, bien que précoce à bien des égards, était naturellement timide. Il se dit qu'un bateau qui effectue ainsi une aussi longue traversée est un microcosme où tout est possible, mais la passade qu'il espérait ne se réalise pas. Accostant en Espagne, il improvise pour palier son manque d'argent, se fait guide au musée du Prado, mais cette femme qu'il suit toujours autant par admiration que dans le fol espoir de partager son lit se révèle enceinte, mais pas de son mari. Pour autant, touché par cette histoire, il décide de l'aider mais elle se résout à rejoindre Kurt, le père de son enfant, en Allemagne. Devant un tel revirement de situation, Daniel choisit le voyage pour se guérir de cette femme mais finit par rencontrer Kurt et prend conscience que Gaby n'est rien d'autre qu'une manipulatrice capable des plus horribles mensonges. Du coup, l'image idyllique du début en prend un sérieux coup.
J'ai entamé la lecture de ce livre à cause de la vie de Daniel Chavarría (né en 1933 en Uruguay) qui est un véritable roman. Effet, avant de devenir écrivain et professeur de littérature classique à l'université de La Havanne, il a fait beaucoup de métiers et même vécu des expériences uniques qui l'ont profondément marqué. Pour autant, j'ai été déçu par ce roman qui se veut le compte-rendu de cette "aventure", peut-être à cause du style sans recherche, des revirements un peu trop invraisemblables ou peut-être de cette histoire qui promettait d'être passionnante au début et qui, pour moi, s'est révélée décevante. Qu'il ait voulu faire de cette tranche de vie un roman ne me gêne pas, mais le résultat m'a paru peu probant.
Ce que je retiens cependant, c'est que cette amour impossible entre Gaby et Daniel se transforme, avec le temps et les cheveux blancs en une amitié durable. Même si je ne suis pas entré dans cette histoire, je retiens que la création littéraire est une force qui transforme et apaise, que les mots sont un extraordinaire baume.
©Hervé GAUTIER – Févrer 2013.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE LIVRE DE L'INTRANQUILLITE – Fernando Pessoa
- Le 21/02/2013
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°624– Février 2013.
LE LIVRE DE L'INTRANQUILLITE – Fernando Pessoa - Christian Bourgois Editeur
Il s'agit d'une œuvre posthume de l'écrivain portugais Fernando Pessoa [1888-1935], attribuée par lui-même à Bernardo Soares un « semi-hétéronyme », c'est à dire un des nombreux doubles de l'auteur qui incarnent autant de facettes de sa personnalité. Pessoa n'a en effet presque jamais signé ses œuvres de son vrai nom mais il est cependant reconnu comme un des plus grands écrivains portugais alors même que son nom signifie « personne ».
C'est un recueil de réflexions, de pensées, de poèmes en prose écrits de 1913 à 1935, de manière anarchique, sur des feuilles éparses, suivant son habitude et enfouies dans une malle. Il est considéré comme le chef-d’œuvre de son auteur. Il met en scène Bernardo Soares qui est un modeste employé de bureau dans un magasin de tissus, sans la moindre ambition et qui fait ce qu'il peut pour ne pas se faire remarquer. Il n'a ni famille ni attache, vit petitement et se fonde humblement dans le décor de son quotidien. C'est une véritable« Autobiographie sans événements ». Comme Pessoa, il a mal à sa vie, la refuse ou fait au moins ce qu'il peut pour ne pas s'adapter. L'écriture étant une formidable manière de s'en évader, il en fait une chronique ce qui donne un texte à la fois lucide et désespéré. Pourtant il note avec un certain paradoxe « J'ai toujours évité, avec horreur, d'être compris ».
Bernardo Soares est sans doute le personnage qui se rapproche le plus de Pessoa parmi ses nombreux « doubles » puisque la vie de l'auteur se résume à presque rien. Il est, quant à lui, un poète introverti, anxieux et discret, écrivant à la fois en portugais et en anglais, qui a passé la presque totalité de sa vie à Lisbonne comme rédacteur et traducteur chez différents transitaires maritimes. Pourtant d'autres hétéronymes de Pessoa tels Alberto Careiro, le sage-païen, son exact contraire, Ricardo Reis, un épicurien stoïcien et le sensationiste et moderniste Alvaro de Campo se différencient largement de lui. Masques ou miroirs, la question mérite d'être posée puisque Pessoa vit en fait une autre existence qui lui convient mieux. C'est à la fois un rêveur et un idéaliste
Le mot lui-même d' « intranquillité » qui pourrait être assimilé à l'inquiétude ou plus précisément à la difficulté d'être, est un néologisme, même s'il a été auparavant employé par le poète Henri Michaux.
Il s'agit ici de textes qui dénoncent le désenchantement du monde et une affirmation que la vie n'est rien sans l'art qui ainsi lui donne un sens. J'y ai lu une profonde tristesse, une sensation aiguë de solitude qu'il combat grâce au sommeil, à l'idée du voyage, mais d'un voyage immobile, au rêve ["Je ne suis pas seulement un rêveur, je suis exclusivement une rêveur"] et aussi à l'alcool, une impression de temps suspendu tant sa vie est banale et sans relief, comme lui- même [ "C'est une saoulerie de n'être rien et la volonté est un seau qu'on a renversé au passage dans la cour, d'un geste indolent du pied"].tant son quotidien qui se résume à la fenêtre de sa chambre, à ce bureau de la rue des Douradores, à ce quartier et à cette ville, est monotone, banal, sans relief.
C'est aussi un journal intime au quotidien, avec de nombreuses réminiscences d'enfance, tenu tout au long de sa vie où l'auteur analyse les nombreuses facettes de cet « hétéronyme », cette « prolifération de soi-même » qui existe en chacun de nous. Cela donne, sous la forme de pensées décousues mais dans une prose somptueuse et poétique, une analyse de l'existence quotidienne au bureau, douloureuse et parfois étonnamment douce. Cette somme de réflexions, de remarques, de prise de conscience de soi-même et parfois d'élans lyriques est presque une biographie de Pessoa écrite par Soares. Pourtant on peut aussi le considérer comme un récit, mais qui aurait la particularité d'être impossible à raconter ! De cette relation du quotidien sourd un ennui, la saudade, tout à fait caractéristique de l'âme lusitanienne. De plus, dans cet ouvrage, Pessoa entretient avec la ville de Lisbonne une relation toute particulière un peu comme le fait James Joyce avec Dublin.
Certains commentateurs ont parlé à propos de cet ouvrage de "littérature de limbes". J'ai vraiment eu l'impression que Pessoa a vécu sa vie comme un calvaire et anticipe son entrée dans le néant dans pour autant le craindre. Pour lui, il me semble que la vie elle-même était un lieu de souffrance où elle s’apparentait à une mort lente. Les limbes sont un espace assez confus et flou qui nous est proposé par les catholiques. Ils se situent après la mort, aux marges de l'enfer pour des âmes qui en seront libérées pour finalement entrer au Paradis, une sorte de purgatoire en quelque sorte. C'est aussi un endroit où séjournent les enfants non baptisés qui ne peuvent accéder au Paradis mais ne méritent pas pour autant l'enfer. C'est là un débat théologique qui devait échapper à Pessoa. L'auteur, conscient de lui-même n'est ni vraiment vivant ni complètement mort, juste de passage ici-bas, mais semble indifférent à son existence, à sa promotion professionnelle en se concentrant sur ses propres aspirations dont il est une sorte de contemplatif ironique. Il sait ce qu'il souhaiterait en ce monde pour lui-même mais, dans le même temps, à conscience qu'il ne parviendra pas à l'obtenir. Ce narcissisme enfante une certaine jouissance intime d'explorer son propre labyrinthe, d'analyser les arcanes de son "Moi", tout en ayant une parfaite conscience de soi et d'être l'illustration consciente de la parole de Rimbaud "Je est un autre". Paradoxalement peut-être, dans ce processus, l’humilité le dispute à la désespérance et Pessoa-Soares choisit une vie grise et sans relief. Il y a aussi de la lucidité dans tout cela et s'il choisit la solitude, le célibat, comme une sorte de sacerdoce, c'est pour mieux y développer sa réflexion sur le monde tout en en restant en retrait. C'est quand même l'ouvrage d'un philosophe, d'un penseur mais aussi et surtout d'un érudit.
A la lecture de ce texte, j'ai l'impression qu'il y a aussi du regret dans ces lignes ["Je gis ma vie"], une extrême conscience de l'échec [« Je suis l'enfant douloureux malmené par la vie »] au point de confier au papier puis à sa malle, autant dire au néant, toutes les réflexions que lui inspire ce quotidien sans joie ["Et je contemple avec dégoût, à travers les grilles qui masquent les fenêtres de l'arrière-boutique, les ordures de tout un chacun qui s'entassent, sous la pluie, dans cette cour minable qu'est ma vie"]. Pourtant il y révèle un curieux rapport à l'écriture qui n'est pas dénué d'un sens de l'esthétisme ["J'écris parce que c'est là le but ultime, le raffinement suprême, le raffinement viscéralement illogique de mon art de cultiver les états d'âme"]. Manifestement, il compense ce manque avec le rêve et l'imaginaire.
Il est vrai que l'analyse de cette œuvre de Pessoa ne peut se faire valablement dans ce court article.
©Hervé GAUTIER – Févrer 2013.http://hervegautier.e-monsite.com
-
Quelques mots sur Rafaël ALBERTI [1902-1999].
- Le 16/10/2012
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°595– Octobre 2012.
Quelques mots sur Rafaël ALBERTI [1902-1999].
Cet homme qui est reconnu comme un poète espagnol majeur, membre de la « Génération de 27 »[ Ce mouvement littéraire espagnol composé majoritairement de poètes est né entre 1923 et 1927 et a disparu au moment de la Guerre Civile. Il a voulu faire la synthèse entre la poésie traditionnelle espagnole inspirée par le gongorisme et l'avant-garde esthétique européenne de l'époque illustrée notamment par le surréalisme en la faisant évoluer du classicisme vers un langage plus libre et esthétiquement plus pur] se destinait originellement à la peinture.
D'origine italienne par ses deux grands-pères, Rafaël, cinquième enfant d'une famille qui en compta six, naît et grandit à Santa Maria, un petit port près de Cadix. Il reçut une éducation bourgeoise, religieuse et classique mais s’ennuya fort chez les jésuites qu'il quitta au bout de 4 ans. La mer restera un grand thème de son inspiration.
Alors qu'il était encore adolescent, la famille s'installa à Madrid où il put s'initier à la peinture au musée du Prado. Pourtant, à la mort de son père, en 1920, il se mit à écrire. Sa santé fragile affirma cette nouvelle vocation et son premier recueil « Marinero en tierra » reçoit le Prix national de littérature. Publiée en 1925, cette œuvre lui permet d’entamer une longue et fructueuse amitié avec la poète Juan Ramon Jimenez, chef de file de la « génération de 27 ». En 1927, il est au nombre des jeunes poètes, dont Frederico Garcia Lorca, qui se réunissent pour célébrer le tricentenaire de la mort du poète baroque espagnol, Luis de Gongora.
Rapidement, le gongorisme, en vogue à l'époque, laisse dans son écriture la place au surréalisme ce qui l'amène à rencontrer d'autres poètes. En 1930, il épouse Maria Terésa Leon avec qui il se consacre au théâtre. Il adhère également au parti communiste. Il présente notamment une pièce « Firmin Galàn » à la gloire d'un jeune capitaine républicain, fusillé en 1930 pour avoir soulevé la garnison de Jaca contre le pouvoir royal. Cette œuvre inaugure la nouvelle orientation de son écriture, résolument tournée vers les luttes sociales. En 1931, la seconde république est proclamée en Espagne. Il participe à la guerre civile mais à partir de 1939 s’exile en France (où il rencontre le poète chilien Pablo Neruda), en Argentine, en Italie. Après la mort de Franco il rentre en Espagne en 1977 où il meurt en 1999.
Au pied de l'avion qui le ramena dans sa patrie il eut cette phrase qui définit bien l'esprit de transition démocratique entre l'ancienne et la nouvelle Espagne : « J'ai quitté l'Espagne avec la poing fermé et je retourne avec la main ouverte en signe de concorde entre tous les Espagnols. »
La première phase de son œuvre (1925-1927) s'inscrit dans la tradition de la poésie espagnole. Il y exprime la contemplation de la nature et l'expression des sentiments. Il sacrifie ensuite au gongorisme (1928), précieux et métaphorique, emprunt d'une métrique lourde pour finalement se consacrer au surréalisme et à une versification libre. Là, son vers se peuple d'images et parfois de violence. Bizarrement, ce cycle se referme sur une œuvre consacrée aux grands comiques du cinéma muet (« Yo era un tonto y lo que he visto me a hecho dos tontos » 1929). Ensuite vient la poésie politique inspirée du marxisme révolutionnaire à partir de l'avènement de la seconde république. L'exil (1939-1977) inaugure une écriture empreinte de nostalgie.
En France, ses poèmes ont été popularisés par le chanteur Paco Ibanez (notamment « A galopar » ou « Ballade de celui qui ne connut jamais Grenade »).
Rafaël Alberti reste, malgré ses années d'exil, un poète représentatif de son temps et de son pays.
©Hervé GAUTIER – Octobre 2012.http://hervegautier.e-monsite.com
-
Ces vies-là
- Le 20/05/2012
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°566 Avril 2012
CES VIES-LA Alfons Cervera. Éditions la contre-Allée
Le décès d'un parent est souvent l'occasion de relations longtemps cachées sur son parcours, sur sa vie. Chacun apporte son témoignage, on libre la parole, on fait valoir des convictions, on exhibe des preuves, des photos, des papiers, on pose des questions qui appellent des réponses, des commentaires parfois. Des légendes souvent patiemment tissées s'effondrent d'un coup et des affirmations trouvent soudain leur justification. Tous ces secrets de famille révélés en un jour écornent ou renforcent l'image du défunt.
Quelques temps après la mort de sa mère, l'auteur qui est aussi le narrateur, participe un colloque Grenoble sur le thème "Témoins et témoignages, mémoire individuelle et collective". C'est pour lui l'occasion de revenir sur les dernier jours de cette femme dont une chute apparemment sans gravité avait révélé une tumeur qui allait l'emporter. Pendant un an et demi, elle avait subi patiemment soins et examens médicaux , comme si la mort, avec elle, avait pris son temps. Elle s’était accrochée à la vie tout en appelant la mort de ses vœux. L'auteur se souvient des signes inquiétants survenus avant son décès, de cette longue agonie, de ses silences, de ses moments d'absence, de cette lente progression de la maladie, de la peur qu'on ne peut maîtriser, peur de l'inconnu, du moment fatal et incontournable, peur de souffrir, de mourir [pourtant il cite opportunément Thomas Berhnard " Je ne comprends pas la peur de la mort parce que mourir est aussi normal que manger "], peur de l’au-delà, du néant ou de l'inconnu, peur d’être enterrée vivante. La mort guette et elle est patiente. Bien entendu elle inaugurera une longue période d'oubli que ceux qui restent combattront avec leurs moyens. Cervera a choisi l’écriture pour exorciser à la fois cet oubli et ce deuil. L'ouverture de cette succession révèle aussi des documents dont il n'avait jamais entendu parler, qui attendaient sans doute depuis des années et qui concernaient son père mort depuis 16 ans d'un infarctus. L'un disait qu'il avait été condamné à 12 ans de prison en 1940 et l'autre, de 1952, annulait cette condamnation et ce un an après la fin de la guerre civile espagnole qu'il avait faite dans le camp républicains ! Pourtant, il n'aurait jamais été emprisonné. Autour de cet événement, le mystère s’épaissit au cours du récit d'autant que la vieillesse et la maladie ont gommé la mémoire de ceux qui l'ont connu. Nous apprendrons plus tard que ce père a simplement été condamné sur dénonciation, après le conflit, pour avoir participé à l'attaque d'une maison où étaient conservées des reconnaissances de dettes de tout le village. Cette condamnation a été commuée en exil intérieur. Lui qui était boulanger au village de Los Yesares dut partir pour Valence où il se fit laitier. Cet épisode familial est, pour Cervera, à travers le souvenir de son père, l'occasion de prendre son compte la mémoire des vaincus de cette guerre meurtrière qui ensanglanta le pays et engendra, même après la fin du conflit, haine, exil et assassinats sommaires.
J'ai bien aimé ce texte écrit d'une manière nostalgique et mesurée, simple et parlante à la fois[" Nous construisons nos vies sur l’échafaudage de nos souvenirs"], sans que je sache exactement si cette impression est due au style de l'auteur ou la qualité de la traduction.[ Sans vouloir faire offense aux auteurs en général, certaines traductions, tout en restant fidèles au texte original, sont de véritables recréations au cas particulier cela n'a d'ailleurs pas dû être très facile puisque j'ai noté au milieu du roman, une phrase sans ponctuation, qui fait un chapitre entier, court, certes, mais quand même !] Qu'importe d'ailleurs, lire est un plaisir chaque fois renouvelé surtout quand le texte sert si bien notre belle langue française.
J'ai appris aussi, de la part de Cervera qui confesse ne jamais se séparer d'un cahier où il note tour ce que lui inspire l'instant, les aphorismes sur l”écriture " Écrire est un acte héroïque, un labeur impossible, une erreur, la seule écriture descente est celle du silence", "Lire est une autre forme d'écriture, une autre erreur". J’adhère assez cette analyse de l'écriture, ce qui est du domaine du non-dit et le sera toujours à cause de l’impossibilité de s'exprimer ou par la non-volonté de le faire, à cause de motivations qui resteront à jamais secrètes parce que l'art de la parole écrite n'est pas forcement libératrice et ne doit en aucun cas être quelque chose qu'on fait pour plaire aux autres. Elle peut être un exorcisme mais elle reste toujours en retrait de ce qu'on voudrait dire et qu'on ne dira jamais, sans doute parce que la douleur qu'on porte en soi est trop forte et que tenter de l'exprimer est la fois désespéré et inutile. Pire peut-être ? Cet exercice est souvent un pauvre cautère et il est illusoire de penser que le lecteur puisse s'y retrouver ou s'y reconnaître. Il est quand même paradoxalement nécessaire parce qu'il est le vecteur de la mémoire.
Alfons Cervera (dont il est déjà question dans le n° 564 de cette chronique) est un de ces écrivains du renouveau littéraire espagnol. Il a choisi de faire sien le combat contre l'oubli en portant la parole des vaincus de la Guerre civile, des bannis, des morts et de leur redonner une mémoire que la dictature franquiste avait si longtemps étouffée.Ce roman est le deuxième publié en français.
.
c Hervé GAUTIER - Avril 2012.
http://hervegautier.e-monsite.com
-
Cosmofobia
- Le 20/05/2012
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°574– Mai 2012.
COSMOFOBIA – Lucia Etxebarria – Éditions Héloïse d'Ormesson.
Traduit de l'espagnol par Maïder Lafourcade et Nicols Véron.
J'avais déjà lu, un peu par hasard, cette auteure (« Amour, prozac et autres curiosités » – La Feuille Volante n° 433 de juin 2010). J'avais bien aimé parce qu'elle m'avait étonné par son humour. Pourtant là, j'ai eu beaucoup plus de mal à entrer dans son univers. Tout d'abord je n'ai pas aimé le style. Je suis peut-être vieux-jeu mais j’attends d'un roman qu'il soit bien écrit et quand on doit passer par le biais de la traduction, c'est d'autant plus difficile parce qu'il n'appartient pas au traducteur de réécrire le livre qu'on lui a confié. Le style est certes spontané, reflète le langage parlé, les dialogues en sont la reproduction. Je ne dis pas que cela me gêne mais quand j'ouvre un roman, je m'attends, peut-être inconsciemment à lire autre chose que ce que je côtoie dans la vie, même s'il se trouve des lecteurs pour penser le contraire. Des enfants ballottés d'un côté et de l'autre par des parents qui font passer leur plaisir ou leurs intérêts avant ceux de leur progéniture, les couples qui se séparent alors qu'ils se sont promis de s'aimer pour la vie, des gens qui choisissent de vivre ensemble alors qu'ils ne se supportent plus par habitude ou par peur de la solitude ou qui préfèrent fermer les yeux sur les infidélité de l'autre, l'existence qui devient soudain insupportable alors qu'elle avait été magnifique, les mensonges, les trahisons, l'hypocrisie, cela existe, ce sont des faits de société et personne n'y peut rien. Nous ne vivons pas dans un monde virtuel où tous les protagonistes sont beaux, gentils, fidèles et irréprochables. Les contes de fée, c'est pour les enfants et l'espèce humaine me semble de plus en plus infréquentable...
Cela me semble être la traduction du titre : Cosmofobia, peur du monde entier. Cela me plaît plutôt quand la littérature se fait l'écho de ce quotidien qui n'a rien d'un monde melliflu, mais au moins que cela soit agréable à lire, que le lecteur passe un bon moment, que sa lecture soit un plaisir.
Ce roman est une autofiction, une somme de nouvelles qui mettent en scène une télé-opératrice fauchée et un peu paumée qui vit dans un quartier populaire de Madrid. A travers de nombreux personnages l'auteure aborde les questions du métissage, de l’immigration, de la vie en société et de ses amours difficiles.
Je suis désolé de ne pas faire chorus avec les louanges que j'ai pu lire dans la presse à propos de cette auteure. C'est vrai que c'est facile de formuler ainsi des critiques, mais j'ai eu beaucoup de mal à terminer ce roman et je n'y ai pris aucun plaisir.
-
Anatomie d'un instant
- Le 25/04/2012
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°568 – Avril 2012.
ANATOMIE D'UN INSTANT – Javier Cercas – ACTES SUD.
Traduit de l'espagnol par Élisabeth Beyer et Alexandra Grujieie.
L’Espagne est un pays qui ne peut nous laisser indifférents. Il a toujours fait partie de notre culture, de notre histoire, soit à l'occasion de conflits, soit parce que, au nom de la démocratie, de la défense de la liberté, nous avons, nous Français, pris partie pour sa sauvegarde, même si, la politique s'en mêlant, le résultat n'était pas forcément à la hauteur des espérances tressées. Ce pays qui reste celui du soleil, du farniente, des vacances, de l’exubérance mais aussi de la culture a inspiré de nombreux créateurs et nombreux sont les Espagnols qui ont trouvé refuge en France, s'y sont établis, ont choisi de combattre pour lui, l'ont enrichi... Il resurgit régulièrement dans l'actualité pour nous rappeler qu'il n'est pas seulement un pays voisin, limitrophe de la France mais surtout un peuple ami avec qui nous partageons plus que d'anecdotiques événements.
La Guerre d'Espagne, ses suites parfois malheureuses, l'établissement durable du fascisme ont nourri fantasmes et soutiens de tous ordres en faveur de ceux qui avaient une légitime aspiration à la liberté, et le retour à la démocratie a été salué par tous comme la fermeture d'une parenthèse douloureuse de quarante années de franquisme. Las, dans toutes les démocraties, surtout si elles sont jeunes, il y a toujours des nostalgiques du passé, des idéologies perdues, de l'arbitraire, de l'injustice, des privilèges qu'ils ont perdus. Franco a laissé une trace prégnante dans ce pays. Malgré l'ouverture à la liberté, le pays a été secoué par des attentats, des soulèvements populaires. Nous sommes en Février 1981, Adolfo Suàres, Président du gouvernement est un homme affaibli qui vient de démissionner de sa charge et le parlement s'est réuni ce 23 février pour élire son successeur, Calvo Sotelo. Les débats promettent d'être houleux et passionnés mais ce n'est que le jeu normal de la démocratie quand surgissent des militaires en armes qui intiment l'ordre impératif à tous de se mettre à terre en le soulignant de coups de feu. A leur tête, le lieutenant-colonel Tejero de la Garde Civile, unité emblématique du franquisme. Nous avons tous en mémoire cette scène où la liberté bascule, le coup d’État qui est une pratique traditionnelle en Espagne recommence, le franquisme menace la jeune démocratie, créant un vide que des militaires putschistes ne vont pas tarder à combler, et ce en direct. Les membres de la représentation nationale se couchent tous, à l'exception de trois personnes, Adolfo Suàres, le vieux général Guitiérrez Mellado et Santiago Carrillo, qui, pour des raisons différentes tentent de résister, à leur manière à cet officier menaçant. Ce geste peut passer pour du courage, de la révolte, une manifestation de liberté face à la violence mais il peut parfaitement être analysé différemment. L'auteur se demande avec pertinence s'il n'était tout simplement pas dicté, pour chez chacun d'eux, par le besoin de racheter une faute personnelle.
Adolfo Suàres est un homme politique controversé, ancien membre de la phalange, arriviste ambitieux et opportuniste dénué de scrupules. Il fut choisi par le roi Juan Carlos pour organiser la transition démocratique, c'est à dire de liquider le franquisme et légaliser le parti communiste. Il s’acquitta de cette tâche, mena les réformes nécessaires mais c'est un homme épuisé, abandonné de tous et surtout du roi, au bord de la retraite qui vient de donner sa démission de chef du gouvernement et que le monde politique souhaite voir se retirer. L'ambiance autour de lui est à la conspiration et tout, à l'intérieur comme à l'extérieur, semblait avoir pour but l'éviction de Suàres. L'auteur se demande s'il ne cherche à mourir en martyr dans un ultime geste spectaculaire et ce même s'il n'était pas au courant, comme beaucoup d'autres initiés, de l'intrusion de Tejero dans l'hémicycle.
Guitiérrez Mellado est un officier de carrière fondamentalement franquiste, maintenant haï des militaires, qui a combattu dans les rangs nationalistes pendant la Guerre civile et devint, à cette période, membre de la 5° colonne c'est à dire qu'il infiltra les rangs républicains. Promu général, il s'engagea en politique et devient ministre de la défense dans le gouvernement d'Adolfo Suàres dont il était l'ami personnel. Puis, à la suite de son opposition spectaculaire à Tejero, épuisé, il se retira de la politique.
Santiago Carrillo fut un dirigeant historique du parti communiste espagnol, il a combattu dans les rangs de l'armée républicaine pendant la Guerre civile. Compromis pendant ce conflit, il joua un rôle déterminant dans le processus de transition démocratique. Au moment du putsch il est un homme politique sur le déclin. Le jeu politique fit que Carrillo le communiste et Suàres l'ancien phalangiste, pourtant ennemis inconciliables se retrouvèrent côte à côte dans le rétablissement de la démocratie et que, lorsqu'ils furent l'un et l'autre évincés de la vie politique, ils entretinrent de solides liens d'amitiés.
Vient ensuite l'évocation des putschistes, les généraux Armada, Milans et le lieutenant-colonel Tejero, tous militaires ambitieux, monarchistes, franquistes et opposés à la démocratie telle que l'entendait Suàres et donc contre lui, mais surtout tous fondamentalement différents dans leurs motivations, ce qui mena le putsch à l'échec.
Même si l'auteur présente ces hommes, qu'il qualifie de traîtres à leur idéal comme des personnages de fiction, les événement du 23 février s'étant déroulés dans une lumière blafarde et quelque peu irréelle, ce récit n'est pas un roman, c'est plutôt une non-fiction écrite avec faconde parce que la réalité dépasse l'imaginaire. Avec une précision d'archiviste, Javier Cercas démonte tout ce qui a conduit à ce coup d’État, certes avorté, mais oh combien prévisible dans la classe politique et ce qui en motiva l'échec, le putsch manqué n'étant que la partie visible de conspirations multiples et secrètes dans un contexte d'attentats de l'ETA et d’assassinats de gardes civils, de peur et de situation catastrophique de l’État et de la couronne. Ainsi montre-t-il que, ce qui a été ressenti dans l'opinion comme une atteinte à la démocratie n'était en réalité que l'aboutissement, certes mort-né, d'une atmosphère politique délétère. L'intervention télévisée du roi revêtu de son uniforme militaire se rangeant aux côtés de la constitution a été déterminante pour sauver la jeune démocratie espagnole. Armada et Milans, en prônant un gouvernement d'union nationale que refusait Tejero abandonnèrent ce dernier qui refusa la fuite et l'exil. Puis vint le procès et les condamnations mais il reste que ce coup d’État manqué, cette séquestration humiliante pour les politiques durant 17h30 dans l'hémicycle a renforcé la démocratie et la couronne et mis une fin définitive à la Guerre civile.
S'il fallait trouver une « morale » à ce livre remarquablement documenté, à ces faits, c'est sans doute Jorge Luis Borges que la fournit et l'auteur qui la cite opportunément : « Tout destin, si long et compliqué soit-il, se résume au fond à un seul moment : le moment où l'homme apprend une fois pour toutes qui il est ».
©Hervé GAUTIER – Avril 2012.http://hervegautier.e-monsite.com
-
Maquis
- Le 10/04/2012
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°564 – Avril 2012
MAQUIS – Alfons Cervera -Éditions La Fosse aux Ours.
Traduit de l'espagnol par Georges Tyras.
Ce sont en réalité de petites anecdotes racontées à la manière des gens du peuple, de ce petit village de la province de Valence après la victoire des franquistes. Là, des hommes prennent le maquis pour résister à la Guardia Civil sans pitié pour ceux qui restent, les enfants et les femmes des maquisards.
Grâce à des analepses et à différents témoignages éclatés dans le temps, les choses se révèlent, faites de souffrances, d'humiliations, d'embuscades et d'exécutions sommaires comme les affectionnaient les franquistes. C'est pour y échapper que les hommes se réfugient dans la montagne et choisissent de résister à Franco mais aussi peut-être pour venger la défaite républicaine et leurs camarades assassinés par les vainqueurs. Ils s'appellent, « Paco Haute tension » Justino Sanchez, Sébas, Nicasio, Ojos Azules, et ont été les victimes du caporal Bustamente, misérable petit chef de la Garde Civile qui fait régner la terreur dans le petit village de Los Yesares. Les circonstances font que celui-ci se croit autorisé a perpétrer des violences contre ceux qui sont restés au village pour qu'il dénoncent ceux qui l'ont quitté et qui les harcèlent. Il fait régner la terreur qui donne aux vainqueurs tous les droits, tortures, humiliations et assassinats pour affirmer leur autorité. A chaque page il y a la peur de la mort, celle des autorités chargées de maintenir l'ordre moral franquiste, le maire, le curé, les notables, le chef de la phalange, le caporal Bustamente et son arbitraire, celles des gardes qui craignent les représailles des maquisards, celle de son voisin qui peut parfaitement devenir un délateur... Une sorte de folie ordinaire s'empare de ce village perdu et oublié où le maquisard n'est qu'un nom, qu'une frêle silhouette promise à la mort ... et le combat est tellement inégal !
Ce n'est pas un roman, mais un récit, inspiré peu ou prou par l'histoire familiale de l'auteur, réalisé à petites touches avec différents témoignages d'hommes déjà morts, écrits dans un langage volontairement populaire mais aussi éminemment poétique. Il marque ainsi une phase de résistance au franquisme, entre la fin de la guerre civile et les années cinquante, période marquée par la peur, la culpabilité, l'oubli et, bien sûr, la répression, avec aussi, au début, l'espoir un peu fou des vaincus que Franco sera délogé par les alliés à la fin de le Deuxième guerre mondiale ! Face à cette lutte perdue dans le maquis, il ne reste plus aux opposants survivants qu'à s'exiler à l'étranger et tenter de résister à Franco à l'abri des frontières, en France. C'est le récit des temps difficiles de l'Espagne des vaincus persécutés par les vainqueurs
Ce travail de mémoire, qui est aussi une sorte de « devoir de mémoire » est bien résumé par cette phrase : « Il lui a parlé de la mémoire, de ce que nous sommes et ne sommes pas si nous renonçons à laisser le meilleur de nous-mêmes à ceux qui viendront après nous ». La lutte était nécessaire ne serait-ce que pour faire échec à l'oubli même si l'histoire est écrite par les vainqueurs « Dans la mémoire des gens seules restent les guerres remportées par les vainqueurs, les autres, on les oublie parce que les victoires marquent l'indignité de la défaite et que, au bout du compte c'est la vérité falsifiée, écrite par les chroniqueurs de l'oubli qui s'imposera ».
L'auteur qui n'a pas connue cette période puisqu'il est né en 1947, s'approprie cette « mémoire des vaincus » et la laisse en héritage aux générations futures, porte témoignage sur ce qu'a été cette guerre civile sanglante et sans pitié qui a bouleversé bien des consciences et préparé le chaos de la Deuxième Guerre Mondiale. « Nous ne sommes que ce que nous laissons, Sebas. Mets toi bien ça dans la crâne, juste ce que nous laissons. Une fois morts, il n'y a plus moyen de rectifier ce que nous avons été ou pas été, ni dans un sens ni dans l'autre, rien à faire, que dalle, point final ».
Alfons Cervera est journaliste, universitaire au service culturel de l'université de Valence, responsable du « Forum des débats », poète, écrivain de langue catalane. A partir de 1984, il publie « Sur les vampires et autres histoires d'amour » surtout axé sur une recherche esthétique du langage. A partir de 1990, à cause sans doute de ses origines valenciennes, il ressent le besoin d'être le témoin de « la mémoire des vaincus ». Teruel et Cuenca, qui furent le théâtre d'affrontements sanglants pendant la guerre civile ne sont pas si loin. Il inaugure ainsi un cycle romanesque avec « La couleur du crépuscule »(1995), « Maquis »(1997), « La nuit immobile »(1999), « L'ombre du ciel »(2002), « Cet hiver-là »(2005).
Cette recherche littéraire de la mémoire collective des républicains a été saluée par le critique espagnole. Cervera précise bien « Je ne recherche pas la revanche mais la mémoire des faits qui n'ont jusqu'alors été racontés que dans une version unique et intéressée des vainqueurs de la guerre ». C'est donc exercice de récupération de cette mémoire confisquée par les vainqueurs auquel ce livre Alfons Cervera... avec bonheur !
© Hervé GAUTIER - Avril 2012.
-
En attendant Robert Capa
- Le 07/04/2012
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°563 – Avril 2012
EN ATTENDANT ROBERT CAPA – Susana Fortes -Éditions Héloïse d'Ormesson.
Traduit de l'espagnol par Julie Marcot.
Fuyant l'Allemagne nazie, Gerta Pohorylle, jeune juive allemande, admiratrice de Greta Garbo, « avec un passeport polonais », vient d'arriver à Paris. « Elle à 24ans et elle est vivante » ! Elle ne va pas tarder à rencontrer, un peu par hasard, un autre réfugié, photographe, Hongrois, ambitieux mais désargenté. Ces deux-là étaient faits pour se croiser et le fait qu'ils le fassent dans la capitale française est plus qu'un symbole. Gerta y voit un signe, une chance ! Lui, c'est André Friedmann, juif lui aussi, qui vit avec son Leica comme on vit avec une femme. Dans ce Paris d'avant-guerre, pleins d'intellectuels, ils croisent au hasard des cafés ou des cercles, dans le tourbillon germanopratin, James Joyce, Man Ray...
Pourtant, entre eux, ce n'est pas vraiment le « coup de foudre », juste, de la part de Gerta, une sorte d'observation curieuse. Elle adopte cependant cet homme [« Ne t'inquiète pas, ce qu'il te faut c'est un manager...Et c'est moi qui vais être ton manager »]. Pour lui, elle est « la patronne » et il l'initie à la photographie en même temps qu''il devient son amant.
Foncièrement antifasciste, André part pour l'Espagne, d'abord comme reporter-photographe et Gerta, restée à Paris, apporte sa pierre à la réaction républicaine qui se doit de faire front aux bruits de bottes qui approchent, qu'ils viennent de Berlin ou d'ailleurs. Pourtant Gerta et André sont amoureux l'un de l'autre, prennent la décision un peu folle de couvrir la guerre d'Espagne comme photo-reporters en s'inventant les pseudonymes américains de Gerta Taro et Robert Capa. C'est une manière pour eux d'échapper à leur judéité autant que d'inaugurer leur nouvelle vie ensemble. En changeant de nom, André devient un américain triomphant et audacieux, en devenant Taro, Gerta s'approprie phonétiquement le nom de Garbo, son actrice fétiche.
Ce conflit les fascine autant qu'il les révolte et ils rendent compte en images du quotidien des républicains au front ou dans les villes et villages. Cette guerre fait d'eux un couple mythique qui ne vit que pour son métier de photographe de guerre et sa passion d'informer, armés de leur appareil photo ou à l'occasion d'un fusil, tissant leur propre légende, exposant leur vie. Leur amour fait contrepoids à la violence des combats et, petit à petit, ils changent leur vision romantique de la guerre. Si des atrocités ont été commises de part et d'autre, eux ont choisi leur camp, celui des républicains. Comme ils sont jeunes, leur vie se déroule au mépris du danger, tantôt houleuse et cahoteuse, tantôt passionnée, au sein même de ce conflit sanglant. Pourtant l'amour de leur métier se conjugue assez mal avec celui, à la fois sensuel et épisodique qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Gerta est éprise de liberté et d'indépendance mais a du mal à exister professionnellement dans l'ombre de Capa. Certains de ces clichés sont attribués à Robert; le journalisme de guerre n'est pas vraiment une affaire de femme ! Cependant, quand elle apparaît, au front ou à l'arrière, tous ces hommes un peu frustes n'ont d'yeux que pour elle. Pourtant, elle n'est pas vraiment une beauté au sens des canons traditionnels, mais il émane d'elle une sorte d'aura. « La guerre l'avait dotée d'une beauté différente, de survivante » écrit joliment Susanna Fortes.
C'est aussi un hommage aux journalistes de terrain qui risquent leur vie pour l'information du plus grand nombre, mais c'est aussi un récit passionnant, émouvant et poétique où le lecteur croise Raphaël Alberti, Ernest Hemingway, autant qu'une version romancée de la vie libre, passionnée et solaire de ces deux amants, une mise en lumière de celle de Gerta dont on ne connaissait jusqu'alors que très peu l'existence. Elle se révèle sous la plume de l'auteur être une femme courageuse, passionnée et passionnante quand le nom seul de Capa était connu autant d'ailleurs que certaines de ses photos dont l'une d'elles, devenue célèbre, représente un milicien espagnol anonyme, fauché par une balle. Capa ne se remit jamais de ce cliché par ailleurs sujet à polémique.
C'est un roman très bien documenté sur cette Guerre civile ( d'aucuns l'ont baptisée « incivile ») qui déchira l'Espagne de 1936 à 1939 et qui annonça la Deuxième Guerre Mondiale. L'auteur mêle donc dans ce travail, la fiction à la réalité. C'est une histoire tragique aussi puisqu'elle se termine par la mort de Gerta, la première femme reporter tuée pendant la Guerre Civile, fauchée à la bataille de Brunete en juillet 1937 à l'âge de 27 ans [« C'est à cet instant qu'elle comprit que toute une vie tenait dans l'éclair d'un millième de firmament, car le temps n'existait pas. »].
Elle qui vivait dans l'espoir d'une victoire des républicains ne vit pas leur défaite. Elle sera enterrée au cimetière du Père Lachaise, en présence de milliers de personnes, son éloge funèbre prononcée par Pablo Neruda et Louis Aragon. Elle ne quittera jamais plus la mémoire de Capa qui s'en voulait de l'avoir abandonnée aux combats meurtriers de l'Espagne. Sa vie à lui est désormais en pointillés, et quand il débarque, le jour J à Omaha Beach avec la première vague d'assaut, il pense aussi à cette mort qu'il a si longtemps défiée. S'il survit, comme par miracle au débarquement et au conflit, c'est en Indochine en 1954, à l'âge de 40 ans que le destin les réunira.
Il se dégage de ce roman une formidable énergie autant qu'un amour de la vie de la part de ces êtres, morts jeunes, que le monde fascinait mais qui n'étaient pas faits pour lui, qui mettaient constamment en balance leur vie sachant qu'ils n'en étaient que les usufruitiers. Ils ont pris des risques pour vivre intensément l'instant, pratiquer l'art de la photo unique qui résume tout, mais aussi pour satisfaire leur idéal d'informer, de témoigner, d'être présents là où il n'y avait personne d'autre, et d'y arriver avant les autres ! Avec eux, la photo est devenue une véritable arme.
L'occasion de ce récit a été inspiré à Susanna Fortes, un peu par hasard à cause de la découverte de négatifs et de clichés de Capa et de Gerta, en 2008, au Mexique. Il a le grand mérite de mettre en lumière la personnalité de cette femme d'exception qui n'était jusque là qu'une silhouette.
© Hervé GAUTIER - Avril 2012.
-
La vie de Lazarillo de Tormes
- Le 12/03/2012
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 1 commentaire
N°558 – Mars 2012
La vie de Lazarillo de Tormes - Anonyme.
Ce livre raconte les tribulations d'un orphelin d'une dizaine d'années dans l'Espagne du XVI° siècle entre Salamanque et Tolède. Pour lui la vie a mal commencé et il est confié par sa mère, veuve, à un aveugle avaricieux et vagabond qui subsistait en récitant des prières, en mendiant et en exerçant une activité de pseudo-guérisseur. L'enfant lui servit de guide mais surtout de souffre-douleur. Il en acquit une expérience particulière qui l'amena à être aussi malin que ce maître qu'il finira quitter pour se mettre au service d'un prêtre ladre et dépourvu de toute charité qui le congédie.
Poursuivant sa quête de mieux-être il se mettra au service d'un écuyer impécunieux et malhonnête qui l'abandonnera à son sort, puis il proposera ses services à un moine qui n'avait que peu de goût pour la vie monastique. Après quelques aventures, il entrera au service d'un bulliste, hâbleur et charlatan qui vendait des bulles papales et surtout les indulgences qui allaient avec à un public populaire et crédule. Le garçon ne manqua pas de s'apercevoir que ce commerce était avant tout basé sur la naïveté de la clientèle mais aussi sur des manœuvres où la supercherie et la dévotion religieuse n'étaient pas absentes. Le garçon finit par rencontrer un chapelain qui le traita passablement et qui lui permit de s'insérer dans la société en devenant crieur public. Enfin, il croisa la route d'un archiprêtre qui le maria avec sa servante et fit de lui un citoyen honnête, même si la lecture de l'épilogue peut signifier que Lazarillo souhaita faire perdurer sa situation, même au prix d'une complaisance conjugale.
Il s'agit d'un écrit anonyme, publié en 1554 à Burgos, mais le style du texte, la richesse du vocabulaire, le respect de la syntaxe, l'analyse des situations et la pertinence des remarques donnent à penser que l'auteur ne peut être qu'un lettré et qu'un homme cultivé. Ce livre fut bien entendu censuré par l'Inquisition et parut en 1573 sous une version expurgée. Des noms d'auteurs sont avancés notamment comme celui de Diego Hurtado de Mendoza y Pacheco[1503-1575], poète et diplomate espagnol, Lope de Rueda [1510-1565] dramaturge et poète espagnol, de même que celui de Sebastien de Harozco[1510-1580] et même celui d'un moine dominicain et professeur de mathématiques Juan de Ortega [1480-1568]. On a même pensé que l'auteur pouvait être un chrétien espagnol vivant en Flandres, à cause de la parenté de Lazaro avec Till Ulenspiegel. Bien entendu rien n'est confirmé.
C'est, en tout cas l'occasion pour l'auteur de se livrer, sous couvert d'un récit facétieux, à une évocation critique de la société à une période que l'Histoire a cependant retenu sous le nom de « Siècle d'Or ». Elle présente Lazarillo comme un jeune garçon sans expérience dont le seul et unique but est de manger mais qui finalement parvient à une certaine aisance matérielle. Le texte s'inspire de la tradition orale populaire et s'inscrit dans un contexte satirique mettant en scène le mendiant, le prêtre avare et l'écuyer(variante de l'hidalgo) ridicule et famélique.
A titre personnel, j'ai toujours été extrêmement intéressé par cette période de l'histoire littéraire espagnole.
Quelques mots sur le roman picaresque.
Le roman picaresque est né en Espagne au XVI° siècle. Cela vient du mot espagnol :« picaro » qui signifie misérable, mais aussi futé, malicieux.
D'aucuns en font remonter l'origine à l'Antiquité et plus particulièrement à Apulée, écrivain d'origine berbère né probablement en 123 après JC et mort vers 170. Son œuvre principale est « L'âne d'or » où le héros, un aristocrate nommé Lucius est transformé par accident en âne et connait différentes aventures parfois burlesques mais aussi malheureuses.
Le roman picaresque se caractérise par une vision critique de la société et des mœurs de l'époque. Sa construction d'une grande liberté permet à l'auteur de faire se succéder sans grande logique des épisodes différents au sein d'un même récit. En ce sens, il diffère des genres littéraires traditionnels comme la tragédie ou le discours qui répondent à des règles de constructions très précises. La peinture sans complaisance de la société implique en effet une liberté totale d'expression. Il s'oppose également au gongorisme, très en vogue au temps des Habsbourg
Le picaro est toujours d'un rang social très bas, constamment aux prises avec la faim, la souffrance et la malchance. En ce sens, il est l'exact contraire du chevalier à la condition et à l'idéal plus élevés. Le picaro est le type même de « l'anti-héros » qui vit en marge et ne recule devant rien pour améliorer sa condition, pourtant il échoue toujours dans cette entreprise. Quoiqu'il fasse, il restera toujours un déshérité !
Pour autant, le picaro qui entre pour survivre au service de différents personnages qui lui sont socialement supérieurs ne manque pas de critiquer son nouveau maître. Il y a donc dans sa démarche une dimension satirique incontestable et même moralisatrice puisque la conduite dévoyée d'un individu se termine souvent soit par un repentir soit par une punition. N'oublions pas non plus que ce genre littéraire s'épanouit à un moment connu pour être « l'âge d'or » de l'Espagne, ce qui en fait un témoignage exceptionnel du point de vue psychologique et sociologique.
Du point de vue style, le texte est souvent rédigé à la première personne ce qui peut faire passer, à tort cependant, le récit pour une autobiographie. Il évoque le parcours aventureux du héros, souvent obligé de changer de maître au gré des nécessités puisque sa seule préoccupation est de survivre, c'est à dire de manger, dans une société dont il semble exclu ou dans la quelle il a le plus grand mal à s 'insérer.
Ce genre littéraire a été illustré notamment par « La vie de Lazarillo deTormes » (1553), récit anonyme, par « Guzman de Alfarache » (publié en deux parties en 1599 et 1604) de Matéo Aleman, par « Las relaciones de la vida y aventuras del escudero Marcos de Obregon » (1618) de Vicente Espinel, par « El buscón » de Francisco de Quevedo. Alain-René Lesage [1668-1747] peut être considéré comme l'héritier français du roman picaresque avec « Gil Blas de Santillane »
© Hervé GAUTIER - Mars 2012.
-
LA TOUR DE GUET – Anna Maria Matute
- Le 11/06/2011
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°525 – Juin 2011.
LA TOUR DE GUET – Anna Maria Matute – Éditions Phébus.
Traduit de l'espagnol par Michelle Lévy-Provençal.
C'est une ambiance du haut Moyen-Age que visite ce roman avec des personnages tels que le père du narrateur, « petit féodal très pauvre » mais surtout aux mœurs frustes et vicieuses. Le décor n'est pas en reste avec ces donjons inconfortables, ces hivers rigoureux, ces forêts mystérieuses, ces loups hurlants, ces buchers expiatoires où l'on brûle des sorcières, ces combats brutaux, ces marias peuplés de dragons ... L'ambiance aussi, témoin le récit de la mort de la baronne Mohl.
C'est que ce texte commence quand le narrateur est encore un enfant, laid et abandonné par ses parents, fils d'un pauvre vassal inculte et brutal et d'une mère qui ne s'occupe pas de lui et termine sa vie dans un couvent et que ses frères maltraitent. Pour parfaire son éducation de chevalier qu'il a commencé seul, lui qui n'est encore qu'un enfant, se rend, comme ses trois frères avant lui, au château du suzerain de son père, le baron Mohl, un puissant et riche seigneur et tombe amoureux de l'énigmatique châtelaine qu'il surnomme l'ogresse. Là il apprend non seulement l'art de se battre, de manier l'épieu et l'épée mais aussi les bonnes manières, la lecture la musique et les bonnes manières. Là il vit dans un milieu plus raffiné, plus cultivé que dans la maison délabrée de son père, mais ses frères sont là qui l'observent, menaçants...
Pourtant, son avis sur le baron change vite quand il apprend par une indiscrétion de soldat que le château abrite aussi de jeunes éphèbes et de tendre jeunes filles pour le plaisir du maître des lieux. Il comprend que son hôte n'est pas aussi vertueux qu'il l'avait supposé mais qu'il est au contraire injuste, sanguinaire et sadique, capable de tuer avec raffinement son jeune amant et de le livrer aux chiens !
Le grand fleuve qui baigne ce pays inconnu est une frontière au-delà de laquelle s'étend la steppe inhospitalière
Je ne suis que très modérément entré dans l'univers de ce roman déroutant, épique et fantasmagorique. L'auteur, Anna Maria Mature m'était inconnue malgré sa notoriété et l'importance de son œuvre couronnée du prestigieux prix Cervantes en 2010. C'est, certes un roman initiatique sur l'éducation d'un jeune chevalier, fort bien écrit, baroque et dépaysant. Le lecteur y retrouve des questions éternelles comme la place de l'homme dans le monde, le regard d'un humain porté sur l'espèce à laquelle il appartient et à laquelle il ressemble, l'idéal de puissance et de domination... C'est un roman de la découverte de soi, de la quête du bien et du mal, du passage de l'enfance à l'âge adulte, de la perte de l'innocence, de la solitude, de la prise de conscience de la complexité de ce monde et de l'angoisse d'y vivre. Finalement, le monde décrit ici n'est pas très différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui et les paroles du narrateur sont parfaitement transposables « Je me promis de ne jamais plus participer à une vie qui n'étais pas ma vie, me mêler et me confondre à une race qui subsiste et gravit à force de coups, de ruses, de renoncements, de désespoirs, de haine, d'amour et de mort. »
©Hervé GAUTIER – Juin 2011. http://hervegautier.e-monsite.com
-
L'EVANGILE SELON JESUS-CHRIST – José Saramago
- Le 12/05/2011
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°520 – Mai 2011.
L'EVANGILE SELON JESUS-CHRIST – José Saramago – Le Seuil.
Traduit du portugais par Geneviève Leibrich.
À lire la 4° de couverture, et ayant déjà lu Saramago, je m'attendais à ce que ce texte prenne des allures blasphématoires. En effet, nous avions déjà la Vulgate, les évangiles apocryphes, rien de l'empêchait donc, en qualité d'homme de plume, de livrer une version très personnelle de cette histoire. En effet, l'Évangile n'a pas, comme dans d'autres religions, été dicté par Dieu, mais ce sont des hommes qui, ayant connu le Christ et ayant entendu son enseignement, ont décidé de le transcrire à l'intention de toute l'humanité. Certes Saramago n'a pas connu Jésus, mais il en a beaucoup entendu parler dans un Portugal catholique. Il avait donc le droit de nous livrer sa version. Après tout notre auteur est un homme de lettres doué d'imagination...
Pourtant, ce texte est écrit par un narrateur anonyme (et non par Jésus lui-même comme pourrait le laisser penser le titre – Il s'agit ici véritablement d'un évangile selon Saramago) qui s'approprie à sa manière l'histoire de Jésus, la replaçant dans un contexte historique, décrivant avec une grande érudition le temple de Jérusalem avant sa destruction, citant les différentes phases du rituel juif pour un lecteur dont les cinq sens sont sollicités. Il évoque Hérode comme un roi malade et sanguinaire qui craignait pour son pouvoir à cause des Écritures et qui perpétra ce que nous connaissons sous le nom du « Massacres des saints innocents » à l'occasion d'un recensement imposé par les Romains. Certes, l'auteur prend des libertés avec le texte classique en nous présentant l'annonciation formulée non par l'archange Gabriel, mais par un simple mendiant [Marie ne saura que plus tard la vraie filiation divine de son fils et le lecteur pourra s'interroger sur la nature véritable de ce mendiant]. Il nous présente-il Joseph comme un charpentier un peu rustre, peu habitué aux mondanités, coupé du monde à cause de son métier d'artisan, mais respectueux des anciens et des rituels religieux, comme un bon père aussi, soucieux de sa famille et de son premier-né.
Vers la onzième année de Jésus, l'auteur décrit une révolte nationaliste fomentée par un certain Judas de Galilée. Après tout, cela est une réaction normale dans un pays occupé par une puissance étrangère. Joseph, père maintenant de neuf enfants reste aux yeux de Saramago un traitre à la cause des Juifs. En effet, il l'accuse d'avoir été le témoin de l'ordre assassin d' Hérode et de ne pas en avoir averti les autres, portant en quelque sorte la responsabilité de l'assassinat des enfants de Bethléem. De plus, il fait de lui un martyr innocent, exécuté par erreur pour un délit qu'il n'avait pas commis. Face à cette mort injuste, son fils Jésus va se sentir coupable tout comme il est poursuivi par la responsabilité qu'il estime porter dans l'assassinat de ces enfants tués par Hérode au moment de sa naissance. Il en viendra à interroger les docteurs de la loi dans le temple de Jérusalem sur ce thème.
Puis, Jésus part de chez lui, se fait berger en Judée, abandonne son métier de charpentier et rencontre Pasteur, un pâtre non juif, qui lui enseigne ses nouvelles fonctions autant qu'il lui sert de père. Jésus est révolté par la vie que les hommes suppriment parfois au nom de Dieu, rompt avec sa famille qu'il rencontre par hasard, se révolte contre le dogme et les rites religieux sacrificiels, s'interroge sur la vraie nature des gens qui croisent sa route, jusqu'à confondre sciemment Dieu et Satan [« J'ai compris que lorsque l'un et l'autre sont d'accord, on ne peut pas distinguer un ange du Seigneur d'un ange de Satan ». « Je vais vous conduire jusqu'à la rive pour que tous puissent enfin voir Dieu et le Diable comme ils sont. Ils verront comme ils s'entendent bien, comme ils se ressemblent »]. Saramago nous le présente comme un garçon de quinze ans, très averti du judaïsme, déjà un homme, qui a tout compris de la condition humaine et qui ressent, dans le désert, l'appel de Dieu auquel il ne peut se soustraire. Désormais, il sera l'élu, celui qui a vu Dieu (mais aussi celui qui a rencontré le Diable). Il sera obligé d'aller au devant d'un destin qu'il ne souhaitait pas mais qu'il finit par accepter, celui du Fils de Dieu devant mourir sur la croix pour racheter les péchés des hommes. Sauf qu'il voit dans cette destiné, une volonté divine qui utilise ce fils pour étendre sa domination sur le monde en ne lui laissant pas le choix. Dieu est présenté comme une puissance sanguinaire qui ne recule devant rien pour s'imposer aux hommes à qui il demande un lourd tribu en vie humaines à travers les martyrs, les guerres, l'inquisition [" Alors le diable dit, il faut être Dieu pour aimer autant le sang »]. Il est vrai que l'histoire de l'Église catholique est là pour illustrer ce propos. Il pose donc en ces termes le problème de la liberté et celui de la révolte, mais face à Dieu, cette insoumission est impossible.
Saramango donne à Jésus une véritable dimension humaine dans sa révolte comme dans sa vie, un homme qui ne peut résister notamment à l'appel de la chair. Marie-Madeleine le déniaise et vit avec lui une authentique histoire d'amour ( son personnage est particulièrement bien rendu ). Celle qui était à l'origine une prostituée change de vie pour être sa compagne fidèle et complice au quotidien. Jésus est présenté comme un nomade solitaire, intelligent et vif d'esprit, pauvre et sympathique qui, par ses miracles aide les hommes à vivre, tout en leur rappelant qu'il n'y est pour rien et que c'est le Seigneur dont il est véritablement le fils qui parle par sa voix. Il reste un être tourmenté, partagé entre Dieu et Satan et les Juifs autour de lui le prennent pour un être d'exception, un mage, le Messie des Écritures ou celui qui pourrait bien libérer la terre d'Israël du joug romain. Les apôtres et les disciples ne viendront qu'ensuite et le suivront. Même si Saramago bouleverse un peu l'ordre et le contexte des miracles de l'Évangile, choisit de mettre en exergue un fait plutôt qu'un autre ou la personnalité d'un apôtre ou d'un personnage, même s'il fait de Marie une mère incrédule, loin en tout cas du dogme de la virginité puisqu'elle une vie sexuelle normale et féconde avec son mari, il ne donne pas à voir un Jésus antipathique, bien au contraire. Il le présente comme une victime de son destin implacable, un instrument de la domination divine sur le monde. C'est à Dieu le père qu'il s'en prend.
On le voit bien ici, c'est davantage une fiction romanesque qu'un véritable évangile qui, en d'autres temps lui aurait valu le bucher [Je dois quand même avouer que le dialogue entre Dieu et le Diable à quelque chose de naïf et de peu convainquant]. A la suite de l'édition des « versets sataniques » Salman Rushdie a été victime d'une fatwa et dut se cacher pour sauver sa vie. Après la publication de ce roman en 1991, et devant la réaction violente de l'église catholique portugaise, Saramago dut s'exiler aux Canaries où il mourût en 2010.
J'entends que sa démarche soit romanesque, que son droit à la recréation lui soit reconnu ( comment ne le serait-il pas ? Martin Scorsese reprenant « La dernière tentation du Christ » de Nikos Kazantzakis avait fait de même ...). Je ne suis pas attaché au texte du Nouveau Testament, je ne suis peut-être qu'un vulgaire mécréant sans importance et promis au feu de l'enfer, mais cette grande fresque largement sacrilège, pourtant bien écrite (bien traduite, malgré une disposition des dialogues un peu difficile à suivre) avec des moments agréablement poétiques, m'a un peu gêné sans que je sache vraiment pourquoi.
-
LE DIEU MANCHOT – José Saramago
- Le 07/05/2011
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°519 – Mai 2011.
LE DIEU MANCHOT – José Saramago – Albin Michel.
Traduit du portugais par Geneviève Leibrich.
Nous sommes au XVIII° siècle au Portugal sous le règne de Jean V dit « le Magnanime » (1706-1750). Ce roi fait le serment à Dieu de lui élever un couvent dans la ville de Mafrat contre la promesse d'un héritier légitime. L'infante Maria Barbara naîtra peu après. Ce projet vaniteux et quelque peu pharaonien devra rivaliser avec St Pierre de Rome devient possible grâce à l'or du Brésil.
Ce texte met en scène Balthazar Mateus, dit Sept Soleils, un soldat portugais que la guerre a rendu manchot de la main gauche, mendiant et vagabond et Blimunda, une sorte de sorcière qui a le pouvoir de lire dans les âmes de ses contemporains. Ensemble, ils forment un couple symbolique mais surtout illégitime, condamné par l'Église mais pas par le Père jésuite Bartolomeu de Gusmão (1685-1724), un génial et authentique inventeur qui a conçu la « Passarole », une machine au mécanisme compliqué à base de boules d'ambre, d'aimants, de chaleur du soleil, de voiles, de sphères contenant des volontés humaines et... de grâce de Dieu ! En principe, elle doit s'élever « en vertu d'attraction contraire à la chute des corps graves ». C'est lui d'ailleurs qui révèle à Balthazar que Dieu est, comme lui, manchot de la main gauche [« Je suis le seul à le dire mais Dieu n'a pas de main gauche puisque c'est à sa droite que s'asseyent les élus... Personne de s'assied à la gauche de Dieu, c'est le vide, le néant, l'absence d'où il résulte que Dieu est manchot. »] et qui baptise sa compagne du nom de « Sept-Lunes ».
Cette femme révèle à son compagnon des vérités religieuses qui vont à l'encontre de l'enseignement catholique [ « Les saints n'ont pas été sauvés...personne n'est sauvé et personne n'est damné... Le péché n'existe pas, seuls existent la vie et la mort »]. Ensemble, ils secondent le jésuite dans la construction de cette machine qui volera effectivement devant le roi en 1710 (et donc bien avant la montgolfière) mais dont le projet, quelque peu dangereux sera abandonné. (La relation romancée du premier vol de cette machine tel que l'imagine Saramago est particulièrement savoureuse).
Baltahazar et Blimunda vivent sans doute dans le péché, mais le moine en fait encore un bien plus grand qui est de vouloir voler, c'est à dire de vouloir aller contre les choses établies par Dieu et ainsi vouloir l'offenser. Ainsi le prêtre est inquiet parce que l'inquisition veille et craint autant pour sa vie que pour son invention. D'ailleurs la mère de Blimunda est morte sur le bucher du Saint Office pour sorcellerie.
C'est aussi l'occasion pour l'auteur de nous conter, à travers les yeux de Balthazar, l'histoire de ces opprimés qui construisent le monastère de Mafrat. Ce chantier sera une hécatombe pour les ouvriers chargés de sa construction, recrutés et traités comme de véritables esclaves. A dix sept ans, Maria Barbara part du Portugal pour devenir reine d'Espagne mais le monastère qu'on va consacrer n'est même pas encore terminé.
Publié en 1982, ce roman épique promène le lecteur dans une Lisbonne baroque faite de richesses des découvertes, de dévotions religieuses, d'autodafés, de fornications adultères, de luttes d'influence, de sorcières, d'alchimie, d'inquisiteurs, de nobles, de toute une population interlope, d'un petit peuple qu'on sacrifie pour l'édification de ce monastère, de mortifications religieuses inutiles, avec, en toile de fond, le clavecin de Domenico Scarlati... C'est une histoire d'amour, une fable blasphématoire autant qu'un roman historique qui replonge le lecteur dans cette société lusitanienne du XVIII d'avant le tremblement de terre de 1755.
En dépit de phrases longues et difficiles à suivre parfois, à cause de la ponctuation et des dialogues disposés bizarrement, l'auteur, dans un style luxuriant, poétique, jubilatoire et complice, transporte littéralement son lecteur dans une ambiance dépaysante et particulière qui le fascine.
-
CAIN- José Saramago
- Le 01/05/2011
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°518 – Mai 2011.
CAĪN – José Saramago – Le Seuil.
Traduit du portugais par Geneviève Leibrich.
Après « L'Évangile selon Jésus-Christ », sorti en 1992, où José Saramago (1922-2010) présente Jésus perdant sa virginité avec Marie-Madeleine, l'auteur récidive dans ses attaques contre Dieu avec ce roman. A l'évidence, il a, sinon l'envie de créer la polémique, à tout le moins celle de vider avec Lui un lourd contentieux. Alors que nombre d'écrivains ont célébré le Créateur ou ont choisi, au contraire de l'ignorer, Saramago le dénonce comme « un dieu cruel, envieux et insupportable qui n'existe que dans notre tête ». Quand il parle de Lui, il évite soigneusement la majuscule qui d'ordinaire orne son nom et choisit dans ce roman de présenter le meurtre d'Abel par son frère Caïn non comme le disent les Écritures à cause de l'envie mais bien plutôt à cause de l'injustice de Dieu. Il dépeint Caïn, pourtant présenté comme le premier meurtrier, comme un être bon et amoureux de la vie mais qui, s'étant rebellé contre l'arbitraire divin, est méprisé par Dieu. Ainsi le seul coupable de la mort d'Abel ce n'est pas Caïn mais Dieu. « Qui donc es-tu pour mettre à l'épreuve ce que tu as crée ? » lui dit Caïn.
Dès lors il est condamné à errer (juif errant !)sur la terre, succombe aux charmes de Lilith qui est à la fois la maîtresse d'une ville, l'épouse de Noé et l'amante des hommes de passage. Il aime la vie, est le témoin impuissant des grands événements de « l'Histoire Sainte ». C'est lui qui arrête le bras d'Abraham sacrifiant son fils unique à Dieu, c'est lui qui voit la tour de Babel et ce qu'il en résulte pour les hommes, qui assiste à la mort des innocents de Sodome, au bras vengeur de Moïse tuant les adorateurs du veau d'or, sans oublier des souffrances pour lesquelles Dieu s'allie à Satan pour tourmenter Job. C'est une sorte de roman philosophique voltairien, un conte plaisant, écrit et traduit sur un mode jubilatoire qui revisite les saintes écritures en s'adressant directement au lecteur. Caïn est présenté comme une sorte de Candide qui se promène dans le temps sur le dos d'un âne. Ensemble, et par le miracle de l'écriture, ils traversent le « présent-futur » ou « le présent-alternatif » mais aussi visitent le passé. Dieu est toujours présenté comme un dictateur sanguinaire, jaloux, manipulateur, rancunier et injuste qui fait un choix parmi les hommes. Déjà dans « Le Dieu manchot » Saramago avait posé le problème de l'injustice : un roi décide d'offrir à Dieu un monastère pour le remercier de lui avoir donné un fils mais cette construction occasionne la mort de nombreux innocents. Il pose le problème de la coexistence entre les hommes et Dieu, entre les puissants et les humbles.
C'est, d'évidence, un combat de la créature contre son créateur à travers la personnalité d'un être que la Bible, toujours manichéenne, a présenté comme quelqu'un de mauvais. L'Évangile prendra plus tard ce relais, notamment avec Judas. Caïn ose interroger Dieu et s'opposer à lui ! Prendre parti pour un désavoué, un réprouvé est toujours un défi intéressant, d'autant que c'est un prix Nobel de littérature qui fait ce choix. Combattre la soumission à une divinité qui est le socle de toute religion peut paraître iconoclaste. Cela n'en est pas moins la marque de cet homme engagé qui a, tout au long de sa vie, choisi d'être « politiquement incorrect », d'être en quelque sorte rebelle aux idées reçues et même à l'ordre établi, surtout contre l'Église . Depuis toujours, il a choisi son camp, celui des opprimés. On se souvient de ses positions pro-palestiniennes qui lui ont valu beaucoup de critiques au Portugal qu'il a été obligé de quitter, en Europe et dans le monde.
Il ne pose pas pour autant le problème de la foi (s'adressant à Dieu il n'en nie pas l'existence mais remet en cause la bonté qui est censée le caractériser) qui est personnelle à chacun mais celui de la transcendance de Dieu et de la résignation humaine. Il est lui-même un écrivain dont le rôle est de raconter des histoires (Il précise qu'il est « un simple rapporteur d'histoires antiques »). Il considère que la Bible est un livre d'histoire emprunt de violence et qu'il peut parfaitement réécrire à sa manière en le désacralisant. Il m'apparaît que c'est un écrivain qui n'accepte pas le compromis et qui a choisi de se rebeller contre ce que l'humanité dans son ensemble considère comme une évidence : la soumission aveugle et consentante à une sorte de destin dicté par Dieu avec tout ce qu'il a d' injuste et d'irrationnel. Il me semble que, dans la mesure où l'on reste soi-même, où l'on assume ses choix, surtout s'ils vont à l'encontre de ceux du plus grand nombre, de ceux dictés par les institutions, on est parfaitement respectable. La peur de la mort, celle de l'enfer, de la damnation éternelle dont on nous a si abondamment parlé dans nos sociétés tant marquées par le judéo-christianisme, n'ont pas de prise sur lui. Il affirme ses convictions et en accepte les conséquences et je ne vois pas au nom de quoi il devrait se taire. Son style est remarquable, humoristique et toujours plaisant pour le lecteur. Il a fait valoir son talent comme le dit la parabole et je ne vois pas ce qui justifierait son silence. Et tant pis si d'aucuns ont pu voir dans ce texte une fable blasphématoire !
Cela dit, même s'il a dû s'exiler en Espagne à cause sans doute de l'Église catholique qui n'a pas supporter ses écrits et ses prises de position, il n'en reste pas moins qu'il est le seul écrivain de langue portugaise à avoir obtenu le prix Nobel de littérature (1998), et, à ce titre, son pays en est fier. Heureusement !
-
L’EMPIRE D’UN HOMME – Ramon Sender
- Le 28/04/2011
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°299– Mai 2008
L’EMPIRE D’UN HOMME – Ramon Sender – Éditions Actes Sud
Roman traduit de l’espagnol par Claude Bleton.
C’est d’une bien «ténébreuse affaire » dont nous parle Sender. Dans une petite contrée espagnole on retrouve un homme disparu depuis bientôt quinze années à cause d’un pressentiment inexpliqué, et qui vivait solitaire dans la montagne. Tout porte à croire qu’il s’agit de Sabino, pauvre hère qui serait mort assassiné depuis longtemps mais dont on n’a jamais retrouvé le cadavre. De ce meurtre on a accusé Juan et Vicente dont les aveux ont été obtenus avec zèle par le brigadier de la Garde Civile locale et avec des méthodes héritées de l'inquisition.
L’instruction quelque peu courtelinesque le dispute à l’imagination de l’avocat de la défense pour expliquer les circonstances de cette affaire. Les deux prévenus ont fini par avouer tout et n’importe quoi, pourvu qu’on les laisse en paix. Ils sont donc devenus deux assassins et ont fait pour cela quinze années de prison. Tout cela sur fond politique où, dans un petit village, les Libéraux s’opposent aux Conservateurs, dans une lutte d’influence où l'Église prend ses marques, s’allie à la force, pourvu que les apparences soient sauves, l’ordre public sauvegardé, et la religion maintenue dans son autorité morale.
Mais voilà, ce Sabino, mort depuis quinze ans, refait son apparition à la surprise générale au point qu’on se demande s’il ne s’agit pas de son fantôme et les femmes, mères ou épouses, laissent leur empreinte dans ce drame fait de fantasmes populaires et de croyances d’un autre âge au point que de vieilles querelles, où l’honneur familial et la moralité sont mis en cause, vont se réveiller et trouveront leur épilogue « sur le pré ».
Je remarque qu’à l’heure où l’on revient enfin à une compréhension et un apprentissage plus traditionnel de la grammaire française, ce texte est restitué en français avec un grand respect de la concordance des temps chère aux Espagnols
-
LE ROI ET LA REINE – Ramón Sender
- Le 28/04/2011
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°517 – Avril 2011.
LE ROI ET LA REINE – Ramón Sender – Éditions Attila.
Traduit de l'espagnol par Emmanue Roblès
Ce roman qui a l'origine avait été publié en 1955, fait l'objet d'une réédition, enrichie de dessins d'Anne Careil.
Cette histoire commence d'une manière assez inattendue. La jeune Duchesse d'Arlanza est complètement nue dans la piscine de son palais madrilène. Entre Romulo, son jardinier, mais elle néglige de se couvrir le corps au seul motif qu'il n'est qu'un simple domestique et surtout pas « un homme ». Le lecteur mesure ainsi, dès les premières lignes le ton de ce roman, l'image d'une société espagnole d'un autre âge. Le lendemain, le 13 juillet 1936, José Calvo Sotelo, chef du parti anarchiste est assassiné. C'est le point de départ du soulèvement franquiste et le début de la sanglante guerre civile qui va déchirer le pays.
Le mari de la duchesse, officier d'artillerie dans le rang des nationalistes rejoint son poste mais retrouve son épouse nuitamment dans leur demeure où la duchesse s'est cachée. Après la réquisition de son château par les républicains et la nomination de Romulo comme gardien des lieux, le duc est livré et tué. La duchesse, pétrie de convictions surannées, semble étrangère aux bouleversements du dehors, continue de regarder son jardinier comme un domestique, de se recommander à Dieu et d'attendre l'intervention du roi Alfonse XIII. Les visites nocturnes du duc qu'il prend pour un autre amant, rendent Romulo jaloux. Ainsi cet homme du peuple, devient-il, par hasard et compte tenu des circonstances, l'égal de ses anciens maîtres, du moins le pense-t-il ! Cependant, compte tenu de l'amour qu'il croit porter à la duchesse, il se met en devoir de la protéger, même contre les « rouges » dont il fait pourtant officiellement partie. Avec sa complicité, elle reste cloîtrée dans le donjon du château sans que les miliciens en sachent rien et lui bénéficie d'une grande liberté à l'intérieur de ces lieux dont il a la charge. Il joue pourtant un double jeu et choisit, par amour pour cette femme, un camp auquel il n'appartiendra cependant jamais. Il accepte par avance de prendre sur lui l'assassinat du capitaine républicain dans lequel il n'est pour rien pour sa seule raison que la duchesse le lui demande. Il fait d'ailleurs disparaître le corps pour qu'elle ne soit pas inquiétée. Quand il sent qu'elle peut le dénoncer en échange d'un sauf-conduit qui la sauvera, il accepte ce sacrifice et attend patiemment la mort. C'est aussi cette même mort qu'il va chercher au front en s'engageant, un peu comme si elle devait le délivrer de cette emprise qu'a sur lui la duchesse tout aussi bien qu'elle allait l'élever au-dessus de sa condition.
Pourtant, c'est un peu comme si les événements extérieurs étaient presque secondaires au regard des relations quelque peu ambiguës qui s'établissent en lui (le roi) et elle (le reine). Elles sont faites de fantasmes et de mort, d'attente et de fuite, de fols espoirs et de projets surréalistes... C'est, dans ce microcosme, un huis clos, qui figure une sorte d'unité de lieu, que se déroule ce combat inégal. Le personnage de la duchesse, qui est à ce point immatériel qu'elle ne porte même pas de prénom, est à la fois fantasque, détaché de la réalité, ambigu aussi. Quand son mari meurt, elle se donne à Estéban, un Donjuan cynique et égoïste qu'elle a pourtant toujours regardé comme « le Diable » alors qu'elle songe plutôt à se servir de Romulo comme d'un instrument. Elle est, pour ce dernier, un « rêve », une illusion inaccessible et, quand elle s'enfuie, Romulo se répète à l'envi « Elle m'attend quelque part ».
C'est une espèce de jeu de miroirs, une valse-hésitation entre eux, un drame où les dialogues sont réduits au minimum et où s'opposent deux êtres à la personnalité différente, un maître et un esclave. Et pourtant la duchesse ne cesse de descendre des étages à l'intérieur du donjon où elle s'est réfugiée, alors que son jardinier tente de prendre de l 'ascendant sur cette femme qui l'impressionne. Il ne ressent aucune peine pour la mort de son épouse tuée dans un bombardement fasciste et accepte même que la duchesse revête ses vêtements pour passer inaperçue dans sa fuite.
Il y a aussi des personnages secondaires, Elena, le nain qui bizarrement porte un nom de femme qui mène un combat contre les rats, comme Romulo le fait contre lui-même. Il peut représenter un danger pour le jardinier mais dès lors qu'il sent que la duchesse est morte, il cesse de le craindre. Esteban qui est seulement évoqué représente le côté bestial et érotique de l'amour, Romulo incarnant son aspect idéalisé. Cette idéalisation est fondée sur la vision fugitive de la nudité féminine, complète au départ puis limitée à un bout de sein à la fin. Les marionnettes ont un rôle révélateur dans ce récit, celui peut-être du chœur dans le théâtre grec, celui assurément de l'espèce humaine qu'elles représentent. Chaque marionnette est un homme qu'on peut aisément manipuler et c'est à l'une d'elle que l'auteur laisse le dernier mot : « acta est fabula » !
Ce texte est illustré de dessins dus à Anne Careil qui soulignent bien le thème traité : la danse d'Eros avec Thanatos !
Je continuerai à m'intéresser à cet auteur qui avait déjà retenu mon attention [la feuille volante n° 299 -Mai 2008]
©Hervé GAUTIER – Avril 2011. http://hervegautier.e-monsite.com
-
IL NE FAUT PAS MOURIR DEUX FOIS – Francisco Gonzales Ledesma
- Le 15/02/2011
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
L A F E U I L L E V O L A N T E
La Feuille Volante est une revue littéraire créée en 1980. Elle n’a pas de prix, sa diffusion est gratuite,
elle voyage dans la correspondance privée et maintenant sur Internet.
N°505 – Février 2011.
IL NE FAUT PAS MOURIR DEUX FOIS – Francisco Gonzales Ledesma* – L'Atalante.
Traduit de l'espagnol par Christophe Josse.
Le début est un peu déroutant. Trois histoires apparemment indépendantes les unes des autres qui se déroulent quand même dans la ville mythique de Barcelone. Elle est le véritable personnage central de tous les romans de Ledesma.
Gabri qui sort de prison vient se recueillir sur la tombe de sa femme quand on lui propose de tuer un inconnu. Une vieille maquerelle, Dalia, qui loue une adolescente trisomique aux assauts sexuels de notables locaux. Un mariage qui se transforme en tuerie, les deux futurs époux ayant fait le projet de s'assassiner l'un l'autre...
Le pauvre inspecteur Méndez, toujours aussi marginal, indiscipliné, alcoolique et désœuvré, va s'intéresser à toute cette délinquance malgré une hiérarchie qui ne l'aime guère et qui ne lui fait même plus confiance. Et d'ailleurs on ne lui confie même pas cette enquête ! Il est, selon ses propres termes « un policier à la manque que personne ne croit, un policier des rues ». Son patron a l'apparence de Monterde, commissaire principal, impénitent fumeur de havanes et accessoirement fort sensible aux charmes des femmes, de ses collègues féminines en particulier. Il a, à l'endroit de son inspecteur une formule peu académique pour s'adresser à lui (« Putain Méndez ») mais son subordonné reste égal à lui-même, prenant des initiatives toujours à la limite de la légalité. Il reste, malgré son âge un élément de valeur que, pour une fois, son administration songe à récompenser !
Gabri est un dur qui a décapité celui qui a violé son épouse, Elisa, morte en couches et tué en prison l'assassin d'une fillette. L'homme qu'on lui demande de d'exécuter se révèle être une femme, Greda, enceinte qui plus est des œuvres de son ex-patron, qui ainsi souhaite se débarrasser d'un double problème qui risque de lui coûter sa place et son riche mariage. Son beaux-père qui ne l'aime guère rêve de le voir disparaître. L'ex-taulard est cousu de dettes mais c'est quand même un type bien et propose à Greda de s'enfuir.
Près de la maison de Dalia, Haliz, un type un peu mystérieux et ancien souteneur est tué. Cela n'arrange pas les petites affaires de l'ex-tenancière qui voit fuir sa clientèle puisque que Méndez veille. Il se rend vite compte que la clientèle tourne autour de trois hommes, un conducteur de porsche 911, un type au nœud papillon, au regard de mort et Barrerra, un gros toujours vêtu de noir, vicieux et collectionneur de poupées gonflables. Tous des pédophiles... mais Méndez observe... Cela n'empêche pas une autre victime d'être exécutée ce qui oriente l'enquête vers le terrorisme et le péril islamique.
Heureusement, Méndez ne lâche jamais une proie ni une idée. Sa mémoire infaillible, un véritable disque dur, doit autant à son ancienneté dans le métier que dans les fréquentations pas toujours très catholiques qui ont été les siennes, l'aide beaucoup dans sa traque. Il s'ensuit des développements improbables, des aventures parfois sanglantes, bref une parcours labyrinthique qui sied si bien à la littérature policière.
J'ai bien aimé le personnage de Méndez décidément très attachant et son admiration pour la beauté des femmes. Ce récit décliné en chapitres courts et relatés dans un vocabulaire parfois poétique et émouvant mais surtout truculent ne m'a pas laissé indifférent. Il tient le lecteur en haleine jusqu'à la fin et ce roman lui donne l'occasion de formuler des aphorismes bien sentis sur la nature humaine et des réflexions de bons sens sur la marche du monde. Je retiens la traduction qui est pour beaucoup dans l'attachement du lecteur au texte du roman.
Je ne connaissais pas cet écrivain espagnol, son sens de la formule et son admiration inconditionnelle pour les charmes féminins. Il m'a été révélé par hasard (la Feuille Volante n° 436) et je ne regrette pas.
* Écrivain et journaliste espagnol, né à Barcelone en 1927.
©Hervé GAUTIER – Février 2011.http://hervegautier.e-monsite.com
-
L'armée des cendres – José Pablo Feinmann
- Le 04/02/2011
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°501 – Février 2011.
L'armée des cendres – José Pablo Feinmann – Abin Michel.
Traduit de l'espagnol par Hélène Visotsky.
Découvrir un écrivain inconnu à travers un premier livre a toujours quelque chose de fascinant. J'ai donc abordé ce récit avec tout l'attachement que je porte d'ordinaire aux auteurs sud-américains.
Nous sommes en 1828 à Buenos Aires et le lieutenant Julian Quesada vient de tuer en duel le docteur Nicasio Costa, père du lieutenant Juan Ramon Costa. On imagine ce militaire familier de cette « procédure » à cause de son côté hâbleur ou de son attirance pour les femmes. Quesada a en effet tenu des propos diffamants sur l'officier Costa, l'accusant de lâcheté devant l'ennemi. Une telle issue implique que Quesada quitte la ville. On lui confie donc une étrange mission qui consiste à remettre une lettre au Colonel Andrade qui tient garnison dans le sud lointain. Pour cela, il lui faut traverser le désert en compagnie d'un pisteur. Il arrive à destination mais le colonel se révèle être un homme étrange, héros de la guerre d'indépendance au passé militaire glorieux mais aussi un être insaisissable qui, malgré l'importance du pli qui lui est destiné refuse, pendant quelques jours de recevoir le lieutenant.
Finalement, il décide de partir en guerre contre les insoumis, quitte le fort avec un détachement dont fait partie Quesada, poursuit d'une manière étrange un ennemi invisible qui finit quand même par l'attaquer. Est-ce le désert, cette étrange et labyrinthique traque ponctuée d'assassinats ou ses années de luttes émaillées de défaites et d'incarcérations qui dérangent l'esprit du colonel?
Celui-ci agit d'une manière si démente que le lieutenant Quesada le démet de ses fonctions et prend le commandement. Il remettra l'officier supérieur aux instances militaires de la capitale qui l'interneront dans un asile où il va rapidement mourir. Attaché à son chef, Quesada l'enterre dans le désert. Il rencontre le Lieutenant Juan Ramon Costa, retour d'une longue campagne au Brésil qui, apprenant les circonstances de la mort de son père, provoque Quesada en duel. Ce dernier y trouvera une mort qu'il recherchait depuis longtemps. Voilà à peu près la trame de ce roman.
J'avoue que cet ouvrage m'a laissé un peu dubitatif, pas vraiment passionné par l'histoire racontée. Tout au plus la personnalité du colonel-fou m'a-t-elle fait, un moment, penser à Don Donquichotte. Pour le reste, la langue (la traduction) donne à voir des paysages parfois grandioses et c'est peut-être la seule chose que je retiens !
©Hervé GAUTIER – Février 2011.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA LUCIDITÉ – José Saramago
- Le 03/12/2010
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°479– Décembre 2010.
LA LUCIDITÉ – José Saramago *– Le Seuil
« La lucidité est la blessure la plus proche du soleil » disait René Char. Je ne gloserai pas sur cet aphorisme, d'autres le feront sans doute mieux que moi mais selon de dictionnaire, la lucidité évoque la raison saine et claire, la conscience, la clairvoyance...
Selon son habitude, Saramago met en scène une capitale sans nom dans un pays également anonyme et concocte une fable apparemment surréaliste : lors d'une élection municipale, 83% des électeurs ont voté blanc. Il n'y a pas eu d'abstention, c'est à dire que ces mêmes citoyens ont fait leur devoir électoral, mais ce qu'ils ont signifié au pouvoir sort des réponses traditionnelles que les sondages sont censés prévoir. D'ordinaire l'électorat porte la droite au pouvoir face à une gauche inexistante, mais là, la réaction populaire est sans précédent. Il n'est pas imaginable que cela exprime un rejet de la politique en général, qu'elle soit proposée par le parti au pouvoir ou par l'opposition. C'est une forme d'expression qui n'est, de ce fait, pas admissible en démocratie.
Les hommes politiques n'estiment jamais tant le peuple dont ils tiennent leur mandat qu'au moment des campagnes électorales. Elles révèlent leur imagination et excitent leurs facultés de surenchère, mais surtout, ils ne peuvent pas s'imaginer que leur fonction est menacée. La paranoïa ordinaire refait surface et avec elle la théorie bien connue du complot qui prend ici la forme d'une improbable conspiration subversive d'un petit groupe d'anarchistes contre la pensée unique. Le pouvoir politique, loin de s'interroger sur les raisons profondes de cette attitude, ne songe qu'à culpabiliser les électeurs, estimant que ces bulletins n'auraient pour but que d'attenter à la stabilité du régime. Le vote blanc rend le système ingérable, même s'il y a une tentative d'auto-gestion par le peuple. Tout cela aurait contaminé tout le pays et il est urgent d'y mettre un terme.
Les « blanchards » assument pourtant leur option politique avec calme, le peuple s'organise au quotidien mais, à cause de leur posture jugée illégitime par les hommes politiques, ils sont des adversaires tout trouvés contre lesquels la violence va se déchaîner. Cela va donner une intrigue policière où il va falloir trouver des coupables... ou en inventer ! Dans les situations de crise, davantage peut-être que dans le quotidien ordinaire, la faculté humaine de délation trouve son terrain de prédilection. Ici, le sycophante ne peut pas ne pas se manifester et grâce à lui, le pouvoir trouve aisément le responsable de ce vote blanc. Il s'agit d'une femme qui aurait échappé quatre ans plus tôt à une épidémie temporaire de cécité et qui aurait commis un meurtre. Ce fait est regardé comme hautement suspect par les autorités même s'il n'y a évidemment aucun lieu entre les deux événements. Une enquête est quand même diligentée qui doit être menée à son terme. Elle mettra en évidence, non la vérité mais la nécessaire et judéo-chrétienne culpabilisation de l'individu et une conclusion déjà concoctée par les autorités . Dans une ville en état de siège un commissaire de police diligente cependant des investigations réglementaires où Courteline donne la main à Kafka, sans pour autant se faire beaucoup d'illusions sur le sens de sa mission. L'épilogue sera celui d'un véritable roman policier.
Je n'oublie pas non plus que Saramago a été membre du parti communiste portugais, a milité dans les rangs des altermondialistes et n'a pas caché sa sympathie pour les Palestiniens contre Israël. Il a même été tenté par une carrière politique en se présentant aux élections européennes en 2009. Faut-il voir dans ce roman le prolongement de ses réflexions personnelles ou une critique ironique des démocraties occidentales. C'est un roman subversif comme les aime Saramago. L'auteur, sous couvert d'une fiction un peu surréaliste met en évidence les travers de l'espèce humaine qui est bien moins humaniste qu'on veut bien le dire. Il lui permet de pointer du doigt la fragilitéde la démocratie qui est toujours mise en avant et regardée comme une avancée face aux dictatures. Selon Churchill, elle est « la pire forme de gouvernement , sauf tous les autres qui ont été essayées ». Il est donc parfaitement possible de l'instrumentaliser. Est-ce la reconnaissance implicite d'un rejet populaire des partis politiques traditionnels ou la mise en évidence de l'absurde d'une situation, le peu de cas qui est fait du citoyen face à la raison d'état ?
Saramago quitte ici son rôle purement littéraire pour revêtir l'habit du militant, pour donner aux citoyens du monde l'occasion d'inviter le pouvoir à redessiner autrement le paysage politique, de prendre en compte ce qui et un véritable « suffrage exprimé », loin des partis politiques traditionnels, même s'il ne correspond pas à ce qu'on s'attend à voir sortir des urnes. Conclut-il à un échec programmé de toutes les subversions, même les plus constructives ? Pense-t-il que l'appareil politique reste le plus fort face à l'individu ou que le « pré carré » des politiques doit resté ce qu'il est ?
Je continue d'être enthousiasmé, malgré des pratiques rédactionnelles originales et des digressions parfois un peu longues et difficiles à suivre, par l'œuvre de Saramago dont cette revue s'est largement fait l'écho (La Feuille Volante n° 475 – 476 - 478)
*José Saramago (1922-2010] – Prix Nobel de littérature 1998.
-
L'AUTRE COMME MOI – José Saramago–
- Le 02/12/2010
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°478– Décembre 2010.
L'AUTRE COMME MOI – José Saramago– Le Seuil
Nous avons tous un sosie, dit-on. Tertuliano Maximo Alfonso, la quarantaine, divorcé solitaire, un peu dépressif, professeur d'histoire découvrira le sien par hasard en louant , sur le conseil d'un collègue de travail, une cassette dont le nom seul est tout un programme « Qui cherche trouve ». Le nom de cet homme lui est jusque là inconnu : Daniel Santa-Clara, un obscur acteur de cinéma dont la vraie identité est Antonio Claro. Il est son double parfait. Revenu de sa surprise il va chercher à en savoir davantage à son sujet. Il découvre que 5 ans auparavant, lui-même Tertuliano ressemblait trait pour trait à Antonio. Dès lors, il se met à explorer toute la filmographie où son double apparaît. Ses recherches laborieuses finissent cependant par aboutir et les deux hommes conviennent d'une rencontre. Découvrir son alter-ego exact est toujours un choc. Tertuliano n'y échappe pas. Alors, fantaisie de la nature, occasion de se poser des questions sur sa propre vie, son propre parcours, celle de l'autre... Notre professeur va bousculer les habitudes de sa vie bien rangée, bien morne, jusqu'à mettre à convaincre Maria da Paz, la femme avec qui il a une liaison en pointillés, de se livrer à des canulars téléphoniques et postales ou user de postiches pour tenter d'espionner celui qui reste pour lui à la fois un mystère et une invitation permanent à en savoir plus à son propos. Cette quête se révèle absurde et inutile et il découvre un personnage aussi falot que lui, acteur de seconde zone, sans grande envergure et sans grand talent, juste un coureur de cachets, vivant comme lui, mais un peu différemment.
Comme toujours on omet quelque chose dans les rapports entre les humains, leurs passions, leurs folies aussi et tout n'est pas aussi simple [« L'âme humaine est une boîte d'où peut toujours sortir un clown grimaçant qui nous tire la langue, mais parfois ce même clown se borne à nous regarder par-dessus le bord de la boîte et s'il voit que nous agissons selon ce qui est juste et honnête, il nous adresse un signe d'approbation avec la tête et il disparaît se disant que nous ne sommes pas un cas entièrement désespéré »] . Est-ce parce que Antonio est un séducteur-né où que son métier d'acteur le pousse naturellement vers les passades? Ce dernier, quand il apprend cette gémellité, se croit obligé de séduire Maria, la compagne de Tetuliano. Celui-ci, partagé entre sa volonté d'éprouver son amie et de pousser au bout cette expérience, finit par accepter la proposition d'Antonio, et ce d'autant qu'il va, lui aussi et à cette occasion, partager une nuit avec Héléna, la femme légitime d'Antonio. Les deux protagonistes soignent le mimétisme jusque dans les moindres détails pour arriver à leurs fins. Pour Antonio, c'est le simple plaisir de séduire une femme, mais pour Tertuliano c'est plutôt l'occasion de sortir de son quotidien, de mettre un peu de sel dans sa vie intime, de remettre en question un amour qu'il met en doute, de pousser jusqu'à l'absurde un jeu un peu ridicule. Las, le hasard s'en mêle, la petite enclouure à laquelle on n'avait pas pensé vient tout remettre en question, la Camarde entre en scène comme une punition d'avoir ainsi voulu brouiller les cartes, comme pour signifier que cela ne peut durer ainsi bien longtemps ! Alors, sanction voulue par l'auteur pour punir les auteurs de ce qui aurait pu rester une bonne blague ou manifestation d'une forme de justice immanente pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi ?
Comme à chaque fois, j'ai apprécié l'effet labyrinthique, l'humour subtil et le suspense qui caractérisent le style de Samarago. La manipulation des phrases et des dialogues, la pratique de l'incise, l'emploi anachronique des majuscules, la syntaxe parfois chaotique qui constituent sa singularité sont quand même un peu déroutantes à la longue et ce qui peut passer pour une originalité littéraire finit par lasser. Je regrette, malgré l'intérêt du thème traité, les nombreuses longueurs et digressions dont l'auteur est friand d'autant que le lecteur doit attendre les dernières lignes pour découvrir l'épilogue. L'idée du double et son application littéraire au pseudonyme, les variations sur une personnalité autre que la sienne, la face cachée de soi-même, le principe de l'altérité et les questionnements et les fantasmes qu'elle entraîne inévitablement donnent lieu à des développements passionnants. La perte de la certitude de l'unicité que peut avoir chaque être est angoissant face à la prise de conscience que que la société moderne est constituée d'êtres de plus en plus semblables, de plis en plus standardisés. L'étude des passions et des travers humains est habillement menée et jusqu'à la dernière ligne le lecteur se demande encore qui est qui.
J'avais déjà été intéressé par la découverte de cet auteur [« Tous les noms » et « Les intermittences de la mort » -La Feuille volante n° 475 et 476] . Malgré une première approche un peu difficile de ce roman, je n'ai pas été déçu.
-
LES INTERMITTENCES DE LA MORT – José Saramago
- Le 24/11/2010
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°476– Novembre 2010.
LES INTERMITTENCES DE LA MORT – José Saramago *[1922-2010]– Le Seuil.
Dès la première ligne le ton est donné « Le lendemain personne ne mourut ».
C'est que dans ce pays imaginaire, la mort n'existe plus. Certes le temps n'est pas aboli, la jeunesse n'est pas éternelle et les gens vieillissent, les accidents se produisent et la maladie sévit toujours mais la mort n'intervient pas, transformant la vie en une gigantesque agonie. « Depuis le début de l'an neuf, plus précisément depuis zéro heure de ce mois de janvier pas un seul décès n'avait été enregistré dans l'ensemble du pays ».
L'auteur s'attaque à sa manière au grand tabou de nos société occidentales : la mort. Elle est certes inévitable, fait partie de la condition humaine, mais nous vivons comme si elle n'existait pas et ce vieux rêve de l'homme, l'immortalité, prend ici corps dans une longue et douloureuse vieillesse. La société est complètement désorganisée, les vieux ne meurent plus comme avant, les hôpitaux sont surchargés, les pompes funèbres et les société d'assurances ruinées, l'État désemparé et au bord de la faillite, le société dans son ensemble complètement perturbée (ne parlons pas du financement des retraites !), l'Église dépossédée de son fonds de commerce. En effet, la mort ayant disparu, plus de résurrection, plus de morale, plus de menaces surréalistes avec la sanction de l'enfer ou de promesse du paradis. C'en est fini des fantasmes judéo-chrétiens... Quant à l'idée même de Dieu, il vaut mieux ne pas l'évoquer ! L'homme ne peut plus basculer dans le néant ni s'offrir à lui-même son propre trépas comme une délivrance. On ne peut même plus se servir des accidents pour faire peur aux imprudents... Reste la souffrance aussi implacable que la peur de mourir, comme une punition ! C'est un peu comme si le premier jour de cette nouvelle année introduisait une nouvelle façon de vivre puisque la vie devenait, à partir de ce moment, définitive. Il y a de quoi s'alarmer face à cette Camarde qui ne remplit plus son macabre office alors que les animaux eux, continuent de mourir et qu'à l'extérieur des frontières de ce fabuleux pays on continue normalement de payer son tribut à Thanatos ! Y aurait-il deux poids et deux mesures dans ce grand chambardement ?
Alors face à cela, les philosophes se mirent à philosopher, les religieux à organiser des prières pour que les choses reviennent un ordre plus classique et les habitants des régions frontalières à transporter leurs mourants de l'autre côté de la frontière, là où le monde ressemblait encore à quelque chose. C'est là qu'entre en jeu la « maphia »(avec « ph » pour la différencier de l'autre) qui va organiser, avec l'aval du pouvoir, un peu mieux ces choses qui ne vont décidément plus. Pourtant, cela n'est pas sans poser quelques problèmes diplomatiques, militaires, enfin des difficultés humaines avec leur lot d'exagérations de volonté de tirer partie d'une situation nouvelle et lucrative...
Heureusement, après une année de grève, la Grande faucheuse décide de reprendre du service ce qui bouleverse un peu les toutes nouvelles habitudes prises. Pire, elle éprouve le besoin d'avertir chacun de son décès par lettre personnelle de couleur violette (y a-t-i une symbolique dans cette couleur qui n'est pas le noir ?). Las l'une d'elle, adressée à un violoncelliste solitaire, revient, refusée par son destinataire, et ce trois fois de suite !
Avec un certain humour, il croque cet homme dans son quotidien, fait allusion à cet échec surréaliste de la mort, évoque l'improbable dialogue de la Camarde avec sa faux à qui elle confie ses doutes, ses hésitation face à ce cas de résistance, déplore le retour par trois fois (y a-t-il là une symbolique ?) de ces missives macabres et annonciatrices qui peuvent parfaitement figurer l'ultime combat du malade face à sa fin ?
Avec son habituel sens de la dérision, il évoque Dieu autant que « l'instant fatal » nécessairement solitaire, va jusqu'à parler directement avec la mort, la tutoyer comme si elle lui était devenue familière, la tourner en dérision avec gourmandise, lui faire abandonner son triste linceul pour lui prêter les traits d'une jolie femme élégamment vêtue [à l'inverse de Proust qui la voyait comme une grosse femme habillée de noir], la réintègre dans ce pays imaginaire allant à la rencontre du fameux violoncelliste qui refuse de mourir, filant à l'envi son interminable fable...
Saramago s'en donne à cœur joie dans cette cour ou le Père Ubu mène la danse. Dans sont style goguenard habituel, parfois difficile à lire et déroutant dans la construction de ses phrases et son habitude de se jouer des majuscules, l'auteur pratique les digressions pour le moins fantaisistes et philosophiques. Quelle sera l'épilogue de cette fable? Quel rôle joue véritablement l'auteur ? L'écriture est-elle, comme souvent, un exorcisme ? Est-ce pour lui une façon de se moquer de la mort ou de s'y préparer ?[roman paru en 2005 - Disparition de l'auteur en 2010 après une longue maladie ]. L'auteur nourrit-il par ce roman le fantasme inhérent à la condition humaine qu'est l'immortalité ? Veut-il rappeler à son lecteur que, même mort, un écrivain continue d'exister à travers ses livres ? Autant d'interrogations...
J'ai retrouvé avec plaisir cet auteur qui traite d'une manière originale mais aussi sérieuse les problèmes de l'humanité, promène son lecteur attentif et curieux de l'épilogue dans un univers décalé qui lui fait voir autrement les choses... même si ce n'est pas vrai, mais c'est l'apanage des romanciers que de redessiner le monde avec des mots !
* Prix Nobel de littérature 1998.
-
TOUS LES NOMS – José Saramago
- Le 19/11/2010
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°475– Novembre 2010.
TOUS LES NOMS – José Saramago *– Le Seuil.
Cela commence plutôt bien puisque l'auteur, non sans un certain humour, caractérise la division hiérarchique du travail « Les préposé aux écritures doivent trimer sans répit du matin jusqu'au soir, tandis que les officiers d'administration travaillent de temps en temps, les sous-chefs de loin en loin seulement, et le conservateur presque jamais ... Imaginer le chef du Conservatoire en train de faire des heures supplémentaires équivalait à peu près à imaginer la quadrature du cercle ».
Celui dont il va être question est M. José, fonctionnaire du plus bas grade, employé au Conservatoire général de l'État Civil dont le rôle est de répertorier les vivants et les morts. Or ce monsieur n'a rien d'extraordinaire : la cinquantaine, célibataire solitaire, sans enfant, et pour occuper le peu de temps que lui laisse sa tâche de subalterne, il va se mettre à collectionner des articles de presse sur les cent personnalités les plus importantes du pays. Un jour, par hasard, il tombe sur le dossier d'une femme de trente six ans, divorcée, professeur de mathématiques et, sans qu'il y ait à cela la moindre explication va s'intéresser à elle. Lui, le petit fonctionnaire modèle, ponctuel, zélé et servile, qui n'a jamais enfreint le moindre article du règlement interne, qui a toujours mené à bien sa tâche sans jamais faillir, va, pour la retrouver, bouleverser ses habitudes, prendre des risques inconsidérés, détricoter la vie de son sujet, se livrer au détournement de quelques imprimés administratifs, falsifier des autorisations et même enfreindre la loi pour atteindre le but surréaliste qu'il s'est fixé. Et cela sans la moindre raison ... Las, sa quête sera vaine puisque la femme inconnue est morte mais il aura, à cette occasion réussi à être un autre homme au moins pendant ces quelques semaines pendant lesquelles il a voulu s'abstraire de cette condition de petit scribouillard courtelinesque aussi transparent que sont abstraites les identités que son emploi l'amène à gérer. Deviendra-t-il amoureux de cette femme désormais définitivement absente ? Il ira même jusqu'à consigner tout cela par écrit dans une sorte de journal intime, peut-être pour garder la mémoire de ce qui a été l'unique action importante de sa pauvre vie.
Dans un style délibérément ironique, jubilatoire, luxuriant, malgré des phrases un peu longues et une mise en page qui rend parfois la lecture un peu délicate, l'auteur fait partager à son lecteur les rebondissements qui vont bouleverser le quotidien de ce vieux garçon pendant quelques temps, montrant tout à la fois les absurdités de cette administration kafkaïenne qui ne permet pas à un subalterne de prendre la moindre initiative, si petite soit elle, sans en référer à son supérieur, où la moindre réclamation prend des proportions monstrueuses, où les discours des chefs sont de minables péroraisons, et met en évidence la personnalité de ce pauvre homme. Son travail est toute sa vie, et il l'accomplit avec dévouement et abnégation sans s'apercevoir qu'il l'abrutit complètement. Pourtant, lui le vulgaire gratte-papier qui n'existe presque pas, va bénéficier d'une sorte de complicité inattendue du conservateur ! Ce dernier, inaccessible et protégé par des pratiques hiérarchiques d'un autre âge, va s'intéresser à lui, ne le considérant plus comme un être « taillable et corvéable à merci », respectant soudain sa personnalité.
Alors, roman à énigme baroque qui moque ce pauvre homme enfermé dans une administration déshumanisée et tentaculaire qui finirait peut-être par le broyer malgré cette tentative de donner un sens à sa vie, ou image en creux de chacun d'entre nous, coincé dans cette société du quotidien qui ignore l'homme et ne cherche qu'à l'avilir ? Elles ne sont pas si forcées que cela les évocations de ce monde du travail que la hiérarchie tronçonne et que les coutumes en usage dans dans ce bureau empreintent à la pratique de la délation et de suspicion entre collègues et de la flagornerie avec l'autorité. Est-ce que cette tentative de vouloir sortir de sa condition a donné à la hiérarchie l'occasion de s'intéresser à un agent qui a soudain voulu faire autre chose que son travail ? Que signifie ce coup de folie de ce petit employé couleur muraille qui choisi par hasard de mener des investigations aussi inutiles que l'est son travail au quotidien ? Qui est ce « monsieur José » (cette civilité lui donne quand même une certaine originalité dans ce récit) qui étrangement est le seul parmi les protagonistes pourtant importants de ce roman à porter réellement un nom (Je ne peux pas ne pas remarquer que l'auteur lui-même se prénomme ainsi, ce qui renvoie immanquablement au personnage de Joseph K du « Procès » de Franz Kafka, lui aussi poursuivi par l'absurde !) ? Que signifie ce berger facétieux qui, à la fin du roman s'amuse à mêler dans ce cimetière les pierres tombales ? L'auteur veut-il insister sur l'inutilité d'un travail improductif et impersonnel pourtant imposé par une hiérarchie aveugle et grisée par son pouvoir ? S'agit-il de dénoncer l'ambiance oppressante de ce bureau ? Que signifie cette attention du conservateur à son égard, paternalisme ou réelle complicité ?
L'auteur s'attache son lecteur tout au long du roman. Nous convie-t-il, sous couvert d'une fable, à nous interroger sur le concept même de l'identité, sur la solitude de l'existence, la place de chacun dans cette société, l'importance de son travail, le néant de la mort, la vanités des choses humaines, le destin ou la volonté d'exister que chacun d'entre nous possède en lui? A quoi sert un écrivain ? Probablement à être le miroir du monde dans lequel il vit, à renvoyer à son lecteur une image bien réelle de son univers quotidien ... et ce n'est peut-être pas là la moindre de ses qualités.
A chacun d'apporter sa réponse.
* Prix Nobel de littérature 1998.
-
LE JEU DE L'ANGE – Carlos Ruiz Zafón
- Le 18/11/2010
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°474– Novembre 2010
LE JEU DE L'ANGE – Carlos Ruiz Zafón – Éditions Robert Laffont.
[Traduit de l'espagnol par François Maspero]
Dès l'abord, l'auteur entre dans dans la problématique d'où va découler tout ce roman « Un écrivain n'oublie jamais le moment où, pour la première fois, il a accepté un peu d'argent ou quelques éloges en échange d'une histoire ». On pourrait penser qu'il allait y être question d'écriture mais aussi de la difficulté d'un auteur, de ses relations jubilatoires mais parfois difficiles avec l'écriture elle-même et aussi avec les éditeurs ! C'était déjà une perspective intéressante.
Dans ce texte l'auteur reste fidèle aux années 20 et à Barcelone qui, encore une fois est le décor où va se dérouler cette action au cours de laquelle David Martín, fils d'un vétéran de la guerre qui n'aimait pas les livres, travaille dès son plus jeune âge dans un journal,« La voix de l'industrie », mais comme simple manutentionnaire. A la suite d'une défection, il est amené, grâce à Pedro Vidal, un riche citoyen, chroniqueur d'occasion dans ce journal et auteur besogneux sans grand talent, à écrire une série de textes qui révèlent ses dons d'écrivain. Tout semble aller bien pour lui puisque, pour la première fois de sa vie il est payé pour écrire, et que le succès est au rendez-vous ! Rapidement il va être pris dans une spirale où il va devoir « produire » des feuilletons sous un pseudonyme et non plus créer comme il l'aurait souhaité, et ce en étant exploité par un éditeur sans scrupule. Le rythme qui lui est imposé l'épuise de sorte qu'il doit renoncer d'autant qu'il est licencié de ce journal.
Pourtant il tente d'écrire son propre roman mais, boudé par la critique c'est un échec, et, dans le même temps, il en écrit un pour Vidal qui le signe et qui est un succès. Il est désespéré, d'autant plus que la jeune fille, Cristina, qu'il aime en secret et pour qui il avait écrit son propre roman va épouser Vidal dont elle était la secrétaire.
Quand il a quitté le bouge où il habitait, il a élu domicile dans une villa, « la maison de la tour », qui avait appartenu à Diego Marlasca, cet avocat qui avait quitté son cabinet florissant pour se consacrer à l'écriture et venir y vivre avec sa maîtresse, l'énigmatique Irène Sabino. L'immeuble aussi labyrinthique que mystérieux, est fermé depuis 20 ans et dit-on, porte malheur.
Son ami, le libraire Sempere amène David au « Cimetière des livres » où il va déposer son œuvre malheureuse et un éditeur parisien Andréas Corelli, personnage par ailleurs assez secret, lui propose sans raisons apparentes et moyennant une petite fortune, d'écrire une sorte de Bible, un livre qui serait fondateur d'une religion basée sur un messie vengeur. A dater de ce jour, une sorte de mécanique mortelle se met en place autour de lui, faisant passer de vie à trépas ses amis et même Cristina qui pourtant ne l'avait pas oublié. Un peu comme si, en acceptant ce contrat avec Corelli, il s'était coupé lui-même de l'inspiration, avait sacrifié sa liberté d'écrivain, avait peut-être vendu son âme au diable?
Quand il reçoit une correspondance de Corelli, la lettre est toujours scellée et l'empreinte dans la cire représente un ange aux ailes déployées qui est son emblème. D'ailleurs, chacune de leurs rencontres, toujours dans des lieux improbables, est placée sous le signe de l'ange. Sa symbolique peut aussi bien s'attacher à l'annonciation qu'à l'apocalypse ou à Lucifer! Le titre du roman trouvera ici son explication et il appartiendra au lecteur d'en percer le mystère.
C'est une histoire contée avec brio, imagination parfois délirante, humour et poésie et que j'ai pris plaisir à lire malgré quelques longueurs et parfois des digressions, un roman à énigme (je préfère ce terme à celui de roman policier) qui tient vraiment le lecteur en haleine jusqu'à la fin. L'auteur reste fidèle à son univers, celui des livres[« Un livre a une âme, l'âme de celui qui l'a écrit, l'âme de ceux qui l'ont lu, ont vécu et ont rêvé avec lui »], des maisons mystérieuses, des personnages qui apparaissent et disparaissent ensuite, des morts suspectes et parfois violentes, des flics pour le moins méprisables... Il y a aussi un rapport aux parents [la mère de David l'a abandonné, son père ne s'est guère occupé de lui à cause de sa vie désordonnée et de sa mort prématurée et par erreur], aux amours contrariées [les rapports d'Isabella et de David sont bizarres, comme ceux d'Isabella et de Sempere junior, cette fable de la petite fille, à la fois avatar et fantôme de Cristina], au feu [il y a toujours un incendie de livre dans un entrepôt d'éditeur et Marlasca meurt non pas noyé mais brûlé vif ], et cette référence à la saga des Sempere et de leur librairie...
Pour autant, est-ce le fruit de mon expérience personnelle au regard de l'écriture, j'ai fait de cet ouvrage une lecture particulière. Je me suis attaché aux différentes tentatives avortées voire impossibles de certains personnages autour de l'écriture [ Isabella, Vidal, Marlasca, David Martín lui-même qui connaît aussi bien le succès que des déboires dans ce domaine, sa difficulté à écrire le livre commandé par Corelli et finalement son destin, les hésitations, des recherches et les doutes dont il parle « L'un des principaux expédients propres à l'écrivain professionnel qu'Isabella a appris de moi était l'art et la pratique de la procrastination »..], le rapport de l'écriture à l'argent [la somme importante proposée par Corelli vient probablement de la fortune de Marlasca dérobée par un ami de sa maîtresse, mais rien n'est sûr... C'est un peu comme si l'écriture de David allait racheter ce vol et ce d'autant plus qu'il s'agit d'un livre religieux]. Je préfère privilégier le rôle d'exorcisme de l'écriture. Je ne connais pas Carlos Ruiz Zafón , mais j'imagine assez bien un être torturé qui trouve dans l'écriture un exutoire bienvenu et salutaire. C'est généralement le cas de beaucoup d'écrivains authentiques.
J'ai apprécié la lecture de ce livre à cause du style fluide, captivant et agréable à lire malgré la longueur de l'ouvrage (536 pages). Ce texte écrit à la première personne m'a quand même laissé un peu perplexe pour ne pas dire déçu, à cause peut-être des répétitions de scènes déjà évoquées dans son premier roman [ Décor de la libraire Sempere, du « cimetière des livres oubliés » -Incendie constaté dans un entrepôt de livres, victimes gravement brûlées - il y aurait sans doute une explication dans cette permanence du feu – Omniprésence de la police aux méthodes inquisitoriales, violentes et parfois illégales ...] et de la fin qui m'a surpris. J'avais encore en mémoire « L'ombre du vent » qui m'avait enthousiasmé. La Feuille Volante n°470) ! Pourtant les nombreuses références à ce roman, autant par son côté mystérieux, énigmatique donnent plutôt une unité à l'œuvre.
© Hervé GAUTIER – Novembre 2010.http://hervegautier.e-monsite.com
-
L'ombre du vent - Carlos Ruiz Zafón
- Le 01/11/2010
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°470– Novembre 2010.
L'ombre du vent – Carlos Ruiz Zafón - Grasset.
(traduit de l'espagnol par François Maspero)
Le décor : Barcelone, ville mythique que la période de l'après-guerre civile rend plus énigmatique encore, le quotidien difficile pour le père de Daniel Sempere, le narrateur, garçon de onze ans au début du récit que son père, modeste libraire emmène dans un lieu mystérieux du quartier gothique : « le cimetière des livres oubliés ». L'enfant qui pense toujours à sa mère morte quelques années plus tôt est convié à un étrange rituel transmis de génération en génération. Il doit « adopter » un livre parmi des millions et son choix se porte sur « l'ombre du vent », un roman de Juliàn Carax, auteur parfaitement inconnu. Il le saura plus tard, ce volume est le seul survivant d'une édition qui a été détruite en grande partie par le feu. La possession de ce livre, que chacun souhaite lui racheter, va transformer sa vie. Il ne le sait pas encore mais cet épisode va le conduire dans une histoire rocambolesque où il va être amené à pénétrer les secrets de gens dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Il va devenir le complice et même l'instrument d'une intrigue sans vraiment comprendre le rôle qu'il y joue. Son histoire, à travers destiné, amitiés, hasard, trahison, villa mystérieuse, se confondant avec celle de Juliàn Carax faisant de ce récit plus qu'une traditionnelle mise en abyme.
Qui était donc ce Carax, obscur auteur barcelonais qui a vécu à Paris au début de XX° siècle et qui jouait du piano dans un bordel de Pigalle ? Il s'appelait aussi Fortuny, était le fils d'un chapelier qui prétendait le contraire et d'une mère pianiste. Il serait mort à Barcelone en 1936 au tout début de la guerre civile, mais rien n'est sûr puisque le mystère qui a toujours fait partie de sa vie, enveloppe aussi sa mort. Les rares romans qu'il a publiés en France ont été un fiasco. Il se révèle être un personnage énigmatique autant que ce qui entoure la publication de ses livres, un individu étrange, qui vit dans le souvenir d'une femme inaccessible qu'il a aimée mais qu'il a perdue : Pénélope Aldaya. Entre eux c'est une histoire d'amour passionnée, de rendez-vous manqués, de projets contrariés, de fausses pistes, de courriers interceptés et finalement de séparation définitive.
Pourtant, dans sa quête d'informations à propos de Carax, Daniel est poursuivi par un homme assez étrange au visage défiguré par le feu, ce qui le fait assimiler au diable, Lian Courbet, qui souhaite lui racheter son livre et qui ressemble à s'y méprendre à un personnage de ce roman. Entre fiction et réalité, il finira peut-être par rejoindre les chapitres de cette histoire ? Je n'aurais garde d'oublier l'inspecteur Fumero, individu méprisable, flic de la pire espèce que la guerre civile et la franquisme qui la suivit permirent de révéler sa véritable personnalité, celle d'un traitre et d'un assassin. Il s'ensuit une sorte de course où la vie se mêle à la mort et au terme de laquelle Daniel se débarrasse de ce livre pour mieux le retrouver.
C'est pour le lecteur l'occasion de visiter cette ville extraordinaire chargée d'histoire, à la fois port ouvert sur le monde, berceau de la liberté et de la création artistique. Il découvre également une étonnante galerie de portraits dont Fermín Romero de Torres, ex-clochard, ex-agent secret, qui se distingue surtout par des aphorismes bien sentis, par une érudition immense et précise, une grande connaissance des femmes, une grande aptitude à se tirer des situations les plus étranges, une misanthropie militante en générale et un anti-franquisme en particulier. Le père de Daniel est lui plus philosophe et désireux de survivre dans cette ville hantée par la police, les indicateurs et les traitres de tout poil. C'est aussi pour Daniel, à travers une histoire mouvementée, une sorte de voyage initiatique à la découverte de l'amour mais aussi de la condition humaine, de ses grandeurs comme de ses travers, la rencontre d'hommes mais surtout de femmes pleines de charme, de mystère et parfois aussi d'érotisme, Nuria Montfort, Beatrice Aguilar, Pénélope Aldaya, Clara Barcelo, Bernarda...
C'est un roman labyrinthique, comme je les aime, entre personnages mystérieux et maison hantée, amours romantiques et destinés fatales, énigmatique aussi, où le suspense le dispute à une saga pleine de rebondissements. Le texte bien écrit, agréable à lire, avec des moments d'humour sertis dans des phrases finement ciselées et poétiques où le lecteur, tenu en haleine jusqu'à la fin, se perd avec plaisir.
Dans ce récit, Ruiz Zafon évoque un personnage qui, parlant d'un roman Carax, indique qu' un lecteur qui le découvrait pour la première fois avait cette irrésistible envie de lire le reste de son œuvre. C'est étonnant, mais il s'est passé la même chose pour moi et ce livre, lu presque d'un trait malgré une longueur peu commune (525 pages), ce qui d'ordinaire est en ce qui me concerne rédhibitoire, m'a passionné jusqu'à la dernière ligne. Il ne fait pas de doute que je vais continuer la lecture de cet auteur.
©Hervé GAUTIER – Novembre 2010.http://hervegautier.e-monsite.com
-
Lituma dans les Andes – Mario Vargas Llosa
- Le 22/10/2010
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°466 - Octobre 2010
Lituma dans les Andes – Mario Vargas Llosa*
(traduit de l'espagnol par Albert Bensoussan)
Lituma est un simple brigadier. En compagnie de son adjoint, le truculent garde civil Tomasino Carreňo, ce gradé grelotte de froid dans ce coin des Andes, lui, l'homme du littoral, mais peut-être bien aussi de trouille puisque les terroristes du Sentier Lumineux rodent et que les disparitions mystérieuses se multiplient comme celle de ce couple de touristes français qui se rendait à Cuzco en autocar ou celle de Mme d'Harcourt, cette scientifique écologiste. Ils exécutent les policiers, les cadres des mines ainsi que les étrangers et enrôlent de force les mineurs ou les « peones » dans leur milice. Les meurtres qu'ils perpétuent tiennent davantage du sacrifice humain rituel que de l'assassinat politique au nom du peuple qu'ils disent défendre. Cela procède probablement du mystère du Pérou qui est assez bien résumé par la remarque d'un personnage américain de ce roman :« C'est un pays que personne ne peut comprendre, fit Scarlatine en riant, et rien n'est plus attirant que l'indéchiffrable, pour des gens qui viennent de pays aussi clairs et transparent que le mien ».
Ces deux militaires sont contraints de cohabiter dans ce poste de police perdu dans la montagne au-dessus de Naccos. C'est une pauvre bourgade entre la « puna » de la Cordillère et la « selva » des basses terres, une ancienne ville minière où la seule distraction pour les « peones » qui construisent une route qui ne sera jamais terminée et le bar où ils se soulent avec une grande régularité. Il est tenu par un couple énigmatique et un peu louche, Dionisio, tenancier bachique et sa femme Ariana, sorcière au passé un peu flou, au présent plus que douteux aussi, à la fois sorcière et habile intrigante. Leurs prénoms à eux seuls évoquent des personnages antiques, Dionysos et Ariane dont ils sont par certains côtés la réincarnation. Ils sont les véritables maîtres de Naccos ! Ils ont ensemble une histoire compliquée que le narrateur de cette histoire rocambolesque livre peu à peu au lecteur.
Lituma devra donc devoir résoudre un de ces meurtres qui s'est produit dans sa juridiction, mais, cette fois, celui-là a été perpétré par les « peones » et non par les terroristes, sur la personne de Pedrito Tinoco, un pauvre muet, sorte d'idiot du village qui leur rendait de menus services au poste. Sa tâche ne sera pas facile parce qu'il doit enquêter sur fond de violence quotidienne, mais aussi dans la crainte des milices terroristes qui peuvent intervenir à tout instant et anéantir ces deux militaires, sans ignorer les croyances populaires héritées des Incas, les rites magiques d'un autre âge pleins de charlatanismes et de superstitions, la présence des « amarus », les « apus » esprits des montagnes qui inspirent à chacun la crainte et surtout les « pishtacos », sorte de personnages mystérieux mais apparemment bien réels qui vident ceux qu'ils rencontrent de leur substance, de leur graisse et dont les victimes finissent par mourir. Les tremblements de terre et autres catastrophes naturelles leur sont systématiquement attribué. Lituma échappera à l'une d'elles, par l'entremise probable de ces divinités, faisant de lui un homme que cette montagne accepte comme l'un des siens !
Et tout cela dans le contexte d'une histoire d'amour passionnée et un peu compliquée entre Mercedes qui fut jadis vendue comme une vulgaire marchandise et Tomasino. Après moult péripéties, elle reviendra vers lui, faisant le choix de cet homme que tout cependant éloignait d'elle. Lutima, de son côté, a avec les femmes, des relations qui tiennent du fantasmes et de l'éternelle attente, comme une recherche de la compagne idéale ! Il verra son avenir professionnel prendre un tour enfin favorable.
Ce roman un peu policier se déroule dans le décor grandiose, dépaysant et dépouillé de cette Cordillère mystérieuse et envoutante.
Ce n'est pas le premier roman de Llosa que je lis. J'avais déjà apprécié « L'éloge de la marâtre » (la Feuille Volante n° 279) qui se situe pourtant dans un tout autre registre. Comme souvent chez les écrivains sud-américains, j'ai retrouvé cet art du conteur que j'attends toujours de la part d'un romancier.
*Prix Nobel de littérature 2010].
© Hervé GAUTIER – Octobre 2010.http://hervegautier.e-monsite.com
-
L'ELOGE DE LA MARATRE – Mario VARGAS LLOSA
- Le 20/10/2010
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°279 – Août 2007
L'ELOGE DE LA MARATRE – Mario VARGAS LLOSA - Gallimard Editeur.
Loin du registre qui a fait sa notoriété, l'auteur explore un univers familial particulier, celui, vu à la fois avec les yeux d'adultes et ceux d'un enfant, d'une femme, non seulement épouse mais aussi maîtresse, en ce qu'elle est la complice active des jeux de l'amour, mais surtout la belle-mère. Cette dernière emprunte son lien de parenté au mariage, c'est à dire qu'elle apparaît un peu par hasard dans la vie de gens qui n'ont rien fait pour la connaître. Elle est souvent l'intruse, le mauvais côté de l'image de la femme. Ici, il s'agit de la marâtre, terme un peu péjoratif qui désigne la deuxième femme du père, souvent plus jeune que lui, à la suite de cette détestable habitude qu'ont les hommes d'épouser, surtout en secondes noces, des femmes-enfants! Ils puisent en elles leur vitalité retrouvée, la volonté de combattre les affres de la vieillesse qui vient et parfois l'échec de leur premier mariage. Elle est porteuse de symboles mais aussi de promesses qu'elle ne doit pas décevoir. Pour l'enfant, dit « du premier lit »elle remplace la mère disparue ou partie, sans pour autant prendre sa place, bien au contraire. Il l'accueille souvent mal et s'engage entre eux un combat fait de subtils attaques ou d'affrontements violents peut-être parce que le complexe d'œdipe s'habille ici d'autres apparences, que chacun marque son territoire et tient à ses prérogatives parfois durement acquises...
Mais le titre nous indique qu'il s'agit d'un éloge et donc que vont être battues en brèche les idées reçues que le sujet génère. Il s'agit d'une mise en perspective d'un trio, le père, Don Rigoberto, jouisseur-esthète et fort amoureux de Lucrecia, sa deuxième épouse, marâtre de son fils Alfonso. On pourrait croire qu'il va s'agir du théâtre d'une lutte entre ces trois personnages. D'ailleurs, l'auteur sollicite à la fois la culture et l'attention de son lecteur, par l'évocation qu'il fait de tableaux aussi différents que ceux de Jacob Jordeans, du Titien, de Fra Angélico ou de Fernando de Szyszlo. Les époques et les écoles s'y mélangent, comme le figuratif et l'abstrait. Vargas Llossa y livre sa lecture de ces œuvres où se retrouve toujours un trio, et, en filigranes, une histoire d'amour. Cet amour est à la fois chaste et jouisseur, emprunt de retenue ou de licence, humain et divin. Le corps de la femme y est alternativement montré et caché, mais aussi joliment évoqué avec des mots choisis. Un troisième personnage vient souvent s'immiscer dans le tableau, soit qu'il y est déjà et parle, soit qu'il en est le commentateur extérieur qui, à la manière du chœur antique traduit pour le lecteur-témoin les pensées de la femme ou se charge de débroussailler le subtils écheveau de ses désirs secrets oscillant entre lubricité et vertu parce qu' ainsi va la vie et que le plaisir procède de ces deux facettes.
En même temps, la femme, prétexte aux désirs masculins est présentée alternativement comme objet mais aussi comme sujet de l'action amoureuse, à la fois passive et active. L'auteur nous rappelle, à travers ces fables écrotico-esthétiques, en réalité de longs poèmes, que l'amour n'est pas un acte bestial, voué à la seule procréation ou a l'assouvissement d'instincts animaux, la démarche, et ce qu'il en résulte est au contraire toute en nuances, faite de prolégomènes et de soins des apparences sans lesquels la séduction spontanée paraît impossible. En filigrane, je souhaite voir l'image de la mort, pendant de celle de l'amour et qui en est parfois la conséquence comme l'est paradoxalement la vie avec tous les fantasmes inhérents aux relations ambiguës hommes-femmes, mais aussi enfants-adultes.
Je choisis de voir dans ce texte, non un éloge comme l'indique le titre mais une vengeance subtilement accomplie du beau-fils qui amène habillement sa marâtre à se compromettre et grâce à un écrit anodin, sorte de mise en abyme du livre de Vargas Llosa, à dénoncer l'adultère, à amener son père à se séparer de cette épouse infidèle ainsi démasquée, à le forcer peut-être à rester fidèle à son ancienne épouse, même si, pour cela, il doit perdre sa joie de vivre retrouvée et pénéter de plain-pied dans la mort. C'est probablement une manière de retrouver son père et peut-être aussi de le détruire, tant les relations entre les humains sont complexes, faites d'amour et de haine, de luttes et d'apaisements, de sincérité et de mensonge.
© Hervé GAUTIER - Août 2007.
-
Cinq heures avec Mario – Miguel Delibes
- Le 08/10/2010
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°462 - Octobre 2010
Cinq heures avec Mario – Miguel Delibes – Éditions de la découvertes.
Mario Diez Collado, petit intellectuel de province et fervent humaniste, opposant au franquisme, intègre et désintéressé, vient de succomber à un infarctus à l'age de 49 ans. Carmen, sa veuve, procède à sa toilette funéraire, le veille, fait face à la traditionnelle mais douloureuse cérémonie des condoléances. A cette occasion incontournable, elle entend tous les truismes qu'on exprime d'ordinaire en pareilles circonstances. C'est un salmigondis d'hypocrisies, de regrets sincères, entre voyeurisme, désir de consolation, volonté de paraître fort et envie de se laisser aller. Une véritable épreuve!
Quand tout ceci est terminé, Carmen s'installe aux côtés de Mario, en compagnie d'un exemplaire de sa Bible dont il a souligné certains passages et entreprend de régler ses comptes avec lui. Dès lors, tout ce qu'elle ne lui a pas dit de son vivant revient, entre refus d'acheter une voiture et écriture cachée de poèmes qui lui étaient destinés, son parcours un peu difficile d'écrivain incompris, son refus de s'installer confortablement dans une vie bourgeoise... Tout y passe et à travers les reproches que lui adresse, à la première personne, cette femme profondément catholique et à la mentalité de petit bourgeois, le lecteur découvre son véritable portait. C'est une dévote, engluée dans les valeurs de l'Espagne traditionnelle, puritaine et rigide, frustrée d'avoir été toute sa vie cantonnée aux tâches familiales et d'avoir dû vivre dans l'ombre de son mari. De même, à travers ses propos pleins de rancœurs et parfois de fantasmes, entre amour et mépris, apparaît la véritable figure de son époux, petit professeur idéaliste, dénué d'ambition mais épris de justice.
A travers les propos acerbes et parfois mesquins de la jeune veuve on devine le gouffre qui séparaient les deux époux qui ne se ressemblaient pas. On sent que ses aveux couvaient depuis si longtemps qu'ils ne pouvaient pas ne pas être exprimés avant qu'on ne l'ensevelisse et ce d'autant qu'ils sont exprimés avec la Bible pour témoin. Il fallait qu'il soit présent physiquement pour qu'elle lui exprime une dernière fois tout ce qu'elle avait sur le cœur, tout ce que sa vie avait creusé en elle de désillusions et de remords dont il était, bien entendu, responsable. Au cours de cette nuit qui pour Mario annonce celle de l'ensevelissement, elle sent venir vers elle la solitude et le désespoir du veuvage qu'un traditionalisme exacerbé empêchera une nouvelle union avec un autre homme. Elle chérit peut-être encore cet époux mort, mais pendant les quelques heures de cette nuit qui précédera les obsèques elle refait à l'envers le parcours de ce couple dont la vie était vouée à l'échec mais un échec accepté, avec, malgré les apparences sa solitude, ses incompréhensions, les refuges de chacun pour échapper au quotidien. Peut-on dire que ce long monologue devant un mort est apaisant? Peut-être?
Alors, portait d'une société espagnole engluée dans le franquisme, peut-être, celui d'une facette de la condition humaine sans doute aussi, et assurément la remise en cause de cette idée reçue que le mariage réunit deux êtres faits l'un pour l'autre. Ce livre écrit en 1966 est plein du traumatisme de la Guerre Civile qui déchira le pays et de la dictature qui suivit autant que que le désamour qui présida à la vie de ces deux êtres que tout opposait et pour lequel le divorce et l'adultère étaient impossible. C'est une sorte de roman d'amour à l'envers à travers ce monologue caricatural, une tentative de dépasser par l'écriture les dérives d'une société figée dans le conservatisme et l'immobilisme.
© Hervé GAUTIER – Octobre 2010.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE CONTRAT AVEC DIEU - Juan Gómez-Jurado
- Le 06/08/2010
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°441– Août 2010
LE CONTRAT AVEC DIEU – Juan Gómez-Jurado. Éditions Plon.
(Traduit de l'espagnol par Pierre Gautier)
Cela paraît un peu confus au début, l'histoire d'un médecin nazi tortionnaire dans un camp de concentration qui a échappé au tribunal
grâce à des complicités, un prêtre Anthony Fowler, à la fois agent double de la CIA et du Vatican. Et puis cette histoire d'expédition secrète, officiellement sous couvert d'exploiter des phosphates dans une région où, d'évidence il n'y en a pas! Elle est baptisée « Moïse », financée par Raymond Kayn, un milliardaire américain agoraphobe à la vie déchirée, et dirigée par un vieil archéologue juif spécialiste de la Bible et de ses messages abscons, Cecyl Forrester, jusque dans les sables du désert de Jordanie avec le projet un peu surréaliste de retrouver l'Arche d'Alliance contenant les « Tables de la Loi » qui y serait enterrée, preuve matérielle de l'existence d'un contrat passé en Dieu et les hommes... C'est que, en 70 après JC, le temple de Jérusalem fut rasé et les Juifs, pour sauvegarder leur relation privilégiée avec Yahweh transportèrent cette Arche jusque dans le désert de Jordanie où ils l'enterrèrent. Le but de cette expédition est donc de la retrouver, mais le temps presse et le secret est de rigueur! Après tout pourquoi pas, l'idée, quoique déjà émise est plutôt bonne, surtout quand on est en pleine fiction?
Pour découvrir l'endroit exact, on fera appel au deuxième fragment des rouleaux de Qumran caché à l'intérieur d'une bougie qu'une famille juive a conservé de génération en génération sans en connaître la véritable importance !
C'est que différents personnages gravitent autour de cette histoire: Le père Fowler sera embarqué, un peu contre son gré dans cette aventure qui ne laisse pas le Vatican indifférent tout comme Jacob Russel, assistant exclusif de Kayn qui est le seul habilité à faire le lien entre lui et le monde extérieur, Andrea Otero, journaliste espagnole récemment licenciée d'El Globo dont les aventures un peu rocambolesques, entre scorpions et tentatives de meurtre sur sa personne, annoncent la disparitions violentes de nombreux protagonistes ainsi que différents attentats contre cette entreprise, Morgen Dekker, chef de la sécurité de l'expédition qui cite constamment Schopenhauer, le père Albert, ex-délinquant et génie de l'informatique qui lui aussi est au service du Vatican...
Pour que le récit gagne en intensité l'auteur y introduit un épisode de la Deuxième guerre mondiale qui met en scène le médecin nazi du début et ses expériences inutiles et cruelles sur les enfants des camps, une explication rationnelle de l'Arche loin de son contexte religieux, le Mossad israélien et un groupe islamique terroriste qui veut faire échouer cette expédition.
Tout au long du récit le suspense est entretenu par des chapitres brefs, apparemment sans lien entre eux au début, déclinés sous la forme d'un journal de bord avec dates et heures, agrémenté de références précises bien documentées, d'épisodes qui se déroulent à Washington et en Jordanie et de dessins qui rappellent les gravures qui illustraient des romans de Jules Vernes de mon enfance...
Je dois dire qu'au départ, j'ai eu un peu de mal à entrer dans ce scénario et j'ai été tenté de refermer le livre, mais la curiosité a été la plus forte. Même si le texte ne se signale pas par une recherche littéraire avérée mais privilégie un style simple, parfois émaillé d'humour, je retiendrai la relation palpitante qui tient jusqu'à la fin le lecteur en haleine. Ce récit qui mêle habilement fiction, réalité, politique et ésotérisme remet en question bien des personnages dont le portrait a été savamment brossé par l'auteur à travers leur histoire personnelle.
Gómez-Jurado invite son lecteur, à la fin, à méditer un poème de Sam Keen qui introduit ce roman. C'est peut-être là le véritable message de ce livre à la fois émouvant et excitant. Je lui ai donné une dimension religieuse, malgré le Cinquième Commandement mais j'y vois aussi une invitation à regarder son prochain autrement, une véritable leçon sur la condition humaine!
Le hasard qui avait guidé mon choix de lecture, le titre, la 4° de couverture, le secret qui entoure cette affaire un peu ténébreuse, les références bibliques qui évidemment excitent l'imaginaire humain, cette histoire d'alliance improbable entre Dieu et les hommes, ce contexte politico-religieux qui implique le Vatican mais aussi des groupes islamiques fondamentalistes et qui ne sont pas sans ajouter au mystère et nourrir les fantasmes, m'avaient un peu mis en appétit. Je me suis laissé happé par ce roman d'aventures et contrairement à ma première impression, je n'ai pas été déçu.
©Hervé GAUTIER – Août 2010.http://hervegautier.e-monsite.com
-
UN ROMAN DE QUARTIER - Francisco González LEDESMA
- Le 07/07/2010
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°436– Juillet 2010
UN ROMAN DE QUARTIER – Francisco González LEDESMA – Éditions L'Atalante.
Traduit de l'espagnol par Christophe Josse.
Je voudrais bien le rencontrer ce Mendez, un inspecteur de police à deux doigts de la retraite, choisi par son commissaire pour élucider une affaire un peu ténébreuse au seul motif qu'il dispose de temps libre.
L'affaire, justement, est une vengeance. Dans les années 1970, lors d'un hold-up, un garçon de trois ans est tué par erreur et, de nos jours, à Barcelone, un des deux braqueurs est assassiné dans un vieil immeuble promis à la démolition. Craignant le subir le même sort que son complice, le truand survivant va tenter de supprimer celui qu'il prend pour le vengeur, c'est à dire le père de l'enfant : David Miralles. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est le combat intime de cet homme désespéré qui exorcise comme il peut la mort prématurée de son fils au point de lui réinventer une vie au quotidien, une forme différente de vengeance... Il se trouve que ce Miralles, garde du corps de son état et donc titulaire d'un port d'arme, n'est pas, selon le rapport de balistique, le responsable de cette exécution. Mendez le sait, mais pas le tueur et la course-poursuite qui va être menée passe par la fréquentation d'un avocat bizarre et la consultation de petites annonces coquines, d'autres rencontres insolites...
Il y a bien d'autres histoires dans ce récit, celle des relations qu'entretient Miralles avec une ancienne prostituée devenue son assistante, Eva, celle de cette vieille maquerelle barcelonaise, Ruth, devenue marquise et des rapports difficiles qu'elle entretient avec une de ses anciennes pensionnaires, Mabel, qui maintenant est chargée de s'occuper d'elle. Dans cette cohabitation difficile où la mort rode à chaque instant, le règlement de compte le dispute à la méchanceté et même au sadisme.
Ce que je retiens surtout c'est le cadre, cette ville catalane dont le seul nom fait rêver parce qu'il est associé à la Guerre Civile espagnole, à la contestation permanente, à une certaine idée de la liberté, au combat pour la vie, parce que là plus qu'ailleurs un art créatif s'y est développé et que dans ces quartiers chauds existe un certain art de vivre qu'on ne rencontre sans doute qu'ici! C'est le véritable personnage de ce roman. C'est l'occasion pour l'auteur d'exprimer la nostalgie d'un temps où les bourgeois venaient au Barrio Chino pour boire un verre ou s'encanailler avec des filles... La spéculation immobilière a eu peu à peu raison des bars, des bordels et des ruelles qui faisaient le charme de cette ville. Ces quartiers que connait bien notre inspecteur sont en train de mourir comme le suscite la 4° de couverture...
C'est aussi une peinture de la société barcelonaise faite de violence mais aussi des portraits de femmes dont l'auteur est l'admirateur inconditionnel qui luttent avec dignité dans un monde cruel.
Ce qui me plait bien, c'est surtout ce personnage de Ricardo Mendez, fonctionnaire de police un peu marginal, légèrement alcoolique et désabusé par la vie, qui fait son métier d'une manière efficace mais parfois discutable, un homme un peu frustre qui n'a pas vraiment le sens des convenances. Le style administratif et règlementaire de ses rapports, sa vie dans des pensions minables, ses déjeuners dans des bouibouis à la limite de l'insalubrité, son mépris pour l'avancement et pour sa hiérarchie retiennent mon attention et mon intérêt. Ses investigations ont cette particularité d'être pour le moins bizarres et originales, mais cela marche. On y rencontre d'anciennes putes, des proxénètes sur le retour, de vielles maquerelles rangées qui égrènent leurs souvenirs, ou d'autres êtres cabossés par la vie, bref toute une société interlope qui va si bien à ce quartier... Cet être familier des livres autant que de l'alcool bon marché (« Mendez vida son orujo du terroir, qui avait certainement voyagé à dos d'homme depuis la Galice en suivant la route des églises romanes ») , méprisé des femmes autant que de ses supérieurs[« Je ne suis qu'un chat de gouttière, admit Mendez, il n'est pas inutile de me le rappeler de temps en temps. »], aime sa ville et ce quartier où il a grandi et qu'il ne quitte pratiquement jamais, même s'il est promis à la démolition, ces rues qui sont sa véritable école... Sa qualité de policier se caractérise davantage par l'indépendance et la justice que par la soumission à la procédure, à la hiérarchie ou au plan de carrière, mais peut lui chaut. Il est « un vieux serpent » et avoue lui-même que sa « vie est toujours un désastre absolu » .
J'ai apprécié aussi le suspense, ce texte humoristique, le style alerte, un peu gouailleur et aussi ce sens de la formule [« Dans ce monde mécanisé, il ne reste que deux gâteries faites exclusivement à la main : le havane et la branlette »]qui sied si bien au roman noir autant qu'à son héros, le climat de ce récit où on rencontre que modérément ce qui peuple ordinairement, et à toutes les pages, les œuvres de ce registre : le sexe, la violence et le sang.
Cette première lecture favorisée par le hasard m'engage à en connaître davantage.
Et puis c'est vrai que je voudrais bien le rencontrer ce Mendez, et tant pis s'il est un personnage fictif comme tous les héros de romans, mais quand même, il me plaît bien!!
© Hervé GAUTIER – Juillet 2010.http://hervegautier.e-monsite.com
-
AMOUR, PROZAC ET AUTRES CURIOSITÉS - Lucía Etxebarría
- Le 11/06/2010
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°433– Juin 2010
AMOUR, PROZAC ET AUTRES CURIOSITÉS – Lucía Etxebarría - Denoël.
(traduit de l'espagnol par Marianne Millon)
La découverte d'un auteur inconnu est toujours un moment fort pour moi et quand celui-ci est espagnol, mon appétit de lire en est augmenté. J'ai donc pris ce roman, un peu au hasard d'autant que la 4° de couverture était plutôt engageante. A l'en croire, le public de la péninsule l'avait accueilli comme « le roman d'une génération ».
Au vrai, cela commençait plutôt bien, je veux dire sur le ton de l'humour qui nous fait supporter bien des choses dans notre pauvre vie. D'abord Cristina, 24 ans, serveuse après avoir travaillé quelques temps dans un bureau, elle est un peu le vilain petit canard de cette famille Gaena... Elle n'arrive pas à se remettre d'avoir été larguée par son petit copain irlandais.. Quand, pour compenser ce manque, elle ne s'envoie pas en l'air avec des amants de passage, elle se met à songer à son enfance où s'entremêlent les regrets d'être une fille, une religiosité surréaliste, la fuite du père, ses débuts difficiles dans le monde du travail, et à ses autres sœurs auxquelles elle ne parle presque plus. Son problème principal semble être son taux de testostérone qui, par ailleurs justifie, pense-t-elle, sa propension à s'envoyer en l'air. Rosa, 30 ans, distante, froide, rationnelle, condescendante, suffisante, cadre supérieur consciente de ses responsabilités, de ses compétences, elle a réussi dans un monde d'hommes. Pourtant elle est seule dans son bel appartement, dans sa puissante voiture, avec ses tailleurs à la mode! Elle a perdu sa virginité comme on passe un examen... par nécessité! Ana, 32 ans. Elle a tout ce qu'une mère de famille et maîtresse de maison sérieuse, maniérée, bourgeoise peut désirer, un mari beau et brillant, un enfant adorable, une maison, une domestique... mais elle est fatiguée de vivre au quotidien parmi les marques de lessives et n'a même plus la force de faire le ménage ou de ranger ses placards. Elle sait tout de l'orgasme... mais par ouï-dire seulement et a dû la perte de sa virginité à un quasi-viol. Autant dire que la roulette de la génétique les a faites complètement différentes au physique comme au moral, mais leur mère ne voit rien de la détresse de ses filles!
Pourtant, elles ont en commun une sorte de mal de vivre que chacune combat à sa manière puisqu'elles dépriment tant qu'elle le peuvent: Cristina carbure à l'ecstasy, à l'alcool, on peut dire qu'elle est aussi un peu nymphomane (« j'ai besoin d'une queue entre les jambes » avoue-t-elle), Rosa a jeté son dévolu sur le Prozac et autres anxiolytiques, quant à Anna, ce sont les somnifères qu'elle affectionne... chacune sa panacée dans ce monde déshumanisé!
Dans ces « paradis artificiels », il me semble qu'il est surtout question d'amour, ou plus exactement de sexe. Pour Cristina, c'est un usage abusif et obsessionnel, peut-être à cause de la fuite du père, peut-être aussi parce qu'elle passe son temps à vouloir être aimée par des gens qui ne font même pas attention à elle (thème connu), pour Rosa c'est plutôt une absence cruelle tandis que pour Anna, ce serait plutôt la routine... avec des regrets et des remords.
Dans une sorte de catalogue alphabétique, l'auteur nous décline toute les facettes du mal-être commun à ces trois sœurs ainsi que leur parcours, leurs expériences, leurs apprentissages . Elle y parle d'un univers qui est aussi le nôtre, pourquoi pas! L'auteur le fait sur le ton de l'humour et dans un style volontiers enlevé qui s'attache le lecteur, plus attentif sans doute à l'anecdote qu'à la détresse que peu à peu elle instille dans sa description. C'est pourtant vers la fin que ce récit est carrément émouvant. Jusque là, la narratrice s'était surtout appesantie sur le cas de Cristina, mais sur un mode léger. Dans les dernières pages elle rappelle tout le désarroi de cette «jeune fille de bonne famille recyclée», en perpétuelle recherche d'un amour impossible, qui a 16 ans a fait une tentative de suicide et qui maintenant glisse vers l'héroïne. Le discours humoristique du début cède la place à l'horreur quand elle évoque l'épreuve de la seringue, la douleur de l'injection et la mort par overdose de son copain Santiago. A ce moment Cristina prend une autre dimension, elle goûte soudain « la chance d'être encore en vie. C'est un immense cadeau », mais n'a plus personne à qui se raccrocher et sûrement pas à sa mère que la vie a meurtri elle aussi, mais d'une autre manière et qui a toujours été absente.
Elle prend alors une résolution « Tant que je serai là, j'irai de l'avant », rappelle que la femme n'est pas comme la Bible le prétend sous la dépendance de l'homme, mais puise dans la Kabbale des exemples de femmes fortes ( Déborah, Athalie, Judith, Betsabée, Esther...) qui elles aussi ont su faire face... Alors, le message des bonnes sœurs qui a perturbé son enfance, il valait mieux l'oublier! Elle choisit de retenir l'exemple de Lilith, femme créée , selon la tradition rabbinique avant Ève et faite d'un peu de boue. Elle est l'égal d'Adam et sa compagne et non sous sa dépendance. Quant à ses sœurs, elles ont, elles aussi, décidé de réagir, Ana demande le divorce(et finira sans doute par l'obtenir) sans donner de raison et se voit internée dans un asile d'aliénés, Rosa s'accepte enfin comme elle est, à cause peut-être d'une chanson obsédante qu'elle entend au téléphone et qui lui rappelle son enfance. Bref, ces trois sœurs se retrouvent autour de la déchéance de l'une d'entre elles, se reparlent même si elles choisissent de rejeter leur mère. Une sorte de happy-end en quelque sorte, un message d'espoir dans cette société qui peu à peu a perdu tous ses repères!
C'est vrai qu'au départ, j'ai lu ce livre avec les yeux d'un lecteur que l'humour amusait un peu malgré un style oral et sans véritable recherche littéraire. J'ai même connu une certaine lassitude mais j'ai poursuivi jusqu'au bout, partagé entre la curiosité et la volonté d'en finir pour pouvoir en parler et me dire que j'avais au moins lu un ouvrage de cet auteur. J'ai été ému à la fin et je n'ai pas regretté ma persévérance en me disant que sans cela je serais sans doute passé à côté de quelque chose et que cela aurait été dommage.
Alors, roman d'une génération, sûrement! Sous couvert d'un certain humour, c'est en réalité une photographie sans fard de notre société, avec ses travers, ses dérives, un espoir... Peut-être?
© Hervé GAUTIER – Juin 2010.http://hervegautier.e-monsite.com
-
L'HÔTE - Guadaluppe Nettel
- Le 06/06/2010
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°395– Février 2010.
L'HÔTE – Guadaluppe Nettel – Actes Sud.
Ana est habitée par une « Chose » qui fait partie d'elle depuis l'enfance. Elle vit avec elle, ou plus exactement est en elle depuis toujours, elle ne la voit pas mais elle la sent et celle-ci se sert d'elle, s'en nourrit presque, jusqu'à à en devenir insupportable. La chose grandissait en effet en elle « comme une chrysalide »;
Durant l'enfance, elle a été sa compagne-complice ce qui meubla la solitude de la fillette. Seul son frère, Diego, échappait à son emprise, mais plus tard ses réactions furent inattendues, dévastatrices au point de s'attaquer à ce frère lui-même... et l'anéantir, le vider de sa propre substance! C'est à tout le moins l'explication qu'Ana donna à la mort prématurée de son frère, associant le sang de ses premières règles à celui qui accompagnait la mort de Diego. Parfois la chose alternait entre accalmie et violence, parfois se manifestait sous la forme d'une petite voix mais avant la mort de ce frère aimé, il semble que la « chose » a laissé sur son bras une sorte de cicatrice qui évoque le braille. Alors, message codé ou annonce de mauvaise augure, rite cabalistique ou volonté de voir un mystère à déchiffrer? Ce fut pour elle l'occasion d'entrer dans le monde des aveugles, pourquoi pas en devenant lectrice dans un institut pour non-voyants? Ce serait une façon bien originale et sûrement efficace pour Ana de se débarrasser de cette « chose » qui devenait de plus en plus un parasite, de l'exorciser en quelque sorte par une sorte de transfert, comme si l'hépatite dont elle souffrit un temps lui aurait permis de partager sa souffrance avec cet « hôte » encombrant?
Pourtant, à force d'explorer le monde souterrain des aveugles, de les fréquenter jusque dans leur quotidien, à la fois dans cet établissement qui l'emploie mais surtout dans un monde interlope fait de rencontres improbables, de mendicité, de handicap et de vie cachée dans le métro mexicain, véritable cloaque où pourtant elle finit par se mouvoir presque naturellement, elle finit par décrypter le message sur le bras de son frère!
Alors, manifestation d'un dédoublement de personnalité dont nous souffrons tous sans bien nous en rendre compte, peur intrinsèque à l'enfance de voir disparaître des êtres que nous aimons face à l'inconscience des adultes qui préfèrent transformer la mort en tabou, habitude prise dès les premières années de vivre avec autre chose qui fait que les adultes, et parfois nous-mêmes, craignons pour notre santé mentale, volonté de se recréer un monde différent de celui dans lequel nous vivons, sentiment de culpabilité ou désir de voir dans autre chose le responsable de ses propres malheurs, phobie irraisonnée de cette enfance qui pourtant s'en va, mythomanie dévorante qui confine parfois à la folie, itinéraire intime qui consiste à se libérer définitivement d'une obsession? Qui sait!
J'avoue que j'ai lu ce livre avec une certaine circonspection, partagé entre intérêt et curiosité... Je suis peut-être passé à côté de quelque chose, mais cet ouvrage, malgré les éloges que j'ai pu en lire par ailleurs m'a laissé une impression bizarre, non par le sujet traité qui me parlerait peut-être, mais par la manière de l'aborder, entre fiction et réalité.
-
GABRIEL GARCIA MÁRQUES - UNE VIE- Gérald Martin
- Le 28/05/2010
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°428– Mai 2010
GABRIEL GARCĺA MÁRQUES – UNE VIE- Gérald Martin -Grasset.
Cette chronique qui s'est si souvent fait l'écho des romans de García Márques ne pouvait rester muette à la sortie d'un livre sur sa biographie. C'est cependant un quasi-paradoxe d'écrire la biographie d'un auteur dont l'œuvre est toute entière inspirée par sa propre vie autant d'ailleurs que par la réalité qui l'entoure.
Né en Colombie en 1927,(et non pas en 1917 comme on peut le lire dès la 1° ligne de l'avant-propos, mais cette coquille n'entache en rien le travail de cet universitaire britannique qui met en perspective la vie de l'auteur et son œuvre ), il est l'ainé de onze enfants et porte l'espoir de toute sa famille. Prix Nobel de littérature en 1982, homme de gauche engagé, volontiers défenseur des grandes causes, il est le plus connu, le plus populaire et le plus emblématique romancier du continent sud américain et chacun des grands de ce monde recherche son amitié. Sa généalogie labyrinthique, largement évoquée dans « Cent ans de solitude »(son livre le plus important) et dans toute son œuvre, irrigue son écriture tout comme son enfance dont gardera une durable nostalgie. Elle se déroule sur fond de guerre civile, de troubles sociaux, de corruption politique, de filiation illégitime, de bouleversements familiaux... Il sera fortement marqué par son grand-père maternel, le colonel Nicolas Ricardo Márques Mejila, sa grand-mère Tranquilina, ses parents, une mère effacée et un père volage et aventurier et son village d'enfance, Aracataca devenu Macondo ...
Le petit Gabito entame un chemin difficile avec en contre-point la maladie, des études parfois laborieuses, ses premiers émois amoureux, une ascension sociale nécessaire, un éveil à l'étude de la littérature, la manifestation d'un talent précoce, des aventures sentimentales souvent épiques... Gabriel se révèle cependant angoissé, hypersensible, hypocondriaque, bref kafkaïen...
Son père, avec qui il s'entendait assez mal, estimait que la littérature était une chose mineure, son fils fera donc du droit pour être avocat mais n'oubliera jamais son penchant pour l'écriture. Il poursuivra cependant ses études, mais avec une grande irrégularité et un grand amateurisme et l'assassinat de l'avocat libéral Gaitan sera pour lui révélateur. Il choisira de prendre ses distances avec le droit, et de gagner sa vie dans le journalisme. Il est à l'époque un garçon maigre timide et désargenté et affirme une vocation déjà connue d'écrivain mais aussi un engagement politique dans un contexte de luttes partisanes faites de violence et de corruption. Ses articles, notamment sur le glissement de terrain de Médellin et sur le naufrage d'un destroyer de la marine colombienne le mettent en position de délicatesse avec le pouvoir politique et c'est le départ pour l'Europe, vécu comme un exil volontaire et professionnel. A Rome, Paris, en Allemagne de l'Est, à Cuba, à New-York, à Mexico où il fut reporter et critique de film avec plus ou moins de bonheur, il connut des difficultés d'écriture mais surtout financières. Il devient « Gabo » et lui qui au départ ne gagnait pas sa vie même comme journaliste va crouler sous les honneurs et la reconnaissance, la fortune avec la consécration littéraire.
Ses romans sont certes inspirés par sa vie, par son enfance, mais il mêle toujours à la fiction, l'histoire, les superstitions, les tabous et le folklore de son pays et de tout le continent sud-américain. Il ne manque jamais de dénoncer les inégalité sociales et de prendre parti pour les plus démunis ce qui fait de son œuvre non seulement un extraordinaire moment de lecture mais aussi le plaidoyer social d'un grand témoin de son temps. Son écriture flamboyante, son humour, son imagination débordante et cet extraordinaire talent de conteur et de narrateur révèlent l'âme de la Colombie. C'est véritablement son pays qui a fait de lui l'auteur que nous connaissons. Pourtant, il a fini par prendre ses distances avec lui!
C'est donc un destin d'écrivain qui est présenté ici mais aussi l'illustration d'un paradoxe: comment concilier une vie littéraire, politique et personnelle avec tant de notoriété? C'est que, avec le temps, il s'est largement impliqué dans la politique, est devenu thuriféraire des gouvernants qui avaient sa sympathie, jusqu'à être sans doute dépassé par cet engagement. Mais cet homme au « réalisme magique » cache cependant un sentiment de solitude qui irriguera sans aucun doute son écriture, tout comme l'amour et le sexe d'ailleurs! A ce propos, malgré cette société dont il fait évidemment partie où les hommes ont volontiers des relations avec les prostituées ou des aventures avec des femmes mariées, il ne cessera, malgré sa vie privée mouvementée, de penser à Mercedes, pourtant plus jeune que lui, qu'il a demandée en mariage quand elle avait 9 ans, et qu'il épousera!
Il est maintenant un vieil homme luttant contre la maladie qui devient de plus en plus amnésique, un paradoxe de plus pour un écrivain qui a fait de la mémoire le thème central de son œuvre. Même s'il attend la mort, se perd un peu dans son propre labyrinthe, il a déjà l'acquit l'immortalité.
C'est, sous un titre sobre, un travail monumental, qui n'est cependant pas une hagiographie, et qui est présenté pédagogiquement sous une forme chronologique par son biographe « officiel ». C'est aussi une bonne idée d'avoir enrichi le livre de cartes de géographie, d'arbres généalogiques et de notes.
Je ne peux que saluer la sortie de ce livre, fruit de dix-sept années de travail assidu et constant, une version cependant courte selon Martin (Ce livre comporte plus de 650 pages avec les notes alors que l'autre, « longue », sera publiée plus tard en compte 2000!), qui nous montre un être à plusieurs faces, à la fois narcissique et tourmenté, mystérieux et parfois empêtré dans ses contradictions, à l'occasion flagorneur et manipulateur, mais conscient de sa notoriété... L'auteur fait un analyse pertinente de l'œuvre de Márques et replace sa vie dans le contexte des événements politiques auxquels il n'est pas resté indifférent.
Mais, prenons garde, Márques a avoué à son biographe, sans doute en guise d'avertissement, « Tout le monde a trois vies, une vie publique, une vie privée et une vie secrète! ». Cet ouvrage nous aide un peu à comprendre cette dernière!
C'est en tout cas un hommage majeur à un homme et à un écrivain exceptionnel.
-
ET MAINTENANT DANSEZ - Andrés BARBA
- Le 14/03/2010
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°403 – Mars 2010
ET MAINTENANT DANSEZ – Andrés BARBA – Bourgois Éditeur.
Les personnages tout d'abord. Inès la mère qui autrefois a été belle, Pablo, le mari, ancien employé de Chemins de Fer espagnols dont l'emploi était toute sa vie. Il voue une affection attachante à son épouse qui n'est pourtant plus que l'ombre d'elle-même, Santiago, le fils préféré, qui a de plus en plus honte de ses parents mais qui prend conscience qu'il est incapable d'aimer une autre femme que sa mère, Barbara, la fille, 40 ans, qui a souffert d'être un peu mise à l'écart et qui s'aperçoit que sa vie d'épouse et de mère de famille devient de jour en jour plus morne. Elle se découvre des penchants homosexuels pour Eléna, son employée de maison. Il y a aussi Béatriz, la petite sœur anormale, morte à trois mois. Personne ne parvient vraiment à faire le deuil de ce fantôme.
Inés, mère jadis sévère et un peu bigote, à presque soixante dix ans, perd la tête et s'enfonce de jour en jour dans les affres de la vieillesse et de la sénilité. Elle perd de plus en plus la mémoire, oublie jusqu'aux prénoms de ses proches, agit d'une manière désordonnée dans les gestes les plus quotidiens, perd jusqu'au sens du langage. Pablo prend conscience que sa femme est condamnée, se révèle maladroit, coupé de la réalité depuis son départ en retraite, et paradoxalement, dépendant de sa femme. Chacun, à cette occasion, se remet en question, s'interroge sur lui-même, sur son avenir, sous l'ombre tutélaire d'Ines qui n'est déjà plus là mais qui reste étonnamment présente, même si chacun pense à sa mort prochaine... Il en résulte une ambiance angoissante.
Ce roman sans grands dialogues, sans beaucoup de descriptions non plus, offre le ton assez pathétique des monologues intérieurs (sauf celui d'Inès qui n'existe pas). C'est aussi une série un peu délétère de portraits juxtaposés, avec seulement entre eux des liens artificiels. Je ne suis pas bien d'accord avec la quatrième de couverture qui annonce un texte « sans pitié ni misérabilisme ». Je serais plutôt de l'avis contraire (Les évocations d'Inés et de sa maladie sont affligeantes, les réflexions de Pablo sont un mélange de craintes, de fausse complicité et de navrante subordination, il y a une sorte de diabolisation de la beauté féminine, de la nudité, du plaisir sexuel, une volonté de transformer tout cela en tabou, l'impression un peu bizarre que chacun d'eux n'est pour l'autre qu'un étranger ).
Il me paraît que ce roman un peu lugubre donne à voir des personnages malgré tout un peu lisses, sans grand relief et incrustés dans le quotidien. Il marque un bouleversement réel des choses, une tentative peut-être manquée de briser des interdits et de formuler des non-dits, une peinture sans concession d'êtres face à leurs contradictions, une sorte de lente agonie d'un foyer jadis stable qui maintenant part à vau l'eau, une évocation de l'impossibilité pour les enfants, Barbara et Santiago, de s'unir à leur tour sous l'égide de l'amour, la consécration de la solitude. C'est un roman de la défaite face à la vie, l'image un peu délétère de la vieillesse, de la mort annoncée et de la triste condition humaine.
Ces quatre mouvements me paraissent peu convaincants et je ne suis pas bien sûr de vouloir poursuivre la lecture de l'œuvre de ce jeune auteur.
© Hervé GAUTIER – Mars 2010.
-
LE SYNDROME D'ULYSSE - Santiago GAMBOA
- Le 26/02/2010
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°400– Février 2010.
LE SYNDROME D'ULYSSE – Santiago GAMBOA - Métailié.
J'ai, avec la lecture des relations bizarres et quand je choisis un livre, c'est parfois à cause de sa notoriété, parce qu'il faut l'avoir lu pour pouvoir en parler[c'est un peu l'objet de cette chronique], mais souvent, c'est le hasard qui guide mon choix. Il fait bien ou mal les choses, c'est selon!
Pourquoi ai-je choisi ce roman? A cause de James Joyce, peut-être ou de mon chat qui porte le même nom que le héros grec à cause de l'habitude que nous avons prise de baptiser nos animaux de compagnie de noms dont le première lettre varie en fonction de l'année? Ou peut-être de l'attirance irraisonnée que le ressens toujours pour les auteurs hispaniques? Allez savoir!
L'histoire m'a pourtant paru, au début un peu fastidieuse, mais je ne sais pas pourquoi, je m'y suis accroché. Cela ne m'intéressait pourtant pas beaucoup d'en savoir davantage sur cet Esteban, jeune colombien venu à Paris dans l'espoir d'étudier en Sorbonne et celui un peu plus fou de devenir écrivain. Comme c'était prévisible, lui qui ne rêvait que de salons littéraires et de prix prestigieux, n'a connu que la pluie, le froid, la promiscuité... et la plonge dans un restaurant parisien!
Je n'avais pas non plus de réelles sympathies pour ce marocain qui lui aussi nourrissait des fantasmes de réussites universitaires françaises mais son parcours s'est révélé le même! Suivent d'autres rencontres avec des Sud-américains, des Roumains, qui livrent tous, à la première personne, une récit proche de l'oralité fait de solitude et de désarroi, comme celle de Jung, le Coréen, réfugié et travailleur précaire, des aventures avec des femmes plus ou moins prostituées aussi. Cela m'a semblé être comme une succession de récits reliés artificiellement entre eux, souhaitant sans doute nous rappeler la dure condition des travailleurs émigrés. Je ne dis pas que ce n'est pas émouvant et une piqure de rappel ne fait jamais de mal surtout dans un pays qui proclame bien haut ses valeurs humanistes et républicaines, mais ne respecte même pas ses propres citoyens nationaux. Mais quand même! C'est d'autant moins original que le récit dévie rapidement vers l'homosexualité et vers des évocations érotiques voire pornographiques, sans doute pour être dans un contexte plus actuel, vers la drogue et l'alcool aussi, sans oublier de remuer des poncifs un peu usés.
Pour faire intellectuel, l'auteur note constamment des références culturelles, ce que je n'ai, personnellement, pas trouvé très convaincant.
J'ai cherché ce qu'est réellement le syndrome d'Ulysse, peut-être pour m'expliquer le titre de ce roman dont je suivais les méandres avec difficultés. Il s'agit de retracer le parcours d'un individu qui, sans être sujet à des pressions psychologiques, peut se trouver capter par un autre ou un groupe d'autres au point qu'il en perde tout sens critique et qu'il soit même incapable de se remettre lui-même en cause. C'est aussi le stress ressenti par un émigré qui arrive dans un pays étranger et le ressent comme hostile. Loin de moi de vouloir minimiser un tel message, mais je suis vite lassé, même si ce récit suscite une grande solitude et se termine par le suicide. Quant à l'écriture, présentée comme une libération dans ce contexte difficile, pourquoi pas? Nous savons tous qu'elle est une vertu et une manière de se recréer un monde différent et plus conforme à nos vues.
Je suis peut-être passé à côté de quelque chose, mais je n'ai pas vraiment été enthousiasmé par cet auteur dont je ne souhaite pas poursuivre la découverte.
J'avoue que je me suis beaucoup ennuyé à la lecture de ce livre, pas vraiment (et même pas du tout) bien écrit, ni passionnant ni attachant. Cela n'a pas correspondu à ce que j'attends d'un roman, celui d'être un moment d'exception et de plaisir, à la découverte d'un auteur et de son univers.
©Hervé GAUTIER – Février 2010.http://hervegautier.e-monsite.com
-
L'HÔTE – Guadaluppe Nettel
- Le 03/02/2010
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°395– Février 2010.
L'HÔTE – Guadaluppe Nettel – Actes Sud.
Ana est habitée par une « Chose » qui fait partie d'elle depuis l'enfance. Elle vit avec elle, ou plus exactement est en elle depuis toujours, elle ne la voit pas mais elle la sent et celle-ci se sert d'elle, s'en nourrit presque, jusqu'à à en devenir insupportable. La chose grandissait en effet en elle « comme une chrysalide »;
Durant l'enfance, elle a été sa compagne-complice ce qui meubla la solitude de la fillette. Seul son frère, Diego, échappait à son emprise, mais plus tard ses réactions furent inattendues, dévastatrices au point de s'attaquer à ce frère lui-même... et l'anéantir, le vider de sa propre substance! C'est à tout le moins l'explication qu'Ana donna à la mort prématurée de son frère, associant le sang de ses premières règles à celui qui accompagnait la mort de Diego. Parfois la chose alternait entre accalmie et violence, parfois se manifestait sous la forme d'une petite voix mais avant la mort de ce frère aimé, il semble que la « chose » a laissé sur son bras une sorte de cicatrice qui évoque le braille. Alors, message codé ou annonce de mauvaise augure, rite cabalistique ou volonté de voir un mystère à déchiffrer? Ce fut pour elle l'occasion d'entrer dans le monde des aveugles, pourquoi pas en devenant lectrice dans un institut pour non-voyants? Ce serait une façon bien originale et sûrement efficace pour Ana de se débarrasser de cette « chose » qui devenait de plus en plus un parasite, de l'exorciser en quelque sorte par une sorte de transfert, comme si l'hépatite dont elle souffrit un temps lui aurait permis de partager sa souffrance avec cet « hôte » encombrant?
Pourtant, à force d'explorer le monde souterrain des aveugles, de les fréquenter jusque dans leur quotidien, à la fois dans cet établissement qui l'emploie mais surtout dans un monde interlope fait de rencontres improbables, de mendicité, de handicap et de vie cachée dans le métro mexicain, véritable cloaque où pourtant elle finit par se mouvoir presque naturellement, elle finit par décrypter le message sur le bras de son frère!
Alors, manifestation d'un dédoublement de personnalité dont nous souffrons tous sans bien nous en rendre compte, peur intrinsèque à l'enfance de voir disparaître des êtres que nous aimons face à l'inconscience des adultes qui préfèrent transformer la mort en tabou, habitude prise dès les premières années de vivre avec autre chose qui fait que les adultes, et parfois nous-mêmes, craignons pour notre santé mentale, volonté de se recréer un monde différent de celui dans lequel nous vivons, sentiment de culpabilité ou désir de voir dans autre chose le responsable de ses propres malheurs, phobie irraisonnée de cette enfance qui pourtant s'en va, mythomanie dévorante qui confine parfois à la folie, itinéraire intime qui consiste à se libérer définitivement d'une obsession? Qui sait!
J'avoue que j'ai lu ce livre avec une certaine circonspection, partagé entre intérêt et curiosité... Je suis peut-être passé à côté de quelque chose, mais cet ouvrage, malgré les éloges que j'ai pu en lire par ailleurs m'a laissé une impression bizarre, non par le sujet traité qui me parlerait peut-être, mais par la manière de l'aborder, entre fiction et réalité.
-
LE TABLEAU DU MAITRE FLAMAND – Arturo PEREZ-REVERTE.
- Le 19/01/2010
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°390– Janvier 2010.
LE TABLEAU DU MAITRE FLAMAND – Arturo PEREZ-REVERTE.
Julia est restauratrice de tableaux à Madrid. Elle s'occupe d'une œuvre de Van Huys, peintre flamand du XV° siècle qui représente deux nobles qui jouent aux échecs et, en arrière-plan, une femme en deuil qui lit et semble les observer. Il pourrait s'agir d'une scène banale mais le travail de restauration, accompagné d'une recherche radiographique approfondie, révèle sous la peinture une inscription en latin « qui a pris le cavalier? » qui l'intrigue quelque peu. Une étude plus poussée révèle que le peintre a exécuté ce tableau trois années après la mort quelque peu étrange d'un des joueurs et l'inscription cachée pourrait tout aussi bien se traduire par « qui a tué le chevalier? », c'est à dire l'un des deux aristocrates représentés sur le tableau. C'est qu'il met en scène deux personnages historiques avec, en arrière-plan une femme qui aurait bien pu jouer un rôle déterminant dans le disparition de celui qui a été tué. Cette composition énigmatique est bien dans la style de l'époque et est d'ailleurs partagée par d'autres artistes.
Voici posée une énigme, voulue sans doute par le peintre et qui va se compliquer par la vente prochaine du valeureux tableau, l'attribution de commissions juteuses, de tractations tordues en marge de la légalité et l'intervention de personnages mystérieux et parfois sans aucun scrupule. Une véritable partie d'échec là aussi! Deux protagonistes de cette histoire seront même assassinés dans des circonstances troublantes, ce qui ajoutera au mystère qui entoure cette œuvre et ne manquera pas de réunir le passé au présent qui lui aussi comporte des interrogations qui ne sont pas sans rappeler l'œuvre de Van Huys!
L'ambiance un peu noire est entretenue tout au long de ce roman par l'analyse des situations, les couleurs du tableau mais surtout par l'échiquier lui-même, représenté sur la toile avec certaines pièces du jeu dont le déplacement pourrait bien révéler une partie du mystère! La symbolique des pièces, les arcanes du jeu, la stratégie et la technique des échecs, l'éventualité d'un autre joueur qui viendrait déplacer les pions, l'existence d'une main anonyme qui distribuerait messages et indices, brouillant ainsi les pistes, l'intervention de la police, la présence de miroirs, l'opposition des carrés noirs et blancs laissant supposer un certain manichéisme, les supputations logiques et parfois déconcertantes faites autours de cette partie laissée en suspens depuis cinq siècles et qui semble vouloir livrer son secret à qui voudra bien s'y intéresser! C'est que ce tableau, sous des apparences ordinaires, invite le spectateur à prendre d'hypothétiques chemins qui semblent l'égarer à l'envi, d'autant plus que cette œuvre finit par être volée et donc par disparaître.
Le jeu d'échecs peut-être un passe-temps, une simple parabole, un miroir qui cache la réalité...
Comme toujours Arturo Peres-Reverte renoue avec le type de roman à énigme où se mêlent suspense savamment distillé, délit et blanchiment d'argent, comme toujours une grande érudition, nombre de mises en abymes et sens de la formule toujours aussi affirmé.[« Je voulais parler de la vie, de ces soixante-quatre cases de noires nuits et de blanches journées dont parlais le poète... Ou peut-être le contraire: de nuits blanches et de jours obscurs. Tout dépend de quel côté du joueur nous voulons placer l'image... De quel côté, pour parler en parabole, nous plaçons le miroir. ». « La vie est une espèce de restaurant coûteux où l'on finit toujours par vous remettre l'addition, sans qu'il faille pour autant renier ce qu'on a savouré avec bonheur ou plaisir. »].
L'auteur tient en haleine son lecteur passionné jusqu'à la fin. C'est extraordinaire!
Je ne regrette pas d'avoir, par hasard, fait la connaissance de cet auteur.
©Hervé GAUTIER – Janvier 2010.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA PEAU DU TAMBOUR - Arturo Perez-Reverte
- Le 13/01/2010
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°387– Janvier 2010.
LA PEAU DU TAMBOUR – Arturo Perez-Reverte – Le Seuil.
Eh bien imaginez-vous qu'un pirate informatique, un hacker, s'est introduit dans l'ordinateur du Vatican et que le Pape est au courant. On soupçonne un ecclésiastique surnommé « Vêpres » (évidemment!), curé d'une petite paroisse à Séville, d'en être le coupable! Sauf qu'on n'est pas très sûr et que pour avoir des renseignements fiables on y délègue, en toute discrétion, un prude, vertueux mais élégant et non dénué de charme envoyé du Saint Siège, le père Lorenzo Quart, pour faire toute la lumière sur cette affaire. Il n'est pas indifférent au femmes et si son col romain lui ouvre bien des portes, il lui rappelle aussi ses vœux ecclésiastiques et lui évite des faux-pas.
C'est que cela se complique un peu quand l'église (Notre Dame des Larmes), une merveille architecturale qui tombe en ruine et que tente de restaurer Gris Marsala, une troublante architecte américaine, accessoirement religieuse atypique égarée dans les ordres dont le rôle lui paraît assez imprécis. Cet édifice religieux dont est responsable le brave et ombrageux curé sévillan, Don Priamo Ferro, « tue pour se défendre », selon une formule sibylline qui sied bien aux membres de cette congrégation, entendez par là qu'elle a déjà fait deux morts dans son enceinte, mais deux morts qui ressemblent à s'y méprendre à des homicides! C'est que le projet, déjà bien avancé, est de la détruire pour que le terrain sur lequel elle est construite, soit destiné à la spéculation immobilière et que des subsides viennent, accessoirement, alimenter les caisses de l'archevêché de Séville dont Mgr Corvo préside aux destinées, Ajoutez à cela trois malfrats chargés de surveiller le père Quart, la belle et mystérieuse aristocrate andalouse, Macarena Bruner de Lebrija, aussi extravagante qu'infidèle, plus ou moins ex-épouse du financier véreux Pancho Gravira, le banquier spéculateur Don Octavio Machuca, le père Oscar Lobato, jeune vicaire qui a délibérément sacrifié son avenir et qui pourrait bien être « Vêpres » et un corsaire espagnol disparu au large de Cuba en 1898... Mais l'affaire se corse puisque les fidèles de cette paroisse sont prêts à tout pour conserver leur église et que Don Priamo Ferro ne veut pas s'en laisser conter et ce d'autant moins qu'il est soutenu par Macarena Bruner.
Pire peut-être, et comme si tout cela ne suffisait pas, un problème juridique de taille vient troubler ce jeu trop bien huilé : le curé de la paroisse doit dire tous les jeudis une messe pour le repos de l'âme de Gaspar Bruner, donateur du terrain sur lequel est édifiée l'église et ancêtre de Macarena et l'ecclésiastique entend respecter cette condition... et s'en servir pour garder son église. Si l'édifice venait à être détruit, le terrain reviendrait à la famille Bruner... mais ce n'est pas si simple et des actions judiciaires sont possibles, tant l'enjeu est important. De plus, le père Quart n'a pas été envoyé par hasard à Séville. Il a avec Mgr Corvo une vieille querelle inoubliée qui, bien entendu, refera surface! Tout cela se déroule dans un contexte de luttes d'influences, de prises de pouvoir, de volontés mercantiles, de coups bas aussi... Mais le père Quart ne va pas manquer de s'apercevoir rapidement que sa mission n'a rien de confidentiel, que les protagonistes de cette histoire sont tous à la fois mystérieux et solidaires, ce qui ne va pas aller sans rebondissements.
Vous avez ainsi tous les ingrédients d'un roman passionnant, avec cette histoire de carte postale mystérieuse, toutes les pièces d'un puzzle où les amours contrariées se mêlent à l'aventure et au dépaysement dans le somptueux décor de Séville, carrefour ancien des religions, des cultures et donc de la tolérance et de son tropisme irrésistible.
Comme toujours j'ai apprécié les portraits, le père Ferro qui qualifie lui-même les vieux prêtres de « vieille peau de tambour jaunie sur laquelle résonne la gloire de Dieu », mais surtout les femmes, celui de Cruz Bruner, de sa fille Macarena, mais aussi celui de Gris Marsala... La complicité amicale qui existe entre elles brouille un peu le jeu. Bien entendu, dans le contexte religieux, elles sont regardées par la hiérarchie catholique comme des créatures du Diable et donc comme des tentatrices dont il convient de se défier, pourtant Loranzo Quart fait ce qu'il peut pour ne pas succomber... !
J'ai retrouvé avec plaisir l'imagination débordante de Perez-Reverte où se mêle le suspense, une grande profusion de détails évocateurs et un sens de la formule et aussi beaucoup d'érudition historique. J'ai apprécié l'humour dont son style est emprunt, les descriptions de Séville, les dialogues entre ecclésiastiques faits d'hypocrisie, de duplicité, de mots couverts et d'euphémismes qui siéent si bien à cette corporation. J'ai même eu l'impression que l'auteur réglait quelques comptes, faisant, à l'occasion un constat pas si éloigné que cela de la réalité de l'église catholique apostolique et romaine...
Mais seul importe le plaisir de lire, et là, encore une fois, je dois dire qu'il a été complet! J'ai même franchement bien ri en lisant, à haute voix pour ne rien perdre de leur subtilité, certains paragraphes où l'auteur évoque les facettes de ses personnages.
©Hervé GAUTIER – Janvier 2010.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA REINE DU SUD – Arturo PEREZ-REVERTE
- Le 23/12/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°385– Décembre 2009.
LA REINE DU SUD – Arturo PEREZ-REVERTE – Le Seuil.
Térésa Mendoza est une jeune fille mexicaine de 19 ans qui n'a connu que la misère et la violence. Pour échapper à cela, elle vit avec Guero Davila, un pilote à la solde des trafiquants de drogue qui viennent de l'assassiner. Cette sentence de mort s'étend, bien entendu à elle et elle ne peut que fuir pour leur échapper. Ils la retrouvent cependant, la violent et elle n'échappe à la mort que par miracle.
Elle se retrouve dans l'enclave espagnole de Melilla où elle partage la vie de Santiago Fisterra, un Galicien trafiquant de drogue qui trouve la mort en mer. Térésa qui l'accompagne sauve encore une fois sa vie mais est condamnée par la justice espagnole à plusieurs mois de prison. Là, elle fait la connaissance de Pati O'Farrell, en rébellion contre sa famille bourgeoise, condamnée elle aussi pour trafic de drogue. A son contact, Térésa découvre la lecture et se cultive. A leur sortie, les deux femmes récupèrent une cargaison de drogue cachée par Pati et, avec l'aide d'Eddy Alvarez, avocat affairiste, elles créent une société de transport, en réalité une société écran ainsi qu'un réseau de société fictives dont le seul but est le blanchiment d'argent. La petite mexicaine est donc devenue « la reine du sud » grâce au trafic de drogue et de tabac, même si aucune charge ne peut véritablement être retenue contre elle. Elle réussit à s'imposer dans un univers d'hommes, comme une véritable femme d'affaires, change complètement et se découvre différente.
Pourtant, elle n'a jamais oublié ni ses racines mexicaines ni la mort de Guero, le véritable homme de sa vie et cette vie de femme d'influence ne lui sied guère.
Voilà donc posée l'intrigue de ce roman, avec ses rebondissements, son suspense, ses personnages bien ciselés ...
Le personnage central est une femme d'exception, comme souvent dans les romans de Perez-Reverte, à la fois forte et faible, comme sont les êtres en général. On sent que l'auteur aime les femmes et prend plaisir à nous faire partager sa passion pour elles. Malgré son parti-pris sympathique, il n'en reste pas mois que Térésa est une trafiquante, une « narca ». Il nous la présente et la fait vivre dans un contexte d'un roman d'aventures inspiré par Alexandre Dumas dont il est un grand admirateur. L'auteur évoque le monde interlope de la drogue, de la corruption qui a cours au Mexique, de la menace qu'elle fait peser sur l'Europe, de l'Espagne considérée comme une plaque tournante de ce trafic, à la fois proche de l'Amérique latine et de l'Afrique, des meurtres...
L'auteur à certes abandonné le roman historique pour nous offrir une évocation plus actuelle de notre société. Lui-même s'implique d'ailleurs dans ce texte, parle de son travail de romancier, de ses lecteurs qu'il imagine, de leur façon de recevoir un livre, d'entrer dans le monde de la fiction... C'est une approche intéressante.
Pourtant, je n'ai pas retrouvé le même souffle que dans le « maître d'escrime » et je le regrette un peu.
©Hervé GAUTIER – Décembre 2009.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE MAITRE D'ESCRIME – Arturo PEREZ-REVERTE
- Le 19/12/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°384– Décembre 2009.
LE MAITRE D'ESCRIME – Arturo PEREZ-REVERTE – Le Seuil.
« Tout le monde conspirait en cet été 1868 », les jours de la reine Isabelle II étaient comptés et les supputations républicaines aillaient bon train. C'est une Espagne traditionnelle, machiste, monarchiste, immobile qui est le cadre de ce roman pseudo-historique où Jaime Astarloa, vieux maître d'armes, vit ou plutôt survit dans l'ombre bienveillante mais distante des grands aristocrates à qui il enseigne son art. Pourtant, cette discipline à laquelle il a été fidèle toute sa vie est sur le déclin au point d'être ravalée au rang de sport, tout comme sont galvaudées les valeurs de chevalerie et d'honneur qui s'y attachent. Face à ce monde qui s'effondre, il s'efforce de rédiger un traité qui résumera toutes les nuances de son art, avec la révélation de la botte secrète et imparable, une sorte de Graal. Il considère que son enseignement est exclusivement réservé aux hommes, mais c'est une femme, jeune, belle, secrète et célibataire, Adela de Otero, qui vient solliciter ses services, et, accessoirement améliorer son niveau de vie en l'initiant à une botte dont il a le secret, « la botte des deux cents écus »!
Cela pourrait être intéressant, mais il considère qu'une femme ne peut manier l'épée parce que cet exercice est réservé aux hommes. Il refuse donc mais finit par céder, et ce d'autant plus qu'il tombe amoureux de la belle. C'est qu'il n'a jamais pu résister à une femme. Elles ont provoqué bien des renoncements et des bouleversements dans sa vie et celle-ci lui donne à penser qu'elle n'est pas tout à fait insensible à sa personne.
Don Jaime est sous le charme des yeux violets de la dame autant que de son habileté à manier l'épée et à être à ce point en avance sur son temps. Il en vient même à concevoir quelque jalousie à cause des relations intimes qu'elles avec un de ses élèves, un aristocrate bien en vue, Don Luis de Ayala, marquis des Alumbres qui a, un temps, tenu un rôle politique. Don Jaime n'a pourtant rien à espérer de Doňa Adela!
Autour de lui, dans la chaleur étouffante de Madrid et surtout sans que cela lui fasse rien, les querelles politiques se déchainent dans le café où il a ses habitudes, et dans le pays les complots succèdent aux faux espoirs de révolution... Mais lui vit désormais et depuis longtemps hors du temps. Il ne se rend compte que bien tardivement qu'il est le jouet des événements au point d'être soupçonné du meurtre de Don Luis puisque c'est sa « botte secrète » qui a été utilisée pour l'exécuter et que Adela de Otero a disparu mystérieusement! L'escrime et les femmes n'étaient-elles pas quelques-uns des points faibles du marquis?
Il va entrer, presque malgré lui, dans des intrigues où l'assassinat politique est un passage obligé avec pour but ultime le renversement de la monarchie. S'il ne s'était, à ce point retiré du monde, il aurait peut-être compris ce qui se tramait autour de lui!
Ce roman est construit comme un engagement , assaut, fausse attaque,estocade, jusqu'au combat à pointe nue et de son issue, la mort, une véritable métaphore à travers le vocabulaire peut-être un peu trop technique pour un non-initié, du duel à l'épée.
Grand admirateur d'Alexandre Dumas, l'auteur nous offre ici un roman où tous les ingrédients se retrouvent, intrigues politico-policières, histoire d'amour, contexte historique d'une société au bord de l'explosion... Don Jaime est présenté comme un idéaliste, un homme finissant, gardien de valeurs surannées et d'un art qui se dissout dans le temps, mais aussi comme un naïf, pitoyable et crédule qui ne comprend pas une époque qui n'est déjà plus la sienne. Il prend brutalement conscience de la noirceur des hommes et du tourbillon dans lequel il s'est laissé entraîner au point que sa vie est dangereusement menacée. C'est une sorte de Don Quichotte avec des moulins à vent plein la tête. En cela, je le trouve attachant.
Ce roman tisse une atmosphère qui me plaît bien, celle d'un moment charnière, de quelque chose que l'on connaît et qui se termine et d'une autre chose qu'on ignore mais qui fascine et inquiète à la fois.
Le texte plein d'humour est bien écrit ou en tout cas bien traduit, ce qui rend sa lecture agréable. Le récit des différents combats est particulièrement bien mené, le suspense y est distillé jusqu'à la fin et et tient le lecteur attentif et passionné en haleine.
Pour moi, cela a correspondu pleinement à ce que j'attends d'un livre: un moment de réel plaisir, mais aussi une invite à découvrir l'atmosphère si particulière tissée par cet auteur.
©Hervé GAUTIER – Décembre 2009.http://hervegautier.e-monsite.com
-
QUELQUES MOTS SUR HORACIO QUIROGA [1878-1937]
- Le 24/09/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°367– Septembre 2009
QUELQUES MOTS SUR HORACIO QUIROGA [1878-1937]
Les écrivains sont le miroir de l'humanité. Ils parlent d'elle et elle se reflète en eux. A ce titre, ils présentent de multiples facettes et mettent en lumière toutes les composantes de la condition humaine, des plus basses turpitudes aux attitudes les plus morales. Ainsi a-t-on l'habitude de résumer en quelques mots l'œuvre d'un auteur. A titre personnel, je ne sais pourquoi, j'ai toujours été attiré par ceux qui parlent de la solitude et de la mort, probablement parce que, bien que nous refusions cela, elles résument notre parcours terrestre. Parmi les noms qui sont présents dans ma bibliothèque idéale, celui d'Horacio Quiroga y tient une place particulière.
Il y a, certes, des contes pour enfants[« Contes de la forêt vierge »], écrits pendant le séjour qu'il fit le long du fleuve Paran, en Argentine, où le spectacle qu'il donne à voir est onirique et même plaisant, il a également publié des recueils de poèmes mais, ailleurs, dans toute son œuvre, la mort revient avec une prégnance singulière. Elle est présente dans chacune de ses nouvelles. Elle est même parfois dépeinte comme une chose simple et même parfois apaisante comme dans « les exilés » où un paysan heureux repose au soleil, une machette plantée dans le ventre ou un homme, au fond d'un puits, regarde les étincelles d'une mèche de dynamite qui se consume à ses pieds. Elle peut-être aussi plus subtilement distillée sous forme d'un alcool mortel dégusté par un client au pied même de l'alambic! C'est donc de la fragilité de l'existence dont l'auteur souhaite être le témoin.
C'est que la mort a fait très tôt partie de sa vie, son père mourant accidentellement alors qu'Horacio, son fils, n'avait que trois mois, puis, dix-sept ans plus tard, c'est son beau-père qui se suicide sous ses yeux. Sa première épouse met fin à ses jours puis s'est lui qui, en manipulant une arme tue son meilleur ami, Frédérico Ferrando. Plus tard, atteint d'un cancer, se suicidera en 1937 à Buenos Aires et ses deux enfants se suicideront à leur tour. La violence dans la mort est aussi une constante dans ses écrits.
La solitude est également un thème récurrent dans son œuvre. Né en Uruguay, il s'installe, en 1912, à San Ignacio, dans la forêt tropicale, son œuvre témoigne de ce lieu, de la faune hostile comme de la flore et l'atmosphère qui se dégage de ses écrits est oppressante. Dans « Anaconda », il dessine un décor labyrinthique où les animaux dont doués de sentiments humains dans lequel le lecteur trouve à la fois la folie et la mort. Au départ, les histoires racontées sont réalistes, dans un style épuré et sont le fruit de l'expérience vécue de l'auteur, mais elles dérapent rapidement dans un surréalisme inquiétant et l'atmosphère qui s'en dégage est monstrueuse et délirante.
Dans « Contes d'amour de folie et de mort »,il y a, certes, l'évocation des deux premiers thèmes, mais c'est surtout le dernier qui est évoqué, comme un poison que l'homme porte en lui et qui finira par lui être fatal.
Il est considéré, à juste titre, comme le maître de la nouvelle fantastique latino-américaine, à l'égal de Maupassant ou d'Edgar Poe dont il s'est sans doute inspiré.
(C)Hervé GAUTIER – Septembre 2009.http://hervegautier.e-monsite.com
-
1492 - Les aventures de Juan Calbezón de Castille - Homero ARIDJIS.
- Le 11/04/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°270 – Mars 2007
1492 – Les aventures de Juan Calbezón de Castille – Homero ARIDJIS.
Décidément, les écrivains sud et meso américains me passionnent par leurs écrits. Cette chronique s'est d'ailleurs souvent fait l'écho de leurs œuvres. Ce n'est pas la lecture de ce roman qui me fera changer d'avis!
Ainsi, de la première à la dernière ligne de ces chapitres, l'auteur entraîne son lecteur passionné sur les pas de Juan Calbezón de Castille à travers cette Espagne du XIV°-XV° siècle dévorée par la Sainte Inquisition. A l'aide de documents historiques et d'une imagination de bon aloi, Homero Aridjis nous restitue sur le mode picaresque cette société parfois interlope et qui tient de la Cour des Miracles mais aussi aristocratique et religieuse au point qu'on a l'impression de la voir vivre sous nos yeux. Juan Calbezón est notre guide, mais aussi Pero Meňique, Isabel de la Vega... Nous traversons avec eux la Castille, L'Aragon, l'Andalousie... C'est un tableau de cette société médiévale qui m'a toujours éblouie avec son désir de spiritualité, son appétit de vie charnelle, son bouillonnement d'idées nouvelles, mais aussi ses débordements et sa fascination pour la mort. C'est l'Espagne où trois religions cohabitent en bonne intelligence, Islam, Chrétienté et Judaïsme, au point qu'elle est montrée comme exemple de la tolérance. Et puis soudain, sans doute parce que la reconquête du pays sur les Maures est une obligation morale, mais surtout parce que l'antisémitisme de l'Église catholique couvait depuis trop longtemps, par cupidité aussi, tout cela s'est effondré comme un vulgaire château de cartes. Au nom du Christ qui inspira et prêcha le message d'amour de l'Évangile au point de mourir pour cela, les rois, connus pourtant pour être “catholiques”, et leur alliée un peu trop zélée, la hiérarchie catholique, vont s'arroger le droit de chasser les Juifs d'Espagne et, bien entendu, de confisquer tous leurs biens. Ainsi émerge la triste figure de Tomás de Torquemada, grand inquisiteur, assoiffé du sang des juifs et des convertis, accusés de tous les maux et voués à la torture et finalement au bûcher. L'auteur nous brosse avec talent toute cette société jadis tolérante et respectueuse des valeurs religieuses qui se transforme et compte dans ses rangs des faux témoins capables de précipiter leur propre voisin dans la mort, des flagorneurs, des délateurs qui, pour complaire au pouvoir et pour se faire valoir ne ménagent ni la trahison ni la volonté de détruire... c'est une nouvelle illustration du “juif errant”, dont le destin est d'être chassé de partout, toléré nulle part...
L'idée utopique de Christophe Colomb termine le livre et avec elle un formidable espoir...
Il y a, certes ce récit passionnant, mais je choisis d'y voir un témoignage de la condition humaine, pas si éloigné que cela de notre histoire contemporaine, la dénonciation d'une facette de cet Homme dont on dit volontiers qu'il est humain, voire humaniste, mais qui porte en lui le germe de la mort.
© Hervé GAUTIER - Mars 2007
-
CONTES D'AMOUR DE FOLIE ET DE MORT - Horacio QUIROGA - Editions Métailié /Unesco.
- Le 05/04/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°223
Mai 2000
CONTES D’AMOUR DE FOLIE ET DE MORT - Horacio QUIROGA – Editions Métailié /Unesco.
A priori le lecteur pourrait croire qu’il s’agit de récits qui sont imaginaires et fantastiques et qui s’inspirent de la condition humaine. De quoi, en effet, parlent les artistes et spécialement les écrivains depuis l’aube des temps sinon de l’homme, de son quotidien, de ses aspirations, parfois de ses fantasmes et de l’issue de sa vie ?
Pourtant, dans la trilogie classique « La vie, l’amour, la mort. », j’ai rencontré chez Quiroga surtout la dernière. Ses contes m’ont fait penser à la phrase d’Yves Bonnefoy « La mort est un pays que tu aimais. ». C’est en effet un thème récurrent chez l’écrivain uruguayen puisqu’elle a fait très tôt partie de sa vie. Ce fut d’abord celle de son père puis celle de son meilleur ami Federico Ferrando qu’il tua accidentellement, celle de son frère, de sa sœur puis de sa première femme. Mais ce fut surtout le suicide, celui de son beau-père puis le sien en 1937. Il fait le joint entre ces trois mots, en est l’issue définitive.
Il faut se rappeler que c’est à partir du suicide de son beau-père en 1896 qu’il commença à écrire.
L’homme porte en lui la mort comme un germe, comme un poison. Notre auteur, à qui la condition humaine n’était point étrangère a su si bien l’exprimer dans sa simplicité mais aussi dans sa complexité, dans son horreur comme dans sa violence. Même si le Cantique des Cantiques rappelle que « l’amour est plus fort que la mort », c’est pourtant elle qui gagne à la fin, sans que nous y puissions rien !
La solitude qui bien souvent est la cause ou la conséquence de la folie fait aussi partie de son être. Il s’est lui-même exilé en pleine forêt. Il en fera la matière de certains de ses contes, le décor, l’essence.
Dans cette forêt se confondent et s’opposent deux civilisations, celle ancestrale des indiens Guaranis et celle des blancs des grandes compagnies étrangères. En cela, Quiroga, amoureux de cette nature dénonce un système ce qui fait de lui un écrivain engagé. D’autres suivront son exemple !
Ecrivain de la vie, il sait que nous ne sommes ici que de passage. La durée nécessairement courte de notre existence s’incarne chez lui dans le conte ou la nouvelle, forme brève qui porte en elle toute la nécessité de dire, avec une grande économie de mots, le message qu’il porte en lui. Le style est, plus que dans le roman, épuré, dépouillé parfois, toujours sans artifice. Autant dire qu’il choisit d’aller à l’essentiel.
Il y a aussi du fantastique, du merveilleux, de l’étrange chez Quiroga. Cela peut faire partie de notre vie comme il faisait sans doute partie de la sienne, de son imaginaire, sûrement ! Ses textes en sont aussi les témoins.
La mer est présente dans cette œuvre. Elle fait, au même titre que la solitude, la folie et la mort, partie de la vie de l’auteur. Son père, marin, inspira de son exemple l’écriture de ce fils.
Peut-on dire que son écriture débouche Dieu ? Quiroga pourrait-il être regardé comme un écrivain mystique comme on a pu le dire ? Je dois avouer que je n’ai pas lu ou senti cette dimension dans ses textes. Pourtant j’y ai rencontré bien des préoccupations humaines et personnelles. C’est pour moi un beau livre !
© Hervé GAUTIER.
-
LA HARPE ET L’OMBRE - Alejo CARPENTIER - Editions Gallimard.
- Le 04/04/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°207
Juillet 1999
LA HARPE ET L’OMBRE - Alejo CARPENTIER - Editions Gallimard.
Je dois bien l’avouer à mon improbable lecteur, tout ce qui concerne la papauté m’intéresse. Je ne sais pas pourquoi, mais c’est ainsi. Le livre d’Alejo Carpentier ne pouvait donc me laisser indifférent.
De quoi s’agit-il donc sinon d’une parcelle de l’histoire qui n’est peut-être pas restée dans la mémoire collective comme un fait majeur. Au tout début du roman est évoquée la personnalité d’un prélat franciscain : Giovani Maria Mastïa qui avait choisi de servir l'Église autant, nous dit-on par déception amoureuse qu’en raison de la pauvreté de sa famille pourtant de haute lignée. Il se fit pourtant remarquer par ses prêches aussi ardents qu’ éloquents mais cela ne pouvait raisonnablement lui laisser espérer une ascension rapide dans la hiérarchie catholique. Il fut cependant désigné pour accompagner un prélat dans une mission apostolique en Argentine et au Chili. Celle-ci ne fut pas couronnée de succès mais il en est revenu avec l’idée que la découverte des Amériques avait été l’événement capital des temps modernes.
Plus tard, devenu pape sous le nom de Pie IX il était toujours possédé par cette idée au point de décider d’ouvrir le procès en béatification, qui est le préalable à la sanctification, de Christophe Colomb!
L’auteur nous propose les portraits croisés de ces deux personnages, le pape et le marin qui finit par convaincre, après moult pérégrinations, Isabelle la Catholique de financer son expédition.. Mais qui était-il donc, ce navigateur, un génie, un aventurier, un imposteur, un mystificateur, un arriviste qui ne reculait devant rien pour parvenir à ses fins? Alejo Carpentier nous restitue ce qu’il imagine être l’ambiance de cette époque, en plaine reconquista mais aussi pendant l’expulsion des juifs d’Espagne. Il fait du génois l’amant de sa royale protectrice qui finit par lui faire confiance autant par exercice de l’autorité que par la volonté de trouver des richesses pour porter contre les Maures la guerre en Afrique.
A partir de documents d’archives l’auteur nous donne à entendre la voix même de Colomb, en quelque sorte la manière dont il aurait lui-même jugé son entreprise et dont il se serait jugé lui-même. Il nous fait partager ses hésitations, ses doutes. Il se révèle menteur quand il promet de trouver de l’or et des épices aux Indes qu’il recherche, cynique quand il envisage de faire le commerce des esclaves à la place des richesses qu’il n’a pas rapportées... Mais tout ce qu’il avait espéré découvrir reste introuvable et le commerce des esclaves est interdit par ordre du roi. Alors il met en avant les âmes des indigènes qu’il faut sauver et c’est le spirituel qui prend le pas sur le temporel qui pourtant était la vraie raison de son expédition.
En fait Christophe Colomb fut rejoint par son destin, rattrapé par ses forfaitures et dépassé par son exploit. Le luxe a pâli ainsi que les ors à l’heure du jugement et c’est un pauvre homme sans richesse, honni par l’Espagne, moqué par les hommes qui s’apprête à rendre des comptes. Lui, le découvreur de l’Amérique a, en fait apporté à ce continent vierge si semblable au paradis terrestre la cupidité, la luxure, le vice, le péché, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes. Il est loi, si loin de sa légende!
Restait le décret pontifical introduit « par voie d’exception » qui ouvrait le procès en béatification. « Disputant doctores »... et pour cela, par la magie de l’imaginaire le romancier convoque pêle-mêle, pour témoigner, Victor Hugo, Lamartine, Jules Vernes; Bartholomé de las Casas...
Il reste un roman qui ou l’humour et le style, sans doute servi par une traduction de qualité, m’ont fait passer un agréable moment de lecture.
©Hervé GAUTIER
-
MON ANGE - Guillermo Rosales - ACTES SUD.
- Le 03/04/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°276 – Juillet 2007
MON ANGE – Guillermo Rosales – ACTES SUD.
Ce n'est pas de la morbidité, mais j'ai toujours eu un intérêt marqué pour les créateurs qui ont choisi de se suicider. Guillermo Rosales est de ceux-là qui ont eu, à mes yeux, la lucidité, d'aucuns diront le courage et d'autres la lâcheté, c'est selon, de regarder la vie en face et d'en finir volontairement, sans attendre que le hasard s'en charge.
Il y aura toujours des gens pour vilipender cet acte et d'autres pour le magnifier... Pour moi, ce qu'ils écrivent reste un témoignage plus poignant que les autres sans doute parce que l'écriture ne leur a pas permis d'exorciser cette vie, d'autant que leurs œuvres sont souvent posthumes ou circulent sous le manteau, comme quelque chose de précieux ou de dangereux et qui indique peut-être qu'ils ne sont déjà plus de ce monde. Ce fut le cas de ce roman dont l'auteur s'est suicidé à 47 ans, à Miami.
Ce qui est décrit ici, c'est un univers parallèle, où survivent des marginaux qui n'ont jamais pu ou voulu s'intégrer à cette société parfaite, ou prétendue telle, qui est celle des États-Unis. Ils ne le feront d'ailleurs jamais puisqu'elle reste constituée de gens qui ont réussi ou, à tout le moins montrent tous les signes extérieurs de leur richesse, jusqu'à l'ostentation; l'auteur parle d'eux comme des « triomphateurs », ces Cubains exilés, capables de toutes les compromissions et toutes les bassesses pour vivre ce fameux « rêve américain » qu'ils sont venus chercher.
Ils sont bien différents des fous, réfugiés dans ce « boarding home », sorte de phalanstère pour paumés qui n'ont pas ailleurs où aller, avant-dernière demeure avant de basculer dans le néant de la mort. Ils sont noirs, rejetés par la société américaine ou latinos fuyant leur pays et venus chercher ici un improbable « el dorado » qu'ils n'atteindront jamais. Mais voilà, dans ce microcosme, ils ne sont guère mieux. Non seulement ils sont la proie de profiteurs mais aussi de plus minables qu'eux qui, en quelque sorte et à leur détriment, prennent une sorte de revanche sur cette vie. Ici, toute une société se reforme, fixe ses règles non écrites, se développe sur ses propres vestiges...
Alors, William Figueras, trente huit ans, ancien communiste cubain qui a fui son pays, rejeté par sa famille, cultivé mais déstabilisé par la vie, s'est refait un monde où il entend des voix, lit des romans et des poèmes, écrit des livres qui ne seront jamais publiés. Il ne se trompe pourtant pas sur sa condition « Je ne suis pas un exilé politique. Je suis un exilé total. Je me dis parfois que si j'étais né au Brésil, en Espagne, au Vénézuela ou en Scandinavie, j'aurais fui tout autant leurs rues, leurs ports et leurs prairies »
Il se retrouve dans ce« boarding home » infecte où il ne se sent même pas bien mais glisse petit à petit, sans même s'en rendre compte, vers une violence faite aux plus faibles que lui. La souffrance qu'il éprouve appelle la souffrance qu'il va infliger aux autres. Il finira par trouver l'amour avec une fille aussi paumée que lu qui ne cesse de lui répéter « Mon ange », mais leur histoire sera contrariée par le reste du monde, parce que il ne peut sans doute en être autrement.
Petite société miniature qui côtoie la grande mais n'a rien à lui envier. Les deux se ressemblent, surtout par leur côté délétère, mais William, résigné, accepte l'enfermement physique qui ressemble à son enferment moral dont le lecteur comprend qu'il ira en s' aggravant. Figueras perdra l'habitude de lire et d'écrire et ne trouvera d'issue que dans la mort.
© Hervé GAUTIER - juillet 2007
-
PEREIRA PRETEND - Antonio Tabucchi - Christian Bourgois Editeur.
- Le 03/04/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
n°206 - Juin 1999
PEREIRA PRETEND - Antonio Tabucchi - Christian Bourgois Editeur.
C’est un étrange roman que nous offre ici l’auteur.
A en croire une note annexée au texte et publiée pour la dixième édition italienne, il s’agit là d’une histoire vraie. Bien sûr Pereira est un nom inventé mais le texte relate une sorte de tranche de la vie d’un vieux journaliste portugais qui a effectivement existé.
Tabucchi le campe sous les traits d’un veuf cardiaque et gros qui passait son temps a parler au portrait de son épouse décédée quelques années plus tôt et qui souriait d’une manière énigmatique à tous les propos qu’il lui tenait. Il l’emporte avec lui lors de tous ses déplacements en prenant bien soin de le mettre sur le dessus de sa valise pour qu’elle respire bien. Il faut dire qu’elle était morte de la tuberculose!. Il le présente comme un être soupçonneux, ne fréquentant guère ses semblables et se méfiant de sa concierge qu’il suppose être un indicateur de police.
Pereira était catholique mais ma résurrection de la chair ne lui convenait pas parce qu’il n’aimait pas son corps adipeux et encombrant. Son confident était un franciscain simple à qui il confessait régulièrement cette hérésie mais qui le priait surtout de lui avouer des pêchés plus véniels pour mériter son absolution!
Cet obscur journaliste s’occupait de la page culturelle du « Lisboa », journal de l’après-midi. Sa vie fut en quelque sorte bouleversée par la rencontre qu’il fit d’un médecin qui bouscula ses croyances sur l’âme humaine. Il aimait la littérature française, les citronnades sucrées , les omelettes aux herbes et le cigare.
La magie de l’écriture transforma cet homme banal en un être obsédé par la mort et surtout par les positions politiques d’écrivains catholiques à propos du conflit qui se déroulait alors en Espagne. C’est que l’auteur a choisi comme décor le mois d’août 1938 à Lisbonne alors que gronde aux frontières la guerre civile qu’il rencontre indirectement sous les traits de différents personnages qui y sont partie prenante.. Le paradoxe de la position de l'Église à propos de ce conflit le tourmente tout autant que les prises de position des écrivains catholiques français.
C’est alors qu’il décide, lui modeste journaliste de prendre position dans ce pays que le salazarisme marque de son empreinte dictatoriale. C’est un peu comme s’il prenait soudain conscience qu’il devait pour une fois être lui-même. A la suite d’un stratagème, il joue un bon tour à la censure en dénonçant les pratique de la police politique. Pour lui bien sûr ce sera l’exil mais cela importe peu à ses yeux.
Le plus étonnant est que l’auteur prétend qu’à la suite d’une visite qu’il fit à la morgue après la mort de ce journaliste, l’âme de cet homme vint le visiter en songe pour se confesser à lui. Écrivain, il ne pouvait laisser passer cette occasion de lui rendre hommage et cela a donné ce roman qui m’a bien plu.
Je choisis d’y voir pour cet homme solitaire une prise de conscience de la réalité des événements extérieurs et de la nécessité soudain ressentie de s’exprimer même si pour cela il fallait bouleverser sa vie. Je choisis aussi d’y voir l’extraordinaire pouvoir de l’écriture qui transcende un fait anodin et qui, si on en croit l’auteur, plonge ses racines dans la révélation qui nous est parfois faite au pas du sommeil. Personnellement j’adhère à cette notion quasi-rimbaldienne de l’inspiration. Ce n’est pas si souvent qu’un écrivain révèle au lecteur ce qui a présidé à son travail de création même si l’auteur prête un peu ses sentiments à son personnage.
© Hervé GAUTIER
-
DES CRIMES INSIGNIFIANTS - Alvaro Pombo- Editions Gallimard.
- Le 01/04/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
DES CRIMES INSIGNIFIANTS - Alvaro Pombo- Editions Gallimard.
Il se trouve que je suis amateur de romans policiers. Ce titre, du moins en apparence, m’a donné à penser que ce livre pouvait en être un. Je l’ai donc lu. Malheureusement, tel n’était pas le cas.
Sans déflorer l’intrigue, qui m’a paru par ailleurs bien laborieuse, l’histoire relate, dans le climat surchauffé de Madrid, les relations ambiguës d’Ortega, un ancien romancier qui a perdu le goût d’écrire et qui s’est reconverti dans un travail de bureau autant que dans la solitude et Quiros, un jeune homme, un peu éphèbe, actuellement en chômage et qui semble apprécier sa situation d’oisif.
Celui-ci nous est dépeint comme un profiteur « qui vit des femmes », c’est à dire de sa mère, veuve, qui le loge et pourvoit à son entretient quotidien et Cristina, sa fiancée qui subvient à ses besoins et surtout à ses caprices.
Au contact de Quiros, Ortega semble reprendre goût à l’écriture à moins qu’il ne découvre en lui des fantasmes inavouables et des désirs inassouvis. Le futur remariage de sa mère et l’attitude de Cristina qui commence à trouver que cette situation a assez duré rapprochent Quiros d’Ortega qui apparemment supporte mal ce bouleversement de sa vie.
J’avais voulu en savoir plus sur cet écrivain inconnu de moi mais qui avait l’avantage, à mes yeux important, d’être espagnol. Je dois avouer que j’ai été un peu déçu.
© Herve GAUTIER
-
A PROPOS DE FRANCISCO COLOANE - Editions Phébus
- Le 01/04/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
A PROPOS DE FRANCISCO COLOANE - Editions Phébus
Décidément, les écrivains sud-américains ne cessent de m’étonner.
L’intérêt que je porte au talent d’Alvaro Mutis m’a tout naturellement dirigé vers Francisco Coloane, romancier et nouvelliste Chilien, dont Mutis révéla l'œuvre au public français.
Qu’il évoque les paysages envoûtants de la Patagonie dans ses nouvelles (le Golfe des Peines) ou l’histoire tourmentée du peuple indien Ona (le Guanaco) ou le destin des Alakalufs, il n’abandonne jamais longtemps la mer, ses marins, les tempêtes meurtrières du Grand Sud, ses navires (Le Dernier Mousse), ses naufrages.
C’est toujours un peu de sa biographie qu’il nous livre à travers les récits qu’il fait et les personnages qu’il campe, souvent pauvres et sans famille. Ils ne craignent pas d’affronter la souffrance et souvent la mort dans les paysages inhospitaliers mais aussi grandioses des Canaux de Patagonie, du Cap Horn ou de la Terre de Feu
Il y a sûrement un peu de son père dans le Capitaine Albarran (Le Sillage de la Baleine). Ses personnages ont quelque chose d’attachant puisque, à travers eux, m’a-t-il semblé, c’est à une recherche de l’homme à laquelle il se livre même si la condition humaine dont il est question ici est celle de la souffrance et de la mort.
C’est là un romancier authentique dont les mots ne peuvent laisser le lecteur indifférent. Ils puisent sans doute leur force dans les tempêtes, le froid et l’évocation des mystères du monde de la mer et de sa beauté inhumaine. Elle est présente à chaque ligne dans son œuvre. C’est vrai qu’il a sacrifié aussi aux légendes des vaisseaux fantômes, au décor des bars et des bordels dont chaque port est indissociable et à toute une mythologie de monstres marins dont les baleines qu’on pêche ici prennent les traits. Mais ce qu’il peint aussi c’est les dures conditions de vie des marins, véritables forçats de cette mer ingrate à laquelle pourtant ils se donnent pour échapper à la misère d’une terre stérile.
Il y a aussi cette quête que chaque homme mène et qui est sa raison de vivre, que ce soit celle du frère disparu (Le dernier mousse) ou celui du père inconnu (Le Sillage de la Baleine), le gain ou la femme à qui l’on rêve et dont on a, un jour, croisé le sourire.
L’auteur nous rappelle que nous ne sommes que de passage sur terre, que la vie ne se résume pas forcément à une somme de moments heureux et que l’homme est fragile, vulnérable face aux éléments.
Avec » Le Sillage de la Baleine », l’auteur signe ici un texte non seulement émouvant et parfois même bouleversant mais sûrement un moment fort de son œuvre. Dès lors, je ne m’étonne pas qu’Alvaro Mutis, le créateur du personnage de Maqroll El Gaviero, marin mythique, dont j’ai abondamment parlé dans cette chronique ait été sensible à l’écriture de Coloane.
Neruda lui-même nota que « Pour embrasser Coloane, il faut avoir des bras longs comme des rivières ».
© Hervé GAUTIER
-
LE CHATEAU DE LA LETTRE CODEE - Javier TOMEO - Edition Christian Bourgois.
- Le 01/04/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°83 - Octobre 1991.
LE CHATEAU DE LA LETTRE CODEE - Javier TOMEO - Edition Christian Bourgois.
Si, livre en mains, vous prenez la peine de lire les quelques lignes de présentation qui emportent souvent la décision du lecteur dubitatif, vous ne manquerez pas de remarquer que la traductrice de cet ouvrage l’annonce comme un roman formidable. Je partage, pour ma part complètement cet avis tant le flot de mots qu’on peut y lire entraîne le lecteur presque malgré lui dans le sillage du marquis en une multitude de situations pour la remise d’une hypothétique lettre dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle est bizarre (codée!) à un comte qui ne l’est pas moins, par son domestique de qui il attend un dévouement aussi aveugle qu’anachronique.
Il a l’obligeance de l’avertir de tout ce qu’il risque dans cette entreprise, de tout ce qu’il doit éviter de faire et de dire pour ne pas encourir les foudres du dangereux comte.
Cette lettre, loin d’être un message n’est qu’un prétexte puisqu’elle est incompréhensible et indéchiffrable, c’est à dire le contraire d’une missive qui se respecte. Sous couvert d’expliquer l’inexplicable, l’auteur qui par ailleurs observe la désuète unité de temps, de lieu et d’action (ou d’inaction) cultive admirablement la digression, et, dans une espèce de fatrasie surréaliste où les fadaises le disputent aux poncifs promène le lecteur dans une sorte de soulerie de mots (salutaires souleries de mots qui valent bien, je vous en réponds les libations vinicoles!)
Ce long monologue du marquis, naufragé volontaire de la société pendant vingt années derrière les murs de son drôle de château est entrecoupé de silences circonstanciés (ou seulement évoqués) du valet. Il consiste en une sorte d’évocations plus illogiques les unes que les autres, émaillées de propos oiseux sur les insectes et les batraciens, des proverbes et autres apostilles mais cache sûrement le poids très fort de la solitude à moins que ce soit le plaisir de se laisser aller, devant la page blanche, aux délices de l’écriture automatique guidée par une imagination fantasque. Il se pourrait même que le château n’existe pas plus que la lettre... Il resterait au moins le livre, unique et bien différent de ce qu’on a l’habitude de lire. Cela vaut son pesant d’humour et au moins c’est original.
© Hervé GAUTIER
-
Quelques mots sur Camilo-José CELA.
- Le 01/04/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N° 239 – Avril 2002
Quelques mots sur Camilo-José CELA.
Ce que je veux retenir de cet écrivain espagnol, ce n’est pas sa vie, au demeurant assez peu connue qui s’est déroulée en grande partie sous la dictature franquiste qu’il a, par ailleurs, servie, ce n’est pas son Prix Nobel de littérature non plus, pas sa mort survenue récemment mais peut-être son style découvert à travers deux ouvrages « La famille de Pascal Duarte » mais surtout « La ruche ».
C’est une opinion personnelle et sans doute assez peu partagée, mais il me semble que son style est bien peu espagnol, ou, à tout le moins reflète bien l’époque dans laquelle a vécu CELA. Il me paraît être parfaitement le reflet de cette dictature fasciste qui fut pendant longtemps le quotidien de l’Espagne.
On ne peut, certes pas se limiter à la lecture de deux ouvrages, ma si « La famille de Pascal Duarte » qui relate la vie d’un condamné à mort et évoque avec force la fatalité et le destin qui pèse sur l’homme, « La Ruche » est sans doute son livre le plus important, j’entends par-là le plus révélateur de ce qui fait la spécificité de cet écrivain. Ici, il procède par petites touches, comme un tableau pointilliste ou comme une mosaïque qui finalement fait une grande fresque. Chaque paragraphe est un élément du décor qui, pris isolément est, en quelque sorte sans importance, mais qui, réuni aux autres devient l’élément indivisible d’un tout qui fait le roman. Le style, volontairement plat et sans relief ajoute à cet ambiance.
Nous le savons, l’action de « la ruche » se passe à Madrid en 1942. Elle respecte la classique unité de temps et de lieu. Quant à celle d’action, c’est un peu une impression d’inaction que ressent le lecteur parce que c’est là une somme d’histoires sans importance, mettant en scène des gens sans importance, en apparence du moins. C’est pourtant le quotidien ordinaire qui est ici décrit avec ses bassesses, ses rencontres, ses anecdotes, ses amours et ses fortunes qui se font et se défont, le temps qui passe… C’est au spectacle de la simple condition humaine dans tout ce qu’elle a de plus simple que nous convie l’écrivain à travers la peinture d’une multitude de personnages(L’éditeur remarque qu’ils sont en réalité au nombre de 348, certains sont réels, d’autres imaginaires). C’est pourtant dans le café de Dona Rosa que commence l’ouvrage, cet établissement si prisé des Espagnols qu’il symbolise la cité. Dans la ville grouillent des êtres vivants qui naissent vivent et meurent. Les personnages sont en réalité de « pauvres types » qui regardent passer le temps en sirotant une consommation chez Dona Rosa.
Le temps est en effet le deuxième élément de cette écriture. Il est à la fois fatalité, régularité inexorable et révélateur de la monotonie de l’existence humaine. Que sommes-nous au regard de l’éternité, qu’est notre vie sinon un misérable souffle ? Il passe pour chacun, sinon de la même manière, à tout le moins avec finalement le même rythme, le jour, la nuit et cela recommence, pour tout le monde pareil…
Il peut cependant être dégagé trois idées. C’est tout d’abord un roman collectif, comme l’indique d’ailleurs le titre lui-même, comme si la vie était réduite à sa seule dimension biologique, sans idéal, une sorte d’existence primitive !
La vie est donc inerte, fermée, absurde, étouffante, c’est là la deuxième idée.
La troisième idée est sans doute le sexe. Cela peut paraître étonnant dans cette période, dans ce pays où ce tabou est roi, ou la religion commande tout et le pouvoir politique asservit le peuple, ses aspirations, sa culture. Le sexe ici est à peine évoqué, à travers un mariage arrangé, la prostitué qui se vend pour manger, la jeune fille qui doit rester vierge pour son mari qui sera nécessairement le seul homme officiel de sa vie, mais aussi, à mots couverts l’adultère, le mensonge.
« Ils mentent, ceux qui veulent déguiser la vie à l’aide du masque grimaçant de la littérature » écrit Camilo-José CELA dans une note lors de la première édition tout en laissant au lecteur le soin d’apposer sur son livre l’étiquette qu’il jugera bon.
Dans une deuxième note publiée quatre ans après, il précise que « La Ruche » est un cri dans le désert, ce cri n’est pas tellement strident ni trop déchirant ».
Camilo-José CELA n’est pas l’égal en littérature d’un Garcia-Lorca, d’un Unamuno, d’un Antonio Marchado, ou d’un José Ortega y Gasset. La guerre civile et l’exil avaient anéanti les grands intellectuels de ce pays. C’était bien un désert culturel qui y régnait et le mérite de Camilo-José CELA est de s’être fait l’écho de cet « existentialisme noire » qui avait cours, alors en Espagne. Pour ma part, je choisis d’y voir une peinture sinon pessimiste à tout le moins réaliste de la vie à cette époque.
Il n’est cependant pas inutile de rappeler que, photographie de la société de ce temps, ce livre n’a pu être édité en Espagne, à tout le moins au début. La première édition fut argentine, la deuxième mexicaine. C’était peut-être là le signe d’une société qui ne voulait pas voir ses réalités en face !
©Hervé GAUTIERhttp://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg
-
VIVRE POUR LA RACONTER - Gabriel Garcia MÁRQUEZ-Editions Grasset.
- Le 01/04/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°263 - Novembre 2006
VIVRE POUR LA RACONTER – Gabriel Garcίa MÁRQUEZ– Editions Grasset.
(traduit de l’espagnol par Annie Morvan)
J’ai déjà écrit dans cette chronique à plusieurs reprises combien j’apprécie l’écriture de Gabriel Garcia Marquez. Je n’ai aucune mérite puisque son talent a été largement récompensé, mais quand même ! Jusque là, il était un romancier dont je célébrais les qualités et notamment celles qui consistaient à débuter son texte par une première phrase apparemment anodine et, à partir de celle-ci, de dérouler toute une fiction de plusieurs centaines de pages pour la plus grande joie de son lecteur passionné, déçu simplement par le mot « fin ». Ici, c’est la même chose et ce qui débute le récit « Ma mère me demanda de l’accompagner pour vendre la maison » vous entraîne pendant six cents pages sans que l’ennui ne s’insinue dans votre lecture. Pourtant ce n’est pas exactement un roman, plutôt une autobiographie, comme l’indique le titre, encore qu’avec lui, il faille se méfier, puisque tout est prétexte à l’écriture et que l’exercice dans lequel il excelle est, avant tout, de raconter une histoire, fût-ce celle de sa propre vie !
A partir d’un voyage effectué avec sa mère dans le but hypothétique de la vente de la maison de son enfance, ses souvenirs remontent de la terre natale comme l’eau d’une source. C’est aussi l’occasion pour lui de nous indiquer qu’à cette époque de sa vie il était étudiant, puis journaliste « dans un hebdomadaire indépendant et à l’avenir incertain », de nous faire découvrir avec quelque effroi, le parcours initiatique qui fut le sien sur le chemin de ce merveilleux état qui, à défaut d’être un métier, est sans doute la plus extraordinaire des raisons de justifier son passage sur terre : être écrivain !
Il est rassurant de lire sous sa plume des conseils qu’on lui donna et qu’il n’oublia pas de mettre en pratique, de « continuer à écrire, ne fût-ce que pour [sa] santé mentale » et de « ne jamais montrer à personne le brouillon qu’[il] est entrain d’écrire »
Pour le plaisir de son lecteur, il remonte le moindre rameau de son arbre généalogique en révélant tous les travers de cette société quelque peu clanique, à la fois intolérante et pétrie de principes surannés, avec un sens de la formule qui n’appartient qu’à lui « Ce préjugé atavique, dont les séquelles subsistent encore aujourd’hui, a fait de nous une vaste fratrie composée de vieilles filles et d’hommes débraguettés avec toute une ribambelle d’enfants semés dans les rues ». Il nous invite à parcourir les arcanes de ces histoires intimes où les enfants légitimes côtoient les bâtards, où les amours tumultueuses et passionnées de ses parents le disputent aux querelles d’honneur, aux improbables aveux et aux rebondissements inattendus dans un contexte de principes moraux, d’interdits religieux et de retournements de fortune !
Dans cette quête de souvenirs, les fantasmes font bien souvent place à la réalité idyllique, parce que, chez lui aussi la mémoire enjolive les moindres faits, les sublime et y instille un arrière-goût de nostalgie. Il nous invite avec un humour consommé, à parcourir cette enfance, à la fois dissipée et innocente, rapidement désabusée et pourtant amusée, à l’image de l’enfant qu’il était et qui ouvrait sur le monde ses grands yeux étonnés, comme le montre la photo de la couverture. Elle s’est déroulée sous l’égide, sinon sous la bienveillance complice, de son grand-père, ex-colonel dans l’armée révolutionnaire, d’une mère aimante et généreuse, d’un père éternel rêveur un peu volage, de la pauvreté, de la chance … L’auteur y déroule avec humour une vie où son histoire personnelle, faite de lectures, de femmes, d’alcool, d’amitiés, de rencontres dans des bars, des bordels, des salles de rédaction, se confond parfois avec celle de son propre pays. Ce livre montre à quel point sa propre existence nourrit une œuvre littéraire hors du commun.
Lire un livre de Gabriel Garcia Marques c’est tout simplement passer un moment merveilleux et j’appliquerai volontiers à cet ouvrage la remarque qu’il fait lui-même « Je n’ai jamais oublié qu’on ne devait lire que les livres qui nous obligent à les relire ».
-
DOUZE CONTES VAGABONDS - GABRIEL GARCIA MARQUEZ - GRASSET.
- Le 01/04/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°269 – Février 2007
DOUZE CONTES VAGABONDS – GABRIEL GARCIA MARQUEZ – GRASSET.
De ces douze contes vagabonds, je ne dirai rien, sinon qu'ils sont à l'image des textes que Marquez écrits avec un talent et un humour qui ne se démentent pas et qui tiennent en haleine le lecteur dont la curiosité demeure en éveil, de la première à la dernière ligne. Son écriture jubilatoire m'a toujours enchanté. Depuis sa création, cette chronique s'est d'ailleurs fait l'écho de l'œuvre du Prix Nobel, et ce n'est pas maintenant que je vais changer d'avis! Je noterai quand même que beaucoup de ses contes se terminent par la mort ou l'évoquent, mais celle-ci n'est pas triste, n'inspire pas la crainte et n'est pas tabou comme en occident. Au Mexique où vit l'auteur, la mort est joyeuse, elle est une fête lorsque les disparus reviennent visiter les vivants qui leur font fête et célèbrent ainsi leur mémoire. Ils accompagnent les hommes au quotidien...
On lit rarement les prologues. Celui-ci est intéressant. L'auteur y évoque le processus de l'écriture, au vrai, une véritable alchimie avec ses biffures, ses ratures, ses épluchures de gomme, ses hésitations, ses archivages minutieux, ses incertitudes d'avenir... Il parle aussi du plaisir d'écrire, car c'en est un, malgré l'impérieuse nécessité de la correction, l'implacable dictature de l'inspiration, la disponibilité obligatoire de l'auteur devenu son esclave volontaire, la nécessité du travail toujours recommencé“[au]plaisir d'écrire, le plus intime et le plus solitaire qui soit, et si l'on ne passe pas le restant de ses jours à corriger le livre c'est parce qu'il faut s'imposer, pour le terminer, la même implacable rigueur que pour le commencer”. Il rappelle lui-même, comme une sorte de consolation “qu'on apprécie un bon écrivain à ce qu'il déchire plus qu'à ce qu'il publie”. Et lui de parler de l'incessant vagabondage de ces contes “entre [son] bureau et sa corbeille”, soulignant ses doutes, ses renoncements, son travail toujours recommencé. Son recueil tire de là son titre, sans doute?
Dans ce contexte du temps qui passe, de la mémoire qu'un écrit conserve des lieux et des personnages évoqués alors que l'auteur lui-même en est oublieux, Marquez note “Les souvenirs réels me paraissaient des fantômes de la mémoire tandis que les faux souvenirs étaient si convaincants qu'ils avaient supplanté la réalité. Si bien qu'il m'était impossible de discerner la frontière entre la désillusion et la nostalgie”. Remettre sur le métier un texte en se disant qu'il sera meilleur plus tard, cela joue des tours et il note non sans humour “ Je n'ai jamais relu aucun de mes livres par crainte de me repentir de les avoir écrits”. C'est que, il l'avoue lui-même, les douze contes qui composent ce recueil ont été écrits au long de dix huit années. Certains ont connu des fortune diverses, mais Marquez insiste, ne serait-ce, dit-il, qu'à l'usage des enfants qui veulent devenir écrivains,”Qu'ils sachent...combien le vice de l'écriture est insatiable et abrasif”. Dont acte, car il sait de quoi il parle!
Les idées viennent au créateur par des voies détournées et souvent inattendues, à travers le voyage ou l'immobilité, l'éveil ou le songe, mais ce qu'il sait en revanche, et il est le seul à le savoir, c'est qu'il ne doit pas les laisser s'évanouir dans l'oubli, il doit obligatoirement les travailler, les exploiter, les faire grandir... Et ce d'autant plus qu'elles lui ont été offertes gracieusement, mais en même temps avec la conviction intime qu'il est en quelque sorte le débiteur de cette voix mystérieuse que d'aucuns habillent de divinité, mais à la disposition de laquelle il doit se mettre sans même discuter, sous peine de n'en être plus jamais le sujet... Abandonner une bonne idée peut être un signe d'humilité, mais la prudence oblige parfois à l'archivage. On ne sait jamais! C'est vrai que l'écrivain, si célèbre soit-il, se doit d'être humble devant le phénomène même de l'écriture. Il n'ignore pas, en effet, qu'il reste totalement dépendant de cette vibration extraordinaire dont il a fait son métier, et ce malgré toute sa culture, tout son travail, toute son expérience et toute sa sensibilité... Même pour l' écrivain, l'écriture reste un mystère! L'état d' écrivain a ses grandeurs, mais aussi ses servitudes!
L'auteur est aussi un témoin, non seulement de sa propre personnalité, de son propre talent, mais aussi, et peut-être surtout, de son temps, du peuple dont il fait partie, de la culture qu'il incarne, de la condition humaine.
Ces contes procurent un moment unique de lecture, mais j'apprécie aussi la préface, elle rappelle des vérités sur le matériau même du livre, l'écriture!
-
QUELQUES MOTS SUR GABRIEL GARCIA MARQUEZ [à travers trois livres]
- Le 01/04/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°298– Avril 2008
QUELQUES MOTS SUR GABRIEL GARCIA MARQUEZ [à travers trois livres]
Je ne sais pas ce qui motive cette lecture effrénée de Marquez, sans doute l'inflation de ce qui se publie actuellement qui n'implique malheureusement pas la qualité de l'écriture et qui m'entraîne insensiblement à lire et à relire les bons auteurs, en tout cas ceux qui ont la particularité de m'étonner. Marquez est de ceux-là et les lecteurs de cette chronique savent l'intérêt jamais démenti que je lui porte. Il est un des rares qui peut raconter une histoire à partir de trois mots anodins en apparence mais qui captive son lecteur pendant plusieurs centaines de pages sans que l'ennui s'insinue dans la lecture. Le seul nom de Marquez retient mon attention. Plus sans doute que les autres auteurs, il s'empare de la réalité, que cela soit de sa propre vie ou de l'histoire, se l'approprie et en fait une fiction merveilleuse.
Par exemple « Pas de lettre pour le colonel »[Editions Grasset] raconte l'histoire, sur fond de misère et d'improbables tribulations autour d'un coq de combat, d'un ancien combattant péruvien, colonel à 20 ans, qui attend désespérément, depuis de trop nombreuses années une pension d'ancien combattant qui ne viendra jamais, à cause du perpétuel changement de gouvernement, des restrictions budgétaires et surtout de l'oubli général...
Dans le style du journaliste qu'il a été, Marquez évoque dans « Journal d'un enlèvement »[Editions Grasset] cette période délétère de l'histoire de la Colombie émaillée d'enlèvements, d'assassinats politiques, de terrorisme, d'attentats, de guerrilla, de corruption sur fonds de lutte contre les narco-trafiquants du cartel de Medellin, les complexités du pouvoir politique, des descentes meurtrières de police. Ce n'est pas à proprement parler un livre dans le droit fil des romans quelque peu baroques de Marquez. Ici, le registre est plus sobre pour évoquer l'angoisse, les espoirs des otages et de leurs familles. Ce livre pourtant publié en 1997 est malheureusement d'actualité puisqu'il évoque une triste habitude de la Colombie de pratiquer l'enlèvement.
Avec « Le général dans son labyrinthe »[Editions Grasset] , je note que ce roman est dédié à Alvaro Mutis dont il a été longuement question dans cette chronique depuis sa création.] Marquez renoue avec son style teinté d'humour subtil que des formules laconiques soulignent à l'envi. Mêlant fiction et réalité, Il s'empare du personnage à ce moment précis et narre le dernier voyage du général Bolivar, héros de l'Amérique Andine, qui ayant quitté le pouvoir, part pour un exil sans retour et renoue avec ses souvenirs guerriers et glorieux, avec celui des femmes qui partagèrent fugacement sa vie. Il jette un regard désabusé sur ce que fut sa vie, mais aussi sur l'ingratitude de ses contemporains et sur la condition humaine, le sens de cette vie qui s'achève.. C'est que, après tant d'année à guerroyer contre les Espagnols, il entame, en compagnie de son hamac et de son fidèle serviteur, son dernier voyage, celui qui le conduira à la mort. C'est un récit à la fois émouvant et épique des quatorze derniers jours d' « El Liberador » qui voyait ainsi s'achever cette vie labyrinthique qui aurait pu être celle d'un paisible propriétaire mais que le destin a fait basculer. J'y vois l'hommage d'un Colombien illustre à un compatriote qui ne l'est pas moins.
-
Deux écrivains sud américains – Gabriel Garcia MARQUES – Alvaro MUTIS
- Le 01/04/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
Je ferai à peu près la même remarque à propos de l’excellent roman d’Alvaro Mutis « Un bel morir » (GRASSET) qui retrace la vie aventureuse de Maqroll El Gaviero avec un art consommé de la narration.
Ce personnage qui mène une existence folle et amoureuse sur tous les endroits malfamés du globe a tous les attributs du marin qu’il est. Pourquoi cependant est-il venu se perdre dans ce coin de la Cordillères et est-il devenu le complice un peu involontaire de trafiquants d’armes ? Pourquoi est-il innocenté par un militaire et va-t-il mourir dans les marais à la barre d’une mauvaise embarcation, un peu comme quelqu’un qui choisir de mettre un terme à un voyage trop long et fatigant, aux confins de la terre et des eaux, où on ne distingue pas vraiment l’un de l’autre.
Il a donc posé son sac d’aventurier avec le souvenir de toutes les femmes qu’il a aimées.
Il est de la race des héros mythiques qui n’en finissent pas de mourir et de ressusciter (n’a-t-il pas deux noms ?) et que personne, surtout pas l’auteur lui-même, ne peut ni ne doit tuer, même d’un coup de plume !.
© Hervé GAUTIER.
-
Deux écrivains sud américains – Gabriel Garcia MARQUES – Alvaro MUTIS
- Le 01/04/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°75
Août 1991
Deux écrivains sud américains – Gabriel Garcia MARQUES – Alvaro MUTIS
Je n’ai vraiment aucun mérite à conseiller la lecture de « Cent ans de solitude » de Gabriel Garcia Marques.
On ne se lassera pas de lire ce roman où le style n’a d’égal que les invraisemblables mais passionnantes aventures qu’il raconte. J’avoue, comme à chaque fois que j’ouvre un de ses livres que je prends le même plaisir à goûter son exceptionnel talent qui accapare le lecteur dès la première phrase et l’abandonne, un peu désorienté à la dernière en l’ayant entraîné dans un autre univers où le temps semble battre à un rythme différent du nôtre et où le destin des acteurs de cette grande épopée se déroule dans un microcosme à l’abri du reste du monde.
Dans cette saga où les personnages paraissent vivre à la dérive dans une marginalité délirante, le quotidien le dispute au merveilleux avec toujours cette verve poétique si attachante.
-
RECIT D’UN NAUFRAGE – Gabriel Garcia MARQUEZ – Editions Grasset.
- Le 01/04/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°158
Juin 1993
RECIT D’UN NAUFRAGE – Gabriel Garcia MARQUEZ – Editions Grasset.
Il s’agit d’une histoire contée par un marin, un de ces hommes en perpétuelle errance qui ont choisi la mer pour fuir ou chercher quelque chose sans trop savoir ce que c’est.
Le décor : la mer des Caraïbes qui a vu tant de navires disparaître et où le mystère s’épaissit à chaque naufrage.
Le récit : après l’accident d’un destroyer de la Marine colombienne, l’histoire d’un homme qui se débat et survit sur un radeau à la faim, à la soif, à la peur, aux hallucinations, avec l’espoir de croiser un avion ou un bateau.
Comme je l’ai déjà dit dans cette chronique, Gabriel Garcia MARQUEZ est un de ces écrivains qui prennent et passionnent leur lecteur dès la première ligne et ne l’abandonnent qu’à la fin du roman, grisé de dépaysement et toujours un peu déçu que le récit soit déjà terminé.
En outre, il est de ces écrivains sud-américains dont le style possède cette musique, cette odeur, et cette chose intraduisible qui fait dire au lecteur qu’il a passionnément aimé un livre.
-
DEUX ROMANS DE GABRIEL GARCIA MARQUEZ.
- Le 01/04/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°146
Février 1993
DEUX ROMANS DE GABRIEL GARCIA MARQUEZ.
J’ai déjà écrit dans cette chronique que la récente publication d’un livre n’était pas le seul critère d’intérêt pour le lecteur. L’ouvrage reste permanent et garde en lui sa part de rêve et de dépaysement. Il n’attend que l’amateur.
*
Ainsi ces deux ouvrages de Gabriel Garcia Marquez, La Mala hora tout d’abord qui a pour décor un petit village de Colombie écrasé de chaleur où s’abattent parfois des orages tropicaux qui balayent tout sur leur passage et transforment le fleuve tout proche en un impétueux torrent de boue. Il ne s’y passe rien sinon que dans ses rues et entre les murs de ses maisons enfle une rumeur qui se nourrit d’affiches anonymes apposées nuitamment... Elles apportent au village son lot d’incertitudes et de doutes…
César Montero tue un matin l’amant de sa femme. Dès lors vont entrer en scène pendant dix sept jours le Maire, torturé par une rage de dents, le Père Angel, absorbé par les devoirs de sa charge… Cependant le temps semble s’écouler avec la lenteur qui sied à ces latitudes, mais ces cieux tourmentés ont aussi connu, il n’y a pas si longtemps la guerre civile avec ses querelles politiques , ses assassinats. L’absence de légitimité des gouvernants le dispute à la soif de revanche des opposants.
Pourtant, on affirme bien haut que les choses ont changé, et ce, malgré les affiches qui ne révèlent rien qu’on ne connaissent déjà. Cependant les passions finiront par se déchaîner et la terreur reprendra comme avant.
*
Le second ouvrage, qui est aussi le premier de Garcia Marquez met l’accent sur un thème qui lui est cher, celui de la solitude. Des feuilles dans la bourrasque rassemble au début trois personnages autour d’un cercueil. Chacun donne libre cours à ses pensées. Ils évoquent le mort, un médecin qui vient de se pendre, un homme que tout le village exécrait parce qu’il avait un jour refusé de soigner des blessés et qui depuis vivait reclus chez lui.
A cause d’une promesse l’un des personnages, un vieux colonel, va l’enterrer pour qu’il ne soit pas la proie des vautours. Il le fera malgré la haine du village de Macondo, jadis enrichi par une société bananière et qui maintenant n’est plus que l’ombre de lui-même…
Cette impression de solitude est accentuée par les monologues entrecroisés des différents personnages. Le décor de ce roman, autant que le thème qui y est traité préfigurent déjà l’œuvre de Garcia Marquez.
Ces deux romans sont publiés chez Grasset.
-
LE TEMPS DE GRACE - Maria Judite de Carvalho - Editions de la Différence.
- Le 31/03/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°228
Juillet 2000
LE TEMPS DE GRACE – Maria Judite de Carvalho – Editions de la Différence.
Qu’est ce qui fait qu’un homme, Mateus Silva, sur terre temporairement comme nous tous, mais perpétuellement en transit partout où il passe et continuellement en regret, aspire à vivre seul alors qu’on nous rebat les oreilles avec un bonheur qui ne peut se vivre qu’à deux ?
Il n’a jamais accepté les compromis que chaque homme doit faire avec la vie, ces petits arrangements qui la font, sinon belle, à tout le moins plus supportable. Il vit avec ses remords, ses deuils. Il n’a jamais réussi et ne réussira jamais, parce qu’il n’a pas le sens des choses ni des bonnes transactions, parce qu’il accepte sans broncher les petitesses d’un emploi subalterne, parce qu’il regrette sa mère, son père absent et volage, parti mourir au-delà des mers…
De son enfance, il garde des images merveilleuses et irréelles, un peu comme celles d’un paradis définitivement perdu qu’on ne retrouvera jamais. Il en conserve aussi un diminutif de son nom, comme s’il n’était pas actuellement la même personne…
S’il vend la maison de ses parents, désormais sienne, mais vide, déserte depuis longtemps et presque devenue étrangère pour lui, c’est moins pour gagner de l’argent que pour se forcer à tourner une page dans sa vie.
Il évoque son camarade Ginho qui a réussi, lui, et qui fera sûrement un beau et surtout un riche mariage. Il revoie Dona Mercês, la mère de son ami, dont jadis la beauté le faisait rêver et sûrement aussi un peu fantasmer. Elle est désormais laide, vieille et a choisi d’oublier le temps où la moralité ne guidait pas sa vie et où elle était la maîtresse de son père. C’est peut-être à cause d’elle qu’il était parti et que son épouse était morte d’avoir été abandonnée ?
Osorio, le mari de Dona Mercês, lui, se contente de gagner de l’argent et ne s’occupe pas du reste. La vie pour lui n’est pas autre chose que cela, faire des affaires…
Mateus a une femme, Alberta, torturée par la maladie et qui veut voir l’Acropole avant de mourir. Elle est entrée dans sa vie presque par hasard et la quittera comme par effraction.
Après cela ce sera la solitude mais sûrement pas la vie avec Natalia, la fille de Dona Mercês. Au début le lecteur peut supposer qu'elle est sa demi-sœur, celle qui serait née des amours illicites de Mercês et de son père mais il n’en est rien. Il la laissera cependant s’éloigner alors que tout était possible entre eux, une passade comme une vie plus stable qui aurait pu faire de lui le beau-frère de Ginho et lui assurer un avenir plus sûr…
Nous ne sommes sur terre que de passage. Le temps s’écoule inexorablement et inscrit sa marque sur notre corps et creuse des rides sur notre visage… C’est là une des contingences de la condition humaine : nous vieillissons, mais s’il fallait recommencer sa vie, il y a fort à parier que nous ferions les mêmes choix !
© Hervé GAUTIER.
-
PAULA – Isabel ALLENDE – FAYARD.
- Le 30/03/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°275 – Juillet 2007
PAULA – Isabel ALLENDE – FAYARD.
(traduction Pierre Guillaumin)
Avec ce livre, le lecteur replonge dans la généalogie de la famille Allende et dans l'extraordinaire plaisir ressenti à la lecture d'histoires que l'auteur excelle à raconter, mais, cette fois, ce texte est destiné à sa fille qui ne l'entend peut-être pas puisqu'elle est plongée dans un coma prolongé. Porphyrie, nom barbare qui évoque une roche rouge comme de sang! C'est le nom de cette maladie contre laquelle lutte sa fille Paula alors âgée de vingt neuf ans, mais maladie rare et qui n'intéresse personne. Sa mère l'accompagnera donc avec sa présence, ses mots, ses messages d'amour, ses soins...
Pourtant, la lecture de ce livre m'a laissé une impression bien différente du précédent [la FV n°274] Le contexte est certes éloigné de « La maison aux esprits » et le style forcément moins jubilatoire, plus ordinaire, même quand elle évoquent les personnages de sa vie et sa vie elle-même avec son cortège de conquêtes amoureuses, ses périodes de déprime, ses échecs, ses contradictions, la genèse de ses l:ivres dont elle veut parler à sa fille. Mais il y a autre chose, une sorte de malaise que j'ai ressenti tout au long de ce livre. J'ai eu l'impression, fugace d'abord, puis qui s'est affermie à mesure que je tournais les pages, que ce monologue ressemblait un peu à quelque chose comme une relation qui n'avait existé qu'en pointillé entre une mère et sa fille et que, celle-ci étant au pas de la mort, celle-là voulait rattraper le temps perdu, lui dire tout en bloc alors que toutes ces choses auraient pu être distillées patiemment, avec complicité, avec un rythme différent peut-être?
Puisque la mère redoutait la mort de sa fille, j'attendais peut-être inconsciemment qu'elle retraçât sa courte existence à elle pour garder le souvenir de son passage sur terre, mais rien. Il y a bien cette tentative « Tu veux que je te parle de la période de ton enfance... », mais rien sinon l'histoire immédiate du Chili avec les figures de Salvador Allende et de Pablo Néruda, symboles d'une démocratie assassinée... et la vie de sa mère « quarante neuf ans à toute vitesse... » sans autre but que « la poursuite d'objectifs aujourd'hui oubliés » et donc sans importance. Du temps perdu qu'on ne rattrape jamais! Elle le dit d'ailleurs elle-même « Cette fille qui est ma fille, qui est-elle? » ou encore « Ma fille m'a donné l'occasion de regarder en moi, de découvrir des espaces intérieurs vides, obscurs, étrangement paisibles que je n'avais pas encore explorés ».
Je verrais plutôt dans ce témoignage l'illustration d'une des fonctions de l'écriture, celle qui exorcise la douleur de voir ainsi sa fille en souffrance et qui, peu à peu quitte ce monde sur la pointe des pieds, et de l'idée obsédante de devoir aller à l'enterrement de son enfant, d'être désormais seul, orphelin de lui, si l'on peut dire, et donc sans aucun avenir, proclamer aux autres qui soudain choisissent d'oublier jusqu'à votre présence parce que vous n'êtes plus dans la norme, que la mort est un injuste gâchis surtout quand elle emporte un être jeune!
Il y a probablement une autre fonction insoupçonnée de l'écriture qui est celle de la miséricorde après la confession. C'est bien cela aussi, ce livre résonne pour moi non comme un récit mais comme des explications qu'on donne à sa fille dont la vie s'en va. l'auteur se justifie, apporte des réponses aux questions qu'elle suscite elle-même, affirme sans ménagement, cherchant dans tout cela une explication extralucide ou une révélation puisée dans le langage du tarot ou dans les arcanes des songes.
Perdre un enfant est la pire épreuve qui soit, non seulement parce qu'on est seul à affronter cette tourmente, parce que le temps n'a rien d'apaisant, au contraire, et parce que cette douleur ne s'éteindra qu'avec sa propre mort! Le seul baume, dans ce triste bouleversement est l'accompagnement des siens, même si chacun vit cette épreuve à sa manière et comme il le peut. La parole aussi est apaisante et l'écriture procède de cette démarche. Cette forme de création permet l'évasion autant que l'exorcisme et les arcanes de l'inspiration produisent parfois des effets inattendus, étranges, déroutants pour celui-là même qui est censé en être l'auteur, parce que les livres sont un univers douloureux mais parfois s'écrivent tout seuls, quand nous nous y attendons le moins, parce qu'on le porte en soi depuis longtemps et qu'ils choisissent de naître tout seuls, insufflant à leur auteur un peu d'humilité. Il y a aussi ce tourbillon de l'histoire qu'on raconte mais qu'en réalité se compose elle-même au fur et à mesure que l'écriture s'en fait le témoin.
Cette épreuve nous rappelle que, selon les mots d'Aragon « rien n'est jamais acquis à l'homme », que la mort frappe au moment où nous nous y attendons le moins, que c'est une des facettes de la condition humaine contre laquelle nous ne pouvons lutter. Alors, on se raccroche à tout ce qui peut être un point d'ancrage dans cette vie devenue soudain insupportable. On se dit que son souvenir ne nous quittera jamais, qu'il sera plus présent en nous que s'il était vivant... Ce genre d'épreuve transforment à jamais ceux qui la traversent. Elle suscite les choses les plus étranges où se manifeste à la fois l'inconscient, les croyances, la certitude d'avoir des réponses à ses questionnements les plus fous! Il y a aussi cette improbable volonté de voir dans le hasard qui gouverne nos vies, des signes auxquels on veut à toute force être attentif et dans lesquels on veut lire des significations...
Il y a aussi ce rythme permanent et cyclique de la vie, comme si les événements étaient traçés à l'avance, les choses à jamais figées, l'inutile bataille perdue d'avance contre la mort et l'impossible troc de sa propre vie contre celle de celui qui va mourir!
C'est pourtant un livre que j'ai lu avec passion, presque sans désemparer. Ce qui m'a le plus ému, c'est sans doute l'épilogue, la description des gestes et événements, comme en filigranes, qui accompagnent le départ de Paula pour une autre dimension. Paradoxalement peut-être, je ne l'ai pas ressenti comme quelque chose de triste mais plutôt comme un apaisement, avec tous les fantômes des parents disparus, les figures diaphanes des vivants présents ou absents!
© Hervé GAUTIER - juillet 2007
-
LA MAISON AUX ESPRITS – Isabel ALLENDE – FAYARD.
- Le 30/03/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°274 – Juin 2007
LA MAISON AUX ESPRITS – Isabel ALLENDE – FAYARD.
(traduction Claude et Carmen Durand)
Je le confesse bien volontiers, avant ce livre, je ne connaissais pas Isabelle Allende, mais mon irrésistible passion pour les écrivains sud-américains m'a tout naturellement entraîné vers elle. J'ai lu son livre avec gourmandise et intérêt, je n'ai pas été déçu! Faire des comparaisons, évoquer d'autres écrivains qu'on juge “cousins” à la lecture d'un roman est toujours un exercice à haut risque, parce que, sans renier l'apport de ses pairs, même s'il s'agit d'un premier roman[publié en 1994], l'auteur veut toujours être lui-même. La quatrième de couverture sacrifie à ce qu'on peut considérer comme une tradition. Eh bien, que mon improbable lecteur me pardonne, tout au long de la lecture de cet ouvrage, j'ai pensé à Gabriel Garcia Marquez! Ici, j'ai retrouvé sa verve intarissable, son sens du détail où l'humour le dispute à la précision du verbe.
Comme lui, elle a ce don de l'écriture qui prend le lecteur au début du récit par une phrase courte et apparemment anodine, ici “Barrabas arriva dans la famille par voie maritime, nota la petite Clara de son écriture délicate”, et l'abandonne quelques cinq cents pages plus tard, émerveillé par ce qu'il vient de lire, étonné d'avoir pu être tenu en haleine par un récit rendu passionnant autant par un style jubilaitoire que par le sens consommé de la relation d'une histoire où jamais l'ennui ne s'insinue dans sa lecture, ou le réalisme le disputre au burelesque et parfois au tragique, et surtout un peu triste que cela s'arrête!
Je dois également souligner que la traduction n'est pas être étrangère à cette complicité heureuse qui se tisse entre l'auteur et son lecteur.
Isabelle Allende nous invite donc dans cette famille dont elle nous présente chaque membre à travers l'histoire de sa vie et les arcanes de son destin; elle le fait comme un témoin qui rassemble ses souvenirs pour les confier au papier, mais laisse Esteban Trueba, le grand-père qui va mourir, exprimer à la première personne et brièvement, ses états d'âme et ses remords.
Il y a, certes, l'humour qui marque les choses, ce petit arrangement avec l'existence qui permet de s'en moquer. Elle paraît ainsi moins dure, plus acceptable, moins invivable. Il y a, aussi le compte rendu fait au lecteur autant qu'à soi même par l'auteur, l'histoire qui arrache un sourire intérieur en se disant que « voilà au moins quelqu'un qui écrit bien »... Mais quand même, il faut aller au-delà et bien des scène rapportées ne prêtent pas à sourire, bien au contraire. Le talent de l'écrivain force l'attention parce qu'elle rend compte de la réalité de la vie, qu'elle choississe de décrire un paysage désolé, la condition du petit peuple ou l'édification d'une fortune, la décrépitude d'une personne en fin de vie. C'est que l'histoire de cette famille, racontée sur trois générations se confond avec l'histoire de ce pays d'Amérique latine jamais nommé, mais que le lecteur identifiera facilement, surtout à la fin parce qu'il évoque désormais la démocratie assassinée, mais aussi parce que le nom de l'auteur y est également et définitivement associé. Elle y plante le décor, dans cette maison labyrinthique dite « du coin », elle est un peu une unité de lieu comme l'est aussi celle des « Trois Maria ». Esteban Trueba y traverse le temps, y bousculent les événements, les épousent en fonction de ses intérêts ou de ses convictions, entouré de ses bâtards, de ceux qu'ils appelle pompeusement « ses gens », de flagorneurs et surtout de femmes. Car les véritables personnages de ce roman sont des femmes, Rosa la belle qu'il ne put épouser, Clara la clairvoyante qui la remplaça, Blanca sa fille et Alba sa petite-fille, et même secondairement les soeurs Mora, Férula et Transito Solo... Chacune d'elles imprime sa marque, pèse sur ce qui fait la trame de cette histoire. Certaines d'entre elles ont des dons pananormaux et, invoquant les esprits des morts, les font réapparaître et lisent l'avenir dans leurs rêves. C'est à Alba, sa petite fille et non à un mâle, qu'il passe en quelque sorte le relais et la responsabilité de transmettre la vie et de faire perdurer la dynastie qu'il a fondée. C'est le souvenir de son épouse morte qu'il invoque avant lui-même de remettre son âme à la mort. Pourtant, au risque d'étonner mon lecteur, je dirai cependant que cette histoire est assez banale. Toutes les familles comptent dans leur sein des êtres uniques qui emplissent l'espace autour d'eux et parfois écrasent ceux qui vivent dans leur ombre. Ici, l'art de la romancière transcende les événements qu'elle rapporte, met en scène les personnages pour le plus grand plaisir du lecteur.
Dans un roman, on prend la mesure du temps et de l'usure des choses, de la dimensions des personnages, de leur côté dérisoire et parfois ridicule. Le lecteur attentif comprend que le monde y est petit et que la vengence qui anime les êtres finit toujours par déverser son fiel, il assiste à la réalisation de cette fresque sans fard de la condition humaine, de ses grandeurs, de ses facettes cachées, pitoyables ou secrètes parfois, de sa force mais aussi de ses fragilités... comme dans toutes les sagas, il y a ceux qui réussissent et ceux qui lamentablement échouent, ceux qui s'adonnent aux plaisirs de la vie et qui lui brûlent des cierges, ceux qui préfèrent parler à Dieu et Lui offrir encens et prières, ceux qui veulent tout changer et ceux qui jettent sur elle le regard désabusé du spectateur blasé que rien n'étonne plus, ceux qui choississent de n'être rien qu'eux-mêmes... Au cours de ses chapîtres on célébre la vie mais la Camarde pousse son linceul... Par le miracle à chaque fois renouvellé des mots, les morts ressucitent et les souvenirs se débarrassent de leurs scories de malheur, s'habillent d'une douce patine.
La vie, l'amour, la mort, ces thèmes éternels peuplent les romans depuis que l'écriture a été instituée comme support de la mémoire, des fantasmes et de l'imagination, comme moyen d'exprimer ses joies et d'exorciser ses peines, parce que, malgré les apparence, le livre est un univers douloureux où l'auteur modèle à l'envi d'évanescentes aquarelles, des esquisses sombres ou des dessins couleur sépia.
© Hervé GAUTIER - juin 2007
-
CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE. - Gabriel Garcia MARQUES - Editions GRASSET.
- Le 30/03/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°53
Février 1991
CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE. - Gabriel Garcia MARQUES - Editions GRASSET.
Il est des écrivains bénis qui captent l’attention de leur lecteur dès la première ligne et l’abandonnent à la dernière, perplexe mais ravi d’avoir tenu entre leurs mains un chef-d’œuvre. Gabriel Garcia Marquez est de ceux-là qui, avec « Chronique d’une mort annoncée » tient en haleine l’impatient témoin de cette histoire qui aurait pu se résumer en quelques phrases.
A travers un enchevêtrement de faits, de contre-temps et de personnages, l’auteur nous raconte avec humour et un sens consommé du suspens l’assassinat d’un homme et sa préparation où la nécessité de laver l’honneur d’une femme le dispute à la fatalité.
-
BUREAU DE TABAC - Alvaro de Campos [Fernando PESSOA] Edition UNES.
- Le 30/03/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°277 – Juillet 2007
BUREAU DE TABAC – Alvaro de Campos [Fernando PESSOA] Edition UNES.
C'est sans doute une drôle d'idée et assurément un manque d'humilité de ma part que de vouloir présenter ce poète qu'on ne présente plus, de vouloir parler de lui dont on parle encore, et pour longtemps encore, d'oser commenter une partie de son oeuvre... Eh bien j'ose puisqu'il me fascine toujours, davantage peut-être par ce qu'il a été que par ce qu'il a écrit..
C'est un bien étrange tableau que nous dessine Alavaro de Campos, alias Fernando Pessoa. Il est à la fois tout en nuances et plein de couleurs crues, de coups de pinceaux abrupts. La forme interpelle d'abord. Ce poème est écrit en strophes inégales et sans grande logique, alternativement descriptives (la rue)et introspectives (ses interrogations sur lui-même et sur le monde)en insistant toutefois sur ces dernières, sans beaucoup d'action, avec cependant des remarques de nature philosophique mais aussi inattendues, comme l'allusion au chocolat qu'une improbable petite fille est invitée à manger. L'auteur nous indique qu'il préfère cette friandise à la métaphysique! Cela laisse une curieuse impression de phrases juxtaposées et parfois contradictoires, comme nées d'une écriture automatique.
Il semble que nous ayons affaire à quelqu'un de désespéré qui s'approche de sa fenêtre avec le sentiment diffus qu'il ne verra pas la fin de la journée. Nous n'avons pas de renseignements précis sur lui ni sur l'étage où se trouve cette ouverture, mais, j'ai l'impression qu'elle est au moins au premier, en ce sens qu'elle semble ouvrir sur un vide attirant. Cette impression suicidaire est corroborée par les idées fugitives qui sont couchées sur le papier, comme s'il était urgent de les exprimer au fur et à mesure qu'elles lui viennent. Tout commence par une sorte d'aphorisme [« Je ne suis rien »] qui évoque un sentiment d'impuissance, tout aussitôt suivi de son contraire[« Je ne peux vouloir être rien »], puis viennent pêle-mêle des remarques sur le monde auquel il appartient et qu'il va sans doute quitter. Il fait allusion à la mort, au destin, au temps qui passe, se dit lucide, perplexe, se déclare « raté » parce que le hasard ne lui a pas été favorable et il remâche ses échecs, que ceux-ci soient de sa faute [« Je jette tout par terre comme j'ai jeté ma vie – J'ai fait de moi ce que je ne pensais pas et ce que je pouvais faire de moi, je ne l'ai pas fait - J'ai enjambé la formation qu'on m'a donnée par la fenêtre de derrière »] ou simplement de celle du hasard [« Le domino que j'ai mis n'était pas le bon », pour aussitôt se demander s'il n'est pas au contraire un génie méconnu[« Génie? En ce moment, cent mille cerveaux se prennent en rêve, comme moi, pour des génies »], ce qui engendre une interrogation sur lui-même[« Que sais-je ce que je serai, moi qui ne sais qui je suis? »], une sorte d'auto-suffisance de celui qui a toujours été incompris et qui dénonce le côté dérisoire de cette vie [« Toujours une chose aussi inutile que l'autre, toujours l'impossible en face du réel »]. Il se sent en ce monde « comme en exil», « comme un chien toléré par la direction parce qu'il est inoffenssif » avec la mort « qui moisit les murs et blanchit les cheveux des hommes » et dont on ne sait, en cet instant, s'il la souhaite ou s'il la redoute.
Son désarroi est grand qu'il exprime par des mots forts [« Mon coeur est un seau vide »]. Cet homme est un adulte et nous imaginons qu'enfant il avait déjà tissé des projets d'avenir qui ne sont maintenant plus que des souvenirs inconsistants [« Je porte en moi tous les rêves du monde »] Il a vu dans la vie une extraordinaire occasion de faire bouger les choses, de faire changer ce vieux monde, d'y laisser sa marque, mais ses rêves se sont révélés être des chimères. [« Combien d'aspirations hautes, nobles et lucides... ne verrons jamais la lumière du vrai soleil »] . En cela il est le reflet de la condition humaine. C'est un simple humain assujetti à la fuite du temps, à la vieillesse, à la mort, au destin « qui mène la carriole de tout sur la route de rien ». Pour lui cette prise de conscience génère un malaise [« Foulant aux pieds la conscience de se sentir exister, comme un tapis où trébuche un ivrogne »], un doute [« Non, je ne crois pas en moi » - « Que sais-je de ce que je serai, moi qui ne sais qui je suis »] et rien d'autre ne pourra l'en guérir, ni les religions [Dieu?] ni même l'écriture et surtout pas la métaphysique qui « n'est que le résultat d'une indisposition ».
C'est un être tourmenté, facette hétéronyme de Pessoa, à la fois conscient de son inexistence et porteur d'ambitions qu'il n'atteindra jamais, un paradoxe apparent. Il le sait et le déplore, le regrette aussi parce qu'on ne peut se satisfaire d'une telle image de soi-même, coincé entre réalité et rêve. C'est aussi un idéaliste qui fait prévaloir l'écriture et attend vainement le succès, la notoriété peut-être [« Je serai toujours celui qui attendait qu'on lui ouvrît la porte, au pied d'un mur sans porte qui chantait la chanson de l'Infini dans un poulailler »]. Il me semble qu'il entretient avec son écriture une relation à la fois salvatrice et malsaine en ce sens qu'il vit par elle et pour elle, mais la légitime notoriété qu'il en attendait n'a jamais été au rendez-vous où peut-être ressent-il une impossibilité de s'exprimer complètement? Dès lors, il en parle comme d'un « portail en ruines sur l'impossible » et allume une cigarette au lieu de prendre la plume, comme si, en cet instant, sa fumée, bleue et légère, valait mieux que tout!
Il s'interroge sur l'inutilité de ce qu'il a écrit mais pense sérieusement à recommencer, fait allusion aux femmes qui consolent du mal de vivre pour revenir au spectacle de la rue, véritable toile de fond dynamique de cette évocation, au patron du tabac d'en face, à un client, à une cigarette qu'il allume, à la fille de la blanchisseuse qu'il pourrait épouser et ainsi être heureux. Ce client c'est « Estève-n'a-pas-de-métaphysique », et à qui tout son univers est étranger, il le connaît, le salue, c'est comme si la vie reprenait le dessus avec son quotidien, comme si la seule vue de cet homme suffisait à lui rendre l'envie de vivre.
C'est le texte d'un désespéré que le spectacle simple du réel, la rue, la boutique du buraliste d'en face, le patron avec son cou endolori, le client qui est simplement venu acheter du tabac, fait reprendre temporairement goût à la vie. A tout le moins a-t-il décidé lui-même de lui donner dernière chance, même s'il avoue que ce monde lui et étranger, qu'il n'a rien à y faire. « L'univers s'est refermé sur moi sans idéal et sans espoir et le patron du Tabac a souri. »
© Hervé GAUTIER - juillet 2007.
-
CANCIONEIRO[Poèmes 1911- 1935] – Fernando Pessoa – Christian BOURGOIS Éditeur.
- Le 30/03/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°288– Décembre 2007
CANCIONEIRO[Poèmes 1911- 1935] – Fernando Pessoa – Christian BOURGOIS Éditeur.
Il n'est pas aisé de parler de Fernando Pessoa. Il est un paradoxe à lui tout seul. Modeste employé de commerce, citoyen qui n'a jamais cherché les honneurs ni la réussite, écrivain qui n'a jamais vraiment connu la consécration littéraire de son vivant, poète sans succès mais surtout pas sans talent, il reste l'écrivain le plus célèbre de la littérature portugaise. Pour cela, il est une énigme pour le lecteur et sans doute encore plus pour l'exégète, à cause notamment de l'existence des « hétéronymes », manifestation protéiforme dans son écriture et des nombreuses facettes de lui-même. Sa silhouette nous est connue, mais elle est fuyante, son ombre, au contraire, s'étend et n'en finit pas de questionner, mais ce ne sont pas ses poèmes qui apporteront une réponse. Ils suscitent, au contraire, bien des interrogations! Tout jeune, il a reçu l'empreinte de la culture anglaise victorienne, mais c'est en portugais, « sa langue », qu'il choisit de s'exprimer. Son style post-romantique et symboliste va du naïf au mystique en passant par l'érotisme, mais reste baigné par cette « saudade » qui caractérise tant l'âme portugaise. C'est un homme qui a sacrifié sa courte vie à une oeuvre immense mais quasiment inédite de sa propre volonté.
C'est sous ce titre original et pratiquement intraduisible en français, mais qui évoque la musique, que Pessoa souhaitait publier sa poésie lyrique. Il n'en a pas eu le temps. Il s'agit ici d'une oeuvre « orthonyme », c'est à dire sous la seule signature de Pessoa et non sous le masque de ses nombreux hétéronymes, ainsi, qu'on y prenne bien garde, Pessoa est tellement complexe que lorsqu'il a décidé, comme ici, d'être son propre personnage, il tisse à nouveau, et à l'insu de son lecteur, un masque supplémentaire. En effet, ce qu'on peut interpréter comme une tentative de connaissance de lui-même, n'est peut-être pas autre chose qu'une couche supplémentaire de mystère que l'auteur rajoute. Cet ouvrage est organisé en trois temps « Loin de moi en moi », « Entre le sommeil et le songe » et « Sur le chemin de ma dissonance » qui sont des titre empruntés à Pessoa lui-même. Cette somme de poèmes, malgré l'impression première, possède une grande unité, celle de la recherche de soi-même et de la conscience de soi, à la fois plénitude et vacuité. Comment, en effet, concevoir que Pessoa puisse se définir lui-même en dehors des hétéronymes qu'il a si génialement créés et à qui il a insufflé la vie. On a beaucoup glosé sur « le cas Pessoa » qui a brouillé les pistes, ou, à tout le moins, défini ses propres aspirations littéraires et philosophiques à travers eux. Dédoublement de la personnalité, recherche véritable du moi ou simple exercice de style visant à une création littéraire certes originale mais avant tout intellectuelle ? Chaque hétéronymes a-t-il sa propre personnalité, sa propre vision du monde, sa propre sensibilité ou sont-elles autant de facettes de Pessoa. Pire, dans cette pléiade de poètes, seul Pessoa a existé réellement , a habité cette terre portugaise et y est mort, mais a-t-il été le géniteur de ces hétéronymes, ne les a-t-il crée que pour mieux leur insufflé une vie qu'il n'a pas connue et dont il a rêvée? Cela révèle-t-il de profondes contradictions, des apparences fuyantes ou une réalité insondable. En effet, son oeuvre est un constant affrontement entre deux réalités que les langues ibériques rendent parfaitement par la dualité de forme du verbe être, l'une transitoire[estar] et l'autre définitive [ser]. De plus Pessoa fait usage de l'oxymore qui est la forme de rhétorique des contraires.
Il aggrave même son cas en analysant en quelque sorte sa créativité et en la caractérisant avec des mots. Pour lui, le poète est un « fingidor », celui qui feint, parce que la « saudade », cette nostalgie qui chez Pessoa prend sa source dans l'enfance perdue, trouve dans les mots du poète adulte, une tentative d'antidote.
De tout cela naît pour le lecteur un véritable vertige qui peut s'expliquer dans la connaissance que Pessoa avait de l'astrologie, dans la certitude de sa médiumnité, à la fois celle du poète mais aussi celle des relations bien réelles qu'il a eues avec le mage anglais Aleister Crowley. Tout se tient et se manifeste en mots puisqu'on ne peut scinder le Pessoa poète du Pessoa passionné de sciences occultes, de société secrètes et d'hermétisme. Elles nourrissent son imaginaire et son écriture n'en est que le reflet.
La notoriété de Pessoa est telle aujourd'hui que nombre d'exégètes notoires en font chacun une lecture différente, ce qui influence forcément le simple lecteur et qui bouleverse encore plus les pistes sinon de la compréhension, à tout le moins de l'appréhension de Pessoa. Et après tout qu'importe! Chacun d'entre nous lit Pessoa avec sa propre sensibilité et ce que nous en retirons nous regarde et nous comble. C'est là le signe d'un véritable écrivain.
© Hervé GAUTIER - Décembre 2007.
http://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg -
LE DERNIER VISAGE - Alvaro MUTIS - Editions GRASSET.
- Le 30/03/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
Janvier 1994 - n°180
LE DERNIER VISAGE - Alvaro MUTIS - Editions GRASSET.
Le lecteur habituel de cette chronique sait quelle importance j’attache à l’oeuvre d’Alvaro Mutis sans que je puisse vraiment en analyser les raisons profondes. Comme je l’ai déjà écrit, il fait partie des écrivains qui me procurent durablement de l’émotion et s’attache mon attention dès la première ligne du texte. Bref, il m’étonne!
Cela tient sans doute à la qualité du style, simple et évocateur, au dépaysement que prête chacun de ses romans. L’auteur distille cette alchimie délicate et secrète qui transforme une histoire simplement racontée avec des mots en un récit passionnant suivi du début à la fin sans que l’ennui s’insinue dans la lecture et qui fait dire au lecteur qu’il a bien aimé le roman.
Je parlais à l’instant de l’importance du style. Il est certes du à la qualité de la traduction mais ici Mutis ne se départit pas de cette écriture poétique qui a été révélée par la publication des éléments du désastre et un récit tel que « Sharaya » rappelle qu’il est aussi un bon poète.
Il a aussi le sens de la formule évocatrice, croquant dans l’instant l’attitude d’un personnage « Il avait l’habitude de se balancer sur ses grands pieds comme le font les préfets de collège religieux, donnant une autorité à la fois humble et formidable à toutes les observations qui sortait de la gorge grasse de bedeau. Il y avait quelque chose dans son allure d’un cow-boy qui eût partagé ses loisirs entre la prédication et l’homéopathie ».
Ici il s’agit non d’un roman comme d’habitude mais d’une succession de récits et qu’on lise « La maison d’Araucaïna » ou « le dernier visage », il y a cette omniprésence de la mort rappelée par cette formule lapidaire dont l’idée est constamment présente dans l’oeuvre « En vérité nous tombons en naissant dans un piège sans issue ».
L’impuissance de l’homme devant le trépas, l’inutilité, peut-être de l’oeuvre qu’il a accomplie durant son passage sur terre, le sentiment d’abandon qu’il éprouve face à l’indifférence voire l’hostilité des autres hommes, la solitude qui fait partie de la condition humaine... tout cela est dans le décor intérieur des personnages.
Il y aussi ces figures de femmes énigmatiques, à la fois mères et compagnes, épouses et maîtresses qui donnent le monde aux enfants, soignent les blessures et préparent la nourriture, celles aussi qui donnent du plaisir aux soldats et aux hommes de passage. C’est que l’univers romanesque d’Alvaro Mutis s’inscrit dans le quotidien de cette Amérique Latine en proie à une perpétuelle révolte contre la misère et l’oppression, l’éternelle révolution et la quête de la liberté avec en toile de fond cette lutte armée dispensatrice de violence aveugle et de mort qui brise et génère à la fois ce cycle de la paix et de la guerre, de la répression et des prisons où la vie se déroule autrement.. Ici, c’est la peur des gens, la drogue pour aider à supporter l’enfermement mais aussi, au bout du chemin la mort qui est une manière de libération...
Il y a aussi le récit dit « véridique » qui met en présence le personnage de Maqroll El Gaviero sans qui une oeuvre de Mutis n’en serait pas réellement une. Ce personnage mythique qui doit bien prendre vie dans l’existence d’un humain, à moins que lui-même ne soit un savant dosage entre imaginaire et réalité est ici en compagnie d’un personnage bien réel celui-là, le peintre colombien Alejandro Obregon. Il tisse avec lui une amitié solide, corroborée par la fréquentation assidue des femmes et des bars.
Il me surprendra toujours ce Maqroll, non seulement par son besoin insatisfait d’errances mais surtout par sa culture qui fait de lui quelqu’un dont le jugement est recherché et apprécié! Ici, le Gabier, via Mutis dans le rôle « ingrat de simple intermédiaire » donne son avis sur la peinture d’Obregon qu’il qualifie de « peintre angélique mais d’anges du sixième jour de la Création ». Mieux, il est pour lui un révélateur, un prétexte puisque, à son contact il va faire évoluer sa peinture. Obregon va, grâce à lui, »peindre le vent », pas celui qui passe dans les arbres (celui) qui ne laisse pas de traces, le vent si pareil à nous, à notre vie, à cette chose qui n’a pas de nom et file entre nos mains sans que nous sachions comment. »
-
ECOUTE-MOI AMIRBAR - Alavro Mutis - Editions GRASSET.
- Le 30/03/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N° 163 - Août 1993
ECOUTE-MOI AMIRBAR - Alavro Mutis - Editions GRASSET.
Je serai toujours étonné et curieux de la vie de ce personnage de roman qui, pour être fictive n’est est pas moins captivante. Maqroll dit “ El Gaviero”, éternel bourlingueur, grand amateur de femmes et d’alcool, naviguant sur toutes les mers du globe a cette intarissable habitude de s’entremettre dans les combinaisons commerciales les plus douteuses où il perd régulièrement le peu d’argent qu’il a. Elles le laissent à chaque fois plus désabusé, malade et ruiné mais riche d’aventures que son créateur et témoin privilégié relate pour le lecteur. C’est à chaque fois un moment exceptionnel qui justifie, s’il en était besoin, la lecture d’un roman d’Alvaro Mutis.
Pourtant Maqroll n’est pas une frappe, bien au contraire. C’est quelqu’un qui, malgré sa grande naïveté laisse dans la mémoire de ceux qui l’ont « rencontré » l’image du « parfait honnête homme », passionné par les Guerres de Vendée et par celle de Succession d’Espagne, citant par cœur Chateaubriand, tenant, avec raison Louis Ferdinand Céline pour le meilleur écrivain français, dévorant avec passion les romans de Simenon, parcourant le monde avec son éternel sac marin plein de livres précieux qu’il relit jusqu’à satiété. Ne sont-ils pas souvent des cadeaux de femmes?
Mutis rappelle la façon dont il a » fait connaissance « de son héros... Il était chef-mécanicien sur un pétrolier. Ils parlèrent longuement du droit que pouvait faire valoir Louis XIV pour son petit-fils au trône d’Espagne... C’est que cet homme porte en lui un pouvoir de susciter la curiosité et sa rencontre même, toujours relatée dans des circonstances insolites a le don d’entamer le sérieux le plus établi mais aussi de faire naître les amours les plus passionnés, les amitiés les plus solides. Il tisse autour de lui une sorte de halo d’immortalité... Mais n’est-ce pas normal pour un personnage tel que lui?
Bref, ce qui lui va le mieux ce sont les grands espaces, la mer, la liberté même si celle-ci parfois flirte avec la mort. En bon marin qu’il est, il ne reste jamais à la même place et la fièvre des départs n’est jamais longue à faire sentir ses effets. Ici, pourtant ce ne sera pas l’appel de la mer mais celui de la Cordillère qui va le motiver, avec en plus la folie que procure la recherche de l’or. De « La Bourdonnante » qui ne lui rapportera rien à « Amirbar » ainsi baptisée par lui à cause du chuchotement que fait le vent à travers les galeries, la mine va exercer une fascination au moins égale à l’envoûtement que la mer lui procure. Paradoxe pour cet homme habitué au soleil, aux tempêtes et à la houle... Il va devenir chercheur d’or! Symbole sans doute puisque la mort s’attache aux pas de Maqroll et qu’autour de chacune de ces deux mines prospectées elle marque de son sceau ces contrées. « Il n’y a pas d’or sans défunts ni de femmes sans secrets » dit un proverbe local...
Les femmes aussi sont présentes à ses côtés comme autant de remèdes à son mal de vivre. « La Conseillère » étonnamment généreuse rejoint dans sa mémoire toutes celles qui lui « ont donné l’unique raison certaine de continuer à vivre », Antonéa l’étrange qui va sombrer dans la folie pour n’avoir peut-être pas su le retenir... Elles sont, au même titre que les autres ses compagnes. Mais le destin de Maqroll veille et il ne peut rester à la même place, sur la terre ferme ou avec une femme. Si la chance s’attarde un moment sur lui, elle ne tarde pas à transformer tout ce qu’il fait en échec. Il ne vieillira jamais dans une retraite paisible... Pourtant le portrait que nous brosse ici Mutis de son héros est celui d’un homme fatigué, malade qui attend davantage la mort qu’une autre destination.
En appendice, l’auteur révèle au lecteur la passion d’El Gaviero pour des livres aussi incroyables qu’inattendus pour un homme en perpétuel mouvement. « Le portrait de mon ami que je me propose de léguer à une postérité, hélas, bien aléatoire puisqu’elle est fonction de l’audience que peuvent recueillir mes livres consacrés à ses entreprises et tribulations » : Telle est la conclusion provisoire de ce roman qui s’inscrit dans une œuvre d’une grande unité.
Qu’alvaro Mutis se rassure, les aventures d’El Gaviero seront toujours pour moi l’occasion d’une lecture passionnée... Et je ne suis pas le seul.
© Hervé GAUTIER
-
LES ELEMENTS DU DESASTRE. -Alvaro Mutis - Editions Grasset.
- Le 30/03/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N° 177- Décembre 1993
LES ELEMENTS DU DESASTRE. -Alvaro Mutis - Editions Grasset.
On connaissait Alvaro Mutis comme romancier. Cette chronique s’est fait l’écho de la totalité de son œuvre traduite en français, on le connaissait peut-être moins comme poète. Cette récente édition permet de découvrir une nouvelle facette du talent de cet homme né à Bogota en 1923 et qui était salué dès 1959 par Otavio Paz comme « Un poète dont la mission consiste à convoquer les vieux pouvoirs, faire revivre la liturgie verbale, dire la parole de vie. »
Ce livre est, à mes yeux aussi important et révélateur de l’écrivain que ses nombreux autres romans. Là il fige l’instant en le nommant avec des mots, lui donne une dimension d’éternité. Il y a dans son œuvre une grande unité d’inspiration fondée sur la magie du verbe et la beauté écrasante des images.
©Hervé GAUTIER
-
LA DERNIERE ESCALE DU TRAMP STEAMER - Alvaro Mutis- Editions Syvie Messinger.
- Le 29/03/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
LA DERNIERE ESCALE DU TRAMP STEAMER - Alvaro Mutis- Editions Syvie Messinger.
Cette fois Mutis abandonne (provisoirement) son héros préféré pour exorciser encore une fois, sous les « apparences » évanescentes d’un narrateur, ses vieux démons maritimes. Il évoque un vieux tramp steamer, petit cargo caboteur qui, tel un vaisseau fantôme fait des apparitions fugaces dans sa vie sans qu’il puisse vraiment ni en apercevoir l’équipage, ni même en déchiffrer le nom. Sa silhouette bringuebalante de future épave s’offre à lui entre la mer Baltique et les Caraïbes, un peu comme une insulte dans la beauté du paysage, sans qu’on sache vraiment comment il a pu traverser l’atlantique et ses tempêtes.
Au vrai, la relation qu’il a avec ce bâtiment juste entr’aperçu est de nature émotionnelle, presque sentimentale. Le narrateur nous compte l’histoire de cet esquif, mais seulement par épisodes, au rythme des hasards de leurs rencontres... avec cette étrange envie d’en savoir plus!
Et puis, pour que notre plaisir soit complet, le narrateur va croiser ses propres personnages, El Gaviero, bien entendu, mais par l’intermédiaire du capitaine Iturri qui l’a rencontré. Avec lui aussi une relation passionnelle s’établit avec le tramp steamer (l’Alcion) qu’il commande. C’est un peu comme s’il avait choisi ce bateau pour l’amener à la mort, liant sa propre vie d’homme à l’existence en sursis du navire. L’histoire d’amour du capitaine Iturri, vieillissant et solitaire et de la belle Warda, propriétaire de l’Alcion n’existe d’ailleurs que par ce navire au nom mythique et se termine avec lui presque en même temps que son naufrage... comme si les choses étaient liées.
A cette occasion Mutis jette sur le monde merveilleux du roman et sur celui un peu moins beau des hommes un regard de philosophe « Les hommes changent si peu, continuent d’être perpétuellement eux-mêmes qu’il n’existe qu’une seule histoire d’amour depuis la nuit des temps qui se répète à l’infini sans perdre sa terrible simplicité, son irrémédiable infortune. »
Dans un style délirant mais d’une extraordinaire précision, Mutis entraîne son lecteur passionné dans de pittoresques récits où l’intarissable humour le dispute au dépaysement, l’irrationnel à l’envie qu’ont les personnages de ne jamais rester en place. Allez savoir, c’est sans doute ce qu’on appelle le talent!
© Hervé GAUTIER
-
ILONA VIENT AVEC LA PLUIE - Alvaro Mutis - Editions Sylvie Messinger
- Le 29/03/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°100 - Mars 1992
ILONA VIENT AVEC LA PLUIE - Alvaro Mutis - Editions Sylvie Messinger
Et revoilà le personnage de Maqroll dit El Gaviero, figure mythique du voyage, éternel errant, bourlingueur, homme aux semelles de vent, incapable de se fixer quelque part et à la recherche perpétuelle d’un coin où s’arrêter, tout en ayant aussitôt la volonté de fuir. Marin en partance, il est de toutes les expéditions risquées et la routine ne saurait faire partie de sa vie. Son sac marin jamais plein déteste le contact avec la terre ferme et c’est sur le pont d’un bateau ou au fond d’une cale que notre homme reprend vraiment vie. Quand il touche terre ou fait escale, l’éternelle question qu’il se pose à lui-même est « Qu’est ce que je fais ici? », la réponse étant tout aussitôt donnée par la commande d’un (ou plusieurs)verre de vodka salvateur...
Une femme dans chaque port, il connaît tous les bouges et ses beuveries sont légendaires. Il joue avec sa vie comme à la roulette russe... et pour le plaisir du lecteur il gagne toujours, se réservant grâce à son auteur -géniteur le droit et surtout le devoir de nous faire vibrer à l’occasion d’autres aventures!
Il faut dire que l’art consommé de la narration et le style truculent qui caractérisent Alvaro Mutis sont pour beaucoup dans l’extraordinaire charisme de ce personnage qui tient en haleine jusqu’au bout le lecteur attentif et passionné.
Le voilà encore coincé dans un petit port des Caraïbes avec le cadavre de son capitaine qui vient de choisir de mettre fin à ses jours. Mais El Gaviero reste un sentimental et ses souvenirs surnagent, l’émotion revient.
Wito, le capitaine sans avenir d’un cargo au nom pompeux et peint « d’un jaune rageur » couleur queue de perroquet, Wita, sa femme morte prématurément mais qui reste la passion de son mari par-delà le trépas, leur fille qui s’est enfuie à quinze ans avec un pasteur protestant père de six enfants...! Pour wito aussi la haute mer est un refuge et quand il touche terre les ennuis commencent. Ce petit port de San Cristobal, sorte de cul de sac en mer signifie pour ce pauvre capitaine la fin du voyage. Pour lui voyager était une fuite plutôt qu’un gagne-pain!
Bref, revoilà El Gaviero dans une de ces situations inextricables et néanmoins coutumières à base de dettes, d’envies de fuir mais aussi de solutions bâtardes qui finalement sont préférées malgré les risques à cause de quelques dollars éphémères qu’elles peuvent lui procurer. C’est à chaque fois le même scénario, la même dérive, la même histoire sordide mais répétée à l’envi avec son dénouement connu à l’avance qui se traduit par une fuite d’El Gaviero et l’amer goût de l’arnaque. Pourtant « les dieux tutélaires » veillent sur lui et le tirent toujours à la fin de ce mauvais pas que lui vaut la terre ferme. Son souvenir est peuplé d’inoubliables escales plus rocambolesques les unes que les autres qui se terminent toutes au fond d’un bar tout comme ses traversées scabreuses le conduisent immanquablement devant les autorités portuaires pour y répondre de frauduleux transports...!
Il finit par croiser Ilona, femme de toujours, son double féminin, aussi friande d’aventures que lui-même, des aventures amoureuses aussi mais qui n’a avec les hommes que des relations fugaces qui ne peuvent pas ne pas plaire à El Gaviero. Ilona, personnage aussi attachant et gouailleur que Maqroll lui-même et qui comme lui a un sérieux sens de l’amitié. Comme lui elle apparaît ou disparaît mais revient toujours dans sa vie quand il est au bord du gouffre... et à la faveur de la pluie. Sa vie à elle est faite d’échecs annoncés (comme pour Maqroll) d’entreprises douteuses... mais peu lui chaut. Tous les deux vivent leur vie, vont dans le sens de leur destin et cela seul est l’essentiel. Même si ce destin est de voir mourir ceux qu’on aime.
© Hervé GAUTIER.
-
Abdul Bashur, le rêveur de navires - Alvaro MUTIS - Le Livre de poche - Editions GRASS
- Le 29/03/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
Février 1998
Abdul Bashur, le rêveur de navires - Alvaro MUTIS - Le Livre de poche - Editions GRASSET.
D'ordinaire, quand un nouveau roman d'Alvaro Mutis est publié je m'empresse de le lire comme quelqu'un qui attendrait des nouvelles d'un ami parti depuis longtemps. Chaque ouvrage déroule en effet, en pointillés les aventures de Maqroll El Gaviero. Ici, il n'a pas de rôle principal, et c'est Abdul Bashur, son grand ami presque son frère dont il est essentiellement question... En apparence seulement puisque l'auteur en profite pour affiner le portrait d'El Gaviero en l'opposant à la personnalité de Bashur.
Ce sont en fait deux hommes parfaitement complémentaires dans la diversité mais qui sont unis par une indéfectible amitié.
Le titre du roman résume assez bien le thème développé ici. Bashur qui appartient à une vieille famille d'armateurs levantins poursuit cette idée un peu folle de découvrir un navire aux lignes parfaites. Pour cela il n'hésite pas à parcourir les mers, à braver les dangers, à rencontrer les personnages les plus inquiétants, à risquer sa vie même pour obtenir l'objet de ses désirs.
Bien sûr, un roman de Mutis ne se conçoit pas sans histoires d'amour, plutôt des passades que des passions et comme Maqroll, Bashur sait tourner la page sans pour autant oublier les femmes qui ont malgré tout marqué sa vie et dont ils ont parfois, tous les deux partagé l'intimité.
Pourtant, sans que je m'explique pourquoi, cet ouvrage me paraît moins enlevé, moins palpitant, les aventures de Bashur, bien qu'elles soient assez semblables à celles de son ami qui est aussi son compagnon dans ce livre me semblent cette fois moins passionnantes. Pour moi l'intérêt réel commence, à travers une juxtaposition de récits, à mi chemin du livre ce qui, à mon sens est dommageable pour le lecteur habituel de Mutis.
Mais revenons au prétexte du roman, la quête du cargo imaginaire. C'est un peu un idéal impossible à atteindre mais qui fait courir les hommes passionnés. Abdul l'avoue lui-même en déclarant au bout de son épuisante recherche :"J'ai appris désormais à tirer des rêves jamais réalisés de solides raisons de continuer à vivre et je m'y suis habitué." Il est vrai que ses origines levantines expliquent ce caractère fataliste des peuples de l'Islam.
On pourrait croire que c'est un roman de la vie où celle-ci gagne et s'impose comme une richesse parce que malgré le malheur et les épreuves chaque homme porte en lui le force de continuer à exister et à repousser l'échéance de cette mort qui nous attend tous. Il y a certes de la résignation face au destin chez Bashur mais la poursuite du rêve impossible de découvrir le tramp steamer idéal a occupé une bonne part de sa vie. Et pourtant, malgré les apparences cette histoire est bien une illustration de la condition humaine parce que chaque homme est voué à la disparition dès le jour de sa naissance. Il ne sait ni combien de temps ni dans quelles conditions il restera sur cette terre où il n'est que de passage. Il ne sait pas non plus s'il connaîtra l'accomplissement ou les joies que nous réserve la vie ou si, au contraire il collectionnera les échecs. Peu importe d'ailleurs c'est là l'histoire de chacun. Dans ce roman en effet, peut-être davantage que dans tous les autres l'idée de la mort est présente, celle d'Ilona tout d'abord, un autre personnage mythique de Mutis mais surtout celle de Bashur lui-même. Evoquée au début du roman à travers la personnalité de sa soeur Fatima, elle est présente en filigranes derrière chacun de ses voyages pour rencontrer le bateau idéal.
Ce qui me frappe ce sont les réflexions qui naissent sous la plume de Mutis, un peu comme si pour lui la mort de chaque homme était le reflet de sa vie, son aboutissement :"Quand elle arrive... C'est son origine, ce sont certaines conditions morales voire esthétiques qui doivent lui donner sa figure et qui... font du moins qu'elle s'accorde avec des exigences, des circonstances longuement forgées pendant toute notre vie, tracées par des pouvoirs qui nous dépassent." Bashur est certes un personnage de roman que l'auteur fait vivre et mourir à sa guise mais je retiens qu'il indique combien les circonstances de sa mort étaient prévisibles. La photo de Bashur enfant examinant les débris fumants d'un avion qui vient de s'écraser annonce sa disparition dans les mêmes circonstances, avec un arrière-plan la silhouette du cargo qu'il était sur le point d'acheter et qui correspondait peut-être à l'aboutissement de son rêve! Ce fait peut paraître anodin au regard des aventures rocambolesques que relatent d'ordinaire les romans de Mutis mais c'est bien cette idée que j'ai pu vérifier que notre mort s'annonce à nous dans des circonstances qui peuvent être fugaces et que nous ne parvenons pas toujours à décrypter mais qui reflètent souvent ce qu'a été notre propre vie.
Notes de lecture personnelles - (c)Hervé GAUTIER
-
ETRANGE ETRANGER - Une biographie de Fernando PESSOA
- Le 29/03/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
ETRANGE ETRANGER - Une biographie de Fernando PESSOA
Robert BRECHON - Christian BOURGOIS - Editeur.
Le personnage de Fernando Pessoa m'a toujours fasciné.
Cet homme, mort relativement jeune (47 ans) qui a choisi par dépit ou par réelle volonté la situation de modeste agent du bureau malgré une solide formation littéraire et une parfaite connaissance de l'anglais, qui a résolu de vivre en solitaire à Lisbonne malgré une adolescence sud-africaine prometteuse, qui a choisi d'écrire parce qu'il avait eu l'intuition très tôt que là était sa véritable destiné mais qui a peu publié préférant entasser ses manuscrits dans une malle qu'on retrouva après sa mort, ce créateur qui a été pratiquement ignoré de son vivant malgré des efforts en direction de la notoriété et qui, cinquante ans après sa mort a été reconnu comme l'un des plus grands écrivains portugais depuis le Renaissance au point de reposer maintenant au Monastère des Jeróminos aux côtés de Vasco de Gama et de Camões, ne pouvait me laisser indifférent.
Cet homme, en effet est , en lui-même un véritable paradoxe.
Sans réel livre ni lecteur de son vivant, il a cependant voulu marquer son temps par des prises de positions politiques et littéraires mais tout cela est pratiquement resté sans lendemain. Il me fait songer à cette phrase de Constantin Cavafy "Tu es fait pour accomplir de grandes et belles choses mais toujours le sort te refuse les encouragements et le succès."
Pourtant il a puisé dans ses contradictions mêmes la richesse de son oeuvre. Tour à tour nationaliste, sentimental, cynique, baroque, classique, érotique, ésotérique ou tragique, ses écrits et spécialement ses poèmes ont jalonné son itinéraire mais c'est surtout grâce au Livre de l'intranquillité, sorte de journal intime en prose qu'il tint toute sa vie qu'il est maintenant le plus connu.
Dans sa jeunesse il s'enthousiasma pour les revues. Des deux qu'il créa Orpheu ne dépassa pas deux numéros et Athéna cinq. Ses écrits, pour la plupart inédits ont pourtant été publiés ponctuellement mais dans d'autres revues. Etrange destiné en effet que celle de Pessoa qui, s'il publia, le fit cependant à compte d'auteur où en revues et essuya souvent le refus des éditeurs.
Etonnant aussi cet écrivain qui fit si bien chanter la langue portugaise et qui, dès lors qu'il tomba amoureux d'Ophelia Queiroz, sans doute l'unique femme de sa vie et de quelques dix ans sa cadette lui adressa des missives enfantines pour finalement rompre avec elle brutalement et sans autre raison sans doute qu'un profond état dépressif. Celui-ci est certainement un des terrains nourriciers de son oeuvre!
L'écriture sera pour Pessoa une manière de bouée de sauvetage dans un monde qui décidément n'est pas fait pour lui. Je crois en effet que c'est grâce à elle et plus spécialement à la poésie qu'il parviendra à y survivre. Il fut sans doute comme les écrivains maudits qui ne peuvent, leur vie durant, être reconnus et se débattent contre l'adversité mais je crois surtout qu'intimement il avait la nostalgie de la grandeur du Portugal, de ce pays où il a choisi de vivre, qu'il a choisi de servir dans l'ombre avec des moments plus officiels. Il est resté hanté par le mythe de dom Sébastien, "Le Roi caché", tué au Maroc en 1578 et qui selon la légende doit revenir à Lisbonne. Il a donc cherché parmi les hommes politiques de son temps celui qui pourrait bien incarner le renouveau de son pays. Ce fut Sidonio Paiz, puis, au début Salazar qu'il finit par combattre ouvertement. Quelques temps avant sa mort l'élégie de l'ombre dit sa profonde déception.
Il a voulu "Tout sentir de toutes les manières" mais il est resté reclus dans ce quartier de la Baixa de Lisbonne jusqu'à donner de lui l'image d'un citoyen quelconque vivant au quotidien...
Illustrant la phrase de Descartes "Au moment de monter sur le théâtre du monde... Je m'avance masqué"(encore ne l'a-t-il été que très partiellement puisqu'il a signé de son nom nombre de poèmes) il a donné naissance aux hétéronymes, sorte d'autres lui-même qui non seulement ont reçu de lui l'existence mais encore la faculté d'écrire. Pessoa a donc été un créateur au sens plein du terme. Il a illustré jusque dans le détail les relations subtiles qui existent entre un auteur et ses personnages mais surtout il leur a donné plus que la liberté d'être. Ils ont été les acteurs de son "drame", ont vécu leur vie fictive comme de véritables êtres humains et comme des écrivains à la fois semblables et différents de lui au point que notre auteur les regardera vivre tout en restant en retrait. Il avouera "Il me semble que tout cela était encore moi, le créateur de l'ensemble, qui était le moins présent. On dirait que tout s'est passé et continue de se passer indépendamment de moi." De sorte qu'on ne sait plus très bien où commence et où s'arrête le jeu que Pessoa a initié. Mais ce n'est pas tout. Considérant cette galerie de personnages (cette "coterie" comme il l'appelle) Pessoa disserte sur leur talent respectif, publie des études faites par lui à leur propos ou par certains d'entre eux sur certains autres sans qu'un non-averti puisse supposer que tout cela n'est finalement que l'oeuvre de Pessoa lui-même.
Tout se passe comme s'il avait voulu brouiller les cartes et compliquer cette situation à l'envi au point peut-être d'être dépassé par elle, subjugué par ses propres créatures.
On peut se perdre en conjectures sur les raisons de l'existence de ces principaux hétéronymes. Alberto Caeiro est un poète païen à l'éducation fruste dont le style refuse les artifices du genre et où l'émotion est absente. Le Docteur Ricardo Reis est un épicurien au langage châtié, l'ingénieur Alvaro de Campos un poète sensationniste qui veut lui aussi "tout sentir de toutes les manières". Ils ont chacun une biographie et une oeuvre publiée par Pessoa lui-même. C'est aussi Bernardo Soares, l'auteur du Livre de l'intranquillité n'est peut-être qu'un demi-hétéronyme mais qui est sans doute celui qui ressemble le plus à l'auteur de Message. Il y en a d'autres bien sûr mais tout cela me semble procéder d'une intuition rimbaldienne de notre auteur qui à sa manière a eu la révélation de cette phrase toute simple "Je est un autre". En effet, à cinq ans il s'adressait déjà des lettres du Chevalier de Pas, un autre hétéronyme.
Est-ce par goût de l'ambiguïté, pour donner libre cours à son imagination, pour révéler les facettes cachée de sa personnalité, pour donner vie à des personnages qu'il aurait aimé être, par simple goût de vivre masqué ou pour le plaisir de se construire un microcosme intime dans lequel il avait plaisir à vivre en compagne de gens qu'il aimait? C'est sans doute pour toutes ces raisons à la fois... Je ne peux pas pour ma part imaginer que le goût qu'il avait pour les sciences occultes ait été étranger à cela. De même son penchant pour les contraires qui se manifeste dans le phénomène des hétéronymes trouve aussi une illustration dans l'usage qu'il faisait des oxymores.
Ce qui paraît important de garder toujours a l'esprit c'est que Pessoa est à la fois témoin de son temps malgré la solitude qu'il cultive et un intellectuel d'une grande culture et d'une extraordinaire créativité, un formidable magicien des mots à travers une poésie multiforme, quelqu'un qui a rêvé d'être ce qu'il n'a jamais été au point de n'être finalement rien et d'en avoir une conscience extrême. Aussi avoue-t-il simplement "Je ne suis rien, cela dit je porte en moi tous les rêves du monde"
Il incarne à mes yeux la condition solitaire de l'écrivain face à lui-même et à son oeuvre. Il est le truchement nécessaire à cette création qui avant lui et sans lui ne serait rien et qui accomplit sa tâche parce que cela correspond à sa fonction sur terre. Peu lui importe dès lors la reconnaissance et les honneurs. Il collationne ses écrits et les entasse. Tant pis si, à la fin, fatigué de vivre il accepte la mort. Il a accompli sur terre son office.
Plus que tout le reste sans doute c'est quelqu'un, comme l'a bien noté Gaspar Simoès qui puise dans la magie de son enfance perdue la force d'écrire dans le vide, celle de durer malgré son mal de vivre et la mort d'êtres chers qui s'est très tôt révélée à lui, quelqu'un qui malgré sa nostalgie et ses échecs a toujours été un étranger pour lui-même et sur la terre, quelqu'un qui "attendait qu'on lui ouvre une porte devant un mur sans porte."
Comme le note très bien Robert Brechon il reste un poète et « Les Poètes aussi écrivent pour les dieux, c'est à dire pour une hypothétique conscience du monde sans laquelle rien de ce que nous faisons n'a de sens ici-bas ».
-
Hervé GAUTIER
-
LE RENDEZ-VOUS DE BERGEN - Alvaro MUTIS - Editions GRASSET.
- Le 29/03/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
LE RENDEZ-VOUS DE BERGEN - Alvaro MUTIS - Editions GRASSET.
Décidément, depuis le temps que je le fréquente, par romans et traductions interposés, je l'aime bien ce Maqroll El Gaviero, "son absence de goût et de projets d'avenir" et sa prodigieuse aptitude à se mettre dans des situations inextricables qui tournent souvent au fiasco. Bourlingueur infatigable, mais toujours en perpétuelle errance, il me paraît être à la recherche des racines de son être.
A travers ce récit, et à l'occasion de ce rendez-vous donné par Sverre Jensen, un vieil ami, dans ce port de Norvège où celui-ci a décidé de mettre fin à ses jours Alvaro MUTIS se livre à l'exploration de l'âme de Maqroll et plus spécialement aux relations qu'un humain peut entretenir avec sa propre mort à venir. Nous ne sommes ici que de passage!
Malgré ses aventures rocambolesques, et pour le lecteur enchanteresses, relatées dans les romans précédents, j'ai toujours eu le sentiment que même s'il a bien souvent frôlé la mort, El Gaviero a toujours eu la volonté de faire prévaloir "les raisons de continuer à nager contre le courant». Je veux dire que même si son ami a choisi le suicide, la lecture des romans d'Alvaro MUTIS nous apprend que Maqroll a toujours lutté contre cette idée et ne s'est jamais laissé aller à son autodestruction! Pour Jensen les choses sont différentes et étonnamment simples: "J'avais accumulé quelque chose que je peux seulement définir comme la fatigue d'être vivant... Je ne supporte plus le bruit que font les vivants." C'est un peu l'occasion que chaque homme choisit de saisir pour régler ses comptes avec sa propre vie en ayant conscience de le faire librement mais avec la certitude que le destin existe et qu'on ne peut lui échapper. Ces choses-là, il est vrai s'expriment difficilement avec des mots!
Dans la deuxième relation, avec un humour au phrasé délicat, MUTIS renoue avec une habitude déjà prise par le passé (Le Dernier Visage- Editions GRASSET- Présentation La Feuille Volante n°180 Janvier 1994) de faire se rencontrer Maqroll, personnage de roman et le peintre Alejandro Obregón. Mêlant fiction et réalité, il poursuit à sa manière l'analyse de l'âme tourmentée d'El Gaviero qui est peut-être l'image de la sienne propre? Cette rencontre, pour inattendue qu'elle soit est extraordinaire et le lecteur attentif se tient constamment sur cette frontière édifiée avec des mots qui sépare l'imaginaire du réel. L'auteur tient d'ailleurs à nous rappeler les choses :"Il n'y a qu'à nous qu'il arrive des histoires pareilles!" Il est vrai qu'entendre Maqroll parler, en Français, des chats d'Istambul et de leur prescience, aux petites heures du matin à Carthagène devant un verre de rhum a quelque chose d'irréel!
Je ne sais par quel miracle une amitié sans faille naquit de cette rencontre et El Gaviero, en humaniste averti commença à s'intéresser à la peinture d'Obregón qu'il qualifia, Dieu sait pourquoi "d'angélique, mais d'ange du sixième jour de la création.". Il s'ensuivit une analyse de l'art pictural de son ami où la précision le dispute à la pertinence du propos. Cependant, ce qu'Obregón souhaite avant tout peindre c'est le vent, celui qui ne laisse aucune trace de son passage... Cela tient de la gageure!
El Gaviero, marin mythique ne peut mourir. Après nous avoir donné à penser qu'il ait pu aller "Ad Patres" dans un marigot perdu, nous le retrouvons, lors de la troisième nouvelle sur l'île de Majorque. C'est pourtant un homme tout différent que MUTIS nous donne à voir ici, un être blessé et tourmenté par la mort. Nous le savons, El Gaviero est fidèle en amitié. Elle lui fait traverser les océans sur des rafiots de fortune pour être présent auprès d'un ami qui l'a appelé sans que nous sachions très bien par quel miracle sa lettre a pu lui parvenir! Cette fidélité va bien au-delà de la mort puisqu'il respecte scrupuleusement à l'égard de ses amis disparus le "devoir de mémoire". Ici les circonstances l'amènent à prendre en charge le fils d'un ami décédé. Lui qui s'était promis de vivre sans attache voit dans ce coup du sort une manière de défi ou une épreuve supplémentaire imposée par son funeste destin. Bien sûr il l'accepte comme une sorte de paternité par procuration! C'est pour lui l'occasion de découvrir l'éveil d'un enfant à la vie, de s'attacher à ce petit être qui le lui rendra bien mais qu'il devra se résoudre à regarder partir parce que leur chemin finira par s'écarter. C'est à nouveau la mort qui est ici rappelée par l'évocation d'une séparation définitive.
C'est un Maqroll vieillissant qui nous est présenté à travers cet enfant qui pourrait bien être son petit-fils mais dont l'intrusion dans la vie de l'aventurier m'a fait penser au Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Evoquant les déchirements que parfois nous impose la vie, c'est le thème de la mort qui est ici récurent. Elle fait certes partie de notre condition humaine mais ceux qui restent en vie après le trépas d'un être cher ont une petite idée de ce que peut être l'enfer. Même si les paroles peuvent libérer la souffrance elles ne l'exorcisent pas tout à fait!
Tenant le lecteur en haleine jusqu'au bout MUTIS qui relate ici une de ses rencontres avec El Gaviero lui-même et se livre à une analyse pointue des replis de l'âme de Maqroll et des sentiments qui peuvent y naître.
C'est bien vrai que, comme le dit Bernard Clavel, "Mutis est un enchanteur!"
© Hervé GAUTIER
-
Alvaro MUTIS et Maqroll El Gaviero, personnages hétéronymes ?
- Le 29/03/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
Alvaro MUTIS et Maqroll El Gaviero, personnages hétéronymes ?
Je ne sais ce qui m'attire chez les écrivains sud-américains mais assurément quand paraît un roman d'Alvaro Mutis, je m'empresse de le lire comme quelqu'un qui attendrait des nouvelles d'un ami parti depuis longtemps.
De lui, je ne sais que peu de choses. Romancier et poète il est Colombien, né en 1923 et vit à Mexico. Il a obtenu le Prix Médicis Etranger en 1983.
A l'occasion de chacun de ses romans, il affine le portrait de son héros favori, le marin Maqroll El Gaviero mais il le fait à la manière d'un troubadour qui raconterait ses aventures. Véritables chansons de geste, ses récits nous donnent à voir un personnage truculent, éternel voyageur, évoluant dans des décors où le dépaysement est garanti ce qui a fait dire à Bernard Clavel "Mutis est un enchanteur".
Je ne sais pas si la vie de Maqroll reflète la sienne ou si, par la magie de l'écriture Mutis se crée un univers de substitution mais ce que je sais c'est qu'il le fait fort joliment en donnant à l'ensemble de son oeuvre une unité et une continuité agréable à son lecteur.
Je l'avoue, il me procure de l'émotion et sait m'attacher à ses pas dès la première ligne du roman sans que l'intérêt qu'il a fait naître en moi retombe avant la fin. Est-ce son humour au phrasé délicat, est-ce cette alchimie secrète qui transforme une histoire qui aurait pu être banale en récit passionnant où Maqroll nous est présenté comme un érudit autant que comme un aventurier? Au vrai, je n'en sais rien mais il y a du merveilleux dans tout cela. C'est peu dire qu'El Gaviero est familier de l'errance puisque chacune de ses pérégrinations l'entraîne sur terre comme sur mer à la poursuite de je ne sais quelle chimère. Sa vie est une longue suite de quêtes où l'appât du gain est largement secondaire. Il vit au jour le jour sans projet d'avenir avec cette prodigieuse aptitude à se mettre dans des situations inextricables qui tournent le plus souvent au fiasco! C'est un vagabond qui n'amasse pas pour ses vieux jours mais qui est seulement riche de souvenirs. Ils prennent leurs racines dans la fréquentation assidue des ports, des femmes et des bouteilles d'alcool...! Ce qui lui va le mieux ce sont les océans, la liberté, mais sa vie, quelque aventureuse qu'elle soit n'est en fait que le reflet de la condition humaine. Son destin qui est d'aller de "désastre en désastre" s'accroche à ses pas ce qui fait de lui un homme solitaire, aux attaches aussi peu définitives que celles qui amarrent le bateau au quai. Il y a du fatalisme chez lui dans cette acceptation constante de son état auquel il ne peut échapper.
Cette impossibilité de se fixer quelque part ne l'empêche pas de cultiver l'amitié, la vraie, celle qui lui fait parcourir les mers et oublier ses propres intérêts pour être aux côtés de celui qui l'appelle, restant au besoin fidèle à un ami au-delà de la mort de celui-ci.
Surtout n'allez pas croire que El Gaviero n'est qu'un buveur marginal. Que nenni! Il est, bien au contraire et par-delà ses apparences rabelaisiennes un "honnête homme", un humaniste, un épicurien qui trouve malgré toutes ses épreuves de bonnes raisons pour continuer à vivre. Il reste cependant un marin qui vit l'amour davantage comme des passades que comme des passions. Il y a dans chacune des femmes que Mutis met sur sa route l'image tout à la fois de la mère, de la compagne, de l'épouse mais surtout de la maîtresse, dispensatrice de vie, de stabilité, de tendresse mais aussi de plaisir. Au gré des romans nous les découvrons. Ce sont Antonea, Flor Estevez, Ilona et combien d'autres...
Dans ses derniers romans parus, Mutis choisit de traiter non seulement la recherche de l'impossible rêve mais surtout celui de la mort. Ce thème est toujours sous-jacent dans son oeuvre mais maintenant il nous la présente non comme une réalité crainte mais comme un fait purement humain. Il nous rappelle simplement que, simples mortels nous ne sommes ici que de passage et que les traces que nous laisserons après nous ne manqueront pas de s'effacer. Alors, parcours initiatique ou symbole de l'éternelle quête de l'homme et de sa fuite ou rappel que l'échec existe, qu'il fait partie de la vie, que notre but sur terre ne doit pas forcément être synonyme de réussite sociale, que la mort est au bout de notre parcours?
Personnage de roman que Mutis prétend rencontrer parfois physiquement ou homme bien réel aux aventures rocambolesques, les multiples facettes de la personnalité de Maqroll en font une figure attachante, une créature mythique de cet auteur bolivien dont Otavio Paz a dit "(qu'il est) un poète dont la mission consiste à convoquer les vieux pouvoirs et faire revivre la liturgie verbale, dire la parole de vie."
Alvaro Mutis a publié des romans, La Neige de l'Amiral (Prix Médicis Etranger 1989), la Dernière Escale du Stramp Steamer (1989), Ilona vient avec la pluie (1989), Un bel morir (1991), Ecoute-moi Amirbar (1992), Le Rendez-vous de Bergen (1993), Abdul Bashur, le rêveur de navires (1994), des nouvelles, Le Dernier Visage (1991) et des poèmes, Les Eléments du désastre (1993)
Notes personnelles de lecture - © Hervé GAUTIER
-
Quelques mots sur Miguel Hernandez (1910-1942).
- Le 29/03/2009
- Dans Littérature hispanique et ibérique
- 0 commentaire
N°324– Févr
Quelques mots sur Miguel Hernandez (1910-1942).
Je ne sais trop pourquoi, mais je me suis toujours intéressé à l'Espagne. Sa langue est une musique et son histoire douloureuse ne peut me laisser indifférent. Est-ce en cette année où ce pays célèbre les 70 ans de son roi qui rétablit si heureusement la démocratie après toutes ces années de dictature sanglante, est-ce à cause de sa culture si remarquable ou des épisodes, parfois mouvementés, qui ont marqué nos relations communes? Je ne saurais le dire! Je me suis pourtant particulièrement intéressé à cette guerre civile qui déchira le pays, bouleversa le monde et des voix qui l'incarnèrent. Parmi elles, celle de Miguel Hernandez n'est sans doute pas des plus connues mais n'en garde pas moins, à mes yeux, une grande importance.
Il fut ce poète autodidacte, né à Orihuela près d'Alicante, gardien de chèvres dans son enfance, formé par la lecture des grands auteurs espagnols du siècle d'or [Cervantes – Calderon de la Barca – Garcilaso de la Vega et surtout Luis de Gongorra] sous l'impulsion des jésuites. Il garda de ces courtes études l'empreinte de Gongorra. Son écriture d'alors sera marquée par les images fantasques, tortueuses et la forme stricte de ce mouvement littéraire né au XV° siècle en Espagne [« Perito en lunas » [1934]. Il a aussi l'opportunité de rencontrer Ramón Sijè qui jouera un rôle déterminant dans sa vie. La presse locale accueillit ses premiers poèmes en 1929.
En 1932 il se rend à Madrid, sans grand succès, mais, un deuxième séjour lui permet de rencontrer Pablo Neruda et Vincente Aleixendre, Alberti et Lorca. Ces poètes consacrés reconnurent en ce poète-paysan presque inculte un de leurs pairs, l'aidèrent et, bien sûr, influencèrent son écriture, la faisant évoluer de l'influence trop religieuse de Sije dans le sens du surréalisme et de la poésie révolutionnaire, marquée davantage par une idéologie sociale et politique. Il fut le seul contemporain de la « Generacion del 27 », sans toutefois en être membre , à n'être pas issu de la bourgeoisie et à ne pas avoir reçu une formation académique.
Il devient, dès lors, un citadin, travaillant chez un notaire puis comme secrétaire
Quand éclate la guerre d'Espagne, il combat les armes à la main aux côtés des républicains puis devient commissaire à la culture dans le bataillon « El Campesino ». En 1937, Il prend part au 2° congrès international des antifascistes. En 1939, il tente de fuir au Portugal, mais arrêté, il purge une peine de prison à Madrid et à Séville. En 1940, il est condamné à mort mais la sentence est commuée en une peine de prison de 30 ans. Il meurt, peu après, de la tuberculose, le 28 mars 1942 à la prison d'Alicante.
Son écriture est celle d'un poète paysan, amoureux de la terre, sensible à sa beauté et à son frémissement mais aussi, et peut-être surtout, à partir de sa période madrilène, chante l'amour de sa femme et de ses enfants et surtout devient sensible aux souffrances des hommes du peuple. Son écriture est alors engagée, c'est celle d'un guetteur, plus volontiers préoccupé par la condition des plus défavorisés.
Paco Ibaňez contribuera, notamment pendant son exil en France, à populariser ses poèmes en les mettant en musique.
De nos jours l'Université d'Elche porte son nom.
Hervé GAUTIER – Février 2009.http://hervegautier.e-monsite.com
Principales Œuvres publiées : « Perito en lunas » [1934] - « El rayo que no cesa [1936] - « Vientos del pueblo me llevan[1937] - « El hombre que acecha »[1938] - « Cancionero y Romancero de ausencias »[1942 – inachevé]ier 2009