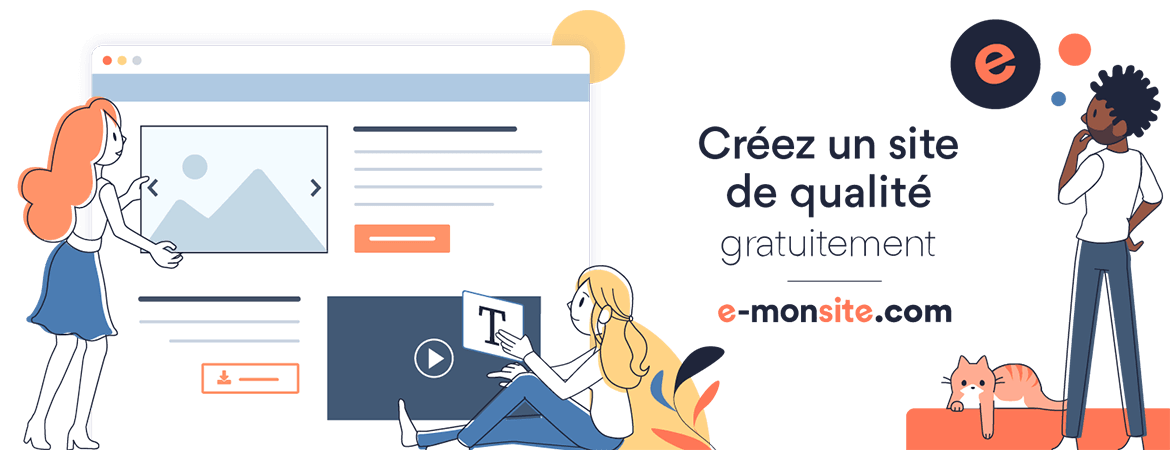cinéma français
-
Coutures
- Le 23/02/2026
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
La feuille Volante n° 2039– Février 2026.
Coutures – Un film d’Alice Winocour. (2025).
C’est un film franco-américain qui met en scène trois femmes, Maxine Walker (Angélina Jolie), une réalisatrice américaine qui vient à Paris pour la « fashion week » tourner une vidéo avec pour thème les femmes vampires, qui ouvrira un défilé de haute couture. Elle apprendra rapidement qu’elle est atteinte d’un cancer du sein, que l’opération est urgente et qu’elle devra se faire opérée à Paris par les soins du Professeur Hansen (Vincent Lindon, remarquable dans son rôle de médecin, entre humanité et autorité). Elle devra donc rester en France plus longtemps que prévu, devoir mettre sa vie professionnelle en parenthèses et se concentrer sur elle-même. On verra sur son corps dessinées symboliquement les futures coutures de son opération. Elle se jette dans une passade sans lendemain avec son assistant Anton (Louis Garrel) pour tromper sa peur de l’opération et son angoisse de la mort et peine à annoncer à sa fille restée aux États-Unis, la nouvelle de sa maladie. Son chemin va croiser celui d’Ada (Anyer Anei), une jeune mannequin soudanaise débutante qui a dû quitter son pays, oublier un métier dont elle rêvait pour échapper à la pauvreté qui ronge sa famille et renoncer aux liens qui la lient à son frère. Elle aura un rôle dans la vidéo de Maxine qui ouvrira le défilé. Elle rencontre aussi Angèle (Ella Rumpf), une maquilleuse qui aspire à quitter sa vie précaire et itinérante de petite main pour devenir écrivain et voit dans l’écriture le moyen de sortir de sa condition. Elle va se heurter à l’incompréhension d’un éventuel éditeur qui fait passer son rôle de découvreur de talent après celui plus lucratif de businessman. C’est donc la rencontre de trois destins de femmes venues d’horizons bien différents, entre lumière et ombre, chacune d’elles tentant à sa manière, dans une sorte de révolte, de raccommoder les fils de son histoire personnelle faite d’ambitions, d’illusions, de renoncements, d’épreuves, d’échecs, ce qui créera entre elles une complicité insoupçonnée.
C’est un film tout en nuances et plein de sensibilités servis par des comédiens de grand talent (Il est à noter qu’ Angélina Jolie a tenu son rôle en français). Il soulève des questions sur le destin, la responsabilité individuelle face aux choses de notre vie, la résignation pour Ada et Angèle, l’acceptation de la douleur, l’angoisse de la mort inévitable mais rendue plus immédiate pour Maxine dont ce rôle correspond à une épreuve personnelle. Il y a cette effervescence qui caractérise ce milieu de la mode à la fois du côté des mannequins qui s’entraînent dans un couloir à défiler que du travail acharné de Christine (Garance Marillier) pour réaliser la robe que portera Ada. Ce mélange de drames intimes et descriptions de mondes souvent vus artificiellement de l’extérieur par des spectateurs fascinés m’a particulièrement intéressé. Tout cela se termine dans une sorte d’apothéose, Ada qui continue son show malgré la pluie et la tempête qui détruit les tribunes et ne laisse rien que des débris informes. La symbolique est pour moi particulièrement parlante, celle de la solitude face à l’adversité, l’humilité nécessaire face à l’épreuve, la fragilité, la vulnérabilité, la résilience face aux apparences, la vanité des choses humaines...
Alice Winocour, la réalisatrice, a précisé dans une interview que tous ses films naissent d’expériences intimes et qu’elle a elle-même vécu le parcours de Maxine Walker à qui on annonce qu’elle est atteinte d’un cancer. Ce film complète le travail sérieux, de documentation et de réflexion d’Alice Winocour qui ainsi s’inscrit dans un cinéma témoin de son temps.
-
Retour à Ithaque -Un film de Laurent Cantet
- Le 06/10/2025
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
La Feuille Volante - N° 2018– Octobre 2025.
Retour à Ithaque– Un film de Laurent Cantet, écrit par lui-même et par Leonardo Padura. (2014)
Ithaque c’est, dans l’Odyssée d’Homère, une île dont Ulysse est le roi et qu’il regagne au terme d’une longue errance en mer. Il y retrouve son épouse Pénélope qui l’a attendu malgré les sollicitations de nombreux soupirants.
Sur une terrasse qui domine La Havane au soleil couchant, quatre amis, Tania (Isabel Santos), Eddy (Jorge Perugorría), Aldo (Pedro Julio Dias Ferran) , Rafa (Fernando Hechevarria) se retrouvent pour fêter le retour d’Amedeo (Nestór Jimenez) après seize ans d’exil en Espagne. Du crépuscule à l’aube ils évoquent leur jeunesse, leurs projets de vie, leurs espérances et la joyeuse bande de copains qu’ils formaient. Ce retour dans le passé, commencé au départ dans la bonne humeur, ne va évidemment pas sans dialogues parfois cruels et sans concession ce qui en fait un film humain et donc universel, évoquant le traditionnel thème des « rêves perdus », de l’amitié, de la fidélité, de la foi trahie.
Amedeo est un écrivain cubain jadis primé mais qui s’est exilé en Espagne, abandonnant sa femme atteinte d’un cancer, Rafa est un peintre un peu alcoolique qui a arrêté de peindre et survit en vendant des croûtes, Tania est une ophtalmologue complètement ruinée dont les enfants sont partis aux USA avec leur père, comme beaucoup de Cubains, Eddy est un cadre du castrisme, corrompu et arriviste, ce que ses amis ne lui pardonnent pas et surtout un écrivain raté et Aldo, le noir, l’hôte du groupe qui pourtant avait cru au socialisme, survit en bricolant des batteries automobiles et qui doit supporter son fils adolescent, Yoenis, qui ne fait rien et souhaite quitter Cuba. Chacun fait son propre bilan, à la fois cruel et désabusé et évidemment celui de Cuba durant ces seize années difficiles imposées par Castro, qui ont fait suite à la chute de l’URSS et compliqué la vie des Cubains avec la peur, la pauvreté, l’exil et la corruption.
La classique unité de temps , de lieu et d’action (ou d’inaction puisqu’il ne s’agit que de dialogues, d’une sorte de huis-clos sur le toit d’un immeuble) est respectée. Le film se déroule face à la mer qui symbolise la fuite et dans contexte d’une ville foisonnante de bruits et de vie. C’est un film sur le temps passé et donc le vieillissement, la nostalgie où chacun vit difficilement avec ses lâchetés, ses désillusions, ses compromissions, ses regrets, ses remords et cela renvoie à la situation de Cuba lui-même englué dans une dictature castriste et ses promesses avortées. C’est aussi un hymne à l’amitié malgré le sacrifice d’une génération qui a cru à la révolution castriste et qui prend conscience qu’elle a été laissée pour compte.
Leonardo Padura est le co-auteur de ce film et il est incontestable qu’il se retrouve dans le personnage d’Aldo. En effet Padura qui possède également la nationalité espagnole depuis 2011 et donc pourrait vivre en Espagne, mais préfère son Île. Il dit d’ailleurs avoir non pas deux nationalités mais deux citoyennetés et que sa seule nationalité c’est Cuba sans laquelle il ne peut écrire. Le régime contre lequel il est très critique ne lui ouvre que rarement les portes des médias qu’il contrôle alors que son succès est indéniable sur l’île et à l’international. Il y vit donc d’une manière quasiment anonyme.
Ce film est surtout le dernier de Laurent Cantet, metteur en scène humaniste qui jette sur le monde qui l’entoure un regard critique et curieux des problèmes de son temps, palme d’or à Cannes en 2008 pour « Entre les murs », disparu prématurément à l’âge de 63 ans.
-
Mourir d'aimer - Un film d'André Cayatte
- Le 09/09/2025
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
La Feuille Volante - N° 2012 – Septembre 2025.
Mourir d’aimer – Un film d’André Cayatte (1971)
C’est l’histoire d’amour d’une professeure de lycée rouennais, Danièle Guénot (Annie Girardot) avec un de ses élèves âgé de 16 ans, Gérard Leguen (Bruno Pradal) . Danièle, divorcée, mère de deux enfants, est une prof passionnée par son métier et qui noue avec ses élèves des liens forts, un de ces profs qui nous ont fait aimer l’école quand tant d’autres n’ont fait que nous en dégoûter.
Le film retrace, un peu comme un témoin, la genèse de la relation entre Danièle et Gérard, dans la façon que cette professeur porte son enseignement et accompagne ses élèves hors de la classe jusque dans les bars et les manifestations de Mai 68.
On peut admettre la réaction des parents de Gérard, alors mineur, qui, selon eux, est victime de « envoûtement » d’une femme adulte. On peut comprendre qu’ils sont dans leur rôle, qu’ils reprouvent la différence d’âge, qu’ils souhaitent avant tout l’avenir de leur fils, qu’ils redoutent peut-être aussi l’absence probable de petits-enfants et qu’ils n’avaient pas vraiment prévu cet événement. Éloigner Gérard pour que les choses reviennent à une normalité plus recevable est plausible, lui-même finit par l’accepter pour sauver sa relation avec Danièle, mais le faire interner dans un asile psychiatrique où on se chargera de le shooter à coup de médicaments et porter plainte contre Danièle pour enlèvement et détournement de mineur en espérant lui faire perdre son poste et donc la détruire, c’est autre chose. L’intransigeance du père de Gérard (François Simon), refusant de retirer sa plainte est de ce point de vue révélatrice. C’est pour Danièle qui est réellement amoureuse un combat perdu d’avance puisqu’elle a contre elle sa hiérarchie qui, comme d’habitude, ne veut pas faire de vagues mais surtout la loi, Gérard étant encore mineur. Elle doit non seulement affronter ses juges mais auparavant la Force Publique et ses harcèlements, une perquisition à son domicile, la menace de placement de ses enfants à l’Assistance Publique, la presse avide et destructrice, l’appel du procureur devant le jugement en première instance qui, compte tenu d’une relative clémence et assorti du sursis sera annulé par l’amnistie consécutive à l’élection du nouveau président de la République. En effet, Danièle est l’image du désordre de Mai 68, ce qui à ses yeux de magistrat protecteur de la société, est inacceptable. C’est une battante et croit en la force de l’amour d’autant qu’elle et Gérard ont des soutiens dans leur entourage mais devant cet acharnement, elle finira par craquer. Dès lors, la mort est la seule solution. J’imagine la culpabilisation ressentie par les parents de Gérard, le désarroi de celui-ci, leurs relations durablement voire définitivement affectées, sa vie bouleversée…
Ce film fait évidemment référence à l’affaire Gabrielle Russier (1937-1969) dont il reprend les faits et qui ont ému ou scandalisé la France entière. J’ai souvenir d’une conférence de presse télévisée de Georges Pompidou, alors président de la République, qu’un journaliste interrogea en fin de séance sur cette affaire. Surpris, presque gêné, marquant un long silence que l’image en noir et blanc semblait souligner, hésitant aussi, prononça quelques mots laconiques sur ce qu’il en avait pensé et sur ce qu’il avait fait, ne parvenant cependant à convaincre personne malgré une décontraction feinte, s’en tirant assez piteusement, lui le normalien, agrégé de Lettres, l’auteur notamment d’une anthologie de la poésie française, en citant Paul Eluard , avant de quitter la salle de presse,
« Comprenne qui voudra, moi mon remords ce fut la victime raisonnable au regard d’enfant perdu, celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés »
Au moins, à cette époque, nous avions un président cultivé, ça a bien changé depuis !
Ce genre de relation amoureuse entre deux êtres d’un âge différent est déjà arrivé et arrivera encore sans qu’elle soit heureusement conclue par cet épilogue tragique. Ce que le journaliste, interrogeant le président, avait qualifié de « fait divers » donna lieu notamment à deux films, celui-ci qui obtint un immense succès et fut couronné par « Le grand prix du cinéma français » en 1970 et distribué dans le monde entier, un téléfilm de José Dayan de 2009 avec Muriel Robin dans le rôle principal, une chanson écrite et chantée avant la sortie du film mais qui n’y figure pas par Charles Aznavour. Le nom de Gabrielle Russier et de sa tragique histoire sont gravés dans la mémoire collective un peu comme si l’espèce humaine dont la principale caractéristique est l’amnésie voulait exorciser ce malheureux épisode.
-
Trafic - Un film de Jacques Tati
- Le 26/08/2025
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
La Feuille Volante - N° 2010 – Août 2025.
Trafic – Un film de Jacques Tati.(1971)
M. Hulot (JacquesTati) est dessinateur chez « Altra » un constructeur automobile français. Il est chargé avec Marcel, le chauffeur (Marcel Fraval) et Maria, l’attachée de presse (Maria Kimberly), d’accompagner un modèle de son invention, une 4L aménagée en camping-car, ce qui est révolutionnaire pour l’époque, et qui sera présenté au salon d’Amsterdam. Tout le film est basé sur ce voyage mouvementé entre Paris et Amsterdam, fait de problèmes techniques (crevaison, panne d’essence), d’accidents de la circulation, d’une rétention dans un commissariat où tous les gadgets de la voiture sont dévoilés devant des policiers étonnés, de nombreux plans sur les véhicules en mouvement ou d’événements annexes, souvent provoqués par Hulot ou Maria, au point qu’on en oublie le but réel de cette expédition. Au bout du compte, l’’équipage arrive bien au salon, mais à la fermeture de celui-ci et Marcel a la présence d’esprit de présenter le camping-car à un public dont on se demande d’où il sort ... et d’engranger les commandes. Quand à Hulot, Il est licencié sur le champ et part avec Maria.
Ce film est le cinquième long métrage de Jacques Tati (1907-1982) qui n’en réalisa de son vivant que six. Il fait suite à Playtime (1967) qui le ruina au point que Trafic fut financé par Alec Wildenstein, un marchand d’art français, à la condition que le principal rôle féminin soit tenu par Maria Kimberly, sa compagne. On y retrouve le Hulot de Mon oncle (1958), ce célibataire dégingandé avec son chapeau déformé et ses pantalons trop courts, éternel gaffeur décalé qui veut surtout rendre service autour de lui tout en semblant être ailleurs. Il n’est pas sans évoquer les personnages de Charlie Chaplin ou de Buster Keaton dont Tati s’est sans doute inspiré tout en donnant à Hulot une dimension à la fois réelle et imaginaire, embarquant le spectateur dans un récit qui bien souvent reste en suspension, à la fois drôle, mélancolique, délirant et burlesque,poétique fait de grands gestes, d’expressions dubitatives, de sons extérieurs, de silences…
J’ai voulu avec cet article qui sera sans doute un des derniers de cette chronique, rendre un modeste hommage à Jacques Tati parce que, une nouvelle fois, il nous fait partager son écriture cinématographique si particulière, son sens de la dérision, son sens de la découverte, son esprit toujours en éveil, son humour subtil qu’on n’apprécie que dans l’instant à condition d’être attentif à chaque geste, à chaque attitude des personnages. Et cela en vaut la peine puisque, malgré tout ce temps passé depuis sa sortie, ce film n’a pas vieilli et garde toujours, à mes yeux, cette faculté de nous étonner, et de nous faire sourire, l’humour étant une des armes à notre disposition pour lutter contre ce monde qui autour de nous explose et contre cette société qui a perdu tous ses repères. Et puis, regarder un tel film où il n’est question ni de sang ni de violence ni de sexe est plutôt apaisant.
Après avoir oublié Jacques Tati pendant de nombreuses années, il semblerait qu’on redécouvre actuellement le talent original qui était le sien. C’est une bonne chose mais il n ‘a pas échappé à ce cette malheureuse amnésie qui est le propre de l‘espèce humaine et aussi un peu de l’abandon, ce qui a fait dire à Philippe Labro « Adieu Monsieur Hulot, On le pleure mort, il aurait fallu l’aider vivant »
-
L'attachement - Un film de Carine Tardieu
- Le 11/03/2025
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°1970– Mars 2025.
L’attachement – Un film de Carine Tardieu.
Sélectionné pour la Mostra de Venise en 2024,sorti en France en février 2025.
Il s’agit de l’adaptation d’un roman d’Alice Ferney, « l’intimité », paru en 2020.
Les premières images du film révèlent un couple dont la femme, Cécile, (Melissa Barbaud) va accoucher et qui confie son jeune fils de six ans, Elliot, (Cesar Botti) à sa voisine de palier qu’elle connaît à peine, Sandra, (Valeria Bruni Tedeschi), une cinquantenaire, féministe, célibataire et libérée. Sauf que Cécile va décéder lors de l’accouchement laissant son mari, Alex (Pïo Marmai), désemparé face à la petite Lucille qui vient de naître et à Elliot dont il n’est que le beau-père. Il assumera néanmoins ses nouvelles responsabilités paternelles sans renoncer aux anciennes. La mort de Cécile plane un temps sur cette famille désarticulée mais la vie va s’imposer grâce à Sandra qui, oubliant ses préjugés, s’attache à Elliot puis à Alex. Cela donne des réunions familiales un peu hétéroclites qui réunissent l’ex-de Cécile, David (Raphael Quenard), Marianne, la sœur de Sandra (Florence Muller), la mère de Cécile (Catherine Mouchet), la mère de Sandra et de Marianne (Marie-Christine Barrault). Un peu par hasard, Alex rencontre Emilia, une pédiatre (Vimala Pons) avec qui il se marie, laissant désespérée Sandra qui s’était entre-temps attachée à Elliot.
On rit beaucoup dans ce film qui pourtant est un drame à la fois pour Alex, pour Sandra et pour Elliot qui, malgré son jeune âge crève l’écran par sa présence. Pïo Marmai fait une prestation remarquée malgré une élocution par moments difficile à suivre. Valeria Bruni Tedeschi, toujours aussi talentueuse, campe une Sandra attachante qui sait rester discrète dans un contexte familial difficile et qui accepte, malgré son âge, ses convictions et ses choix personnels de se remettre en question et de bouleverser sa vie. Elle qui avait banni les enfants de son quotidien découvre avec Elliot et Lucille les choix et les joies inspirés par cette nouvelle famille.
;
-
Prodigieuses - Un film de Frédéric et Valentin Potier
- Le 27/11/2024
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°1946– Novembre 2024.
Prodigieuses - Un film de Frédéric et Valentin Potier (2024)
Pour être portée à l’écran, il n’est rien de tel qu’une histoire vraie parce qu’elle est avant tout une aventure humaine , comme celle des sœurs Audrey et Diane Pleynet dont le scénario de ce film s’est inspiré. Elles poursuivent leur carrière de virtuose et sont les seules à avoir mis au point cette technique originale.
Dans la famille Vallois, Claire (Camille Razat) et Jeanne (Mélanie Robert) sont jumelles et toute leur vie a été consacrée au piano par la volonté inébranlable de leur père, Serge (Franck Dubosq), un ancien champion désormais handicapé qui veut absolument la réussite de ses filles qui bénéficient aussi du soutien de leur mère, Catherine (Isabelle Carré). Claire et Jeanne sont des virtuoses du piano et elles sont admises dans la prestigieuse université musicale de Karlsruhe, sous la direction de l’intraitable professeur Klaus Lenhardt (August Vinttgenstein). La gémellité les a toujours renforcées mais l’accès à cette formation d’excellence met en évidence une compétition qui risque de détruire leur traditionnelle connivence. Alors qu’un avenir prometteur s’ouvre devant elles, une maladie orpheline transmise génétiquement les affecte toutes les deux, qui attaque les articulations des poignets et leur interdit la moindre carrière dans leur domaine. Face à cette catastrophe, malgré leur découragement, dans le plus grand secret et grâce à leur complicité unique et leur volonté commune, elles mettent au point elles-mêmes une technique basée sur le mouvement des mains, ce qui leur permet de jouer ensemble un morceau normalement exécuté par un soliste et ainsi de forcer leur destin contraire. Elles sont vraiment prodigieuses.
La musique classique sert de fil conducteur à ce film et jalonne les efforts communs soutenus par la volonté fusionnelle de Claire et de Jeanne .
La distribution est particulièrement réussie et Claire et Jeanne donnent une grande dimension émotionnelle à ce film que porte également leur mère Catherine. Je voudrais faire une mention toute particulière pour Franck Dubost qui joue d’ordinaire dans un tout autre registre. Lui confier le rôle dramatique d’un père intransigeant a été sans doute une gageure mais a démontré un talent insoupçonné du public, le faisant sortir du rôle d’amuseur où il était sans doute enfermé. Ce n’est pas la première fois qu’un comédien dont le répertoire s’inscrit dans le comique se voit offrir un rôle émouvant et dramatique. Cela a été une bonne idée et une révélation.
-
Les gens d'à côté - Un film d'Andre Techiné
- Le 25/08/2024
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°1926 – Août 2024.
Les gens d’à côté – Un film d’André Téchiné (2024).
Lucie (Isabelle Huppert) est agent de police technique et scientifique, pas loin de la retraite. Elle sort d’un long séjour en psychiatrie suite au suicide de son compagnon, Slimane, également policier, qui vivait mal le malaise qui régnait dans sa profession. Sa hiérarchie ne souhaite pas qu’elle reprenne son poste mais elle insiste et obtient gain de cause. Elle habite donc seule dans un quartier pavillonnaire, dans le souvenir de cet homme qu’elle continue à aimer. Par hasard, un jeune couple emménage à côté de chez elle et elle se prend d’amitié pour eux, s’occupe de leur petite fille, Rose. Lui, Yan (Nahuel Perez Biscayart) est un artiste de talent un peu marginal et elle (Hafsia Herzi) est une professeure des écoles, débordée. Elle s’aperçoit que Yan est un activiste d’extrême- gauche, anti-flic et en délicatesse avec la justice. Elle s’attache quand même à eux et finit par aider Yan à échapper à une perquisition menée à son domicile et ainsi à entraver une instruction diligentée contre lui, trahissant ainsi son métier, ses fonctions de protection de la société, entravant le cours de la justice et la manifestation de la vérité.
Ce film m’a laissé perplexe. Certes, tout au long de sa carrière André Téchiné s’est toujours attaché aux problèmes de société et aux relations humaines mais ce film qui met en évidence l’humanisme et la tolérance qui bien souvent font défaut à nos sociétés, sonne faux. Que le hasard fasse partie de notre vie au point d’en modifier parfois le cours, cela je veux bien l’admettre. Quant à l’amitié, elle a bien souvent la solidité d’un château de cartes dans un courant d’air. Le talent d’Isabelle Huppert peine à soutenir ce scénario un peu trop manichéen, voire naïf. Peut-on, en effet, sacrifier son métier, sa raison de vivre, sa liberté au nom de l’amitié pour quelqu’un qui ne partage pas les mêmes valeurs que soi ? Les liens ainsi tissés autorisent-ils à violer la loi et à sacrifier ses propres engagements, sa propre vie ?
La voix off n’ajoute rien et je n’ai pas été convaincu non plus par par les relations posthumes que Lucie entretient avec le fantôme de Slimane. C’est donc un sentiment de déception qui domine.
-
Belle enfant - Thierry Terrasson
- Le 05/08/2024
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°1923 – Août 2024.
Belle enfant – Un film de Thierry Terrasson (Jim) – 2024 .
Emily (Marine Bohin), une jeune femme un peu marginale et avide de liberté, apprend par l’une de ses sœurs, que sa mère, Rosalyne (Marisa Berenson) qui réside chez son oncle Remy(Albert Delpy) en Italie au bord de la mer, a fait une tentative de suicide. Elle fait donc le voyage depuis Paris pour la rencontrer. En réalité, cette tentative qui n’a jamais existé, n’était qu’un prétexte pour revoir , une dernière fois peut-être, ses trois filles, parties depuis longtemps pour échapper à cette famille dysfonctionnelle. Elle retrouve donc ses deux sœurs, Salomé (Caroline Bourg) et Cheyenne (Cybèle Villemagne) mais s’apercevant qu’elles sont de connivence, Emily se prépare à repartir pour la France. A Gène, elle rencontre un jeune Français, Gabin,(Baptiste Lecaplain), un amoureux éconduit à qui elle explique que sa mère, dépressive et mégalomane, n’en a jamais été vraiment une, et qui, entre drague et harcèlement, lui conseille de l’affronter pour exorciser les secrets de cette famille hors norme. Il participe d’ailleurs personnellement à ce processus dans un jeu de rôles efficace.
J’ai trouvé que Marine Bohin, dont c’est le premier long-métrage, campait son personnage avec justesse. entre colère et tendresse.
C’est un film classé dans la catégorie « comédie familiale ». Personnellement je l’ai plutôt abordé comme une œuvre dramatique émouvante et qui, à travers l’opposition traditionnelle mère-fille, remet en cause la figure maternelle classiquement considérée comme le pilier de la famille et qui apparaît ici sous un jour fondamentalement différent, ce qui n’a pas été sans influencer la vie d’adulte de ses trois filles. Je ne suis pas bien sûr cependant que cet épisode ait réussi à ressouder cette parentèle éparpillée, et ce malgré les efforts de cet oncle un peu perdu face à la réalité. Quoiqu’il en soit, c’est un film attachant dans la mesure où il accepte de regarder en face la réalité de la famille à laquelle on a bien trop souvent attaché une image d’Épinal idéale.
Thierry Terrasson (Jim) qui est surtout connu comme auteur de BD, signe ici son premier long-métrage qui est une réussite. Il est plein de belles images aux accents d’une chanson italienne de Pascal et Alexandre Ignelzi. Il joue, avec bonheur sur le registre de l’humour et de l’émotion.
-
Ressources humaines - Un film de Laurent Cantet
- Le 03/05/2024
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
Ressources humaines – Un film de Laurent Cantet.
Laurent Cantet (1961-2024), réalisateur et scénariste de cinéma et de télévision vient de mourir à l’âge de 63 ans. Ce film de 2000 a notamment été récompensé par le « César de la meilleure première œuvre » et celui du « Meilleur espoir masculin » pour Jalil Lespert. Il évoque l’expérience de Franck (Jalil Lespert), un fils d’ouvrier de province qui, grâce aux sacrifices de ses parents, a été diplômé d’ HEC et a obtenu un stage dans l’usine où travaille son père comme simple ouvrier, depuis 35 ans. Il se retrouve aux « Ressources humaines », c’est à dire à la Direction, chargé de mettre en œuvre les nouvelles dispositions des « 35 heures ». Ses nouvelles responsabilités lui laissent entrevoir une carrière prometteuse au sein du groupe , malgré un certaine hostilité de la part de la hiérarchie intermédiaire. Franck est à la fois l’objet de la fierté de son père mais aussi prend conscience des réalités de l’entreprise et à ce titre est suspect de trahison de classe. Dans le cadre de ses fonctions, il s’oppose d’abord aux syndicats de gauche qui se méfient de l’usage que fera le patron de cette nouvelle loi et réclament des négociations. Un peu par hasard, il apprend et révèle le projet de licenciement des plus vieux ouvriers moins rentables, soutient la grève et fait acte de rébellion face au patron qui le met à la porte. Cette mise en perspective est pertinente puisqu’elle met en évidence les illusions d’un jeune diplômé, fils d’ouvrier, face à la rentabilité de l’entreprise mais aussi désireux de ne pas trahir ses origines, placé devant son avenir professionnel, conscient de la différence qui existera toujours entre les ouvriers devenus chômeurs dans une ville de province et sa propre carrière de cadre dirigeant qui se déroulera dans un autre contexte, ailleurs. Ce film est bien servi par des acteurs peu connus du grand public à l’exception de Jalil Lespert. .
Né à Melle de parents instituteurs Laurent Cantet était diplômé de l’Institut des hautes études cinématographiques ( IDHEC) et a été couronné par une palme d’or au 61° festival de Cannes en 2008 pour son film « Entre les murs » à l’unanimité du jury. Il s’est d’abord consacré aux courts métrages – « L’étendu » (1987)- « Tous à la manif » (1994) - « Jeux de plage »(1995) , puis aux longs métrages « Les sanguinaires »(1998), « Ressources Humaines »(2000) pour Arte, suivis de nombreux autres jusqu’en 2021. Une belle réussite en tout cas. Il s’est également impliqué à titre personnel en faveur des sans-papiers en 2010 puis dans la promotion de l’égalité des hommes et des femmes et de la diversité sexuelle et de genre dans le cinéma et l’audiovisuel. Il était également impliqué dans l’association « amitié Echire-Haiti ». Discret et indépendant, Laurent Cantet laissera l’image d’un humaniste, soucieux des problèmes sociaux de son époque.
-
Vers le sud - Un film de Laurent Cantet
- Le 03/05/2024
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°1873– Mai 2024.
Vers le sud – Un film de Laurent Cantet.
Ces nouvelles de l’écrivain haïtien Dany Laferrière, de l’académie française, ont été adaptées par Laurent Cantet (1961-2024), réalisateur et scénariste de cinéma et de télévision qui vient de nous quitter. Avec ce film de 2005 le cinéaste s’attaque à un problème de son temps, celui du tourisme sexuel, mais pas exactement dans le sens auquel on peut s’attendre. Pour cela il met en scène trois femmes blanches, américaines et québécoises, Ellen (Charlotte Rampling), Brenda (Karen Young) et Sue (Louise Portal) qui viennent, en célibataires, chercher à Haïti,en 1979, le plaisir avec de jeunes noirs et spécialement Legba (Menolty Cesar) que deux d’entre elles se partagent se partagent. Elles ne sont d’ailleurs pas les seules et Ellen confie revenir chaque année à Port au Princes pour le plaisir de rencontrer des jeunes qui deviennent leurs amants. Toutes passent ici un séjour après quoi elles repartiront vers leur quotidien parce que la règle non-écrite est que personne ne s’attache à personne et que chacun oublie l’autre après en avoir profité. Chacune de ces trois femmes se présente dans un monologue et Brenda nous confie être déjà venue avec son mari, il y a trois ans et avoir déjà connu Legba qu’elle n’a pas oublié. Lui ne vit que du plaisir qu’il donne à ces femmes et en retire de l’argent, des cadeaux... Sa mère voudrait bien qu’il revienne vivre chez elle, qu’il change de vie, se range, mais accepte son argent faute de pouvoir faire autrement. Ce pays est pauvre et instable où l’armée est aux ordres d’un pouvoir corrompu et dictatorial. Il n’y a que très peu infrastructures touristiques et la prostitution aussi bien féminine que masculine s’ajoute au soleil, aux palmiers, à la mer, au farniente...les autorités tolèrent cet équilibre fragile simplement parce que ce tourisme sexuel rapporte de l’argent à un pays qui en a bien besoin. A ce titre, les ordres de ces femmes blanches sont exécutés et elles-mêmes sont respectées ou à tout le moins tolérées, parce qu’elles apportent des devises. Elles ne sont jamais inquiétées quand un meurtre a lieu dans cette communauté de jeunes hommes. En revanche ces éphèbes sont rejetés, à l’image de l’attitude révélatrice du patron de l’hôtel face à Legba, ce qui n’est pas du racisme mais du mépris. Ce qui au départ n’était qu’un jeu, une simple quête du plaisir pour ces femmes qui trouvaient dans ce pays l’opportunité de faire ce qu’elle ne pouvaient pas ou n’osaient pas faire chez elles, se transforme pour Brenda en un drame. Ses larmes du début, quand elle se souvient de son premier adultère avec Legba, font écho à celles qu’elle verse pour la mort de son amant et aussi à celles d’Ellen qui prend conscience, en rentrant définitivement chez elle, de la fin de ce jeu de l’amour, de la perte de Legba à qui, malgré tout elle était attachée et aussi à celle de Brenda désormais sans attache, qui choisit de rester dans ce sud paradisiaque pour oublier ce bouleversement dans sa vie. D’ordinaire on jetait, avec raison, l’opprobre sur ces hommes qui choisissaient des pays d’Asie, non pour leur culture ou leurs paysages, mais parce qu’ils y trouvaient l’occasion de pratiques sexuelles proscrites et surtout condamnées dans leur propre pays. On a beaucoup parlé des situations dont les femmes ont toujours été victimes dans toutes les couches de la société, de la part d’hommes influents qui ont profité de leur position dominante. Une certaine littérature, notamment vaudevillesque, s’en est même largement nourrie. Des actions judiciaires sont actuellement pendantes, des esclandres ont été dénoncés, des scandales ont éclaté et un mouvement général de libération de la parole s’est développé, dénonçant cette situation inacceptable de dépendance dans un pays où la femme est traditionnellement regardée comme un pilier de la famille. Ce film, tourné en République dominicaine et à Haïti, a l’avantage de lever l’hypocrisie sur la réalité du tourisme sexuel, sur cette nature humaine à laquelle nous appartenons tous, où la recherche du plaisir charnel est une constante, nonobstant toutes les paroles lénifiantes qui peuvent être dites, que cela implique les hommes autant que les femmes, jusques dans l’oubli du risque des maladies vénériennes. Cela est rappelé par une mère de famille au début du film « Les bons masques sont mélangés avec les mauvais, mais tous portent un masque ». C’est là une marque universelle soulignée par le mélange des langues anglaise et française. Le décès de Laurent Cantet a provoqué un grand nombre d’hommages bienvenus pour faire connaître son œuvre. C’est peut-être dommage qu’on ne le reconnaisse que maintenant.
-
Entre les murs - Un film de Laurent Cantet
- Le 01/05/2024
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°314 – Septembre 2008
ENTRE LES MURS – Un film de Laurent CANTET [Palme d'or Cannes 2008].
Il est de la “Palme d'or” comme du “Prix Goncourt”, on parle de l'œuvre qui est couronnée et elle fait débat! C'est d'ailleurs heureux puisque, pour un créateur, rien n'est pire que l'indifférence. Ici, c'est carrément une polémique que suscite ce film et on oscille entre des extrêmes, soit on est laudatif voire inconditionnel, soit les critiques pleuvent...
A s'en tenir au film, qu'en ai-je retenu? D'abord le décor : une classe de 4° dans un collège de ZEP d'une banlieue difficile où un professeur de Français peine à faire son véritable métier, celui d'enseigner notre langue, de provoquer les réactions constructives de ses élèves, de leur donner l'occasion de s'exprimer sur le programme scolaire mais aussi sur la langue, la littérature, la syntaxe, le vocabulaire...
Premier constat : Le message ne passe pas et le malheureux enseignant à qui on demande de nombreux diplômes pour être nommé à ce poste a du mal à se faire entendre de ses élèves et en est réduit à faire de la discipline dans sa classe, pour la simple raison qu'il n'y règne pas l'ordre et le silence nécessaires à la transmission du savoir. C'est aussi un paradoxe, ce professeur souhaiterait évidemment plus de sérénité dans son cours, même s'il a été, quelques années avant, un étudiant un peu indiscipliné, voire chahuteur, dans les amplis de la faculté! Cela est souligné par le personnage d'Esméralda, volontiers frondeuse et irrévérencieuse... qui veut plus tard être policière, sans doute par amour de cet ordre qu'elle contribue largement à perturber dans ce microcosme!
Deuxième constat : Les élèves veulent rester dans le système scolaire, même si, d'évidence, il ne leur sert à rien: témoin cette jeune fille au début du film qui ne veut pas être dirigée sur le “secteur professionnel” alors que son avenir est plus sûrement dans ce domaine que dans le milieu scolaire traditionnel d'où elle sortira sans diplôme et donc sans perspective. Cette classe étant composée majoritairement d'enfants d'immigrés, on comprend bien que l'école, qui devrait être regardée comme une chance d'intégration est en réalité une voie de garage. S'ils en sont exclus, ce sera aussi l'expulsion administrative du territoire avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Dès lors, l'école apparaît comme un moyen des plus artificiels de maintenir un fragile équilibre que les élèves eux-mêmes, en dépit de leur intérêt, ne font rien pour entretenir.
Troisième constat : Les enseignants de ce collège sont conscients de cela, témoin ce professeur de mathématiques qui, en se présentant à ses collègues, se déclare “prof de tables de multiplications”! C'est assez dire le niveau de cette 4° où, d'évidence, les acquis des années antérieures sont nuls! D'ailleurs, on n'entend jamais François Marin parler de littérature, ce qu'il devrait quand même faire! Chacun de ses cours n'est qu'un long et pénible débat, par ailleurs oiseux et sans méthode, avec ses élèves, sur tout et n'importe quoi... Et on se demande bien ce qu'ils peuvent en retirer.
Quatrième constat : L'organisation d'une société à laquelle l'école est censée préparer inclut l'ordre. Le professeur devrait incarner l'autorité et, à l'évidence, ne le fait pas puisque non seulement il accepte, au nom sans doute de la dialectique, un dialogue qui se révèle stérile avec des élèves inconsistants dont on comprend vite qu'ils sont ici pour passer le temps, mais surtout perd son sang-froid et se met lui-même dans une position difficile à tenir. Le spectateur sent bien que l'autorité dont est censé être revêtu le chef d'établissement, et à travers lui l'école, ne peut rien face à la mauvaise volonté des élèves. La décision du Conseil de discipline prononçant l'exclusion de Souleymane est révélatrice. Il sera expulsé de France [on devine son avenir] et paiera seul ce qui n'était qu'un dérapage partagé né de l'insolence constante de cette classe, mais aussi du manque d'autorité du professeur. [Le spectateur aurait sans doute espéré davantage de mansuétude dans le prononcé de cette sanction!]
Cinquième constat : Ce film montre bien bien que ceux qui sont irrévérencieux sont noirs ou d'origine maghrébine, les blancs et les jaunes méritent félicitations et encouragements, ce qui correspond bien à l'image [malheureuse] de notre société multiraciale pour laquelle l'école veut être une chance d'intégration, ce qu'en réalité elle est rarement! C'est la mère de Souleymane qui présente, dans sa langue, ses excuses personnelles au nom de son fils pour éviter l'exclusion que celui-ci semble maintenant accepter comme une fatalité. Double constat d'échec en matière d'éducation, celui de l'école certes, mais aussi celui de la cellule familiale.
Sixième constat : la faillite de l'école mise en évidence par les dernières secondes du film. Cette séquence pose question. Une élève qu'on n'a pas vue pendant le long métrage, c'est à dire qu'elle ne s'est signalée ni par son insolence ni par son assiduité, vient avouer simplement “qu'elle n'a rien appris pendant l'année”! On suppose qu'elle s'est également ennuyée dans les classes précédentes. C'est là un constat des plus alarmants remettant en cause le fondement même de l'enseignement et, au-delà, de notre société.
Septième constant : à mon avis, le rôle d'un professeur de Français, surtout en 4°, est de donner envie à ses élèves de lire. Cela ne me semble pas évident au vu de ce film, nonobstant l'épisode du journal d'Anne Frank. Je voudrais cependant souligner que l'allusion d'Esméralda à “La République” de Platon, qu'elle dit avoir lu avec intérêt me semble un peu artificiel face à l'image qu'elle a donné d'elle. Soit c'est faux et c'est dommage, soit c'est vrai et François Begaudeau, l'auteur du roman qui a servi de prétexte à ce film, n'a plus qu'à changer de métier, ce que je crois, il a fait.
J'observe enfin qu'un débat s'instaure entre les élèves sur la nationalité française et qu'Esméralda déclare n'être pas fière d'être française. Pourtant, j'imagine que ses parents, eux, ont beaucoup souffert pour cela et ne doivent pas renier leur choix!
Un film est une œuvre d'art. Le rôle d'un artiste n'est pas seulement de créer, c'est à dire de réaliser une fiction, c'est aussi de porter témoignage de son temps. De ce point de vue, Laurent Cantet remplit son rôle, d'autres cinéastes l'ont fait également avec talent, même si ce témoignage est nécessairement partiel, voire partisan. En tout cas, son film ne laisse pas indifférent. C'est là un documentaire plus qu'une œuvre de création, mais je continue de penser et même d'espérer que l'école reste globalement un moyen d'éducation, voire d'intégration et un des fondements de notre société.
-
La nouvelle femme - un film de Léa Todorov
- Le 08/04/2024
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°1857– Avril 2024.
La nouvelle femme - Un film franco-italien de Lea Todorov. (2023)
L’éducation est un moyen essentiel dans l’émancipation de l’homme et de sa réalisation personnelle. Cette affirmation prend toute son importance quand il s’agit de personnes handicapées qui ont comme les autres le droit à la vie. Face à ce problème, le régimes totalitaires ont apporté une solution d’élimination quand les démocraties cherchent à y apporter une réponse plus adaptée. Ce fut un long combat, il est vrai souvent caractérisé par des initiatives individuelles quand la collectivité choisissait souvent d’ignorer voire de cacher ceux qui en étaient atteints.
Nous sommes à Rome en 1900 et Lili d’Alengy, une prostituée qui a fui Paris, cache sa fille idiote qui entrave sa carrière. Elle y rencontre Maria Montessori (1870-1952), une femme médecin qui travaille dans un institut pour enfants déficients et qui a développé une méthode d’éducation pour les aider à se réadapter. Il naît entre ces deux femmes que tout oppose une relation faite d’empathie, de compréhension et de volonté d’aide face à une détresse solitaire, celle de Lilli qui souhaite dissimuler la présence de sa fille et celle de Maria qui veut faire reconnaître son action. Maria elle aussi cache un fils, certes normal, mais né hors mariage, ce qui a l’époque est pour une femme célibataire un motif d’exclusion de cette société bourgeoise, bien pensante et hypocrite. De plus, pour une femme, être médecin est tout simplement inconcevable dans un monde réservé aux hommes et son action personnelle en faveur des enfants est éclipsée au profit de son collègue, le père de son fils, Guisepe Montesano, codirecteur de l’institut. Lilli fait profiter à Maria de sa connaissance du monde masculin et de la façon de se comporter face à lui pour lui résister et Maria aide efficacement sa fille à progresser. Maria qui auparavant ne vivait que pour la science et pour son travail se révèle être cette « nouvelle femme » qui va s’affirmer. Ce sont les deux personnalités féminines de ce film. Cette opposition entre ces deux femmes, l’une réelle, Maria Montessori (Jasmine Trinca) et l’autre fictive incarnée par Leila Bekti est bienvenue. Elle met en prescriptive la personnalisé de la première, autoritaire, ambitieuse et surtout désireuse de s’imposer dans un monde qui la rejette et la seconde qui reste une demi-mondaine mais une femme libre et indépendante qui va aider Maria à conquérir son autonomie financière , fonder son propre centre et imposer la méthode qui va porter son nom et révolutionner l’école de son temps. Elle est encore utilisée aujourd’hui.
Un autre aspect important est la relation entre Maria et son compagnon, le père de son fils qui co-dirige l’institut, Guisepe Montesano (Rafaele Esposito) qui souhaiterait qu’ils se marient, notamment pour légitimer leur fils, mais Maria refuse puisqu’elle perdrait du même coup son indépendance, la femme mariée était à l’époque sous la tutelle exclusive de son époux. La reconnaissance de son fils par son père, qui par ailleurs de marie avec une autre femme, fait perdre à Maria ses droits sur son fils dont elle doit se séparer pendant 12 ans. C’est le douloureux prix qu’elle doit payer pour être reconnue.
Ce film est important parce qu’il met en scène des enfants réellement déficients mais dont la direction s’est adaptée à leur handicap. En outre il s’inspire directement du journal intime de Maria.
Ce long métrage s’inscrit parfaitement dans la difficile conquête des droits de l‘enfant inadapté mais aussi la prise en compte du long combat des femmes pour la reconnaissance de leur statut au sein de la société. Le cinéma italien s’en fait actuellement l’écho, mais dans un tout autre registre, notamment avec le film de Paola Cortellesi « C’e ancora domani » (il reste encore demain) et celui de Maria Savina (« Prima donna »)
C’est le premier film de Lea Todorov, connue par ailleurs dans le domaine de réalisation de documentaires et c’est une réussite.
-
l'innocent - Louis Garrel
- Le 21/10/2022
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
L'innocent
Un film de Louis Garrel
C'est le 4° film réalisé par l'acteur-réalisateur Louis Garrel qui joue le rôle d'Abel, un fils que le remariage de sa mère, Sylvie (Anouk Grinberg) avec un taulard, Michel, ( Roschdy Zem) inquiète au point de pister ce dernier avec l'aide de sa meilleure amie, Clémence (Noéamie Merlant), persuadé qu'il est que son nouveau beau-père va replonger. C'est là un thème traditionnel que le cinéma et la littérature ont souvent exploité. On verra rapidement que Michel n'a pas renoncé à l'usage du mensonge quand elle s'est à nouveau laissée happer par le tourbillon du grand amour.
Ici Sylvie, qui anime un atelier de théâtre en prison tombe amoureuse de Michel au point de l'épouser, n'en est pas à son coup d'essai et c'est bien ce qui inquiète Abel. Ses doutes seront rapidement confirmés notamment quand Sylvie qui ,depuis son mariage, semble vivre sur une autre planète, prend avec Michel la gérance d'un magasin de fleurs. Abel dont les filatures grossières n'échappent pas à Michel finit par marcher dans le jeu de ce derniet et se fait expliquer son prochain projet : braquer un camion transportant du caviar. Bizarrement, alors qu'il se méfiait de Michel et semblait vouloir le bonheur de sa mère, Abel décide de participer à cette opération avec la complicité active de Clémence. Pourquoi après tout et le coup est monté avec Jean-Paul (Jean-Claude Pautot). Evidemment la chose tourne mal et ce qui semblait devoir n'être qu'une formalité se termine par un fiasco.
Dans ce genre de scénario l'épilogue est souvent dicté par la morale qui veut que les voyous sont démasqués comme c'est le cas ici, Michel, trahi par Jean-Paul, retournera en prison et Abel, pris par la police sera incarcéré à son tour. Louis Garrel veut-il nous dire qu'il ne faut faire confiance à personne, mais cela nous le savions déjà. La morale est donc sauve, même si le bref mariage de Sylvie se terminera par un divorce. On imagine d'ailleurs qu'elle est prête à recommencer avec un autre homme, prisonnier ou pas, faisant semblant d'oublier que le mariage est une loterie et qu'elle n'est apparemment pas chanceuse dans ce domaine. Seule Clémence semble s'en tirer, encore qu'on imagine mal le sort de la cargaison de caviar entreposée avec les pinguoins dans un local réfrigéré de l'aquarium où Michel et Sylvie travaillent. Ces deux là finissent par se marier mais Abel, à son tour, va passer quelques années en prison.
Je ne partage pas du tout l'avis dithyranbique de la critique qui voit ce film comme drôle. Je n'ai pas du tout cru à cette histoire mais je n'ai peut-être rien compris. Quant au titre du film, le conducteur du camion, peut-être?
-
Le sixième enfant - Léoplod Legrand
- Le 02/10/2022
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°1678 – Octobre 2022
Le sixième enfant – Un film de Léopold Legrand.
Pour une femme dont l’instinct maternel est fort, ne pas pouvoir enfanter est un drame et quand la médecine s’est révélée impuissante et que le droit multiplie les conditions de l’adoption au point de la rendre impossible, faire appel à son imagination, même si elle contrevient à la loi, est tentant. C’est le thème de ce film qui met en scène un couple d’avocats dont l’épouse, Anna (Sara Giraudeau), a fait plusieurs fausses couches et dont Julien (Benjamin Lavernhe), commis d’office dans une procédure, rencontre Franck (Damien Bonnard), un délinquant marginal gitan qui, au terme de l’instance, lui offre un marché. Son épouse, Meriem (Judith Chemla) enceinte de son sixième enfant est déterminée, avec l’accord de son époux, à ne pas le garder parce qu’ils ne pourront pas l’élever, pour des raisons financières. Une transaction est donc mise sur pied, l’enfant à naître sera « vendu ». Cette offre est simple et Anna et Julien ne peuvent ignorer que la loi qualifie un tel acte de trafic d’êtres humains et évidemment le condamne mais, après pas mal d’hésitations, surtout de la part du mari, et qui mettent à mal l’équilibre du couple, ils prennent quand même la décision d’accepter.
C’est une intrigue déjà présente dans la littérature, notamment chez Maupassant et c’est aussi, de nos jours une chanson de Viktor Lazlo, Mais ce film est une adaptation du roman d’Alain Jaspard (« Pleurez des rivières » aux Éditions Héloïse d’Ormesson) où les personnages et les situations ne sont pas tout à fait les mêmes, les événements plus ramassés, mais le sujet est parfaitement identique, celui d’un drame sur fond de choc des cultures, celui d’une rencontre de deux couples qui n’avaient aucune chance de se croiser, l’un, bourgeois parisien qui vit dans les beaux quartiers et l’autre qui survit en banlieue sur une aire réservée aux gens du voyage, une famille jeune mais triste, sans enfant et une autre plus âgée, joyeuse et pleine de gamins, mais tellement pauvre qu’elle ne pourra même pas faire face à la venue d’une autre bouche à nourrir. Il y a cependant dans cette opposition une note de liberté que la précarité ne gomme pas.
On pouvait se douter de l’épilogue, même si une décision contraire de dernière minute de la part de Meriem pouvait encore intervenir et empêcher la réalisation du projet. En outre, lors des préparatifs de l’accouchement et au cours de celui-ci, Meriem, plus âgée, est présentée comme une primo parturiente, mensonge qui ne pouvait échapper au médecin et à la sage-femme qui en ont d’ailleurs fait le signalement. D’autre part, je comprends parfaitement la réaction du fils aîné du couple qui analyse simplement la situation de la famille et l’accepte. Être l’aîné dans un contexte familial difficile mûrit plus vite un enfant et lui fait prendre conscience des réalités en hypothéquant son enfance. Catholique fervente, Meriem ne peut accepter l’avortement, en revanche, j’ai un peu de mal à concevoir que les gens du voyage, très croyants et également très attachés à leurs enfants se résolvent à vendre l’un d’eux. La complicité de ces deux couples, et spécialement des femmes que tout oppose, est bouleversante. Il faut cependant espérer pour Anna, qui prend sur elle toute la responsabilité de cette terrible histoire, que, même s’il s’agit d’une fiction, le jury des Assises soit majoritairement composé de femmes qui, mieux que des hommes comprendront ce problème.
C’est un très beau film, tout en nuances et en finesse, d’ailleurs couronné de nombreux prix (Prix du Public, d’interprétation féminine, de la meilleure musique et du meilleur scénario), servi par des acteurs talentueux et authentiques qui interprètent magistralement et dans le ton juste cette partition difficile. Une façon aussi de nous faire réfléchir sur la famille, la destiné des nantis par rapport aux plus pauvres qui sont aussi des êtres humains.
Hervé GAUTIER
-
Grâce à Dieu - Un film de François Ozon
- Le 10/03/2019
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1332 – Mai 2019
Grâce à Dieu – Scenario de François Ozon. (Grand prix du Jury – Berlinale 2019)
Je ne sais si, comme on le dit, « nous vivons une époque formidable », mais au moins la société, après avoir été longtemps apathique et avoir accepté sans beaucoup broncher tout et n'importe quoi a décidé maintenant de se réveiller et de contester ce qu'auparavant elle prenait pour argent comptant. C'est vrai en matière politique, fiscale, sociologique, culturelle … Et pourquoi pas en matière religieuse ? Un tel mouvement me paraît être une bonne chose et nourrit la démocratie autant que le concept d'humanité.
Je ne veux ni faire le résumé d'un film qui retrace l'histoire des victimes et dont la sortie en salles a défrayé la chronique au point de faire l'objet de deux instances judiciaires préalables, ni remettre en cause la présomption d'innocence du Père Preynat qui a d'ailleurs avoué les fautes qui lui sont reprochées, ni même jeter l’opprobre sur cet ecclésiastique qui a broyé la vie de centaines d'adolescents. Je me suis toujours demandé comment il était possible que des hommes à qui les meilleurs parents du monde confiaient leurs enfants au seul motif qu'ils étaient religieux et donc dépositaires de valeurs morales et chrétiennes et, en outre, représentants proclamés d'une divinité à laquelle notre culture judéo-chrétienne nous a amenés à croire quasi automatiquement à travers des rituels devenus traditionnels (messe du dimanche, baptême, communion, enterrement...), comment ces hommes dont le discours apaisant était traditionnellement recherché dans l'adversité, à qui chacun faisait une pleine confiance, sans doute à cause de ce qu'ils représentaient, ont pu ainsi en abuser pour perpétrer ces sévices sur des enfants naïfs et incapables de se défendre en réclamant de plus leur silence? Il ne fait pas de doute que l'hypocrisie qui est une des tristes caractéristiques de notre société s'est à nouveau manifestée à l'occasion de cette affaire. Dans le film, les adultes ont bien entendu été avertis des agissements du prêtre mais bien peu ont réagi. Beaucoup ont préféré ne rien voir, sans doute parce que, venant d'un homme de Dieu ce qui leur était révélé ne pouvait qu'être inconcevable. Ou ils ont préféré ne pas faire de vagues par crainte du scandale ou peut-être par peur de l'enfer, ce concept si longtemps agité comme un épouvantail par l’Église elle-même, à supposer qu'il existe ailleurs que sur terre. Que dire de la hiérarchie catholique qui non seulement a préféré ignorer les interrogations de ceux qui ont eu le courage de les formuler, mais n'a pris aucune sanction contre les fautifs, couvrant non seulement leurs agissements mais les déplaçant dans le seul but d'éviter un scandale tout en les laissant œuvrer au contact d'enfants? J'observe que lorsque l’Église consent, souvent au terme d'un longue réflexion, nourrie par la polémique ou le scandale, à reconnaître ses erreurs, elle ne fait que demander pardon, comme si cela suffisait à entraîner l'oubli des victimes. Il y aurait beaucoup à dire à ce propos sur ce qui a principalement un caractère religieux, mais il suppose, de part et d'autre, à travers la confession et la contrition, une démarche sincère, difficile dans ce contexte. Il est en outre bien facile de se retrancher derrière la prescription comme on le voit dans le film, le cardinal ayant ce mot malheureux qui pourtant est révélateur, ou même derrière la prière, pour tenter une nouvelle diversion et les circonstances de cette affaire qui n'emprunte rien à la fiction, sont bien de nature à s'interroger sur la foi chrétienne comme il est suggéré à la fin.
Je ne galéjerai pas non plus sur la parole du Christ rapportée notamment par saint Matthieu (Mat XIX – 13-15) où il est question des enfants, ce serait bien trop facile, mais de l’Évangile que l’Église catholique a oublié pendant des centaines d'années, quand elle ne l'a pas noyé sous des flots de sang en s'alliant au pouvoir politique, que reste-t-il ? Pourquoi s'étonne-t-on que les églises soient vides comme elles ne l'ont jamais été et, quand elles se remplissent, c'est pour un témoignage public, un mariage, un enterrement – cette dernière cérémonie étant de plus en plus confiée à des laïcs – qui a davantage une signification sociale, amicale, voire politique que religieuse. Cette institution a-t-elle à ce point manqué son but et trahi ceux qui lui faisaient confiance ?
Certes, tous les prêtres ne sont pas pédophiles et nous en avons tous connus qui ont été ou sont encore un exemple d'abnégation et de moralité, respectueux de leurs vœux et de leur engagement sacerdotal. Un tel phénomène n'est pas du seul fait des organisations confessionnelles catholiques et affecte aussi d'autres corporations, mais ces dénonciations au sein de l’Église, notamment dans le clergé américain, ont entraîné des démissions et des mesures drastiques en vue d'assainir ce problème. Même si l’Église catholique a été longtemps un pilier de notre société et ses prêtres des références respectées, la révélation de ce scandale qui enfin éclate ne va sûrement pas arranger l'anticléricalisme viscéral des Français. Que va-t-il rester de tout cela, au moment où notre monde connaît une vraie crise des vocations religieuses, si le pape, comme il en a le courage qu'il faut saluer, s'attelle à ce problème au point d'organiser au Vatican un colloque sur ce sujet et d'exiger que toute la lumière soit faite sur cette question, que les coupables soient sanctionnés par la justice des hommes et que lui-même commence à défroquer des cardinaux convaincus de pédophilie ? Si cette démarche va a son terme et qu'il est réellement fait quelque chose pour assainir cette situation délétère, l’Église ne peut en sortir que grandie mais il est permis d'émettre des doutes compte tenu de l'ampleur que cela risque de prendre et je crains que l'effectif du clergé en soit durablement affecté et qu'il ne reste plus grand monde pour exercer ce ministère ! Quant au pape, pourra-t-il ou voudra-t-il mener à bien la mission qu'il s'est fixée face à la toute puissante curie romaine?
La parole se libère actuellement et sans haine, notamment dans l’Église et on voit à la télévision des reportages concernant des religieuses violées par des prêtres et on dénonce même la pratique d'avortements connue du Vatican, ce qui est un comble au regard du message religieux et des commandements de Dieu dont l’Église est garante. Ces révélations sont sidérantes.
H.L.
-
Un air de famille - Agnès Jaoui - Roland Bacri
- Le 20/11/2018
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1295
Un air de famille – Une pièce d'Agnès Jaoui et de Roland Bacri - Un film de Cédric Klapisch.
Ce film tourné en 1996 par Cédric Klapisch est d'abord une pièce de théâtre, portant le même titre, écrite en 1994 par Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui qui sont aussi au générique.
La famille Ménard a quelque chose de traditionnel. « La Mère » (Claire Maurier) est veuve et parmi ses trois enfants Philippe, la quarantaine (Wladimir Yordanoff), marié à Yolande (Catherine Frot), est cadre dans une société d'informatique. C'est le préféré de sa mère, celui qui a réussi, qui prend les décisions pour tout le monde, tandis que Henri (Jean-Pierre Bacri), l’aîné, marié à Arlette, le raté de la famille, s'est contenté de reprendre « Au père tranquille », le café minable, auparavant tenu par son père, sans y avoir fait aucune modification. On y retrouve l'ancien juke-box en panne, la décoration et le mobilier d'un autre âge. Il vivote entre le « plat du jour » à midi et les retraités qui font durer un ballon de rouge tout l'après-midi en tapant le carton. Betty (Agnès Jaoui), la benjamine, qui a du travail grâce à Philippe dans son entreprise, célibataire de trente ans, conserve son indépendance et son franc-parler, ce qui inquiète sa mère. Sa marginalité rebelle face à sa hiérarchie risque de lui coûter sa place mais elle n'en n'a cure, elle reprendra sans doute son errance professionnelle faite de petits boulots et d'allocations- chômage. L'employé d'Henri, Denis, (Jean-Pierre Darroussin) est un peu le souffre-douleur de ce patron sans envergure mais qui cependant ne s'en laisse pas conter et fait valoir sa différence et ses préférences.
C'est le soir du 35° anniversaire de Yolande qui doit être célébré dans un bon restaurant du coin mais l'absence d'Arlette, dont on apprend très vite qu'elle a quitté le domicile conjugal, retarde le départ des convives, ce qui fait que tout se passera « au père tranquille » dans l'improvisation la plus totale. Rapidement, ce qui devait être une réunion de famille annuelle, traditionnelle et surtout paisible tourne à l'affrontement. A propos du passage raté à la télévision régionale de Philippe qui devait y parler de son entreprise, de vieilles querelles familiales ressortent et des disputes éclatent. Denis quant à lui, malgré sa non-appartenance à cette parentèle, fait ce qu'il peut pour donner un semblant de fête à cette soirée ratée. Le côté naturel et naïf de Yolande ressort qui énerve quelque peu son mari qui depuis longtemps ne lui accorde que peu d'importance, tandis que la mère campe exactement l'archétype de la « Belle-mère » et de la mère abusive, faisant ouvertement des différences entre ses enfants. Caruso, le pauvre chien paralysé, qui bien entendu ne dit rien et ne bouge pas, a même de la présence.
La traditionnelle règle du théâtre de l'unité de temps, de lieu est d'action est pratiquement respectée dans ce microcosme et le drame peut éclater, heureusement conclu par un épilogue moins sombre.
Cette œuvre est une évocation très juste de ce qui se passe dans toutes les familles, entre hypocrisies et non-dits, une entente de façade qui dégénère très vite en règlements de compte à propos de rien, ici d'un bafouillage de Philippe devant les caméras ou de sa cravate jugée peu conforme aux vues de sa mère et accessoirement une prise de bec entre Betty, décidément bien en état d'insubordination, et un des cadres de l'entreprise où elle travaille. Ces détails, savamment étudiés et exploités à l’extrême vont entraîner les membres de cette famille dans une sorte de maelstrom révélateur et destructeur.
J'ai trouvé le jeu des acteurs convaincant, les dialogues incisifs, les intonations de voix étudiées, bien dans l'ambiance un peu délétère d'une famille traditionnelle composée de membres qui ne se ressemblent pas forcément et qui ont entre eux d'inévitables désaccords et rivalités. Les différences sociales et familiales sont bien marquées ce qui fait de cette œuvre une satire fort pertinente.
© Hervé Gautier – Novembre 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
,
-
Un air de famille - Un film de Cédric Klapisch
- Le 20/11/2018
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1295
Un air de famille – Une pièce d'Agnès Jaoui et de Roland Bacri - Un film de Cédric Klapisch.
Ce film tourné en 1996 par Cédric Klapisch est d'abord une pièce de théâtre, portant le même titre, écrite en 1994 par Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui qui sont aussi au générique.
La famille Ménard a quelque chose de traditionnel. « La Mère » (Claire Maurier) est veuve et parmi ses trois enfants Philippe, la quarantaine (Wladimir Yordanoff), marié à Yolande (Catherine Frot), est cadre dans une société d'informatique. C'est le préféré de sa mère, celui qui a réussi, qui prend les décisions pour tout le monde, tandis que Henri (Jean-Pierre Bacri), l’aîné, marié à Arlette, le raté de la famille, s'est contenté de reprendre « Au père tranquille », le café minable, auparavant tenu par son père, sans y avoir fait aucune modification. On y retrouve l'ancien juke-box en panne, la décoration et le mobilier d'un autre âge. Il vivote entre le « plat du jour » à midi et les retraités qui font durer un ballon de rouge tout l'après-midi en tapant le carton. Betty (Agnès Jaoui), la benjamine, qui a du travail grâce à Philippe dans son entreprise, célibataire de trente ans, conserve son indépendance et son franc-parler, ce qui inquiète sa mère. Sa marginalité rebelle face à sa hiérarchie risque de lui coûter sa place mais elle n'en n'a cure, elle reprendra sans doute son errance professionnelle faite de petits boulots et d'allocations- chômage. L'employé d'Henri, Denis, (Jean-Pierre Darroussin) est un peu le souffre-douleur de ce patron sans envergure mais qui cependant ne s'en laisse pas conter et fait valoir sa différence et ses préférences.
C'est le soir du 35° anniversaire de Yolande qui doit être célébré dans un bon restaurant du coin mais l'absence d'Arlette, dont on apprend très vite qu'elle a quitté le domicile conjugal, retarde le départ des convives, ce qui fait que tout se passera « au père tranquille » dans l'improvisation la plus totale. Rapidement, ce qui devait être une réunion de famille annuelle, traditionnelle et surtout paisible tourne à l'affrontement. A propos du passage raté à la télévision régionale de Philippe qui devait y parler de son entreprise, de vieilles querelles familiales ressortent et des disputes éclatent. Denis quant à lui, malgré sa non-appartenance à cette parentèle, fait ce qu'il peut pour donner un semblant de fête à cette soirée ratée. Le côté naturel et naïf de Yolande ressort qui énerve quelque peu son mari qui depuis longtemps ne lui accorde que peu d'importance, tandis que la mère campe exactement l'archétype de la « Belle-mère » et de la mère abusive, faisant ouvertement des différences entre ses enfants. Caruso, le pauvre chien paralysé, qui bien entendu ne dit rien et ne bouge pas, a même de la présence.
La traditionnelle règle du théâtre de l'unité de temps, de lieu est d'action est pratiquement respectée dans ce microcosme et le drame peut éclater, heureusement conclu par un épilogue moins sombre.
Cette œuvre est une évocation très juste de ce qui se passe dans toutes les familles, entre hypocrisies et non-dits, une entente de façade qui dégénère très vite en règlements de compte à propos de rien, ici d'un bafouillage de Philippe devant les caméras ou de sa cravate jugée peu conforme aux vues de sa mère et accessoirement une prise de bec entre Betty, décidément bien en état d'insubordination, et un des cadres de l'entreprise où elle travaille. Ces détails, savamment étudiés et exploités à l’extrême vont entraîner les membres de cette famille dans une sorte de maelstrom révélateur et destructeur.
J'ai trouvé le jeu des acteurs convaincant, les dialogues incisifs, les intonations de voix étudiées, bien dans l'ambiance un peu délétère d'une famille traditionnelle composée de membres qui ne se ressemblent pas forcément et qui ont entre eux d'inévitables désaccords et rivalités. Les différences sociales et familiales sont bien marquées ce qui fait de cette œuvre une satire fort pertinente.
© Hervé Gautier – Novembre 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
,
-
JUSQU'A L'ENFER - Un film de Denis Malleval
- Le 08/08/2015
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°949– Août 2015
JUSQU'A L'ENFER – Téléfilm de Denis Malleval (2009). rediffusion 7 Août 2015 -France 2
Adaptation d'un roman de Georges Simenon « La Mort de Belle »
Simon Andrieu (Bruno Solo) est professeur de mathématiques dans un lycée d'Orléans. Bien que d’origine modeste, ses parents étaient boulangers à Châteauroux, il s'est marié avec Christine (Delphine Rollin) dont le père était professeur de médecine. Il l'a sans doute rencontrée à l 'université et ses amis se demandent encore pourquoi elle a bien pu le choisir comme mari, alors qu'elle devait être courtisée par nombre de jeunes hommes plus fortunés et plus en vue. Par le miracle de l'amour sans doute, on peut dire que Simon a fait un riche mariage. Ils forment ensemble un couple bizarre et sans enfant malgré la quarantaine. La fortune et les relations de Christine leur permettent d'avoir un certain train de vie, de faire partie des notables de la ville et ils fréquentent volontiers le Procureur, des avocats, des médecins… Simon ne se sent pas pour autant intégré dans ce milieu où il n'a pas sa place et où il n'est pas vraiment accepté ; Christine aime sortir avec des amis mais lui préfère la solitude alcoolique, s'enferme volontiers dans son bureau qui est aussi son terrain de jeu puisqu'il y joue au train électrique. Cette activité est souvent l'apanage d'anciens cheminots mais dans son cas c'est plutôt la marque d'une volonté de retrait du monde dans lequel il vit, comme quelqu’un qui voudrait rester dans sa bulle, dans son enfance. De l'enfance justement, il garde la timidité, l’inhibition, surtout vis à vis des femmes, ses voisines, ses jeunes et belles élèves, les passantes qu'il croise dans la rue. Avec elles il vivrait volontiers une passade ou une liaison, mais il n'ose pas à cause d'un traumatisme qui remonte à son adolescence. Il les regarde de loin, sans oser les toucher. Cette névrose se retrouve dans leur vie de couple où ils semblent mener deux existences juxtaposées, quotidiennes, domestiques, sans véritable passion et l'amour, s'il a existé entre eux au début, n'est plus qu'un lointain souvenir …Cette oppressante ambiance traduit l'enfermement qui est celui de Simon, à la fois dans dans sa vie au jour le jour et en lui-même.
Un soir que sa femme est sortie sans lui, alors qu'il a préféré la correction de ses copies, sa bouteille de whisky et son jeu de train favori, une jeune anglaise, Belle Sherman, que le couple héberge par complaisance, est retrouvée morte dans sa chambre. Commence une enquête judiciaire où les soupçons se portent évidemment sur lui, surtout pour ses voisins, ses collègues et la presse mais ses relations semblent le protéger pour un temps, d'autant que les investigations piétinent … C’est l’alcool qui précipitera les choses, leur donnant un épilogue inattendu.
J'ai retrouvé dans cette œuvre, écrite en 1952 aux États-Unis, toute l'ambiance distillée d'ordinaire dans les romans de Simenon, l'analyse psychologique des personnages, leurs démons intérieurs, leurs fantasmes, leurs fêlures... En matière de romans policiers, je les préfère et de loin à ce qu'on peut voir actuellement où des scènes de violence, de sexe et de destruction, d'hémoglobine, sont l’ordinaire de ce genre de littérature.
J'ai particulièrement apprécié le personnage campé par Bruno Solo qui nous a plutôt habitués à des rôles plus plus légers et comiques. C'était sans doute là un défi intéressant pour lui mais il donne ici toute la mesure de son talent dans ce rôle dramatique. J’avais d'ailleurs fait la même remarque à propos de Bernard Campan (La Feuille Volante nº 869) dans « La Boule noire », une autre adaptation d'un roman de Simenon par Denis Malleval.
Hervé GAUTIER – Août 2015 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE COUPERET - Costa Gavras
- Le 05/08/2015
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°578– Mai 2012.
LE COUPERET – Un film de Costa Gavras.[2004]
Ciné+club - Vendredi 18 mai 2012 – 21h.
Le cinéma comme la littérature ne sont vraiment dans leur rôle que lorsqu'ils sont le reflet de notre société.
Dans ce film, adapté d'un roman éponyme de l'américain Donald Westlake, Costa Gavras choisit de traiter un sujet qui gangrène nos sociétés occidentales : le chômage. Pour cela il met en scène un cadre supérieur, Bruno Davert (José Garcia), hyper diplômé et particulièrement compétent dans l'industrie du papier. A la suite d'une restructuration, d'une compression de personnel, la société qui l'emploie et qui n'a rien à lui reprocher se délocalise à l'étranger au nom du profit et de la pression des actionnaires... pour gagner encore plus d'argent. Cela n'a rien d'un cas d'école et peut malheureusement se vérifier chaque jour quand les plans sociaux et les fermetures d'usine sont le quotidien d'un monde du travail en pleine mutation.
Après deux ans de veine recherches, entre entretient d'embauches qui tournent mal et déception chronique, Davert devenu amer et agressif, conçoit un plan machiavélique. A la suite d'un stratagème, il se fait communiquer les CV de cadres qui, comme lui, sont à la recherche d'emploi dans sa branche et qui, de ce fait, sont des concurrents potentiels et donc des obstacles pour lui. Il en sélectionne cinq qu'il estime être de son niveau et une société, « Arcadia » qui peut fournir l'emploi souhaité. L'un d'eux y est d'ailleurs employé. A ses yeux, le seul moyen d'y obtenir du travail est... de les tuer! Il va donc ressortir le vieux Luger de la guerre 39-45 que lui a légué son père pour mettre en œuvre son sombre projet. Il y a urgence et, malgré le cadre agréable de sa maison, et son confort qui correspondent bien à un cadre supérieur, tout autour de lui se délite. Son épouse (Karine Viard) qui fait vivre la famille grâce à de petits boulots, le trompe et son fils est convaincu de vol ce qui attire la police à son domicile. Seule sa fille semble être un pilier solide au milieu de toute cette débandade. C'est elle qui redonne à la fin à Bruno son véritable rôle de père-héros au sein de sa propre famille.
La quête criminelle de Bruno l'amène à côtoyer les cadres supérieurs qu'il a sélectionnés et qui se sont reconvertis pour un temps, qui dans un restaurant minable, qui dans le prêt à porter et qui lui confient leurs états d'âme et leur désarroi face à la crise. Cela ne l'empêche pas de les éliminer les uns après les autres tant sa détermination est grande ou d'assister, par enquête policière interposée, à leur suicide. C'est que notre homme, quoique déterminé, reste quand même un amateur en matière de crime. Il laisse derrière lui des traces qui font que la police se présente chez lui, non pour l'arrêter, mais pour l'avertir qu'une série de meurtre a été commise... contre des cadres de la papeterie au chômage ! Pendant tout le film, l'omniprésence des policiers entretiendra un suspense équivoque et sera comme une épée de Damoclès sur la tête de Bruno. C'est finalement l'inspecteur en charge de l'enquête qui viendra lui annoncer... qu'il n'a plus rien à craindre ... de ce serial killer !
Au bout du compte, Bruno assiste, un peu par hasard à la mort accidentelle du responsable de la société qu'il souhaite intégrer. Il faut dire qu'il est, si l'on peut dire, un peu chanceux dans son entreprise morbide et que tout semble, en apparence, s'arranger pour lui, mais en apparence seulement. La dernière image du film nous le présente comme un cadre bien installé dans sa nouvelle entreprise et même bien dans sa peau mais qui va, à son tour, devenir la proie de ceux qui, comme lui auparavant, sont à la recherche d'un emploi et qui n'hésiteront pas à mettre en œuvre ses propres méthodes pour prendre sa place.
C'est l'occasion pour Costa Gavras d'exprimer une idée bien simple. Dans d'autres sociétés humaines, on élimine, au nom de l'élan vital, les éléments surnuméraires, enfants et vieillards, dès lors qu'ils sont une charge insupportable pour la collectivité, pour ne garder que ceux qui sont rentables. Dans nos sociétés occidentales, c'est le contraire et on se débarrasse, au nom du profit, des meilleurs qu'on pousse vers la sortie, la pauvreté, le suicide...
José Garcia est ici à contre-emploi mais campe admirablement le personnage machiavélique et déterminé constamment noyé dans l’ambiguïté de l'action, emprunt d'un humour froid mais qui ne parvient cependant pas à être antipathique.
Après avoir traité avec brio des problèmes politiques (Z, l'aveu) Costa Gavras choisit ici un sujet de société malheureusement bien actuel. Il le fait, certes, sous l'angle bien particulier du thriller, mais en donnant à cette fable, adapté d'un roman noir américain, une dimension humaine dans ce qu'elle a de plus déstructurant pour un individu mais en sauvegardant à la fois la valeur de la famille et du travail.
-
LA GRANDE ILLUSION - Un film de Jean Renoir
- Le 17/11/2014
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°830 – Novembre 2014.
LA GRANDE ILLUSION – Jean Renoir (1937).
Pendant la Grande Guerre, l'avion du lieutenant Maréchal (Jean Gabin) et du capitaine de Boëldieu (Pierre Fresnay) est abattu par le commandant Von Rauffenstein (Eric Von Stroheim), un aristocrate raffiné connaissant la famille du capitaine. Faits prisonniers les deux officiers français sont envoyés dans un camp en Allemagne où il retrouvent des soldats alliés de toutes nationalités, de tous grades et de tous milieux sociaux. La vie s'organise et aussi leur future évasion mais la veille de celle-ci, Maréchal et Boëldieu sont transférés dans une citadelle commandée par Von Rauffenstein devenu inapte au service à la suite d'une grave blessure. Les deux officiers aristocrates sympathisent en raison de leur milieu tandis que Maréchal, ancien ouvrier et le lieutenant Rosenthal, fils de banquier juif, rêvent d'évasion. Le devoir de tout prisonnier de guerre est de s'évader mais le sens de l'honneur de Boëldieu le pousse à se sacrifier pour favoriser la fuite des deux autres français. Le capitaine sera tué par le commandant du camp, victime en quelque sorte de son devoir. L'attitude du capitaine est une forme de rébellion contre les Allemands, il participe à sa manière à l'évasion des deux autres mais respecte une parole d'honneur qu'il n'a pas vraiment donnée au commandant de ne pas chercher à s'évader. Ils appartiennent à la même caste et à ce titre se lient d'amitié.
Les fuyards, épuisés seront recueillis dans une ferme par Elsa qui élève seule sa fille. Toute sa famille est morte au cours de cette guerre. Maréchal tombe amoureux d'Elsa, songe à rester avec elle mais se résout au départ tout en lui promettant de revenir s'il survit et atteint la Suisse. Ils réussissent dans leur entreprise mais le film se termine sans qu'on sache si Maréchal revient vers Elsa, s'il respecte lui aussi la parole qu'il lui a donnée.
Ce film met en scène des personnages très marqués par leur milieu social, Maréchal est un prolétaire promu officier, Von Rauffenstein et Boëldieu sont deux aristocrates engoncés dans leurs préjugés de classe, Rosenthal est fils d'un banquier, juif de surcroît. Lors de leur première incarcération, les hommes de tous les grades et de tous les milieux sont en situation de concentration. On peut comprendre que l'aristocratie, transcende les frontières alors qu'il y a plus d'affinités entre les autres classes sociales et que le devoir de combattre et de résister est plus important dans leur cas. Pourtant, il y a quand même une sorte de solidarité née du travail quand les officiers français et allemands sympathisent autour d’une table et apprennent qu'ils ont travaillé dans la même branche de l'industrie. Je note que ce film n'est pas antisémite puisque Rosenthal est présenté sous un jour favorable.
Nos sommes en 1914-1918 et les camps de prisonniers présentés n'ont rien des camps nazis du conflit suivant. Les gardiens allemands font même preuve d'une certaine bonhomie. Ce n'est pas non plus un film de guerre puisqu'il n'y a aucune scène de combat.
Reste la signification de ce titre. Le film met en scène des personnes appartenant à des groupes sociaux différents qui sont censés être animés des mêmes idéaux. La guerre, comme l’ancien service militaire, est censée rapprocher des hommes qui en temps ordinaire s'ignorent ou se combattent. D'autre part, ce conflit à amené des gens, souvent d'une même caste mais appartenant de deux pays belligérants à se combattre alors qu'ils n'en avaient pas envie. Il n'y a d'ailleurs pas de haine entre les prisonniers et les gardiens et seul le sacrifice de Boëldieu répond à un sens de l'honneur. On n'oubliera pas non plus que Maréchal espère par deux fois que cette guerre sera la dernière et que Rosenthal lui répond en invoquant « une illusion ». Nous sommes en 1937 et la montée du nazisme laisse entrevoir le prochain conflit.
Ce film qui s'inscrit parfaitement dans le centenaire de la Grande Guerre est considéré à juste titre comme un chef-d’œuvre, couronné notamment à la Mostra de Venise en 1937. A titre personnel, je retiens le rôle magistralement tenu par Pierre Freynay.
©Hervé GAUTIER – Novembre 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
UN SINGE EN HIVER - U film d'Henri Verneuil
- Le 26/07/2014
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°769 – Juillet 2014.
UN SINGE EN HIVER – Antoine Blondin- Adaptation cinématographique d'Henri Verneuil (1962).
A quoi ça tient les serments d'ivrogne ! Albert Quentin, patron d'un hôtel-restaurant, ancien fusilier-marin en Chine pendant son service militaire a promis, pendant le bombardement de 1944 de Tigreville, une petite station balnéaire de la côte normande, de ne plus boire s'il en réchappait. C'était l'époque ou le service militaire était une période incontournable, un rituel initiatique. Si on ne l'avait pas fait on n'était pas un homme, c'est à tout le moins ce qu'on disait ! Quentin en a la nostalgie parce que ces années se confondaient avec l'alcool. Quentin est un homme de parole et il mène une vie tranquille aux côtés de Suzanne, sa femme, c'est à dire un quotidien dédié au régime sec, et ce pendant quinze ans. Il déserte même le café de son voisin. Mais voilà qu'un jeune publicitaire, Gabriel Fouquet, débarque un beau jour et s’installe dans l'hôtel de Quentin. Lui, il boit pour oublier l'échec de sa vie sentimentale avec Claire et l'alcool le transporte en Espagne où vit son amie, chacun son voyage ! Et d'ailleurs il vient à Tigreville voir sa fille, pensionnaire dans une institution. L'Espagne, il en rêve au point de parler aux incrédules clients du café de son soleil, de son flamenco, de ses taureaux et, joignant le geste à la parole va jusqu'à interrompre la circulation de cette petite ville en transformant la rue principale en arène. Sauf que, pour lui, les voitures sont autant de taureaux, ce qui déplaît à la maréchaussée. Pour Quentin, c'est le signal qu'il attendait depuis longtemps, il reconnaît en Fouquet un compagnon qui comme lui n'a « ni le vin petit ni la cuite mesquine », le délivre de la perspective d'une nuit passée en cellule de dégrisement et nos deux compères s'en vont arroser cela dans un bar un peu louche qui surplombe la ville « Les gastronomes disent que c'est une maison de passe et les vicelards un restaurant chinois. », indique-t-il en guide averti. Ils connaîtront ensemble deux jours d'ivresse conclus par un mémorable feux d'artifice improvisé sur la plage pour lequel Landru, un commerçant local, s'associe à eux pour lui aussi s'offrir son quart d'heure colonial.
Après cette « nuit d'ivresse » qu'ils illustrent en chantant la fameuse chanson « Nuit de Chine », ils reprendront chacun leur vie d'avant, Quentin en rentrant à l’hôtel et en allant, comme chaque année visiter la tombe de son père, Fouquet en emmenant avec lui sa fille. Dans le train qui les emmène vers leur destination respective, la petite demande à Quentin de lui raconter une histoire avant de prendre sa correspondance. Un peu tristement il conclut « En Chine, quand les grands froids arrivent, dans toutes les rues des villes, on trouve des tas de petits singes égarés sans père ni mère. On sait pas s'ils sont venus là par curiosité ou bien par peur de l'hiver, mais comme tous les gens là-bas croient que même les singes ont une âme, ils donnent tout ce qu'ils ont pour qu'on les ramène dans leur forêt, pour qu'ils trouvent leurs habitudes, leurs amis. C'est pour ça qu'on trouve des trains pleins de petits singes qui remontent vers la jungle ».
Je revois toujours ce film avec plaisir et émotion à cause du jeu des acteurs mais aussi des somptueux dialogues de Michel Audiard.
©Hervé GAUTIER – Juillet 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
TRAFIC – Un film de Jacques TATI
- Le 10/12/2013
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°706 - Décembre 2013.
TRAFIC – Un film de Jacques TATI
Ciné + Classic -Dimanche 8 décembre 2013 – 20h45.
L'histoire est bien simple, la firme parisienne « Altra » veut présenter au salon automobile d'Amsterdam un concept nouveau de camping-car, en fait une 4L astucieusement aménagée pour faire du camping. Pour cela, le prototype va devoir voyager en compagnie d'une « Public Relation » Maria, d'un chauffeur et du dessinateur-concepteur, M.Hulot (Jacques Tati) et ce parcours va être pour le moins mouvementé. Au bout du compte il arrivera effectivement à bon port... mais après la fermeture du salon. Pourtant, miracle, alors que le public a déserté les lieux, des gens se pressent autour du camping-car pour l'acheter de sorte que l'opération qui apparemment était un fiasco sera commercialement rentable.
Hulot est dans ce film fidèle à son personnage décalé. Au début on le voit arriver en retard au bureau rasant les murs pour ne pas se faire remarquer et tout au long du voyage il sera avant tout désireux de rendre service autour de lui et d'apporter son concours aux autres, se mettant à l'occasion dans des situations impossibles desquelles il se tire toujours presque malgré lui. Il est le concepteur de ce projet mais, comme si cela ne le concernait plus et qu'il avait déjà la tête ailleurs, il laisse le soin à Marcel le chauffeur de faire la promotion de ce produit, ce qu'il fait très bien d'ailleurs ! Chez les policiers c'est bien lui qui fait l'article devant des flics suspicieux au début puis carrément conquis à la fin au point qu'ils saluent amicalement le départ du convoi.
Nous sommes en plein dans les « Trente glorieuses » où le chômage n'existe pratiquement pas, où chacun consomme sans se soucier de l’environnement avec le seul souci de profiter de la vie. Le petit groupe d'Altra incarnera ce réel art de vivre en prenant son temps, mangeant et dormant chez l'habitant alors qu'on les attend impatiemment au salon. Cette exposition devient rapidement secondaire et même accessoire.
C'est vrai que cette expédition était mal préparée, une panne d'essence à laquelle succède une avarie d'embrayage pour le camion, pas mal de stress inculqué par Marie qui voit de plus en plus le retard s'accumuler, de l'inconscience dans le passage pour le moins folklorique de la frontière néerlandaise ce qui aggrave les délais, et de malchance lors de cet accident stupide au carrefour qui endommage la 4L ou dans les incontournables embouteillages ! Pendant ce temps, le directeur présent à Amsterdam se désespère en attendant son prototype qui ne vient pas et ce jusqu'à se faire carrément expulser de son stand au profit d'une marque plus connue et sans doute mieux organisée. Quand il arrivera enfin, le convoi trouvera un hall vide, un directeur hors de lui, surtout devant la facture qu'il doit régler. Tout naturellement il s'en prend à Hulot, tout désigné pour être le bouc-émissaire qui comprend à ce moment-là, revenant sur terre, que son emploi est menacé. Effectivement, il est licencié sur le champ et sans aucun ménagement. Il s'en va donc vers d’autres aventures mais en compagnie de Maria qu'il avait vainement tenté de draguer pendant tout le voyage.
Le plus drôle chez Tati, ce n'est pas l'histoire malgré ses rebondissements multiples, mais la somme des gags qu'il faut saisir au vol pour réellement les apprécier. Dans ces films, et dans celui-ci en particulier qui n'est sûrement pas le plus connu dans sa filmographie, ce ne sont pas les dialogues pratiquement inexistants ou réduits à leur lus simple expression mais les situations qui créent le comique. Le spectateur ne doit en effet pas être passif mais au contraire toujours en éveil pour ne rien manquer de cette invitation à sourire qui lui est faite par Tati. En effet, c'est moins le rire que le sourire qui ici lui est proposé notamment parce que les situations dans lesquelles se met M. Hulot et avec le plus grand sérieux du monde sont finalement très burlesques.
Je ne peux pas ne pas observer que Tati, de son vrai nom Jacques Tatischeff [1907-1982], s'il a connu un certain succès avec son premier long métrage « Jour de fête » n'a pas vraiment rencontré le succès de son vivant et c'est là un véritable euphémisme. Si sa filmographie a été bien mince (Six longs métrages seulement) c'est qu'il a eu beaucoup de difficultés à financer ses œuvres (demi-échec de « Playtime » et mise ne liquidation de la St Specta Films) et il a dû faire produire son dernier film « Parade » avec l'aide de la télévision suédoise en 1973. Cette situation n'a pas échappé à Philippe Labro qui rapportant dans Paris-Match la mort de Tati écrivit « Adieu M. Hulot. On le pleure mort, il aurait fallut l'aider vivant ».
Il n'a donc été vraiment reconnu qu'après sa mort, avec d’ailleurs une certaine gêne mais il eût sans doute apprécié de son vivant les couronnes de lauriers qu'on lui tresse aujourd'hui.
©Hervé GAUTIER – Décembre 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
ROMAN DE GARE – Un film de Claude LELOUCH
- Le 20/11/2013
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°380– Novembre 2009
ROMAN DE GARE – Un film de Claude LELOUCH [2007]. Diffusé le 25/11/2009 20H40 sur Cinéma club.
Je ne suis pas vraiment cinéphile, pas non plus amateur des films de Claude Lelouch, mais là, j'ai été bluffé par le scénario qui juxtapose les histoires sans aucun lien apparent entre elles mais qui finissent par tisser une trame policière où le spectateur lui-même se perd, croit se retrouver pour, encore une fois s'égarer, entre fantasmes, fausses-piste, retournements, mises en abymes, certitudes et remises en question...
Cela commence par la comparution aux « quais des Orfèvres » de Judith Ralitzer [Fanny Ardant], séductrice mais aussi auteur à succès, interrogée par un policier sur la mort suspecte de son mari. Le décor est donc planté.
Puis, flash back avec l'annonce à la radio d'une évasion de la prison de la santé d'un dangereux criminel [sa lente descente le long d'un mur de pierre, accroché à des draps noués a quelque chose de merveilleusement désuet]. Puis la caméra s'attarde dans le huis clos d'une voiture sur un couple qui, bien qu'en route pour une demande en mariage, se déchire et finit par se séparer sur une aire d'autoroute. La femme, Huguette[Audrey Dana], plus ou moins coiffeuse et un peu midinette, qui y est abandonnée rencontre par hasard une sorte de magicien, Pierre Laclos/Louis [Dominique Pinon] dont le spectateur craint qu'il ne s'agisse de l'évadé de la prison. On imagine facilement entre eux une idylle et l'issue macabre de celle-ci . Mais rien de tout cela n'arrive. Pourtant, l'individu un peu louche laisse planer un doute sur son véritable métier [Professeur de Lettres dans un lycée de banlieue, secrétaire de Judith Ralitzer, son nègre peut-être?], sa véritable identité, d'autant que l'annonce de l'évasion reste toujours présente. La rencontre, au bord de la route, avec la maréchaussée, relance le suspense, vite dissipé cependant par Huguette.
Celle-ci, plus ou moins en rupture avec ses parents et qui souhaitait leur présenter l'homme qui allait enfin partager sa vie, demande à l'inconnu qui accepte, de jouer ce rôle pour cette famille un peu atypique et quelque peu soupçonneuse. La certitude du spectateur qu'il est bien en présence d'un tueur est renforcée quand ce dernier passe de longues heures solitaires au bord d'un torrent en quête de truites avec la fille d'Huguette qui vit chez ses grands-parents. Mais là non plus rien de ce qu'il avait pu imaginer ne se passe.
Une autre histoire se déroule sous ses yeux, un professeur de Lettres d'un lycée de banlieue a soudain quitté femme et enfants pour disparaître et fatalement le spectateur pense au compagnon temporaire d'Huguette. Florence [Michèle Bernier], l'épouse ainsi délaissée finit par tomber amoureuse du commissaire qui, précisément, au début du film, est en train d'interroger la romancière.
L'énigmatique Pierre Laclos se retrouve sur la yacht de la romancière à Cannes, le spectateur découvre qu'il est, depuis sept ans son secrétaire et surtout le véritable auteur de tous les livres à succès de Judith Ralitzer, qu'il est en train d'écrire à nouveau pour elle un roman qu'il veut pourtant garder pour lui, qu'elle est en train de le mystifier, qu'il s'en rend compte et souhaite mettre fin à cette collaboration avant d'être, lui aussi, victime de la meurtrière romancière. Quand il disparaît, en vue des côtes, et qu'il ne réapparait pas pendant un an, Judith est, en public lors d'une émission de télévision, accusée par Huguette de n'être pas l'auteur de ses livres et par le policier d'être la meurtrière de son secrétaire, comme elle l'est peut-être de son mari.
Tout rentre dans l'ordre et la fin, si l'on peut dire, est à la mesure de ce drame qui tient le spectateur en haleine tout au long du film.
Claude Lelouch a signé ce film d'un pseudonyme [Hervé Picard], laissant croire à l'existence d'un nouveau réalisateur. Cela n'est pas sans rappeler l'aventure littéraire d'Émile Ajard, alias Romain Gary, qui mystifia tout le monde au point d'obtenir, par cet artifice, une deuxième fois le prestigieux Prix Goncourt]. J'aime bien qu'on brouille ainsi les cartes pour remettre les choses à leur vraie place, qu'on les bouscule et qu'on s'affirme, surtout quand le talent est au rendez-vous.
J'avais modérément aimé sa filmographie, je suis, par cette œuvre qui n'a rien d'un banal roman de gare, réconcilié avec lui.
©Hervé GAUTIER – Novembre 2009.http://hervegautier.e-monsite.com
-
BLOOD TIES – Un film de Guillaume Canet.
- Le 05/11/2013
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°692– Novembre 2013.
BLOOD TIES – Un film de Guillaume Canet.
Nous sommes à New-York en 1974 . Chris, la cinquantaine sort d'une longue peine de prison pour un meurtre. Son frère, Franck, plus jeune, vient le chercher mais ne se sent pas très à l'aise, évidement lui est policier et son frère est un assassin. Il y a autre chose : les deux frères ne se connaissent pratiquement pas, ont eu des vies parallèles et même rivales et ce depuis l'enfance ; Le père, Léon qui avait une préférence pour Chris malgré la prison qu’il a connue très tôt, a fait ce qu'il a pu pour élever ses trois enfants mais le départ de leur mère a déséquilibré cette famille qui aurait pu être heureuse.
Quand Chris sort de prison, il reprend contact avec sa famille, avec Franck évidemment mais aussi avec son père malade et avec sa sœur qui voudrait bien reconstituer cette famille déchirée. Il reproche à son frère de ne pas être venu le voir pendant toutes ces années d'incarcération et lui ne peut que lui opposer son métier de policier, ce qui est évidemment une mauvaise raison. Les deux frères auraient dû être complices au cours de leur adolescence mais un minable cambriolage qui s'est terminé par l'arrestation de Chris les a définitivement séparés, Franck l'ayant trahi au dernier moment. C'est pour Chris le départ d'un long parcours dans la délinquance. Il ne cessera de fréquenter les tribunaux.
Pourtant, à sa sortie de prison, Franck héberge son frère, l'aide à renouer les relations avec ses enfants et son ex-femme, Monica, lui trouve un travail pour justifier sa réinsertion, mais c'est un emploi précaire, mal payé, peu valorisant. Et puis on se méfie de cet ancien taulard qui perd patience et joue même de malchance dans sa volonté de se réadapter. Chris fait preuve apparemment de bonne volonté, rencontre Nathalie avec qui une nouvelle vie rangée devient possible. Pourtant, ses anciens amis le contactent et, bien entendu, il replonge. Ce sera le départ d'une série de braquages qui feront de lui un homme riche mais toujours un marginal. Pire peut-être, il monte une affaire de prostitution dans laquelle Monica se retrouve promue mère-maquerelle et trafiquante de drogue. Elle sera dénoncée et la police remontera jusqu'à Chris.
De son côté Franck qui est pourtant un bon flic, doit affronter ses collègues et sa hiérarchie : On le soupçonne de jouer un double jeu surtout quand il croit reconnaître Chris qu'il blesse dans un casse qui tourne mal. Il rompt définitivement les liens avec son frère et préfère quitter la police. Ni la mort de leur père, ni les fêtes de famille sous l'égide de leur sœur ne parviennent à ressouder ce « lien du sang » définitivement rompu entre les deux frères. C'est vrai qu'ils sont bien différents. Chris a pour les femmes l'aura du mauvais garçon et n'a aucun mal à conquérir Nathalie. Franck, lui, n'a rien d'un Don Juan, a toujours été un garçon timide, réservé mais aussi un peu gauche avec les femmes. Il aggrave même son cas en renouant avec Vanessa, une ancienne amie mais qui est azussi la compagne d'Anthony Scarfo, un malfrat violent que Franck a jadis arrêté et fait jeter en prison. Quand ce dernier sort, il harcèle le policier et sa compagne et menace de tuer Franck.
Le « lien du sang » sera renoué à la fin, mais avec celui de Scarfo que Chris, malgré le fait que la police le recherche n'hésite pas, dans la gare de « Grand Central », à tuer Scarfo pour protéger son frère et ainsi lui sauver la vie. En agissant ainsi, il sacrifie son propre avenir. Bien entendu il retournera en prison pour longtemps alors qu'on peut imaginer que Franck, réhabilité par le geste de son frère, pourra réintégrer la police et être heureux avec Vanessa.
Même s'il s'agit d'un remake du film de Jacques Maillot « Les liens du sang » de 2008, le thème du film jouant sur l'opposition au sein d'une même famille entre un flic et un voyou me semble pertinente. D'autre part la distribution est somptueuse et le jeu des acteurs convainquant.
© Hervé GAUTIER - Novembre 2013 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
Amour – Un film de Michael Haneke
- Le 27/10/2012
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°597– Octobre 2012.
Amour – Un film de Michael Haneke- Palme d'Or à Cannes 2012.
Ce film dont il faut évoquer brièvement l'intrigue tourne auteur de deux personnages. C'est une histoire simple, presque banale de fin de vie, celle d'Anne ( Emmanuelle Rivas) et de Georges (Jean-Louis Trintignant), deux octogénaires qui mènent une vie tranquille de retraités. On les voit au début assister à un concert d'un des élèves d'Anne, ancienne professeur de musique classique. La musique justement, celle de Schubert, de Beethoven, de Bach, les tableaux accrochés aux murs et les livres qui tapissent les bibliothèques, tout indique que nous sommes ici chez des gens aisés et cultivés. Puis soudain, Anne a une attaque qui la laisse paralysée du côté droit. Courageusement elle s'adapte à sa nouvelle situation comme on fait face à l'adversité. La vie s'organise autour de son infirmité nouvelle et Georges l'accompagne patiemment, s'improvise infirmier, accompagnateur de vie, homme au foyer de cette femme qui peu à peu va perdre toutes ses facultés pour ne plus mener qu'une vie végétative et aphasique et entrer de plain-pied dans l'agonie. Il le fait avec courage, abnégation et même héroïsme au point de se charger seul, contre les médecins, les soignants et l'inévitable bon sens qui commanderait qu'il se déchargeât un peu du poids de plus en plus lourd qu'elle représente. Pour cela, il n'a que son impuissance grandissante face à cette situation qui se complique de jour en jour et même si elle fait l'admiration des gens autour de lui et l'inquiétude légitime mais à ses yeux inutile de sa fille Eva (Isabelle Huppert), il veut continuer à cacher aux autres cette réalité et peut-être se la cacher à lui-même.
Le couple attend la mort et Georges fait preuve de résignation [« ça va aller de mal en pis et puis ce sera fini »] , mais pas de désespérance, elle ne viendra qu'à la fin parce qu'il n'y a pas autre chose à faire, entre photos jaunies et souvenirs qui peu à peu s'effacent, un huis-clos qui se déroule dans une sorte d'unité de lieu de leur appartement qui jadis était plein de vie mais qui peu à peu se vide.
Il n'y a pas de voyeurisme dans ces scènes quotidiennes, tout juste un compte rendu exact de ce qu'est le rôle que Georges a choisi depuis le début et qui va petit à petit le dépasser, un compte à rebours aussi ! A mesure que les facultés d'Anne disparaissent, qu'elle entre progressivement dans la mort, on le voit lui, si plein de bonne volonté au départ, perdre pied au point de la gifler parce qu'elle refuse de s'alimenter, battre en retraite pour ne plus dormir que dans un petite chambre loin d'elle au point que, sa propre déchéance à lui va être suscitée pour le spectateur par la résurrection symbolique de son épouse et qu'il va prendre une dimension quasi spectrale. On voit leurs rides, leurs corps affaiblis, leurs cheveux, blancs et ternes pour elle qu'un reste de coquetterie veut masquer, épars et hirsutes pour lui qui marquent, comme la barbe qu'il néglige de raser chaque jour, le désintérêt qu'il porte à sa propre personne pour ne plus se consacrer qu'à Anne. Il respecte la parole donnée de ne pas ne pas l’envoyer à l'hôpital puis, plus tard, dans l'inévitable maison de retraite qui serait pour elle comme un mouroir puisqu'elle serait séparée de Georges.
Le jeu des acteurs et bouleversant de vérité et ce film nous rappelle une évidence, celle que nous sommes tous mortels, que tout à une fin et que la vieillesse est une déchéance. Le cinéma d'ordinaire se fait plus volontiers l'écho de la beauté, de la jeunesse, de la réussite, de la sensualité... La palette d'Haneke est grande et talentueuse. On sent qu'il ne craint pas de déranger, de bouleverser les codes et les idées reçues et, pour cela d'être, peut-être, désagréable au spectateur qui attend volontiers un « happy end ». J'aime personnellement qu'on ne cache rien, qu'on ne donne pas une image idyllique de cette société qui ne le mérite pas et qu'on en montre les travers et les failles. Dans ce film intimiste et plein de sensibilité, c'est la mort qui nous est montrée parce qu'elle est non seulement la fin de la vie et que, même si elle a été taboue pendant toute notre existence, si on a vécu sans y penser comme il convient dans nos sociétés occidentales, elle guette chacun d'entre nous et nous surprend au moment où nous y pensons le moins. Qu'on le veuille ou non, la condition humaine est ainsi faite et les règles de notre société paraissent immuables. Quelles que soient les fonctions qu'on y ait exercé, quand la retraite sonne on n'est plus rien et quand la mort nous frappe on est oublié définitivement.
Je retiens aussi de ce film une écriture cinématographique originale portée par des acteurs d'exception. Elle est à la fois intense, juste et économe en mots, comporte des plans parfois longs et silencieux, une bande sonore faite ici opportunément de musique classique, des scènes plus suscitées qu'effectivement montrées, des bruits apparemment anodins, tel celui du robinet qui coule constamment et qui brusquement s'arrête, suggérant un rebondissement.
L’amour existe certes, mais il y a quand même quelque chose d'irréel dans cette œuvre. Cet homme et cette femme s'aiment d'un amour authentique et fidèle que traduisent des regard et les gestes tendres du début. Ils se sont choisis pour partager les joies et maintenant ils connaissent les peines mais leur complicité est complète. Ils aimaient la vie ensemble parce qu'elle ne pouvait être que commune et elle a été longue [« C'est beau la vie , si longtemps »]. Je crains que cela ne reflètent cependant pas la réalité quand un mariage sur deux se termine actuellement par un divorce et que cela affecte, et c'est nouveau, les seniors. Même si les couples qui restent ensemble le font pour des questions de morale, de religion, de convenances ou de finances, ce choix cache bien souvent une vie où l'hypocrisie le dispute à l'indifférence ou pire encore. Ils se terminent parfois par une séparation que le concept moderne de « famille recomposée » peine à masquer. Quand Eva, à la vie sentimentale agitée, donne de ses nouvelles à ses parents, on a du mal à imaginer que lorsqu'elle sera vieille à son tour, elle connaîtra pareille complicité avec son mari. Mais c'est sans doute un autre débat ? Quand elle apparaît pour s'émouvoir de la maladie évolutive d'Anne, il est difficile de voir dans ses larmes autre chose qu'une posture de circonstance. Elle disparaîtra bientôt pour laisser la place à Georges qui ira au bout de sa démarche, seul, comme il le souhaite.
Ce film qui est un jalon supplémentaire dans la démarche d'Haneke est le onzième long métrage et le deuxième couronné par une prestigieuse palme d'or à Cannes. Il est bouleversant à bien des titres. Il est en tout cas une invite à la prise de conscience, un rappel des réalités de cette vie, il lève un tabou dont on se demande bien pourquoi il est, dans notre société, si savamment entretenu.
©Hervé GAUTIER – Octobre 2012.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LES INVITES DE MON PERE – un film d’Anne le Ny
- Le 09/10/2012
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°594– Septembre 2012.
LES INVITES DE MON PERE – un film d’Anne le Ny [2009].
France 2. Dimanche 7 octobre 2012 – 20H45.
C'est plus fort que moi, je ne suis pas un cinéphile averti, tant s'en faut, mais j'aime que le cinéma soit le reflet de la réalité qui nous entoure et dont nous faisons partie. Un des thèmes qui est ici évoqué, celui des sans-papiers, est de plus en plus une composante de notre paysage social et mérite bien qu'on s'y attache.
Lucien Paumelle [Michel Aumont] est un médecin à la retraite,80 ans, veuf, ancien résistant et engagé dans l'action humanitaire où son nom est une référence. Il passe sa vieillesse active à défendre ceux que la société a exclus ou qu'elle rejette parce qu'ils sont étrangers et ce malgré le code pénal. C'est effectivement un thème bien actuel et traité par ailleurs au cinéma, valorisant pour un citoyen français et bien digne du message humaniste et généreux de notre pays. Rien à dire donc ou plutôt on ne peut qu'être admiratifs devant l'engagement de cet homme que la retraite n'a pas diminué.
Il a deux enfants maintenant mariés ou en couple, la quarantaine plus ou moins avancée. Arnaud [Fabrice Luchini], son fils, cynique, avocat d'affaires qui a toutes les marques de la réussite sociale, cabinet florissant, grosse berline, appartement de standing, riche train de vie... Il a épousé une femme qui n'a pas fait d'études comme lui. Ce n'est pas tout à fait l'image du père qu'il nous renvoie. Ensemble, ils ont deux enfants un peu conventionnels. Babette [Karine Viard], la fille de Lucien, est un obscur médecin généraliste dans ce qu'on suppose être un dispensaire de quartier. Elle aussi est digne de son père non seulement parce qu'elle est médecin au service des autres, qu'elle a toujours vécu dans son ombre, mais aussi parce que, comme son frère, elle n'est pas installée et ne voue pas à l'argent un culte effréné.
Tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes si Lucien, sous couvert d'aider Tatiana, une jeune et jolie Moldave, réfugiée en France avec sa fille et désireuse de s'y établir avec des papiers en règle, ne s'était mis en tête de l'épouser malgré une différence d'âge digne du théâtre de Molière, le comique en moins, en réalisant un « mariage blanc ». Après tout, pourrait-on penser, c'est plutôt, pour cet homme, le couronnement de toute une vie d'engagement humanitaire. Que nenni, tout cela c'est de la frime, Lucien est vraiment amoureux de Tatiana et ce mariage a plutôt la couleur du viagra et met la vie de Lucien en danger ! Il se retrouve d’ailleurs à l'hôpital et on finit par se dire que c'est pour lui le dernier acte. Il est réellement amoureux de cette femme, non seulement lui trouve du travail pour aider à la régularisation de sa situation mais invite ses propres enfants à renoncer à leur futur héritage... pour en faire profiter Tatiana !
Le spectateur reste sans voix devant le personnage de cette étrangère qu' Arnaud qualifie de « pute » et qui poursuit inexorablement son but sans qu'on sache si elle œuvre pour sa fille ou pour elle-même. On la voit déterminée et sans gêne devant les enfants de Lucien, détachée de lui, raciste [déjà], désireuse que sa fille fréquente la meilleure école où il n'y a pas de noirs ni d'arabes ! On imagine aussi qu'elle a bien pu vouloir avancer l'échéance du décès de Lucien pour disposer plus vite de ses biens en se trompant dans ses médicaments.
Ce fait est pour autant déterminant et fonctionne comme un déclencheur. Arnaud et Babette qui jusque là semblaient assister, quelque peu indifférents, voire complices, aux extravagances de leur père prennent soudain conscience qu'il peut mourir par la main de cette jeune intrigante. C'est pourtant l'épouse d'Arnaud qui réagit au nom de la parentèle en dénonçant ces manœuvres à la Préfecture et fait ainsi échouer les projets de Lucien. Certes, cette manœuvre a, aux yeux de Babette et d'Arnaud, des relents de pétainisme mais, après cette dénonciation, ils y souscrivent cependant. Tatiana repartira dans son pays avec sa fille. Fin de l'épisode ! Pourtant, devant le résultat de cette action et malgré la satisfaction qu'ils ont de voir leur père revenir à une vie plus normale, ils se laissent aller à une sorte de culpabilisation pour avoir contrecarré ses projets matrimoniaux.
Pour autant, ce thème ne me semble pas être le seul traité par ce film. C'est que cet événement a des répercussions au sein de la famille apparemment unie, avec, en filigranes, le fantôme de la mère. Arnaud se rappelle qu'étudiant, son père lui a coupé les vivres, sans doute parce qu'il refusait de faire ce qu'il lui demandait et que Babette, qui a toujours joué le rôle de la fille effacée et comme il faut, non seulement n'a pas défendu son frère mais encore s'est réjoui de cette situation et en a même profité. On imagine même que les liens entre le frère et la sœur ne sont pas aussi forts qu'il y paraît. Voila aussi que l'intermède amoureux de Lucien provoque celui de Babette qui, après avoir supporté pendant des années son compagnon s'envoie ne l'air avec un collègue de travail, apparemment plus jeune qu'elle et avec qui, finalement, elle choisit de vivre. C’est bien son tour de se lâcher un peu, d'autant qu'elle connaît enfin l'orgasme !
Les choses semblent rentrer dans l'ordre à l'occasion d'un week-end, quelques mois plus tard. Arnaud rejoint son père désormais assagi aux côtés d'une retraitée bretonne et végétarienne. L'image qu'il donne correspond davantage à celle d'un retraité paisible qu'à l'épisode précédent de son mariage manqué et peut-être maintenant oublié, même s'il s'ennuie en regardant la mer à cause du thé vert au gingembre et du pain au varech !Pire, il s'emmerde et on l'imagine déjà un pied dans la tombe après avoir tourné définitivement la page de sa vie antérieure !
Je ne suis pas sûr d'avoir assisté à une comédie puisque c'est la catégorie dans laquelle ce film est classé par la critique. Certes on peut rire de tout et les répliques sont parfois drôles [« C'est un acte militant... mais il y a des actes militants qui sont plus agréables à regarder que d'autres », « non seulement il m'a pourri mon enfance mais il me vole ma crise de la cinquantaine », « En fait la blonde trop jeune c'est à ton âge qu'on se fait ce trip, pas au sien »] mais les nombreux thèmes traités ici ne s'y prêtent guère, celui de la vieillesse et de la solitude, de la remise ne question des choses établies et de l’image que donnent les gens, de l'utopisme de gauche, de l’adolescence contestataire et généreuse, de la famille qui éclate, de la mort qu'on perçoit au loin... Seul le jeu des acteurs qui se résume à un trio (Karine Viard, Michel Aumont, Fabrice Luchini) peut prêter à sourire tant il est juste et parfois humoristique. Je ne suis pas bien sûr pour autant que le happy-end qui clôt ce film soit toujours au rendez-vous dans la vraie vie !
Après « Ceux qui restent » Anne de Ny nous offre ci une nouvelle peinture de la société. J'ai bien aimé.
©Hervé GAUTIER – Octobre 2012.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE PRIX A PAYER – un film d'Alexandra Leclère
- Le 26/09/2012
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°593– Septembre 2012.
LE PRIX A PAYER – un film d'Alexandra Leclère [2007].
TF1 Dimanche 23 septembre 2012 – 20H50.
Je poursuis l'intérêt que je porte à l’œuvre cinématographique d'Alexandra Leclère. La Feuille Volante en a déjà été le témoin à propos des « Sœurs fâchées » (FV n° 554 de février 2012) et de « Maman » (FV n°577 de mai 2012) et j'avoue bien sincèrement que je suis très attentif à ce mode d'expression intimiste du cinéma.
Ici, Alexandra Leclère s'attaque aux problèmes de couple. C'est sans doute peu original mais cela fait parti de la vie et mérite bien qu'on y prête un peu d'attention. Jean-Pierre Ménard [Christian Clavier], homme d'affaires riche et ayant réussi, est marié à une femme, jolie mais dépensière, Odile, [Natahlie Bayle] mais il est malheureux en ménage : c'est qu'elle a décidé depuis quelques temps de faire chambre à part et donc de se refuser à lui. Sur le conseil de Richard, son chauffeur macho et frustré [Gérard Lanvin] à qui il avoue son infortune, il lui supprime sa carte de crédit et son chéquier afin de la ramener vers lui. Il lui exprime les termes d'un marché qui a l'avantage de l'économie de mots et de la simplicité « Pas de cul, pas de fric » ! Avec une telle formule, le terme « devoir conjugal » prend tout son sens. De son côté, Richard vit avec Caroline[Géraldine Pailhas] qui poursuit un rêve inaccessible auquel il est étranger. Voici pour le décor.
J'ai trouvé ce film un tantinet caricatural où d'un côté les femmes sont présentées comme des êtres libres qui s'adaptent à l'évolution de leur situation mais sont quand même dépendantes de l'argent de leur compagnon considéré comme un pourvoyeur d'euros, et de l'autre les hommes, pour qui l'argent qu'ils gagnent paie tout mais qui se sentent désemparés quand elles disparaissent. J'avoue que, malgré tout, j'ai du mal à entrer dans ce schéma un peu trop simpliste où les femmes sont maîtresses d'un jeu où l'argent est roi et achète les consciences et les postures,. Elles semblent assumer leur existence à travers lui, qu'elles se le procure à travers le travail ou les épisodes vaudevillesques. C'est plus fort que moi, je ne peux pas ne pas donner à la dernière réplique du film qu'Odile adresse à Jean-Pierre [« Tu comptes beaucoup pour moi »] une signification... comptable !
J'ai trouvé le jeu des acteurs tout à fait dans le ton du film et conforme à son côté grand-guignol. A mon avis, la distribution sauve même le scénario. Cela aurait pu être drôle surtout lorsque Caroline avoue que dans sa vie l'écriture tient un grande place et correspond à ses aspirations profondes et que Jean-Pierre lui rétorque que sa femme aussi a des dispositions dans ce domaine, mais uniquement pour rédiger les chèques ! Pourtant, et malgré les apparences, je ne suis pas bien sûr d'avoir assisté à une « comédie », puisque j'y ai vu une illustration supplémentaire de la difficile cohabitation entre hommes et femmes et des épreuves qui émaillent inévitablement une vie de couple. On peut certes rire de tout mais ce genre d'épreuves laissent quand même des traces. Même l'épisode de la passade ratée avec un inconnu (Patrick Chesnais) ne me semble pas crédible. Je ne suis pas sûr non plus qu'Odile, à ce point dégoûtée de son mari, puisse répondre simplement à un admirateur enamouré qui lui déclare qu'elle est « très belle », qu'elle est seulement... « très mariée » et qu'elle choisisse de revenir dans le giron familial ! Compte tenu de l'ambiance délétère qui règne au sein de ce couple, la fidélité de Jean-Pierre qui est ainsi artificiellement maintenue, ne me semble pas de mise. On imagine facilement qu'au lieu de se livrer à ce petit larcin misérable, il puisse préférer des amours de contrebande... D'autre part je conçois mal qu'une jolie femme en pleine possession de sa féminité, fasse l'impasse sur une vie sexuelle que son charme et sa beauté incitent naturellement à la séduction. Qu'elle se refuse à son mari pour des raisons obscures ou futiles, passe encore, qu'au moins elle satisfasse un ou plusieurs amants, l'abstinence qui est ici suscitée me semble quelque peu irréaliste !
Jusque là je dois dire que j'avais apprécié le regard qu'Alexandra Leclère portait sur la société dont le cinéma peut être le miroir. Le thème choisi avait l'avantage de concerner le plus grand nombre d'entre nous qui n'ignorons pas que les relations entre les hommes et les femmes sont complexes, faites beaucoup plus de tensions, de haine et d'hypocrisie que d'amour et d'attachement. Ce qui est valable au début du mariage laisse rapidement la place à une atmosphère pesante où la passion se délite rapidement. Tous ceux qui ont contracté mariage l'ont fait par amour, pour faire comme tout le monde, par intérêt, par convenance, pour changer de vie ... mais on oublie un peu vite que, comme le spirituel, cela suppose une vocation. Après tout, on n'a pas trouvé mieux, depuis que le monde existe pour perpétuer la race et organiser les rapports entre les êtres. La morale, la philosophie, la religion, le droit ont tenté d'y mettre leur patte pour que cela ait des apparences correctes, présentables voire attirantes. Oui, mais, si on part du principe que l'amour existe, il rime rarement avec « toujours » et rapidement les choses prennent un autre visage moins avouable, fait de duplicités, de trahisons, d'infidélités... Le contrat de départ ne manque pas d'être écorné et presque naturellement c'est le divorce qui intervient, avec son lot de désillusions, de remords, de remises en question parfois impossible à surmonter, de vies brisées... On peut aussi admettre que les époux fassent perdurer artificiellement ce lien tout en vivant leur vie chacun de leur côté, en faisant prévaloir leur intérêt. Certes l'argent est roi et gouverne le monde, nous le savions déjà, mais de là à en faire l'enjeu de l'épanouissement sexuel d'un des conjoints, je trouve cela un peu fort. Ce problème de testostérone et de machisme me paraît un peu surfait. Je ne suis peut-être que très peu averti des choses de ce monde ou l'auteur a peut-être voulu être originale, mais il me semble que l'issue d'une telle situation intimement nuisible peut facilement être différente et déboucher sur une autre situation que celle proposée par le film. Cela aussi fait partie de cette règle du jeu et il n'est quand même pas rare que, dans le mariage, il y ait ce genre d'accident...
J'ai donc été un peu déçu par ce film mais j'y ai retrouvé des thèmes traités dans « les sœurs fâchées »... et j'attends le suivant.
©Hervé GAUTIER – Septembre 2012.http://hervegautier.e-monsite.com
-
Le couperet - Un film de Costa Gavras
- Le 19/05/2012
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°578– Mai 2012.
LE COUPERET – Un film de Costa Gavras.[2004]
Ciné+club - Vendredi 18 mai 2012 – 21h.
Le cinéma comme la littérature ne sont vraiment dans leur rôle que lorsqu'ils sont le reflet de notre société.
Dans ce film, adapté d'un roman éponyme de l'américain Donald Westlake, Costa Gavras choisit de traiter un sujet qui gangrène nos sociétés occidentales : le chômage. Pour cela il met en scène un cadre supérieur, Bruno Davert (José Garcia), hyper diplômé et particulièrement compétent dans l'industrie du papier. A la suite d'une restructuration, d'une compression de personnel, la société qui l'emploie et qui n'a rien à lui reprocher se délocalise à l'étranger au nom du profit et de la pression des actionnaires... pour gagner encore plus d'argent. Cela n'a rien d'un cas d'école et peut malheureusement se vérifier chaque jour quand les plans sociaux et les fermetures d'usine sont le quotidien d'un monde du travail en pleine mutation.
Après deux ans de veine recherches, entre entretient d'embauches qui tournent mal et déception chronique, Davert devenu amer et agressif, conçoit un plan machiavélique. A la suite d'un stratagème, il se fait communiquer les CV de cadres qui, comme lui, sont à la recherche d'emploi dans sa branche et qui, de ce fait, sont des concurrents potentiels et donc des obstacles pour lui. Il en sélectionne cinq qu'il estime être de son niveau et une société, « Arcadia » qui peut fournir l'emploi souhaité. L'un d'eux y est d'ailleurs employé. A ses yeux, le seul moyen d'y obtenir du travail est... de les tuer! Il va donc ressortir le vieux Luger de la guerre 39-45 que lui a légué son père pour mettre en œuvre son sombre projet. Il y a urgence et, malgré le cadre agréable de sa maison, et son confort qui correspondent bien à un cadre supérieur, tout autour de lui se délite. Son épouse (Karine Viard) qui fait vivre la famille grâce à de petits boulots, le trompe et son fils est convaincu de vol ce qui attire la police à son domicile. Seule sa fille semble être un pilier solide au milieu de toute cette débandade. C'est elle qui redonne à la fin à Bruno son véritable rôle de père-héros au sein de sa propre famille.
La quête criminelle de Bruno l'amène à côtoyer les cadres supérieurs qu'il a sélectionnés et qui se sont reconvertis pour un temps, qui dans un restaurant minable, qui dans le prêt à porter et qui lui confient leurs états d'âme et leur désarroi face à la crise. Cela ne l'empêche pas de les éliminer les uns après les autres tant sa détermination est grande ou d'assister, par enquête policière interposée, à leur suicide. C'est que notre homme, quoique déterminé, reste quand même un amateur en matière de crime. Il laisse derrière lui des traces qui font que la police se présente chez lui, non pour l'arrêter, mais pour l'avertir qu'une série de meurtre a été commise... contre des cadres de la papeterie au chômage ! Pendant tout le film, l'omniprésence des policiers entretiendra un suspense équivoque et sera comme une épée de Damoclès sur la tête de Bruno. C'est finalement l'inspecteur en charge de l'enquête qui viendra lui annoncer... qu'il n'a plus rien à craindre ... de ce serial killer !
Au bout du compte, Bruno assiste, un peu par hasard à la mort accidentelle du responsable de la société qu'il souhaite intégrer. Il faut dire qu'il est, si l'on peut dire, un peu chanceux dans son entreprise morbide et que tout semble, en apparence, s'arranger pour lui, mais en apparence seulement. La dernière image du film nous le présente comme un cadre bien installé dans sa nouvelle entreprise et même bien dans sa peau mais qui va, à son tour, devenir la proie de ceux qui, comme lui auparavant, sont à la recherche d'un emploi et qui n'hésiteront pas à mettre en œuvre ses propres méthodes pour prendre sa place.
C'est l'occasion pour Costa Gavras d'exprimer une idée bien simple. Dans d'autres sociétés humaines, on élimine, au nom de l'élan vital, les éléments surnuméraires, enfants et vieillards, dès lors qu'ils sont une charge insupportable pour la collectivité, pour ne garder que ceux qui sont rentables. Dans nos sociétés occidentales, c'est le contraire et on se débarrasse, au nom du profit, des meilleurs qu'on pousse vers la sortie, la pauvreté, le suicide...
José Garcia est ici à contre-emploi mais campe admirablement le personnage machiavélique et déterminé constamment noyé dans l’ambiguïté de l'action, emprunt d'un humour froid mais qui ne parvient cependant pas à être antipathique.
Après avoir traité avec brio des problèmes politiques (Z, l'aveu) Costa Gavras choisit ici un sujet de société malheureusement bien actuel. Il le fait, certes, sous l'angle bien particulier du thriller, mais en donnant à cette fable, adapté d'un roman noir américain, une dimension humaine dans ce qu'elle a de plus déstructurant pour un individu mais en sauvegardant à la fois la valeur de la famille et du travail.
-
MAMAN – Un film d'Alexandra Leclère.
- Le 14/05/2012
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°577– Mai 2012.
MAMAN – Un film d'Alexandra Leclère.
Alexandra Leclère s'attaque encore une fois au drame de la famille. Déjà, avec « les sœurs fâchées » (La Feuille Volante n° 554) elle avait mis en scène deux femmes que tout opposait. Ici, ce sont également deux sœurs, Sandrine ( Mathilde Seigner) et Alice (Marina Foïs), la quarantaine, parisiennes, mais bien différentes l'une de l'autre qui voient, tout d'un coup, leur mère, Pauline, divorcée (Josiane Balasko) dont elles n'avaient pas de nouvelles depuis vingt ans, débarquer dans la capitale parce qu'elle a été abandonnée par l'homme avec qui elle vivait. Cette mère acariâtre, excessive et égoïste compte sur ses filles pour la seconder et l'aider dans sa nouvelle vie et peut-être aussi lui faire oublier son échec sentimental. C'est surtout l'occasion pour elles de régler avec leur mère un vieux compte. Elle ne les a jamais aimées, elle n'a jamais su être maternelle bref elle n'a été pour ses filles qu'une véritable étrangère. Elles vont donc la kidnapper le temps d'un week-end dans un manoir breton pour lui faire prendre conscience de ses carences affectives et l'obliger enfin à les aimer.
Au début c'est Sandrine qui ouvre le bal et s'oppose ouvertement à sa mère alors que sa sœur paraît vouloir rechercher un compromis. Alice, plus docile, semble même être à la traîne de sa sœur, mais, tout d'un coup, elle prend conscience que l'occasion est trop belle et sort de ses gonds. C'est à cause de cette mère indigne que ses filles ont manqué d'amour, que Alice passe son temps à refuser la maternité en se faisant avortée et que Sandrine a une vie sentimentale décousue. Des claques volent en même temps que des mots durs mais aussi des menaces de mort... Alice et Sandrine veulent faire payer à Pauline tout ce temps perdu, toutes ces occasions manquées. Chacun finit par s'expliquer et il n'y a rien de manichéen dans cette situation. Il y a une opposition entre le calme de la mer et la violence des scènes de ce film préfigurant peut-être la réconciliation du dénouement qui se conclue par une sorte de « happy end », si on veut le voir comme cela, dans le fait que Sandrine qui était la plus remontée contre sa mère, à tel point qu'elle ne pouvait même pas l'appeler « maman », lui donne enfin ce titre.
Il y a sans doute de l'autobiographie dans ce film, mais nous sommes nombreux sans doute à avoir souffert de l'abandon ou de l'indifférence de nos parents. L'amour maternel est une sorte de fantasme que nombre d'écrivains et de poètes ont célébré et qui a été, en quelque sorte, sanctifiée par une fête annuelle, même si celle-ci nous vient des temps contestés du pétainisme. A mes yeux, c'est plutôt bien d'avoir montré que toutes les femmes ne sont pas maternelles, et pourquoi le seraient-elles d’ailleurs ? Nous avons tous vécu avec cette sorte d'image d’Épinal où la femme devenue mère se sacrifiait pour ses enfants. Il suffit de promener son regard sur notre société, d'écouter parler les gens, de recueillir leur témoignage pour se persuader que toutes les grandes idées qu'on peut avoir sur la famille en général et sur les mères en particulier se révèlent souvent être des idées fausses mais qu'on transforme rapidement en tabou pour éviter de les évoquer. Après tout, toutes les petites filles n'ont pas joué à la poupée au sortir du berceau et si, mariées, elles ont donné la vie, ce n'était pas forcément par désir mais on peut imaginer qu'elles l'ont fait par hasard, par erreur, par accident ou pour satisfaire à un besoin de descendance de leur famille. L'amour n'est pas forcément au rendez-vous et elles ne sont pas, dans ces conditions, tenues d'aimer leurs rejetons. Tant pis pour eux, il faudra qu'ils s'y fassent, qu'ils vivent avec ce manque toute leur vie et qu'ils parviennent, peut-être à le surmonter !
Ce film, même s'il comporte des longueurs inévitables compte tenu du thème traité n'est pas une fable, pas une fiction, bien au contraire, c'est un drame, une histoire banale mais douloureuse qui malheureusement se reproduit trop souvent et génère injustices et traumatismes pour les enfants qui sont, bien souvent, les seuls à payer.
-
Le Président - Un film d'Henri Verneuil
- Le 07/05/2012
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°576– Mai 2012.
LE PRESIDENT – Un film d'Henri Verneuil (1961).
(Arte – Dimanche 6 mai 2012 – 20h40).
La politique est une chose passionnante mais ceux qui la font, c'est à dire ceux qui en font leur métier, le sont, à mes yeux, beaucoup moins. Ainsi donc, au soir du 6 mai 2012, une fois les résultats de l'élection présidentielle connus, ai-je eu plaisir à regarder une nouvelle fois le fameux film d'Henri Verneuil « Le Président ». Cela tombait plutôt bien et collait à l'actualité. Je délaissai donc les cris de victoire et d'espoir des vainqueurs, et les déclarations de dépit des autres, abandonnant la situation et ses évolutions probables aux commentaires des journalistes, aux déclarations des hommes politiques des deux bords, aux appréciations des instituts de sondage; tout cela reviendrait bien assez tôt, dès le lendemain dans les médias, sous forme de florilèges ou de chroniques. Et puis j'aime bien le cinéma. Surtout que ce film, même s'il n'est pas de la première jeunesse, même s'il est en noir et blanc, a le mérite d'être le reflet de la condition d'hommes politiques, même si le constat date un peu et s'inscrit dans une hypothétique IV° République qui s'est caractérisée par des crises ministérielles à répétition et a fini par en crever.
Et puis, quand un film met en scène Jean Gabin, c'est plus fort que moi, il faut que je le regarde et que je le savoure tant cet acteur avait de talent. Il campait avec le même bonheur un prolétaire ou un aristocrate, un flic intègre ou un voyou de la pire espèce. Nous manquons actuellement terriblement de ces « Monstres sacrés » que chacun à plaisir à retrouver sur la pellicule bien des années après leur disparition. Et puis ce film brille aussi par les dialogues et aphorismes du regretté Michel Audiard qui savait si bien manier les mots. (« Dans un voyou il y a toujours un Préfet de Police qui sommeille » « Je suis un mélange de conservateur et d’anarchiste, dans des proportions qui restent à déterminer »)
L'histoire où, bien entendu « toute ressemblance avec des personnes existants ou ayant existé ne serait que pure coïncidence » s'ouvre sur la visite d'un homme politique anglais de premier plan qui vient à Paris pour une conférence internationale et fait à son vieil ami, le Président Émile Beaufort (Jean Gabin), qui passe dans sa propriété familiale une retraite paisible, une visite de courtoisie. Paisible, pas tout à fait puisque, compte tenu de son grand âge, il y a à sa porte une meute de journalistes qui attendent la nouvelle de sa mort et que la venue du médecin ou du curé remplissent d'espoir. Au moins ils auront quelque chose à imprimer dans leur journal. C'est que l'homme n'est pas le premier venu. Il a été, dans le cadre d'une hypothétique IV° République, un Président du Conseil qui, à l'époque, éclipsait même le locataire de l'Elysée. Il incarnait, fictivement bien sûr, cette génération d'hommes qui étaient entrés en politique comme on entre en religion, c'est à dire qu'ils s'étaient investis si personnellement dans leurs fonctions qu'ils s'étaient oubliés eux-même. Quand on lui demande le détail de sa vie sentimentale Beaufort répond qu'il est veuf après dix années d'un mariage heureux, qu'il n'a jamais qu'une maîtresse, la France, et pour le reste, il a fréquenté les maisons closes et les théâtres subventionnés (merci Michel Audiard). Nous avons effectivement eu dans l'histoire de nos républiques des hommes qui se sont effacés devant leur fonction au point de ne pas pratiquer l'enrichissement personnel, le népotisme ou les prévarications de tous ordres, mais ils sont rares. Ceux de maintenant fréquentent plus souvent les prétoires et parfois même les prisons que les couloirs de la Chambre, les bureaux des ministères ou les salons des palais nationaux. Le traditionnel antiparlementarisme français vient sans doute de là.
C'est que, un Président du Conseil, surtout quand il a été intègre, a toujours quelque chose à dire et compte bien laisser son nom dans l'histoire en révélant sur le tard les ficelles et les intrigues qui ont émaillé ses mandats. Alors il écrit ses mémoires. C'est bien ce que fait Beaufort. Il en profite pour jeter un regard désabusé sur l'espèce humaine en général, sur ses trahisons et ses compromissions et bien entendu sur la classe politique qu'il connaît bien. Son directeur de cabinet de l'époque, Philippe Chalamond (Bernard Blier), jeune homme plein d'avenir et d'ambition, trahit le secret qui entoure une prochaine dévaluation. C'était le temps où, quand elle était réussie, elle correspondait à une relance de l'économie, à condition qu'elle reste cachée jusqu'au dernier moment. Pour des raison d'enrichissement familiale et parce qu'il voit là une occasion de se lancer dans l'arène, il révèle cette mesure à son beau-père, banquier, ce qui lui permet de spéculer contre le franc, c'est à dire contre son pays. Beaufort ne peut enrayé cette décision mais exige que Chalamond atteste par écrit sa culpabilité. Cette simple lettre qui restera longtemps entre les mains de Beaufort bride Chalamond au point que le ministère de l'Intérieur charge la secrétaire particulière du Président de récupérer ce papier compromettant. Nous retrouvons Chalamond, à la Chambre quelques années plus tard. Il est question de la construction européenne que Beaufort avait défendue(déjà) et que Chalamond, alors chef de file des députés conservateurs, avait combattue. A l'époque, ils avaient refusé la confiance à Beaufort ce qui avait fait chuter son ministère. Cela a été l'occasion d'une envolée lyrique du Président comme on aimerait en entendre plus souvent au parlement et ailleurs, dénonçant l'affairisme des députés d'opposition. A l'un d'eux qui a fait du pacifisme son option politique, il reproche l'activité familiale de... fabriquant d'armes, à un autre, démocrate chrétien, il rappelle son métier d'avocat d'une banque israélite...
Plus tard, Chalamond qui est pressenti comme chef de gouvernement, vient rendre visite nuitamment à Beaufort, sollicitant son avis et lui proposant une collaboration occulte, faisant aussi amende honorable, son projet de gouvernement reprenant celui de Beaufort qu'il avait portant combattu quelques années plus tôt. Le vieux renard refuse de succomber à la vanité de revenir ainsi aux affaires et Chalamond qui en réalité venait rechercher sa confession compromettante, repart sans l'avoir obtenue et se voit contraint de renoncer au pouvoir.
J'ai revu ce film toujours d'actualité avec plaisir. On y parle des États-Unis d'Europe, du nécessaire abandon de la souveraineté nationale qu'implique le fédéralisme, de l'Europe de la fortune contre celle du travail. On y met une nouvelle fois en lumière la bassesse et la cupidité des hommes, leur appétit de pouvoir, l'hypocrisie qui gouverne cette espèce humaine décidément peu fréquentable.
©Hervé GAUTIER – Mai 2012.http://hervegautier.e-monsite.com
.
-
Le crabe-tambour- Un film de Pierre Shœndœrffer
- Le 28/03/2012
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°562 – Mars 2012
LE CRABE-TAMBOUR – Un film de Pierre Shœndœrffer [1977]
Le 14 mars 2012, Pierre Shœndœrffer nous quittait à l'âge de 83 ans. La République et l'armée ont rendu un hommage solennel aux Invalides, en présence du Premier ministre et du ministre de la culture à celui qui s'était engagé dans le service cinématographique des armées en Indochine jusqu'à la défaite de Diên Biên Phu. Il avait continué sa vie en tant que photographe de presse, cinéaste et romancier, se situant dans la lignée prestigieuse des écrivains de marine.
C'est l'occasion d'évoquer non pas son œuvre toute entière, d'autres le feront mieux que moi, mais un film en particulier, considéré comme son chef-d'œuvre. J'en avais gardé, lors de sa sortie, un souvenir précis non seulement parce qu'il était servi par des acteurs prestigieux (Jean Rochefort – César 1978 du meilleur acteur, Jacques Dufilho – César 1978 du meilleur second rôle) mais aussi à cause des somptueuses prises de vue en mer (César 1978 de la meilleure photographie), le vieux navire qui geint de toutes ses membrures, les vagues qui se brisent sur la coque, l'étrave qui fend la houle dans le brouillard et la haute mer...
L'histoire tout d'abord. Elle est suggérée par un roman éponyme de Shœndœrffer paru chez Grasset (Grand prix du roman de l'Académie Française), inspiré par la vie du lieutenant de vaisseau Pierre Guillaume. Il retrace la dernière mission d'un capitaine de vaisseau, homme austère, dévoré par un cancer, (Jean Rochefort dit « le vieux ») qui reprend un commandement à la mer sur l'escorteur d'escadre « Jauréguiberry » dont c'est le dernier voyage avant sa réforme définitive. Il s'agit d'assurer une mission de surveillance et d'assistance aux chalutiers français pêchant sur les bancs de Terre-Neuve.
Pourtant c'est un peu plus que cela, c'est un retour dans le passé puisque « le vieux » veut revoir une dernière fois son ami et compagnon d'armes, l'ancien lieutenant de vaisseau Willsdorff, dit « le crabe-tambour » (Jacques Perrin) devenu capitaine de chalutier dans ce Grand Nord désolé, fuyant ainsi l'espère humaine avec, comme toujours, un chat noir sur l'épaule. C'est Pierre (Claude Rich), le médecin du bord, qui en a parlé le premier sur la passerelle « Vous connaissez Willsdorff ?». Lui était son ami en Indochine et souhaite le revoir une dernière fois. C'est la vraie raison de son rengagement et de sa présence à bord. Après la défaite française, il est resté là-bas pour soigner ses anciens ennemis. Il a pourtant été expulsé du Viet-Nam. Le commandant, habile manœuvrier, confie au médecin son corps meurtri par la maladie mais aussi son âme tourmentée d'homme « déjà mort » en l'invitant chaque jour à sa table. Il est évidemment question de Willsdorff, ce mythique soldat perdu qu'ils ont connu séparément. Pourtant, cette rencontre n'aura lieu qu'en filigrane, avec une grande économie de mots, comme si, malgré son ultime démarche, le commandant ne pouvait plus parler à cet ami, comme si c'était trop tard, comme s'il n'avait plus rien de commun avec lui, comme s'ils n'étaient plus l'un pour l'autre que deux fantômes. Cette idée est suggérée dans la scène du transfert du courrier où les deux bâtiments se côtoient, une trace sur l'écran radar, la radio qui grésille, rien que quelques mots convenus trop lourds de passé, un salut de sirène, une page qui se tourne, définitivement ! « Adieu » ne cesse de répéter Willsdorff, « Aperçu » fait simplement répondre le commandant par le timonier. Seul Pierre échangera quelques mots amicaux et complices avec Willsdorff et le chalutier s'éloignera.
Cette quête est alimentée en flash-back par des évocations de gens qui l'ont également connu, le commandant puis Pierre, le narrateur de ce récit, mais aussi le chef mécanicien, dit « le chef », alcoolique et catholique pratiquant (Jacques Dufilho) et ses histoires loufoques du pays bigouden, chacun apportant témoignages et souvenirs de cet homme hors du commun ayant combattu en Indochine. Ils évoquent, chacun à leur manière et avec des anecdotes, le parcours militaire de cet officier fidèle à son engagement et à lui-même, à son sens de l'honneur, qui est exclu de l'armée, jugé pour désobéissance et rébellion. (« une histoire de mer et de discipline poussée jusqu'à l'absurde ») Cela sonne comme un hommage, comme un remerciement à quelqu'un qui a refusé la compromission face à un choix.
Dans ce film il y aussi un questionnement chrétien et même profondément humain qui m'interpelle, même s'il passe quelque peu au second plan. C'est celui qui est évoqué par « La parabole des talents », texte de l'Évangile qui invite chaque homme à s'interroger sur le sens de son passage sur terre et sur l'usage qu'il a fait des facultés qu'il a reçues à sa naissance, sur la fidélité aussi. « Qu'as-tu fait de ton talent ? », « Celui qui ne fait pas fructifier ce qu'il a reçu du Seigneur sera jeté dans les ténèbres extérieurs », rappelle « le chef ». C'est aussi l'occasion pour l'auteur d'asséner des aphorismes : « Qui êtes-vous pour le juger ? » de rappeler que le choix de l'homme « n'est pas forcément entre le bien et le mal, mais entre un bien et un autre bien ».
Le nom même de Pierre Shœndœrffer évoque des films devenus mythiques qu'il a réalisés « La 317° section » (1964), « L'honneur d'un capitaine » (1982) qui s'interrogent tous sur les guerres coloniales françaises, sur les militaires eux-mêmes. Plus que « Ramutcho »(1958) et « Pêcheurs d'Islande »(1959) qui sont des adaptations des romans de Pierre Loti et qui ne rencontrèrent guère le succès, Pierre Shœndœrffer s'attacha toujours à évoquer l'aventure humaine, témoin « La passe du diable » (1956) qui est une adaptation du roman de son ami Joseph Kessel mais aussi la dure réalité de la guerre, sur les questions qu'elles posent, les personnalités qu'elles révèlent [ « Diên Biên Phu »(1992)]. C'est que les personnages de ces films s'inspirent tous d'hommes ayant réellement existé, témoignent de leur parcours personnel, de leurs questionnements intimes sur leur mission, sur leur vie. Chacun à sa manière, ils ont nourri l'œuvre de Shœndœrffer.
C'est pour moi un film émouvant. Il ne s' agit pas ici de polémiquer sur la guerre mais de porter un regard, mais pas un jugement, sur les hommes de tout grade qui l'ont faite, de l'engagement de ces soldats perdus, de leur courage, de leur abnégation, de leur obligation d'obéir aux ordres face à leur conscience, valeurs aujourd'hui contestées, et même regardées comme désuètes dans une société sans boussole. L'auteur porte témoignage de ces conflits décriés, volontairement oubliés et parfois même injustement rejetés par la communauté nationale, de ces soldats oubliés.
© Hervé GAUTIER - Mars 2012.
-
Les soeurs fâchées- Un film d'Alexandra Leclère
- Le 18/02/2012
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°554 – Février 2012
LES SOEURS FÂCHEES- Un film d'Alexandra Leclère (2004) Rediffusion le jeudi 13 février 2012, 20h35.– FR3.
C'est, au départ, une histoire bien banale, celle de deux sœurs que tout oppose. Leur mère, vieille et alcoolique, qui attend la mort dans une maison de retraite de province les a très tôt bannies de sa vie en leur prédisant un avenir désastreux . (J'ai toujours été étonné de la manière dont des personnes, par ailleurs très contestables dans leur vie, se croient autorisées à lire dans le marc de café pour les autres et à manier ainsi l'anathème définitif pour les personnes qu'elles rejettent unilatéralement ). D'elle on n'entend parler qu'en filigrane et c'est sans doute ce qu'elle mérite. Elle a donc eu deux filles bien différentes, Martine ( Isabelle Huppert), désœuvrée, snob, aigrie, méchante vit à Paris une existence de mère de famille indifférente à son jeune fils.(Je suis toujours étonné de constater les surprises que nous réserve la génétique qui, au sein d'une même fratrie met en scène des personnalités bien différentes, pourtant issues du même sang ). Elle a apparemment fait un beau mariage et montre toutes marques d'une réussite sociale. Elle s'ennuie cependant dans un costume bien trop grand pour elle au point qu'elle envisage de travailler, elle qui, malgré la quarantaine, n'a jamais rien fait dans sa vie. Elle fréquente un monde superficiel fait de vernissages et de rendez-vous mondains. De son mari, Pierre (François Berléand), on ne sait rien sinon qu'il existe, qu'il est riche, qu'il la supporte et qu'il ramène la vie à des occasions de fornications animales. Non seulement il considère son épouse comme devant se livrer au traditionnel « devoir conjugal » mais il étend volontiers ses talents au bénéfice de la voisine du dessus, aussi avide de sexe que lui, et pourquoi pas à sa belle-sœur !
L'autre, Louise (Catherine Frot), mariée et mère de famille, est esthéticienne au Mans, ce qui n'augure pas d'une vie bien trépidante. Le spectateur comprend très vite qu'elle n'a rien de bien original sinon qu'elle est gaie, spontanée, à en devenir exaspérante et même maladroite. Pourtant, et à l'inverse de cette sœur oubliée depuis bien des années, elle rencontre l'amour en croisant le regard d'un homme, sur un trottoir, un véritable « coup de foudre » qu'elle veut à tout prix ne pas laisser passer. Pour cela, elle hésite puis finalement se lance pour le conquérir et ainsi bouleverse son présent pour ce moment de folie. Elle vit avec lui depuis deux ans ! Cet instant a dû être exceptionnel et chargé d'émotions puisque, elle qui n'était guère douée en français et n'avait jamais tenu un stylo de sa vie, à part peut-être pour sa liste de courses ou la rédaction de ses chèques, confie spontanément cette expérience à la page blanche. Il en résulte un roman qu'elle a envoyé à un grand éditeur parisien ! Une folie de plus mais qui a passionné les membres du comité de lecture et provoqué une convocation prometteuse... et une future édition. C'est la raison de sa présence à Paris de Louise qui en profite, pendant trois jours, pour renouer avec Martine, alors qu'elle aurait pu faire l'aller et retour dans la journée. C'est aussi l'occasion pour cette provinciale de visiter la capitale, de faire connaissance avec son jeune neveu, de craindre un peu pour la future édition de son livre pourtant promis à un succès de librairie... et de bouleverser la vie de cette sœur un peu trop guindée !
C'est pourtant un peu grâce à elle, à son rejet de ce microcosme où elle n'est pas acceptée que Martine prend conscience des relations coupables que son mari entretient avec sa voisine du dessous, celle-là même qu'elle prenait pour sa meilleure amie. C'est aussi un peu par hasard qu'elle rencontre un ancien amant désormais marié et père de famille. C'est aussi pour se venger de cette adversité qu'elle gifle Louise. Quant à Pierre, il disparaît... On imagine un divorce à venir, une nouvelle vie, et ce d'autant plus que la dernière scène du film se déroule à la gare Montparnasse, sur un quai où tout espoir est désormais possible. Louise revient au Mans emportant avec elle la magie des rues de Paris mais aussi les déconvenues familiales. Elle n'est pas au courant du bouleversement qui est intervenu dans la vie de sa sœur mais c'est pourtant mi- surprise mi-complice qu'elle la voit se présenter à elle avec son fils pour ce qui n'est peut-être pas un adieu définitif.
Il s'agit là d'un film qui était le premier long métrage d'Alexandra Leclère et le hasard, encore lui, à transformé pour moi une soirée qui menaçait d'être morne en un bon moment. En effet, J'ai été séduit par le jeux des acteurs, ces deux personnalités que tout oppose et qui sont si bien incarnées par deux actrices d'exception, Isabelle Huppert et Catherine Frot. L'étude psychologique aussi est bien menée, Louise rappelant à sa sœur ses origines sociales, lui donnant un peu malgré elle ce que cette dernière n'a plus, l'amour de la vie, l'intérêt pour les autres, la folie peut-être ? Le portrait de la bourgeoise parisienne ainsi brossé est pertinent et les personnages campés correspondent bien à ce qu'ils sont dans l'inconscient collectif.
© Hervé GAUTIER - Février 2012.
-
Les enfants du marais - Un film de Jean Becker.
- Le 09/02/2012
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°552 – Février 2012
LES ENFANTS DU MARAIS– Un film de Jean Becker (1999).
Il est des films qui s'inscrivent dans notre mémoire à cause des distinctions qu'ils reçoivent, de la notoriété qu'ils obtiennent grâce à la médiatisation au moment de leur sortie en salles, de l'histoire qu'ils évoquent, des acteurs qui servent leur scénario, des paysages qu'ils offrent...Il en est d'autres, au contraire, dont nous nous souvenons avec précision sans trop savoir pourquoi, peut-être parce qu'ils nous ressemblent et évoquent une partie de notre parcours. « les enfants du marais » est de ceux-là.
Pourtant, il raconte une histoire bien banale, celle d'une rencontre de deux hommes devenus amis presque par hasard. Garris[Jacques Gamblin], un homme encore jeune, sans famille, sans attache ni fortune qui revient de cette grande boucherie de 14-18 qui l'a profondément marqué. Il croise un vieil homme[Jacques Dufilho] qui habite dans une pauvre masure près d'un étang en Bourgogne et qui l'y invite. Rapidement, il meurt en lui laissant tout ce qu'il possède, cette cabane en planches et quelques lignes pour la pêche à la grenouille. Il s'installe donc ici et rencontre Riton [Jacques Villeret] qui vit ici depuis toujours avec sa deuxième femme et ses trois enfants. Autant le premier est généreux et courageux, autant le second est paresseux, roublard et alcoolique. Garris l'entraine pourtant à travailler pour survivre. Une véritable amitié nait entre eux et ensemble, ils se font, au rythme de l'année, chanteurs de rues, marchands d'un peu de tout, fournisseurs de grenouilles ou d'escargots pour les restaurants de la ville d'à côté. Après tout, ils ne possèdent que leur vie dans ce coin de France où l'eau et la terre se conjuguent, qui ressemble à un paradis à l'écart de la ville et où la liberté semble être la règle. Pourtant, ils ne sont pas à la charge d'une société en marge de laquelle ils vivent volontiers « On est des gagne-misère, mais on n'est pas des peigne-culs »!
Cette amitié est partagée avec Amédée [André Dussolier], sorte d'intellectuel féru de lecture et de musique, sympathique et oisif mais qui épouse parfaitement ce mode de vie tout en différence. Elle l'est aussi par un veuf illettré, Hyacinthe Richard, dit « Pépé la Rainette » [Michel Serrault] qui a jadis habité au bord de cet étang et à qui la vie a souri. De ramasseur de ferraille il est devenu un riche patron de fonderie ce qui lui a permis de devenir notable et de marier sa fille à un arriviste qui le l'aime guère. Sa famille devenue bourgeoise et méprisante lui interdit de revenir au marais, mais il brave volontiers cette défense, ce qui lui sera fatal.
Eric Cantona signe ici avec talent un rôle de boxeur à sa mesure, victime lui aussi des femmes autant que de son caractère impulsif. Il complète avec bonheur ce panel de comédiens d'exception.
Il n'y a pas que cette connivence entre eux. Riton se remet mal du départ de sa première femme, Paméla, et Garris croisera le regard claire de Marie, domestique dans une grande maison. Il apprendra à ses dépens que ses amours ancillaires seront contrariées et que celle qu'il aimait a suivi dans le sud un homme plus âgé qu'elle, plus riche aussi sans doute parce qu'il représente sa sécurité et son avenir.
La morale de ce film tient en ces quelques mots de la conteuse qui illustrent bien ce qu'est la condition humaine « Il y a des moments dans la vie où l'on voudrait que rien ne change jamais plus ».
Il est cependant un personnage qui m'interpelle, celui qu'incarne le regretté Jacques Villeret [1951-2005]. J'ai déjà eu l'occasion de dire dans cette chronique (La Feuille Volante n° 157) tout le bien que je pensais de cet acteur emblématique, à la filmographie prestigieuse, au palmarès impressionnant, notamment oscar du meilleur second rôle en 1999 pour « Le dîner de cons », dont le talent se déclinait au théâtre comme au cinéma, disparu trop tôt à près de 54 ans, à la fois discret et représentatif du « Français moyen », gentil, rondouillard, raciste, maladroit, froussard, naïf et souffre-douleur des autres. Jamais vraiment star et même plutôt discret, il était l'archétype de l'acteur populaire et son apparition sur les écrans, même dans un rôle secondaire, était toujours pour le public un gage de qualité.
Gamblin, Dussolier et Villeret forment ensemble dans ce film à la fois drôle, poétique et profondémlent humain, un trio amical, émouvant et complice.
© Hervé GAUTIER - Février 2012.
-
TIRÉ Á PART - Un film de Bernard Rapp
- Le 27/08/2011
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
L A F E U I L L E V O L A N T E
La Feuille Volante est une revue littéraire créée en 1980. Elle n’a pas de prix, sa diffusion est gratuite,
elle voyage dans la correspondance privée et maintenant sur Internet.
TIRÉ Á PART – Un film de Bernard Rapp (1996)
(diffusé le samedi 27 aout 2011 sur la chaine Ciné Polar)
Cette histoire est celle d'une subtile vengeance. Nicolas Fabri [Daniel Mesguich], un obscur auteur français qui ne brillait pas jusqu'à présent par son talent, apporte à son ami, l'éditeur anglais Sir Edward Lamb [Terence Stamp], un manuscrit que l'auteur lui présente comme exceptionnel. Connaissant le style et le peu d'intérêt qu'offrent traditionnellement les œuvres de Fabri, Lamb entame sa lecture sans grande illusion mais rapidement il prend un intérêt nouveau pour cette découverte. Non seulement le style est différent mais l'histoire qu'il est en train de lire ne lui est pas étrangère. Fabri y décrit par le menu une histoire d' amour qui a mal tourné et qui s'est conclue, en Tunisie, quelques dizaines d'années auparavant, par le suicide inexpliqué de Farida, une femme qu'Edward avait passionnément aimée. Cette mort avait été por lui, perndant toutes ces années, une énigme obsédante. Pourtant, il fait de la publicité à son protégé mais devant la suffisance de Fabri qui commence à parler de prix littéraire pour son roman, Lamb va profiter de ses relations non seulement pour en proposer la publication par un grand éditeur français, mais aussi, par l'intermédiaire d'une ancienne maîtresse de Fabri devenue critique littéraire très en vue, pour susciter l'intérêt des milieux culturels et artistiques parisiens et ainsi obtenir le prestigieux Goncourt. Dans le même temps, et tout en restant dans l'ombre, Lamb va monter de toutes pièces un scénario attestant sans aucun doute possible la réalité d'un plagiat. Malgré toute sa suffisance Fabri n'y résistera pas.
Sans le savoir Fabri se jette dans la gueule du loup sans se douter qu'il permet à Lamb de mettre en place une vengeance d'autant plus forte qu'elle attend depuis longtemps. Il tient entre ses mains la confession de cet homme responsable de ses amours malheureuses avec cette femme mais surtout Fabri lui déclare que sans cette épisode il n'aurait pas pu écrire ce roman. Dans le même temps le spectateur comprend que c'est précisément cet événement qui a déterminé Lamb à cesser d'écrire. C'est donc à une sorte de jeu de miroirs que ce texte se livre. Ainsi, l'apparition de la fille de la morte qui lui ressemble et porte le même prénom qu'elle et le suicide de cette femme victime d'un viol qui répondra à celui de Fabri qui en a été l'auteur. Lamb qui apparemment fait montre d'un calme très britannique face à la fatuité et à la cupidité de Fabri, est en réalité un bourreau intraitable, animé de la nécessité du châtiment, mais qui veut néanmoins conserver un strict anonymat dans ce processus.
Il s'agit là d'une adaptation inspirée du roman de Jean-Jacques Fiechter. J'ai aimé l'ambiance toute britannique de l'intrigue autant que le développement machiavélique de cette intrigue et l'intensité de la rancune accumulée depuis si longtemps.
Ce film est le premier long métrage de Bernard Rapp, disparu en 2006. On le connaissait comme un journaliste de talent, animateur d'émissions à succès comme « l'assiette anglaise » ou « Jamais sans mon livre », d'homme de culture et il convient, à l'occasion de ce film, de se souvenir de lui.
Hervé GAUTIER – Août 2011.http://hervegautier.e-monsite.com
-
NI A VENDRE NI A LOUER – Un film de Pascal Rabaté.
- Le 18/07/2011
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°532– Juillet 2011.
NI A VENDRE NI A LOUER – Un film de Pascal Rabaté.
Il est des œuvres dont on parle beaucoup à leur sortie, qu'on rattache à une parenté parfois prestigieuse ou originale mais qui, au bout du compte, sans vraiment décevoir, laissent un goût d'autant plus amer qu'on s'attendait à mieux.
Qu'avons nous ? Une petite station balnéaire un peu quelconque de Loire-Atlantique où vont se retrouver, l'espace d'un week-end des personnages aussi hétéroclites que cette période des vacances peut mettre en situation : un couple de retraités qui regagne sa maisonnette en bord de mer, deux familles qui campent, un supermarché vide dont les codes-barres sont le seul intérêt, un couple de punk avec chiens, un enterrement, un cadre en mosaïque à demi terminé par le défunt, une histoire de cerf-volant perdu qui provoque un adultère, un épisode sado-maso dans une chambre d'hôtel, un lapin à contre-emploi, deux golfeurs un peu imposteurs et, pour finir un spectacle franchement minable où un chanteur nous répète que « les vacances à la mer, c'est super ! ». Le tout sans vraiment de dialogue, avec seulement des bruits de fond ou des onomatopées et sur une musique entrainante et épisodique. C'est donc une mosaïque de personnages qui ne se rencontrent pratiquement pas, une succession de saynètes indépendantes les unes des autres où les gags fleurissent sans, à mon sens, jamais convaincre vraiment.
Le décor, les personnages, le scénario (s'il y en a un), l'absence de dialogue (ce qui n'en fait pas pour autant un film muet), évoquent Jacques Tati[« Les vacances de M. Hulot » (1953)]. C'est sans doute pour cela qu'on a qualifié ce film de génial, même si de son vivant Jacques Tati n'a pas vraiment convaincu dans ce domaine et qu'on a attendu qu'il soit mort pour s'intéresser à son œuvre cinématographique et pour lui trouver du génie ! Tati s'était approprié un phénomène récent, les vacances populaires, l'avait traité avec cet humour décalé qui faisait son originalité. Mais ici, il me semble que, malgré une touche de tendresse, les gags sont parfois un peu trop forcés et caricaturaux, parfois un peu trop répétitifs aussi. Le comique existe pourtant, c'est indéniable, mais c'est plutôt une succession de cartes postales animées, burlesques et dérisoires, mais sans la poésie que la spectateur était en droit d'attendre eu égard à la filiation annoncée de ce film. Pascal Rabaté se différencie de Tati en ce sens qu'il actualise son message par la prise en compte de l'échangisme, genre amour de vacances, le phénomène sado-maso, le camp de nudistes ou l'homosexualité punk. Pourtant je m'attendais à une sorte de fresque sociologique, une peinture de la société française comme aimait à le faire l'auteur de « Mon oncle ». Seule peut-être l'émotion prévaut autour de la mort de l'époux ou de la prise en compte un peu furtive de la fuite du temps à travers le dessin de la petite fille qui a grandi et qui est maintenant devenue une femme.
Le film est cependant servi par un choix d'artistes dont le talent n'est pas assez mis en valeur par le parti-pris de l'absence de dialogue. On pouvait s'attendre à ce que le comique, voire l'émotion, naissent de de l'expression ou de la seule situation. C'était une volonté louable, mais cela ne fonctionne pas toujours, malheureusement. J'ai assisté à une sorte d'exercice de style un peu décevant et sans réel rythme où le comique que j'aime tant chez Tati n'était pas vraiment au rendez-vous.
©Hervé GAUTIER – juillet 2011.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LES POUPÉES RUSSES – Un film de Cédric Klapisch
- Le 13/12/2010
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°483– Décembre 2010.
LES POUPÉES RUSSES – Un film de Cédric Klapisch (2005)
Nous retrouvons Xavier (Romain Duris), 30 ans que nous avions laissé lors d'un précédent film (« L'auberge espagnole » sorti en 2002), alors qu'il partait en courant de Bercy et abandonnait ainsi une carrière sûre de fonctionnaire. Au moins en avait-il le courage dans un monde du travail fluctuant et incertain ! Grâce à un appui important et au succès à un concours, il avait décroché cet emploi qui devait lui assurer un avenir sans nuage mais le premier contact avec ses futurs collègues avait dû être décisif et c'est sans doute que qui avait motivé sa course rapide mais déterminée vers un ailleurs différent. C'est vrai que cela était fondamentalement différent de l'année universitaire qu'il venait de passer à Barcelone, la fin d'un DEA d'économie, dans le cadre du programme « Erasmus ». Là-bas, il avait connu cette ville merveilleuse et pleine de surprises, avait rencontré des étudiants étrangers avec qui il avait cohabité, un appartement co-loué par des étudiants européens de toutes les nationalités, parlant des langues différentes, avait appris l'espagnol autant que la tolérance, avait mené une vie de liberté, avait rompu avec sa copine française Martine, (Audrey Tautou), avait eu une liaison brève mais torride avec l'épouse d'un médecin français qui l'avait un temps hébergé...
Pour autant l'économie ne l'avait pas passionné et cet épisode de sa vie lui avait permis de se confirmer à lui-même sa véritable vocation : celle d'être écrivain. Il en était résulté un roman « L'auberge espagnole » qui méritait bien son nom et qui retraçait son expérience barcelonaise insouciante, libre, sans entrave... Et il avait jugé que cette situation était incompatible avec un emploi de fonctionnaire. Cette révélation soudaine avait sans doute motivé sa course effrénée loin de cet immeuble du bord de Seine, ce symbole de la Fonction Publique...
Être écrivain était un rêve d'enfance qui méritait bien, à ses yeux, qu'il s'y consacrât pleinement, sauf que, maintenant qu'il n'avait pas d'emploi stable ni de revenus réguliers, il avait un peu peur, était même un peu perdu surtout face à sa banquière qui elle ne comprend que les chiffres et la réalité concrète... Alors que lui se contente de ne lui servir que des mots et des perspectives aléatoires.
Par voie de conséquences sans doute, un peu comme il l'avait fait à Barcelone l'année précédente, il a un peu de mal à se fixer durablement avec une fille, à mener une aventure amoureuse sérieuse. Il faut dire que sa condition d'écrivain, son roman dont personne ne veut, ne l'incitent pas à considérer qu'il a fait le bon choix en fuyant l'administration. Il en vient même à fuir le travail, l'amour et l'écriture. Pourtant, après avoir envisagé d'être « nègre », il finit par décrocher quelque chose à la télévision, une espèce de scénario à l'eau de rose... mais la mondialisation ou plus surement les économies budgétaires le rattrapent. Ses rêves d'enfance, ses illusions en ont quand même pris un coup.
A la suite d'un concours de circonstances, il se retrouve à Londres puis de temps à autres à Paris pour participer à la rédaction des mémoires d'une jeune actrice superficielle mais célèbre, à peine sortie de l'adolescence mais dont il tombe amoureux. En Angleterre, il retrouve Wendy (Kelly Reilly) qu'il avait connue à Barcelone. Ils doivent collaborer professionnellement et bien entendu ils s'aiment, se quittent pour se retrouver enfin à St Petersbourg pour le mariage de son frère William qui est, lui, tombé amoureux à Paris d'une danseuse-étoile russe.
Alors, amours impossibles, éternelles hésitations face à la beauté des femmes, volonté de rester célibataires pour mieux profiter d'elles et de la liberté, peur de s'engager dans la vie d'adultes pour des jeunes gens un peu immatures, états d'âme de post-adolescents qui n'ont pas encore perdu toutes leurs illusions... Il faudra bien pourtant qu'il se décide puisque les autres l'ont fait (Isabelle – Cécile de France - a décroché un job sur une chaine de télévision financière). Après tout, il est encore temps mais il sera vite trop tard s'il laisse s'éloigner Wendy...
Dans ces deux films, Cédrik Klapisch retrouve son acteur fétiche, Romain Duris et on songe évidemment à la collaboration fructueuse de François Truffaut et Jean-Pierre Leaud.
J'ai, en tout cas, bien aimé l'humour et l'ambiance de ces deux films.
©Hervé GAUTIER – Décembre 2010.http://hervegautier.e-monsite.com
-
Des hommes et des dieux ; Un film de Xavier Beauvais
- Le 28/09/2010
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°458 - Septembre 2010
Des hommes et des dieux – Un film de Xavier Beauvais – Prix du Jury au 63°Festival de Cannes
Il est des films dont la projection laisse le spectateur sans voix.
Ce film est de ceux-là et l'impression première que j'ai eue, la lumière revenue, fut le silence, l'immobilité des gens, leurs larmes secrètes peut-être? On pouvait y lire à la fois l'horreur pour cette mort atroce pourtant tout juste évoquée, l'admiration pour l'abnégation de ces hommes et pour leur sacrifice consenti, la révolte contre la violence, la fascination pour le courage d'aller au-devant d'une mort certaine et acceptée, la fin d'une mission terrestre, le commencement d'une autre vie... D'évidence, ce genre d'exemple ne laisse pas indifférent!
Au-delà des événements que tout le monde a encore en mémoire [ Une communauté de huit moines trappistes qui vit en harmonie depuis longtemps à Tibhérine au Maghreb algérien en contact avec la population arabe à qui elle vient en aide, sa prise en otage en 1996 puis son assassinat dans un rituel inconnu et barbare – on ne retrouvera que leurs têtes mais pas leurs corps] mais qui reste encore aujourd'hui un mystère, il y a ce film. Même s'il est librement inspiré de faits réels, il nous rappelle encore une fois que chaque homme est mortel, même si dans nos civilisations occidentales cette évidence est encore taboue. Il parle aussi de cette propension qu'ont les hommes à s'entretuer avec pour cela l'excuse de la religion comme le rappelle cette pensée de Pascal opportunément citée, mais aussi de l'acceptation de cette mort que l'on sent rôder, sous la forme de groupes armés islamiques incontrôlés.
Dès lors se pose, pour les moines, le problème de l'abandon de cette population arabe aux exactions des islamistes ou le maintien de leur présence au monastère quoiqu'il arrive. Un monastère est constitué par un groupe d'hommes venus d'horizons différents avec des personnalités différentes, soudés par la seule force de leur foi, de leur mission et par le règle de leur ordre. Dès lors, quitter les lieux revient aussi à fissurer la cohésion de la communauté, d'accepter d'opposer à la violence extérieure la force de la prière et de l'exemple quoiqu'il puisse en coûter! Ce cheminement vers l'acceptation du martyre est bien montré dans le doute de chacun au début puis, à la fin, dans un ultime repas pris en commun (la cène!) que Frère Luc (Michael Lonsdale époustouflant de réalisme et d'humanité qui se pose avant tout en homme libre) choisit d'agrémenter de vin rouge (comme le sang du sacrifice) et de la musique profane de Tchaïkovski (Le lac des cygnes) à la place de la traditionnelle lecture de textes sacrés, comme on abandonne ce monde terrestre, les larmes vite essuyées du vieux Frère Amédée, la détermination de Frère Christian (Lambert Wilson en contemplatif déterminé), la décision de toute la communauté...
Ce n'est pas un film confessionnel au sens strict du terme puisque la vie des moines dans ce coin de l'Atlas se déroule sans la moindre volonté de prosélytisme. Ils soignent indifféremment tous ceux qui se présentent au monastère, prient pour l'âme d'un enfant assassiné autant que celle du rebelle assassin, parlent librement du monde extérieur... Il n'y a pas de message proprement évangélique (les moines citent à la fois le Coran et l'Évangile - on peut parfaitement être athée et être bouleversé par cet exemple), seulement la mise en évidence des valeurs humaines de tolérance, de charité, de fraternité entre les hommes, maintenant fortement gommées par notre mode de vie où la réussite sociale, financière, professionnelle, le paraître, sont les seuls critères. L'image donnée par le monde au quotidien en procure tous les jours l'illustration.
Ces moines sont des hommes de dieu et choisissent d'opposer leurs fragiles chants liturgiques aux vrombissements des hélicoptères de l'armée, décident, contre toute logique, de rester au monastère malgré les mises en garde des autorités incapables d'assurer l'ordre public dans un pays en totale décomposition, opposent un refus silencieux à la délation même si elle vise à livrer des terroristes et même si en jouant ce jeu, les moines se protègent indirectement. Ils rappellent d'une manière apparemment anachronique que leur vie ne vaut rien parce qu'elle est déjà offerte à dieu et qu'ils doivent accepter sa volonté sous quelque forme qu'elle se présente. Il y a quelque chose de grand dans l'acceptation de ce sacrifice.
De nos jours encore, des hommes que tout désignait pour un parcours brillant et carriériste choisissent de tout quitter, de refuser une vie de famille, d'embrasser la pauvreté, l'abnégation, le service de l'humanité et la foi en un dieu qu'ils n'ont jamais vu mais qu'ils servent aveuglément, parce que là est le véritable sens de leur vie. Le silence, la prière, la foi sont leurs seules armes. En cela ils forcent le respect, apportent un certain apaisement et un exemple de dignité. Ce n'est pas un film qui oppose l'islam et l'Évangile, ce sont toutes deux des religions révélées, des religions du Livre, qui prônent la tolérance, la charité, le respect de l'autre, ce n'est même pas un film contre les islamistes, leur vision meurtrière du monde et leur mauvaise interprétation du Coran. Les circonstances « historiques » eussent été différentes, le résultat n'en aurait pas moins été le même. Les hommes continueront de s'entretuer tant qu'ils vivront!
Le film n'apporte pas de réponse à ces exécutions, ce n'était d'ailleurs pas le sujet, même si on a pu se livrer à des supputations sans le moindre fondement, si le mystère entoure encore cette prise d'otages et le marchandage qui y a fait suite. L'important est ailleurs, au-delà du spectacle qui ne veut sans doute pas emporter l'adhésion du spectateur mais lui donner l'occasion de remettre en question des idées reçues, de réfléchir sur un monde qui devient chaque jour plus fou.
C'est assurément la mise en évidence d'un exemple bouleversant.
Hervé GAUTIER – Septembre 2010.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LIBERTÉ – Un film de Tony Gatlif.
- Le 11/03/2010
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°402 – Mars 2010
LIBERTÉ – Un film de Tony Gatlif.
Tout commence par une image poétique et tragique à la fois, un camp de concentration et une musique jetée au vent et produite par des cordes de guitare qui vibrent au rythme des barbelés. Le ton est donné.
La deuxième image est celle d'un campement de gitans en marche dans une forêt à la recherche d'un hypothétique fantôme qui leur fait peur. Ce n'est en fait qu'un petit garçon qui veut se joindre à eux pour échapper à l'orphelinat. Lui aussi a choisi la liberté, celle de ceux qui ne sont de nulle part et qui n'ont comme boussole que le vent. Cette famille tsigane s'installe provisoirement dans un village pour les vendanges, comme tous les ans. Pour autant, on commence à comprendre que les choses ont changé, qu'ils se méfient. On aperçoit la silhouette de soldats allemands qu'ils semblent fuir. Pourtant, dans ce village, ils ont leurs habitudes, qu'ils y connaissent des gens qu'ils respectent, comme ce Pentecôte qu'ils accueillent au début en ami. Pourtant, c'est la guerre et même si cela n'est la « leur guerre », elle est là et a changé les mentalités et surtout les hommes. Pentecôte qui était auparavant leur ami est devenu un « collabo », à la solde de la milice et des SS, désireux avant tout de les spolier du peu qu'ils ont et de servir ses propres intérêts. A partir de ce moment les choses s'enclenchent et de fuites en persécutions et internements dans un camp, le spectateur les prend forcément en sympathie. Ils sont les faibles dont les plus forts vont avoir raison, la mort va s'imposer, même s'il elle n'est suscitée qu'à travers l'assassinat de Taloche.
Dans ce film sans véritable scénario, fait seulement de scènes juxtaposées, Gatlif choisit de célébrer le besoin de liberté [Taloche, décidément en décalage complet avec notre société qui libère l'eau en ouvrant largement les robinets – C'est dans l'eau de la rivière qu'il trouvera la mort, symbole d'une véritable libération mais aussi de la volonté d'anéantissement des Allemands] qui colle aux « semelles de vent » des Tsiganes. A l'occasion, l'auteur souhaite revenir aussi sur les idées reçues et fortement ancrées dans l'inconscient collectif qui font d'eux des « voleurs de poules » [L'épisode où les gens du village viennent les chercher et les paient pour jouer devant leurs poules qui ne veulent plus pondre, est révélateur]. Il les montrent comme des gens qui refusent définitivement d'intégrer notre société sédentaire, scolarisée, obéissante..., comme des gens qu'on souhaite surtout voir s'installer ailleurs [Même s'ils jouent dans les bals de campagne, apparemment à la satisfaction de tous, ils n'en sont pas moins l'objet de l'hostilité des villageois, même s'ils partagent, peu ou prou, les mêmes peurs, les mêmes superstitions]
Gatlif n'oublie personne et rappelle, à sa manière, qu'ils n'ont pas été les seuls à être persécutés par les Allemands [l'épisode où Taloche, malgré son côté hurluberlu et comique, découvre à la sortie d'un tunnel ferroviaire une montre juive, remet les choses dans leur contexte]. Hitler ne s'en est pas pris seulement aux Juifs, mais aussi à tous ceux qui n'avaient pas l'heur de lui plaire [communistes, résistants, opposants politiques, homosexuels...]. Il rend également hommage à ceux qui ont gardé leur humanité, le maire du village qui vient les chercher dans le camp et les sauve provisoirement par un subterfuge juridique, l'instructrice qui est aussi une résistante, le personnage incarné par Rufus qui leur fournit du travail et de la nourriture. Ils sont eux aussi, à leur manière, des « Justes parmi les justes » mais cette distinction n'existe pas chez les Tsiganes. Il n'y a pas eu chez eux, comme chez les Juifs, d'écrivains et des éditeurs pour porter témoignage de cette extermination.
Ce film est donc bienvenu par l'authenticité de ses personnages et par le témoignage qu'il porte, non seulement sur la différence [et donc sur la tolérance qu'elle entraîne de la part d'une société qui se dit civilisée], mais surtout sur le massacre, avec la complicité de l'État français, de ce peuple victime, lui aussi, de la folie meurtrière des nazis.
© Hervé GAUTIER – Mars 2010.
-
DIALOGUE AVEC MON JARDINIER - Comédie dramatique de Jean Becker
- Le 24/06/2009
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°347– Juin 2009
DIALOGUE AVEC MON JARDINIER – Comédie dramatique de Jean Becker – Mardi 23/6/2009 – Cinéma Premier..
Ce film, un peu perdu dans une programmation tardive, aurait pu passer inaperçu. Il a pourtant retenu mon attention.
Le titre un peu banal n'a pourtant rien d'original. De quoi s'agit-il? C'est la rencontre fortuite de deux anciens camarades d'école qui s'étaient perdus de vue, l'un, incarné par Daniel Auteuil, fils d'un notable, devenu lui-même artiste-peintre connu et reconnu, qui revient dans la maison de son enfance parce que la séparation d'avec sa femme va bientôt déboucher sur un divorce qu'il refuse mais qui devient de jour en jour plus incontournable, l'autre, incarné par Jean Pierre Darroussin, fils d'ouvrier devenu cheminot par nécessité, qui occupe sa récente retraite en faisant son jardin. Rien que de très banal au départ.
Ils vont se reconnaître et l'ancien cheminot va proposer ses services à ce camarade pour aménager son jardin en friche depuis bien longtemps.
Tout oppose ces deux hommes : leur parcours, l'un a refusé de reprendre la pharmacie paternelle pour devenir artiste et l'autre opte, pour un emploi aux Chemins de Fer, mais comme poseur de voies, c'est à dire le métier le plus dur et le plus mal payé. Il y mène une carrière obscure et difficile, mais son métier c'est toute sa vie. Il a toujours vécu en HLM alors que son camarade a acquit des biens immobiliers en rapport avec sa situation.
Il ya aussi les femmes, en arrière plan. L'ancien cheminot parle de son épouse comme d'une icône, lointaine et respectable, une perception un peu décalée et hors du temps quand l'artiste, davantage dans son époque, opte pour des mœurs libérées. L'un est amoureux de son épouse et l'autre la quitte, certes à regrets, mais s'avoue incapable, malgré sa qualité de peintre, de se souvenir de la couleur de ses yeux! L'un respecte les femmes et l'autre y voit, malgré son âge, une quête de plaisir.
L'un va toujours en vacances au même endroit depuis des années et l'autre voyage au gré de ses expositions. L'un cite Bonnard, parle de la couleur, de la lumière quand l'autre lui répond « calendrier des Postes, Chromos ou tapisserie de supermarché ».
L'un se bat pour la vie et l'autre choisit de s'empoisonner avec des paradis artificiels. L'un n'a qu'un vélomoteur et n'a toute sa vie été qu'un ouvrier quand l'autre est habitué aux vernissages et aux encombrements de la capitale...
Pourtant, ce film est pleins de sensibilité. Il va se tisser au fil de ces rencontres et de ces dialogues une complicité entre ces deux hommes au point qu'ils ne vont plus s'appeler par un pseudonyme choisi par eux et qui évoque leurs fonctions [Dujardin et Dupinceau] et le mode de vie de l'artiste va être complètement transformé par l'ancien ouvrier qui va même, à la fin, influencer son style malgré ses manières un peu frustres.
Et puis il y a la mort, abordée ici tantôt sur le mode humoristique tantôt sur le mode tragique. Elle finira par avoir raison de l'ancien cheminot qui l'a pourtant plusieurs fois repoussée et qui, comme un ultime hommage lui demande de peindre quelque chose qui lui ressemble. Ce sera le style de son ami pour l'avenir, à la fois différent de ce qu'il faisait avant et surtout à cent lieues de ce que le snobisme consacre en matière d'art [j'ai toujours été personnellement plus curieux des commentaires critiques sur l'art moderne que de cet art lui-même. Trouver les mots pour expliquer ce qui ne tombe pas sous le sens commun m'a toujours paru un exploit bien plus intéressant que l'acte de création lui-même, surtout quand je ne le comprends pas]. Je vois dans cette démarche non seulement une évolution créatrice intéressante d'un artiste qui se remet en question et accepte de faire évoluer sa démarche vers davantage de sincérité et de simplicité mais surtout une sorte d'acte de mémoire envers cet homme attachant par son authenticité.
Ce fut donc un bon moment et ce film aurait mérité une programmation plus en vue dans la soirée.
-
DÉSOBÉIR : Aristide de Sousa Mendes
- Le 13/06/2009
- Dans cinéma français
- 3 commentaires
N°345– Juin 2009
DÉSOBÉIR : Aristide de Sousa Mendes – Téléfilm de Joël Santoni - France 2 vendredi 12 juin 2009 – 20H35.
La sélection du programme pour une soirée de télévision du vendredi soir se fait souvent au hasard. C'est vrai qu'il fait partie de notre vie beaucoup plus que nous voulons bien l'admettre, mais c'est là un autre débat. Me voilà donc devant mon écran avec le choix entre des émission de variété plus ou moins enthousiasmantes, des séries télévisées et des débats...Le hasard a décidé pour moi. Heureusement!
« Désobéir ». Le titre lui-même est tout un programme. Ce mot évoque à la fois des relents d'enfance et de tentations d'adultes, mais là, le scénario est différent. L'action d'abord: la France de 1940 face à la défaite militaire, à l'exode des populations civiles, à la perte de ses repères culturels, religieux, civiques, patriotiques, à la peur du nazisme qui déferle sur le sol national et précipite l'Europe dans le chaos. Dans ce genre de circonstances, l'individualisme, l'égoïsme, la lâcheté... ressortent plus forts encore que dans le quotidien ordinaire et chacun est prompt à faire prévaloir son propre intérêt, sa propre survie sur ce qu'en d'autres temps on nomme, avec quelque emphase « l'intérêt général ». Face à ces circonstances exceptionnelles, on fait facilement taire des aspirations auxquelles, en d'autres circonstances peut-être [ou peut-être pas], on aurait prêter une oreille attentive. Après tout l'attention portée à sa propre personne est une cause recevable.
Le personnage ensuite. Aristide de Sousa Mendes, consul de 1° classe du Portugal à Bordeaux campé par Bernard le Coq [décidément omniprésent sur notre petit écran en cette période] est bouleversant de sincérité même si cela, par moment, frise un peu l'angélisme. Il représente son pays, certes dirigé par un dictateur, Salazar, mais neutre au regard du conflit mondial. Du coup, toute la population susceptible d'être exterminée par les nazis [Juifs, républicains espagnols, communistes, réfugiés... Ceux qu'on appelait « les indésirables »], souhaite obtenir un visa pour le Portugal. Devant le consulat de Bordeaux, comme ailleurs en France, on fait la queue pour obtenir ce précieux sésame pour la liberté, pour la vie aussi!
Les sympathies de Salazar pour le nazisme inclinent celui-ci à interdire à sa représentation diplomatique à l'étranger de délivrer ces fameux visas. Le cas de conscience de Mendes de Sousa est simple, au moins dans sa formulation, lui, le chrétien, l'humaniste, mais aussi le haut fonctionnaire, représentant d'un Etat auquel il doit, bien entendu, une obéissance sans réserve, peut-il passer outre la circulaire (circulaire n°14) qui lui enjoint de refuser l'accès de son pays à ces pauvres gens et ainsi de les précipiter dans la mort alors que sa conscience l'oblige à désobéir à des ordres qui ne sont pas certes illégaux, mais immoraux et inhumains? Après tout il est payé pour obéir, pour être loyal... c'est ce que lui rappelle son premier secrétaire [Roger Sousa est convainquant et émouvant dans son rôle de fonctionnaire, fidèle au début, et qui finit par se laisser convaincre par l'humanisme du Consul]. Après tout, il appartient à une grande lignée de l'aristocratie portugaise, il est diplomate, père d'une nombreuse famille aux soins de laquelle il veille jalousement et pourrait faire prévaloir la fidélité à son pays. Il pourrait aussi mettre en sommeil cette morale chrétienne qui lui sert de boussole mais qui, par ailleurs, ne lui provoque aucun état d'âme quand il fréquente une maîtresse qui va lui donner un enfant. Il pourrait parfaitement camper sur cette position assez hypocritement confortable et décider de faire ce à quoi il a dédié sa vie d'agent de l'État et obéir aux ordres sans se poser toutes ces questions que les circonstances font naître.
Ainsi, après une rencontre [peut-être imaginaire] avec un rabbin avec qui il disserte longuement sur le message de paix contenu dans le Talmud et l'Évangile, et après une réflexion personnelle qui fait blanchir prématurément ses cheveux [on imagine ainsi la violente tempête sous ce crâne], il décide pour lui-même, mais aussi pour sa famille [parce qu'après tout il n'engage pas que lui dans cette affaire et on conçoit facilement que Salazar ne restera pas indifférent à cet acte de sédition] d'être en accord avec sa conscience. Pourtant il pouvait légitimement penser que ce dictateur, par l'éducation chrétienne qu'il a reçue, ne pouvait que partager son engagement.
Après avoir délivrer des visas en pleine connaissance de cause, il rentre chez lui , au Portugal, bien décidé à affronter, peut-être un peu trop inconsciemment, la justice de son pays. Il se bat pour faire reconnaître sa bonne foi, rappelle que son attitude ne lui a été inspirée que par l'idéal chrétien dont se recommande aussi Salazar et que, de toute manière, son action était parfaitement conforme à la constitution de son pays. Le dictateur souhaite au contraire que ce procès n'ait qu'un caractère administratif, mettant l'accent sur la seule désobéissance et non pas ce pour quoi il a désobéi. Le jugement rendu prend en compte les aspirations humanistes du Consul et lui est, d'une certaine façon, favorable, mais, c'est oublier que le chef d'un état totalitaire ne peut admettre la désobéissance. Par ordre suprême, Il est donc radié à vie de toute fonction publique, privé de ressources et condamné à une mort à petit feu, lui et sa nombreuse descendance. Il n'est donc plus qu'un fantôme qui attend la mort et qui n'est même pas autorisé, comme il le souhaite, à s'expliquer devant le chef, pour plaider sa cause. Pendant des années il devra supporter des attentes vexatoires dans ces antichambres du palais présidentiel et finira par mourir, abandonné de tous, inconnu, ruiné et oublié. Il faudra attendre le retour laborieux à la démocratie pour que sa mémoire soit réhabilitée. Ce film y contribue heureusement!
Cela n'empêchera pas Salazar, à la fin de la guerre, de se prévaloir de son rôle dans l'accueil des Juifs fuyant le régime nazi, volant ainsi à Mendes de Sousa son engagement humanitaire et chrétien.
Ils furent nombreux ces hommes et ces fonctionnaires, à cette époque notamment, qui ont dû choisir entre ce à quoi les obligeaient leurs fonctions et ce que leur dictait leur cœur et ainsi donner un autre sens à leur « devoir ». Cette chronique [La Feuille Volante n° 323 – Février 2009] s'est fait l'écho de l'hommage rendu à l'un d'entre eux, également oublié de l'histoire décidément un peu trop sélective et parfois même amnésique.
Je trouve plutôt bien que ce soit le Service Public, dont on souhaite apparemment la disparition actuellement, qui soit à l'origine de cette réhabilitation.
©Hervé GAUTIER – Juin 2009.http://hervegautier.e-monsite.com
-
JE M'APPELLE VICTOR - Film de Guy Jacques.
- Le 13/04/2009
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°169
Octobre 1993
JE M’APPELLE VICTOR – Film de Guy Jacques.
Pendant près de deux heures, le spectateur, pour peu qu’il emboîte de pas de l’auteur, partage la vie, ou plus exactement l’univers de Basile, ce petit garçon de onze ans, amoureux de Cécile, une jeune fille plus âgée que lui et qu’il tente de séduire en lui faisant croire qu’il est réincarné et qu’ainsi il a connu son arrière-grand-père, le nain kleptomane…
En réalité, il puise dans les souvenirs d’une vieille dame, Rose, qui vit recluse dans son microcosme, au premier étage de la maison des grands-parents du garçon à Wassy.
Malgré les apparences, Rose n’a pas vieilli, car sa vie à elle s’est arrêtée au moment où, en pleine guerre de 14-18 sa mère devait venir la chercher et a trouvé la mort dans la petite gare de Wassy sans que Rose en sache rien. Depuis, clouée sur un fauteuil roulant à cause de l’autre guerre, elle vit avec cet espoir fou de revoir sa mère, mais aussi avec le souvenir de ce Victor, un coureur automobile qui lui aussi a disparu, qui était son compagnon et avec qui elle devait faire sa vie.
En fait, le personnage fascinant de Rose est en prise directe sur Basile au point qu’il s’identifie à Victor, qu’il prend sa place. Il n’a de cesse d’entraîner sa jeune amie dans «l’’île aux amoureux » à cause d’une légende instillée dans l’esprit de l’enfant par Rose elle-même.
Dans ce récit initiatique, il y a plus qu’une histoire, il y a une invitation au rêve, à l’amour, au merveilleux. Il y a ceux qui y sont déjà, Rose, qui n’en sortira que par la mort, ceux qui veulent y entrer, qui en entrouvre la porte, comme Basile mais qui souffre de ne pas entraîner celle qu’il aime dans sa démarche, parce que cet amour d’enfant est impossible, ceux qui resteront sur le seuil comme Cécile qui regrettera jusqu’aux larmes de ne pas sauter le pas parce qu’elle est consciente de l’impossibilité de cet amour, ceux qui sont ailleurs, dans un autre monde, différent mais tout aussi idyllique et qui n’en sorte que de temps en temps, le vieux Chef de Gare qui n’est plus là que pour lever les barrières et regarder passer des trains qui ne s’arrêtent plus mais qui reconstitue pour lui seul dans la gare désormais vide tout un réseau de train électrique, le grand-père de Basile, un ancien légionnaire qui n’a jamais vraiment quitté le Tonkin et qui en recrée le décor, ceux enfin qui sont étrangers à tout cela, le compagnon de Cécile, plus intéressé par la moto et les copains. Il est en dehors du monde de cette émouvante histoire, tout comme Luce, la grand-mère de Basile, bourrelée de remords. Elle n’y vit physiquement que dans les exagérations de son mari. Elle est fait une femme malheureuse, dominée par Rose qui lui est supérieure et qui l’écrase, l’étouffe…
Outre les excentricités des personnages, il y a l’atmosphère de ce film où le présent se mêle au passé par le truchement de la réincarnation feinte de Basile, et pourtant le spectateur ne sait jamais où s’arrête l’un et où commence l’autre, tant le fantastique et présent à chaque moment fort, au point que les souvenirs de Rose, véritables prétextes de ce récit resurgissent à l’occasion des larcins que le nain voleur avait cachés dans sa maison et qui réapparaissent comme par hasard !
Mais est-ce vraiment par hasard que Rose choisit de quitter son décor et sa vie parce que Basile, son complice, est venu lui annoncer «l’arrivée » de sa mère ?
Chacun des personnages vit dans un monde qu’il s’est construit parce que, pour lui, peu ou prou, il reste un peu de cet esprit d’enfance magique, merveilleux, poétique, mélancolique aussi. Bref, un film à la réelle personnalité, plein de rigueur et d’émotion.
© Hervé GAUTIER.
-
MON PERE- Film de José GIOVANNI ET Bertrand TAVERNIER
- Le 01/04/2009
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
.
N° 246–Juin 2003
MON PERE- Film de José GIOVANNI ET Bertrand TAVERNIER
France 3 - lundi 5 mai 2003.
« La Feuille Volante » célèbre cette année son 24° anniversaire.
Ce n’est pas sa vocation première, puisqu’elle est destinée à donner son avis (qu’on ne lui demande d’ailleurs pas) sur la littérature et la poésie françaises, pourtant, cette fois, c’est un film qui a retenu mon attention, mais pas n’importe lequel !
J’avais déjà signé un article sur l’excellent roman de José Giovanni (La feuille Volante n° 204 de mars 1999) « Il avait dans le cœur des jardins introuvables » où l’auteur parle de son père avec un amour plein de remords, comme si les deux hommes avaient passé leur vie à se côtoyer sans jamais se comprendre, se rencontrer, sans peut-être vouloir le faire vraiment…
Le film s’inspire de ce roman autobiographique, mais c’est avant tout une création axée sur le rôle d’un homme en faveur de son fils parce que sa vie est menacée !
Tout se résume en une quête d’un père, Joe, Corse pauvre qui partit, avant la 1° guerre mondiale pour l’Amérique « avec quelques pièces d’or portées dans une ceinture, à même la peau », un jeu de cartes et une envie de réussir à tout prix dans ce pays où tous les rêves étaient possibles. De retour en France, on nous fait comprendre qu’il a été très absent, qu’il a donné à ses fils le mauvais exemple dans la fréquentation des prostituées, des tripots et du « milieu », un homme, en tout cas qui ne s’est pas occupé d‘eux comme il aurait dû le faire. Il les a précipités, probablement sans le vouloir, mais en ne faisant rien pour l’empêcher, dans la vie facile mais dangereuse que leur offrait Santos, leur oncle, un truand maudit pourtant par ce père.
L’aîné perdra la vie dans une entreprise aventureuse ourdie par cet oncle qui les trahira, une rixe meurtrière d’où Manu, le cadet, sortira en vie mais condamné par une justice qui voyait plus en lui un coupable idéal qu’un véritable assassin qu’il n’était pas. Il fallait que quelqu’un paie pour la vie des victimes, ce serait donc lui qu’on avait choisi. La guillotine trancherait sa vie puisque, à l’époque, cela se faisait encore ainsi. C’est vrai que dans cette après-guerre on était peu sourcilleux sur la présomption d’innocence et bien plus désireux de faire « des exemples »
On entraperçoit le personnage de la mère qui, à travers la recherche d’une improbable martingale, veut retrouver cette richesse qui avait été la leur autrefois et dont elle conservait le souvenir dans quelques photographies un peu jaunies. Malgré tout, là aussi il y a un échec, tempéré sans doute par les paroles d’une cartomancienne qui lui avait prédit la réussite d’un de ses enfants. Pour elle, pas de doute possible, ce sera sa fille, douée pour les arts ! Certes, cette femme incarne la famille face à un père plus occupé ailleurs, elle symbolise sa permanence puisque c’est elle que Joe charge de faire connaître à Manu, maintenant détenu dans le quartier des condamnés à mort, le résultat de ses tractations. C’est que le père a trouvé dans ce nouveau combat qu’il mène dans l’ombre pour la libération de son dernier fils, le vrai sens de sa vie. C’est un peu comme une revanche, un pardon qu’il sollicite, un rachat sans doute… Mais les relations avec son fils sont toujours aussi tendues.
Comme il ne peut lui parler sans que leur incompréhension n’éclate de nouveau, Joe devient un habitué du café qui fait face à la prison de la Santé opportunément appelé « Ici mieux qu’en face. » Il y rencontre les surveillants qui lui donnent des nouvelles de Manu (Rufus est émouvant dans le rôle de ce gardien, marié à une femme aveugle et qui entretient avec les détenus une quasi-sympathie - un condamné à mort propose même de donner ses yeux pour son épouse !) devient presque leur ami. Il y apprend les coutumes de la prison, comme celle de faire laver le couloir du secteur des condamnés à mort quand ce n’est pas le jour réglementaire, ce qui signifie qu’il va y avoir une exécution, ce qui amplifie encore l’angoisse de Joe parce que son fils y est présent et que c’est peut-être son tour !
Il y a même une atmosphère de compassion qui se tisse entre les détenus et ces hommes, obligés de faire leur travail pour ne pas perdre leur emploi, une justice un peu trop prompte à condamner et ce père qui se bat pour la vie de son fils.
On ne prononce pas le mot « maton », au contraire, les détenus respectent ces surveillants qui les gardent mais qui doivent souvent travailler à l’extérieur pour élever leurs enfants, tel cet homme reconnu par un prisonnier repris et qui avait vu un de ces gardiens qui devait, pour survivre et élever Sa nombreuse famille… cirer les chaussures en pleine rue !
Joe œuvrera seul, dans l’ombre et à l’insu de son fils, ira même jusqu’à implorer la pitié des parents des victimes pourtant dans l’attente de l’exécution. Il obtiendra, par avocats et personnalités interposées que le Président Vincent Auriol commue la peine en détention à perpétuité. Il avait probablement dans le cœur ces jardins introuvables, ce père qui n’hésita pas à mettre en gage son bridge en or pour payer les frais d’avocats chargés de trouver un improbable vice de procédure et ainsi faire casser un jugement ou faire reporter la date de l’exécution ou à passer des nuits sous la pluie pour émouvoir une mère et arracher son pardon ! Puis ce seront les remises de peine et toujours ces rendez-vous au café en face de la prison pour y quêter des nouvelles de son fils.
Sous l’impulsion discrète mais obstinée de cet homme enfin dans son rôle de père, un élan de solidarité se crée en faveur de Manu…
Parce que son avocat avait remarqué que Manu tenait un journal et avait un goût pour l’écriture, il lui conseille de relater son séjour en prison. Son roman « Le trou » sera un succès. Dès lors une nouvelle vie commence pour lui et pour son père un espoir possible de libération même s’il reste de plus en plus en marge. C’est lors d’une séance de signature que les gardiens lui révèlent l’action de Joe en sa faveur, ses attentes au café, ses espoirs déçus parfois… C’est une révélation pour Manu qui recherche son père dans l’assistance mais ne le trouve pas. Seul le spectateur voit disparaître sa lourde silhouette poursuivie par ce fils désormais célèbre et libre, mais l’ultime rencontre ne se fait pas, comme un rendez-vous perpétuellement manqué entre ce père et lui ! (Bruno Cremer campe le personnage de Joe avec son talent habituel) Ce combat l’avait tellement épuisé qu’il mourut avant la réhabilitation de ce fils qu’il avait si activement contribué à faire libérer.
Sa vie pouvait dès lors se terminer. Il ne servait plus à rien et c’est sans doute le sens de cet ultime appel de Manu, soudain revenu à la réalité qui va devoir vivre comme avant certes, mais cette fois avec une manière de remords et le sentiment d’une dette imprescriptible envers un homme désormais absent pour toujours. Il lui adresse, en même temps que ce film un pathétique « A Bientôt ! »
Le roman avait su m’émouvoir, le film a ravivé cette émotion qui met en lumière ces relations parfois difficiles entre les membres d’une même famille surtout quand la vie de l’un de ses membres est en jeu. Et qu’il est toujours temps de racheter un manquement, une faute...
NB : a mon avis le film méritait plus de deux 7 à la cote de télé 7 jours.
Diffusion gratuite – correspondance privée.
© Hervé GAUTIER Revenir au début http://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg
-
ENTRE LES MURS – Un film de Laurent CANTET [Palme d'or Cannes 2008].
- Le 29/03/2009
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°314 – Septembre 2008
ENTRE LES MURS – Un film de Laurent CANTET [Palme d'or Cannes 2008].
Il est de la “Palme d'or” comme du “Prix Goncourt”, on parle de l'oeuvre qui est couronnée et elle fait débat! C'est d'ailleurs heureux puisque, pour un créateur, rien n'est pire que l'idifférence. Ici, c'est carrément une polémique que suscite ce film et on oscille entre des extrèmes, soit on est laudatif voire inconditionnel, soit les critiques pleuvent...
A s'en tenir au film, qu'en ai-je retenu? D'abord le décor : une classe de 4° dans un collège de ZEP d'une banlieue difficile où un professeur de Français peine à faire son véritable métier, celui d'enseigner notre langue, de provoquer les réactions constructives de ses élèves, de leur donner l'occasion de s'exprimer sur le programme scolaire mais aussi sur la langue, la littérature, la syntaxe, le vocabulaire...
Premier constat : Le message ne passe pas et le malheureux enseignant à qui on demande de nombreux diplômes pour être nommé à ce poste a du mal à se faire entendre de ses élèves et en est réduit à faire de la discipline dans sa classe, pour la simple raison qu'il n'y règne pas l'ordre et le silence nécessaires à la transmission du savoir. C'est aussi un paradoxe, ce professeur souhaiterait évidemment plus de sérénité dans son cours, même s'il a été, quelques années avant, un étudiant un peu indiscipliné, voire chahuteur, dans les amplis de la faculté! Cela est souligné par le personnage d'Esméralda, volontiers frondeuse et irrévérencieuse... qui veut plus tard être policière, sans doute par amour de cet ordre qu'elle contribue largement à perturber dans ce microcosme!
Deuxième constat : Les élèves veulent rester dans le système scolaire, même si, d'évidence, il ne leur sert à rien: témoin cette jeune fille au début du film qui ne veut pas être dirigée sur le “secteur professionnel” alors que son avenir est plus sûrement dans ce domaine que dans le milieu scolaire traditionnel d'où elle sortira sans diplôme et donc sans prespective. Cette classe étant composée majoritairement d'enfants d'immigrés, on comprend bien que l'école, qui devrait être regardée comme une chance d'intégration est en réalité une voie de garage. S'ils en sont exclus, ce sera aussi l'explusion administrative du territoire avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Dès lors, l'école apparaît comme un moyen des plus artificiels de maintenir un fragile équilibre que les élèves eux-mêmes, en dépit de leur intérêt, ne font rien pour entretenir.
Troisième constat : Les enseignants de ce collège sont conscients de cela, témoin ce professeur de mathématiques qui, en se présentant à ses collègues, se déclare “prof de tables de multiplications”! C'est assez dire le niveau de cette 4° où, d'évidence, les acquis des années antérieures sont nuls! D'ailleurs, on n'entend jamais François Marin parler de littérature, ce qu'il devrait quand même faire! Chacun de ses cours n'est qu'un long et pénible débat, par ailleurs oiseux et sans méthode, avec ses élèves, sur tout et n'importe quoi... Et on se demande bien ce qu'ils peuvent en retirer.
Quatrième constat : L'organisation d'une société à laquelle l'école est censée préparer inclut l'ordre. Le professeur devrait incarner l'autorité et, à l'évidence, ne le fait pas puisque non seulement il accepte, au nom sans doute de la dialectique, un dialogue qui se révèle stéril avec des élèves inconsistants dont on comprend vite qu'ils sont ici pour passer le temps, mais surtout perd son sang-froid et se met lui-même dans une position difficile à tenir. Le spectateur sent bien que l'autorité dont est censé être revêtu le chef d'établissement, et à travers lui l'école, ne peut rien face à la mauvaise volonté des élèves. La décision du Conseil de discipline prononçant l'exclusion de Souleymane est révélatrice. Il sera explusé de France [on devine son avenir] et paiera seul ce qui n'était qu'un dérapage partagé né de l'insolence constante de cette classe, mais aussi du manque d'autorité du professeur. [Le spectacteur aurait sans doute espéré davantage de mensuétude dans le prononcé de cette sanction!]
Cinquième constat : Ce fim montre bien bien que ceux qui sont irrévérencieux sont noirs ou d'origine maghrébine, les blancs et les jaunes méritent félicitations et encouragements, ce qui correspond bien à l'image [malheureuse] de notre société multiraciale pour laquelle l'école veut être une chance d'intégration, ce qu'en réalité elle est rarement! C'est la mère de Souleymane qui présente, dans sa langue, ses excuses personnelles au nom de son fils pour éviter l'exclusion que celui-ci semble maintenant accepter comme une fatalité. Double constat d'échec en matière d'éducation, celui de l'école certes, mais aussi celui de la cellule familiale.
Sixième constat : la faillite de l'école mise en évidence par les dernières secondes du film. Cette séquence pose question. Une élève qu'on n'a pas vue pendant le long métrage, c'est à dire qu'elle ne s'est signalée ni par son insolence ni par son assiduité, vient avouer simplement “qu'elle n'a rien appris pendant l'année”! On suppose qu'elle s'est également ennuyée dans les classes précédentes. C'est là un constat des plus alarmants remettant en cause le fondement même de l'enseignement et, au-delà, de notre société.
Septième constant : à mon avis, le rôle d'un professeur de Français, surtout en 4°, est de donner envie à ses élèves de lire. Cela ne me semble pas évident au vu de ce film, nonbstant l'épisode du jounal d'Anne Frank. Je voudrais cependant souligner que l'allusion d'Esméralda à “La République” de Platon, qu'elle dit avoir lu avec intérêt me semble un peu artificiel face à l'image qu'elle a donné d'elle. Soit c'est faux et c'est dommage, soit c'est vrai et François Begaudeau, l'auteur du roman qui a servi de prétexte à ce film, n'a plus qu'à changer de métier, ce que je crois, il a fait.
J'observe enfin qu'un débat s'instaure entre les élèves sur la nationalité française et qu'Esméralda déclare n'être pas fière d'être française. Pourtant, j'imagine que ses parents, eux, ont beaucoup souffert pour cela et ne doivent pas renier leur choix!
Un film est une oeuvre d'art. Le rôle d'un artiste n'est pas seulement de créer, c'est à dire de réaliser une fiction, c'est aussi de porter témoignage de son temps. De ce point de vue, Laurent Cantet remplit son rôle, d'autres cinéates l'ont fait également avec talent, même si ce témoignage est nécessairement partiel, voire partisan. En tout cas, son film ne laisse pas indifférent. C'est là un documentaire plus qu'une oeuvre de création, mais je continue de penser et même d'espérer que l'école reste globalement un moyen d'éducation, voire d'intégration et un des fondements de notre société.
© Hervé GAUTIER - Septembre 2008.
-
Bienvenue chez les Ch'tis - Un film de Dany Boon.
- Le 29/03/2009
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°321– Décembre 2008
Bienvenue chez les Ch’tis – Un film de Dany Boon.
Dans ma mémoire cinématographique de plus en plus mauvaise le personnage du facteur avait acquis ses lettres de noblesse grâce à Jacques Tati.
Le nord, que je ne connais toujours pas et où je n’ai jamais mis les pieds restera définitivement évoqué par la chanson de Pierre Bachelet autant que par celle du plus que méridional Enrico Macias et celle de Jacques Brel, évidemment ! C’est que j’ai depuis toujours mes racines au sud de la Loire, cette frontière qui coupe inégalement la France en deux à bien des points de vue… et je dois dire que, ne serait-ce que du point de vue climat, cela me va bien ! Bref, sans l’exagération viscérale de Michel Galabru, cette région, pour moi, c’était un peu cela !
Ce film fait un peu dans les idées reçues. Les facteurs alcooliques, il y en a partout, c’est même plus qu’une institution. Cela pourrait nourrir la velléité de certains technocrates désireux de supprimer le Service Public. Après tout, François, le préposé-héros de « jour de fête » n’était pas vraiment sobre. Quant au décor, les corons, les terrils, les pavés et les champs de betteraves… Tout cela n’était pas vraiment attirant. L’épisode de Bergues, l’ancienne ville minière, le montre bien !
Reste la chaleur humaine, le sens de l’accueil, le sens de l’hospitalité traditionnel et proverbiale, cela j’en avais entendu parler.
Le film, en fait une somme de gags, c’est l’histoire un peu banale d’un receveur des Postes du Midi qui, à la suite d’un subterfuge grossier qui se retourne contre lui, se retrouve muté disciplinairement et pour deux ans dans le département du Pas-de-Calais. Il y arrive « à reculons », comme on pénètre à regret dans un territoire étranger dont on ne connaît ni la langue, ni les coutumes, ni les habitudes culinaires, ni même les autochtones qu’on prend un peu pour des extra-terrestres. Forcément, quand on vient du pays du soleil, le ciel plombé et les températures hivernales en dessous de 0, cela n’attire guère ! Tout cela fait de lui un « célibataire géographique » dont la Fonction Publique a le secret.
Pourtant, il doit bien y avoir une alchimie dans ces contrées éloignées et soi-disant inhospitalières puisque, le moment d’acclimatation passé, celui qui avait peur de s’ennuyer non seulement ne voit plus le temps passer mais surtout va avoir recours à des grossières idées reçues pour décourager son épouse de le rejoindre. Cela se fait pourtant et elle aussi tombe sous le charme, et cela dure trois ans. Enrico qui s’y connaissait n’a pas dit autre chose « Les gens du nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor…ont dans le cœur le soleil qu’ils n’ont pas dehors »… Mais ils repartent vers le sud, parce que, même s’ils finissent par aimer cette région… ils la quittent, même si c’est avec beaucoup de regrets! « Quand un étranger vient vivre dans ch’nord, il brait deux fois : quand il arrive et quand il repart ». Dont acte !
Ce que je retiens, ce n’est pas tant le côté comique indéniable, mais le côté humain, l’émotion aussi, parce que cela reste, à mon sens, un film bouleversant comme l’est la dernière image, Kad Mourad au bord des larmes tombant dans les bras de Dany Boon. Il n’y a plus de rapports hiérarchiques entre les hommes au contraire, il naît même entre eux une complicité authentique.
C’est peut-être moins marquant, mais une des dernières phrases adressées par un agent des Postes à son directeur sonne quand même comme un reproche, non seulement il part mais, lui aussi est bien comme les autres, il vient ici pour faire sa carrière puis, la mutation ou l’avancement obtenus, il s’en va. Et le charme tissé par cette histoire, la complicité sont rompus.
C’est un véritable hymne à sa région que nous offre Dany Boon, mais c’est aussi l’invitation pour chacun d’entre nous à aimer l’endroit où il vit, parce que nous avons la chance d’habiter un beau pays aux multiples visages que bien des gens nous envient. On le savait déjà, mais il n’y a pas que Paris en France ! C’est une façon de voir le bon côté des choses, l’invitation à rire de soi, même si on n’est jamais très loin de la caricature, une manière d’être tolérant, et cela, ça me plaît bien ! Quoi d’étonnant qu’au palmarès des hommes de l’année Dany Boon, qui a reçu chez lui une ovation digne des joueurs de foot vainqueurs de la coupe du Monde, passe devant tout le monde, hommes politiques compris !
Alors, merci Biloute !
Hervé GAUTIER – Décembre 2008.http://hervegautier.e-monsite.com
-
INDIGENES. – Un film de Rachid BOUCHAREB.
- Le 29/03/2009
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°259- Octobre 2006
INDIGENES. – Un film de Rachid BOUCHAREB.
Je vais encore une fois déroger au but de cette revue, celui de la chronique culturelle, encore que nous n’en sommes malgré tout pas très loin avec ce film que je n’ai pas encore vu mais qui sera peut-être l’occasion d’un compte rendu de ma part.
Ce qui m’amène à réfléchir aujourd’hui, c’est moins cette actualité cinématographique que les conséquences qu’elle sous-tend dans le monde politique, dans le quotidien et dans l’évolution des mentalités.
L’histoire de notre pays a été mouvementée et l’étude qui nous en est proposée, notamment dans les manuels scolaires, présente d’inquiétantes zones d’ombre, souvent de pieux mensonges, parfois même des contre-vérités affligeantes. Il y a aussi de nombreux silences qu’on peut allègrement mettre sur le compte du nécessaire allègement des programmes scolaires trop chargés. Heureusement la presse, les livres, le cinéma, la télévision… sont là pour rétablir sinon un semblant de vérité, à tout le moins pour éclairer nos connaissances d’une autre lumière.
Même s’il ne saurait être question de battre sa coulpe pour les erreurs du passé, comme cela fut mis à la mode il y a peu, il n’en reste pas moins que la vérité officielle doit bien souvent être gommée ou carrément remise en question. Ainsi, les gens qu’on appelait maladroitement « indigènes » et à qui on avait enseigné, dans les écoles de la République, malgré leur origine africaine et la couleur de leur peau, que leurs ancêtres étaient grands, blancs et blonds, furent-il enrôlés en masse pour défendre la France (la « mère-Patrie ») qu’ils ne connaissaient pas, contre le nazisme. Le pouvoir politique de l’époque qui ne les tenait pas en grande considération et regroupait cette entité géographique sous le vocable « Colonies », su cependant se souvenir d’eux dès lors qu’il s’est agi de défendre le territoire national. Il est vrai que, lors de la Première Guerre Mondiale, leurs parents avaient eux aussi servi de « chair à canon » sans pour autant que les manuels scolaires, ni même les monuments aux morts se souviennent de leur sacrifice.
Depuis Clemenceau, ceux qui ont défendu le pays ont « des droits sur nous » et il est légitime de rétribuer sous forme de pensions, ceux qui ont fait, pour leur pays le sacrifice de leur jeunesse, sauf que ces droits étaient jusqu’à présent appréciés différemment suivant la couleur de la peau ou l’origine ethnique des bénéficiaires. Cette doctrine a fait naître des disparités criantes entre ceux qui, selon qu’ils étaient Français ou « Indigènes », ont cependant également défendu le territoire et la liberté.
Ce film arrive donc à temps pour effacer cette injustice, encore qu’il était temps car beaucoup d’entre eux sont morts sans avoir pu constater cette marque de reconnaissance. Je pense même qu’il tombe bien, après le douloureux épisode de banlieues en flammes, car tout est lié, comme tombe bien aussi l’émotion du Président de la République qui se souvient ainsi d’une promesse électorale qui trouvera ainsi et tardivement un commencement d’exécution. Il était temps ! Pourtant, il y a d’autres combattants qui attendent encore ce genre de reconnaissance, les Harkis par exemple, qui, au moment des évènements d’Algérie, ont fait le choix de la France…
Il y a une autre réflexion que cela m’inspire. C’est que dans notre pays, il faut des comédiens, des amuseurs publics, souvent eux-mêmes issus de l’immigration, pour faire changer les mentalités, faire évoluer les choses et que le monde politique, décidément sourd et aveugle aux problèmes quotidiens des plus défavorisés, en prenne soudain conscience et accepte d’y porter remède. Ce fut naguère Coluche, lui-même enfant d’immigrés italiens qui s’émut que dans un pays riche, il puisse encore y avoir des gens qui meurent de faim. Il contribua non seulement à des mesures fiscales en faveur des plus pauvres mais déclencha aussi un vaste élan de solidarité. C’est maintenant Djamel Debbouze qui incarne, par le truchement d’un rôle dans ce film, un des ces « indigènes » qui se sont battus pour notre liberté sous l’uniforme français. J’observe aussi qu’au moment ou le pouvoir politique de tout bord est plus soucieux de distribuer des prébendes et des avantages aux nantis, ce sont des baladins, singulièrement issus de l’immigration , à qui revient le rôle de susciter une amélioration du sort des plus défavorisés.
Une autre réflexion me vient à l’esprit et qui me rassure. La France, davantage que les Etats-Unis dont on nous a rebattu les oreilles avec le « Melting pot », reste un pays d’immigration, d’intégration, de tolérance, une société multiraciale qui se nourrit de ces différences. Elle y puise davantage de raisons de s’enrichir et de grandir que de craindre pour sa sécurité ou pour sa survie.
© Hervé GAUTIER. http://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg