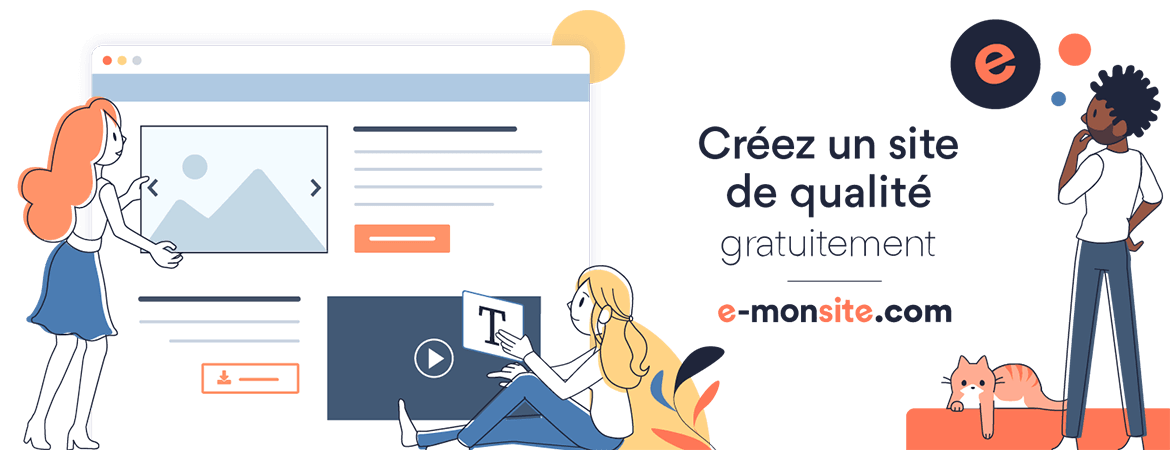Marguerite DURAS
-
Ecrire
- Le 28/03/2024
- Dans Marguerite DURAS
- 0 commentaire
N°1855 – Mars 2024.
Écrire - Marguerite Duras. Gallimard.
C’est un livre, le dernier, publié en 1993, dans lequel Marguerite Duras au crépuscule de sa propre vie, revient sur son activité et son rôle d’écrivain, sur cette action d’écrire, une réflexion sur sa spécificité, sur la genèse et la nécessité pour elle de l’écrit.
J’ai toujours lu Duras avec en tête cette citation de l’Amant « Je n'ai jamais écrit, croyant le faire, je n'ai jamais aimé, croyant aimer, je n'ai jamais rien fait que d'attendre devant la porte fermée ». Ici elle note « Écrire, c’était la seule chose qui peuplait ma vie et qui m’enchantait… L’écriture ne m’a jamais quittée » C’était donc à la fois paradoxal et intéressant qu’elle s’explique sur ce qui a été toute sa vie. Elle égrène donc une série de remarques qui accompagnent, selon elle, la création d’un texte, l’importance du silence, la nécessité de s’écouter soi-même parce qu’écrire c’est se parler, c’est une sorte de soliloque même si la composition d’un livre peut durer des années. Écrire, comme elle le dit, c’est parler mais aussi rester silencieux, c’est « hurler sans bruit », pratiquer une sorte de non-écriture faite de non-dits, de révoltes muettes. La solitude aussi est essentielle. Elle peut être de deux natures, non seulement la solitude, physique et même morale qui résulte d’une souffrance ou d’une volonté délibérée, mais aussi la confrontation individuelle et intime face à la page blanche qui est ainsi le témoin privilégié de l’expression de la pensée, du message. Pourtant la présence d’amis, d’amants, lui est indispensable. C’est aussi un paradoxe car c’est dans le silence et la solitude que le créateur, conçoit, donne vie à ses personnages. Il a avec eux une relation privilégiée faite de volonté de les guider mais aussi il y a, de leur part, des velléités de liberté. La qualité d’un livre vient aussi de cette lutte intime entre eux. Elle insiste sur les lieux choisis dans lesquels peut éclore l’écriture. Il lui faut une maison et personne autour d’elle, des images et des sons lointains de la campagne ou de la mer et c’est dans un lieu d’exception et son environnement immédiat, son parc, ses arbres, sa lumière, dans cette sorte de microcosme ainsi crée et coupé du monde extérieur qu’elle s’enferme volontairement et que naîtra le livre qu’elle porte en elle, un peu comme un accouchement. Il lui faut des rituels, la quiétude de la nuit, la présence d’un amants, peut-être l’alcool comme un autre paradoxe qui l’aide sans doute non seulement à supporter la vie mais aussi à faire sortir les mots du néant, à apprivoiser son inspiration, c’est à dire qui lui permet d’écrire mais, autre contradiction, c’est avec l’écriture qu’elle combat ce fléau. Il lui faut tout cela parce que le souffle créatif est exigeant, capricieux aussi et on se doit d’y être attentif et même disponible, parce que si on ne cède pas à la sollicitation nocturne des mots, des images, tout cela est happé par le néant et une telle vibration ne se représentera plus. C’est un combat contre soi-même parce qu’on écrit toujours pour exorciser une douleur intime, c’est aussi une folie parce qu’on n’est jamais sûr du résultat et qu’il y a des chances pour que cela ne serve à rien
Une telle réflexion sur soi-même pleine de contradictions, cette sorte de confession, s’agissant d’un écrivain de la stature de Marguerite Duras, est important pour chacun d’entre nous et spécialement pour ceux (et celles) qui ont fait de l’écriture un des centres d’intérêt importants de leur vie. A titre personnel, j’ai toujours respecté les livres et ceux qui les écrivent parce que cette démarche n’est jamais innocente. Derrière les mots il y a un travail, des souffrances, de l’espoir et plus souvent du désespoir, un témoignage pour échapper à l’oubli, à la mort . Cela mérite le respect et de l’attention même si je ne partage rien de leur voyage.
-
Le vice consul
- Le 16/03/2024
- Dans Marguerite DURAS
- 0 commentaire
N°1851 – Mars 2024.
Le vice-consul – Marguerite Duras- Gallimard.
Ce roman est raconté par un narrateur anonyme et par l’écrivain Peter Morgan mais c’est avant tout une galerie de portraits. Nous sommes à Calcutta en 1930 au début de la mousson et l’ombre d’une mendiante plane sur tout ce récit. Cela correspond à un épisode obsédant dont Marguerite Duras a été le témoin dans sa jeunesse, la vente de son enfants par une femme trop pauvre pour le nourrir. La mendiante se mêle aux lépreux de Calcutta où se termine son long et misérable voyage à pied.
Le vice-consul ensuite, c’est à dire le consul en second , Jean-Marc de H., individu solitaire, précédemment en poste à Lahore, déplacé à Calcutta dans l’attente d’une nouvelle affectation. Cette mesure, de nature disciplinaire, lui a été imposée pour avoir ouvert le feu sans raison sur des lépreux dans les jardins de Shalimar. Il a reconnu les faits mais ne les explique pas. L’ambassadeur Stretter est en charge de ce dossier difficile que défend sans grandes convictions Charles Rossett.
Personnage mystérieux que ce vice-consul, esseulé certes mais surtout différent des autres européens dans cette région de l’Asie. Il parle beaucoup, surtout quand il est saoul et prétend être vierge, c’est à dire que malgré ses quarante ans il n’a jamais touché une femme. Il est surtout fasciné par Anne-Marie Stretter, l’épouse de l’ambassadeur de France. Je me suis demandé pourquoi cette femme était à ce point fascinante. Plus jeune que son mari qui était conciliant, elle le suivait dans ses différents postes et sa situation d’épouse lui donnait une aura particulière qui s’ajoutait à sa beauté et à son maintient qui la faisaient être le point de mire de tous les hommes. Ils la regardaient avec l’envie de la posséder parce que c’est souvent ainsi que réagissent les mâles. Ils le faisaient d’autant plus aisément que sa réputation la précédait, celle d’une femme qui, lorsqu’elle croisait un homme jeune et inconnu, n’avait de cesse que de le mettre dans son lit pour une unique étreinte, une femme libre face à un mari complaisant et résigné, écrivain frustré qui a cessé d’écrire sur les injonctions de son épouse, désireuse sans doute qu’il ne lui vole pas la vedette, d’autant que ses rides commencent à se voir sous le fard et que, l’ennui s’insinue dans sa vie malgré ses toquades et les réceptions arrosées de l’ambassade. Il a obéi parce qu’il est désireux de la garder auprès de lui pour le rassurer. C’est la deuxième femme de ce roman et elle entretient cette cour autour d’elle. Cela la flatte d’être ainsi entourée d’hommes. C’est donc de cette femme que le vice-consul a entraperçue de loin au début et dont il est épris mais une bonne dose de timidité le fait se tenir loin d’elle qui attendrait sûrement autre chose à l’exception d’une danse. Il s’en tiendra au fantasme qu’elle lui inspire, en souffrira sans pouvoir faire autrement et pourtant il a une réelle attirance pour elle. Pour ma part je le tiens pour un personnage relativement secondaire contrairement à ce que le titre laisserait à penser. Il est, administrativement un agent secondaire ce qui répond à son rôle auprès d’Anne-Marie. Pour moi le vrai personnage de ce roman est Anne-Marie Stretter, à la fois complexe et contradictoire qui est entourée d’une sorte de halo de mystère puisqu’à son sujet on ne sait pas autre chose que des on-dits..
Charles Rossett est un jeune fonctionnaire nouvellement arrivé et qui, évidemment fait partie des adorateurs d’Anne-Marie et deviendra comme d’autres peut-être un de ses éphémères amants ? De cela nous ne sauront rien tout comme de cette sordide affaire qui a valu au vice-consul son déplacement à Calcutta. Il devrait sans doute y avoir une enquête judiciaire mais on n’en parle même pas. Tout cela m’a laissé un peu sur ma faim tout comme le style que je ne goûte guère. C’est sans doute l’émanation des thèmes chers au « Nouveau roman » qui a voulu remettre en cause les bases traditionnelles du roman classique.
-
La vie matérielle
- Le 10/03/2024
- Dans Marguerite DURAS
- 0 commentaire
N°1848 – Mars 2024.
La vie matérielle – Marguerite Duras- Gallimard.
La quatrième de couverture m’interpelle. L’auteure nous présente ce livre comme n’en étant pas un. D’ordinaire, quand je choisis un ouvrage, j’aime qu’il ait du sens, mais après tout pourquoi pas et j’aime aussi beaucoup être étonné.
Au fil de ma lecture je m’aperçois que Marguerite Duras nous parle surtout d’elle à travers un texte confié à Jérôme Beaujour. Pourquoi pas et nombre d’écrivains de renom tels que Philippe Besson, Patrick Modiano, Annie Ernaux, ces deux derniers nobélisés, n’ont pas fait autre chose. Le danger est bien évidemment le solipsisme de l’ écrivain, mais bien peu ont échappé à ce travers. J’ai donc lu ce livre qui n’en est pas un, cette « vie matérielle », cet « aller et retour entre moi et moi, entre vous et moi-même » comme elle le dit elle-même.
L’ouvrage refermé, il m’a semblé que je venait de lire un amalgame de textes courts qui correspondent à des moments de sa vie, de ses réflexions, une sorte de journal si on veut le caractériser ainsi et qui emprunte à ce mode d’expression informatif son style brut sans beaucoup de recherches littéraires. Un peu en vrac, elle nous parle donc d’elle, de ses livres, le l’alcool, de l’Indochine, de la douleur, de la mort, de la solitude, de l’écriture et de des paradoxes de cet exercice, de l’inspiration et de ses manifestations, de l’intimité qui existe entre un auteur et les personnages qu’il a crées et qu’un lecteur, même attentif ne pourra jamais connaître. Elle évoque le souvenir des ses amours, de ses amants, dont évidemment Yann Andréa, de ses films, des maisons où elle a habité, de sa mère, des écrivains qu’elle a connus et d’autres qu’elle a admirés, des hommes et des femmes, du désir, du fantasme, de sa folie aussi. J’ai eu l’impression qu’elle voulait tout dire d’elle, ne rien cacher, un peu comme si elle ressentait ce besoin de se confier… ou de parler d’elle tout simplement, comme s’il était nécessaire que son lecteur soit informé de tout ce qui la concerne, jusque dans les moindres détails … ou peut-être une volonté d’ajouter un titre supplémentaire à sa bibliographie personnelle…
Je ne suis pas un admirateur inconditionnel de Marguerite Duras mais je la lis par curiosité, pour pouvoir m’en faire une idée parce qu’elle fait partie du paysage littéraire.
-
Dix heures et demie du soir en été
- Le 05/03/2024
- Dans Marguerite DURAS
- 0 commentaire
N°1846 – Mars 2024.
Dix heures et demie du soir en été – Marguerite Duras – Gallimard.
Pierre, Maria, leur fille Judith et Claire, l’amie du couple sont en route pour l‘Espagne à destination de Madrid. En chemin ils font halte dans une petite ville à cause de la chaleur. Au bar de l’hôtel où ils sont descendus, il n’est question que du crime qui vient d’être commis : Rodrigo Palestra a tué sa femme en même temps que Tony Perez et a disparu. On comprends très vite qu’il s’agit d’un crime passionnel parce que la femme de Rodrigo n’était pas ce qu’on appelle un modèle de fidélité et de vertu. Maria écoute cette histoire pendant l’orage tout en sirotant de la manzanilla. On ne tarde pas à apprendre que Pierre et Claire sont amants et que Maria connaît cette liaison. Jusque là il n’y a pas vraiment d’originalité. Était-ce la nuit, la pluie chaude de l’orage, les verres d’alcool, Maria croit reconnaître la forme d’un corps sur le toit en face de l’hôtel et s’imagine que c’est celui du meurtrier. Demain il sera trop tard et il sera pris . Dès lors elle qui ne dort pas se met en tête de le sauver des patrouilles qui le cherchent, de l’aimer peut-être ? Un adultère avéré contre un autre fantasmé. Elle erre dans la ville, l’aide à en sortir.
j’ai apprécié les descriptions, les effets de l’alcool sur Maria, les étapes de son inconscience, de son rêve fou, de sa complicité complexe avec Pierre et Claire, de la chaleur, de son attirance pour l’inconnu, le danger, de la fin d’une histoire d’amour et de la prise de conscience d’une autre inconsciemment refusée et peut-être déjà ancienne, vouée sans doute elle aussi à l’échec, parce que les choses ne sont pas immuables, Pour le reste...
-
L' amante anglaise
- Le 04/03/2024
- Dans Marguerite DURAS
- 0 commentaire
N°1845 – Mars 2024.
L’amante anglaise – Marguerite Duras – Gallimard.
Le roman s’inspire d’une histoire vraie malgré tout assez classique, une femme qui assassine son mari. Ce qui l’est moins c’est qu’elle le dépèce et précipite les restes dans les trains du haut d’un viaduc. Ici le ce thème est un peu transformé et tourne autour de trois personnages, Claire Lalanne qui assassine sa cousine Marie-Thérèse Bousquet, une sourde et muette qui sert de domestique au couple qu’elle forme avec son mari, Pierre, et à l’insu de ce dernier.
D’emblée Claire se dénonce comme l’assassin et est donc arrêtée. On sait donc depuis le début qui a tué, reste à savoir pourquoi. Le roman cherche une réponse à cette question à travers trois entrevues. Un tiers, journaliste ou plus sûrement policier, interroge Robert Lamy, le patron du bistrot de Viorne, le village où vivent les Lalanne, sur les relations du couple avec Marie-Thérèse. Un autre entretien a lieu entre ce tiers et Pierre cherchant à cerner la personnalité de Claire qu’il considérait comme une folle et d’expliquer son geste, un troisième se fait avec Claire. De ces trois investigations il ne ressort vraiment rien si ce n’est une relation amoureuse ancienne et passionnée entre Claire et un homme et qu’elle regrette.
Je ne me suis pas passionnée pour ce roman, tout entier dialogué. Ce que je retiens c’est l’échec du mariage qui débouche sur la solitude des époux et la folie de Claire. Je n’ai pas compris le titre non plus, si ce n’est le jeu de mots (la menthe anglaise – l’amante anglaise !)
-
C'est tout
- Le 02/03/2024
- Dans Marguerite DURAS
- 0 commentaire
N°1844 – Mars 2024.
C’est tout– Marguerite Duras – P.O.L.
Ce petit livre assez déroutant est dédié à Yan Andrea qui fut son dernier compagnon. C’est un ensemble de textes datés d’octobre 1994 à août 1995 rédigés en partie à son domicile parisien, en partie à Neauphle-le-château. C’est soit un dialogue entre Marguerite Duras et Yan Andrea Steiner avec une alternance de vouvoiement et de tutoiement, et un monologue un peu décousu. Au cours de leurs échanges, elle mentionne son prochain livre où elle parle « d’un homme de 25 ans tout au plus, c’est un homme très beau ». « Vous devenez beau, je vous regarde, vous êtes Yan Andrea Steiner ». Elle parle de la beauté de ses mains et c’est un détail auquel elle paraît particulièrement sensible et qui revient notamment dans « L’amant de la Chine du Nord ». Il s’agit probablement de lui puisqu’elle lui consacre effectivement un livre « Yan Andrea Steiner »
Ce que je retiens c’est la déclaration d’amour qu’elle fait à cet homme, un écrivain plus jeune qu’elle, malgré ou peut-être à cause de leur trente-huit ans de différence. « J’ai voulu vous dire que je vous aimais. Le crier, c’est tout » un peu comme si, comme le suggère le titre, tout était dit ainsi. Elle souhaite sa présence auprès d’elle « J’espère te voir à la fin de l’après-midi », une présence sensuelle qui n’a rien de platonique « Donne-moi ta bouche », « Caressez-moi, venez dans mon visage avec moi, vite, venez », « Viens dans mon visage », comme s’il y avait urgence. Il est sa source d’inspiration « Tout a été écris par toi, par ce corps que tu as » Avec un regret cependant « Ne pas pouvoir être comme toi, c’est un truc que je regrette ». Il sera son dernier amant et c’est lui qu’elle chargera de son « testament littéraire ». Son œuvre est en effet une préoccupation pour elle et la trace qu’elle laissera, même si apparemment elle s’en défend « Vanité des vanités;Tout est poursuite du vent », « C’est moi la poursuite du vent ».
L’écriture fait essentiellement partie de sa vie non seulement parce que c’est son métier mais parce qu’elle ne pourrait pas vivre pleinement sans elle « Quand j’écris je suis de la même folie que dans la vie », « Écrire c’est à la fois se taire et parler » malgré tout, malgré la solitude « Je suis seule », la souffrance, les larmes. C’est qu’à travers Yan elle mesure pour elle le temps passé et l’imminence de la mort qu’elle attend et qu’elle craint. Elle se raccroche à ses courtes lettres comme si les mots tracés sur le papier étaient entre eux un lien, un baume « Viens dans ce papier blanc, avec moi » , elle sent l’imminence de la mort et décédera le 3 mars 1996. Elle fait allusion à son roman « La maladie de la mort », elle note « Je suis au bord de la date fatale » et tout au long de ce recueil cette crainte devient lancinante. Elle y mêle ses souvenirs de Chine, de ses amants, un peu comme si, à l’approche de la mort toute sa vie revenait à sa mémoire.
La mort est une obsession pour elle mais ce que je retiens c’est l’amour qui la lie à Yan Andrea où se mêlent sensualité, écriture, passion, solitude et influences artistiques réciproques. .
-
C'est tout
- Le 02/03/2024
- Dans Marguerite DURAS
- 0 commentaire
N°1844 – Mars 2024.
C’est tout– Marguerite Duras – P.O.L.
Ce petit livre assez déroutant est dédié à Yan Andrea qui fut son dernier compagnon. C’est un ensemble de textes datés d’octobre 1994 à août 1995 rédigés en partie à son domicile parisien, en partie à Neauphle-le-château. C’est soit un dialogue entre Marguerite Duras et Yan Andrea Steiner avec une alternance de vouvoiement et de tutoiement, et un monologue un peu décousu. Au cours de leurs échanges, elle mentionne son prochain livre où elle parle « d’un homme de 25 ans tout au plus, c’est un homme très beau ». « Vous devenez beau, je vous regarde, vous êtes Yan Andrea Steiner ». Elle parle de la beauté de ses mains et c’est un détail auquel elle paraît particulièrement sensible et qui revient notamment dans « L’amant de la Chine du Nord ». Il s’agit probablement de lui puisqu’elle lui consacre effectivement un livre « Yan Andrea Steiner »
Ce que je retiens c’est la déclaration d’amour qu’elle fait à cet homme, un écrivain plus jeune qu’elle, malgré ou peut-être à cause de leur trente-huit ans de différence. « J’ai voulu vous dire que je vous aimais. Le crier, c’est tout » un peu comme si, comme le suggère le titre, tout était dit ainsi. Elle souhaite sa présence auprès d’elle « J’espère te voir à la fin de l’après-midi », une présence sensuelle qui n’a rien de platonique « Donne-moi ta bouche », « Caressez-moi, venez dans mon visage avec moi, vite, venez », « Viens dans mon visage », comme s’il y avait urgence. Il est sa source d’inspiration « Tout a été écris par toi, par ce corps que tu as » Avec un regret cependant « Ne pas pouvoir être comme toi, c’est un truc que je regrette ». Il sera son dernier amant et c’est lui qu’elle chargera de son « testament littéraire ». Son œuvre est en effet une préoccupation pour elle et la trace qu’elle laissera, même si apparemment elle s’en défend « Vanité des vanités;Tout est poursuite du vent », « C’est moi la poursuite du vent ».
L’écriture fait essentiellement partie de sa vie non seulement parce que c’est son métier mais parce qu’elle ne pourrait pas vivre pleinement sans elle « Quand j’écris je suis de la même folie que dans la vie », « Écrire c’est à la fois se taire et parler » malgré tout, malgré la solitude « Je suis seule », la souffrance, les larmes. C’est qu’à travers Yan elle mesure pour elle le temps passé et l’imminence de la mort qu’elle attend et qu’elle craint. Elle se raccroche à ses courtes lettres comme si les mots tracés sur le papier étaient entre eux un lien, un baume « Viens dans ce papier blanc, avec moi » , elle sent l’imminence de la mort et décédera le 3 mars 1996. Elle fait allusion à son roman « La maladie de la mort », elle note « Je suis au bord de la date fatale » et tout au long de ce recueil cette crainte devient lancinante. Elle y mêle ses souvenirs de Chine, de ses amants, un peu comme si, à l’approche de la mort toute sa vie revenait à sa mémoire.
La mort est une obsession pour elle mais ce que je retiens c’est l’amour qui la lie à Yan Andrea où se mêlent sensualité, écriture, passion, solitude et influences artistiques réciproques. .
-
L'amant de la Chine du nord
- Le 01/03/2024
- Dans Marguerite DURAS
- 0 commentaire
N°1842 – Mars 2024.
L’amant de la Chine du Nord– Marguerite Duras – Gallimard.
Ce roman aurait été écrit en 1991 par Marguerite Duras après l’adaptation cinématographique qu’elle juge décevante par jean-Jacques Annaud de « L’amant » qui lui valut le prix Goncourt en 1984 et un succès mondial. C’est donc en quelque sorte une sorte de rectification qui apporte des précisions en vue d’un éventuel autre film avec des annotations précises pour sa réalisation.
Après de longues années passées, quand la vie avait repris son cours, il y avait eu cette communication téléphonique, ces quelques mots lointains de cet amant pleins de regrets, d’amour pour elle, cet oubli impossible . Ainsi veut-elle évoquer sa première histoire d’amour, celle qu’on n’oublie jamais. Ce sera « L’amant », le film d’un autre, puis ce livre. Elle est « l’enfant » et lui n’a pas de nom, sans doute pour insister sur l’aspect transitoire de cette aventure.
Elle se rend à Saïgon pour ses études et relate sa rencontre avec le Chinois élégant et plus vieux qu’elle, sur le bac qui traverse le Mékong, elle se décrit comme une jeune fille de seize ans, pauvre mais insolente, qui a des relations difficiles avec sa mère, un peu délaissée par elle. Il y a ce « coup de foudre » du Chinois qui la voit pour la première fois, l’accompagne dans sa belle voiture, la séduction rapide qui les amène dans sa garçonnière mais cela ne se résume pas à une longue aventure amoureuse et sensuelle. C’est le début de leur histoire et du désir réciproque qui les animent et qu’ils s’avouent. On apprend cette liaison parce évidemment tout se sait mais il n’y a pas de scandale parce que la mère est appréciée, reconnue par tous comme une bonne institutrice, généreuse, humaine. Il y a une grande complicité et une tolérance autour de cette relation autant au lycée qu’à la pension. Elle manque les cours et découche pour rester avec lui et il y a autour de cette relation une grande tolérance, voire une forme de complicité. Elle se confie à Hélène, une élève de la pension pour qui elle nourrit une passion amoureuse.
Ils ne font pas que s’aimer, ils parlent d’eux librement, rient ensemble, se racontent leur histoire, évoquent l’avenir quand ils seront séparés. Ils le savent parce qu’en Chine il y a des traditions autour du mariage. Son amant est fiancé à une jeune fille plus jeune, ailleurs et qu’il doit épouser sinon il perd sa généreuse dot et son père le déshérite, et puis un Chinois n’épouse pas une blanche. Elle devra repartir pour la France qu’elle ne connaît pas, tourner la page. Leur amour est sans lendemain, mais ils s’aiment. Dès lors les relations prennent un tour nouveau. Il y a des rencontres cordiales du Chinois avec la mère, ensemble ils parlent de l’amour qu’il porte à sa fille, de la souffrance et de la solitude qu’il ressent face à l’impasse de cette relation et que les larmes partagées, souvent versées, n’adoucissent pas, la peur pour la fille de tomber enceinte de son amant autant que l’espoir un peu fou d’avoir un enfant de lui pour peser sur:leur histoire, la prise en compte de la sordide misère de la famille, la volonté du Chinois de l’aider sans l’humilier, des projets d’aide financières pour le rapatriement. Et ce malgré le fils aîné plus intéressé que jamais. I ,
Donc beaucoup de différences par rapport au film qui n’était qu’une adaptation du roman, lui-même riche en nuances. Il y a l’ambiance, l’étude des personnages, les relations qui se tissent entre eux .Elle décrit l’atmosphère familiale dans cette école française au sud de l’Indochine en 1930. Le père est mort, sa figure est à peine esquissée, la mère, perturbée, désabusée, désespérée vivote comme elle peut, se méfie de son fils aîné Pierre, son préféré, imprévisible, cupide, voleur, profiteur et même violent et qu’elle songe à faire rapatrier. La préférence de la fille va à Paulo, l’autre fils plus jeune mais aussi à Thanh, le chauffeur dévoué à qui ce livre est dédié. Elle l’aime d’un amour authentique, impossible aussi. Tous sont plus ou moins destinés à terme à quitter ce décor .
Il y a toujours cette obsession de la mort qui me paraît prégnante dans ses romans, comme une fatalité parce que nous sommes mortels mais aussi une attirance face aux échecs de la vie, comme si elle devenait insupportable, parce qu’on ne peut pas revenir en arrière. Face à cet amour authentique et sans issue elle est la seule solution. La figure du père mort est lointaine, la mère préférerait que son fils aîné ne soit plus là mais son départ vers la métropole est pour elle un peu sa mort. Elle l’aime mais il met en péril le fragile équilibre de cette famille. Le Chinois voudrait bien que son père meurt...Le roman se termine sur le suicide d’un jeune passager, en haute mer.
Ce que je retiens dans ce livre c’est la volonté d’écrire ce pan de son histoire personnelle, parce qu’écrire c’est témoigner, c’est aussi un bonheur fou parce que la poésie y est mêlée, c’est à la fois un plaisir, une souffrance, une nécessité, peut-être une absurdité mais c’est aussi une victoire sur la mort.
J’ai longtemps, à titre personnel, nourri, une sorte de rejet de l’œuvre de Marguerite Duras. Cette relecture attentive me la présente sous un jour différent qui n’exclut cependant pas certaines incompréhensions.
-
Moderato cantabile
- Le 29/02/2024
- Dans Marguerite DURAS
- 0 commentaire
N°1842 – Février 2024.
Moderato cantabile – Marguerite Duras – Les éditions de Minuit.
« Moderato cantabile » (Chantant et modéré), c’est l’annotation musicale qui figure sur la partition que le jeune fils d’Anne Desbaresdes travaille pendant les cours privés de piano que lui dispense Mlle Giraud. L’enfant, malgré son grand talent s’obstine à ne pas comprendre le sens de cette note parce qu’il n’aime pas jouer. Il est toujours accompagné par sa mère, l’épouse du directeur des « Fonderies de la Côte » qu’on aperçoit dans ce quartier du port. Elle mène une vie bourgeoise et désœuvrée dans un secteur résidentiel à l’autre bout de la ville et vient à pied. L’appartement de Mlle Giraud est situé dans un immeuble au bas duquel il y a un café fréquenté par les ouvriers et les marins. Il fait beau et les fenêtres sont ouvertes. Lors d’une séance on entend un cri venant de l’estaminet, une femme vient d’y être assassinée et l’homme, son amant, qui l’a tuée est allongé sur elle. Il est embarqué par la police. Le lendemain Anne revient dans ce café après le cours et y rencontre un inconnu, Chauvin, qui la connaît ainsi que la maison où elle vit. Ils parlent du crime et l’inconnu prétend savoir la raison qui a déterminé la victime à demander à son assassin de la tuer. Apparemment cela intéresse Anne qui reviendra souvent rencontrer Chauvin avec qui elle se met à boire. Je m’attendais à une intrigue policière qui, sous la plume d’un grand écrivain, n’aurait pas manqué d’intérêt, mais ça s’arrête là.
Plus ils se rencontrent, plus Chauvin tient à Anne des propos personnels voire intimes sur sa maison, ses souvenirs, sa vie. On comprend qu’il a été ouvrier aux Fonderies et peut-être davantage. Il se rapproche d’elle, elle rentre de plus en plus tard chez elle sans que son mari, bizarrement absent, ne s’en offusque. Un soir où elle doit donner une réception chez elle, elle y arrive en retard et complètement ivre. Le lendemain elle retrouve Chauvin et apparemment choisit, malgré son appréhension, de quitter sa vie facile, de partir avec lui , simple passade ou décision définitive ? Cette toquade me paraît vouée à l’échec.
J’avoue avoir été un peu frustré par cette lecture, non que le style en soit désagréable bien au contraire, les phrases sont d’une lecture facile, mais je m’attendais à autre chose, une intrigue policière ou un roman psychologique autour de cette relation adultère... Il y a certes cette addiction de Duras à alcool qui peut favoriser l’inspiration mais peut être aussi la marque d’une certaine désespérance face à la vie, cette angoisse de la mort qui la hante depuis le décès de son père trahit peut-être une obsession plus intime, la solitude des personnages… Je ne vois rien là de chantant et de modéré.
Je connais mal le mouvement du «nouveau roman » dont a fait partie Marguerite Duras. Ce court texte en est sûrement une illustration.
Je souhaite noter ici une impression souvent suscitée par la lecture des romans de Duras. J’aime beaucoup l’ambiance qui se dégage des tableaux d’Edward Hopper et je la retrouve souvent sous sa plume. C’est au moins une compensation.
-
L'amour
- Le 28/02/2024
- Dans Marguerite DURAS
- 0 commentaire
N°1841 – Février 2024.
L’amour – Marguerite Duras – Gallimard.
Le titre est déjà tout un programme, c’est un thème classique qui a nourri l’œuvre d’ écrivains et de poètes depuis la nuit des temps. Il faut cependant se méfier des certitudes. Duras plante le décor sur une plage à marée basse. Un homme est debout, immobile sur un chemin de planches et il regarde la mer, un autre, plus éloigné marche au hasard sur le sable et, sur la gauche une femme est assise, les yeux fermés. On ne peut pas faire plus minimaliste comme décor, énigmatique aussi puisque la ville porte le nom de S.Thala, une ville où la lumière semble s’arrêter. Ils se croisent, se parlent, on finit par comprendre qu’ils se connaissent, qu’ils ont une histoire en commun et que la femme est enceinte. On imagine un triangle amoureux dans une chronologie assez confuse et une absence d’action.
J’avais déjà lu ce roman il y a de nombreuses années et je n’avais pas aimé à cause du style décousu qui ne me plaît guère et du scenario dont le sens m’avait échappé. Cette relecture ne m’a pas fait changer d’avis. Le livre refermé j’ai eu l’impression d’assister au tournage d’un film surréaliste dont les scènes et les dialogues sont réduits à une grande simplicité avec économie de mots et de gestes. La séquence du début me semble répondre à celle de la fin, avec, entre les deux un rêve que fait la femme. Comme dans un rêve les images se succèdent sans aucune logique. Il est question d’un hall d’hôtel, d’enfants, de prison, d’incendies dans la ville, de murs dont le nombre augmente, d’une lettre jamais envoyée… La constante idée de la mort me paraît en revanche pouvoir s’expliquer par le décès de son père et le vide qu’il a laissé. De même les incendies dans la ville peuvent faire référence à tout ce sa famille a perdu à l’occasion de sa succession et notamment sa maison de Duras destinés aux enfants d’un premier mariage. Quant à l’amour, je n’ai pas bien compris. J’ai consulté Lacan dont je ne suis pas spécialiste qui lie l’amour au hasard (Il écrit la mourre et non l’amour). Si je suis assez d’accord sur la réalité et sur le jeu de mots, ça n’éclaire pas beaucoup mes questionnements sur ce roman.
Je ne suis pas entré dans cette histoire et j’ai vraiment la désagréable impression d’être passé à côté de quelque chose.
-
L'été 80
- Le 27/02/2024
- Dans Marguerite DURAS
- 0 commentaire
N°1840 – Février 2024.
L’été 80 – Marguerite Duras – Les éditions de Minuit.
A l’invitation de Serge July, alors rédacteur en chef au journal Libération, l’auteure s’engage à rédiger une chronique au cours des mois de juin à août 1980. Après avoir hésité et devant l’insuccès de ses films et son absence de projets, elle accepte ce qui est pour elle une sorte de défit puisque July précise qu’il ne voulait pas qu’elle soit politique mais s’inscrive dans une actualité parallèle. Pour un écrivain qui n’est pas journaliste une telle proposition ne pouvait que la séduire mais son hésitation tenait au fait que l’acte d’écrire est forcément différent pour un chroniqueur et pour un romancier mais surtout peut-être que ses articles, imprimés sur « du papier d’un jour », soient lus puis jetés avec le journal lui déplaisait. Elle avait déjà écrit dans « L’illustration » à son retour d’Indochine et cela lui avait peut-être déplu de voir ses textes ainsi détruits après lecture. Elle a peut-être considéré qu’un texte dû à un écrivain méritait mieux que le destin éphémère d’un quotidien jetable et qu’il ne devait pas être perdu. Elle préféra donc la forme classique du livre et porta son manuscrit complet comportant dix articles aux Éditions de Minuit qui l’éditèrent en 1981, ajoutant du même coup un élément supplémentaire à sa bibliographie personnelle. Je me suis demandé si cette proposition n’arrivait pas à point nommé dans un parcours où l’écriture est une épreuve toujours recommencée. Écrire a toujours fait partie de sa vie mais c’est une discipline exigeante où l’inspiration n’est pas toujours au rendez-vous et qu’un hasard peut opportunément provoquer. C’est un long travail, parfois ingrat, souvent une souffrance et demande de la disponibilité. C’est aussi un besoin vital parce que, en tant qu’écrivain elle ne peut vivre, exister, sans écrire. Cela fait partie de son être. C’est un phénomène étrange que l’écriture, soit elle s’impose à l’écrivain, s’invite à travers sa solitude ou à l’occasion d’une rencontre, soit elle se dérobe à lui, parfois sans raison, parfois parce que les évènements extérieurs sont si révoltants ou si enthousiasmants que cela devient impossible et la page blanche impose son vide. Pourtant l’écriture transcende la mort et c’est un peu une victoire contre elle. Sans lire non plus, parce que les deux actes sont complémentaires et, devant le spectacle de la mer elle lit le livre dont elle nous dit qu’il n’est pas terminé. Alors je l’imagine dans sa maison de Trouville-sur-mer, tout simplement.
Il y a bien quelques allusions à l’actualité avec des remarques personnelles sur certains chefs d’État, des allusions historiques rapprochées de l’actualité, des mentions d’évènements alternativement rapportés soit comme des faits importants à ses yeux parce que la mort en fait partie, soit comme de simples faits divers et des considérations sur la vie, la banale marche du temps, le quotidien, les espoirs suscités, les pensées personnelles et politiques qu’elle exprime, Elle décrit le spectacle autour d’elle à travers les yeux de David, un enfant en colonie de vacances et cette évocation devient un conte où la Camarde n’est pas absente. Mais l’été c’est les vacances, le soleil, la plage avec ses planches et ses parasols, les estivants, les cerfs-volants, les enfants, le bruit de l’écume du flux et du reflux, la saveur salée des vagues, les rues vides écrasées de chaleur, les pétroliers au large du Havre ...C’est très différent de son Indochine natale, ce n’est pas la même lumière. Ce n’est pas vraiment un monde parallèle mais c’est plutôt une période entre deux parenthèses qu’on refermera à la fin de l’été.
Ce livres est dédié à Yann Andréa qui fut son dernier compagnon. A la fin du recueil, elle évoque à demi-mots la présence d’un amant auprès d’elle, peut-être lui ou peut-être pas?
Quand j’ouvre un livre de Marguerite Duras, je le fais toujours avec une appréhension mêlée de méfiance, je ne sais pas trop pourquoi, à cause du style sans doute. Je n’ai pas eu cette impression à la lecture de ce court recueil choisi au hasard. Peut-être une invitation à lire différemment ?
-
LA MALADIE DE LA MORT
- Le 28/09/2014
- Dans Marguerite DURAS
- 0 commentaire
N°806 – Septembre 2014.
LA MALADIE DE LA MORT - Marguerite DURAS - Les éditions de Minuit.
C'est une sorte de drame intime qui se déroule dans une chambre d'hôtel au bord de la mer entre une femme apparemment payée pour être là, pour se soumettre et un homme, incapable d'aimer et qui lui dicte ses volontés. Dans cette relation à la fois simple et compliquée il y a des rites. Tous les soirs, la femme arrive, se couche nue dans le lit de l'homme et elle s'endort. L'homme la regarde dormir. Ils parlent peu et cette absence de dialogue semble être aussi une règle édictée par l'homme à moins qu'il n'aime que le silence. Il lui arrive de lui faire l'amour mais apparemment c'est sans joie, un peu par hasard et quand la jouissance est au rendez-vous pour elle, il ne veut pas qu'elle le montre ni même qu'elle y fasse allusion. Ils ne savent rien l'un de l'autre et veulent continuer ainsi et l'absence de nom souligne cette notion impersonnelle. Il arrive à cet homme de ne pas la toucher, de la laisser dormir, de la regarder de loin et de pleurer. Il pleure sur lui, sur son incapacité à aimer les autres et les femmes en particulier. Apparemment cette femme n'est pas une prostituée, ou alors nous avons affaire à quelqu’un d’intellectuellement supérieur, mais cette relation est cependant tarifée ce qui ne manque pas d’ambiguïté. Je peux imaginer que cet homme invite cette femme à venir le rejoindre pour assouvir une passion autre que charnelle qui peut parfaitement être de nature fantasmatique ou purement intellectuelle. Quant à elle, l'auteur semble lui conférer un rôle « thérapeutique ». Elle aurait un diagnostique naturel : non seulement elle lui révèle qu'il est atteint de la maladie de la mort parce qu'il lui est impossible d'aimer mais aussi qu'elle a accepté de venir auprès de lui pour l'en délivrer. Cette maladie est mortelle « en ceci que celui qui en est atteint ne sait pas qu'il est porteur d'elle, de la mort. Et en ceci aussi qu'il serait mort sans vie au préalable à la quelle mourir, sans connaissance aucune de mourir à aucune vie » ». Veut-elle nous dire que la vie est une maladie mortelle ? Nous le savions déjà !
L'homme semble en effet être dans un état psychologique catastrophique et tente sans doute de s'en sortir par cette expérience qui paraît promise à l'échec mais qui est assurément la dernière avant sa mort qu'on peut entrevoir. Il me semble d’ailleurs que les draps dans lesquels repose la femme peuvent signifier une sorte de linceul, le sommeil peut-être regardé comme l'antichambre de la mort, les pleurs répétés de l’homme, évoquer le chagrin inspiré par une perte irrémédiable, la lumière à l'intérieur de la chambre évoquer pourquoi pas la lueur d'un tombeau. J'observe que la mer est noire mais sans majuscule, ce qui peut signifier qu'on est au bord de n'importe quel océan mais surtout que la couleur choisie veut rappeler le deuil. L'élément liquide quant à lui peut évoquer le passage vers autre chose, vers un autre monde que les mythologies ont souvent repris à leur compte. Ainsi l'idée de la mort est-elle incarnée alternativement par l'homme et par la femme mais à un certain moment il désire la tuer parce qu'elle incarne la vie, une vie qu'il ne peut atteindre ou qui se refuse obstinément à lui ! Les indications scéniques de la fin du roman peuvent être ainsi interprétées.
Une partie du texte est écrit au conditionnel surtout quand il s'agit de la femme, de sa conduite face à l'homme. L'auteur y mêle également le présent et interpelle son lecteur, le mettant à la place de l'homme. J'ai eu beaucoup de mal à sentir ce rôle. Quant à la rédaction, elle est hachée, difficilement lisible et ne procure pas, à mon avis une lecture agréable.
Je concède qu'il y a parfois des moments poétiques, surtout quand l'homme regarde avec crainte la nudité de la femme [« Vous regardez cette forme, vous en découvrez en même temps la puissance infernale, l'abominable fragilité, la faiblesse, la force invincible de la faiblesse sans égale »] mais son regard se fait obsessionnel quand il pose avec insistance ses yeux son son sexe et sur ses seins, ce qui trahit une sorte de refoulement. Cela se transforme évidemment en images érotiques mais avec une notion d'impossibilité. D'ailleurs il lui avoue qu'il n'a jamais regardé, désiré ni possédé ni bien sûr aimé une femme avant elle. Elle est en quelque sorte en elle-même une prise de conscience du mal que l'homme porte en lui et quand cela est formulé par elle, la chambre s'éclaire. A partir de ce moment, il y a entre eux une sorte d'échange, d'explication autour du concept de l'amour [« Vous demandez comment le sentiment d'aimer pourrait subvenir. Elle vous répond : peut-être d'une faille soudaine dans la logique de l'univers. Elle dit : par exemple d'une erreur. Elle dit : jamais d'un vouloir »]. Cela étant dit, elle disparaît sans espoir de retour, ne laissant qu'une empreinte froide dans les draps, mais le ciel pour l'homme s'éclaircit comme si le passage de cette femme dans sa vie, y compris dans sa dimension sensuelle et érotique, avait été une révélation et même une libération, une sorte de retour à la vie.
J'avoue que je n'ai jamais beaucoup aimé Marguerite Duras. J'ai toujours refusé de lui trouver du talent au seul motif que la presse spécialisée avait été soudain laudative, surtout après son prix Goncourt. Les romans successifs que j'ai lus d'elle m'ont laissé indifférent, tout comme celui-ci. Je n'ai peut-être rien compris, je suis peut-être passé à côté d'un chef-d’œuvre mais, même s'il peut m'arriver à moi aussi d'être dans un état un peu second, j'avoue qu'une lecture attentive de ce roman ne m'a pas procuré la moindre émotion. Était-ce une étude sur le fantasme masculin, le désir inassouvi, l'impossibilité de conquérir une femme, de la posséder autrement qu'en la payant, un rappel de la supériorité sensuelle et esthétique voire intellectuelle de la femme ? Peut-être ! Si c'était pour nous rappeler que nous sommes mortels, ce n'était pas la peine d'en faire tant. Si c'est pour nous dire qu'elle sentait sur elle l'ombre de la Camarde, là c'est parfaitement respectable, mais ce roman m'a laissé, un peu comme à chaque fois, un goût d'inachevé, de vide, de malaise. C'était sans doute son but ?
©Hervé GAUTIER – Septembre 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com