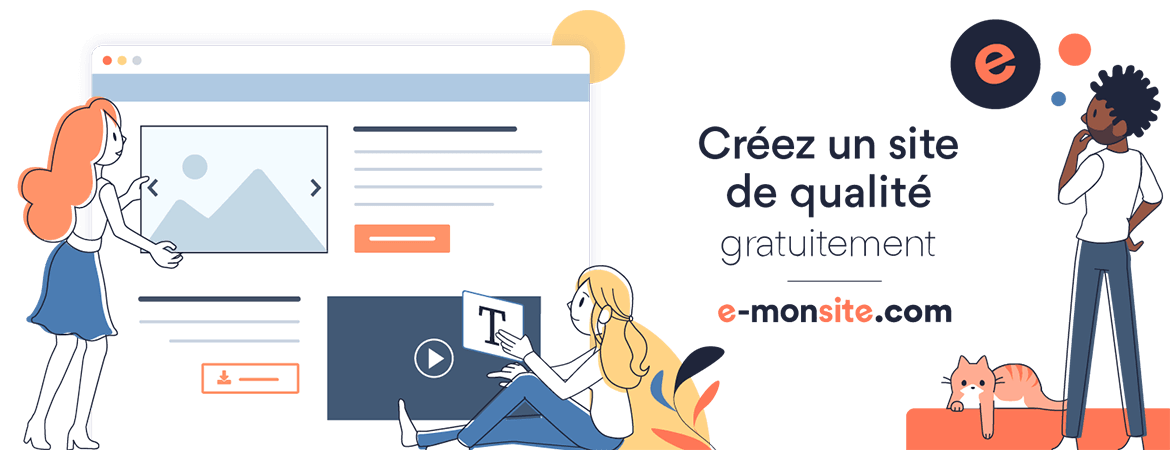Georges PEREC
-
La boutique obscure
- Par ervian
- Le 21/04/2016
- Dans Georges PEREC
- 0 commentaire
La Feuille Volante n°1033– Avril 2016
LA BOUTIQUE OBSCURE– Georges Perec - Gallimard. (année de parution 1973 chez Denoël)
D'emblée, le titre fait penser à Patrick Modiano (« Rue des boutiques obscures » paru en 1978) mais ce roman qui obtint le prix Goncourt en 1978, où le futur Prix Nobel se pose, comme dans toute son œuvre, ses éternelles questions sur lui-même, peut sembler n'avoir aucune connotation avec cet ouvrage de Perec qu'il suit de quelques années. Voire ! L'écriture, et plus généralement la création artistique, sont peu ou prou le résultat d'une introspection de leur auteur qui mène à une connaissance intime plus approfondie. Ici Perec, lui aussi, fait allusion à ses origines et aux obsessions qui en découlent, sa judéité, les camps de concentration et leurs horreurs, la traque de la police, les interdits imposés aux juifs sous l’occupation allemande, la dénonciation dont un texte clôt cet ouvrage...
L’œuvre de Georges Perec est originale par bien des points. Il a expérimenté une nouvelle forme d'écriture, jetant sur le décor qu'il l'entoure un regard à la fois étonné et pertinent. Le langage chez lui est certes un outil pour s'exprimer mais il s'en sert en lui inventant un rôle assez nouveau, tout à la fois jubilatoire, philosophique et poétique. Ici, il livre à son lecteur, toujours un peu dubitatif quand il ouvre un ouvrage de lui, la transcription des rêves qu'il a pu faire où tous les interdits culturels sociaux, religieux, raciaux sont soudain abolis. C'est vrai que ce domaine sous-tend souvent la création, mais il s'agit le plus souvent de rêves éveillés, de fantasmes. En ce qui concerne les rêves nocturnes, il est bien difficile de s'en souvenir au réveil, ils s'effacent rapidement et le réel reprend le dessus au point que la mémoire n'en garde pas la moindre trace, à l'exception peut-être de certains d'entre eux dont on se demande pourquoi ils ont bien pu ainsi imprégner notre souvenir. Ainsi le titre, par ailleurs évocateur, est-il suivi de la mention « 124 rêves » comme d'autres ouvrages comporteraient celle de « Roman » ou « nouvelles ». Il s'agit donc de rêves nocturnes qui ont cette caractéristique d'être colorés, hasardeux, proteiformes et qui procurent à leur manière un dépaysement qui n'est pas seulement une délocalisation. La relation qu'il en fait, en termes simples, a quelque chose à voir avec cette période de relaxation où la liberté, la licence, la volonté la plus folle, les sentiments les plus débridés, les pulsions les plus amoureuses, les projets les plus absurdes, les situations les plus rocambolesques, trouvent soudain leur vérité qui est parfois inquiétante, angoissante et même labyrinthique. Ils ont à la fois cette texture insaisissable et cette abrupte et incompréhensible évidence mais aussi cette façon apparemment décousue de se révéler et de se libérer. Ils évoquent souvent la mort puisque qu'avec l'amour et la vie ce sont là les grands thèmes de notre existence terrestre et s'ils ne sont pas toujours érotiques, les songes de Perec donnent souvent asile à des femmes belles et parfois sensuelles. Dans cet ouvrage, l’accouplement de l'auteur avec une femme est fréquent ce qui témoigne d'un accomplissement de désirs inassouvis (je note que la totalité des textes sont datés postérieurement à Mai 68 qui a correspondu notamment à une libération dans ce domaine). Perec semble ici nier le refoulement intime qui affecte chacun d'entre nous mais aussi les conventions sociales, les tabous... Freud donnait au rêve un caractère sexuel et les surréalistes l'ont largement exploité, insistant sur le non-sens, le chaos, l'absurde… C'est vrai qu'il est tentant de vouloir déchiffrer le songe, d'y voir une prémonition, une activé de substitution ou la matérialisation de ses désirs, loin des censures, en matière sexuelle notamment (on y fait ce qu'on est incapable de faire dans la vraie vie). Comme souvent, l'auteur y ajoute sa patte, son sens de l'humour, son jeu volontaire sur les mots qui est peut-être sa façon à lui d'insister sur l'absurde de la vie. Donner à son lecteur la possibilité d'entrer dans son univers onirique est parfois déroutant, surtout si on n'a pas de l'auteur une connaissance approfondie, et certains de ses rêves le sont, d'autres en revanche ont avec nous une connotation personnelle telle qu'ils nous sont en quelque sorte familiers. Il évite, et c'est heureux, la porte ouverte à la psychanalyse toujours friande de ce genre de visons subconscientes, toujours à l’affût d'une explication fumeuse et bien souvent inutile, voire dangereuses. L'auteur rend compte, parfois avec force détails, de ses peurs intimes, mais il ne me semble pas qu'il veuille un autre témoin et peut-être un autre juge que son lecteur. Il me semble aussi qu'il est conscient de cette expérience originale au point d'en faire une finalité, une sorte de fantaisie d'auteur : rêver dans le seul but de transcrire ses rêves ! (« Je croyais noter les rêves que je faisais : je me suis rendu compte que, très vite, je ne rêvais déjà plus que pour écrire mes rêves »)
Il s'agit donc d'un livre à lire par épisodes en n'oubliant pas que nous tenons entre nos mains quelque chose qui ressemble à une expérience intellectuelle et aussi révolutionnaire (il n'a été pour rien membre de l'Oulipo), quelque chose qui se mérite en tout cas, c'est à dire autre chose qu'une simple fiction. Ce n'est peut-être plus dès lors une banale transcription de rêves mais le départ d'autre chose qui, bien entendu va nous étonner. Ainsi, l'imagination aidant, la nôtre évidemment, à la fin de cet ouvrage serions-nous tentés d'espérer que la dernière page cache encore quelque chose de surprenant !
© Hervé GAUTIER – Avril 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com ]
-
UN HOMME QUI DORT
- Par ervian
- Le 23/04/2014
- Dans Georges PEREC
- 0 commentaire
N°744 – Avril 2014.
UN HOMME QUI DORT – Georges PEREC – Denoël. (1967)
Le personnage central de ce roman est un homme qui s'éveille. Il n'a pas de nom et l'auteur s'adresse à lui en le tutoyant. Est-ce parce qu'il le connaît ou peut-être parce que cet auteur s'adresse à lui-même un peu comme ces solitaires qui soliloquent sans cesse et s'interpellent eux-mêmes ? C'est un étudiant sans importance qui habite une mansarde minable de cinq mètres carrés sans confort, sous les toits et qui décroche de plus en plus des études. Non seulement il ne va pas en cours, a abandonné tout idée de diplôme et de réussite mais il se laisse aller physiquement et moralement, ne se lave même plus, ne quitte sa chambre qu'à la nuit pour roder dans les rues désertes ou pour les gestes élémentaires de la vie. De l'extérieur, il ne perçoit plus que les ombres portées qui se dessinent sur le plafond de son galetas et les bruits étouffés de la rue. Il ne rencontre plus personne, a tourné le dos à ses copains, ne vit plus et ne veut pas de la vie qui se résume pour lui à « une bassine en matière plastique rose où croupissent six chaussettes ». Quelque chose s'est brisé en lui et il n'est pas vraiment de ces philosophes qui s'interrogent à perte de vue sur le sens de l'existence, il laisse les problèmes métaphysiques aux autres.
A vingt cinq ans, c'est un marginal qui s'est inscrit en faculté pour ne pas participer à ce monde, faire partie de cette société qu'il veut ignorer. Il a oublié (où peut-être ne les a t-il jamais connus) la fougue de la jeunesse et l’enthousiasme qui dit-on caractérise cet âge et fait qu'on veut conquérir le monde et réformer la société, il n'a même plus ni repaires, ni souvenirs, ni espoirs, ni amours, ni passé ni avenir et quand il rentre chez ses parents, des retraités qui vivent à la campagne, dans l'Yonne, il ne partage avec eux plus rien que le silence, un lien de parenté qui se distend de plus en plus et peut-être aussi un maigre pécule qu'ils lui allouent pour préparer sa vie. Comme eux il est vieux mais cette vieillesse est d'une autre nature. Eux ont fait leur parcours sur terre et lui refuse de le sien, son itinéraire est déjà tout tracé vers la mort et l’hospice de vieillards. Cette absence de dialogue se traduit par l'éloignement, lui à Paris où il est censé étudier et eux ailleurs, loin de lui, autant dire dans un autre monde. Chez eux il s'isole volontiers en forêt pour regarder les arbres qui le fascinent, peut-être simplement parce qu'ils sont muets. Dans la Capitale, il mène une vie végétative, volontairement coupée du monde. Il est ce piéton qui arpente les rues et dont les gestes habituels et répétitifs sont dérisoires. Pourtant, il suffirait qu'il accepte de correspondre au stéréotype de celui qui fait ce qu'on attend de lui, docilement, qu'il fasse partie de ces oubliés de la société dont on attend rien qu'une obéissance servile et un dévouement de tous les jours, qu'il endosse ce costume du citoyen ordinaire. A ceux-là on donne des miettes sous forme de décorations, de flatteries illusoires, de distinctions hypocrites qui ne sont que de la poudre aux yeux mais qu'ils apprécient. Lui, au contraire ne veut être que « la pièce manquante du puzzle », celui qui n'écoute pas les conseils et marche sans se retourner vers son néant quotidien. Autour de lui le monde s’agite mais il n'en a cure. Il est transparent, sans importance, invisible, limpide et sa vie ne tient qu'en quelques mots, il est« comme une goutte d'eau qui perle au robinet d'un poste d'eau sur un palier, comme six chaussettes trempées dans une bassine en matière plastique rose, comme une mouche ou comme une huître, comme une vache, comme un escargot, comme un enfant ou comme un vieillard, comme un rat ».
A la fois indifférent, inaccessible et solitaire, il marche dans la ville comme dans un labyrinthe, hantant les bars et les squares sans presque s'en rendre compte et le métro est pour lui un souterrain incertain. Ses actions sont limitées, mesquines, sans importance et surtout il néglige l'étude. Tout chez lui est illusoire et sans intérêt. Il se sent persécuté, paranoïaque et le sommeil, ce basculement dans le néant, finit par le gagner et avec lui la perte du sens du réel et même une sorte de dédoublement de lui-même. Son angoisse est réelle, il refuse de réagir, n'offre aucune prise aux événements extérieurs et semble se complaire dans cette situation pas vraiment constructive. C'est aussi un sommeil éveillé, un sorte d'état semi-comateux où il fait des gestes automatiques uniquement destinés à survivre presque comme un ectoplasme, comme un fantôme transparent. La fin laisse entrevoir une espérance possible
Pourtant cette attitude n'est pas nouvelle pour lui et ne résulte pas d'une soudaine prise de conscience ; il a toujours été comme cela, dépressif, défaitiste, indolent, à cause peut-être de l'âge de ses parents. Pourtant il ne semble pas y avoir de ressemblance avec eux. Ils ont fait leurs parcours dans cette vie et espèrent bien que leur fils fera le sien. Ils lui permettent même de faire des études pour que sa vie soit meilleure. Pourtant il n'a pas le même état d'esprit à cause peut-être du fossé des générations, des références qui ne sont pas les mêmes ou à cause des temps qui changent un peu trop vite. Peut-être aussi doit-il cet état déprimé à un lointain aïeul ? La roulette de la génétique a de ces mystères !
C’est un texte déprimant comme l'est la vie de ce jeune homme mais pourtant éminemment poétique. Je connais mal le parcours de Perec. Je ne sais pas si ce texte est autobiographique (il l'a écrit avant son adhésion à l'OULIPO), mais un livre qui est aussi un univers douloureux est souvent porté pendant de nombreuses années avant que les mots ne viennent. Son enfance a été chaotique et il a peut-être été cet étudiant paumé. C'est peut-être aussi une simple fiction (encore que ce livre ne porte pas la mention « roman ») mais je m'y retrouve un peu, il est vrai avec quelques dizaines d'années de recul. J'ai bien dû, moi aussi, avant d'entrer dans la vie active, ressentir les mêmes affres, connaître les mêmes angoisses face à une vie qui semblait vouloir se dérober devant moi. Mes réaction n'ont certes pas été semblables mais il y avait quelque chose de cette errance, dans ces questions sur l'avenir, dans cette perte de repaires qui m'a fait apprécier ce texte
©Hervé GAUTIER – Avril 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
W ou le souvenir d'enfance
- Par ervian
- Le 20/04/2014
- Dans Georges PEREC
- 0 commentaire
N°743 – Avril 2014.
W ou le souvenir d'enfance – Georges PEREC – Denoël. (1975)
D'emblée, ce récit a quelque chose de déconcertant. Il se présente sous la forme de deux textes, l'un autobiographique et l'autre fictif. L'effet recherché est sans doute celui du miroir né de l’alternance ou d'un enchevêtrement complémentaire entre les deux, un peu comme si ce qu'il n'était pas dit dans l'un(où que l'auteur ne pouvait écrire de sa propre biographie ) l'était dans l'autre, avec cependant une certaine pudeur et aussi une certaine volonté d'expliquer les choses comme l'indique l'exergue de Raymond Queneau [« Cette brume insensée où s'agitent des ombres, comment pourrais-je l'éclaircir ? »].
Assez bizarrement, quand il débute l'autobiographie, Perec écrit « Je n'ai pas de souvenirs d'enfance ». Il va pourtant, à travers les réminiscences nées de quelques photos jaunies et quelques bribes de mémoire, nous décrire ce qu'elle a été. Il naît le 7 mars 1936 à Paris et ses parents sont des juifs polonais immigrés (Peretz) dont le père, qu'il n'a pratiquement pas connu, meurt sous l'uniforme au début de la guerre en 1940. Pour le sauver, sa mère l'envoie avec la Croix-Rouge à Villars de Lans en zone libre où il est baptisé et son nom francisé (Perec). Il est ballotté de familles en établissements et de cela il ne garde que peu de souvenirs. Il ne reverra plus sa mère puisqu’elle meurt à Auschwitz. Le thème de la disparition de ses proches hantera donc ce récit et avec lui la douleur de leur absence. « W » est une histoire de son enfance « la vie exclusivement préoccupée par le sport sur un îlot de la Terre de Feu »,une sorte de société qui vit selon les valeurs olympiques. Quand il évoque son enfance, brisée par l'absence de ses parents, cette dernière est symbolisée par la lettre « E » à qui est dédié ce livre [on se souvient que Perec a écrit aussi un autre roman, « La disparition », d'où cette lettre est complètement absente et qui apparaît deux fois dans son nom pourtant court. Cette disparition de ses parents est ressentie par lui comme une suprême injustice.
La fiction est présentée sous forme d'enquête policière (le W apparaît sous la forme d'un nom de la ville où le narrateur, Gaspard Winckler, se rend au début et qui est aussi le nom d'un autre homme qui a disparu) et qui se poursuit par une autre histoire qui se déroule dans une île, « W » (située au bout du monde). Ce territoire comporte quatre villages, sorte de phalanstères organisés, hiérarchisés qui abritent une société pratiquant les valeurs olympiques du sport, une sorte d'idéal avec des rituels compliqués, très codifiés et parfois même inattendus voire surréalistes pour les « Athlètes », autant dire une certaine notion du bonheur inexistante dans son enfance, peut-être aussi un modèle éducatif dont l'absence de ses parents l'a privé. Je note que dans cette collectivité, peut-être utopique, il semble exister des liens internes assez forts que Perec n'a pas connus dans son enfance, tiraillé qu'il a été entre différents membres de sa parentèle.
Petit à petit, l'auteur pourtant dévoile ces ombres comme on soulève une couverture qui recouvre quelque chose. Il le fait comme à son habitude, à coup de références personnelles (Bartleby, Moby Dick de Herman Melville, la fuite, la vengeance, le bien et le mal) et d'un détail à mes yeux significatif. W est « le » souvenir d'enfance alors qu'on pourrait s'attendre à voir ce nom au pluriel. Perec se livre à une démonstration un peu forcée à partir de cette lettre qui, manipulée physiquement devient un X, symbole de l'inconnu mathématique et judiciaire, signe aussi de l'ablation, mais également une croix de Saint André, symbole de mort. Si on la double, c'est le signe qui apparaît sur la casquette de Charlie Chaplin dans le film « le dictateur », si on en prolonge les segments, elle devient une « croix gammée » et redessiné, ce « W » originel se transforme en une étoile de David. Cette lettre est donc omniprésente et devient la marque indélébile de cette enfance assassinée. D'ailleurs tout au long de l'autobiographie, Perec fait allusion aux Allemands, à la guerre, à la peur d'être lui aussi l'objet d'un emprisonnement et d'une déportation. Il fait une discrète allusion aux camps qu'il découvre mais seulement à la fin du récit, note un parallèle étonnant entre les camps de concentration et la vie sur l'île W et remarque enfin que la dictature de Pinochet a installé des camps de déportation dans les îles de la Terre de Feu. Il avait d'ailleurs, au cours du récit consacré à la vie sur W, insisté sur la cruauté et l'humiliation voire l'inhumanité de certaines scènes.
Ces digressions ne sont pas destinées à égarer le lecteur mais bien au contraire à lui tenir la main dans ce récit volontairement labyrinthique. Il y a quelque chose de révélateur dans cette technique où s'entremêlent la fiction et la réalité, la construction et la déconstruction, la mémoire et l'imaginaire. Personnellement j'y vois une tentative de traduire une douleur ressentie par l'écrivain qu'il tente d'exprimer sans pour autant pouvoir y parvenir laissant son lecteur face au « non-dit ». Cela me rappelle les derniers mots écrits de Romain Gary avant son suicide « Je me suis enfin exprimé complètement ».
Ce livre n'est pas un roman au sens classique, il veut nous délivrer un message bien plus important que ce qu'une fiction ordinaire est censée exprimer, à la fois texte intime et pathétique, acte volontaire pour que l'oubli qui fait tant partie de notre vie ne recouvre pas trop vite celle des autres que nous avons aimés et qui nous ont quittés [« J'écris parce que nous avons vécu ensemble, parce que j'ai été un parmi eux, ombre au milieu de leurs ombres, corps auprès de leur corps ; j'écris parce qu'ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est l'écriture ; l'écriture est le souvenir de leur mort et l'affirmation de ma vie »] . C'est ici son rôle rendu à l'écriture comme acte de la mémoire mais aussi l'occasion unique pour celui qui tient le stylo de construire, à travers les souvenirs intimes de son enfance rien d'autre que sa propre vie ; autant dire une véritable thérapie ! Léon-Paul Fargue exprime cela quelque part avec une grande économie de mots :« On ne guérit jamais de son enfance ».
J'avoue que cette lecture m'a laissé à la fois dubitatif et surtout bouleversé, comme si Perec, une nouvelle fois et au-delà des mots, m'invitait à comprendre autre chose qu'une simple histoire. Je suis peut-être passé à côté du message mais j'ai éprouvé le besoin de formaliser ici, et sans aucune prétention, mon sentiment de simple lecteur.
©Hervé GAUTIER – Avril 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA VIE MODE D'EMPLOI
- Par ervian
- Le 17/04/2014
- Dans Georges PEREC
- 0 commentaire
N°742 – Avril 2014.
LA VIE MODE D'EMPLOI – Georges PEREC – Hachette.(Prix Médicis 1978)
Si on en juge par la couverture, ce n'est pas un mais des romans que le lecteur va aborder. Ce texte retrace la vie d'un immeuble imaginaire situé au 11 de la rue Simon Crubellier dans la 17° arrondissement de Paris entre 1875 et 1975. C'est déjà tout un programme et cela commence le 23 juin1975 à huit heures du soir ! Il sera en effet question de ses habitants, de leur histoire et de leurs histoires, bref des destins entrecroisés, des aventures qui s'entrechoquent, des épisodes de cette comédie humaine éphémère et éternelle mais aussi des descriptions scientifiques, des recettes de cuisines, des listes, des grilles de mots croisés, des inventaires... autant de choses hétéroclites, de digressions et de détails un peu fous dont Perec est friand. Pour « faciliter » les choses, le lecteur doit imaginer cet immeuble comme une sorte de maison de poupées dont on aurait supprimé la façade de façon à pouvoir percevoir la vie à l'intérieur à moins qu'il ne préfère être investi de cet étrange pouvoir qu'avait, selon a légende, cette fée qui pouvait soulever les toits des maisons et observer leurs occupants. C'est en tout cas une sorte de microcosme qui existe et meurt sous les yeux du lecteur. L'auteur va décrire minutieusement toutes les pièces (appartements, caves, ascenseur et sa machinerie mais aussi des cages d'escaliers, les caves, la chaufferie et des choses qu'on y perd ou qui s'y trouvent par hasard) et évoquer leurs occupants passés et présents, un peu comme on considère les morceaux d'un puzzle. Cela fait penser à un patchwork, des séquences de vécu qu'on aurait réunies ensemble.
Bartlbooth est quand même le personnage principal de toute cette agitation (même s'il ne l'est qu'en filigranes) et son étrange projet autour de l'aquarelle pour laquelle il n'a aucune disposition mais qui bouscule la logique la plus élémentaire. Il mobilisera son énergie personnelle mais aussi celle de Smauft, son factotum, celle de Winkler (le faiseur de puzzle), celle de Valène (le peintre), celle de Morellet, tous évidemment habitants de cet immeuble mais avec un seul objectif : qu'il ne subsiste rien de tout le travail de chacun !
Ce sont effectivement des romans qui nous sont proposés et qu'on peut lire séparément, des textes gigognes où se mélangent harmonieusement l'histoire, la géographie, les légendes, les aventures personnelles plus ou moins imaginaires et hypothétiques et tout cela sans beaucoup de lien entre elles. On y rencontre à l'occasion des catalogues de bricolage, la généalogie et la biographie d'une famille ou des tranches de vie de locataires successifs, une sorte d'inventaire à la Prévert ainsi que des histoires à arborescences, rebondissements et improbables conclusions qui assurément égarent le lecteur mais qu'importe puisque la relation qu'il est en train de lire a pour lui la solidité d'un château de cartes édifié dans un courant d'air ! Il y est souvent question d'amour et de mariages, de quêtes, de difficultés de tous ordres, de souffrances, de maladies, de décès et de successions subséquentes, d'injustices dans les héritages, de malversations ou de mauvaises affaires, de volontés de laisser une trace de son passage sur terre où celle de retrouver ses racines, bref que des choses bien humaines. Perec a ainsi voulu, semble-t-il, appréhender le monde dans sa totalité, à travers les petites et les grandes choses qui arrivent à chacun mais surtout en en soulignant les incohérences et les incongruités et ce à travers les vies de ses occupants. Il l'a fait sous la forme contraignante édictée par l'OULIPO (Ouvroir de littérature potentielle) qui est censée générer la créativité. Il semblerait bien qu'il ait rempli son « contrat » puisque au terme de cet ouvrage de 695 pages(y compris les annexes) on ne s'y ennuie pas, mieux peut-être on lit chaque chapitre avec la gourmandise d'un écolier qui fait ses premiers pas dans l'apprentissage de la lecture !
Perec a, paraît-il, mis près de 10 ans à écrire cet ouvrage. C'est une œuvre unique, pleine de curiosités et d'érudition qu'il ne faut surtout pas rejeter à priori à cause du nombre de ses pages et peut-être aussi de son côté labyrinthique. La lecture peut paraître difficile mais le lecteur en ressort avec une curieuse sensation, celle peut-être d'avoir lu autre chose qu'un roman traditionnel avec un début, un développement et une fin qui souvent est classiquement un « happy-end ». J'ai goûté cette écriture débridée et débordante qui prend sans doute sa source dans l'imaginaire délirant de l'auteur et sa volonté d'en rajouter toujours un peu dans les précisions et les anecdotes qui souvent prêtent à sourire dans leurs développement comme dans leurs conclusions. Le style de Perec révèlent un goût non dissimulé pour les phrases et les mots qu'on mâche avec gourmandise et que l'auteur a écrits jusqu'à satiété pour le plus grand bonheur de son lecteur mais sûrement d'abord de lui-même. Elle n'a d'égal que celle de monopoliser l'attention et même l’intérêt, et ça marche ! J'ai bien aimé ce dépaysement complet, ce culte du détail qui peut paraître inutile à la compréhension du texte(et l'est peut-être) qui le dispute à la poursuite de l'histoire mais qui est tout à fait propre à exciter l'imagination du lecteur devenu de plus en plus complice de cette chronique abracadabrantesque. Un simple objet par ailleurs anodin est pour notre auteur le prétexte à l'énoncé d'une histoire à la fois improbable et parfaitement acceptable si on veut bien l'admettre. J'ai apprécié aussi le sens abscons de certaines formules pourtant censées être explicatives, claires et même pédagogiques sans oublier les rébus et les incontournables calembours dignes de consommateurs avinés du café du commerce ou de bureaucrates fatigués par une harassante journée de travail dans un bureau mal éclairé et poussiéreux ! Tout cela instille dans l'esprit du lecteur une impression qui ressemble à la fois à du dérisoire et à du sérieux, de l'éternel et de l'éphémère sans qu'on sache très bien si c'est le plaisir de lire un tel ouvrage qui fait se graver un sourire au coin des lèvres ou celui de pénétrer malgré soi dans un univers digne des meilleures fictions mais un peu étrange quand même.
J'ai retrouvé avec un immense plaisir cet auteur dont j'ai déjà parlé dans cette chronique (la Feuille Volante n° 484-486-487). Dans ma bibliothèque idéale, il tient une grande place, celle qu'occupent généralement ceux qui sont partis un peu trop tôt !
©Hervé GAUTIER – Avril 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
Un cabinet d'amateur – Georges Perec
- Par ervian
- Le 27/12/2010
- Dans Georges PEREC
- 0 commentaire
N°487– Décembre 2010.
Un cabinet d'amateur – Georges Perec - Balland.
Les familiers de Perec pourraient probablement émettre des doutes au seul énoncé du titre de ce roman, se demandant où l'auteur de « La vie mode d'emploi » voulait bien les emmener une fois encore. L'exergue puisée chez Jules Verne donnait à penser qu'il allait s'agir de tableaux, mais attention, notre auteur à la fois érudit et génial provocateur n'aime rien tant que d'embarquer son lecteur dans un univers où lui seul possède la clé ! Il ne faut pas non plus perdre de vue sa parenté plus que naturelle avec Boris Vian qui, lui aussi excellait dans cet exercice. Il convient donc d'aborder ce livre avec circonspection, mais surtout en évitant de trop faire montre de préjugés puisque, bien qu'il s'agisse d'un roman, c'est à dire d'une fiction, il recèle des détails techniques, historiques et érudits qui font qu'il ne peut être autre chose que véridique !
Si on en croit Perec, « Un cabinet d'amateur » est une toile du peintre américain d'origine allemande, Henrich Kürz. Elle fut exposée pour la première fois en 1913 à Pittsburg en Pensylvanie (USA), mais passa quasiment inaperçue à cause de la présence, ce jour-là, de critiques célèbres et de collectionneurs illustres parmi lesquels Hermann Raffke, riche amateur d'art. L'exposition fut néanmoins un franc succès pour les autres artistes. On s'intéressa à partir de ce moment-là d'un peu plus près au tableau de Kürz notamment à cause de la notice, par ailleurs anonyme, du catalogue. Grâce à une description grandement laudative, on apprit qu'elle représentait Raffke lui-même, entouré des tableaux de sa collection. Dès lors on se passionna pour ce peintre inconnu. Ainsi organisa-t-on, la semaine suivante, une présentation de l'œuvre dans une pièce qui reprenait la topographie exacte des lieux décrits dans le tableau de Kürz.
En réalité, Perec, s'est inspiré d'une tradition picturale ancienne pratiquée notamment par le peintre flamand du XVII° Guillaume Van Haecht. Dans une série de mises en abymes, il emmène son lecteur où il veut, c'est à dire dans une sorte de maelström où la mise en scène le dispute au culte du plus petit détail et où le faux, qui est toujours possible en peinture, voisine avec les informations les plus crédibles, s'appuyant notamment sur des articles de la presse spécialisée de l'époque. Cela est rappelé par le papier d'un critique dont le thème était « Toute œuvre est le miroir d'une autre », ce qui constitue un terrain de réflexion intéressant en matière d'art et l'occasion d'une mise en perspective passionnante ! Il mettait l'acte de peindre le « cabinet d'amateur » dans une sorte de jeu de miroirs comme une « dynamique réflexive » au terme de laquelle l'œuvre d'un artiste nourrit et inspire celle des autres.
Comme toujours, j'ai bien aimé, même si, je dois l'avouer, je me suis laissé un peu emporter, en me demandant où Perec voulait bien en venir, avec l'énoncé de cette liste un peu longue et très technique qui ressemble, pendant de nombreuses pages, davantage à un catalogue de vente à l'usage d'un commissaire-priseur ou d'acheteurs potentiels ! L'effet labyrinthique, bien dans l'esprit de la philosophie pataphysicienne, est justement obtenu par la rédaction de l'index de la deuxième vente initiée après la mort de Raffke. Les précisions techniques apportées par l'auteur en font un documents crédible et, de page en page, Perec réussit à convaincre son lecteur qu'il a entre les mains la description d'une collection authentique et qui d'ailleurs fait référence en matière d'art. Un véritable effet de trompe-l'œil où le spectateur est à la fois mystifié et séduit par ce qu'il perçoit.
Il faut attendre la dernière ligne du dernier paragraphe de cette « histoire d'un tableau » pour en avoir le fin-mot, c'est à dire le mot de la fin.
La circonspection du début était donc parfaitement justifiée autant d'ailleurs que la référence à Vian puisque, à l'occasion de ce roman, il me souvient de l'exergue de « L'écume des jours » ainsi rédigée « Cette histoire est entièrement vraie puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre. Sa réalisation matérielle proprement dite consiste essentiellement en une projection de la réalité, en atmosphère biaise et chauffée, sur un plan de référence irrégulièrement ondulé et présentant de la distorsion. On le voit, c'est un procédé avouable s'il en fut.»
©Hervé GAUTIER – Décembre 2010.http://hervegautier.e-monsite.com
-
Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ? Georges Perec
- Par ervian
- Le 24/12/2010
- Dans Georges PEREC
- 0 commentaire
N°486– Décembre 2010.
Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ? – Georges Perec* - Denoël.
Il est des livres qu'on apprécie pour l'histoire qu'ils racontent, parce qu'elle est émouvante ou simplement ordinaire, d'autres retiennent notre attention par leur côté déjanté.
Ici l'idée consiste pour quelques copains, dont le narrateur, de tenter de faire réformer en l'estropiant un de leur camarade, « Un mec qui s'appelait Karamanlis ou quelque chose comme ça : Karawo? Karawasch ? Karacouvé ? Enfin bref Karatruc... [son nom variera d'ailleurs beaucoup au cours du récit et on ne manquera pas de remarquer qu'il en change beaucoup plus souvent que de chemise !] deuxième classe dans un régiment du Train à Vincennes depuis quatorze mois», qui ne veut pas aller en Algérie pour y faire la guerre.
Ils bénéficient du concours actif et amical de « Henri Pollack soi-même, maréchal des Logis ... qui menait une double vie : tant que brillait le soleil, il vaquait à ses occupations margistiques... mais quand sonne la demi de dix huit heures... il regagnait son Montparnasse natal où c'est qu'il avait sa bien-aimée, sa piaule, ses potes et ses chers bouquins ». C'est que notre ami, subséquemment appelé du contingent, s'ennuie ferme au Fort Neuf de Vincennes, dans « ce Bon Dieu de Bon Dieu de Saloperie de Service Militaire ». Contrairement aux gradés de carrière, il est plutôt sympathique et bien vu, la preuve, les hommes du rang « l'ovationnait de divers cris d'oiseaux » au lieu de le saluer réglementairement. Il chevauche, pour se rendre à Montparnasse, un vélomoteur pétaradant dont le guidon est chromé.
C'est en tout cas l'occasion, pour l'auteur pas vraiment militariste, de dénoncer les méthodes d'enrôlement que, évidemment, il réprouve. Il le fait avec le talent que nous lui connaissons et dans une manière qui n'aurait certainement pas déplu à Boris Vian [à qui un discret hommage est rendu sous la forme d'un nom de rue], un autre grand contestataire de la chose militaire, un autre auteur talentueux dont les œuvres qui ne vieillissent décidément pas méritent, elles aussi, de figurer dans les anthologies de la littérature française.
Le titre de ce « récit épique et en prose agrémenté d'ornements versifiés » s'interroge sur ce que fait un petit vélo au fond d'une cour. Le livre refermé, le lecteur demeure dubitatif... La parenté avec Vian est plus qu' évidente, lui qui nous a gratifié d'un roman intitulé « L'automne à Pékin » dont la caractéristique est de ne se dérouler ni en automne ni à Pékin !
Un livre est toujours pour Perec un exercice de style avec des contraintes qui nourrissent sa créativité. En en bon littéraire et en virtuose de l'écriture, il égrène les figures de rhétorique comme l'apophtegme, l'anaphore, l'hypotypose... et pour que son lecteur n'en ignore rien et les savoure comme il convient, il les liste lui-même à la fin de cet ouvrage avec les référence aux pages pour une illustration plus complète ! C'est aussi une autre manière de faire de la pédagogie mais si vous préférez la cuisine, vous pourrez toujours vous essayer à la recette du riz aux olives.
J'ai aimé lire et relire, pour le plaisir et surtout à haute voix, les pages de ce petit livre, à cause aussi des digressions et des parenthèses qui enrichissent le texte... On sent qu'il écrit avec délectation, jubilation et délire. Cela donne une véritable musique agréable à l'oreille. L'humour qui est présent à chaque ligne m'a en tout cas bien fait rire. Cela a été pour moi un bon moment de lecture.
Perec en profite pour violer un peu la langue, mais c'est plutôt bien puisqu'il lui fait, selon l'expression désormais consacrée, de beaux enfants ! Après tout c'est rassurant que « de temps à autres, un poète que n'effraie pas l'air raréfie des cimes, ose s'élever au-dessus du vulgaire pour, dans un souffle épique, exalter notre Aujourd'hui ». Quand ce poète se nomme Perec, le plaisir de lire et d'être ailleurs est toujours un enchantement pour le lecteur.
* Georges PEREC (1936-1982) – Membre du mouvement Oulipo - Prix Renaudot 1965 pour « les Choses »– Prix Médecis 1978 pour « La vie mode d'emploi ».
©Hervé GAUTIER – Décembre 2010.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA DISPARITION – Georges Perec
- Par ervian
- Le 14/12/2010
- Dans Georges PEREC
- 0 commentaire
N°484– Décembre 2010.
LA DISPARITION – Georges Perec – Denoël.
Le thème principal de ce roman est la disparition d'Anton Voyl. Ses amis se lancent à sa recherche sans qu'ils sachent vraiment s'il s'agit d'une véritable disparition, d'un rapt ou d'un suicide. Cette quête est d'autant plus difficile qu'il laisse un journal avec un postscriptum particulièrement sibyllin que la police a du mal à interpréter et qui laisse à penser qu'il avait perdu la raison « Portons dix bons whiskys à l'avocat goujat qui fumait au zoo ».
Pourtant, l'avocat dont il est question, Hassan Ibn Abbou disparait à son tour et ses amis réunis à Azincourt afin de faire toute la lumière sur cette seconde absence vont exhumer des souvenirs anciens...
En toile de fond la mort reste tapie avec en toile de fond la damnation éternelle !
Ce sera l'occasion pour l'auteur, non seulement de dérouler une trame policière qui va ravir son lecteur d'autant que cela s'accompagne d'une débauche de vocabulaire, de phrases aussi mystérieuses que triturées pour faire entre eux sonner et parfois chanter les mots empruntés à l'argot ou au plus précieux jargon. Cette histoire un peu déjantée, fantastique, digne des fables les plus hystériques où se mêlent la littérature, les mathématiques et quelques langues étrangères, mérite d'être dite à haute voix à cause des allitérations, de la musique résultant de l'association parfois approximative mais assurément gourmande des termes. Instinctivement le lecteur goûte le calembour, le jeu sur les mots et recherche, souvent vainement, la contrepèterie.
Il est convenu de dire maintenant, même si cela ne fut pas évident à la sortie du livre, qu'il s'agit d'un roman lipogramme(le plus long jamais écrit), c'est à dire qu'il ne comporte pas une fois la lettre « e ». D'ailleurs, pour parvenir à ce qui est quand même une performance, Perec triture les mots aussi bien que la syntaxe. De cela il résulte un étrange phénomène mais pour autant agréable à l'oreille. Et puis, cela va bien dans le sens de l'Oulipo ( acronyme de « l'ouvroir littéraire potentiel » qui peut parfaitement être rattaché au « Collège de 'Pataphysique » dont il est une sous-commission). C'est un groupe international de mathématiciens et de littéraires qui, selon la formule de Raymond Queneau sont « des rats qui construisent eux-mêmes le labyrinthe dont ils se proposent de sortir ». Ils considèrent que les contraintes formelles sont un puissant stimulant de l'imagination. Dans le cas de Perec, c'est particulièrement réussi et le texte qui en résulte, tout à la fois absurde et abracadabrantesque n'aurait sans doute pas été désavoué par Boris Vian ! De plus il convoque des auteurs référents en n'oubliant pas de leur faire quelques violences littéraires bien dans l'esprit de l'Oulipo.
Mais quel est le véritable sens de cette absence de « e »? La considérer comme un exercice gratuit peut paraître un peu court. Alors, thème peut-être biographique de l'absence, pourquoi pas ? Cela donnerait au texte une autre dimension loin de l'aspect jubilatoire du récit, peut-être pas tant que cela d'ailleurs ! Est-ce une invitation à réfléchir sur le poème de Rimbaud « Voyelles », rebaptisé « Vocalisations », trituré et amputé de tous ces « e » ? Est-ce aussi, et ce malgré le côté décalé du récit, l'invitation à réfléchir sur un des aspects de la condition humaine ? Pourquoi pas ?
Il reste que j'ai lu ce roman devenu un classique avec gourmandise.
©Hervé GAUTIER – Décembre 2010.http://hervegautier.e-monsite.com