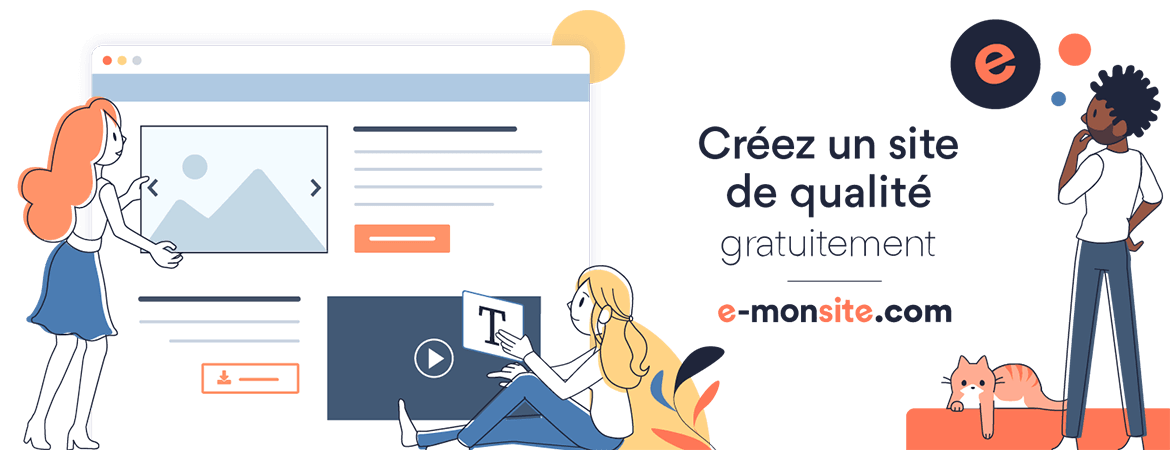Jean-François Pocentek
-
La patience des goélands
- Par ervian
- Le 29/12/2011
- Dans Jean-François Pocentek
- 0 commentaire
N°551 – Décembre 2011
LA PATIENCE DES GOELANDS– Jean-François POCENTEK- Lettres vives.
Le paysage, celui d'une petite ville du bord de mer du Nord, un matin de novembre solitaire et ensommeillé. Dans ce décor un peu froid et désolé, un homme et une femme. Celui-là, Baptiste, a les yeux tournés vers le large et l'autre, Marie, s'affaire d'ordinaire à déposer dans des boites aux lettres « des papiers pour convaincre de dépenser des sous ». Un petit métier pour survivre avec son père, Mathurin, et ses quatre enfants au noms bizarres. Ils sont le regard tournés vers la mer, « assis sur un banc, dos à la ville, là où se rencontre l'avenue Saint-Exupéry, l'esplanade maritime et la promenade Débeyre », face au Christ de faïence blanche, sous les auspices bienveillants des goélands, ils se sont parlé.
C'est que Baptiste est venu d'ailleurs, tout exprès, avec son univers et ses souvenirs personnels de Camille, un ami qui habitait rue Consolante, mort il y a treize ans, de ne pas avoir aimé la vie. C'était pourtant sa seule richesse ! C'est avec ses mots que Camille pour une journée, va revivre, dans cette maison qu'il habitait rue Consolante, qui sentait la bière, le tabac et l'essence à briquet, où il cachait ses « cahiers », témoins de son quotidien. C'est le narrateur qui prendra ce relais en notant lui-aussi dans son carnet noir comme le deuil, cet hommage amical et la vie modeste des personnages qu'il croise en ce jour. Il y est venu pour ranger, récupérer un peu pour la brocante et surtout abandonner au trottoir quelques accries à la curiosité des gens, comme cela se fait là-bas. Une façon de tourner définitivement la page de son passage sur terre où « il n'était que le passager d'un voyage sans heurts, sans retards, sans excès ». Il évoque l'enterrement « ni éloge, ni dithyrambe non plus. Que du vrai. » et ce Camille qui, par le truchement de l'écriture ou de je ne sais quel miracle, accompagnait son propre cercueil; il guidait avec des mots et des silences tous ces mineurs endimanchés et un peu gauches, venus rendre un dernier hommage à leur camarade d'infortune. Il refit à l'envers ce parcours quotidien et du souvenir, des lieux et des gens disparus avant lui, et c'est un peu un pèlerinage que Baptiste accomplit en ce jour de brume grise et froide. C'est aussi en l'honneur de Camille, pour qui on réserve une chaise vide et un couvert, qu'on l'invite à partager le repas de l'amitié. En ce mois de novembre qui est aussi celui des morts, après avoir évoqué Camille sa vie et ses souffrances, Baptiste repart, avec un dernier salut aux vivants. La maison où Camille avait vécu est vendue, les livres dispersés eux aussi, la page est tournée, la vie reprend son cours, le souvenir de Camille reste cependant, en mots noirs sur les pages blanches, parce que les morts ne le sont vraiment que lorsqu'on ne pense plus à eux.
Ce n'est pourtant pas un éloge funèbre, de ceux qui sont officiels, compassés, faussement émus et même un peu hypocrites. Ce sont quelques phrases qu'on jette sur le papier, dans le secret de sa peine pour lui dire tout ce qu'on à pas pu ou su faire de son vivant.
L'univers de Pocentek, il est vrai découvert par hasard dans une bibliothèque, m'émeut toujours et ne me laisse point indifférent (La Feuille Volante n° 414-417-420-421-516) autant par les gens humbles qu'il choisit d'évoquer que par la poésie que ses mots distillent. Ici, les morts parlent aux vivants. On exorcise leur absence à travers les objets qui leur ont appartenu et qu'on garde (le briquet par exemple). Les vies qu'il choisit d'évoquer laissent une empreinte en creux, qui pourrait être aussi éphémère qu'une trace sur le sable. C'est une musique mélancolique tout en pudeur et en subtilités.
Comme je l'ai déjà dit dans cette chronique, l'éditeur propose ce livre à la lecture mais il faut préalablement en couper les pages, comme dans les anciennes publications. Cette démarche n'est pas fastidieuse, au contraire, elle fait partie intégrante de la lecture, lui donne sa dimension terrienne et individuelle, met en condition le lecteur pour le message à recevoir et le temps à y consacrer.
© Hervé GAUTIER - Janvier 2012.
-
LES GENS DU HUIT MAI (et d'autres quartiers du monde) - Jean-François POCENTEK
- Par ervian
- Le 22/04/2011
- Dans Jean-François Pocentek
- 0 commentaire
N°516 – Avril 2011.
LES GENS DU HUIT MAI (et d'autres quartiers du monde) - Jean-François POCENTEK – Éditions la contre-allée.
Comprenez, « les gens de la place du 8 mai 1945», une date qui marque la fin de la deuxième guerre mondiale et qui s'inscrit probablement en lettres blanches sur fond d'émail bleu de la commune d'Aulnoye-Aymerie (Nord). Ce sont eux qui ont inspiré cet ouvrage à l'auteur qui préfère parler d'une « création » à partir de témoignages collationnés entre octobre 2008 et mars 2009, lors d'une « résidence » dans cette commune. C'est donc à la fois un livre de souvenirs, à la fois intimes et collectifs, des lambeaux d'enfance avec des images qu'on n'oublie pas « J'allais lui raconter tous les genoux écorchés, les chaises posées sur le devant des portes, les fils à linge décrochés quand le charbon arrivait... », un retour aussi dans un décor familier mais presque fantomatique « Les parpaings ont commencé de clore les yeux et la bouche des maisons des en-allés, pour que d'autres, en mal de logement, ne puissent venir y prendre refuge ».
Dans ce « pays d'enfance » qui « a des allures de terre sacrée » on évoque des jeux où parfois on endosse la panoplie d'un personnage ( Un-deux-trois Cho-co-lat-Meu-nier – Zorro, Thierry la Fronde...), l'arrivée (tard, au bloc Havret) de la télé en noir et blanc qu'on allait voir chez un voisin ou qui marquait un moment de la journée. « Trois bouts de musiquette et la boite à nostalgie se remet en route ». Tout n'est cependant pas idyllique et là comme ailleurs « le sublime a dû côtoyer le grotesque comme le rire tutoyait les larmes ».
A travers les souvenirs des habitants, on remonte à l'après-guerre des bidonvilles, de l'entre-aide, de la solidarité, de la débrouille. On vivait simplement « oui, c'était une autre époque, Ginette... », puis c'est l'arrivée du confort avec le déménagement au bloc Havret, la rencontre d'anciens et de nouveaux voisins, un monde qui se recompose, comme avant. Et quand on quitte ce paysage pour quelques rares jours de vacances, ce n'est jamais pour longtemps !
Le Nord, c'est l'accent qui chuinte, la baraque à frites, l'usine, les jardins-ouvriers, la Sambre, le canal et les péniches qui passent, la messe du dimanche, la lutte des classes, l'école pour le enfants, le cimetière où l'on parle aux morts... Le Nord, c'est la pluie, le ciel bas, mais aussi une terre de migrants venus du soleil, Arabes ou Italiens, à cause du travail qui apportent avec eux leurs coutumes. Sylvie ne sait plus si, ici, place du 8 mai, elle a vécu les meilleures ou les pires années de sa vie, parce qu'il y avait le soutien des autres mais aussi la violence, la drogue qui l'ont rendue peureuse et méfiante. « Qui a menti Nordine ? Personne. » et tout se brouille avec l'alcool, la combat syndical, les fins de mois difficiles, le licenciement, le chômage et les maigres allocations, la révolte contre les injustices, le mal de vivre qu'on essaie d'oublier « Mais ce n'est pas peine de trop touiller ce qui est du jus saumâtre ».
Sur cette place, il y a aussi une bibliothèque où l'on vient lire, emprunter des livres ou des disques, faire « provision de rêve » ou faire des rencontres pour le simple plaisir de voir des gens ou des silhouettes de femmes. On y parle de soi, on vient y faire partager un peu de sa vie, les joies, les peines, les doutes, les deuils... . Il y a ceux qui restent et ceux qui chaussent leurs « semelles de vent » parce que l'appel de l'ailleurs est le plus fort... et qui reviennent ! Ce n'est pourtant pas un lieu idyllique et la violence, parfois gratuite, s'y exprime aussi. Ici on lit les auteurs au hasard ou en respectant l'ordre alphabétique, c'est selon, mais il y a aussi les conseils et le sourire de « la dame aux livres »...
Ce lieu va être « déconstruit » (pas démolis) mais malgré ce qu'en dit l'auteur il y a toujours un peu de tristesse dans ce mot, même si ce qui viendra sera plus moderne, plus fonctionnel...
J'ai rencontré les textes de Pocentek par hasard sur les rayons d'un bibliothèque publique. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire (La feuille volante n° 414- 417- 420- 421) j'ai bien aimé cette belle écriture qui est le témoin de « semaines de collectage de paroles d'habitants », elle parle simplement de ces tranches de vie, des gens, de leurs malheurs et de leurs moments de bonheurs, leurs souvenirs, leurs secrets. J'aime cette petite musique des mots, cette nostalgie douce que j'ai retrouvées ici avec autant de plaisir.
©Hervé GAUTIER – Avril 2011.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE CAHIER DE CAMILLE - Jean-François POCENTEK
- Par ervian
- Le 26/04/2010
- Dans Jean-François Pocentek
- 0 commentaire
N°420– Avril 2010
LE CAHIER DE CAMILLE – Jean-François POCENTEK – Plein Chant.
Décidément, j'aime bien cette écriture, je la trouve poétique, mais pas seulement. Elle est évocatrice de ce paysage un peu désolé des terrils et des personnages «Ces hommes aux poumons mangés (qui) toussaient et crachaient la haine de leur ouvrage passé ...qui ne voyaient pas plus loin que le bout de leur coron »...
Camille, 70 ans, attend la mort, boit de la bière et ouvre son cahier pour cet anniversaire. Il y décrit sa maison, prise dans la courbe d'une rivière tout près de la Belgique, pleine d'humidité et d'araignées et habitée par ses parents, son père, mineur, « (qui) n'était pas fier de son métier mais ne savait faire que cela ». Par tradition parce que ici, comme ailleurs aussi sans doute, on apprend le métier de son père sans se poser de question, il était destiné à la mine. Sa mère refusait pour son fils cette chose inévitable, mais la Compagnie a eu le dessus parce qu'elle seule commande et donne à chacun « le logement, le travail, les sous et les soins ». C'était sans doute dans l'ordre des choses.
Avant, il y a eu l'école, c'était bien l'école, avec la récréation, les plumes Sergent-Major, les ardoises et l'encre violette « comme une aurore trop rare ou un crépuscule oublié », les livres couverts...
Ce cahier, c'est pour parler de la mine (« mais un cahier ce n'est pas si vaste »), pourtant c'est toute une vie rythmée par le travail , les grèves, un long chemin de 43 ans de noir, de chaud, d'humidité, de honte et d'humiliations aussi parce que le monde du travail est sans pitié, 43 ans pour atteindre la retraite!
Voilà, à 55 ans c'est la liberté, et avec elle celle d'écrire ses souvenirs, de marcher qui est un luxe quand, toute sa vie, on a rampé dans des boyaux de mine étroits où le « dos tente de soulever les mille mètres de croute terrestre qui le tiennent prisonnier des sous à gagner », luxe de respirer, d'exister, de profiter de cette « matutinale liberté d'homme maintenant de terre et de campagne, je pisse n'importe où avec l'innocence du pur ».
Mais la mine se rappelle à son mauvais souvenir « Elle est là encore, cette putain de mine, elle est là dans mes poumons et ... je crache de la boue, je crache mon gavage de poussière et ... ça brille comme un diamant noir ou parfois des rubis fulgurants ». Il est urgent de porter témoignage et de noircir ce cahier de souvenirs, des siens comme de ceux des autres, comme le charbon a noirci sa vie « Je marchais à nouveau, là sur le quadrillage bleu léger que m'offrait chaque page. Des carreaux pour le bonheur, d'autres pour le malheur, une mosaïque d'amour, de mort et d'indifférence ». Mais le vrai témoignage, c'est celui de sa propre vie qu'il confie à la page blanche « Ce soir je me mets au centre de la page, je me glisse entre les petits carreaux, je me cache derrière la ficelle blanche qui empêche ma vie de s'éparpiller ». Pourtant, cette nouvelle vie, celle de la retraite, celle de la liberté, cette dernière longueur, il la parcourra seul, comme il a vécu sa vie entière et son enfance quand sa seule distraction était « d'aller au bout du jardin » qui « était la limite, la fenêtre de notre monde ». A 70 ans, Camille, par amour des chiffres ronds, décide de mettre un terme à cette équipée du souvenir, pour ne pas aller à l'hôpital qui réclame sa charretée de morts qui ont momentanément échappé à la mine. Alors, une dernière fois, une dernière bière, un dernier morceau de lapin, un dernier café et, s'étant apprêté comme quelqu'un qui « a traversé la vie en ayant peur de déranger », il écrit l'épilogue sur ce dernier cahier qui succède à tant d'autres , usés et flétris, parce que celle qu'il attend, qu'il a toujours attendue n'est pas là. Il va tracer les derniers mots qui feront escorte à une vie banale qui maintenant s'en va « Moi qui ai tant aimé écrire, je dis à mon cahier que je ne peux emporter. La fin de l'histoire y est écrite ».
©Hervé GAUTIER – Avril 2010.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LES MANGEURS DE POMMES DE TERRE - Jean-François Pocentek
- Par ervian
- Le 16/04/2010
- Dans Jean-François Pocentek
- 0 commentaire
N°417 – Avril 2010
LES MANGEURS DE POMMES DE TERRE - Jean-François Pocentek – Plein chant.
Malheureusement, j'ai commencé à lire l'œuvre de Pocenteck à l'envers, mais je finirai bien par m'y retrouver. Ce récit en annonce d'autres qui feront sans doute partie de ma bibliothèque personnelle ou imaginaire.
Le titre évoque d'emblée un tableau de Vincent Van Gogh. D'ailleurs, le décor, c'est un peu cela, le Nord de la France et ses corons, une famille de mineurs et un petit garçon qui nous livre ses souvenirs, des dimanches interminables au rituel immuable, le costume un peu raide, la cravate à élastique, le repas dans la salle à manger, la visite du grand-père, ses encouragements pour l'école parce que ainsi l'enfant échappera à la mine [« à chaque rencontre avec mon grand-père, il m'a embrassé le front et donné une pièce »], l'hiver, la chambre sans chauffage, le café au lait avec des tartines épaisses, la toilette sur l'évier... L'école publique, les culottes courtes, les jeux guerriers de la cour de récréation qui permettaient tous les possibles et s'inspiraient des bandes dessinées, le tableau noir, l'encre violette, les cours de morale, les plumes Sergent-Major avec ses pleins et ses déliés, les amitiés et les brouilles entre camarades...
C'était aussi la mort, parce qu'un enterrement est toujours une occasion de rassembler une famille dispersée dont les membres ne se connaissent plus, on promet de se revoir, mais pas pour une occasion funèbre et on oublie vite... C'est l'horloge qu'on arrête et les miroirs qu'on voile, le cortège des visites, la casquette à la main, l'accompagnement du cercueil, la visite annuelle de la Toussaint au cimetière avec ses incontournables pots de chrysanthème et son souvenir ravivé une fois l'an. Mais aujourd'hui l'enfant a grandi, habite ailleurs dans un pays de pâture, la mine s'est arrêtée et le chevalement rouille. Il ne reste que les souvenirs, ceux du triumvirat, maire, curé et instituteur, mais le premier est maintenant plus attentif à sa carrière politique qu'au bien-être de ses concitoyens, les vocations sacerdotales se font plus rares, seul le maître d'école perdure encore... Le décor est complété par l'inévitable bistrot où tous les hommes se retrouvent, et même parfois quelques femmes...
Il y a aussi la figure des gens qui peuplaient ce microcosme, ils sont comme des fantômes avec leur cortège de remords et de nostalgie parce que, contrairement au contes de l'enfance, le monde n'est pas beau, les turpitudes existent, les hommes et les femmes sont loin d'être semblables au portait idyllique des fables.
L'évocation se poursuit en Bretagne là ou le narrateur se réfugie parce que le souvenir est trop fort, pour y faire d'autres rencontres ou des retrouvailles amicales renouvelées. C'est toujours aussi poétique et nostalgique, et cela me plait bien comme l'allégorie de fin qui conjugue une belle image de femme et un air de violoncelle.
Je reste attentif au parcours créatif de cet auteur. Il m'intéresse.
© Hervé GAUTIER – Avril 2010
http://hervegautier.e-monsite.com
.
-
L'ECLUSE DES INUTILES - Jean-François Pocentek
- Par ervian
- Le 12/04/2010
- Dans Jean-François Pocentek
- 0 commentaire
L A F E U I L L E V O L A N T E
La Feuille Volante est une revue littéraire créée en 1980. Elle n’a pas de prix, sa diffusion est gratuite,
elle voyage dans la correspondance privée et maintenant sur Internet.
N°414 – Avril 2010
L'ÉCLUSE DES INUTILES - Jean-François Pocentek – Éditions Lettres vives.
D'abord il y a le livre, un objet qu'on tient dans ses mains mais dont il faut couper les pages avant de les lire; cette opération un peu nostalgique laisse toujours des barbes de papier sur la tranche. Au coin de chaque feuillet qui a échappé à la lame on trouve même un peu du suivant et cela rappelle l'enfance, donne l'image d'une certaine imperfection qui me plait bien quand tout aujourd'hui tend vers l'excellence... On peut donc entamer la lecture!
Le titre ensuite dans lequel figure le mot « inutiles » qui résonne bizarrement dans cette société où chacun doit être efficace et surtout étaler sa réussite sans quoi elle n'a aucune valeur!
Le décor enfin, celui du Nord de la France en novembre, un canal très ordinaire, une eau sombre avec une écluse et quatre maisons perdues. On y accède à pied et dans l'une d'elle, celle de Mathilde, on vient y partager un repas en l'honneur d'on ne sait quoi, la mort d'une chienne ou la venue de la suivante. Images d'un temps immobile, de gens plus ou moins exclus de cette société parce qu'ils sont sans travail ou infirmes, sorte de « bernard l'ermite » occupant des coquilles vides qui passent dans cette vie et finissent par mourir parce que là est la condition de tous les hommes. Que ce soit Marceau, l'ancien maître de forge, Marcial l'infirme, Marthe, Mathilde, l'enfant immobile ou le narrateur, simple employé d'un bureau d'objets trouvés près de la gare, ils sont tous porteurs d'un message, ont tous une histoire à raconter, mais le font en silence et c'est pour cela qu'ils partagent ce repas, peut-être aussi parce qu'ils se ressemblent tous, qu'ils sont tous des anonymes.
C'est une sorte de rituel autours de la cuisinière à charbon qu'on ferme avec des cercles de fonte, du tabac à fumer qu'on roule entre ses gros doigts, des odeurs domestiques, le son d'un carillon, les arômes du café, les silences et l'économie des mots qu'on prononce en hommage aux morts, le vin qu'on boit dans des verres entrechoqués... On y évoque le passage sur terre de ceux qui ne font plus partie des vivants mais qui « ont marqué la mémoire des lieux », ont aimé cette vie parce qu'elle est un bien unique auquel on s'accroche parfois désespérément. A la fin de ce repas, on avance vers le canal, comme on mènerait une procession, pour aider à la digestion ou voir le paysage...
Puis on se quitte parce que c'est la règle et que le temps a ses exigences, avec en prime le chagrin, l'eau dans les yeux, mâtinés si on veut y croire, par l'espoir d'un retour, d'une nouvelle rencontre, avec le rituel des embrassades, des accolades, des serrements de mains et des paroles. Et puis le temps change, les maisons sont détruites, les gens meurent ou disparaissent ...
Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de ma vieille attirance pour la poésie, pour la musique des mots, pour l'ambiance que distille ce texte, mais j'ai bien aimé ce livre et j'ai eu envie de tourner les pages de ce qui n'est peut-être pas un roman. J'y ai entendu une sorte de musique un peu triste mais aussi très douce, un monde différent devant lequel on passe parfois sans le voir tant il est ordinaire. Il est question de l'éclusier, parce que l'écluse justifie sa présence [il parle aussi à la première personne, comme le narrateur] il est présent et absent à la fois, à contre-champ, à contre-jour, à la fois gardien de ce petit bout de planète, veilleur, guetteur... Comme les autres personnages il ressemble à des fantômes. Ils parlent de la petitesse du monde qui les entoure et dont il ne font même plus partie. C'est que le peuple du canal est fait de « ramasseurs de trésor », de « cueilleurs de grenouilles », de « coupeurs de queues de rat » autant de membres d'une communauté qui s'identifie au canal, à son chemin, à ce paysage lui-même!
Et puis il y a les mots qu'on porte en soi, parfois longtemps et qui finissent par sortir un beau jour ou une belle nuit, sans crier gare, parce que c'est l'heure, parce qu'ils en ont décidé ainsi. Les gens pressés appellent cela l'inspiration, mais on n'est pas forcé d'acquiescer à leurs allégations. Pourtant ces mots sont maintenant emprisonnés dans un livre, imprimés sur des pages qu'ils noircissent, à jamais exprimés pour des lecteurs innombrables, passionnés ou indifférents, c'est selon!
© Hervé GAUTIER – Avril 2010
http://hervegautier.e-monsite.com
.