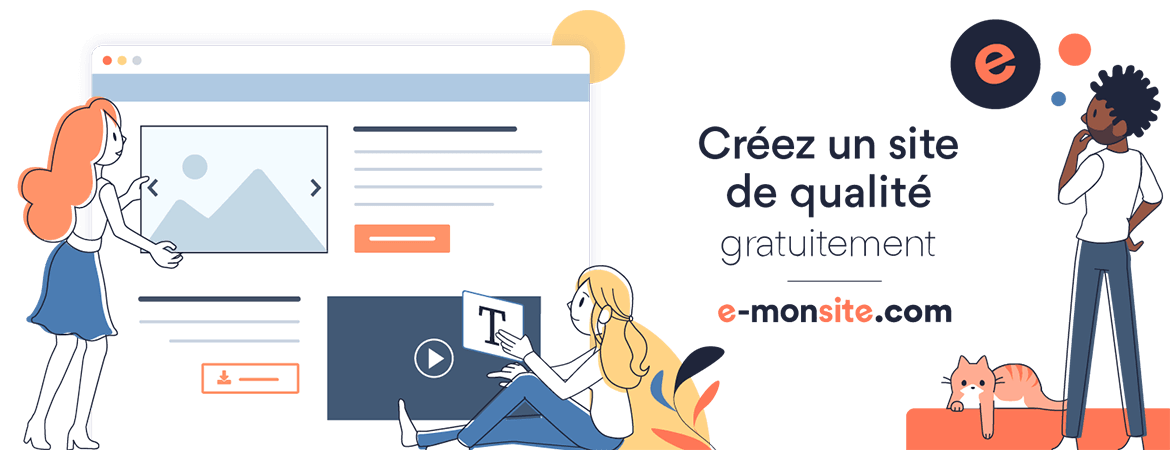Quelques mots sur Camilo-José CELA.
- Par ervian
- Le 01/04/2009
- Dans Camilo-José CELA.
- 0 commentaire
N° 239 – Avril 2002
Quelques mots sur Camilo-José CELA.
Ce que je veux retenir de cet écrivain espagnol, ce n’est pas sa vie, au demeurant assez peu connue qui s’est déroulée en grande partie sous la dictature franquiste qu’il a, par ailleurs, servie, ce n’est pas son Prix Nobel de littérature non plus, pas sa mort survenue récemment mais peut-être son style découvert à travers deux ouvrages « La famille de Pascal Duarte » mais surtout « La ruche ».
C’est une opinion personnelle et sans doute assez peu partagée, mais il me semble que son style est bien peu espagnol, ou, à tout le moins reflète bien l’époque dans laquelle a vécu CELA. Il me paraît être parfaitement le reflet de cette dictature fasciste qui fut pendant longtemps le quotidien de l’Espagne.
On ne peut, certes pas se limiter à la lecture de deux ouvrages, ma si « La famille de Pascal Duarte » qui relate la vie d’un condamné à mort et évoque avec force la fatalité et le destin qui pèse sur l’homme, « La Ruche » est sans doute son livre le plus important, j’entends par-là le plus révélateur de ce qui fait la spécificité de cet écrivain. Ici, il procède par petites touches, comme un tableau pointilliste ou comme une mosaïque qui finalement fait une grande fresque. Chaque paragraphe est un élément du décor qui, pris isolément est, en quelque sorte sans importance, mais qui, réuni aux autres devient l’élément indivisible d’un tout qui fait le roman. Le style, volontairement plat et sans relief ajoute à cet ambiance.
Nous le savons, l’action de « la ruche » se passe à Madrid en 1942. Elle respecte la classique unité de temps et de lieu. Quant à celle d’action, c’est un peu une impression d’inaction que ressent le lecteur parce que c’est là une somme d’histoires sans importance, mettant en scène des gens sans importance, en apparence du moins. C’est pourtant le quotidien ordinaire qui est ici décrit avec ses bassesses, ses rencontres, ses anecdotes, ses amours et ses fortunes qui se font et se défont, le temps qui passe… C’est au spectacle de la simple condition humaine dans tout ce qu’elle a de plus simple que nous convie l’écrivain à travers la peinture d’une multitude de personnages(L’éditeur remarque qu’ils sont en réalité au nombre de 348, certains sont réels, d’autres imaginaires). C’est pourtant dans le café de Dona Rosa que commence l’ouvrage, cet établissement si prisé des Espagnols qu’il symbolise la cité. Dans la ville grouillent des êtres vivants qui naissent vivent et meurent. Les personnages sont en réalité de « pauvres types » qui regardent passer le temps en sirotant une consommation chez Dona Rosa.
Le temps est en effet le deuxième élément de cette écriture. Il est à la fois fatalité, régularité inexorable et révélateur de la monotonie de l’existence humaine. Que sommes-nous au regard de l’éternité, qu’est notre vie sinon un misérable souffle ? Il passe pour chacun, sinon de la même manière, à tout le moins avec finalement le même rythme, le jour, la nuit et cela recommence, pour tout le monde pareil…
Il peut cependant être dégagé trois idées. C’est tout d’abord un roman collectif, comme l’indique d’ailleurs le titre lui-même, comme si la vie était réduite à sa seule dimension biologique, sans idéal, une sorte d’existence primitive !
La vie est donc inerte, fermée, absurde, étouffante, c’est là la deuxième idée.
La troisième idée est sans doute le sexe. Cela peut paraître étonnant dans cette période, dans ce pays où ce tabou est roi, ou la religion commande tout et le pouvoir politique asservit le peuple, ses aspirations, sa culture. Le sexe ici est à peine évoqué, à travers un mariage arrangé, la prostitué qui se vend pour manger, la jeune fille qui doit rester vierge pour son mari qui sera nécessairement le seul homme officiel de sa vie, mais aussi, à mots couverts l’adultère, le mensonge.
« Ils mentent, ceux qui veulent déguiser la vie à l’aide du masque grimaçant de la littérature » écrit Camilo-José CELA dans une note lors de la première édition tout en laissant au lecteur le soin d’apposer sur son livre l’étiquette qu’il jugera bon.
Dans une deuxième note publiée quatre ans après, il précise que « La Ruche » est un cri dans le désert, ce cri n’est pas tellement strident ni trop déchirant ».
Camilo-José CELA n’est pas l’égal en littérature d’un Garcia-Lorca, d’un Unamuno, d’un Antonio Marchado, ou d’un José Ortega y Gasset. La guerre civile et l’exil avaient anéanti les grands intellectuels de ce pays. C’était bien un désert culturel qui y régnait et le mérite de Camilo-José CELA est de s’être fait l’écho de cet « existentialisme noire » qui avait cours, alors en Espagne. Pour ma part, je choisis d’y voir une peinture sinon pessimiste à tout le moins réaliste de la vie à cette époque.
Il n’est cependant pas inutile de rappeler que, photographie de la société de ce temps, ce livre n’a pu être édité en Espagne, à tout le moins au début. La première édition fut argentine, la deuxième mexicaine. C’était peut-être là le signe d’une société qui ne voulait pas voir ses réalités en face !
©Hervé GAUTIERhttp://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg
Ajouter un commentaire