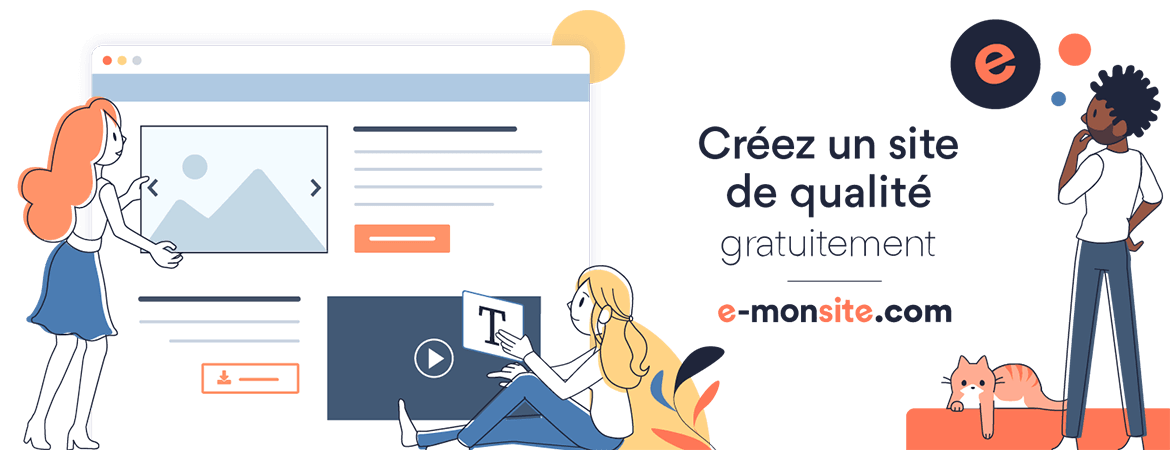Jacques CHESSEX
-
L'OGRE - Jacques CHESSEX - Grasset [Prix Goncourt 1973]
- Par ervian
- Le 01/04/2009
- Dans Jacques CHESSEX
- 0 commentaire
N°320– Novembre 2008
L'OGRE – Jacques CHESSEX – Grasset [Prix Goncourt 1973]
Automne 1972, Jean Calmet, la quarantaine, célibataire, professeur de latin au lycée de Lausanne assiste, en compagnie de ses frères et sœurs et de sa mère, aux obsèques de son père, « le Docteur » Paul Calmet. C'était une force de la nature, aimant son travail, le vin, les servantes d'auberge et allant même jusqu'à dépuceler la jeune fille que son fils courtisait avec une gauche tendresse. Un « personnage » mais surtout le type même du tyran familial! Devant lui chacun a réagi à sa manière. La mère qui a vécu dans son ombre, soumise effacée et veule. La vie de Jean « aurait été une autre vie si elle s'était révoltée ». Il lui en veut de son attitude démissionnaire. Elle n'a été toute sa vie, face à ce mari abusif «[qu'] une espèce de vielle souris effacée et terrifiée ».Ses frères Étienne, l'ingénieur agronome avait fui cette famille et Simon, l'instituteur « le préféré de [la] mère » s'intéressait aux oiseaux, Hélène était devenu infirmière et Anne courait le monde et changeait souvent d'amants. Face à eux Jean, le cadet, avait choisi l'enseignement du latin. Il est un professeur aimé de ses élèves. Ils avaient tous quitté cette famille assassine, mais lui était resté, sans oser réagir, à la disposition de ce père qui l'avait tué à petit feu.
De cet homme craint, aimé bizarrement, admiré, mais surtout honni, il ne reste plus que des cendres enfermées dans une urne que la famille va aller déposer dans un columbarium. Jean n'a pas tué son père comme il l'aurait voulu, mais ce dernier n'est plus rien. Le temps paraît suspendu et chaque instant consacré au choix des gestes est relaté avec une lenteur maladive et obsédante, noyé dans un faux chagrin de circonstance. Le mouvement qui présidait à l'action paternelle quotidienne trouve son « double-opposé » dans la description minutieuse de toutes des phases de la cérémonie! Il y a l'absence du père et avec elle une sorte de libération. Tout va enfin devenir possible, les réconciliations, les retrouvailles, tout ce temps perdu qu'on va enfin pouvoir gommer! La vie, en effet, continue, comme on dit, et avec elle le temps qui s'écoule, la beauté des femmes, la nature qui renaît, les cours qui reprennent. L'auteur distille cette certitude à travers des descriptions poétiques, lumière et émotions, ombres et images douces, amours volées avec cette « fille aux chat », nom donné par lui à cette jeune fille, étudiante aux Beaux-Arts, dont il devient l'amant maladroit et impuissant et qui le plongea tout de suite « dans la joie mystérieuse et folle de Dionysos ». Cette image pose question par l'interprétation que le lecteur peut en donner. Ce n'est pas ici le Bacchus latin, dieu du vin de la vigne et de ses excès, mais le dieu grec, errant, de nulle part et de partout, né « de la cuisse de Jupiter [Zeus]» qui avait une place importante dans le rituel de la mort et de la renaissance. Il était lui, Jean Calmet, le fils modeste et égaré de ce Zeus tout-puissant, fils de son père, fils du « docteur »...
L'épisode du café où Jean sort de ses gonds dans le seul espoir d'exorciser la présence latente de ce père mort qui pourtant l'obsède toujours, le dévore, est révélatrice. Même les exercices érotiques de Thérèse, sa partenaire ne suffisent pas à le guérir de ses obsessions! Il ne trouve son plaisir que dans la masturbation solitaire! L'entrevue chez le Directeur Grapp n'arrange rien. Il est un peu le substitut de son géniteur envahissant dont il évoque d'ailleurs la figure et qui lui parle comme un père! Pourtant il se réfugie auprès d'une prostituée, cette Pernette- Denise, elle -même porteuse de l'image du père, « féminin de Dionysos, la sœur, la fille, la compagne exaltée du divin! ». Cette substitution du Directeur prend toute sa mesure lors de la révolte des élèves qui révèle encore une fois la figure de Grapp, autoritaire, dominateur, colérique, comme le docteur Paul Calmet!
Pourtant l'ombre tutélaire du géniteur continue à planer sur Jean. Sa vie entière lui revient à la figure, cette vie torturée par ce père qui n'a même pas respecté ses envies gauches d'adolescent, qui n'a pas su comprendre ses interrogations et ses craintes de l'avenir, qui l'a humilié. Loin de constituer une libération, la mort du père accentue au contraire l'emprise malsaine qu'il avait sur Jean. Son pouvoir s'aggrave au point d'être plus présent, plus dévorant que lorsqu'il était vivant. Il redevient cet « ogre » qu'il n'a jamais cessé d'être. Cette mort est comme un nouveau rendez-vous où ce père, plus présent qu'avant qui a toujours fagocité l'existence même de ce fils. A chaque instant de la vie de Jean, son père a été présent au mois en pensées, au point qu'il a annihilé chez ce fils toute la joie qu'il pouvait tirer de son quotidien. Que ce soit ses amours avec cette étudiante des Beaux-Arts, Thérèse, qui pourrait être sa fille, la maladie et la mort d'une de ses élèves, la rencontre fortuite d'un hérisson un soir d'été, ou la cérémonie prémonitoire du rasage, tout cela semble enveloppé par le regard du père omniprésent.
A l'occasion d'une rencontre et d'un dialogue un peu surréalistes avec un chat, Jean prend conscience de sa propre mort, de son néant. L'auteur nous dit qu'il prend malgré tout conscience de son inexistence personnelle, de son défaut d'appétit de la vie et ce malgré la disparition de ce père enfin mort. Cette remarque est particulièrement affirmée dans l'épisode sans joie qu'il vit avec la prostituée.
La jalousie que Jean ressent à la liaison de Thérèse et d'un de ses élèves ne suffit pas à le faire changer face à la vie, bien au contraire. Il revit, en quelque sorte et mutatis mutandis, l'échec qu'il a eu au temps de son adolescence avec cette jeune fille qui lui préféra son père. Cette relation révèle son impuissance et souligne encore davantage sa volonté de se sous-estimer, de se rabaisser à ses propres yeux. Il est l'archétype de celui qui ne s'aime pas! Sa mère elle-même ne peut rien face à son mal de vivre.
Les femmes apparaissent comme pouvant être l'antidote à cette omniprésence du père mort mais finalement se révèlent incapables, même par l'amour qu'elles veulent lui donner, ou par leur seule présence, d'exorciser cette absence de goût pour la vie! « Je suis donc fait pour souffrir » se répète-t-il comme en se complaisant dans cette affirmation, craignant peut-être que son père ne revienne pour l'anéantir tout à fait!
Il ne peut effectivement plus réagir même face au manipulateur nazi auquel il ne peut même pas résister au point d'insulter son ami juif. Lâcheté ou désespérance, signe de décrépitude? Il se sent peu à peu happé par la mort sans pouvoir ou sans vouloir y résister, un peu comme si ce père décédé pesait encore sur son fils
Comme j'ai eu souvent l'occasion de l'écrire dans cette chronique, la valeur d'un livre ne réside pas dans sa récente publication ni même dans les prix et distinctions qui lui ont été attribués. Seule la permanence du message qu'il renferme m'intéresse.
Hervé GAUTIER – Novembre 2008.http://hervegautier.e-monsite.com