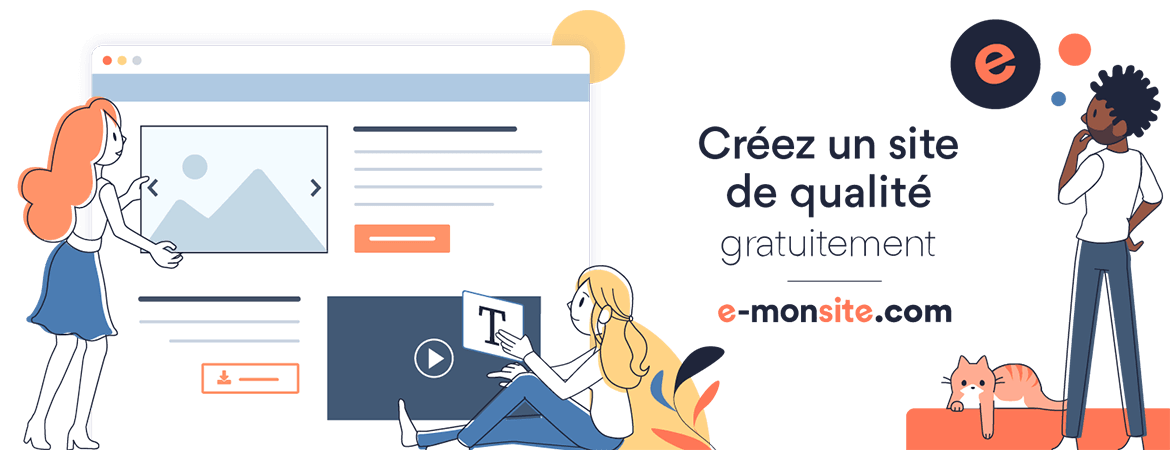LE DERNIER VISAGE - Alvaro MUTIS - Editions GRASSET.
- Par ervian
- Le 30/03/2009
- Dans Alvaro Mutis
- 0 commentaire
Janvier 1994 - n°180
LE DERNIER VISAGE - Alvaro MUTIS - Editions GRASSET.
Le lecteur habituel de cette chronique sait quelle importance j’attache à l’oeuvre d’Alvaro Mutis sans que je puisse vraiment en analyser les raisons profondes. Comme je l’ai déjà écrit, il fait partie des écrivains qui me procurent durablement de l’émotion et s’attache mon attention dès la première ligne du texte. Bref, il m’étonne!
Cela tient sans doute à la qualité du style, simple et évocateur, au dépaysement que prête chacun de ses romans. L’auteur distille cette alchimie délicate et secrète qui transforme une histoire simplement racontée avec des mots en un récit passionnant suivi du début à la fin sans que l’ennui s’insinue dans la lecture et qui fait dire au lecteur qu’il a bien aimé le roman.
Je parlais à l’instant de l’importance du style. Il est certes du à la qualité de la traduction mais ici Mutis ne se départit pas de cette écriture poétique qui a été révélée par la publication des éléments du désastre et un récit tel que « Sharaya » rappelle qu’il est aussi un bon poète.
Il a aussi le sens de la formule évocatrice, croquant dans l’instant l’attitude d’un personnage « Il avait l’habitude de se balancer sur ses grands pieds comme le font les préfets de collège religieux, donnant une autorité à la fois humble et formidable à toutes les observations qui sortait de la gorge grasse de bedeau. Il y avait quelque chose dans son allure d’un cow-boy qui eût partagé ses loisirs entre la prédication et l’homéopathie ».
Ici il s’agit non d’un roman comme d’habitude mais d’une succession de récits et qu’on lise « La maison d’Araucaïna » ou « le dernier visage », il y a cette omniprésence de la mort rappelée par cette formule lapidaire dont l’idée est constamment présente dans l’oeuvre « En vérité nous tombons en naissant dans un piège sans issue ».
L’impuissance de l’homme devant le trépas, l’inutilité, peut-être de l’oeuvre qu’il a accomplie durant son passage sur terre, le sentiment d’abandon qu’il éprouve face à l’indifférence voire l’hostilité des autres hommes, la solitude qui fait partie de la condition humaine... tout cela est dans le décor intérieur des personnages.
Il y aussi ces figures de femmes énigmatiques, à la fois mères et compagnes, épouses et maîtresses qui donnent le monde aux enfants, soignent les blessures et préparent la nourriture, celles aussi qui donnent du plaisir aux soldats et aux hommes de passage. C’est que l’univers romanesque d’Alvaro Mutis s’inscrit dans le quotidien de cette Amérique Latine en proie à une perpétuelle révolte contre la misère et l’oppression, l’éternelle révolution et la quête de la liberté avec en toile de fond cette lutte armée dispensatrice de violence aveugle et de mort qui brise et génère à la fois ce cycle de la paix et de la guerre, de la répression et des prisons où la vie se déroule autrement.. Ici, c’est la peur des gens, la drogue pour aider à supporter l’enfermement mais aussi, au bout du chemin la mort qui est une manière de libération...
Il y a aussi le récit dit « véridique » qui met en présence le personnage de Maqroll El Gaviero sans qui une oeuvre de Mutis n’en serait pas réellement une. Ce personnage mythique qui doit bien prendre vie dans l’existence d’un humain, à moins que lui-même ne soit un savant dosage entre imaginaire et réalité est ici en compagnie d’un personnage bien réel celui-là, le peintre colombien Alejandro Obregon. Il tisse avec lui une amitié solide, corroborée par la fréquentation assidue des femmes et des bars.
Il me surprendra toujours ce Maqroll, non seulement par son besoin insatisfait d’errances mais surtout par sa culture qui fait de lui quelqu’un dont le jugement est recherché et apprécié! Ici, le Gabier, via Mutis dans le rôle « ingrat de simple intermédiaire » donne son avis sur la peinture d’Obregon qu’il qualifie de « peintre angélique mais d’anges du sixième jour de la Création ». Mieux, il est pour lui un révélateur, un prétexte puisque, à son contact il va faire évoluer sa peinture. Obregon va, grâce à lui, »peindre le vent », pas celui qui passe dans les arbres (celui) qui ne laisse pas de traces, le vent si pareil à nous, à notre vie, à cette chose qui n’a pas de nom et file entre nos mains sans que nous sachions comment. »
Ajouter un commentaire