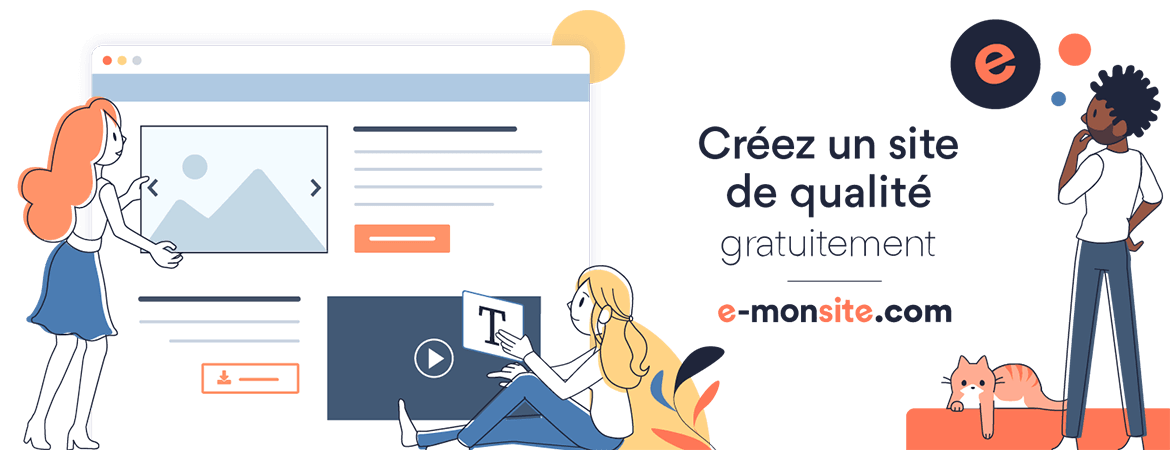L'ECRITURE OU LA VIE - Jorge SEMPRUN- Editions Gallimard.
- Le 11/04/2009
- Dans Jorge SEMPRUN
- 0 commentaire
N°232
Décembre 2000
L’ECRITURE OU LA VIE - Jorge SEMPRUN- Editions Gallimard.
D’emblée, le titre du livre m’a déconcerté.
Pouvait-on concevoir qu’on opposât l’écriture à la vie, cet acte qui, par excellence est synonyme d’existence ?
J’ai donc lu ce récit, attentif à une explication de ce qui me semblait être un paradoxe.
Le texte révèle une partie de la vie de l’auteur et plus précisément son séjour au camp de concentration de Buchenwald où il fut enfermé comme prisonnier politique, les rencontres qu’il a pu y faire, les expériences qu’il en a retirées.
A l’époque, jeune étudiant communiste Espagnol mais vivant en France, il pensait que l’écriture qu’il pratiquait lui-même dans la poésie pouvait exorciser la mort. Il s’est aperçu qu’elle y renvoyait ! En réalité il était un véritable apatride, ni Français ni Espagnol, mais un communiste convaincu, un être qui est passé à travers la mort où plus exactement que la mort a traversé et quand en avril 1945, les troupes du général Patton ont libéré le camp, c’est un peu comme s’il ne restait de lui que les yeux, des yeux hagards qui ne parvenaient plus à croire à la fin de cet enfer, à la vie enfin redevenue possible, libre, loin des hurlements des SS, des mauvais traitements, des fours crématoires… Ces yeux qui jadis avaient eu plaisir à regarder les femmes, ses yeux aussi qui faisaient son charme, résumaient ce qu’il était à cette époque, dans ce camp soudain tranquille, mais que les oiseaux eux-mêmes avaient abandonné à cause de cette insupportable odeur de chair humaine brûlée qui retombait sur le camp en une sorte de suie !
Son séjour dans ce camp où tant de camarades et d’amis ont trouvé la mort a été pour lui une période entre parenthèses que l’écriture lui a permis (peut-être ?) d’exorciser. En tout cas, quand il en parle, il dit « Une autre vie plus tard », comme si la première s’était arrêtée à son entrée dans ce camp, à l’oubli de son nom au profit d’un numéro matricule (44904), qu’il n’était devenu rien d’autre qu’une ombre, le contraire d’un homme !
Pourtant dans ce camp où l’on torturait, où l’on travaillait jusqu’à l’épuisement, où l’on souffrait, il se passait des choses étranges comme ses réunions dans le local des contagieux où les Allemands ne mettaient pas les pieds par peur de la maladie, dans ce local des latrines aussi où l’on parlait de philosophie, de littérature et de liberté…
C’est un paradoxe, mais Buchenwald était proche de la ville de Weimar qui fut le siège d’une éphémère république mais surtout la ville où Goethe aimait venir trouver l’inspiration. Faut-il rappeler que les nazis tortionnaires faisaient aussi pousser des fleurs dans les camps d’extermination !
Même parti de ce camp maudit, il traînait derrière lui en quelque sorte la mort comme son ombre. Rien, pas même un corps de femme « la certitude apaisante de sa beauté ne m’avait distrait de ma douleur, rien d’autre que la mort, bien entendu. »
C’est donc une sorte de renvoi à la condition humaine, celle d’un être qui doit perpétuellement souffrir parce que son destin en a décidé ainsi, parce qu’il aura toujours dans sa mémoire les squelettes ambulants, un peu comme des sculptures de Giacometti, ces morts vivants, ces hommes à jamais disparus dans la fumées des crématoires, cette propension qu’a l’homme à être cruel pour l’autre quand il y va de sa survie ou parfois de son plaisir sadique, à mettre en relief « cette région cruciale de l’âme où le mal absolu s’oppose à la fraternité » comme le dit Malraux.
C’est que la fraternité, il l’a rencontrée à Buchenwald quand le communiste allemand prisonnier qui l’a enregistré à son arrivée, lui ayant demandé son métier et s’étant entendu répondre « étudiant » (Studden) a pourtant inscrit sur sa fiche « Stukatten » ce qui correspond à peu près à décorateur. Dans ce camp, il valait mieux être un bon ouvrier qu’un intellectuel ! Celui qui avait fait cette faute d’orthographe l’avait fait exprès, par fraternité communiste. Longtemps après il s’est souvenu du regard de cet homme dont l’engagement politique valait au moins qu’il se trompât pour sauver un frère. Au surplus, la pratique courante de l’allemand permit à Semprun de travailler dans un bureau, de comptabiliser les entrées et les sorties, les morts surtout, c’est à dire de pouvoir survivre relativement loin de ces mauvais traitements…
Dès lors, sourd un sentiment de culpabilité qu’il n’éprouve cependant pas, celui d’être revenu de l’enfer grâce à un mot vraisemblablement intentionnellement mal orthographié. Il s’interroge bien au contraire sur la chance qu’il avait eue d’avoir croisé cet Allemand, d’avoir été sur la route d’un communiste comme lui qui avait eu l’intention de faire ce qu’il pouvait pour lui sauver la vie, d’être, si l’on peut dire, au bon moment, au bon endroit. « La chance ne s’apprend pas, on l’a », a dit Blaise Cendrars.
Il y a donc, à ce moment-là, pour lui de l’estime, malgré tout ce qu’il pensera plus tard de l’idéologie communiste, de ses déviances, de ses dérives et de ses crimes semblables à ceux des nazis (Buchenwald deviendra après la guerre un camp d’internement russe),à ce moment précis, entre ces deux hommes c’est le respect qui prévaut, au nom d’un idéal individuel, d’un engagement personnel, malgré le silence sur les atrocités, le pacte-germano-soviétique qui tournera au conflit… Il éprouve le besoin de préciser « J’ai toujours respecter plus tard la part d’ombre, d’horreur existentielle abominable, même si le respect ne vaut pas pardon et encore moins oubli. »
Et puis, il y a la neige, cette neige omniprésente du temps de son séjour à Buchenwald comme pendant le temps de sa liberté, cette neige qui recouvrait Weimar comme le souvenir, comme les reproches intimes que l’on peut se faire à soi-même. Ce manteau blanc uniformise tout, les images comme les sons, purifie aussi les formes en en gommant les contours. Cette neige qui l’accompagne jusque dans son sommeil comme une obsession lui rappelant la souffrance et la mort.
Pourtant, quelques cinquante années plus tard, il revint dans cet ancien camp nazi qui fut aussi un camp stalinien après la guerre. La nature y avait reverdi, les arbres repoussé, mais il apprit que cette végétation croissait sur des restes humains, ces cadavres enterrés sur place dans des fosses communes comme si tout cela pouvait être oublié.
Dès lors, l’écrivain qu’il est se doit de témoigner, ne serait-ce qu’au non du « devoir de mémoire » et donc d’écrire. Pour se pose de nouveau le problème du titre de ce récit « l’écriture ou la vie », comme si, encore une fois l’une excluait l’autre. J’ai donc lu ce livre avec toujours en tête cette question pour laquelle je voulais trouver une réponse. Décidément cet homme, et plus précisément son parcours m’étonnaient. Républicain espagnol, résistant français, communiste convaincu et brillant intellectuel, il avait survécu à tout ce que l’homme avait pu enfanter de mauvais, de dangereux, de mortel pour lui-même, et plus exactement pour ses semblables, mais trouvait quand même les mots pour nous parler de la beauté des femmes, de la grandeur de l’homme, de sa culture. En parlant de Maurice Halbachs, de Diego Morales et de combien d’autres inconnus sans nom ni visage, il a porté témoignage. Donc l’écriture est quand même bien la vie ! Et puis il évoqué si bien les poètes, René Char, Vallejo, Primo Lévi que je ne comprends toujours pas cette oppositions entre l’écriture et la vie. J’ai cherché des bribes d’explications dans ce témoignage « l’écriture m’a rendu de nouveau vulnérable aux affres de la mémoire » et si je comprends bien, il avait choisi de vivre en étouffant les mots qu’il portait en lui, parce ces mots le renvoyaient à la mémoire c’est à dire à la mort.
A le lire, ce projet de livre a été maintes fois abandonné « (il) était devenu un autre, pour rester en vie », comme si l’écriture le renvoyait à une part de lui-même qu’il voulait oublier, à cause d’une culpabilité peut-être d’avoir échapper à tout cela, au point de porter en lui cet ouvrage pendant des années et que sa volonté de vivre était telle qu’il ne pouvait pas revenir en arrière sans ouvrir la « boîte de Pandore » de la mémoire et de retrouver la mort…
Et pourtant, il l’a fait et devant son parcours, on ne peut qu’être admiratif et respectueux. Je tiens pour évident qu’un homme qui ne transige pas, qui a le courage d’aller jusqu’au bout de ses idées sans tergiverser, malgré les contradictions d’un système dont il n’est pas personnellement responsable, mérite, à tout le moins notre estime !
Il a donc porté témoignage et ce document est précieux non seulement pour ce qu’il dit mais surtout peut-être pour l’itinéraire qui fut le sien a été sincère, rigoureux… Mais je ne peux pas rappeler le mot de Malraux « Ecrire, c’est arracher quelque chose à la mort ».
© Hervé GAUTIER.
Ajouter un commentaire