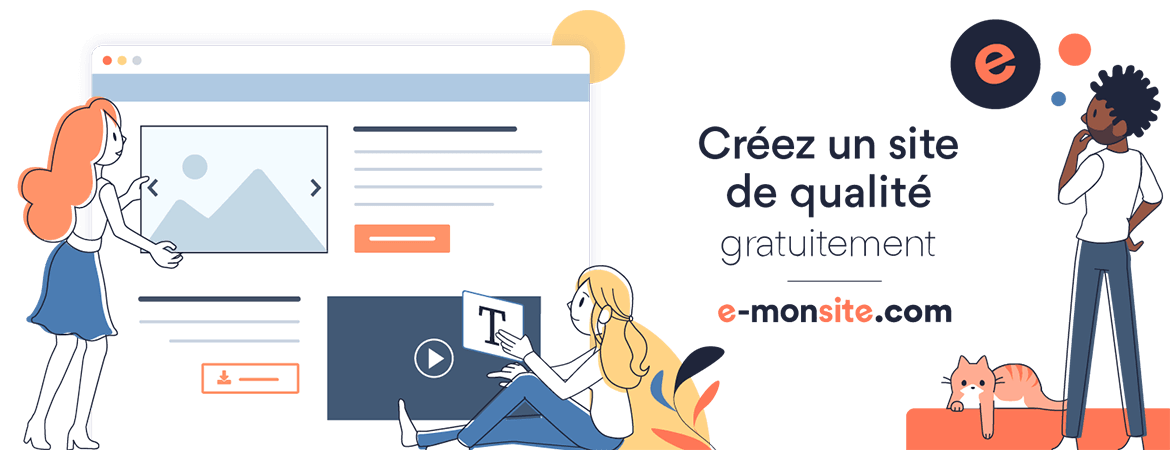Articles de hervegautier
-
OLIVIER ET SES AMIS - Robert SABATIER - Editions Albin MICHEL.
- Par hervegautier
- Le 04/04/2009
- Dans Robert SABATIER
- 0 commentaire
N° 166 - Septembre 1993.
OLIVIER ET SES AMIS - Robert SABATIER - Editions Albin MICHEL.
A l’occasion de trente histoires dont Olivier, Capdeverre, Jack Schlack et consorts sont les personnages et les acteurs, l’auteur nous promène dans le quartier de la Butte qui fut le terrain de jeu de son enfance. Dans ces récits la gouaille parisienne le dispute à la fraîcheur et à la spontanéité de l’enfance, de cette enfance que les adultes eux-mêmes partagent équitablement avec les bambins qu’on imagine facilement ressemblant à des poulbots espiègles. Tout ce monde vit dans ce quartier de Paris qui ressemble à un village au point que la ville, c’est loin ! Il possède ses figures inénarrables, inimitables : Le Père Lapin, Fil de Fer, Mac le Boxeur, Anatole Pot à Colle; et combien d’autres...
Robert Sabatier retrouve, à l’occasion de ces nouvelles (je préfère ce mot à celui de roman) tout le merveilleux de cette période de la vie d’un être humain faite d’insouciance, de candeur, de naïveté, avec ce sens inné de la farce qui en fait un récit authentique. C’est aussi pour lui l’occasion de se rappeler qu’à cette époque la rue était une famille où tout le monde se connaissait, se parlait, s’entraidait... Tout cela est bien loin pour lui et ce livre est le prétexte à l’évocation d’un deuil impossible à oublier.
-
LA FEMME A VENIR. - Christian BOBIN - Editions Gallimard.
- Par hervegautier
- Le 04/04/2009
- Dans Christian BOBIN
- 0 commentaire
Septembre 1993 - N° 165
LA FEMME A VENIR. - Christian BOBIN - Editions Gallimard.
Il est des livres qui vous laissent une impression bizarre, non pas mauvaise mais assez indéfinissable au point qu’on pourrait résumer le roman en quelques mots : « C’est l’histoire de ... » ou quelque chose comme cela. Un roman c’est toujours une tranche de vie plus ou moins imaginaire, une somme d’histoires racontées plus ou moins juxtaposées... des mots... L’auteur en fait un livre, met son nom dessus. On publie...
Ce récit, puisque c’en est un, m’a laissé un sentiment difficile à formuler: Une partie de la vie d’Albe, ses rencontres, ses amours, ses déceptions, ses désillusions et ses jours qui coulent comme un écheveau qui se dévide tout seul, le deuil de son enfance et l’envie de la retenir, avec en filigranes la mort à venir... Mais avant, bien avant, si elle le veut bien, différent des passades, cet amour qu’on attend toute sa vie et qui est rarement au rendez-vous. Cet amour qui doit illuminer l’existence mais qui bien souvent l’empoisonne parce que deux êtres qui sont faits l’un pour l’autre ne parviennent pas à se rencontrer et s’étiolent loin l’un de l’autre. Ils ne vivront jamais ensemble parce que contrairement au dicton le hasard ne fait pas toujours bien les choses. C’est comme cela, on croise des gens, on les aime, on fait avec eux un bout de chemin mais à la fin c’est la solitude qui l’emporte, même si on habille différemment cette réalité.
Ce livre rythmé sur un mode mineur a, jusqu’à la fin nourri ma curiosité.
© Hervé GAUTIER
-
MARJAN!
- Par hervegautier
- Le 04/04/2009
- Dans MARJAN
- 0 commentaire
MARJAN!
Quand le téléphone a sonné, ce jour d'août, j'ai reconnu cette voix familière, plus fatiguée encore depuis ces dernières semaines. C'était celle de Jeanne avec ces mots simples "Marjan est mort". Elle a relaté ensuite comme on le fait en pareilles circonstances les épisodes qui ont précédé sa fin. Tout devenait compliqué avec sa vie au ralenti... Il n'empêche, il n'est plus là. Il est quand même apaisant de savoir que les gens que l'on aime ont quitté ce monde sans souffrir. Il s'est éteint doucement.
Nous avons tous connus Marjan, soit personnellement, soit par le biais de son écriture, qu'elle soit littéraire ou postale, car à travers lettres et enveloppes il avait l'habitude de faire partager ses coups de cœur, ses révoltes, son amitié. C'est par ce canal que passait son activité débordante d'écrivain et d'éditeur. C'est vrai qu'il était un épistolier impénitent. Son préposé en savait quelque chose qui déposait chaque jour sa moisson de courrier dans une boîte qui devait bien être la plus grande et assurément la mieux remplie de la rue de la Burgonce à Niort. Les lettres venaient du monde entier et recevaient toutes une réponse.
Dans cette chronique comme ailleurs, j'ai souvent parlé de l'importance qu'ont eu "Les feuillets Poétiques et Littéraires" qu'il avait fondés tout comme plus récemment "Le Bouc des Deux-Sèvres" ou "Poètes Niortais et des environs". Toutes ces revues et collections rendaient compte d'une façon désintéressée du bouillonnement poétique contemporain, mélangeant les signatures les plus prestigieuses à d'autres plus modestes, voire inconnues. Elles furent un révélateur et nous sommes nombreux de par le vaste monde à lui devoir quelque chose dans notre démarche créatrice, ne serait-ce que l'envie d'écrire! Désintéressé, il l'était. Il rappelait souvent, non sans humour "qu'il avait laissé souvent des plumes pour celles des autres" et ce n'était pas faux. Il avait sans doute gardé de son ancien métier de typographe cet intérêt constant porté à l'écriture des autres, le besoin de les faire connaître. Il savait aussi le faire bénévolement avec beaucoup d'abnégation puisque ce qui comptait surtout pour lui c'était encourager ceux qui faisaient œuvre d'écriture. Il avait banni de son vocabulaire le mot "exclusion".
C'est vrai que tout cela était un peu anachronique dans ce siècle où tout est basé sur l'argent et le profit mais cela faisait partie du personnage. C'était comme cela, il était de ces gens qui s'intéressent aux poètes qui n'ont rien compris au monde d'aujourd'hui et qui croient encore à la beauté des choses et à la bonté des gens. C'est simple, il était l'un d'eux! Comme d'autres mots dans notre langue "poète" est galvaudé, à la fois compliment ou qualificatif compassé, on n'oublie jamais d'y glisser un peu d'ironie. Lui jamais!
Il travaillait aussi les mots, comme il l'avait fait toute sa vie, les distillant pour exprimer l'humour, parfois noir d'une situation. Il fut un spectateur attentif et parfois amusé de ce monde. Il fut surtout un observateur de l'âme humaine, rappelant à l'envi que "l'humour est la politesse du désespoir". Son style, bien souvent imité était à ce point original qu'un journaliste ami avait formé le mot "Marjanerie" en son honneur.
On sait depuis les travaux de Freud sur les mots d'esprit que l'humour est le plus sûr moyen d'asséner des vérités qui sont reçues ainsi d'une manière acceptable. On a dit beaucoup de choses là- dessus, sur son rôle social, pédagogique, sur ceux qui le pratiquent comme sur ceux qui en sont les "victimes". Marjan, quant à lui s'est contenté de regarder le monde tel qu'il est avec la bonne foi parfois candide de celui qui ne veut cependant pas s'en laisser conter. Car c'est bien sûr au second degré qu'il fallait recevoir son propos. Si à la première lecture un sourire vous prenait, la réflexion élémentaire qui suivait vous invitait davantage à plaindre cette société. C'était sa façon à lui de "rire d'une situation plutôt que d'avoir à en pleurer". C'est vrai que ce n'était que des mots jetés comme négligemment sur le papier mais qui portaient bien le message qu'ils entendaient transmettre. Derrière la façade du simple vocabulaire, il savait jouer avec les mots, les triturer, les malmener, pour finalement révéler leur sens caché, leurs paradoxes... J'ai, en tout cas toujours été impressionné par la facilité avec laquelle il écrivait et le plaisir qu'il y prenait. On ne dira jamais assez qu'écrire est un plaisir qu'il faut pratiquer sans modération.
Il est difficile en quelques lignes si pleines d'émotion d'évoquer la vie d'un homme tel que lui. Il eut ses détracteurs, bien sûr car nous savons bien qu'en ce monde il suffit de vouloir faire quelque chose, de développer une action pour aussitôt s'attirer des critiques... souvent de ceux qui ne font rien et se contentent de regarder. Je voudrais simplement signaler qu'il ne s'est pas contenté de dénoncer et de combattre avec des mots. Pacifiste, utopiste, anarchiste, libertaire sont sûrement des qualificatifs qu'il n'aurait pas reniés. Il était en cela l'héritier de Gaston Couté.
Les mots sont forcément réducteurs et enferment le personnage dans une gangue. Il serait injuste de penser qu'il s'est contenté seulement d'en user. Ce serait oublier un peu vite le militant des "Droits de l'homme", des "Restos du coeur" ou d'"Amnesty International" en faveur des plus démunis ou des prisonniers politiques. Cette action se limitait peut être à des dons pécuniaires mais n'en illustrait pas moins ce que Marjan a toujours voulu défendre : la cause des opprimés, la condition des plus humbles...
Quand on parle d'un écrivain, il est presque naturel d'évoquer ses voyages. Ah, les voyages, et l'écriture qui va avec! Pour lui rien de tout cela, il n'a pratiquement jamais quitté Niort. Il avait choisi de peindre la condition humaine et surtout les petites gens, les plus humbles, de dénoncer l'hypocrisie des puissants... Il n'avait pas besoin de courir le monde pour cela, il l'avait sous les yeux, tous les jours!
Il a peu parlé de lui et des siens. C'est vrai! Et pourtant quand il a évoqué sa famille, il l'a fait avec tellement d'émotion et hors de son humour habituel que la nostalgie débordait à chaque mot. A mes yeux "Cour Commune" est sans doute sa meilleure œuvre. Ses amis ne s'y sont pas trompés qui ont qualifié nombre des textes qui composent ce recueil de "poèmes d'anthologie". Parmi ceux-ci "Ma Mère" est assurément le plus touchant.
On ne le dira jamais assez, nous ne sommes en ce monde que temporairement. Les religions nous promettent après la mort un monde meilleur. Acceptons-en l'augure. Le connaissant un peu, je puis dire qu'il fut une sorte de passager clandestin dans ce voyage sur terre, sur vie. Après quatre-vingts ans qui ont dû lui paraître bien courts, il est parti rejoindre ses copains, Jacques Prévert, Hervé Bazin, Paul Baudenon et combien d'autres. Nul doute qu'ils doivent, s'il y a autre chose que le néant, discuter à nouveau, un calembour ou un bon mot au coin des lèvres ou de la plume...C'est dans ces contrées qu'on a du mal à imaginer qu'il a définitivement "jeté l'encre" comme il aurait sans doute dit.
Il nous reste sa mémoire, ses textes dont beaucoup sont inédits. Pour lui faire un dernier salut avant que la terre ne recouvre son cercueil, il y avait un petit groupe que l'intimité réunissait sous ce grand soleil d'Août. Point de cérémonie religieuse ni de protocole compliqué, il n'aurait pas aimé cela. Un peu timidement au début mais surtout sans ordonnancement, des textes de lui furent dits. Malgré la peine que nous éprouvions tous, j'ai eu, à ce moment, le sentiment que ses obsèques n'étaient pas tristes, que ce départ sur la pointe des pieds était comme un de ces clins d'œil malicieux qui adressait souvent à ses amis.
Il est donc, à son tour victime de ce mauvais coup du sort qui nous attend tous. Il en avait si souvent parlé sur le ton de la raillerie ou de la révolte qu'elle a fini par le rattraper, cette mort qui ne parviendra pas à nous le faire oublier.
Voilà, j'ai, dans cette chronique tellement parlé de l'homme et de son œuvre que j'ai l'impression une nouvelle fois de rabâcher, mais il est bien naturel que cette revue qu'il a suscitée, soutenue et diffusée depuis vingt ans l'accompagne avec ce modeste hommage, ces quelques mots.
(C) Hervé GAUTIER
-
Enfin!
- Par hervegautier
- Le 04/04/2009
- Dans MARJAN
- 0 commentaire
N° 194 - Janvier 1998
Enfin!
On dira ce qu'on voudra, mais pour un écrivain la reconnaissance est quelque chose qui compte... même si on a du mal à l'avouer! Elle peut prendre des formes différentes depuis l'aspect commercial jusqu'à l'hommage de ses pairs en passant par la popularité. Archiviste scrupuleux pour tout ce qui le concerne, Marjan collige depuis de nombreuses années articles de presse et témoignages personnels, prix et distinctions, bref tout ce qui est écrit sur son action en faveur de la poésie.
Il va pouvoir désormais ajouter une autre mention à cette collection impressionnante. Il s'agit d'un mémoire de Maîtrise de Lettres Modernes soutenu à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Metz le 29 Octobre 1997 par Frédéric VIGNALE. Le sujet choisi était :"Naître et être poète : Marjan." Le diplôme a été obtenu avec la mention "Bien". Voici donc notre homme consacré par l'Université.
J'ai lu ces quatre-vingts pages d'une traite et avec intérêt car j'ai la faiblesse d'être attentif à tout ce qui est écrit sur Marjan au moins autant qu'à tout ce qu'il écrit lui-même. Il est juste en effet qu' hommage lui soit ainsi rendu lui qui est régulièrement boudé par la presse locale à qui il signale pourtant périodiquement le talent des autres mais qui reste sourde à ses informations. Il est bien loin le temps où Jean Beyt, Delion, Lechantre et Patrick Béguier, journalistes attentifs de Courrier de l'Ouest et de la Nouvelle République rendaient compte périodiquement du fourmillement d'idées et de la créativité qui se donnaient rendez-vous au 166 rue de la Burgonce à Niort. C'est vrai aussi que Marjan est un personnage atypique dans cette ville que l'écriture et la poésie n'intéressent pas à tout le moins quand elles se signalent dans ses murs. C'est là une autre histoire et un autre combat et comme nous le savons, nul n'est prophète...!
Mais revenons à ce travail universitaire.
A part les articles dont il est d'ailleurs largement inspiré rien de semblable n'avait été fait jusqu'à présent. C'était également tentant de parler pour la première fois à l'occasion d'une soutenance de mémoire de Maîtrise d'un auteur vivant et de son action. Il y avait là, certes une originalité mais aussi l'assurance que cette révélation ne prêterait que très peu le flanc à la contradiction. Cela dit j'ai trouvé cette étude bien documentée et d'une grande justesse de ton à la fois dans la forme et dans le fond.
Ce n'était pas facile pour Frédéric VIGNALE de mener ainsi ce travail puisqu'il ne connaissait Marjan que par les textes qu'il a écrits et que par les articles qui lui ont été consacrés. Il est vrai qu'il est aussi un épistolier impénitent et qu'il aime aussi encourager ceux qui écrivent. Alors quand on est soi-même le sujet d'une étude officielle...!
J'imagine bien le travail de dépouillement que Frédéric VIGNALE a dû mener dans l'abondante documentation qui lui était parvenue et je ne suis pas étonné qu'il ait craint un moment d'être lassé par le sujet qu'il avait choisi. Je connais l'importance des textes de Marjan. Les publications s'en sont largement fait l'écho et notre homme détient encore d'autres inédits qui, je ne le dirai jamais assez manquent beaucoup à ceux qui apprécient son style.
Il avait quand même bien choisi car au-delà de la légitime fierté de Marjan qui voyait ainsi reconnue une nouvelle fois et officiellement son action en faveur de la poésie (la sienne et celle des autres comme on le sait!) et au travers de cette correspondance que Frédéric VIGNALE qualifie lui-même de pudique, il a bien du naître quelque chose qui ressemble à de l'amitié entre les deux correspondants. Connaissant le poète niortais, le contraire m'étonnerait. Le rédacteur de cette étude a pu vérifier que ce Marjan, malgré le fait qu'il se déplace peu a beaucoup d'amis, des plus humbles aux plus célèbres et que malgré ses détracteurs nul ne dédaigne ce qu'il fait. Je ne suis pas bien sûr qu'il ait réellement créé une école comme Frédéric VIGNALE ne laisse entendre mais il a assurément été imité dans son écriture comme dans son action puisque notamment l'expérience du Bouc des Deux-Sèvres, revue gratuite (c'est si rare) a largement été imitée.
Ce sur quoi je voudrais insister c'est, comme l'a dit un de ses amis, sur cette caractéristique de "rêveur définitif", cette volonté de repeindre en bleu la grisaille qui nous entoure, de préserver cette part de rêve qui nous manque de plus en plus et qui est pourtant si vitale à chacun d'entre nous! Elle s'exerce dans cette écriture si originale qui est le témoin d'un regard acéré sur la réalité des choses, de ce parti-pris d'en rire même s'il y a forcément quelque amertume derrière tout cela. C'est vrai qu'il y a avant tout du rêve dans cette démarche quand malgré l'âge et la maladie, il continue d'écrire avec verve c'est à dire à jeter au vent des mots aussi impalpables que l'air où se lit la révolte contre la condition des plus humbles et contre la mort. Il y a de l'utopie à mener contre cela un combat quand autour de nous s'établissent l'exclusion et la précarité et que de toute manière, simples mortels, nous ne sommes sur cette terre que de passage. Et qu'on ne vienne pas me dire que l'écriture est une quête d'immortalité!
Alors, au-delà de tout ce qui pourrait ressembler à des hommages, je garde toujours en mémoire sa volonté de conserver une âme d 'enfant rêveur. Il l'a d'ailleurs exprimé lui-même et fort joliment par ces mots :"Moi qui au terme de mon automne ne peut encore m'habituer à l'idée d'être une grande personne."
(c) Hervé GAUTIER
-
COUR COMMUNE - MARJAN
- Par hervegautier
- Le 04/04/2009
- Dans MARJAN
- 0 commentaire
N°120 - Juillet 1992
COUR COMMUNE - MARJAN
Je ne vous ferai pas l’injure de vous parler du Marjan des marjaneries que tout le monde connaît, de ce Marjan à l’humour noir et acerbe qui rit des choses plutôt que d’avoir à en pleurer. Ce Marjan là nous émeut, c’est vrai mais bien plus émouvant encore est l’homme de Cour Commune qu’on connaît beaucoup moins, bien que ce recueil soit la copie exacte de l’édition originale de 1977.
J’ai déjà eu l’occasion d’écrire qu’il est de ces poètes dont la sensibilité est communicative surtout quand il parle de son enfance et de sa famille. Oh, ce n’était pas une enfance riche, dorée, loin de là! C’était une famille d’ouvriers imprimeurs, ce qu’il sera plus tard, une jeunesse passée dans un quartier pauvre de Niort aux côtés d’autres ouvriers, ceux des ganteries où les femmes lavaient « (le) linge sale des riches ». Une cour commune ce n’est pas précisément un signe d’opulence! « On y accède par un couloir sombre et si étroit que le mur laisse sur les épaules toujours un peu de lui-même ».
« Cour commune de mon enfance où lorsque le temps était à la pluie chacun pestait contre le cabinet du voisin. Il y en avait une demi-douzaine, pas mois »...
Pourtant s’il est né le 3 Avril 1918 (le 1° lui serait peut-être mieux allé?) d’une famille d’origine vendéenne, son père qui reviendra blessé de la guerre était encore au combat. « On a salué mon arrivée à coups de canons de vin rouge jusque dans la tranchée de mon père. » Ce n’était cependant pas la misère « Ma mère me lavait avec Cadum, me nourrissait de Phoscao. Elle me donnait du chocolat Poulain... elle tartinait le pain au beurre d’Echiré » mais « on vivait simplement, on bossait durement ». »Mes enfants, un sous est un sou, disait-elle », et s’il était trouvé sans qu’on en connaisse le propriétaire, il revenait au curé aussi naturellement que cela. Ils étaient des « Gens du petit monde », voilà tout!
Ce livre est avant tout dédié à sa mère et on ne peut rester insensible à ce poèmes d’anthologie qu’il lui adresse. « Ma mère en blouse toujours noire, ma mère aux cheveux toujours blancs... ma mère aux mains bourrelées de remords... ma mère à laquelle je suis incapable de dire combien je l’aime, pendant qu’il est encore temps. » Les mots parlent d’eux-mêmes dans leur simplicité, jusque dans l’évocation de sa mort « Ma mère est morte le lundi 4 décembre 1967 dans un bar-tabac ».
L’image du père est forte. Ainsi cet homme « qui n’était pas tout entier » à cause de la guerre, à côté de qui il a vécu et travaillé à l’imprimerie et qui ne croyait pas à son destin de poète a été son modèle et lui a peut-être, à sa façon donné la passion des livres.
Et puis la famille se complète. L’unique grand-mère connue de lui, mais qui était un peu « la honte de la famille »parce qu’elle « travaillait dans la guenille » et qu’elle tirait les cartes... Le jour de sa mort fut l’occasion de sa première bicyclette... Sa tante qui rempaillait les prie-Dieu « pour deux fois rien », qui prisait, « buvait de l’ absinthe le dimanche et gueulait le poing sur la hanche », son vieux cousin allumeur de réverbères du quartier et plus tard son beau-frère (qu’il appelait son frère) mort dans un stalag en 1943. C’est un truisme que de rappeler de la mort est indissociable de l’écriture de Marjan!
Et puis il y a la vie, celle de son quartier, cette « rue de l’orphelinat » où « un ouvrier modèle préféra la crève au renvoi et se pendit ». Les gens de ce quartier ouvrier regardaient de loin les riches et les enviaient peut-être?
Ce livre est aussi l’occasion d’un retour sur soi-même, une sorte d’introspection. Nous retrouvons le petit garçon avide de cinéma et de livres, l’enfant bègue qui aura très tôt des difficultés avec les mots parlés mais »(s’) applique de son mieux à les coucher sur la page blanche. » C’est peut-être à cause de cela qu’il deviendra écrivain! Nous le voyons en classe quand le maître s’endormait et qu’il récitait « ses leçons par coeur » mais qui parfois recevait des gifles « par la main instruite d’un maître de la primaire » quand ce n’était pas « par la main coquine d’une belle rouquine ». Et puis la vie tisse en lui l’amour du travail, des chats, la haine de la guerre...
Il y a toujours dans l’écriture de celui qu’enfant on disait taquin un peu d’humour inévitable, pas des marjaneries mais cette manière bien à lui de faire un bras d’honneur à la mort qui nous attend tous et qui pour lui est une obsession.
Je l’ai dit certains textes de ce livre son émouvants mais puisqu’il s’agit d’une réédition, il aurait été bon qu’il fût complété et enrichi d’autres textes qui pourtant sont écrits.
© Hervé GAUTIER
-
LA HARPE ET L’OMBRE - Alejo CARPENTIER - Editions Gallimard.
- Par hervegautier
- Le 04/04/2009
- Dans Alejo CARPENTIER
- 0 commentaire
N°207
Juillet 1999
LA HARPE ET L’OMBRE - Alejo CARPENTIER - Editions Gallimard.
Je dois bien l’avouer à mon improbable lecteur, tout ce qui concerne la papauté m’intéresse. Je ne sais pas pourquoi, mais c’est ainsi. Le livre d’Alejo Carpentier ne pouvait donc me laisser indifférent.
De quoi s’agit-il donc sinon d’une parcelle de l’histoire qui n’est peut-être pas restée dans la mémoire collective comme un fait majeur. Au tout début du roman est évoquée la personnalité d’un prélat franciscain : Giovani Maria Mastïa qui avait choisi de servir l'Église autant, nous dit-on par déception amoureuse qu’en raison de la pauvreté de sa famille pourtant de haute lignée. Il se fit pourtant remarquer par ses prêches aussi ardents qu’ éloquents mais cela ne pouvait raisonnablement lui laisser espérer une ascension rapide dans la hiérarchie catholique. Il fut cependant désigné pour accompagner un prélat dans une mission apostolique en Argentine et au Chili. Celle-ci ne fut pas couronnée de succès mais il en est revenu avec l’idée que la découverte des Amériques avait été l’événement capital des temps modernes.
Plus tard, devenu pape sous le nom de Pie IX il était toujours possédé par cette idée au point de décider d’ouvrir le procès en béatification, qui est le préalable à la sanctification, de Christophe Colomb!
L’auteur nous propose les portraits croisés de ces deux personnages, le pape et le marin qui finit par convaincre, après moult pérégrinations, Isabelle la Catholique de financer son expédition.. Mais qui était-il donc, ce navigateur, un génie, un aventurier, un imposteur, un mystificateur, un arriviste qui ne reculait devant rien pour parvenir à ses fins? Alejo Carpentier nous restitue ce qu’il imagine être l’ambiance de cette époque, en plaine reconquista mais aussi pendant l’expulsion des juifs d’Espagne. Il fait du génois l’amant de sa royale protectrice qui finit par lui faire confiance autant par exercice de l’autorité que par la volonté de trouver des richesses pour porter contre les Maures la guerre en Afrique.
A partir de documents d’archives l’auteur nous donne à entendre la voix même de Colomb, en quelque sorte la manière dont il aurait lui-même jugé son entreprise et dont il se serait jugé lui-même. Il nous fait partager ses hésitations, ses doutes. Il se révèle menteur quand il promet de trouver de l’or et des épices aux Indes qu’il recherche, cynique quand il envisage de faire le commerce des esclaves à la place des richesses qu’il n’a pas rapportées... Mais tout ce qu’il avait espéré découvrir reste introuvable et le commerce des esclaves est interdit par ordre du roi. Alors il met en avant les âmes des indigènes qu’il faut sauver et c’est le spirituel qui prend le pas sur le temporel qui pourtant était la vraie raison de son expédition.
En fait Christophe Colomb fut rejoint par son destin, rattrapé par ses forfaitures et dépassé par son exploit. Le luxe a pâli ainsi que les ors à l’heure du jugement et c’est un pauvre homme sans richesse, honni par l’Espagne, moqué par les hommes qui s’apprête à rendre des comptes. Lui, le découvreur de l’Amérique a, en fait apporté à ce continent vierge si semblable au paradis terrestre la cupidité, la luxure, le vice, le péché, ce qui n’est pas le moindre des paradoxes. Il est loi, si loin de sa légende!
Restait le décret pontifical introduit « par voie d’exception » qui ouvrait le procès en béatification. « Disputant doctores »... et pour cela, par la magie de l’imaginaire le romancier convoque pêle-mêle, pour témoigner, Victor Hugo, Lamartine, Jules Vernes; Bartholomé de las Casas...
Il reste un roman qui ou l’humour et le style, sans doute servi par une traduction de qualité, m’ont fait passer un agréable moment de lecture.
©Hervé GAUTIER
-
TOUTE UNE VIE BIEN RATEE - Pierre AUTIN-GRENIER -Editions GALLIMARD.
- Par hervegautier
- Le 04/04/2009
- Dans Pierre AUTIN-GRENIER
- 0 commentaire
N°208
Juillet 1999
TOUTE UNE VIE BIEN RATEE - Pierre AUTIN-GRENIER -Editions GALLIMARD.
Le titre avait tout pour m’attirer et me plaire. Cela correspondait tellement à l’idée que j’ai de ma propre vie! J’ai donc lu ces nouvelles ou plutôt ces « récits » puisque c’est comme cela que le livre les présente. Je le dis tout simplement, je n’ai pas aimé! Cela vient sans doute de moi, de ma façon de voir les choses de la littérature. Je me suis dit que Pierre Autin-Grenier avait eu bien de la chance de publier chez Gallimard et que c’est sûrement moi qui ne suis plus en phase avec mon temps! Je ne dois pas être capable de reconnaître de la bonne littérature et sûrement encore moins d’apprécier le talent de l’auteur. Ma faculté de rêver à propos d’un texte doit bien être émoussée au point que ce livre publié dans une maison d’édition qui est pour le moins une référence ne m’a provoqué aucune émotion. Je l’ai lu presque par devoir parce que j’en avais entendu parler à la radio et qu’on en disait du bien! Je me disais que tout cela devait être une référence et qu’il convenait de ne pas passer à côté d’un chef-d'œuvre. Il n’empêche, j’ai été déçu par le style, par le ton des récits, par l’histoire qu’ils racontaient et à laquelle je n’ai guère accroché.
N’allez surtout pas croire que je tiens la prose d’Autin-Grenier pour rien. Cela je ne me le permettrais pas et je sais d’expérience que lorsqu’on noircit une page blanche c’est avant tout parce qu’on a quelque chose à dire et même si dans la littérature comme dans tous les autres arts il y a place pour la fumisterie, je me garderai bien d’employer ce terme pour cet ouvrage.
C’est que je lui reconnais quand même de l’humour qui, dit-on est la politesse du désespoir. C’est vrai que la vie n’est pas forcément belle, qu’elle ne ressemble sûrement pas à ce qu’on voudrait qu’elle soit même si on tente de l’enjoliver avec ce qui en fait, dit-on les plaisirs. On m’objectera sans doute que, lecteur inattentif, je n’ai rien saisi de sa philosophie de l’existence et qu’il vaut mieux rire de tout cela qu’en pleurer et que, somme toute nous ne sommes sur terre que de passage et, au regard de l’éternité, pour bien peu de temps. Il vaut donc mieux prendre les choses comme elles viennent et ne pas chercher partout ce qui ne s’y trouve pas simplement parce qu’on est insatisfait.
Certes, mais quand même, j’attendais autre chose.
Mais pourquoi estime-t-il que sa vie est bien ratée. Parce qu’à la mi-temps de son existence (dit-il!), à l’heure des bilans(on peut toujours le dire de chaque période) il constate qu’il a mené une existence oisive d’écrivain(de poète même), tout juste capable de regarder passer le temps en s’accommodant de l’odeur moite des estaminets et du goût du blanc sec. Peut-être? Pourquoi pas? mais la vie est ainsi faite que ce n’est pas en s’affairant maladivement chaque jour au risque de friser la crise cardiaque, qu’on peut légitimement penser qu’on la remplit bien, qu’on la réussit comme on dit maintenant. Tout cela est affaire d’appréciation personnelle. C’est bien cela, réussir!
Nous n’avons qu’une vie, nous ne sommes que de passage mais il faut impérativement brûler quelques cierges sur l’autel de la réussite, même si l’on doit sacrifier ceux qui sont sur notre route, et cela pour avoir beaucoup d’argent, de notoriété, jouir de la considération générale... Vieux débat, vaste programme!
Pierre Autin-Grenier nous raconte ici ce qu’il en pense, l’air de rien. Bref, sur le fond je serais assez d’accord avec lui mais la forme me paraît à moi plus contestable car j’aime bien en littérature ce qui est bien dit.
©Hervé GAUTIER
-
MON ANGE - Guillermo Rosales - ACTES SUD.
- Par hervegautier
- Le 03/04/2009
- Dans Guillermo Rosales
- 0 commentaire
N°276 – Juillet 2007
MON ANGE – Guillermo Rosales – ACTES SUD.
Ce n'est pas de la morbidité, mais j'ai toujours eu un intérêt marqué pour les créateurs qui ont choisi de se suicider. Guillermo Rosales est de ceux-là qui ont eu, à mes yeux, la lucidité, d'aucuns diront le courage et d'autres la lâcheté, c'est selon, de regarder la vie en face et d'en finir volontairement, sans attendre que le hasard s'en charge.
Il y aura toujours des gens pour vilipender cet acte et d'autres pour le magnifier... Pour moi, ce qu'ils écrivent reste un témoignage plus poignant que les autres sans doute parce que l'écriture ne leur a pas permis d'exorciser cette vie, d'autant que leurs œuvres sont souvent posthumes ou circulent sous le manteau, comme quelque chose de précieux ou de dangereux et qui indique peut-être qu'ils ne sont déjà plus de ce monde. Ce fut le cas de ce roman dont l'auteur s'est suicidé à 47 ans, à Miami.
Ce qui est décrit ici, c'est un univers parallèle, où survivent des marginaux qui n'ont jamais pu ou voulu s'intégrer à cette société parfaite, ou prétendue telle, qui est celle des États-Unis. Ils ne le feront d'ailleurs jamais puisqu'elle reste constituée de gens qui ont réussi ou, à tout le moins montrent tous les signes extérieurs de leur richesse, jusqu'à l'ostentation; l'auteur parle d'eux comme des « triomphateurs », ces Cubains exilés, capables de toutes les compromissions et toutes les bassesses pour vivre ce fameux « rêve américain » qu'ils sont venus chercher.
Ils sont bien différents des fous, réfugiés dans ce « boarding home », sorte de phalanstère pour paumés qui n'ont pas ailleurs où aller, avant-dernière demeure avant de basculer dans le néant de la mort. Ils sont noirs, rejetés par la société américaine ou latinos fuyant leur pays et venus chercher ici un improbable « el dorado » qu'ils n'atteindront jamais. Mais voilà, dans ce microcosme, ils ne sont guère mieux. Non seulement ils sont la proie de profiteurs mais aussi de plus minables qu'eux qui, en quelque sorte et à leur détriment, prennent une sorte de revanche sur cette vie. Ici, toute une société se reforme, fixe ses règles non écrites, se développe sur ses propres vestiges...
Alors, William Figueras, trente huit ans, ancien communiste cubain qui a fui son pays, rejeté par sa famille, cultivé mais déstabilisé par la vie, s'est refait un monde où il entend des voix, lit des romans et des poèmes, écrit des livres qui ne seront jamais publiés. Il ne se trompe pourtant pas sur sa condition « Je ne suis pas un exilé politique. Je suis un exilé total. Je me dis parfois que si j'étais né au Brésil, en Espagne, au Vénézuela ou en Scandinavie, j'aurais fui tout autant leurs rues, leurs ports et leurs prairies »
Il se retrouve dans ce« boarding home » infecte où il ne se sent même pas bien mais glisse petit à petit, sans même s'en rendre compte, vers une violence faite aux plus faibles que lui. La souffrance qu'il éprouve appelle la souffrance qu'il va infliger aux autres. Il finira par trouver l'amour avec une fille aussi paumée que lu qui ne cesse de lui répéter « Mon ange », mais leur histoire sera contrariée par le reste du monde, parce que il ne peut sans doute en être autrement.
Petite société miniature qui côtoie la grande mais n'a rien à lui envier. Les deux se ressemblent, surtout par leur côté délétère, mais William, résigné, accepte l'enfermement physique qui ressemble à son enferment moral dont le lecteur comprend qu'il ira en s' aggravant. Figueras perdra l'habitude de lire et d'écrire et ne trouvera d'issue que dans la mort.
© Hervé GAUTIER - juillet 2007
-
PEREIRA PRETEND - Antonio Tabucchi - Christian Bourgois Editeur.
- Par hervegautier
- Le 03/04/2009
- Dans Antonio Tabucchi
- 0 commentaire
n°206 - Juin 1999
PEREIRA PRETEND - Antonio Tabucchi - Christian Bourgois Editeur.
C’est un étrange roman que nous offre ici l’auteur.
A en croire une note annexée au texte et publiée pour la dixième édition italienne, il s’agit là d’une histoire vraie. Bien sûr Pereira est un nom inventé mais le texte relate une sorte de tranche de la vie d’un vieux journaliste portugais qui a effectivement existé.
Tabucchi le campe sous les traits d’un veuf cardiaque et gros qui passait son temps a parler au portrait de son épouse décédée quelques années plus tôt et qui souriait d’une manière énigmatique à tous les propos qu’il lui tenait. Il l’emporte avec lui lors de tous ses déplacements en prenant bien soin de le mettre sur le dessus de sa valise pour qu’elle respire bien. Il faut dire qu’elle était morte de la tuberculose!. Il le présente comme un être soupçonneux, ne fréquentant guère ses semblables et se méfiant de sa concierge qu’il suppose être un indicateur de police.
Pereira était catholique mais ma résurrection de la chair ne lui convenait pas parce qu’il n’aimait pas son corps adipeux et encombrant. Son confident était un franciscain simple à qui il confessait régulièrement cette hérésie mais qui le priait surtout de lui avouer des pêchés plus véniels pour mériter son absolution!
Cet obscur journaliste s’occupait de la page culturelle du « Lisboa », journal de l’après-midi. Sa vie fut en quelque sorte bouleversée par la rencontre qu’il fit d’un médecin qui bouscula ses croyances sur l’âme humaine. Il aimait la littérature française, les citronnades sucrées , les omelettes aux herbes et le cigare.
La magie de l’écriture transforma cet homme banal en un être obsédé par la mort et surtout par les positions politiques d’écrivains catholiques à propos du conflit qui se déroulait alors en Espagne. C’est que l’auteur a choisi comme décor le mois d’août 1938 à Lisbonne alors que gronde aux frontières la guerre civile qu’il rencontre indirectement sous les traits de différents personnages qui y sont partie prenante.. Le paradoxe de la position de l'Église à propos de ce conflit le tourmente tout autant que les prises de position des écrivains catholiques français.
C’est alors qu’il décide, lui modeste journaliste de prendre position dans ce pays que le salazarisme marque de son empreinte dictatoriale. C’est un peu comme s’il prenait soudain conscience qu’il devait pour une fois être lui-même. A la suite d’un stratagème, il joue un bon tour à la censure en dénonçant les pratique de la police politique. Pour lui bien sûr ce sera l’exil mais cela importe peu à ses yeux.
Le plus étonnant est que l’auteur prétend qu’à la suite d’une visite qu’il fit à la morgue après la mort de ce journaliste, l’âme de cet homme vint le visiter en songe pour se confesser à lui. Écrivain, il ne pouvait laisser passer cette occasion de lui rendre hommage et cela a donné ce roman qui m’a bien plu.
Je choisis d’y voir pour cet homme solitaire une prise de conscience de la réalité des événements extérieurs et de la nécessité soudain ressentie de s’exprimer même si pour cela il fallait bouleverser sa vie. Je choisis aussi d’y voir l’extraordinaire pouvoir de l’écriture qui transcende un fait anodin et qui, si on en croit l’auteur, plonge ses racines dans la révélation qui nous est parfois faite au pas du sommeil. Personnellement j’adhère à cette notion quasi-rimbaldienne de l’inspiration. Ce n’est pas si souvent qu’un écrivain révèle au lecteur ce qui a présidé à son travail de création même si l’auteur prête un peu ses sentiments à son personnage.
© Hervé GAUTIER
-
LA 7° FEMME – Frédérique MOLAY [Prix du quai des Orfèvres -2007] – FAYARD.
- Par hervegautier
- Le 03/04/2009
- Dans Frédérique MOLAY
- 0 commentaire
N°278 – Juillet 2007
LA 7° FEMME – Frédérique MOLAY [Prix du quai des Orfèvres -2007] – FAYARD.
Contrairement à ce que j'ai déjà lu ou entendu, le roman policier, qui, à mes yeux, est différent du « polar », n'est pas un art mineur. C'est un récit écrit en français correct et agréable à lire qui emporte le lecteur dans un univers, certes macabre, mais qui le tient en haleine jusqu'à la fin.
C'est donc un véritable roman policier, passionnant du début à la fin et qui se lit d'un trait que nous propose Frédérique Molay. Il y a certes le décor du prestigieux « 36 Quai des Orfèvres », le détail des autopsies et de la procédure, les différentes techniques d'investigations, la mise en évidence du difficile travail de terrain, celui des psychologues, des graphologues, des profileurs, l'esprit de corps qui règne au sein des équipes d'enquêteurs ... Le jury qui lui a décerné son prix n'y a pas été insensible [elle figure parmi les dix femmes lauréates, ce qui est déjà remarquable], mais ce n'est pas ce qui a retenu mon attention.
Unité de lieu : Paris, unité d'action: une série de meurtres perpétrés par un tueur en série, unité de temps[si l'on peut dire]: 7 jours. C'est selon ce découpage journalier que l'auteur déroule ce scénario sinistre. Il révèle l'exécution de femmes, au profil semblable, jeunes, jolies, brunes, ayant une bonne situation...
Le « modus operandi » est toujours semblable, les victimes sont toutes retrouvées nues, poignardées, attachées après avoir subi trente coups de fouet, des mutilations..., la souffrance avant la mort, une sorte de rituel pour un psychopathe! Autant dire que le tueur signe en quelque sorte son crime, fait preuve d'une grande prudence tout en laissant des indices difficiles à déchiffrer puisqu'un tel individu souhaite aussi être découvert, ...et en annonce un autre. C'est que chaque meurtre est accompagné d'un message. Ce dernier se fait de plus en plus précis, prend des connotations bibliques et surtout s'adresse personnellement à Nico Sirsky, jeune commissaire divisionnaire, chef de la Brigade criminelle de la PJ parisienne.
Au fil des chapîtres habillement construits, le lecteur fait connaissance avec lui, sa vie sentimentale qui va à vau l'eau, la solitude de celui qui vit pour un travail qui le passionne mais qui lui ruine la santé. Le hasard va cependant changer ce quotidien et l'impliquer personnellement... C'est qu'il va tomber éperdument amoureux de son gastro-entérologue, le Docteur Caroline Darly. Sa vie va, bien sûr, en être bouleversée!
De rebondissements en fausses pistes, de révélations en faits nouveaux, l'auteur entraîne son lecteur passionné jusqu'à la dernière page dans les arcanes d'une enquête parisienne dont l'étau se ressert petit à petit et qui justifie pleinement l'exergue de François Mauriac « l'épreuve ne tourne jamais vers nous le visage que nous attendions »
© Hervé GAUTIER - juillet 2007.
-
L'ÉLÉGANCE DU HÉRISSON - Muriel BARBERY - GALLIMARD.
- Par hervegautier
- Le 03/04/2009
- Dans Muriel BARBERY
- 0 commentaire
N°286– Décembre 2007
L'ÉLÉGANCE DU HÉRISSON – Muriel BARBERY - GALLIMARD.
Le bandeau de l'éditeur avait quelque chose d'encourageant, pensez-donc « Prix des Libraires 2007 ». Depuis le syndrome du Goncourt, l'obtention d'un prix, quel qu'il soit, surtout s'il s'affiche sur un morceau de papier rouge vif en travers de la couverture, est toujours, à tout le moins pour moi, assez engageant. Sur la 4em de couverture, j'apprends que le précédent roman de l'auteure, que j'avoue n'avoir pas lu, a été traduit en douze langues! Je suis toujours resté sur la certitude que la traduction d'un ouvrage dans une langue étrangère était forcément un gage de qualité. Ajoutez à cela, une publication chez Gallimard... Je ne pouvais donc qu'être transformé en lecteur attentif!
Le lieu, un immeuble cossu, 7 rue de Grenelle à Paris où se succèdent des générations de résidents-propriétaires. Les personnages, Renée, 54 ans, veuve et concierge de son état dans ledit immeuble et qui voit chaque jour passer devant sa loge la faune des propriétaires riches qui, bien entendu l'ignorent avec suffisance. Paloma, 12 ans, deuxième fille d'une famille de résidents influents, névrosés et snobs, à l'intelligence précoce et quelque peu en révolte avec son milieu social et sa famille et qui, malgré son jeune âge, a déjà l'intuition de ce que la vie lui réserve de désespérant et pense à son prochain anniversaire qu'elle célébrera en mettant le feu à l'immeuble qu'elle habite avec ses parents, et en se suicidant! Elle pense pouvoir y échapper temporairement en rédigeant une sorte de journal intime. Le décor et les principaux protagonistes avaient déjà quelque chose d'attachant, j'aime assez ceux qui se révoltent contre leur milieu et cultivent leur différence. C'est vrai qu'ici, le lecteur est servi. Cette concierge, sous des dehors conformes à son état, est en réalité une lettrée[un peu trop!] volontairement secrète, passionnée de littérature russe et de cinéma japonais, une « autodidacte prolétaire ». C'est elle qui a l'élégance du hérisson, pleine de piquants au dehors, mais sensible et subtile à l'intérieur. Elle vit avec un chat prénommé Léon, en hommage à Léon Tolstoï, et des souvenirs. Paloma distille des aphorismes et des remarques désobligeantes contre le milieu qui l'a vue naître. En arrière-plan, il y a la faune de l'immeuble, indifférente, compassée, imbue d'elle-même et pleine de condescendance pour cette concierge qu'elle traite comme les êtres conscients de leur prétendue supériorité savent le faire avec les subalternes... par le mépris! Il y a cependant des exceptions. Cela menaçait d'être intéressant!
Il y a une vrai complémentarité entre Renée et Paloma, deux solitudes, qui ne se rencontrent qu'à la fin. Le récit lui-même est une sorte de balancement entre deux extrêmes, deux conceptions opposées de la vie. Entre elles il y a cependant une sorte de compréhension pleine de non-dits, d'empathie secrète et muette.
Le style est alerte, emprunt d'humour, d'érudition[un peu trop peut-être?J'ai souvent eu la désagréable et agaçante impression que nombre de chapitres n'étaient là que pour mettre en valeur celle de l'auteure], élégant, jubilatoire même et bien dans l'esprit de cet ouvrage qui est une véritable critique des apparences et du pouvoir sous toutes ses formes. Mais j'avoue que j'ai eu du mal à terminer ce roman qui commençait si bien. L'auteur confie qu'elle s'est fait plaisir en l'écrivant, ce que je veux bien croire et cela me paraît être la moindre des choses, mais moi, en tant que simple lecteur, je ne l'ai que peu partagé, poursuivant ma lecture, davantage par curiosité que par véritable intérêt.
J'ai ressenti, toute au long de cette fiction, une sorte de superficialité, malgré les choses évoquées, une sorte de placage d'idées étrangères aux personnages et, bizarrement, à la fin, cela a laissé place à quelque chose de plus authentiquement humain, de moins intellectuellement apprêté, comme si les choses reprenaient leur vraie place dans un banal quotidien. « Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse ni son cœur ... » nous rappelle le poète.
© Hervé GAUTIER - Décembre 2007.
http://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg -
LIBRES PROPOS PERSONNELS.
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans MARIE DARRIEUSSECQ.
- 0 commentaire
N°209
Août 1999
LIBRES PROPOS PERSONNELS.
Je vais rédiger aujourd’hui ce dont je ne suis pas coutumier : un billet d’humeur.
J’ai lu il y a peu dans une revue spécialisée (Ecrire et Editer n°20) une interview de Marie Darrieussecq. Ce qu’elle disait était intéressant surtout à propos de l’écriture, de sa technique, de l’idée qu’elle s’en faisait, des conseils qu’elle donnait. J’ai cependant été surpris par une de ses réponses. Elle avouait “Quant au lecteur, ma position est claire: un bon lecteur est un lecteur muet qui me fout la paix ”.
Je ne pouvais rester insensible à cette remarque puisque cette chronique est consacrée depuis plus de vingt ans à recueillir mon avis sur les oeuvres des écrivains. Je dis bien recueillir mon avis et non pas les interpeller et surtout pas tenter d’obtenir d’eux une lettre que je pourrais exhiber dans une improbable collection. J’ai horreur de cela! Tout comme je déteste la chasse aux autographes, qu’elle s’applique aux professionnels de l’écriture comme aux chanteurs ou aux hommes politiques.
Je me souviens avoir assisté à une conférence de Michel Ragon et avoir soigneusement évité la foule de ses admirateurs bien que nous ayons préalablement été en correspondance. Quelques jours après je lui ai écrit pour le prier d’excuser ma timidité.
Pourtant, je ne comprends pas cette remarque de Marie Darrieussecq surtout quand elle nous explique que non seulement elle vit de sa plume, qu’elle a toujours voulu être écrivain, que c’est toute sa vie ... Mais qu’est-ce donc qu’un écrivain sans lecteurs, c’est à dire sans la vente de ses livres? Si un livre n’est pas lu, qu’est-il donc sinon un ensemble de feuilles imprimées et reliées auquel personne ne s’intéresse?
Il faut bien des lecteurs privilégiés, les critiques, pour donner leur avis et assurer ainsi le démarrage commercial d’un livre. Il faut bien des lecteurs anonymes pour assurer la vente d’un livre qui, s’il est un succès sera l’invite à en écrire d’autres et ainsi à constituer petit à petit une oeuvre. Ainsi il me semble que le lecteur est le partenaire privilégié de l’écrivain car sans lui il lui serait difficile de vivre de sa plume (c’est si rare). Que pourrait penser un éditeur qui, ayant fait confiance à un auteur verrait ses livres non lus, c’est à dire non vendus.
Dès lors qu’il prend la plume une écrivain se met en situation d’être jugé par le premier lecteur venu et ne doit pas s’étonner qu’éventuellement celui-ci se manifeste. Ce serait plutôt bon signe pour l’auteur qui verrait ainsi qu’il ne laisse pas indifférent.
Ainsi je comprends mal que, sans donner dans un vedettariat outrancier un auteur méprise à ce point son lecteur, le considère uniquement comme quelqu’un qui achète et lit sans lui donner le droit de s’exprimer. Libre à lui d’ailleurs de répondre ou non.
Je l’ai dit, je n’ai pas pour habitude de déranger les auteurs et cette chronique n’existe que pour d’improbables correspondants. Il n’empêche, je me suis toujours attaché à faire parvenir à l’éditeur d’un livre l’avis du simple lecteur que je suis. Certains (rares) m’ont exprimé des remerciements, parfois des remarques, mais ce n’était pas là le but. J’ai la fatuité de penser qu’un écrivain attache autant d’importance à l’avis de son lecteur qu’à celui de la critique, mais peut-être me trompais-je?
Quant à Marie Darrieussecq, je n’ai encore lu aucun de ses livres, mais promis, je vais m’y mettre.
Ne lui en déplaise, je donnerai sans doute dans cette chronique mon avis de simple lecteur... Mais je lui foutrai la paix!
©Hervé GAUTIER
-
A PROPOS DE MARIE DARRIEUSSECQ.
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans MARIE DARRIEUSSECQ.
- 0 commentaire
A PROPOS DE MARIE DARRIEUSSECQ.
Dans un précédent numéro de la Feuille Volante (N°209) j’ai livré mon sentiment sur une remarque de Marie Darrieussecq à propos du lecteur de ses romans. Je ne retire rien de ce que j’ai écrit mais dans cet article j’avouais ne pas connaître l'œuvre récente de cet écrivain. Je l’ai donc abordée à travers deux romans »Le mal de mer » et « La naissance des fantômes ».
Je crois savoir que la critique n’est pas tendre avec elle mais cette revue existe pour que soit exprimé mon avis et non pour qu’elle soit le reflet de celui des autres. De ces deux romans dont le style d’écriture m’a surpris je dirai simplement que, malgré une lecture attentive je n’ai pas réussi à entrer dans l’univers de l’auteur... et que je le regrette.
Je ne comprends pas non plus la remarque laudative de François Nourrisier « Darrieussecq atteint un raffinement dans le style »
©Hervé GAUTIER
-
DES CRIMES INSIGNIFIANTS - Alvaro Pombo- Editions Gallimard.
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Alvaro Pombo
- 0 commentaire
DES CRIMES INSIGNIFIANTS - Alvaro Pombo- Editions Gallimard.
Il se trouve que je suis amateur de romans policiers. Ce titre, du moins en apparence, m’a donné à penser que ce livre pouvait en être un. Je l’ai donc lu. Malheureusement, tel n’était pas le cas.
Sans déflorer l’intrigue, qui m’a paru par ailleurs bien laborieuse, l’histoire relate, dans le climat surchauffé de Madrid, les relations ambiguës d’Ortega, un ancien romancier qui a perdu le goût d’écrire et qui s’est reconverti dans un travail de bureau autant que dans la solitude et Quiros, un jeune homme, un peu éphèbe, actuellement en chômage et qui semble apprécier sa situation d’oisif.
Celui-ci nous est dépeint comme un profiteur « qui vit des femmes », c’est à dire de sa mère, veuve, qui le loge et pourvoit à son entretient quotidien et Cristina, sa fiancée qui subvient à ses besoins et surtout à ses caprices.
Au contact de Quiros, Ortega semble reprendre goût à l’écriture à moins qu’il ne découvre en lui des fantasmes inavouables et des désirs inassouvis. Le futur remariage de sa mère et l’attitude de Cristina qui commence à trouver que cette situation a assez duré rapprochent Quiros d’Ortega qui apparemment supporte mal ce bouleversement de sa vie.
J’avais voulu en savoir plus sur cet écrivain inconnu de moi mais qui avait l’avantage, à mes yeux important, d’être espagnol. Je dois avouer que j’ai été un peu déçu.
© Herve GAUTIER
-
A PROPOS DE FRANCISCO COLOANE - Editions Phébus
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans FRANCISCO COLOANE
- 0 commentaire
A PROPOS DE FRANCISCO COLOANE - Editions Phébus
Décidément, les écrivains sud-américains ne cessent de m’étonner.
L’intérêt que je porte au talent d’Alvaro Mutis m’a tout naturellement dirigé vers Francisco Coloane, romancier et nouvelliste Chilien, dont Mutis révéla l'œuvre au public français.
Qu’il évoque les paysages envoûtants de la Patagonie dans ses nouvelles (le Golfe des Peines) ou l’histoire tourmentée du peuple indien Ona (le Guanaco) ou le destin des Alakalufs, il n’abandonne jamais longtemps la mer, ses marins, les tempêtes meurtrières du Grand Sud, ses navires (Le Dernier Mousse), ses naufrages.
C’est toujours un peu de sa biographie qu’il nous livre à travers les récits qu’il fait et les personnages qu’il campe, souvent pauvres et sans famille. Ils ne craignent pas d’affronter la souffrance et souvent la mort dans les paysages inhospitaliers mais aussi grandioses des Canaux de Patagonie, du Cap Horn ou de la Terre de Feu
Il y a sûrement un peu de son père dans le Capitaine Albarran (Le Sillage de la Baleine). Ses personnages ont quelque chose d’attachant puisque, à travers eux, m’a-t-il semblé, c’est à une recherche de l’homme à laquelle il se livre même si la condition humaine dont il est question ici est celle de la souffrance et de la mort.
C’est là un romancier authentique dont les mots ne peuvent laisser le lecteur indifférent. Ils puisent sans doute leur force dans les tempêtes, le froid et l’évocation des mystères du monde de la mer et de sa beauté inhumaine. Elle est présente à chaque ligne dans son œuvre. C’est vrai qu’il a sacrifié aussi aux légendes des vaisseaux fantômes, au décor des bars et des bordels dont chaque port est indissociable et à toute une mythologie de monstres marins dont les baleines qu’on pêche ici prennent les traits. Mais ce qu’il peint aussi c’est les dures conditions de vie des marins, véritables forçats de cette mer ingrate à laquelle pourtant ils se donnent pour échapper à la misère d’une terre stérile.
Il y a aussi cette quête que chaque homme mène et qui est sa raison de vivre, que ce soit celle du frère disparu (Le dernier mousse) ou celui du père inconnu (Le Sillage de la Baleine), le gain ou la femme à qui l’on rêve et dont on a, un jour, croisé le sourire.
L’auteur nous rappelle que nous ne sommes que de passage sur terre, que la vie ne se résume pas forcément à une somme de moments heureux et que l’homme est fragile, vulnérable face aux éléments.
Avec » Le Sillage de la Baleine », l’auteur signe ici un texte non seulement émouvant et parfois même bouleversant mais sûrement un moment fort de son œuvre. Dès lors, je ne m’étonne pas qu’Alvaro Mutis, le créateur du personnage de Maqroll El Gaviero, marin mythique, dont j’ai abondamment parlé dans cette chronique ait été sensible à l’écriture de Coloane.
Neruda lui-même nota que « Pour embrasser Coloane, il faut avoir des bras longs comme des rivières ».
© Hervé GAUTIER
-
DEUX OU TROIS CHOSES SUR LES NOUVELLES DE DANIEL BOULANGER.
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Daniel BOULANGER
- 0 commentaire
N°224
Mai 2000
DEUX OU TROIS CHOSES SUR LES NOUVELLES DE DANIEL BOULANGER.
C’est effectivement à la visite d’une galerie de portraits que nous convie Daniel Boulanger. Chacune de ses nouvelles est une invitation à entrer dans une histoire, à évoquer, parfois à effleurer, par pudeur sans doute, une parcelle de la vie d’un personnage, entre fiction et réalité.
Par le miracle de l’écriture, véritable alchimie chaque fois renouvelée, l’auteur nous convie à pénétrer le jardin secret d’un être, veuf esseulé, aristocrate original, célibataire par vocation, vieux couples pour qui l’amour n’existe plus, amants et maîtresses, vieilles filles et hommes en quête de l’âme sœur, marginaux, fantasques… Bref tous les protagonistes du théâtre de la vie dont il est le spectateur attentif et qu’il nous donne à voir pour notre plus grand plaisir.
Tous ces êtres passent devant lui, soit en gardant secrète leur existence soit en vidant leur sac « Où traînent de pauvres monnaies dont nous ne savons et nous ne saurons jamais le cours. » comme il le dit si joliment.
C’est une évocation à chaque fois recommencée, une sorte de kaléidoscope de héros ordinaires que dès l’abord on pourrait regarder comme falots et sans importance mais qui sous sa plume prennent une dimension non seulement humaine mais exceptionnelle. On y lit souvent la solitude et le désarroi, la détresse parfois. Vous les auriez cru sans histoire et c’est précisément le contraire qui se produit.
La lecture de ses textes, par leur dimension à la fois poétique, humoristique, émouvante, attendrissante, ouvre les yeux du lecteur sur un univers insoupçonné et qui le laisse le plus souvent émerveillé par le pouvoir d’évocation et de dépaysement de cet auteur qui, à chaque fois m’enchante.
Son humour, son style ont cette légèreté discrète et chaleureuse qui vous font aimé un livre, sa faconde, son culte du mot juste et son sens de la formule révèlent un spectateur vigilant de la condition humaine. En effet, bien peu de décors lui échappent et il sait mettre en scène ces individus pour les rendre attachants.
Auteur prolixe, il sait à merveille disséquer les désordres intérieurs, la quête humaine du bonheur et évoquer la honte, la désapprobation publique qu’un être peut rencontrer dans sa vie. Les replis de l’âme lui sont à ce point connus qu’il les évoque, à la manière d’un orfèvre capable non seulement d’écouter et de voir sans être voyeur mais aussi de restituer pour son lecteur cette approche, par bien des côtés extraordinaire.
Les pulsions, les passions, l’aspect transitoire et temporaire de la vie humaine nourrissent chacune de ses nouvelles. Il n’occulte rien de ce qui fait la vie, l’amour et bien entendu la mort. Il sait rendre l’écume de ces jours et parfois de ces nuits, ces moments qu’il nous peint avidement, heureux ou tragiques, ces miettes de vie, ces copeaux d’existence, ces moments banals ou étranges, déclinés entre fantasmes et certitudes. Les zones d’ombres et de lumière alternent dans des parcelles d’être, entre amours et violence, jouissance de la vie et attirance vers le néant. Les rôles qu’il distribue sont divers, avec peut-être une prédilection pour les femmes d’âge, extravagantes ou veuves de militaires, parfois désirables… Les histoires qu’il raconte s’inscrivent entre foucade et fidélité, passions et passe-temps, souvenirs et regrets…
Tout cela en fait un écrivain d’exception, une sorte de médiateur entre les divinités de l’inspiration et notre pauvre condition de lecteur.
© Hervé GAUTIER.
-
Le MIROITIER - Daniel BOULANGER – Editions GALLIMARD..
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Daniel BOULANGER
- 0 commentaire
N°222
Avril 2000
Le MIROITIER - Daniel BOULANGER – Editions GALLIMARD..
Au moment où un grand éditeur choisit de republier des nouvelles de Daniel Boulanger, il m’a paru intéressant de me replonger dans son œuvre.
J’ai déjà dit dans cette chronique que la valeur d’un livre ne saurait, à mes yeux, résider dans sa seule nouveauté. Son existence, sa permanence sont une invite constante à le découvrir. Bref, j’ai donc choisi Le Miroitier.
C’est là une histoire d’amour comme il en existe tant dans les ouvrages de fiction dont notre auteur place le déroulement à Aussoy sur Orbe, une ville qu’il serait sans doute difficile à situer sur une carte de géographie. Il y fait vivre tout un petit peuple de personnages originaux, insolites, furtifs parfois mais toujours attachants, une véritable galerie de portraits qu’il serait vain d’épeler ici. Le lecteur en découvrira tout le charme, la truculence parfois comme il notera, au fil des pages, l’histoire et les histoires de cette petite ville, au demeurant bien semblable à toutes les autres.
Mais, le titre semble l’indiquer, ce qui est intéressant c’est moins l’environnement de cette agglomération que le personnage principal, Lucien Médard, miroitier de son état qui vit son commerce plus qu’il n’en vit. C’est, en fait, un véritable office, presque une institution. C’est avec lui que Grazina, sa femme, ex-danseuse de Cracovie a choisi la liberté. Elle donne des cours de danse, fait tourner quelques têtes, mais son côté exotique en fait l’âme de cette improbable bourgade.
C’est vrai que Médard, à l’hypothétique lignée a un sens tout particulier du commerce qu’il tient. Vend-on des miroirs si l’on a pas un sens particulier de la vie, sans limite, sans contrainte ? Tient-il des objets qu’il vend un don particulier de voyance ? Allez savoir ! Mais quand même, la complicité avec les miroirs n’est pas quelque chose de banal. Ce simple instrument ne renvoie-t-il pas deux images en une seule, une réelle et une virtuelle dont on nous dit qu’elle se forme derrière la plaque de verre. Ah, l’optique a décidément des mystères délicieux et la virtualité dont on nous rebat maintenant les oreilles à tout propos a toujours eu pour moi un attrait tout particulier !
Et puis rappelons que les poètes ont toujours voulu le traverser. La glace est une surface lisse à laquelle il est bien juste de prêter des pouvoirs magiques. Après tout le miroir ne réfléchit pas seulement notre propre image, mais aussi nos défauts, nos lâchetés, nos renoncements… Il n’est pas seulement pour les alouettes ou pour Narcisse et à travers lui tout est beau, l’image bien souvent plus que l’original ! Et puis l’Orbe qui baigne cette incertaine localité, n’est-elle pas, elle aussi un miroir pour les Aussoyens ?
Il y a aussi une dimension intemporelle ici, à la manière de ce Médard qui annonce toujours l’heure qu’il est à l’autre bout du monde plutôt que de soucier du temps qui s’égrène chez lui. Quand la pendule sonne à l’ église des Pénitents, il feint de l’ignorer et communique, Dieu sait pourquoi, sautant par dessus les fuseaux horaires, ce que marque la montre d’un Chinois ou d’un Américain !
Dans cette foule d’ individus, il y a quand même la bonne conscience du lieu, Basile, sorte de Diogène qui vit en complicité avec un cheval. C’est une sorte de mélange de philosophe, dispensateur de bon sens et un fervent admirateur de Bacchus.
Mais peut-être que tout cela est faux, à l’image des fantasmes du miroitier. Après tout peu importe « Le mensonge sert parfois de canne » et l’important est que cela fasse rêver le lecteur.
Ne vous privez pas d’entrer dans l’univers de ce roman écrit comme une nouvelle, avec son humour au ras des mots. Ce qui compte en ce bas monde, c’est le merveilleux !
© Hervé GAUTIER.
-
LE CHATEAU DE LA LETTRE CODEE - Javier TOMEO - Edition Christian Bourgois.
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Javier TOMEO
- 0 commentaire
N°83 - Octobre 1991.
LE CHATEAU DE LA LETTRE CODEE - Javier TOMEO - Edition Christian Bourgois.
Si, livre en mains, vous prenez la peine de lire les quelques lignes de présentation qui emportent souvent la décision du lecteur dubitatif, vous ne manquerez pas de remarquer que la traductrice de cet ouvrage l’annonce comme un roman formidable. Je partage, pour ma part complètement cet avis tant le flot de mots qu’on peut y lire entraîne le lecteur presque malgré lui dans le sillage du marquis en une multitude de situations pour la remise d’une hypothétique lettre dont le moins qu’on puisse dire est qu’elle est bizarre (codée!) à un comte qui ne l’est pas moins, par son domestique de qui il attend un dévouement aussi aveugle qu’anachronique.
Il a l’obligeance de l’avertir de tout ce qu’il risque dans cette entreprise, de tout ce qu’il doit éviter de faire et de dire pour ne pas encourir les foudres du dangereux comte.
Cette lettre, loin d’être un message n’est qu’un prétexte puisqu’elle est incompréhensible et indéchiffrable, c’est à dire le contraire d’une missive qui se respecte. Sous couvert d’expliquer l’inexplicable, l’auteur qui par ailleurs observe la désuète unité de temps, de lieu et d’action (ou d’inaction) cultive admirablement la digression, et, dans une espèce de fatrasie surréaliste où les fadaises le disputent aux poncifs promène le lecteur dans une sorte de soulerie de mots (salutaires souleries de mots qui valent bien, je vous en réponds les libations vinicoles!)
Ce long monologue du marquis, naufragé volontaire de la société pendant vingt années derrière les murs de son drôle de château est entrecoupé de silences circonstanciés (ou seulement évoqués) du valet. Il consiste en une sorte d’évocations plus illogiques les unes que les autres, émaillées de propos oiseux sur les insectes et les batraciens, des proverbes et autres apostilles mais cache sûrement le poids très fort de la solitude à moins que ce soit le plaisir de se laisser aller, devant la page blanche, aux délices de l’écriture automatique guidée par une imagination fantasque. Il se pourrait même que le château n’existe pas plus que la lettre... Il resterait au moins le livre, unique et bien différent de ce qu’on a l’habitude de lire. Cela vaut son pesant d’humour et au moins c’est original.
© Hervé GAUTIER
-
MON PERE- Film de José GIOVANNI ET Bertrand TAVERNIER
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
.
N° 246–Juin 2003
MON PERE- Film de José GIOVANNI ET Bertrand TAVERNIER
France 3 - lundi 5 mai 2003.
« La Feuille Volante » célèbre cette année son 24° anniversaire.
Ce n’est pas sa vocation première, puisqu’elle est destinée à donner son avis (qu’on ne lui demande d’ailleurs pas) sur la littérature et la poésie françaises, pourtant, cette fois, c’est un film qui a retenu mon attention, mais pas n’importe lequel !
J’avais déjà signé un article sur l’excellent roman de José Giovanni (La feuille Volante n° 204 de mars 1999) « Il avait dans le cœur des jardins introuvables » où l’auteur parle de son père avec un amour plein de remords, comme si les deux hommes avaient passé leur vie à se côtoyer sans jamais se comprendre, se rencontrer, sans peut-être vouloir le faire vraiment…
Le film s’inspire de ce roman autobiographique, mais c’est avant tout une création axée sur le rôle d’un homme en faveur de son fils parce que sa vie est menacée !
Tout se résume en une quête d’un père, Joe, Corse pauvre qui partit, avant la 1° guerre mondiale pour l’Amérique « avec quelques pièces d’or portées dans une ceinture, à même la peau », un jeu de cartes et une envie de réussir à tout prix dans ce pays où tous les rêves étaient possibles. De retour en France, on nous fait comprendre qu’il a été très absent, qu’il a donné à ses fils le mauvais exemple dans la fréquentation des prostituées, des tripots et du « milieu », un homme, en tout cas qui ne s’est pas occupé d‘eux comme il aurait dû le faire. Il les a précipités, probablement sans le vouloir, mais en ne faisant rien pour l’empêcher, dans la vie facile mais dangereuse que leur offrait Santos, leur oncle, un truand maudit pourtant par ce père.
L’aîné perdra la vie dans une entreprise aventureuse ourdie par cet oncle qui les trahira, une rixe meurtrière d’où Manu, le cadet, sortira en vie mais condamné par une justice qui voyait plus en lui un coupable idéal qu’un véritable assassin qu’il n’était pas. Il fallait que quelqu’un paie pour la vie des victimes, ce serait donc lui qu’on avait choisi. La guillotine trancherait sa vie puisque, à l’époque, cela se faisait encore ainsi. C’est vrai que dans cette après-guerre on était peu sourcilleux sur la présomption d’innocence et bien plus désireux de faire « des exemples »
On entraperçoit le personnage de la mère qui, à travers la recherche d’une improbable martingale, veut retrouver cette richesse qui avait été la leur autrefois et dont elle conservait le souvenir dans quelques photographies un peu jaunies. Malgré tout, là aussi il y a un échec, tempéré sans doute par les paroles d’une cartomancienne qui lui avait prédit la réussite d’un de ses enfants. Pour elle, pas de doute possible, ce sera sa fille, douée pour les arts ! Certes, cette femme incarne la famille face à un père plus occupé ailleurs, elle symbolise sa permanence puisque c’est elle que Joe charge de faire connaître à Manu, maintenant détenu dans le quartier des condamnés à mort, le résultat de ses tractations. C’est que le père a trouvé dans ce nouveau combat qu’il mène dans l’ombre pour la libération de son dernier fils, le vrai sens de sa vie. C’est un peu comme une revanche, un pardon qu’il sollicite, un rachat sans doute… Mais les relations avec son fils sont toujours aussi tendues.
Comme il ne peut lui parler sans que leur incompréhension n’éclate de nouveau, Joe devient un habitué du café qui fait face à la prison de la Santé opportunément appelé « Ici mieux qu’en face. » Il y rencontre les surveillants qui lui donnent des nouvelles de Manu (Rufus est émouvant dans le rôle de ce gardien, marié à une femme aveugle et qui entretient avec les détenus une quasi-sympathie - un condamné à mort propose même de donner ses yeux pour son épouse !) devient presque leur ami. Il y apprend les coutumes de la prison, comme celle de faire laver le couloir du secteur des condamnés à mort quand ce n’est pas le jour réglementaire, ce qui signifie qu’il va y avoir une exécution, ce qui amplifie encore l’angoisse de Joe parce que son fils y est présent et que c’est peut-être son tour !
Il y a même une atmosphère de compassion qui se tisse entre les détenus et ces hommes, obligés de faire leur travail pour ne pas perdre leur emploi, une justice un peu trop prompte à condamner et ce père qui se bat pour la vie de son fils.
On ne prononce pas le mot « maton », au contraire, les détenus respectent ces surveillants qui les gardent mais qui doivent souvent travailler à l’extérieur pour élever leurs enfants, tel cet homme reconnu par un prisonnier repris et qui avait vu un de ces gardiens qui devait, pour survivre et élever Sa nombreuse famille… cirer les chaussures en pleine rue !
Joe œuvrera seul, dans l’ombre et à l’insu de son fils, ira même jusqu’à implorer la pitié des parents des victimes pourtant dans l’attente de l’exécution. Il obtiendra, par avocats et personnalités interposées que le Président Vincent Auriol commue la peine en détention à perpétuité. Il avait probablement dans le cœur ces jardins introuvables, ce père qui n’hésita pas à mettre en gage son bridge en or pour payer les frais d’avocats chargés de trouver un improbable vice de procédure et ainsi faire casser un jugement ou faire reporter la date de l’exécution ou à passer des nuits sous la pluie pour émouvoir une mère et arracher son pardon ! Puis ce seront les remises de peine et toujours ces rendez-vous au café en face de la prison pour y quêter des nouvelles de son fils.
Sous l’impulsion discrète mais obstinée de cet homme enfin dans son rôle de père, un élan de solidarité se crée en faveur de Manu…
Parce que son avocat avait remarqué que Manu tenait un journal et avait un goût pour l’écriture, il lui conseille de relater son séjour en prison. Son roman « Le trou » sera un succès. Dès lors une nouvelle vie commence pour lui et pour son père un espoir possible de libération même s’il reste de plus en plus en marge. C’est lors d’une séance de signature que les gardiens lui révèlent l’action de Joe en sa faveur, ses attentes au café, ses espoirs déçus parfois… C’est une révélation pour Manu qui recherche son père dans l’assistance mais ne le trouve pas. Seul le spectateur voit disparaître sa lourde silhouette poursuivie par ce fils désormais célèbre et libre, mais l’ultime rencontre ne se fait pas, comme un rendez-vous perpétuellement manqué entre ce père et lui ! (Bruno Cremer campe le personnage de Joe avec son talent habituel) Ce combat l’avait tellement épuisé qu’il mourut avant la réhabilitation de ce fils qu’il avait si activement contribué à faire libérer.
Sa vie pouvait dès lors se terminer. Il ne servait plus à rien et c’est sans doute le sens de cet ultime appel de Manu, soudain revenu à la réalité qui va devoir vivre comme avant certes, mais cette fois avec une manière de remords et le sentiment d’une dette imprescriptible envers un homme désormais absent pour toujours. Il lui adresse, en même temps que ce film un pathétique « A Bientôt ! »
Le roman avait su m’émouvoir, le film a ravivé cette émotion qui met en lumière ces relations parfois difficiles entre les membres d’une même famille surtout quand la vie de l’un de ses membres est en jeu. Et qu’il est toujours temps de racheter un manquement, une faute...
NB : a mon avis le film méritait plus de deux 7 à la cote de télé 7 jours.
Diffusion gratuite – correspondance privée.
© Hervé GAUTIER Revenir au début http://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg
-
Quelques réflexions personnelles sur l’œuvre de Patricia CORNWELL.
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Patricia CORNWELL.
- 0 commentaire
N° 243–Septembre 2002
Quelques réflexions personnelles sur l’œuvre de Patricia CORNWELL.
Je n’ai pas honte de l’avouer, en ce qui me concerne, la première lecture d’un auteur inconnu se fait souvent à partir d’un amical conseil, d’un article de presse ou tout simplement d’un livre pris, parfois au hasard, sur les rayonnages d’une bibliothèque !
De telles méthodes ont leurs insuffisances et bien souvent leurs limites et si au bout de cinquante pages l’intérêt n’est pas au rendez-vous, j’abandonne.
Je ne sais pas comment le nom de Patricia Cornwell a suscité mon attention, mais ce qui est certain c’est que le roman policier, aussi bien en ce qui concerne l’écriture que la lecture, prend de plus en plus de place dans ma vie et dans mes loisirs… Je ne m’en plains pas !
Au-delà de l’auteur, dont la biographie révèle une réelle réussite d’écrivain et une générosité notable d’autant plus appréciable qu’elle sait rester discrète, pour le progrès de la médecine légale et donc de la justice, il y a les personnages, les histoires…
Tout d’abord je dois dire que ses romans sont servis par une remarquable traduction française, car, s’agissant d’un texte original écrit en américain, il est injuste d’oublier le nom du traducteur (ou de la traductrice) c’est à dire celui qui rend l’ouvrage lisible en français et contribue largement à son succès.
L’héroïne principale, le docteur Kay Scarpetta, d’origine italienne comme son nom l’indique est médecin légiste qui prend d’ailleurs des allures de policiers. La vie du personnage se nourrit des expériences professionnelles et personnelles de l’auteur puisque Patricia Cornwell a été, outre chroniqueur judiciaire, informaticienne à l’institut médico-légal de Richmond (Virginie) où elle noue des liens d’amitié avec le docteur Marcella Fierro, directrice de la morgue, ce qui donnera naissance, sans doute malgré elle, au personnage de Kay Scarpetta. Richmond sera bien entendu le lieu géographique de la plupart de ses romans.
Avec ses collègues, dont l’inséparable capitaine Marino, un peu macho et entretenant avec la bière des liens étroits, elle mène inlassablement ses enquêtes qui l’entraînent parfois à l’autre bout des Etats-Unis.
Ici le rythme est rapide et fascinant à la fois et Kay risque sa vie dans chaque enquête. Elle y perdra même l’homme de sa vie dont la mort continue de l’obséder. Mais elle fait face malgré les chausse-trappes que lui tendent les tueurs désireux de l’éliminer physiquement ainsi que les brimades de sa hiérarchie, le monde macho de la police…
Elle a des relations intimes avec Benton Wesley, un « profileur » du FBI. Elle partage sa vie par intermittente et ses sentiments pour lui montrent combien un auteur peut se révéler dans une de ses œuvres (« Combustion »). Un roman policier n’est pas seulement le récit d’histoires sordides où la mort est présente à chaque page. Dans les cas des œuvres de Patricia Cornwell, j’ai ressentis, personnellement du moins, une forte charge émotionnelle au moment notamment où elle décrit avec moult détails l’atrocité d’un meurtre autant que les différentes sentiments qui habitent Kay Scarpetta quand elle disperse les cendres de son amant sur une plage selon la volonté du défunt. On met toujours un peu de soi dans son écriture et l’œuvre en témoigne !
Pete Marino, omniprésent à ses côtés tel un ange gardien, respectueux cependant de sa vie privée est un peu son double inversé, mais j’aime surtout qu’elle soit cette mère de substitution pour sa nièce, la fragile Lucy, agent du FBI, surdouée, homosexuelle, mais toujours un peu en marge de cette société qu’elle contribue à défendre mais qui la rejette parce qu’elle est une femme œuvrant dans un monde essentiellement masculin.
Il y a deux styles sinon deux manières d’écrire chez Patricia Cornwell. Bien sûr, il n’y a pas de roman policier sans crime et sans atrocités. C’est là le parti pris de l’auteur qui puise largement dans son expérience glanée en médecine légale, mais il ne faut pas oublier que la mort fait partie de la vie et que notre société est aussi composée de criminels, de sadiques, de psychopathes. C’est donc cette face cachée que Patricia Cornwell nous donne à voir… et elle le fait non seulement avec talent mais aussi avec des précisions scientifiques et un goût du détail qui rendent, même pour un non initié comme moi, l’histoire d’autant plus crédible et intéressante.
Il n’en existe pas moins deux séries de personnages-phares : Kay Scarpetta qui vit imprime sa marque dans onze roman. Elle y côtoie Marino, Benton et sa nièce Lucy. A mon avis ce sont de loin les plus intéressants ; puis il y a une seconde série d’où tous ces personnages sont absents. Ce sont les romans les plus récents. Les chefs de la police locale sont des femmes telles Judy Hammer (« L’île aux chiens »-« La griffe du Sud ») ou Virginia West (« La ville des frelons »). Dans cette série émerge un personnage masculin qui sans doute prendra de l’importance dans son œuvre à venir, c’est celui d’Andy Brazil, ex-journaliste de talent devenu policier.
Patricia Cornwell entraîne son lecteur dans une série d’aventures passionnantes qui révèlent autant les bas fonds de la société américaine que la cupidité la cruauté des hommes, quand ils sont des criminels, mais aussi l’humanité des êtres dits « normaux ».
L’auteur est de son temps et l’informatique, inévitable, incontournable de nos jours, tient une grande place dans son œuvre. Internet aussi, évidemment et c’est souvent à cause de ce vecteur que le docteur Scarpetta et ses autres personnages sont entraînés, presque malgré eux dans des enquêtes où le macabre le dispute à l’horreur ! Il est vrai que nous sommes loin des fictions lentes et lénifiantes aux trop heureuses conclusions !
Elle décrit sans complaisance la vie de son temps, de Richmond, cette ville de Virginie qu’on pourrait croire assoupie, mais aussi de cette société américaine, avec ses travers, son quotidien, cette « américan way of life », rêve pour certains, cauchemar pour d’autres, minée par le racisme, la drogue, la corruption, l’omniprésence des armes, le profit, la réussite, la situation centrale des Etats-Unis dans le monde, son goût pour le pouvoir ! Cette société qui a souvent attiré les hommes du monde entier parce que c’est un espace de liberté mais elle masque à peine son autre visage d’insécurité et de violence, d’injustice aussi !
Elle a du se battre pour faire reconnaître son talent et ce n’est pas là la moindre de ses qualités personnelles, même si maintenant on lui rend justice par l’attribution de prix prestigieux tels que le « Edgar Poe Award » ; l’ « Anthony Award », le « Macavity Award », le « Dagger Award ». »
La France, pays de la culture, n’a pas non plus été en reste qui lui a accordé le « Prix du roman d’aventure » (1992) qui récompensait, pour la première fois une Américaine/
Je serai pourtant toujours attentif à cet écrivain dont la notoriété dépasse largement et heureusement les frontières de son pays.
© Hervé GAUTIER. http://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg
P.-S. Patricia Cornwell a notamment publié « Postmortem » (1992) – « Mémoire mortes » (1993) – « Et il ne restera que poussières… » (1994) – « Une peine d’exception (1994) » - « La séquence des corps » (1995) – « Une mort sans nom » (1996) –« Mort en eaux troubles » (1997) – « Mordoc » (1998) – « Combustion » (1999) – « Cadavre X » (2000) – « Le dossier Benton » (2001) – « La ville des frelons » (1998) – « La griffe du sud » (1999) – « L’île des chiens » ( 2002)
-
POUR NE PAS OUBLIER MARJAN.
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans MARJAN
- 1 commentaire
N°213
Novembre 1999
POUR NE PAS OUBLIER MARJAN.
Cela fait plus d’une année qu’il nous a quittés. Dans les revues que je reçois, ses poèmes se font rares, inexistants même. Dans Niort, sa ville qu’il n’a jamais quittée, que reste-il vraiment ? Son nom sur une plaque de rue, une exposition prévue de longue date qui tarde à être organisée et qu’on repousse de plus en plus, son nom qui peu à peu s’efface… Il aimait la vie et se battait contre la mort en une lutte dérisoire que son cœur fatigué rythmait de ses essoufflements. Nous sommes tous mortels, n’est-ce pas ?
Ce n’est pas grand chose qu’une pensée furtive pour ceux qui ne sont plus mais grâce à la vigilance des vivants, ils ne sont pas tout à fait morts. C’est là un hommage fugace, presque inutile, car chacun a ses préoccupations, dit-on !
Que reste-t-il de lui? Des milliers de poèmes disséminés aux quatre vents des revues qui le publiaient et auxquelles il participait. Le simple fait de voir son nom au sommaire d’une publication française ou étrangère l’enchantait. C’était son côté adolescent qui s’émerveillait de tout, qui croyait tant à la force de l’amitié, qui savait être généreux même si parfois cela laissait place à la déception. Qu’importe, il continuait à écrire, à publier les autres surtout dans une sorte d’incompréhensible action de vulgarisation qu’il tenait sans doute de son ancien métier d’imprimeur.
Il faisait partie de cette grande confrérie des brasseurs de mots, des sculpteurs de vent que sont les poètes. Il était de ceux qui, inlassablement noircissent des pages blanches, pour se prouver sans doute qu’ils existent, pour le craquement de la plume ou le feulement de la mine sur le papier ou assurément pour répondre à cette implacable inspiration qui, lorsque parfois elle trouble leur nuit ou leur tranquillité et qu’ils y répondent transforme quelques instants de leur vie en moments d’exception.
Il était à la fois tout cela et bien davantage encore, parce que l’écriture est pauvre quand il s’agit d’évoquer pleinement un homme tel que lui. Je ne le fais pas uniquement au nom de cette grande amitié qui nous unissait, mais aussi, sans doute, parce que dans ma vie le devoir de mémoire a pris, ces dernières années une dimension personnelle. La mort, il est vrai, marque notre condition humaine de son sceau définitif. De son vivant, il était aussi attentif à la trace laissée par ses amis disparus.
Son humour était une arme contre la mort, et malgré ce combat perdu d’avance, je puis témoigner qu’il l’a bien moquée, comme si tout cela n’était malgré tout qu’une vaste comédie, que notre passage sur terre n’était qu’un moment sans grande importance mais que tout homme a cependant le devoir de marquer le plus honorablement possible et pendant lequel il faut impérativement être soi-même !
Ce dont je voudrais me souvenir aussi, c’est de son combat en faveur des petites gens dont il faisait partie. Il savait toutes les souffrances endurées par les pauvres, par cette classe ouvrière dont il était issu et dont il a si bien parlé. C’était, il est vrai plutôt celle des années 30-40 que celle des 35 heures et de l’informatique, mais il faut lui rendre cet hommage qu’il avait su, lui, se souvenir de ses origines et y avait puisé une grande partie de son inspiration.
Je n’oublierai pas non plus le défenseur des droits de l’homme, de ceux qui sont emprisonnés pour leurs idées. Là aussi était son combat. Il était un humaniste, libertaire, attentif aux autres, en perpétuelle révolte contre la misère et l’injustice. Il ne se rangeait jamais du côté du plus fort.
Depuis plus d’un an, nul ne reçoit plus le Bouc des Deux-Sèvres dont il avait fait revue fétiche. Elle avait des défauts, certes (tout est perfectible en ce monde !), mais elle existait et beaucoup lui rendaient hommage et célébraient le formidable optimisme de son unique et désintéressé animateur. C’est qu’il était seul et s’entendait bien avec lui-même. Il en avait toujours été ainsi au cours de son impressionnant parcours d’éditeur et d’animateur de revues.
Il avait accueilli, surtout au sein des Feuillets Poétiques et Littéraires de nombreux auteurs, des célèbres comme des inconnus et il a été à l’origine de vocations d’écrivains par ses seuls encouragements. C’est que le mot exclusion, surtout quand il s’appliquait à l’écriture et à la créativité des autres ne faisait pas partie de son dictionnaire.
Voilà donc ces quelques mots dérisoires tracés en sa mémoire et confiés à ce réseau internet dont je n’appréhende pas bien les ramifications mais qui justifie encore plus aujourd’hui le nom de cette Feuille Volante.
©Hervé GAUTIER
-
Quelques mots sur Camilo-José CELA.
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Camilo-José CELA.
- 0 commentaire
N° 239 – Avril 2002
Quelques mots sur Camilo-José CELA.
Ce que je veux retenir de cet écrivain espagnol, ce n’est pas sa vie, au demeurant assez peu connue qui s’est déroulée en grande partie sous la dictature franquiste qu’il a, par ailleurs, servie, ce n’est pas son Prix Nobel de littérature non plus, pas sa mort survenue récemment mais peut-être son style découvert à travers deux ouvrages « La famille de Pascal Duarte » mais surtout « La ruche ».
C’est une opinion personnelle et sans doute assez peu partagée, mais il me semble que son style est bien peu espagnol, ou, à tout le moins reflète bien l’époque dans laquelle a vécu CELA. Il me paraît être parfaitement le reflet de cette dictature fasciste qui fut pendant longtemps le quotidien de l’Espagne.
On ne peut, certes pas se limiter à la lecture de deux ouvrages, ma si « La famille de Pascal Duarte » qui relate la vie d’un condamné à mort et évoque avec force la fatalité et le destin qui pèse sur l’homme, « La Ruche » est sans doute son livre le plus important, j’entends par-là le plus révélateur de ce qui fait la spécificité de cet écrivain. Ici, il procède par petites touches, comme un tableau pointilliste ou comme une mosaïque qui finalement fait une grande fresque. Chaque paragraphe est un élément du décor qui, pris isolément est, en quelque sorte sans importance, mais qui, réuni aux autres devient l’élément indivisible d’un tout qui fait le roman. Le style, volontairement plat et sans relief ajoute à cet ambiance.
Nous le savons, l’action de « la ruche » se passe à Madrid en 1942. Elle respecte la classique unité de temps et de lieu. Quant à celle d’action, c’est un peu une impression d’inaction que ressent le lecteur parce que c’est là une somme d’histoires sans importance, mettant en scène des gens sans importance, en apparence du moins. C’est pourtant le quotidien ordinaire qui est ici décrit avec ses bassesses, ses rencontres, ses anecdotes, ses amours et ses fortunes qui se font et se défont, le temps qui passe… C’est au spectacle de la simple condition humaine dans tout ce qu’elle a de plus simple que nous convie l’écrivain à travers la peinture d’une multitude de personnages(L’éditeur remarque qu’ils sont en réalité au nombre de 348, certains sont réels, d’autres imaginaires). C’est pourtant dans le café de Dona Rosa que commence l’ouvrage, cet établissement si prisé des Espagnols qu’il symbolise la cité. Dans la ville grouillent des êtres vivants qui naissent vivent et meurent. Les personnages sont en réalité de « pauvres types » qui regardent passer le temps en sirotant une consommation chez Dona Rosa.
Le temps est en effet le deuxième élément de cette écriture. Il est à la fois fatalité, régularité inexorable et révélateur de la monotonie de l’existence humaine. Que sommes-nous au regard de l’éternité, qu’est notre vie sinon un misérable souffle ? Il passe pour chacun, sinon de la même manière, à tout le moins avec finalement le même rythme, le jour, la nuit et cela recommence, pour tout le monde pareil…
Il peut cependant être dégagé trois idées. C’est tout d’abord un roman collectif, comme l’indique d’ailleurs le titre lui-même, comme si la vie était réduite à sa seule dimension biologique, sans idéal, une sorte d’existence primitive !
La vie est donc inerte, fermée, absurde, étouffante, c’est là la deuxième idée.
La troisième idée est sans doute le sexe. Cela peut paraître étonnant dans cette période, dans ce pays où ce tabou est roi, ou la religion commande tout et le pouvoir politique asservit le peuple, ses aspirations, sa culture. Le sexe ici est à peine évoqué, à travers un mariage arrangé, la prostitué qui se vend pour manger, la jeune fille qui doit rester vierge pour son mari qui sera nécessairement le seul homme officiel de sa vie, mais aussi, à mots couverts l’adultère, le mensonge.
« Ils mentent, ceux qui veulent déguiser la vie à l’aide du masque grimaçant de la littérature » écrit Camilo-José CELA dans une note lors de la première édition tout en laissant au lecteur le soin d’apposer sur son livre l’étiquette qu’il jugera bon.
Dans une deuxième note publiée quatre ans après, il précise que « La Ruche » est un cri dans le désert, ce cri n’est pas tellement strident ni trop déchirant ».
Camilo-José CELA n’est pas l’égal en littérature d’un Garcia-Lorca, d’un Unamuno, d’un Antonio Marchado, ou d’un José Ortega y Gasset. La guerre civile et l’exil avaient anéanti les grands intellectuels de ce pays. C’était bien un désert culturel qui y régnait et le mérite de Camilo-José CELA est de s’être fait l’écho de cet « existentialisme noire » qui avait cours, alors en Espagne. Pour ma part, je choisis d’y voir une peinture sinon pessimiste à tout le moins réaliste de la vie à cette époque.
Il n’est cependant pas inutile de rappeler que, photographie de la société de ce temps, ce livre n’a pu être édité en Espagne, à tout le moins au début. La première édition fut argentine, la deuxième mexicaine. C’était peut-être là le signe d’une société qui ne voulait pas voir ses réalités en face !
©Hervé GAUTIERhttp://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg
-
LE MONSTRE – Gaston Cherau -Geste Editions.
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Gaston CHERAU
- 0 commentaire
N°282 – Octobre 2007
LE MONSTRE – Gaston Cherau -Geste Editions.
C'est un récit peu connu d'un écrivain injustement oublié que je viens de lire.
Dire que Gaston Cherau est « le puisatier de l'âme » comme l'écrit excellemment le préfacier est une évidence qui ira se dévoilant tout au long de cette nouvelle comme d'ailleurs dans toute son œuvre et dans toute cette carrière d'écrivain à laquelle il semblait voué de toute éternité.
L'auteur nous livre donc cette histoire pas si simple que cela, « avec recueillement... sans rechercher à expliquer les actes... sans essayer d'en tirer des enseignements ». Peut-être, mais il s'est fait ici non pas tant le témoin d'un fait de société rurale d'un autre âge, mais, à mon sens, le narrateur plein de compassion devant une réaction inhumaine qui est pourtant le fait d'êtres humains. L'homme vivant en société est prompt à jeter l'anathème sur tout ce qui n'est pas normal, c'est à dire conforme à ce qui se fait, aux bonnes mœurs, à la morale, à la loi, à la bienséance. Cette assemblée a érigé des coutumes, mais aussi des non-dits, des hypocrisies, des tolérances... La vie en commun impose ses entraves à la liberté individuelle qui en génère une autre, plus collective et dont tout le monde profite: l'ordre social. Mais là, il ne s'agit pas de cela. C'est tout bonnement l'histoire d'un enfant, François, qui paie pour une faute qu'il n'a pas commise, qu'on a déclaré pour cela et pour cela seulement, exclu du groupe, et donc d'une certaine façon qu'on considère comme « maudit ». Devant cet oukase, il ne peut que s'incliner, se créer un monde à lui, solitaire. Les réactions grégaires font le reste. On y rajoute un peu de méchanceté, un peu de haine aveugle, un peu d'incompréhension et de volonté de chacun d'apporter sa pierre à cet édifice patiemment édifié et qu'il faudrait pourtant jeter à bas.
Cette lecture est pleine d'enseignements d'autant qu'elle est livrée telle quelle, sans commentaire. C'est une invitation, par delà les faits relatés, à observer autour de nous, car Gaston Cherau fut non seulement le peintre de la société de son temps, paysanne ou citadine, mais aussi celui de la condition humaine. Il s'agit ici d'évoquer le désarroi d'un être que tous rejettent sans qu'il lui soit jamais possible de racheter une faute qui n'est pas sienne et qui lui est constamment reprochée. Je choisis d'y voir l'image de la « tâche originelle » dont notre notre éducation judéo-chrétienne est si friande, une sorte de culpabilité qu'on ne comprend pas bien, mais dont on nous rebat constamment les oreilles, comme s'il convenait de nous faire admettre cela comme une évidence inhérente à notre condition d'homme et qui doit constamment demeurer présente à notre esprit, pour mieux asservir notre volonté. Chacun se croit obligé, par sa malveillance, de lui faire payer ce qu'il considère comme une tare. Toute sa vie, ce François sera relégué au second plan, comme s'il n'existait pas, ne trouvant d'amour que chez sa mère, elle-même mise à l'écart par les siens et qui poussera à l'extrême cet attachement pour son fils.
Il y a l'épisode de la mare, le refus de la mère, également victime, de se donner la mort, malgré la nouvelle malédiction qui pèse sur elle et qui n'est pas sans rappeler la première. Elle veut quand même, et malgré tout, rester en vie parce qu'elle est le seul rempart pour protéger son fils. François se met à sa recherche jusqu'au fond de ce cloaque parce qu'il est uni à elle non seulement par cet amour charnel qu'il ne peut connaître avec d'autres femmes mais aussi parce qu'ils partagent le même destin funeste.
J'observe aussi que ce François est mis au monde dans une étable, par une mère qui accouche seule, comme ce fut le cas pour le Christ. Je note aussi l'attitude du curé qui, certes n'a pu avaliser un avortement ou un infanticide, donne quand même au nouveau-né le sacrement de baptême, mais en catimini, comme si Dieu lui-même se mettait de la partie.
Et puis, il y a l'épilogue, la fuite, avec pour seule boussole le hasard, avec l'issue fatale qu'on suppose. Cette mort qui fait parti de la condition humaine revient souvent dans l'œuvre de Gaston Cherau.
Y a-t-il quelque chose de Cherau dans cette nouvelle? Indubitablement oui. Les relations difficiles qu'il a eues avec son père, le mal-être qui en est résulté, sa décision de devenir fonctionnaire des Contributions Directes et avec elle le départ de ce Poitou, alors qu'il était probablement destiné à reprendre la direction de l'industrie familiale, la figure de la mère aimante qui est ici célébrée...
Cherau est également un magnifique écrivain, un créateur talentueux qui, avec des mots simples mais choisis, évoque pour son lecteur, paysages et situations. La scène électrique de la grange par temps d'orage, l'odeur de la balle pendant les battages, l'accouchement solitaire aux petites heures de l'aube mais aussi la quiétude retrouvée qui baignait la ferme du Chebroux après le départ de ceux qu'on aurait voulu ne jamais avoir connus.
© Hervé GAUTIER - Octobre 2007.
-
QUELQUES MOTS SUR GASTON CHERAU [1872-1937].
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Gaston CHERAU
- 0 commentaire
N°280 – Septembre 2007
QUELQUES MOTS SUR GASTON CHERAU [1872-1937].
Il est des écrivains injustement oubliés que le hasard, par le biais de publications ou d'études pertinentes, fait découvrir aux lecteurs curieux. Gaston Cherau est de ceux-là. Le résumer en quelques mots tient de la gageure. Chantre de la province ou plutôt de deux provinces, le Poitou et le Berry [Champi-Tortu, Valentine Pacquault, le flambeau des Riffault]qu'il connut grâce à ses origines familiales, mais aussi des rivages atlantiques [La saison balnéaire de M. Thébault, Le Vent du destin], il le fut sans conteste, tout comme il fut celui de la nature[Le grelet de Marius, L'ombre du Maître, La maison de Patrice Perrier]. Bien que citadin, il ne goûta guère les villes de province, leur décor et surtout leurs habitants qu'il vilipenda. Il resta ancré dans cette terre nourricière de son œuvre dont l'eau est puisée à la source de l'enfance.
Il eut le courage de quitter un emploi sûr de fonctionnaire qui ne convenait ni à son talent littéraire ni à ses aspirations pour embrasser celui, plus risqué, de vivre de sa plume. Il fut donc journaliste, conférencier, chroniqueur, écrivain... Ce n'est pas là la moindre de ses qualités mais bien lui en prit et la notoriété vint heureusement couronner une œuvre aux multiples facettes, riche, mais malheureusement inachevée.
Certaines des ses œuvres sont empruntes d'un humour où parfois venait s'insinuer quelques diatribes comme, dans « Monseigneur voyage »[un roman délicieusement anticlérical et délicatement iconoclaste], qu'il qualifia lui-même de « péché de jeunesse » mais qu'il ne renia pas. Il fut cependant un extraordinaire témoin de son temps, peignant à l'envi la société des hommes dans laquelle il vivait. Il fut le contempteur amusé des travers humains[Les grandes époques de M. Thebault,La saison balnéaire de M. Thébault ] Il savait être à la fois critique de la société des villes[Champi-Tortu, Valentine Pacquault] et de celle des campagnes[Le flambeau des Riffault]. ll fut un écrivain qui a su analyser la psychologie de ses personnages, leur prêter plus qu'une vie littéraire[la prison de verre]. Pourtant, c'est de la condition humaine qu'il fut le témoin. Son oeuvre en est le miroir sans concessions. Parmi l'activité dévolue aux hommes dans la société dans laquelle ils vivaient, la politique était un apanage masculin. Dans « L'enfant du pays », il exprime clairement son mépris pour ce milieu.
La société qu'il avait choisi d'observer et de peindre est faite d'hommes, mais aussi de femmes. Gaston Cherau, qui fut « ce brillant analyste » du cœur féminin n'oublia pas ces dernières qu'il évoque à travers un panel de personnages, de la domestique à la femme mariée à qui il réserve un rôle plus particulièrement quotidien et ménager mais aussi dévolu à l'éducation des enfants, à la transmission de la vie et à qui la religion servait bien souvent de refuge. Il fut, là aussi, le témoin de son époque. A travers différentes figures, il leur prêta même une sorte de folie destructrice [Le grelet de Marius, le vent des destin] mais su aussi aborder le thème difficile à son époque de la sexualité[ Valentine Pacquault,la prison de verre,La maison de Patrice Perrier].
Il sut aussi cultiver l'amitié, celle qui n'est ni oublieuse ni intéressée. Quand il fut académicien Goncourt, il milita pour la reconnaissance de jeunes talents et Ernest Perrochon, alors peu connu, obtint le prestigieux prix littéraire grâce notamment à son appui discret. Il favorisa l'élection à cette académie de Georges Courteline et de Roland Dorgeles et plus tard, comme directeur littérraire aux éditions Ferenczi, il attira Colette et Maurice Genevoix. Lors d'une recontre impromptue avec ce dernier, alors presque inconnu, Gaston Cherau décida spontanément de retarder la publication de son roman « Celui du bois Jacqueline », de la même inspiration et empruntant le même décor solognot que « Raboliot » alors à l'état de manuscrit, de Genevoix. Il souhaitait en effet que sa notoriété ne fît pas de l'ombre à ce jeune auteur dont il appréciait l'oeuvre naissante. Nous étions en 1925 et Maurice Genevoix obtint, cette année-la, le Prix Goncourt pour son roman.
Écrire! On oublie un peu vite que cela ne consiste pas seulement à aligner des mots qui font des phrases, des chapitres et des livres. Gaston Cherau est de ces écrivains qui rappellent par leur style même qu'écrire c'est susciter cette délicate alchimie au terme de laquelle il se produit chez l'auteur quelque chose où le travail le dispute à l'inspiration et chez le lecteur un intérêt pour le récit, pour la manière dont il est relaté et qui le pousse à lire, jusqu'à la fin! Cette même chose, à la fois simple et compliquée, et somme toute assez incompréhensible, Gaston Cherau l'exprime à sa manière « Avec deux mots placés au bon endroit...tout prendra aussitôt de la vie. On se trouvera là où l' écrivain aura voulu vous faire venir et l'on ne sera pas comme spectateur-on y sera comme un acteur même du drame ou de la comédie ». Comme chez bien d'autres écrivains de son époque, je retiens de lui ce ciseleur de la phrase, cet artisan du verbe qui savait si bien, par l'usage qu'il en faisait, servir notre si belle langue française!
Je n'ai pas l'intention de me livrer à une exégèse de l'œuvre de Gaston Cherau. D'autres l'ont fait mieux que je ne saurais le faire, mais ce que je souhaite garder de lui, c'est certes l'image d'un écrivain capable d'intéresser et d'émouvoir son lecteur, mais il n'y a pas que cela. A l' heure où l'homme n'est plus qu'un numéro dans une société qui lui demande essentiellement d'être performant, rentable et parfois l'incite largement à la délation et à l'élimination de ses semblables devenus concurrents, je veux retenir de lui l'empreinte de l'humaniste pétri d'humanité et de modestie, en un mot quelqu'un de bien. Un critique contemporain [Serge Barraux] ne s'y est d'ailleurs pas trompé disant de lui qu'il a été « dédaigneux de toutes réclames parce qu'il trouvait dans la noblesse de son art les hautes satisfactions dont peu savent se contenter au pays des Lettres »
© Hervé GAUTIER - Septembre 2007.
-
VIVRE POUR LA RACONTER - Gabriel Garcia MÁRQUEZ-Editions Grasset.
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Gabriel Garcia Màrquez
- 0 commentaire
N°263 - Novembre 2006
VIVRE POUR LA RACONTER – Gabriel Garcίa MÁRQUEZ– Editions Grasset.
(traduit de l’espagnol par Annie Morvan)
J’ai déjà écrit dans cette chronique à plusieurs reprises combien j’apprécie l’écriture de Gabriel Garcia Marquez. Je n’ai aucune mérite puisque son talent a été largement récompensé, mais quand même ! Jusque là, il était un romancier dont je célébrais les qualités et notamment celles qui consistaient à débuter son texte par une première phrase apparemment anodine et, à partir de celle-ci, de dérouler toute une fiction de plusieurs centaines de pages pour la plus grande joie de son lecteur passionné, déçu simplement par le mot « fin ». Ici, c’est la même chose et ce qui débute le récit « Ma mère me demanda de l’accompagner pour vendre la maison » vous entraîne pendant six cents pages sans que l’ennui ne s’insinue dans votre lecture. Pourtant ce n’est pas exactement un roman, plutôt une autobiographie, comme l’indique le titre, encore qu’avec lui, il faille se méfier, puisque tout est prétexte à l’écriture et que l’exercice dans lequel il excelle est, avant tout, de raconter une histoire, fût-ce celle de sa propre vie !
A partir d’un voyage effectué avec sa mère dans le but hypothétique de la vente de la maison de son enfance, ses souvenirs remontent de la terre natale comme l’eau d’une source. C’est aussi l’occasion pour lui de nous indiquer qu’à cette époque de sa vie il était étudiant, puis journaliste « dans un hebdomadaire indépendant et à l’avenir incertain », de nous faire découvrir avec quelque effroi, le parcours initiatique qui fut le sien sur le chemin de ce merveilleux état qui, à défaut d’être un métier, est sans doute la plus extraordinaire des raisons de justifier son passage sur terre : être écrivain !
Il est rassurant de lire sous sa plume des conseils qu’on lui donna et qu’il n’oublia pas de mettre en pratique, de « continuer à écrire, ne fût-ce que pour [sa] santé mentale » et de « ne jamais montrer à personne le brouillon qu’[il] est entrain d’écrire »
Pour le plaisir de son lecteur, il remonte le moindre rameau de son arbre généalogique en révélant tous les travers de cette société quelque peu clanique, à la fois intolérante et pétrie de principes surannés, avec un sens de la formule qui n’appartient qu’à lui « Ce préjugé atavique, dont les séquelles subsistent encore aujourd’hui, a fait de nous une vaste fratrie composée de vieilles filles et d’hommes débraguettés avec toute une ribambelle d’enfants semés dans les rues ». Il nous invite à parcourir les arcanes de ces histoires intimes où les enfants légitimes côtoient les bâtards, où les amours tumultueuses et passionnées de ses parents le disputent aux querelles d’honneur, aux improbables aveux et aux rebondissements inattendus dans un contexte de principes moraux, d’interdits religieux et de retournements de fortune !
Dans cette quête de souvenirs, les fantasmes font bien souvent place à la réalité idyllique, parce que, chez lui aussi la mémoire enjolive les moindres faits, les sublime et y instille un arrière-goût de nostalgie. Il nous invite avec un humour consommé, à parcourir cette enfance, à la fois dissipée et innocente, rapidement désabusée et pourtant amusée, à l’image de l’enfant qu’il était et qui ouvrait sur le monde ses grands yeux étonnés, comme le montre la photo de la couverture. Elle s’est déroulée sous l’égide, sinon sous la bienveillance complice, de son grand-père, ex-colonel dans l’armée révolutionnaire, d’une mère aimante et généreuse, d’un père éternel rêveur un peu volage, de la pauvreté, de la chance … L’auteur y déroule avec humour une vie où son histoire personnelle, faite de lectures, de femmes, d’alcool, d’amitiés, de rencontres dans des bars, des bordels, des salles de rédaction, se confond parfois avec celle de son propre pays. Ce livre montre à quel point sa propre existence nourrit une œuvre littéraire hors du commun.
Lire un livre de Gabriel Garcia Marques c’est tout simplement passer un moment merveilleux et j’appliquerai volontiers à cet ouvrage la remarque qu’il fait lui-même « Je n’ai jamais oublié qu’on ne devait lire que les livres qui nous obligent à les relire ».
-
DOUZE CONTES VAGABONDS - GABRIEL GARCIA MARQUEZ - GRASSET.
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Gabriel Garcia Màrquez
- 0 commentaire
N°269 – Février 2007
DOUZE CONTES VAGABONDS – GABRIEL GARCIA MARQUEZ – GRASSET.
De ces douze contes vagabonds, je ne dirai rien, sinon qu'ils sont à l'image des textes que Marquez écrits avec un talent et un humour qui ne se démentent pas et qui tiennent en haleine le lecteur dont la curiosité demeure en éveil, de la première à la dernière ligne. Son écriture jubilatoire m'a toujours enchanté. Depuis sa création, cette chronique s'est d'ailleurs fait l'écho de l'œuvre du Prix Nobel, et ce n'est pas maintenant que je vais changer d'avis! Je noterai quand même que beaucoup de ses contes se terminent par la mort ou l'évoquent, mais celle-ci n'est pas triste, n'inspire pas la crainte et n'est pas tabou comme en occident. Au Mexique où vit l'auteur, la mort est joyeuse, elle est une fête lorsque les disparus reviennent visiter les vivants qui leur font fête et célèbrent ainsi leur mémoire. Ils accompagnent les hommes au quotidien...
On lit rarement les prologues. Celui-ci est intéressant. L'auteur y évoque le processus de l'écriture, au vrai, une véritable alchimie avec ses biffures, ses ratures, ses épluchures de gomme, ses hésitations, ses archivages minutieux, ses incertitudes d'avenir... Il parle aussi du plaisir d'écrire, car c'en est un, malgré l'impérieuse nécessité de la correction, l'implacable dictature de l'inspiration, la disponibilité obligatoire de l'auteur devenu son esclave volontaire, la nécessité du travail toujours recommencé“[au]plaisir d'écrire, le plus intime et le plus solitaire qui soit, et si l'on ne passe pas le restant de ses jours à corriger le livre c'est parce qu'il faut s'imposer, pour le terminer, la même implacable rigueur que pour le commencer”. Il rappelle lui-même, comme une sorte de consolation “qu'on apprécie un bon écrivain à ce qu'il déchire plus qu'à ce qu'il publie”. Et lui de parler de l'incessant vagabondage de ces contes “entre [son] bureau et sa corbeille”, soulignant ses doutes, ses renoncements, son travail toujours recommencé. Son recueil tire de là son titre, sans doute?
Dans ce contexte du temps qui passe, de la mémoire qu'un écrit conserve des lieux et des personnages évoqués alors que l'auteur lui-même en est oublieux, Marquez note “Les souvenirs réels me paraissaient des fantômes de la mémoire tandis que les faux souvenirs étaient si convaincants qu'ils avaient supplanté la réalité. Si bien qu'il m'était impossible de discerner la frontière entre la désillusion et la nostalgie”. Remettre sur le métier un texte en se disant qu'il sera meilleur plus tard, cela joue des tours et il note non sans humour “ Je n'ai jamais relu aucun de mes livres par crainte de me repentir de les avoir écrits”. C'est que, il l'avoue lui-même, les douze contes qui composent ce recueil ont été écrits au long de dix huit années. Certains ont connu des fortune diverses, mais Marquez insiste, ne serait-ce, dit-il, qu'à l'usage des enfants qui veulent devenir écrivains,”Qu'ils sachent...combien le vice de l'écriture est insatiable et abrasif”. Dont acte, car il sait de quoi il parle!
Les idées viennent au créateur par des voies détournées et souvent inattendues, à travers le voyage ou l'immobilité, l'éveil ou le songe, mais ce qu'il sait en revanche, et il est le seul à le savoir, c'est qu'il ne doit pas les laisser s'évanouir dans l'oubli, il doit obligatoirement les travailler, les exploiter, les faire grandir... Et ce d'autant plus qu'elles lui ont été offertes gracieusement, mais en même temps avec la conviction intime qu'il est en quelque sorte le débiteur de cette voix mystérieuse que d'aucuns habillent de divinité, mais à la disposition de laquelle il doit se mettre sans même discuter, sous peine de n'en être plus jamais le sujet... Abandonner une bonne idée peut être un signe d'humilité, mais la prudence oblige parfois à l'archivage. On ne sait jamais! C'est vrai que l'écrivain, si célèbre soit-il, se doit d'être humble devant le phénomène même de l'écriture. Il n'ignore pas, en effet, qu'il reste totalement dépendant de cette vibration extraordinaire dont il a fait son métier, et ce malgré toute sa culture, tout son travail, toute son expérience et toute sa sensibilité... Même pour l' écrivain, l'écriture reste un mystère! L'état d' écrivain a ses grandeurs, mais aussi ses servitudes!
L'auteur est aussi un témoin, non seulement de sa propre personnalité, de son propre talent, mais aussi, et peut-être surtout, de son temps, du peuple dont il fait partie, de la culture qu'il incarne, de la condition humaine.
Ces contes procurent un moment unique de lecture, mais j'apprécie aussi la préface, elle rappelle des vérités sur le matériau même du livre, l'écriture!
-
QUELQUES MOTS SUR GABRIEL GARCIA MARQUEZ [à travers trois livres]
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Gabriel Garcia Màrquez
- 0 commentaire
N°298– Avril 2008
QUELQUES MOTS SUR GABRIEL GARCIA MARQUEZ [à travers trois livres]
Je ne sais pas ce qui motive cette lecture effrénée de Marquez, sans doute l'inflation de ce qui se publie actuellement qui n'implique malheureusement pas la qualité de l'écriture et qui m'entraîne insensiblement à lire et à relire les bons auteurs, en tout cas ceux qui ont la particularité de m'étonner. Marquez est de ceux-là et les lecteurs de cette chronique savent l'intérêt jamais démenti que je lui porte. Il est un des rares qui peut raconter une histoire à partir de trois mots anodins en apparence mais qui captive son lecteur pendant plusieurs centaines de pages sans que l'ennui s'insinue dans la lecture. Le seul nom de Marquez retient mon attention. Plus sans doute que les autres auteurs, il s'empare de la réalité, que cela soit de sa propre vie ou de l'histoire, se l'approprie et en fait une fiction merveilleuse.
Par exemple « Pas de lettre pour le colonel »[Editions Grasset] raconte l'histoire, sur fond de misère et d'improbables tribulations autour d'un coq de combat, d'un ancien combattant péruvien, colonel à 20 ans, qui attend désespérément, depuis de trop nombreuses années une pension d'ancien combattant qui ne viendra jamais, à cause du perpétuel changement de gouvernement, des restrictions budgétaires et surtout de l'oubli général...
Dans le style du journaliste qu'il a été, Marquez évoque dans « Journal d'un enlèvement »[Editions Grasset] cette période délétère de l'histoire de la Colombie émaillée d'enlèvements, d'assassinats politiques, de terrorisme, d'attentats, de guerrilla, de corruption sur fonds de lutte contre les narco-trafiquants du cartel de Medellin, les complexités du pouvoir politique, des descentes meurtrières de police. Ce n'est pas à proprement parler un livre dans le droit fil des romans quelque peu baroques de Marquez. Ici, le registre est plus sobre pour évoquer l'angoisse, les espoirs des otages et de leurs familles. Ce livre pourtant publié en 1997 est malheureusement d'actualité puisqu'il évoque une triste habitude de la Colombie de pratiquer l'enlèvement.
Avec « Le général dans son labyrinthe »[Editions Grasset] , je note que ce roman est dédié à Alvaro Mutis dont il a été longuement question dans cette chronique depuis sa création.] Marquez renoue avec son style teinté d'humour subtil que des formules laconiques soulignent à l'envi. Mêlant fiction et réalité, Il s'empare du personnage à ce moment précis et narre le dernier voyage du général Bolivar, héros de l'Amérique Andine, qui ayant quitté le pouvoir, part pour un exil sans retour et renoue avec ses souvenirs guerriers et glorieux, avec celui des femmes qui partagèrent fugacement sa vie. Il jette un regard désabusé sur ce que fut sa vie, mais aussi sur l'ingratitude de ses contemporains et sur la condition humaine, le sens de cette vie qui s'achève.. C'est que, après tant d'année à guerroyer contre les Espagnols, il entame, en compagnie de son hamac et de son fidèle serviteur, son dernier voyage, celui qui le conduira à la mort. C'est un récit à la fois émouvant et épique des quatorze derniers jours d' « El Liberador » qui voyait ainsi s'achever cette vie labyrinthique qui aurait pu être celle d'un paisible propriétaire mais que le destin a fait basculer. J'y vois l'hommage d'un Colombien illustre à un compatriote qui ne l'est pas moins.
-
Deux écrivains sud américains – Gabriel Garcia MARQUES – Alvaro MUTIS
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Alvaro Mutis
- 0 commentaire
Je ferai à peu près la même remarque à propos de l’excellent roman d’Alvaro Mutis « Un bel morir » (GRASSET) qui retrace la vie aventureuse de Maqroll El Gaviero avec un art consommé de la narration.
Ce personnage qui mène une existence folle et amoureuse sur tous les endroits malfamés du globe a tous les attributs du marin qu’il est. Pourquoi cependant est-il venu se perdre dans ce coin de la Cordillères et est-il devenu le complice un peu involontaire de trafiquants d’armes ? Pourquoi est-il innocenté par un militaire et va-t-il mourir dans les marais à la barre d’une mauvaise embarcation, un peu comme quelqu’un qui choisir de mettre un terme à un voyage trop long et fatigant, aux confins de la terre et des eaux, où on ne distingue pas vraiment l’un de l’autre.
Il a donc posé son sac d’aventurier avec le souvenir de toutes les femmes qu’il a aimées.
Il est de la race des héros mythiques qui n’en finissent pas de mourir et de ressusciter (n’a-t-il pas deux noms ?) et que personne, surtout pas l’auteur lui-même, ne peut ni ne doit tuer, même d’un coup de plume !.
© Hervé GAUTIER.
-
Deux écrivains sud américains – Gabriel Garcia MARQUES – Alvaro MUTIS
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Gabriel Garcia Màrquez
- 0 commentaire
N°75
Août 1991
Deux écrivains sud américains – Gabriel Garcia MARQUES – Alvaro MUTIS
Je n’ai vraiment aucun mérite à conseiller la lecture de « Cent ans de solitude » de Gabriel Garcia Marques.
On ne se lassera pas de lire ce roman où le style n’a d’égal que les invraisemblables mais passionnantes aventures qu’il raconte. J’avoue, comme à chaque fois que j’ouvre un de ses livres que je prends le même plaisir à goûter son exceptionnel talent qui accapare le lecteur dès la première phrase et l’abandonne, un peu désorienté à la dernière en l’ayant entraîné dans un autre univers où le temps semble battre à un rythme différent du nôtre et où le destin des acteurs de cette grande épopée se déroule dans un microcosme à l’abri du reste du monde.
Dans cette saga où les personnages paraissent vivre à la dérive dans une marginalité délirante, le quotidien le dispute au merveilleux avec toujours cette verve poétique si attachante.
-
L'OGRE - Jacques CHESSEX - Grasset [Prix Goncourt 1973]
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Jacques CHESSEX
- 0 commentaire
N°320– Novembre 2008
L'OGRE – Jacques CHESSEX – Grasset [Prix Goncourt 1973]
Automne 1972, Jean Calmet, la quarantaine, célibataire, professeur de latin au lycée de Lausanne assiste, en compagnie de ses frères et sœurs et de sa mère, aux obsèques de son père, « le Docteur » Paul Calmet. C'était une force de la nature, aimant son travail, le vin, les servantes d'auberge et allant même jusqu'à dépuceler la jeune fille que son fils courtisait avec une gauche tendresse. Un « personnage » mais surtout le type même du tyran familial! Devant lui chacun a réagi à sa manière. La mère qui a vécu dans son ombre, soumise effacée et veule. La vie de Jean « aurait été une autre vie si elle s'était révoltée ». Il lui en veut de son attitude démissionnaire. Elle n'a été toute sa vie, face à ce mari abusif «[qu'] une espèce de vielle souris effacée et terrifiée ».Ses frères Étienne, l'ingénieur agronome avait fui cette famille et Simon, l'instituteur « le préféré de [la] mère » s'intéressait aux oiseaux, Hélène était devenu infirmière et Anne courait le monde et changeait souvent d'amants. Face à eux Jean, le cadet, avait choisi l'enseignement du latin. Il est un professeur aimé de ses élèves. Ils avaient tous quitté cette famille assassine, mais lui était resté, sans oser réagir, à la disposition de ce père qui l'avait tué à petit feu.
De cet homme craint, aimé bizarrement, admiré, mais surtout honni, il ne reste plus que des cendres enfermées dans une urne que la famille va aller déposer dans un columbarium. Jean n'a pas tué son père comme il l'aurait voulu, mais ce dernier n'est plus rien. Le temps paraît suspendu et chaque instant consacré au choix des gestes est relaté avec une lenteur maladive et obsédante, noyé dans un faux chagrin de circonstance. Le mouvement qui présidait à l'action paternelle quotidienne trouve son « double-opposé » dans la description minutieuse de toutes des phases de la cérémonie! Il y a l'absence du père et avec elle une sorte de libération. Tout va enfin devenir possible, les réconciliations, les retrouvailles, tout ce temps perdu qu'on va enfin pouvoir gommer! La vie, en effet, continue, comme on dit, et avec elle le temps qui s'écoule, la beauté des femmes, la nature qui renaît, les cours qui reprennent. L'auteur distille cette certitude à travers des descriptions poétiques, lumière et émotions, ombres et images douces, amours volées avec cette « fille aux chat », nom donné par lui à cette jeune fille, étudiante aux Beaux-Arts, dont il devient l'amant maladroit et impuissant et qui le plongea tout de suite « dans la joie mystérieuse et folle de Dionysos ». Cette image pose question par l'interprétation que le lecteur peut en donner. Ce n'est pas ici le Bacchus latin, dieu du vin de la vigne et de ses excès, mais le dieu grec, errant, de nulle part et de partout, né « de la cuisse de Jupiter [Zeus]» qui avait une place importante dans le rituel de la mort et de la renaissance. Il était lui, Jean Calmet, le fils modeste et égaré de ce Zeus tout-puissant, fils de son père, fils du « docteur »...
L'épisode du café où Jean sort de ses gonds dans le seul espoir d'exorciser la présence latente de ce père mort qui pourtant l'obsède toujours, le dévore, est révélatrice. Même les exercices érotiques de Thérèse, sa partenaire ne suffisent pas à le guérir de ses obsessions! Il ne trouve son plaisir que dans la masturbation solitaire! L'entrevue chez le Directeur Grapp n'arrange rien. Il est un peu le substitut de son géniteur envahissant dont il évoque d'ailleurs la figure et qui lui parle comme un père! Pourtant il se réfugie auprès d'une prostituée, cette Pernette- Denise, elle -même porteuse de l'image du père, « féminin de Dionysos, la sœur, la fille, la compagne exaltée du divin! ». Cette substitution du Directeur prend toute sa mesure lors de la révolte des élèves qui révèle encore une fois la figure de Grapp, autoritaire, dominateur, colérique, comme le docteur Paul Calmet!
Pourtant l'ombre tutélaire du géniteur continue à planer sur Jean. Sa vie entière lui revient à la figure, cette vie torturée par ce père qui n'a même pas respecté ses envies gauches d'adolescent, qui n'a pas su comprendre ses interrogations et ses craintes de l'avenir, qui l'a humilié. Loin de constituer une libération, la mort du père accentue au contraire l'emprise malsaine qu'il avait sur Jean. Son pouvoir s'aggrave au point d'être plus présent, plus dévorant que lorsqu'il était vivant. Il redevient cet « ogre » qu'il n'a jamais cessé d'être. Cette mort est comme un nouveau rendez-vous où ce père, plus présent qu'avant qui a toujours fagocité l'existence même de ce fils. A chaque instant de la vie de Jean, son père a été présent au mois en pensées, au point qu'il a annihilé chez ce fils toute la joie qu'il pouvait tirer de son quotidien. Que ce soit ses amours avec cette étudiante des Beaux-Arts, Thérèse, qui pourrait être sa fille, la maladie et la mort d'une de ses élèves, la rencontre fortuite d'un hérisson un soir d'été, ou la cérémonie prémonitoire du rasage, tout cela semble enveloppé par le regard du père omniprésent.
A l'occasion d'une rencontre et d'un dialogue un peu surréalistes avec un chat, Jean prend conscience de sa propre mort, de son néant. L'auteur nous dit qu'il prend malgré tout conscience de son inexistence personnelle, de son défaut d'appétit de la vie et ce malgré la disparition de ce père enfin mort. Cette remarque est particulièrement affirmée dans l'épisode sans joie qu'il vit avec la prostituée.
La jalousie que Jean ressent à la liaison de Thérèse et d'un de ses élèves ne suffit pas à le faire changer face à la vie, bien au contraire. Il revit, en quelque sorte et mutatis mutandis, l'échec qu'il a eu au temps de son adolescence avec cette jeune fille qui lui préféra son père. Cette relation révèle son impuissance et souligne encore davantage sa volonté de se sous-estimer, de se rabaisser à ses propres yeux. Il est l'archétype de celui qui ne s'aime pas! Sa mère elle-même ne peut rien face à son mal de vivre.
Les femmes apparaissent comme pouvant être l'antidote à cette omniprésence du père mort mais finalement se révèlent incapables, même par l'amour qu'elles veulent lui donner, ou par leur seule présence, d'exorciser cette absence de goût pour la vie! « Je suis donc fait pour souffrir » se répète-t-il comme en se complaisant dans cette affirmation, craignant peut-être que son père ne revienne pour l'anéantir tout à fait!
Il ne peut effectivement plus réagir même face au manipulateur nazi auquel il ne peut même pas résister au point d'insulter son ami juif. Lâcheté ou désespérance, signe de décrépitude? Il se sent peu à peu happé par la mort sans pouvoir ou sans vouloir y résister, un peu comme si ce père décédé pesait encore sur son fils
Comme j'ai eu souvent l'occasion de l'écrire dans cette chronique, la valeur d'un livre ne réside pas dans sa récente publication ni même dans les prix et distinctions qui lui ont été attribués. Seule la permanence du message qu'il renferme m'intéresse.
Hervé GAUTIER – Novembre 2008.http://hervegautier.e-monsite.com
-
RECIT D’UN NAUFRAGE – Gabriel Garcia MARQUEZ – Editions Grasset.
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Gabriel Garcia Màrquez
- 0 commentaire
N°158
Juin 1993
RECIT D’UN NAUFRAGE – Gabriel Garcia MARQUEZ – Editions Grasset.
Il s’agit d’une histoire contée par un marin, un de ces hommes en perpétuelle errance qui ont choisi la mer pour fuir ou chercher quelque chose sans trop savoir ce que c’est.
Le décor : la mer des Caraïbes qui a vu tant de navires disparaître et où le mystère s’épaissit à chaque naufrage.
Le récit : après l’accident d’un destroyer de la Marine colombienne, l’histoire d’un homme qui se débat et survit sur un radeau à la faim, à la soif, à la peur, aux hallucinations, avec l’espoir de croiser un avion ou un bateau.
Comme je l’ai déjà dit dans cette chronique, Gabriel Garcia MARQUEZ est un de ces écrivains qui prennent et passionnent leur lecteur dès la première ligne et ne l’abandonnent qu’à la fin du roman, grisé de dépaysement et toujours un peu déçu que le récit soit déjà terminé.
En outre, il est de ces écrivains sud-américains dont le style possède cette musique, cette odeur, et cette chose intraduisible qui fait dire au lecteur qu’il a passionnément aimé un livre.
-
ET SI C'ÉTAIT VRAI - Marc LEVY - Robert LAFFONT.
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Marc LEVY
- 0 commentaire
ET SI C'ÉTAIT VRAI – Marc LEVY - Robert LAFFONT.
Que reste-il, le livre refermé? Une histoire d'amour surréaliste entre un homme bien réel, normalement constitué et le fantôme d'une femme médecin, décédée quelques mois auparavant dans un accident de voiture mais dont le corps continue de vivre dans une chambre d'hôpital, dans un coma dépassé, un projet rocambolesque d'enlèvement de ce corps avec la complicité active du « fantôme », une enquête policière à peine esquissée et déjà bouclée avec l'aide inattendue d'un policier aux portes de la retraite, et, à la fin, un « happy end » un peu facile!
Je veux bien que l'intrigue se passe aux États-Unis, pays de toutes les extravagances, je veux bien que la fiction soit, par définition, un récit imaginaire où l'auteur fait naître l'intérêt de son lecteur par la qualité de son écriture, l'art de distiller le suspense jusqu'à la dernière ligne... J'aime ce genre littéraire pour cela! Je veux bien que cela soit le prétexte à un hymne à la vie, à l'amour, au merveilleux, mais aussi évoque la mort, la souffrance, le souvenir, l'absence insupportable de ceux qu'on a aimés et qu'on ne reverra plus... Ce sont là des choses qui ont trait à la condition humaine et qui parlent à chacun d'entre nous, mais quand même!
Je n'ai pas aimé ce livre, ce qui y est décrit me paraît trop artificiel et sans réel intérêt malgré la phrase engageante de la 4° de couverture, répétée dans le roman : « Ce que j'ai à vous dire n'est pas facile à entendre, impossible à admettre, mais si vous voulez bien écouter mon histoire, si vous voulez bien me faire confiance, alors peut-être vous finirez par me croire et c'est important car vous êtes, sans le savoir, la seule personne au monde avec qui je puisse partager ce secret. »
© Hervé GAUTIER – Janvier 2008.
http://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg -
DEUX ROMANS DE GABRIEL GARCIA MARQUEZ.
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Gabriel Garcia Màrquez
- 0 commentaire
N°146
Février 1993
DEUX ROMANS DE GABRIEL GARCIA MARQUEZ.
J’ai déjà écrit dans cette chronique que la récente publication d’un livre n’était pas le seul critère d’intérêt pour le lecteur. L’ouvrage reste permanent et garde en lui sa part de rêve et de dépaysement. Il n’attend que l’amateur.
*
Ainsi ces deux ouvrages de Gabriel Garcia Marquez, La Mala hora tout d’abord qui a pour décor un petit village de Colombie écrasé de chaleur où s’abattent parfois des orages tropicaux qui balayent tout sur leur passage et transforment le fleuve tout proche en un impétueux torrent de boue. Il ne s’y passe rien sinon que dans ses rues et entre les murs de ses maisons enfle une rumeur qui se nourrit d’affiches anonymes apposées nuitamment... Elles apportent au village son lot d’incertitudes et de doutes…
César Montero tue un matin l’amant de sa femme. Dès lors vont entrer en scène pendant dix sept jours le Maire, torturé par une rage de dents, le Père Angel, absorbé par les devoirs de sa charge… Cependant le temps semble s’écouler avec la lenteur qui sied à ces latitudes, mais ces cieux tourmentés ont aussi connu, il n’y a pas si longtemps la guerre civile avec ses querelles politiques , ses assassinats. L’absence de légitimité des gouvernants le dispute à la soif de revanche des opposants.
Pourtant, on affirme bien haut que les choses ont changé, et ce, malgré les affiches qui ne révèlent rien qu’on ne connaissent déjà. Cependant les passions finiront par se déchaîner et la terreur reprendra comme avant.
*
Le second ouvrage, qui est aussi le premier de Garcia Marquez met l’accent sur un thème qui lui est cher, celui de la solitude. Des feuilles dans la bourrasque rassemble au début trois personnages autour d’un cercueil. Chacun donne libre cours à ses pensées. Ils évoquent le mort, un médecin qui vient de se pendre, un homme que tout le village exécrait parce qu’il avait un jour refusé de soigner des blessés et qui depuis vivait reclus chez lui.
A cause d’une promesse l’un des personnages, un vieux colonel, va l’enterrer pour qu’il ne soit pas la proie des vautours. Il le fera malgré la haine du village de Macondo, jadis enrichi par une société bananière et qui maintenant n’est plus que l’ombre de lui-même…
Cette impression de solitude est accentuée par les monologues entrecroisés des différents personnages. Le décor de ce roman, autant que le thème qui y est traité préfigurent déjà l’œuvre de Garcia Marquez.
Ces deux romans sont publiés chez Grasset.
-
ONITSHA - Jean Marie Gustave LE CLEZIO - Gallimard
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Jean Marie Gustave LE CLEZIO
- 0 commentaire
N°318– Novembre 2008
ONITSHA – Jean Marie Gustave LE CLEZIO – Gallimard.
J'ai un peu honte de l'avouer, mais, jusqu'à la lecture de ce livre, je n'étais pas parvenu à entrer dans l'univers et le voyage de Jean Marie LE CLEZIO. Ce n'était pourtant pas faute d'avoir plusieurs fois essayé!
C'est un peu fastidieux de résumer l'histoire, pourtant c'est celle d'un jeune garçon de douze ans, Fintan, qui, en 1948, part pour l'Afrique, en compagnie de sa mère Maou, rejoindre à Onitsha son père qu'il ne connaît pas. Ce sera en même temps que la rencontre avec son géniteur, la découverte de ce continent également inconnu de lui comme il l'est de sa propre mère et qui va se révéler à eux. Fintan va en Afrique parce que son père le lui demande « Je suis Geoffrey Allen, je suis ton père, viens avec moi à Onitsha ». Cette phrase est comme un leitmotiv dans ce roman. Il accomplit ce voyage de France jusqu'en Afrique en compagnie de sa mère, comme un parcours initiatique en mer, sur un vieux bateau, parenthèse nécessaire à cette transition entre deux mondes mais aussi, pour le jeune garçon de douze ans, cette envie d'écrire qui naît en lui et croît à mesure que lui même grandit. « Un long voyage », tel est le titre de ce récit qu'il entame en même temps que que sa progression vers le port fluvial d'Onitsha sur le fleuve Niger. C'est une écriture naïve, naissante et un peu gauche, mais c'est là une manière de se délivrer d'une solitude née de l'enfance qu'il quitte en même temps qu'il abandonne la France. L'énigme ici s'habille d'un possible parallèle entre l'auteur et Fintan.
C'est que de cette Afrique, chacun de ces trois personnages, rêve différemment. Pour Maou, il ne s'agira pas de cette vision un peu romantique qu'elle pouvait en avoir, mais elle se révèle à elle à travers des odeurs âcres, une nature sauvage et hostile, une société cruelle, raciale et torturée par la colonisation anglaise, dévorante, insaisissable parfois, loin de son rêve d'européenne. C'est pourtant dans un lieu différent de l'Europe qu'elle vit désormais et on imagine facilement que cela ne lui déplaît pas. Maou est amoureuse de son mari qu'elle part rejoindre, mais c'est aussi une femme énigmatique secrète et envoûtante que les autres hommes regardent avec envie.
Pour Geoffrey, ce pays, c'est d'abord son métier à « l'United Africa », mais c'est aussi et peut-être surtout une géographie aux multiples légendes, celle de Méroë, ce royaume mythique qui aurait été fondé ici par Arsinoë une reine noire égyptienne, descendante des pharaons et qui le hante. Il partira pourtant d'Onitsha mais gardera jusqu'à sa mort l'obsession de cette quête « Puis la lumière décroît, l'ombre entre dans la petite chambre, recouvre le visage de l'homme qui va mourir, scelle pour toujours ses paupières. Le sable du désert a recouvert les ossements du peuple d'Arsinoë. La route de Méroë n'a pas de fin »
Il y a d'autres personnages non moins intéressants et quelque peu énigmatiques. Sabine Rodes, anglais marginal mais qui ne fréquente pas ses congénères, qui a l'intuition de l'effondrement de l'empire colonial et qui mourra avec lui. Son vrai nom n'est révélé qu'à la fin et il est peut-être le vrai père de Fintan. Il y a aussi Oya, pauvre fille sourde et muette, dans qui Geoffroy veut voir l'incarnation d'une reine noire...
Il y a peut-être un autre personnage plus impalpable, l'Afrique qui se révèle à Fintan avec tout son décor, son atmosphère hors du temps à travers la pauvreté des africains réduits en esclavage. Pour lui cependant, elle est une terre de liberté et de grands espaces que Sabines Rodes lui fera découvrir.
L'atmosphère générale du livre m'a parut apaisante, malgré le thème, à cause du style sans doute, à la fois dépouillé et simple, mais aussi narratif poétique et musical. Il vise simplement à ce que l'auteur soit compris de son lecteur. L'histoire est simple. Elle est donnée à voir au lecteur. Pourtant il s'agit, m'a t-il semblé, d'une révolte profonde dont a voulu parler Le CLEZIO.
© Hervé GAUTIER – Novembre 2008.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LONGTEMPS JE ME SUIS COUCHE DE BONNE HEURE - Jean-Pierre GATTEGNO
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Jean-Pierre GATTEGNO
- 0 commentaire
N°315 – Octobre 2008
LONGTEMPS JE ME SUIS COUCHE DE BONNE HEURE – Jean-Pierre GATTEGNO [Acte Sud].
Cela n'a l'air de rien, mais cet ouvrage illustre à sa manière très personnelle l'attrait, l'intérêt que peut susciter la première phrase d'un livre. Le quidam la lit, puis, sans raison, sans savoir pourquoi, il est happé par ce peu de mots, puis poursuit avec la deuxième ... et se surprend à pousser sa lecture jusqu'à la fin sans que l'ennui s'insinue dans sa démarche, transformant le moment consacré à la lecture, que d'aucuns regardent comme un perte de temps, en un moment de pur plaisir.
Cette chronique s'est souvent fait l'écho de ces auteurs qui captent à ce point un individu que le hasard met en présence de leur livre, le transforment presque aussitôt en témoin passionné de leur voyage, lui prêtent cette merveilleuse ivresse des mots, bref en font un lecteur attentif, enthousiasmé par le récit et presque déçu d'arriver, sans s'en rendre compte, à la fin de ce roman qui lui a procuré tant d'agréments qu'il ne sait lui-même comment l'exprimer et se contente de dire que cela lui a plu. Cette grande économie de mots cache souvent une foule d'impressions à jamais inexprimées comme si c'était déflorer le livre que d'indiquer en quoi il a été à ce point attachant. C'est comme le fil d'un écheveau qu'on tire et qui se déroule en apportant à son curieux amateur un soudain intérêt.
Ainsi Jean-Pierre Gattegno prend-il pour titre de son roman la première phrase mythique d'un roman de Marcel Proust. C'est plutôt une bonne illustration, sauf qu'en ce qui me concerne, je n'ai jamais pu lire l'auteur de « Du Côté de chez Swann »!
Il y a l'histoire, celle d'un petit truand minable, Sébastien Ponchelet, que la prison met en présence d'un détenu cultivé et amateur d'art, voleur de tableau... et grand lecteur. Pendant sa liberté conditionnelle il travaille chez un éditeur parisien, mais son emploi de manutentionnaire rend sa vie terne. Pourtant, il va croiser dans le métro une femme à qui la lecture prête un regard pétillant et un manuscrit raturé et annoté qui va bouleverser sa vie et le faire pénétrer dans l'univers des livres. Cette femme, pourtant personnage furtif de ce récit, me semble avoir un vraie épaisseur avec sa beauté énigmatique, son indifférence feinte, sa compréhension de Sébastien. Je retiens une de ses phrases « Voilà, je préfère l'amour des livres, même quand ils sont mauvais, il y a toujours quelque chose qui les sauve... ». Elle est le prétexte à l'évocation d'un autre monde qui jouxte celui de l'édition, de l'écriture, comme Sébastien peut l'être de la peinture également évoqué à travers une foule de tableaux... et avec son pendant, celui du faux.
Même s'il ne lit pas ce manuscrit comme un passionné, ces quelques mots vont être pour lui le point de départ d'une réflexion, d'un questionnement introspectif. Les annotations et les corrections apposées successivement en marge d'un manuscrit ou d'un livre sont l'illustration d'une sorte de partition silencieuse, une discussion secrète dans un improbable huis clos entre deux personnes qui ne se connaissent pas et qui ne se rencontrerons jamais.
Il y a aussi le style, direct et sans fioriture qui rend ce texte attachant.
Cela rejoint un peu la remarque de Jean-Marie Le Cléziot, Prix Nobel de littérature 2008 qui, nouvellement couronné, conseillait simplement au reste du monde de continuer à lire des romans. Celui-ci fait partie de ces ouvrages qui sont autant de moments jubilatoires dont il serait dommage de se priver.
© Hervé GAUTIER - Octobre 2008. http://hervegautier.e-monsite.com
-
PATMOS et autres poèmes – LORAND GASPAR – Collection Poésie Gallimard.
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Loran Gaspard
- 0 commentaire
N°250 – Juin 2004
PATMOS et autres poèmes – LORAND GASPAR – Collection Poésie Gallimard.
J’ai toujours plaisir à célébrer l’anniversaire de cette modeste revue par la lecture d’un écrivain d’exception. Lorand Gaspar avait déjà accompagné le 23°, il sera donc le prétexte au 25°, et je ne peux que m’en réjouir.
Comment le dire ? J’ai abordé ce livre comme un objet tout d’abord posé sur ma table, en le regardant, le tournant, le prenant en mains avant de l’ouvrir parce le moment de goûter son message n’était probablement pas encore venu. Mais quand le temps de cette communion intime avec le recueil s’est manifesté, il m’a fallu pouvoir abandonner toutes choses et me lancer, porté par cette musique et ce mystère parce que c’était maintenant et que l’instant d’après ce serait trop tard !
Il faut peut-être entrer dans cet univers fait de fragrances, de sons, de couleurs par la porte des mots parce qu’il y a une douceur mystérieuse dans cette écriture, dans l’apaisant mouvement du langage qui berce l’âme, la subtile lueur d’une image simplement tissée dans la clarté de l’instant singulier qui est celui où le souffle de l’inspiration révèle sa force et la prête à celui qui est digne de la recevoir pour la transmettre à son tour par l’alchimie de notre si belle langue française aux autres êtres humains !
C’est le miracle de la vie qui à chaque vers est célébré dans ce livre, c’est l'appel à une lecture neuve, à l’image de cette écriture libérée des entraves, habile à décrypter les pulsations de la nature dont le poète retisse lentement la réalité. Fragilité est ici écrit en lettres majuscules parce que l’auteur de « Sol Absolu » sait et nous rappelle que tout ici-bas est transitoire mais que peu d’hommes en prennent conscience. Sous sa plume, chaque son est une musique et les ongles grattent la portée invisible des cordes instrumentales pour en tirer quelque chose, plainte ou douce lumière, qu’importe. Seul le message compte ! C’est la vie qui gagne parce qu’elle est permanence, parce qu’il sait regarder, écouter et sentir, s’arrêter et perdre son regard dans l’immensité de la mer et du ciel, qu’il sait tomber sous le charme de l’imprévu. !
L’auteur est bien un veilleur, un vigile attentif des lieux, sais les dire, les célébrer simplement qu’ils aient pour nom Patmos, Sidi Bou Saïd, Judée, Mer Rouge ou Saint Rémy du Val… C’est toujours le monde, celui de la Création dont il parle avec simplicité et respect. Face à lui, il sait être pudique, secret et assurément humble. Il sollicite les cinq sens avec en plus peut-être cet art des contrastes qui fait ressortir la vraie beauté des choses, l’usage de l’oxymore, l’opposition entre noir et blanc, froidure et chaleur, clarté et obscurité, le jour et la nuit l’occident et la Chine « à l’âme inoubliée ».
Cet attachement à une maison dont les fondations ( « les amarres » s’enfoncent dans le sable ou la pierre n’est pas moins important car elle est un refuge, un espace qui favorise le repli sur soi pour mieux renaître à cette permanence de la vie. Elle est aussi un jalon, une borne, une sorte d’auberge du silence où se manifeste, ici plus qu’ailleurs sans doute les vibrations qu’il convient de quérir. Ici on porte témoignage, un témoignage intime de sensations et de sentiments en prenant soin de dire les choses, mais aussi en gardant secrètement des parcelles de ces mêmes choses parce qu’elles doivent rester inavouées et temporairement retenues, peut-être aussi parce qu’elles sont indicibles, parce que les mots ne sont pas encore prêts qui les exprimeront complètement. Ce long mûrissement auquel se prête le poète ne peut qu’enfanter des textes qui s’inscrivent dans la durée, dans le temps et dans la mémoire.
Il y a une manière originale de nommer sobrement les choses, la lecture s’offrant simplement avec les nuances du poème en n’oubliant pas que la parole est délicate mais aussi source de vie, née entre deux néants, du silence d’avant et d’après les mots, simples vibrations dans l’air ou traces sur le papier, mais qui pourtant devient pérenne. Il compose son texte comme un peintre son tableau pointilliste, par petites touches, jouant sur les contraires, avec une prédilection peut-être pour le blanc aérien face au noir de l’encre mystérieux et inconnu. Les gris qui gardent la mémoire des formes sont revisités, éclaircis, imprimés fugacement sur les murs chaulés, empreints d’un silence chaud. Les différentes gammes de bleu se déclinent entre mer et ciel, jusqu’à la fumée vaporeuse et odorante de l’encens, du « bleu écaillé d’une barque » ou des « gris-bleus et des verts délavés » qui évoquent pour lui des variations musicales de Debussy.
Il y a l’eau, celle de la mer, celle de la pluie, élément liquide extraordinairement lustral, fluide et matinal qui lave même le regard. La rosée où se lavent les mots, l’eau de mer « où le silence aussi s’entend » sur laquelle le pêcheur, « danseur ébloui sur une nappe de frémissements translucides » semble marcher, à la fois transparente de près et bleue de loin qui accompagne le bruit sec et répété du ressac qui meurt et renaît dans un mouvement d’écume ; cette clarté m’évoque la page blanche, à la fois vide et invite à la création, l’eau de la rosée, celle du torrent dont les eaux «emportent les mots (qu’il) cherche », celle du baptême qui « jaillit des jardins nocturnes du corps », celle de la source dans ce qu’elle a de virginal et de frais, née de la terre elle va vers la mer après ses noces avec la terre et les pierres, eau durcie en cristaux de neige, eau des sanglots, celle qui « tremble dans l’œil » aussi…
L’art de l’hypotypose qui donne à voir une scène par la seule force évocatrice des écrits est présent chaque page avec aussi ce sens de l’image poétique. Il parle de « poignée d’écume » de « tout le rayonnement de midi moulu dans une poussière d’eau » d’ « une lame d’acier cru » ou de la « vendange du raisin de mer » « l’abîme muet du toucher », « la rugine du matin », les « Sons brodés par la nuit » ou des « grappes de pensées »… Il prête au lecteur attentif des visions fugaces, de brefs moments de vie, d’éphémères images d’un lieu avec juste ce qu’il faut de senteurs et de couleurs pour que la trame de la scène effleure l’imaginaire. C’est une sublimation de l’instant poétique dans ce qu’il a d’immédiat, d ‘unique et de bouleversant. Il y a dans ce moment tout chargé de mystères, malgré, ou peut-être à cause de son aspect quotidien et presque banal mais Ô combien précieux pour qui sait en discerner la richesse, une sorte de dimension à la fois bienvenue et impalpable un peu comme les calligrammes chinois tracés à mainlevée par Wang Mo. Il y a quelque chose d’intemporel aussi dans ces poèmes parce que la vie est unique et que les pierres du désert éclatés en sable par le gel, étaient, il y a bien longtemps, des montagnes. Dire les choses avec une grande économie de mots est bien l’apanage de notre auteur parce que les paysages prêtés au « regard » du lecteur possèdent aussi ce dépouillement !
Il célèbre en la nommant « la pure jouissance d’être », ce « mystère d’être là » devant « l’agrafe d’or d’un feu », percevoir « le pain très blanc d’un cri » profiter du « goût exquis du rouget grillé aux herbes sur braise », regarder « l’irruption des martinets ivres d’un festin joyeux absorbés totalement par l’exercice de vivre ». Il y a une sensualité de bon aloi dans cette écriture, cette « étrange saveur de chair nue », ce « geste qui touche un instant le sombre jardin du corps ». Cet amour de la vie est aussi puisé aux « pépites » de l’enfance insouciante et innocente mais aussi tourmentée par les embûches du parcours à venir. Ce monde est là, face à soi qui attend d’être conquis, qui s’offre à la marque unique qu’on voudra bien y imprimer.
Le livre refermé reste sertie dans l’âme du lecteur, et pour longtemps, cette marque poétique tissée de mer et de désert, de terre d’eau et d’air. Elle enchante par sa spontanéité, sa fraîcheur, sa claire densité, son humilité aussi.
©Hervé GAUTIERhttp://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg
-
QUELQUES RÉFLEXIONS PERSONNELLES SUR Lorand GASPAR.
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Loran Gaspard
- 0 commentaire
N° 241 – Juin 2002
QUELQUES RÉFLEXIONS PERSONNELLES SUR Lorand GASPAR.
C’est donc avec un écrivain d’exception que je célébrerai cette année le 23° anniversaire de cette « Feuille Volante », devenue, au fil des années et par le fait des choses, non plus une revue mais une simple note de lecture personnelle. Qu’importe ! Seuls comptent le plaisir de lire, d’apprendre, de rêver, les rencontres littéraires qu’il m’est donné de faire et je me dois, simplement parce que j’en ai décidé ainsi, d’en rendre compte ici, même si cela consiste à avitailler ma seule mémoire !
Je dois à ma vérité intime d’avouer ici, à ma grande honte, que Lorand Gaspar était pour moi un inconnu jusqu’à ce que mon regard croise quelques-uns de ses ouvrages sur les rayons d’une bibliothèque. Il se passe toujours de ces petits miracles qui me font ainsi découvrir ainsi des grandes voix de la littérature. Son nom ne me disant rien, j’ai eu l’intuition que « Carnets de Jérusalem » et « Journaux de voyages » n’allaient pas me laisser indifférent. J’ai toujours été un voyageur immobile et les livres ont été, de tout temps ma seule évasion. Mes origines charentaises ne se manifestent pas seulement dans le port des pantoufles du même nom ! Je suis casanier et je n’y peux rien !
Et pourtant, ce médecin né en Transylvanie orientale partira très tôt servir dans les hôpitaux français de Jérusalem et de Bethléem. Il deviendra amoureux de ce Proche -Orient et des peuples qui l’habitent, de leur histoire chaotique. Ce sera « carnets de Jérusalem » ! Que me reste-t-il, le livre refermé de la relation de cette mission humanitaire. Un mélange étonnant, fascinant même, de curiosité, de dépaysement face à la beauté de ces paysages évoqués avec des mots simples, la solitude, le désert, l’aventure humaine transitoire et merveilleuse surtout quand elle est animée par la passion ! Sous sa plume, c’est une leçon d’histoire, non pas celle donnée par un professeur du haut de sa chaire, mais celle d’un humaniste qui refait le parcours historique de cette « Terre Sainte » qui paradoxalement a toujours été le théâtre de conflits et, où, peut-être plus qu’ailleurs sans doute le sang des hommes n’a cessé de couler et coule encore de nos jours ! C’est un peu comme si cette terre d’Islam qui est aussi juive et chrétienne et où devrait régner la tolérance et la paix a été vouée de tout temps à la mort, au combat, à la haine et au refus de l’autre…
L’auteur se transforme en véritable guide, faisant découvrir à son lecteur attentif tout ce qu’un touriste nécessairement pressé ne voit pas, cherchant jusque dans l’étymologie les détail de la géographie. Il n’oublie pas non plus de parler des religions, de la faunes, de la flore, de l’architectures et des légendes… Et tout cela avec une poésie simple qui sourd des mots eux-mêmes et qui va si bien à ces régions où le temps ne compte pas, où les références du monde dit civilisé semblent se dissoudre dans ces paysages grandioses et arides. Ses mots sont les jalons d’un voyage initiatique, personnel et intérieur qui bouleverse le lecteur ! Moi qui n’ai jamais connu l’appel du désert, la beauté de ses paysages je dois avouer mon envoûtement « Il y a souvent sur ces pistes non tracées, dans cette navigation minérale à l’estime, un moment où de fil en aiguille les choses se compliquent, s’embrouillent. Une piste perdue non retrouvée, un puits pourri, un vent de sable tenace, les défaillances du véhicule quand on en est pourvu ; la moindre erreur, l’incident le plus anodin en apparence peut en entraîner d’autres. Sentiment d’être pris dans un enchaînement rigoureux, implacable. Le dépouillement, la désolation, la solitude découvrent la totalité de leur visage où le plus anodin de leur visage dont on ne percevait que la grandeur issue de notre imagination. L’immensité n’est plus de l’ordre de la beauté, elle n’est pas cette « grandeur » que l’on contemple. Tout devient terriblement concret, un réel auquel on ne peut plus se sentir extérieur et qui est l’élan même du mouvement, limité par d’autres, de notre vie »
Cette étrange alchimie de l’écriture qui sera toujours pour moi un mystère se double de photos en noir et blanc, malgré ou peut-être à cause de la lumière qui règne dans ces contrées, également signées de l’auteur. Elles sont à l’égal du texte, pleines de talent de simplicité, de spiritualité même ! L’auteur nous rappelle que la nature humaine est complexe. A à la fois ange et démon, l’homme est capable du pire comme du meilleur, capable de tuer comme de soigner ses semblables au péril de sa propre vie avec la même foi et la même énergie, capable à la fois de créer les choses les plus magnifiques et de perpétrer les plus cruels massacres. Celui qui était allé là-bas dans un but humanitaire devient un messager de paix, de tolérance, d’amour, comme si cette terre avait le pouvoir de transcender les hommes, de les rendre tout à la fois poètes, bons…
Dans « Journaux de voyages », il redevient cet arpenteur vigilant de la terre, gourmand de ses couleurs, de ses bruits, comme fasciné par le spectacle qu’elle lui donne, que ce soit en Afrique, en Asie ou ailleurs, simplement parce qu’il choisit sa destination, ses haltes qu’il décrit pour son lecteur en un long et délicat poème. Il use d’une langue aussi recherchée que les paysage qu’il traverse sans oublier de lui rappeler que malgré toute cette beauté qu’il y a la mort au bout du chemin parce que telle est la condition de l’homme.
Quel genre d’être est-il, lui qui choisit des contrées où le temps ne compte pas, ne s’écoule pas a même rythme, où le nom des villes invitent à eux seuls au voyage, au dépaysement : Boukhara, Khîva, Samarcande où le passé se mêle au présent, où la poésie doucement chaude et intemporelle revendique sa place parce qu’il ne peut sans doute en être autrement. Il donne un autre univers à offrir en partage, une autre planète qui est pourtant la nôtre mais qui ne peut intéresser le voyageur pressé. Pour lui, c’est une autre image de ce monde qu’il veut évoquer, plus vraie peut-être et authentique, celle qui reprend possession de la pulsation de la vie, des choses simples, des gestes économes, des paroles rares mais pourtant riches de sens.
La route de la soie est revisitée au pas lent des chameaux quand les avions survolent le monde à des vitesses supersoniques, que l’argent est roi que seule la réussite compte. C’est aussi l’Afrique avec son désert envoûtant ses habitants sur qui la civilisation, comme on dit semble n’avoir aucune prise…
Dans ce livre, l’homme reprend presque subrepticement sa place qu’il n’aurait, au vrai, jamais dû quitter, mais ainsi va le monde, le progrès comme on dit ! Dans ces contrées, l’auteur lui redonne sa vraie dimension, le replace dans des paysages qui vivent au rythme du soleil et des prières, lui font retrouver la respect de l’autre, de son environnement, de Dieu peu-être si on veut le voir ainsi
©Hervé GAUTIERhttp://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg
-
ROUGE BRESIL - Jean-Christophe RUFIN [Gallimard]
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Jean-Christophe RUFIN
- 0 commentaire
N°313 – Septembre 2008
ROUGE BRESIL – Jean-Christophe RUFIN [Gallimard].
Nous sommes sous la Renaissance, en 1555, et le Chevalier de Malte Nicolas Durand de Villegagnon commande une expédition à destination du Brésil, et plus précisément pour la baie de Rio de Janeiro alors sauvage et inexplorée, afin d'y implanter une nouvelle colonie française face aux Portugais, mais aussi pour gagner des âmes, c'est à dire évangéliser les indiens qui peuplent ce qu'on appelle la « France Antarctique ». C'est donc à une authentique épopée, malheureusement avortée et oubliée de l'histoire de France, que l'auteur nous convie, comme en d'autres temps Jean de Lery ou André Thevet.
C'est à travers les yeux de deux orphelins, Juste et Colombe, embarqués dans cette expédition pour servir d'interprètes auprès des tribus indiennes, mais qui eux, sont à l'improbable recherche d'un père dont leur mémoire conserve le souvenir et peut-être la légende, que ce récit nous est offert. L'auteur y réalise un véritable travail anthropologique mais aussi théologique dans la querelle qui oppose catholiques et réformés et montre comment les hommes peuvent faire prévaloir ce qui les divise contre ce qui devrait les réunir et combien les passions peuvent les changer irrémédiablement. Jugez plutôt, Villegagnon, tout pétri de christianisme et de culture antique, de chevalerie, d'humanisme tolérant va être transformé par ce voyage initiatique en acteur convaincu de la répression contre les protestants, faisant de cet épisode, avec quelques années d'avance, une répétition générale des guerres de religion qui déchireront la France.
Ce récit nous donne à voir des paysages luxuriants de cette France des Tropiques, un peuple d'indiens, les Tupinanbas[ou Tupis], anthropophages certes, mais qui participent, par leur mode de vie, à la fois sensuel et sans tabous, à une vision d'un paradis terrestre perdu et soudain retrouvé. C'est un hymne à la nature, à la liberté, un appel au bonheur depuis longtemps oublié ou étouffé par les sociétés européennes, deux conceptions de l'humanité, colonisatrice, libératrice, mais finalement meurtrière des Européens, harmonieuse, naturelle et attirante des indiens. Le mythe du « bon sauvage » sera repris plus tard au Siècle des Lumières.
Le titre, « Rouge Brésil » m'évoque, certes, un bois précieux, mais surtout le sang, la violence aveugle de la guerre du côté des Européens, l'anthropophagie traditionnelle au côté des indiens [l'auteur se livre à une intéressante déclinaison de ce concept vu du côté des blancs qui ont embrassé la cause des Tupis], mais aussi la passion pour ces contrées, les histoires d'amour contrariées ou qui se terminent bien ... Voilà pour l'histoire, mais il n'y a pas que cela.
Les personnages, en réalité une véritable galerie de portraits, qui servent de guides au lecteur attentif sont à la fois l'image de la condition humaine dans tout ce qu'elle a de plus répugnant, mais aussi de plus attachant. L'auteur en fait une évocation où le réalisme et parfois le grotesque le dispute à l'émotion
Je voudrais une nouvelle fois dans cette chronique, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire à propos d'autres auteurs, mentionner non seulement le récit qui nous est conté et qui nous entraîne dans un autre univers [l'aspect documentaire et documenté d'un récit est important pour le lecteur qui, à cette occasion apprend quelque chose, surtout ici où cet épisode est complètement occulté par l'Histoire], mais aussi, et peut-être surtout le style aux accents parfois voltairiens. Je veux redire ici que le bon usage de notre si belle langue française transforme le moment consacré à la lecture en une période de pur plaisir. Un humour subtil qui doit beaucoup à la litote, le dispute aux descriptions poétiques, le délicat emploi de la syntaxe, la richesse du vocabulaire, précis juste et recherché qui puise sa rareté, et donc son précieux sens, dans des termes qui empruntent beaucoup à un passé désormais révolu et donc inconnu. C'est déjà un voyage au pays des mots qui est lui-même un dépaysement prisé du témoin attentif. Il procède de cet enchantement que tout lecteur souhaite trouver dans un livre.
J'ai lu ce roman avec délectation. Mon improbable lecteur ne manquera pas de m'objecter que je n'ai, pour cela aucun mérite, ce livre ayant, accessoirement, été couronné en 2001, par le prestigieux « Prix Goncourt ». C'est vrai, mais il voudra bien cependant considérer que ce n'est assurément pas cela qui a retenu mon attention autant qu'il pourra observer que, cette chronique étant avant tout marquée du sceau de la liberté et de l'absence de compromission de quelque nature que ce soit, j'y exerce un droit à la libre parole qui en fait le fondement. Ainsi ne me suis-je jamais gêné de donner des avis qui vont parfois à contre-courant de la mode ou de la pensée de plus en plus unique, même si, souvent, une distinction a accompagné la sortie de l'oeuvre commentée. C'est que, indépendamment de son talent littéraire, le parcours de Jean Christophe Rufin est déjà original. Pensez donc, médecin humanitaire, ce qui est soi n'est pas banal, puisqu'il traduit au quotidien l'action difficile de celui qui a vocation de guérir ou de soulager la souffrance, c'est à dire de mettre à la disposition des plus démunis sa faculté de les soigner, mais aussi voyageur-témoin, et on sait combien cela est de nature à nourrir la créativité de celui qui porte en lui cette merveilleuse faculté non seulement d'attester ce qu'il voit, mais aussi de créer un récit de fiction et, à cette occasion, de faire chanter les mots. Cette musique est toujours agréable à mes oreilles. Puis vint ce prix qui a heureusement contribué à distinguer celui qui menait une carrière de réflexion et d'action, puis cette nomination comme ambassadeur de France et, plus récemment, son élection à l'Académie Française. C'est là un cheminement tout à fait remarquable, un engagement personnel qui atteste à la fois de sa créativité littéraire, du regard qu'il porte sur le monde, du témoignage qu'il entend apporter à l'évolution des mentalités. « Rouge Brésil » procède de cette démarche.
© Hervé GAUTIER - Septembre 2008.
-
CE PEU DE BRUITS - Philippe JACCOTTET - Editions Gallimard.
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Philippe JACCOTTET
- 0 commentaire
N°303 – Juin 2008
CE PEU DE BRUITS – Philippe JACCOTTET - Editions Gallimard.
Ce titre au pluriel n'est peut-être pas autre chose qu'une prise de conscience de la vanité des choses de cette vie, la certitude que, qui que nous soyons, nous ne sommes rien au regard du monde, de sa permanence et de sa durée. Nous faisons ici-bas un bout de chemin, si peu de choses, avec si peu de bruit et de si peu d'importance, même le chuintement des mots, des gestes et des couleurs...
Quand on perçoit le bout du chemin et qu'on a l'intuition de cette fin que nous redoutons tous sans vouloir se l'avouer, qu'il n'y a peut-être plus rien à dire, et chaque mot se résume peut-être à un murmure, alors on cherche ailleurs, dans les visages et les livres des autres,comme on use d'une boussole, ce qu'on ne peut plus dire, ce qu'on n'a peut-être pas oser faire? Je salue quand même la culture autant que l'humilité de l'auteur!
Philippe Jaccotet parle d'un monde qui s'en va, de ce « cœur presque fantôme » ou « plutôt du cœur [qui s'éloigne] de mauvais gré ». Je choisis d'y voir un fatalisme mal assuré, un amour de la vie contrarié et rien, pas même les paroles « mal maîtrisées, mal agencées... répétitives » ne pourraient valablement accompagner le voyageur devenu « une ombre de ruisseau ». Tout ce qu'on a pu vivre de vrai et de fort durant cette existence est insignifiant au regard « du mystère de la pérennité du monde avec cet espoir insensé de l'existence d'un autre monde, un au-delà incertain et hypothétique ». Son écriture est dénuée d'artifice, comme si ses mots, eux non plus, ne voulaient pas faire de bruit, les couleurs s'estompent peu à peu, comme la vie, il confie à l'écriture son intuition de n'avoir été qu'un quidam, un moment rapide de l'espace-temps jusqu'à l'infini mais à l'intérieur d'une vie d'homme lisse et sans histoire. Il parle simplement d'une chose simple, mais que pourtant, pour des raisons obscures et inavouées nous rejetons tous, la mort ou plus précisément le passage de la vie à la mort. Elle est inévitable et nous fait peur [Victor Hugo parlait du « noir verrou de la porte humaine »] d'autant que ce passage s'effectue le plus souvent dans la plus extrême solitude. L'homme, ce rien, face à lui-même, à ce qu'il a été, a conscience de ce qu'il laisse derrière lui [« Combien il est difficile d'arriver à renoncer à ce monde »] parce que dans le monde occidental la mort reste tabou. Il parle de « ce fond noir au dessus et au-dessous, du même vide » sur lequel poussent le désespoir, le regret violent de cette vie qui s'en va, le néant qui s'approche, qui attire comme un aimant, une impression de « fête qui s'achève », avec pour seul bagage la force des mots.
Ce n'est pas le silence, juste quelques paroles chuchotées, mots écrits dans l'intimité de la nuit peut-être, de l'inspiration assurément, destinés à lui seul mais néanmoins partagés. C'est qu'il est question d'une idée obsédante du trépas. De cela on ne parle pas d'ordinaire, même pour soi ou alors à demi mots parce que, même si elle est inévitable, qu'elle porte la marque de la condition humaine, on la redoute même si on s'en défend. C'est d'abord la mort d'amis dont la disparition laisse sans voix, parce que la maladie torture la fin de vie et que l'épreuve ajoute à l'épreuve, mais que le poète parvient quand même à évoquer à la force des mots, la mort de sa chatte même « une petite âme aux chaussons de fourrure, peu de chose, mais quand même », animal familier de l'écrivain situé comme lui entre deux mondes, pas tout à fait de l'un, jamais vraiment de l'autre. Leur silence se complète et se comprennent dans cet équilibre chaque instant remis en question. La mort, qui qu'elle frappe, révolte toujours parce qu'elle est la fin de quelque chose que nous connaissons et le commencement hypothétique d'autre chose, avec cette immense interrogation d'un autre monde dont certains affirment qu'il est une réalité forte et intraduisible et que d'autres nient non moins farouchement. Devant cette simple mais terrible interrogation, il y a l'homme et l'écrivain qui n'a pour la combattre que l'arme de ses mots, défense dérisoire et combat perdu d'avance mais un combat juste, légitime et honorable qui tire son importante nécessité du le seul fait qu'il est désespéré.
L'auteur se rattache à la beauté des choses, de la terre si souvent chantée, de la nature, des choses belles faites pour l'homme, au chuchotement de l'inspiration, cette voix venue on ne sait d'où et qui vous frappe ou plutôt qui se manifeste à vous dans le silence ou l'immatérialité de l'instant. Il en naît parfois un chef-d’œuvre ou parfois rien d'autre que du vent mais un vent qui vient d'un ailleurs insoupçonné et qui s'impose par sa seule force sa seule existence, s'installe et s'offre à tous comme le cadeau définitif et irréel de la vie « poème comme un reflet qui ne s'éteindra pas fatalement avec nous ».
Cette écriture a cette fluidité simple qu'il puise sûrement dans la transparence de cette nature qui s'offre à ses yeux . A l'inverse de la prose qui est souvent précise, le poème lui reste sur le seuil des choses en ce qu'il offre au lecteur attentif un supplément d'inspiration pour lequel il prolonge pour lui et peut-être à son seul usage l'instant d'émotion de l'auteur, se l'approprie, le poursuit et le prolonge;
© Hervé GAUTIER – juin 2008.
http://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg -
CHANSONS DES MAL-AIMANTS - Sylvie GERMAIN - GALLIMARD.
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans Sylvie GERMAIN
- 0 commentaire
N°311– Août 2008
CHANSONS DES MAL-AIMANTS – Sylvie GERMAIN – GALLIMARD.
Que reste-t-il d'une lecture une fois le livre refermé? Des impressions, un avis qu'on a parfois du mal à exprimer avec des mots, un climat qu'on a ressenti ou habité pendant des dizaines de pages...
Ce roman m'a laissé un goût étrange. J'avais pourtant déjà lu Sylvie Germain il y a quelques années avec « l'enfant méduse » [La Feuille Volante n° 75 d'août 1991]. Je n'avais pas eu envie de poursuivre la lecture de cette auteure. Ce roman m'a conforté dans mon impression première qu'un mot pourrait parfaitement caractériser : bizarre! Il y a l'histoire, bringuebalante, décousue, comme la vie de cette petite fille, crachée au monde par des parents qui ne voulaient pas d'elle, abandonnée au gré du hasard qui gouverne nos vies plus bien plus que nous voulons bien l'admettre et qui lui permet, très jeune, de croiser la condition humaine dans ce qu'elle a de plus repoussant, la méchanceté, le crime, l'exclusion, la mort. Cela vous mûrit avant l'âge une petite fille en lui volant son enfance, et déjà elle prend la mesure de ce que sera son existence d'adulte, celle d'une paria à qui la folie et l'ivresse sont interdites. Et de noter « Je m'attendais à tout de la part du monde... La capacité de folie, de nuisance, le substrat de cruauté tapis en chaque être humain me semblaient si énormes que je sourcillais à peine quand tel ou telle passait à l'acte »
Toute la magie de cet épisode de vie se résume à peu de choses : une grammaire latine, une bible, la partition d'un opéra, un masque, le galet d'un gave, autant de petits détails glanés au hasard de jours sans joie. En prime, il y a une virginité perdue, la recherche d'un amour impossible à travers des étreintes sauvages de lupanar, la prégnance des yeux de ce Frédéric, vagabond-dévoreur de passion, la fatalité de l'exemple qu'on reproduit, la bâtardise à venir pour un enfant pas vraiment voulu, l'avortement puis la certitude d'une stérilité future, la poursuite du temps à travers la mutilation des horloges, une façon comme une autre d'apprivoiser la mort qui nous attend tous.
Je ne suis pas parvenu à entrer dans son voyage labyrinthique, peut-être à cause du style, peut-être à cause du récit, sorte de patchwork d'une vie dont les étranges morceaux s'entrechoquent. Trop de morts, peut-être une désagréable impression de tourner en rond, avec de trop fréquents retours en arrière, sorte de passerelles improbables entre les rognures de cet habit d'arlequin devenu trop grand, avec, en contrepoint, toute la souffrance du monde, de ce monde paraît-il si beau, de ce Dieu si bon, à ce qu'on nous a dit. Je n'ai pas bien saisi ce sourd combat « entre la compassion et la révolte » non plus que les digressions sur St Bernadette et sur d'improbables visions oniriques et colorées.
Ce retour à cette enfance contrariée, ce besoin viscéral de remettre ses pas dans les siens propres, un peu effacés cependant par le temps et les épreuves me renvoie à la solitude, la même que dans « l'enfant méduse ». Elle est pourtant puissamment évoquée à la fin avec cette mort consentie de Martin, pas vraiment un suicide mais un retour à l'état de néant qui nous attend tous, avec en plus une absence de sépulture, une négation de toute trace de vie, chair et os digérés comme si le corps et donc le souffle, n'avaient jamais existé, laissant aux bons soins des rapaces montagnards la charge de tout faire disparaître. « Porté disparu », la formule à quelque chose où se mêle le doute et le vide, comme quelqu'un qui s'étant échappé de cette existence en fraude, finira par mériter sa mort officielle, à l'ancienneté, faute d'avoir voulu un trépas officiellement reconnu, sorte de pied de nez à ce rien qui nous va si bien. J'ai apprécié cette complaisance dans la solitude et dans la douleur intime, sorte de « saudade » qui caractérise si bien l'âme portugaise.
Vers la fin, mais vers la fin seulement, j'ai habité ce roman faisant miens les mots de l'auteure qui ne sont pas dénués de poésie « le progressif détachement que je sens s'opérer en moi, ce discret oubli de moi-même qui me vient au contact de cette terre rugueuse, de cet air limpide et dru, de cette eau toujours glacée, partout jaillissante, ruisselante, fracassée d'écume ou sculptée par le gel en hiver, et de ces bêtes lentes sans fin sonnaillant pour mieux rehausser le silence »
© Hervé GAUTIER – Août 2008.http://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg
-
Sheller en solitaire.
- Par hervegautier
- Le 01/04/2009
- Dans chansons françaises.
- 0 commentaire
N°257 Août 2006
Sheller en solitaire.
Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises dans cette chronique, la valeur d’une publication ne réside pas uniquement dans sa nouveauté. Ce disque a été réalisé en public en 1991 par Wiliam Sheller et reprend de nombreuses chansons restées dans ma mémoire.
C’est quand même plus fort que moi, j’aime ces mots poétiques auxquels s’accrochent les notes claires d’un piano solitaire et complice. Ils font revivre l’enfance, difficile, nostalgique, la famille qui n’est peut-être pas celle qu’on avait espérée, qui ne correspondait pas tout à fait aux clichés admis « Dans cette famille où les gens voulaient toujours tout remettre en cause », où la quête de l’autre est forte, interrogative, s’apparente à de l’amour ou à quelque chose qui y ressemble « Et quand t’étais là, je ne savais rien dire, tu ne voyais même pas ce que ça voulait dire, quelqu’un qui tient ton regard aussi fort ». Chacun s’y s’affirme dans un rapport de force qui sera plus tard la règle d’un jeu adulte « Fallait savoir passer devant mes frères qui jugent et s’interposent »[Basket Ball]. L’enfance est un bien transitoire où l’on engrange des secrets étranges qu’on est seul à connaître. Ils forment les souvenirs d’un monde à venir, en seront les rêves, les fantasmes, les remords aussi… « Le goût usé d’un souvenir de jeunesse qu’on tire d’une machine à cachous » [Petit comme un caillou] J’ai choisi d’y lire le tumulte, l’angoisse, la peur du lendemain, de la mort peut-être, de l’absence assurément, de l’incompréhension, à cause de la différence d’âge, de l’éducation qu’on doit accepter, des choses qu’on doit faire parce qu’elles se font, et que c’est ainsi« Nicolas, il veut pas qu’on l’embête, tout ce qu’il a dans la tête c’est qu’ il veut rentrer chez lui, j’veux pas rester icii ».[Nicolas]
Mais bientôt, l’adolescent se libère, prend sa vie à pleins bras, la vit avec le hasard pour boussole, pour carte, l’image fluctuante des nuages, respiration blanche sur le fond bleu du ciel, avec des rêves et des projets plein la tête, parce qu’on l’a lâché seul, en lui recommandant de se débrouiller « On m’a bandé les yeux avant que j’ai vu le chemin, on n’a jamais dit viens, on m’a dit va où tu veux »… Alors pourquoi pas ici ? [Un endroit pour vivre]. Avec en soi, chevillé à l’âme, la certitude de n’être pas grand chose dans cette grande comédie d’une société qu’on n’a pas choisie et dans laquelle on se débat « Je suis un homme de peu, je suis le fils de rien, on m’a bandé les yeux avant que j’ai vu le chemin ».[Un endroit pour vivre] avec aussi cette solitude qui fait partie du jeu, qu’on aime ou qu’on apprivoise, qu’on exorcise un peu « je courre à côté d’un train qu’on m’a donné au passage, de bonheur … j’me sens toujours tout seul »[J’courre tout seul]. Il y a ceux qui réussissent et qu’on aime pour cela, qu’on envie, et les autres qui poussent des chimères sans consistance, parce que les mots sont du vent, ne bâtissent que des châteaux de sable, friables et éphémères. C’est qu’ils ne sentent pas bien « dans ce mal foutu monde » où ils n’ont pas leur place. Leurs histoires d’avenir « ne tiennent pas debout », alors, on les voue à la désespérance.
Il y a les jeunes filles qui deviendront femmes, aimantes ou indifférentes. Pour l’adolescent solitaire, elles vivent dans un autre monde, inaccessible, et les rêves deviennent fous « moi je ne vois rien, je suis fier, et je suis fou de vous … elle s’en fout »[fier et fou de vous] « Est-ce tu sais que j’taime en pagaille, c’est comme un mal de vivre à la débraille » [Les mots qui te viennent tout bas]. Il en reste toujours un peu de ces timidités maladives qui laissent une grande place à la chance « J’attendais toujours là debout, dans ce dernier coin qui me reste, que tu reviennes un jour passer devant chez nous » [Petit comme un cailloux ]. Parfois on peut aussi choisir de se trouver là, simple spectateur d’un décor « Les filles de l’aurore… elles ont autour du corps de l’amour et de l’or que l’on peut jouer au dés ». On pense, avec raison peut-être, qu’on y restera toujours un peu étranger, alors on tresse des mots qui sont longtemps restés au fond de sa gorge, qui n’ont jamais pu être dits ; on les écrit, dans le silence de la page blanche et du crissement de la plume sur la feuille. Les phrases, qui parfois sont des vers, sont jetées au vent, au hasard, ou jalousement conservées dans les replis de l’âme, pour qu’elles ne soient pas perdues. Elles sont à l’image de la folie qu’on porte en soi, l’autre face de nous-même ! Mots-messages, confiés au vent comme une bouteille livrée aux vagues, avec cet espoir fou qu’ils seront reçus et compris. Ce ne sont plus de simple vibrations mais de véritables déclarations intimes « Jusqu’à chanter des mots où tu te reconnaîtras » [Un endroit pour vivre]
La figure de la femme est présente, certes un peu idéalisée, un peu enivrante aussi. Elle accompagne cette vie, l’embellit peut-être. Sa conquête devient une quête intime et perpétuelle « J’ai gardé un mirage dans un drôle de cage, comme savent construire les fous… je t’ai cherchée partout » [Les miroirs dans la boue]
Quand même, la recherche du bonheur qu’on n’a pas connu est légitime, parce qu’on n’a qu’une vie, parce qu’on l’a juste entr’aperçu, comme une vision furtive, à travers les yeux des autres avec cette intuition prégnante, que ces joies existent mais ne sont pas pour soi [Je voudrais être un homme heureux] Alors on aborde ce monde et les gens qui le peuplent avec retenue, avec crainte, parce que cette quête reste empreinte de mystères, de doutes, parce l’amour procède de cette étrange alchimie où l’inconnu le dispute à l’espoir… « Et moi j’te connais à peine, mais ce s’rait une veine qu’on s’en aille un peu comme eux, on pourrait se faire, sans qu’sa gêne, de la place pour deux » [un homme heureux]
La solitude de William Sheller n’est pas seulement celle du musicien face à son instrument, ses doigts effleurant parfois les touches noires et blanches, parfois les frappant littéralement. Mots et notes trahissent cet isolement, cet abandon, que la poésie distille. Il y a dans la musique et dans ce compagnonnage avec son piano quelque chose de doux et de violent à la fois. Avec ses mots poétiques, cela donne quelque chose de bien, un dépaysement, une complicité, un climat ...
© Hervé GAUTIERhttp://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg
-
LA TERRASSE DE LUCREZIA - Félicien Marceau - Editions Gallimard.
- Par hervegautier
- Le 31/03/2009
- Dans Félicien Marceau -
- 0 commentaire
N°161
Juillet 1993
LA TERRASSE DE LUCREZIA – Félicien Marceau – Editions Gallimard.
Décidément, j’ai une préférence marquée, parmi tout ce qui se publie actuellement pour les écrivains qui ont de l’humour, surtout quand celui-ci est sensible dans les mots, dans l’ordonnance du propos, bref dans le style.
Quand un roman est composé de phrases qu’il a plaisir à lire pour la simple raison qu’il les trouve belles, qu’elles sonnent juste et qu’elles sont frappées au coin du bon sens, c’est que le lecteur y trouve son agrément, que l’intérêt l’a accompagné dans chaque ligne e sa démarche de lecture ;
Des phrases où les choses sont suggérées plutôt qu’elles ne sont dites, avec cette fantaisie savamment instillée dans les mots dont le choix lu-même et un ravissement, des phrases dont on ne découvre la réelle musicalité qu’en les lisant à haute voix, des phrases enfin qui font dire que leur auteur sert notre belle langue française par le seul usage correct qu’il en fait. Dès lors la lecture devient un moment d’exception…
Lucrezia « était une de ces femmes dont on dirait que leur seule présence suffit à combler le présent, dont on dirait qu’elles n’ont aucun besoin de souvenirs et qu’elles les ont, une fois pour toutes jetés dans un puits. » C’est que cette femme jeune et belle qui arrive comme gardienne d’un immeuble cossu de la banlieue de Rome va, par sa seule existence, son seul sourire, révolutionner les habitudes de ce microcosme où, d’ordinaire, la coutume voulait que les co-propriétaires n’échangeassent entre eux que des politesses convenues et des attitudes mondaines …Mieux, elle va les faire se rencontrer, exister les uns par rapport aux autres, bref, servir de catalyseur à la vie intérieure de cette vieille bâtisse qui sans elle aurait été morne, sans joie, sans âme.
Au long de ce roman dont l’histoire va durer une vingtaine d’années et verra Lucrezia s’imposer, tirer parti avec quelque impertinence de toutes les circonstances et finalement établir elle-même ses propres enfants, Félicien Marceau note pour son lecteur des remarques personnelles sur la vie romaine. Rome « est une ville qui n’intimide pas » selon lui, et c’est dans ce décor qu’il va faire évoluer Lucrézia et son inextinguible appétit de liberté.
En fait, il flotte autour de cette femme un halo d’amour, d’amitié, d’ indépendance…
Ce serait sans doute assez pour que lecteur y trouve son plaisir mais l’auteur ajoute nombre d’appoggiatures et de maximes en forme d’apophtegmes du genre « L’esprit humain est si roué qu’il lui arrive de faire d’une interdiction une liberté et d’une impossibilité un moyen de défense. » « Il naviguait avec bonheur entre ces deux plaisirs, celui de frôler la tentation et celui de savoir que cela n’irait pas plus loin. » Autant de remarques qui prennent leur vie dans le regard mi-amusé mi-sérieux de quelqu’un qui s’est beaucoup penché sur la condition humaine, ses travers, ses hypocrisies, ses fantasmes…
Dans ce livre Félicien Marceau évoque « la mauvaise passe que connaissent tous les écrivains, les journées entières où rien ne vient, où on n’écrit pas une phrase, une réplique sans en voir la lourdeur et la niaiserie. »
Je n’ai pas assisté, bien sûr, à la naissance de ce roman, je n’en ai été que le lecteur attentif et passionné mais je gage que lors de sa conception l’auteur, l’auteur n’a pas connu pareille période néfaste.
© Hervé GAUTIER.
-
LE TEMPS DE GRACE - Maria Judite de Carvalho - Editions de la Différence.
- Par hervegautier
- Le 31/03/2009
- Dans Maria Judite de Carvalho
- 0 commentaire
N°228
Juillet 2000
LE TEMPS DE GRACE – Maria Judite de Carvalho – Editions de la Différence.
Qu’est ce qui fait qu’un homme, Mateus Silva, sur terre temporairement comme nous tous, mais perpétuellement en transit partout où il passe et continuellement en regret, aspire à vivre seul alors qu’on nous rebat les oreilles avec un bonheur qui ne peut se vivre qu’à deux ?
Il n’a jamais accepté les compromis que chaque homme doit faire avec la vie, ces petits arrangements qui la font, sinon belle, à tout le moins plus supportable. Il vit avec ses remords, ses deuils. Il n’a jamais réussi et ne réussira jamais, parce qu’il n’a pas le sens des choses ni des bonnes transactions, parce qu’il accepte sans broncher les petitesses d’un emploi subalterne, parce qu’il regrette sa mère, son père absent et volage, parti mourir au-delà des mers…
De son enfance, il garde des images merveilleuses et irréelles, un peu comme celles d’un paradis définitivement perdu qu’on ne retrouvera jamais. Il en conserve aussi un diminutif de son nom, comme s’il n’était pas actuellement la même personne…
S’il vend la maison de ses parents, désormais sienne, mais vide, déserte depuis longtemps et presque devenue étrangère pour lui, c’est moins pour gagner de l’argent que pour se forcer à tourner une page dans sa vie.
Il évoque son camarade Ginho qui a réussi, lui, et qui fera sûrement un beau et surtout un riche mariage. Il revoie Dona Mercês, la mère de son ami, dont jadis la beauté le faisait rêver et sûrement aussi un peu fantasmer. Elle est désormais laide, vieille et a choisi d’oublier le temps où la moralité ne guidait pas sa vie et où elle était la maîtresse de son père. C’est peut-être à cause d’elle qu’il était parti et que son épouse était morte d’avoir été abandonnée ?
Osorio, le mari de Dona Mercês, lui, se contente de gagner de l’argent et ne s’occupe pas du reste. La vie pour lui n’est pas autre chose que cela, faire des affaires…
Mateus a une femme, Alberta, torturée par la maladie et qui veut voir l’Acropole avant de mourir. Elle est entrée dans sa vie presque par hasard et la quittera comme par effraction.
Après cela ce sera la solitude mais sûrement pas la vie avec Natalia, la fille de Dona Mercês. Au début le lecteur peut supposer qu'elle est sa demi-sœur, celle qui serait née des amours illicites de Mercês et de son père mais il n’en est rien. Il la laissera cependant s’éloigner alors que tout était possible entre eux, une passade comme une vie plus stable qui aurait pu faire de lui le beau-frère de Ginho et lui assurer un avenir plus sûr…
Nous ne sommes sur terre que de passage. Le temps s’écoule inexorablement et inscrit sa marque sur notre corps et creuse des rides sur notre visage… C’est là une des contingences de la condition humaine : nous vieillissons, mais s’il fallait recommencer sa vie, il y a fort à parier que nous ferions les mêmes choix !
© Hervé GAUTIER.
-
JEUX DE MAUX - David Lodge [traduit de l'anglais par Michel Courtois-Fourcy] - Rivages.
- Par hervegautier
- Le 31/03/2009
- Dans David Lodge
- 0 commentaire
N°330– Mars 2009
JEUX DE MAUX – David Lodge [traduit de l'anglais par Michel Courtois-Fourcy] - Rivages.
L'actualité de l'Église brésilienne avec ses excommunications aussi anachroniques que révoltantes, l'attitude d'un Pape, ancien Grand Inquisiteur, oublieux du message de l'Évangile dont il est pourtant porteur, et qui soulève un tollé de protestations jusque dans les rangs de la hiérarchie épiscopale française, défraient actuellement la chronique. Nous vivons vraiment une époque formidable! Le hasard fait que j'ouvre le roman de David Lodge, qu'il monopolise mon attention et que je le lis avec avec plaisir, avec gourmandise même. Non, ce livre écrit en 1980 n'a pas vieilli, bien au contraire!
Voilà un ouvrage qui parle, avec un humour de bon aloi, d'une « religion », le catholicisme, qu'on nous a fait passer pour la seule possible, parce que la seule vraie et incontournable en occident, mais qui a assurément provoqué, au moins chez les jeunes gens des années 50, fantasmes, terreurs intimes, renoncements, scrupules et sacrifices en tous genres qu' adultes ils ont largement eu le temps de regretter. Il parle de l'hypocrisie, des tabous qu'elle a engendrés, des culpabilisations qu'elle a entretenues dans les jeunes esprits autour de la masturbation féminine et masculine, de la virginité et de la manière de s'en débarrasser, de la jouissance sexuelle et de la découverte du plaisir qui étaient forcément bannis, mais aussi de la nature de Dieu, au passage un peu écornée, de la confession, de la transsubstantiation, de la communion, la peur de l'enfer [et de la dépression nerveuse qui pouvait aller avec], bref de l'Église, de ses rituels et de ses pompes largement entretenus par des générations de parents et une hiérarchie catholique attentive... Autant de thèmes qui ont interrogé, torturé, bouleversé les jeunes d'alors au point que certains d'entre eux [de plus en plus nombreux si j'en crois les statistiques], émettent des doutes sur le message, oublient le chemins des églises... ou se tournent vers d'autres religions!
C'est vrai, j'ai lu ce livre avec plaisir. Il dénonce sur un mode plaisant et parfois badin, mais jamais caricatural, l'impact pesant de l'Église face à l'éveil d'adolescents à la vie et les embûches variés que la hiérarchie catholique a su y mettre au nom de la morale, des bonnes mœurs et surtout de l'organisation figée d' une société puritaine et autoritaire dont elle a toujours été l'alliée intéressée et que les jeunes fidèles, plus contestataires, ont su remettre en question quand ils sont devenus adultes. L'immobilisme dogmatique de l'Église catholique face aux grandes interrogations de l'humanité, de la procréation, du respect de la vie, de la contraception, du plein épanouissement de la sexualité individuelle reste une question d'actualité. Nous le voyons bien actuellement.
A travers plusieurs personnages et leur vie sexuelle et familiale parfois difficile et en tout cas rendue avec force détails parfois amusants, l'auteur règle ses compte avec l'Église catholique, ses dogmes et ses interdits absurdes qui déstabilisent inutilement les individus. Cette atmosphère un peu délétère entretenue par elle au regard du péché, dont on nous rappelle à l'envi qu'il s'agit, en ce qui nous concerne d'un état permanent, n'est peut-être pas autre chose que la peur de l'enfer, la nécessaire obéissance aveugle aux paroles de Pape et leurs inévitables interprétations à la fois variées, hypocrites et partisanes qui nourrissent cet état de choses avec lequel chacun finit, un jour ou l'autre, par prendre ses distances.
L'auteur prend soin de rappeler qu'il nous raconte une histoire, que nous sommes ici dans une fiction, que les personnages ne sont pas réels[bizarrement, il s'adresse directement à son lecteur et prend même congé de lui à la fin], mais le contexte dans lequel il les fait évoluer leur donne une virtualité bien actuelle! Il prend des références historiques citant abondamment l'encyclique « Humanae Vitae » ou le concile Vatican II... Il a cependant soin, et c'est sans doute nécessaire, de nous rappeler que ce n'est pas un roman comique. Dont acte!
La société qui nous est proposée est anglaise, un petit groupe d'étudiants catholiques dont il suit le parcours, mais la transposition est aisée et même bénéfique car si cette église est universelle, comme on nous en a largement rebattu les oreilles, la réaction que peut faire naître son enseignement et son exemple ne l'est pas moins.
Finalement l'auteur paraît appeler de ses vœux une église libérale, mais les événements actuels ne semblent pas aller dans ce sens et nous donnent à penser qu'il peut s'armer de patience!
Hervé GAUTIER – Mars 2009.http://hervegautier.e-monsite.com
-
NOUS ALLIONS VERS LES BEAUX JOURS – Patrick CAUVIN – Editions J.C.LATTES.- RUE DES BONS ENFANTS – Patrick CAUVIN – Editions Albin MICHEL.
- Par hervegautier
- Le 31/03/2009
- Dans Patrick CAUVIN
- 0 commentaire
N°67
Juin 1991
NOUS ALLIONS VERS LES BEAUX JOURS – Patrick CAUVIN – Editions J.C.LATTES.
Au début, c’est un livre plein d’images d’enfance, de l’enfance universelle commune à tous, faite de pleins et de déliés, de lourds cartables, de caniveaux, de séances de cinéma et de premiers rendez-vous.
Pour Paul Lévin, c’est l’amour du théâtre, la magie des personnages qu’on joue… Pour Victoria Shémin, la caméra c’est toute sa vie, tout son rêve… Elle sera actrice.
En toile de fond, il y a l’atmosphère, le climat, celui de la guerre qui menace, qui éclate et s’installe, avec en prime l’étoile jaune, les camps où cet homme et cette femme qui vivaient en France, loin l’un de l’autre, sans se connaître se rencontreront. Ils sont juifs, et parce qu’ils sont acteurs professionnels on leur fait jouer un rôle dans un mauvais film de propagande destiné à prouver à la postérité que l’Allemagne nazie avait une conduite humaine vis à vis des populations civiles juives déportées. Pour eux c’est un sursis face à la mort, quelques jours à gagner sur la vie. C’est dans ce camps qu’ils vont se rencontrer, s’aimer, savoir qu’ils sont faits l’un pour l’autre depuis le début, savoir qu’ils peuvent, par la seule force de leur amour, de leur espoir en la vie administrer une superbe gifle à la face de leurs tortionnaires. De fait, la description de leurs souffrances est émaillée d’instants d’imaginaires folies, d’humour irréel pour conjurer la réalité.
Le camp, c’est à dire la souffrance, le mensonge et la mort va réunir cet homme et cette femme car pour que le subterfuge ne soit jamais dévoilé et que reste pour les générations à venir et pour l’Histoire cette image du « Juif heureux » dans l’Allemagne nazie, tous les acteurs de ce film seront exécutés…
C’est un livre bouleversant, à lire et à relire à l’heure où l’actualité remet en cause la réalité historique du génocide juif et où l’intolérance et le racisme refont cruellement surface.
RUE DES BONS ENFANTS – Patrick CAUVIN – Editions Albin MICHEL.
Comme dans une ancienne chanson de Bécaud, il y a des senteurs, des couleurs, la magie du Midi… « l’accent qui se promène et qui n’en finit pas… », avec, bien entendu, l’absinthe, les bars, les quartiers chauds, les soldats de la Coloniale, les voyous et les truands. Cette carte postale, c’est Marseille en 1922, avec ses légionnaires, ses marins en partance, son port, la porte du Moyen-Orient, de l’Afrique et du monde, le ventre des bateaux pleins de rêves, ceux de Marius, ses quais qui sentent bon la marée et le goudron frais, ses poissons qui vous apportent l’air du large, le soleil des dockers, les entrepôts, l’univers d’une enfance dans un port…
Le temps passe, le pastis remplace l’absinthe mais les filles restent avec leurs souteneurs et leurs quartiers réservés. Le cinéma se met à parler et Pascal et Séraphine qu’un regard d’enfant avait uni et auquel ils resteront fidèles se mettent à grandir eux aussi.
Avec une gouaille entrecoupée de moments de poésie forte, d’images belles et fraîches, Patrick Cauvin nous raconte à la fois l’histoire d’une ville et la saga d’un homme et d’une femme que tout sépare mais qui finissent par se retrouver malgré les vicissitudes de la vie. L’amour veille qui les réunira malgré la guerre, les ruptures, les risques, la collaboration et la Résistance, les trafics et les bombardements.
Il reste le soleil, le soleil qui brille sur cette ville éternelle et sur cette « rue des bons enfants » où chacun se retrouve comme dans un refuge pour un conseil ou un rendez-vous.
© Hervé GAUTIER
-
LES BOULEVARDS DE CEINTURE- Patrick MODIANO – Editions Gallimard.
- Par hervegautier
- Le 31/03/2009
- Dans Patrick MODIANO
- 0 commentaire
LES BOULEVARDS DE CEINTURE- Patrick MODIANO – Editions Gallimard.
Le récit évoque la quête du père par son fils et les relations floues qu’ont ensemble deux êtres à un moment précis de leur histoire. Flous aussi les personnages qui gravitent autour d’eux, floue l’époque, flou le milieu dans lequel ils évoluent, floues aussi leurs activités…
Le lecteur est invité à pénétrer dans ce microcosme le temps d’un roman, comme on regarde une photo-souvenir.
Le fils part à la redécouverte d’un père surgi dans sa vie quand il était adolescent et qui bizarrement voulut le tuer… Depuis, dix années ont passé et le pardon a recouvert « cet épisode douloureux ». Ce père énigmatique qui étrangement ne le reconnaît pas, apparaît puis disparaît. Pourtant le chemin que fait son fils pour aller à sa rencontre s’inscrit dans une démarche d’amour filial exempte d’arrière-pensées. Leurs relations sont des plus distantes, agrémentées d’un voussoiement anachronique, comme deux étrangers…
Le fils fera ce qu’il pourra, mais en vain. Il manque d’attache, de références et les souvenirs qu’il a avec cet homme sont trop vagues ou trop mauvais.
Il y a dans ce livre, comme toujours chez Patrick Modiano une atmosphère caractéristique que j’aime retrouver à chaque fois.
© Hervé GAUTIER.
-
QUARTIER PERDU – Patrick MODIANO – Editions Gallimard..Une Jeunesse – Patrick MODIANO – Editions France-Loisirs
- Par hervegautier
- Le 31/03/2009
- Dans Patrick MODIANO
- 1 commentaire
QUARTIER PERDU – Patrick MODIANO – Editions Gallimard..
« C’est une grande folie, presque toujours châtiée de revenir sur les lieux de sa jeunesse et de vouloir revivre à 40 ans ce qu’on a aimé et dont on a fortement joui à 20 ». Cette phrase d’Albert Camus trouve dans ce roman son illustration puisque Jean Dekker, Français, devenu Ambrose Guise, citoyen britannique et auteur de romans policiers, choisit, à l’occasion d’un rendez-vous d’affaire de revenir à Paris, à la rencontre de son passé.
Comme toujours chez Modiano, il y a cette quête de soi-même, de ses racines, de ses souvenirs, de son identité… Ambrose Guise va croiser des fantômes d’amis disparus, de relations trop vites oubliées, de femmes aimées ou désirées…
La vie nocturne, l’ambiance crépusculaire ajoutent au caractère secret de ce roman. Dans un Paris que l’été vide de ses habitants et qui n’est plus peuplé que de touristes étrangers en transit, la touffeur de Juillet fait prévaloir la nuit et sa fraîcheur.
Mais, avant tout, le narrateur remet vingt ans après ses pas dans les siens propres, à la rencontre de ce qu’a été sa jeunesse, c’est à dire d’une époque révolue qui jamais ne pourra revivre, ni à travers les notes d’une chanson, ni dans des lieux désormais hantés par des ombres.
Le passé s’impose pourtant à lui comme une obsession parce que vingt ans auparavant il a dû fuir Paris et sa jeunesse à cause d’un crime. Sa vie a basculé. Ce fut une autre existence, un autre nom, un autre pays, une situation brillante comme homme de plume ce qui précisément l’incite à remonter le temps qui désormais fait partie de ses souvenirs.
Une Jeunesse – Patrick MODIANO – Editions France-Loisirs
D’emblée, le singulier se conjugue avec le pluriel, puisqu’il s’agit de deux jeunesses. Celle de Louis, que le lecteur rencontre au sortir du service militaire. Il est accompagné de Brossier, sorte de voyageur de commerce rencontré au hasard d’un café à St Lô, celle d’Odile, jeune fille qu’un certain Bellune, chargé de découvrir, pour une maison de disques d’éphémères talents, rencontrera par hasard, alors qu’elle était bien la dernière personne qui pouvait attirer son attention…
Odile devient donc chanteuse par hasard, mais Bellune ne supporte pas la rencontre avec son passé et choisit… Louis devient vaguement salarié de Brossier.
Dans un Paris qui autour des personnages semble vide, ces deux êtres que rien ne prédisposait à se rencontrer vont faire connaissance, précisément au buffet de la Gare St Lazare, là où les gens partent, arrivent, transitent… L’univers dans lequel évoluent Louis et Odile paraît flou, surréaliste même. Leur situation est bizarre, comme sont étranges ceux qui les entourent… et ce qui leur arrive.
A chaque fois le passé ressurgit à l’invite des paroles d’une chanson, de la fragrance d’un parfum, des couleurs d’une carte postale. C’est toujours cette ambiance surannée (et originale) qui ressort de ce roman. C’est aussi l’occasion de replonger dans le passé, pour Louis surtout, personnage central qui recherche désespérément la trace de ses parents, de son père coureur cycliste, de sa mère danseuse de cabaret, tous deux happés par une mort accidentelle.
Pourtant, la jeunesse qui, pour la plupart d’entre nous correspond à une période d’insouciance et de joie reste pour Louis (et peut-être pour l’auteur ?) un paradoxe tout entier contenu dans la dernière phrase du roman : « Quelque chose dont il se demanda plus tard si ce n’était pas tout simplement sa jeunesse, quelque chose qui lui avait pesé jusque là se détachait de lui comme un morceau de rocher tombe lentement vers la mer et disparaît dans une gerbe d’écume. »
L’écriture serait-elle pour Patrick Modiano une catharsis, un extraordinaire exorcisme ?
© Hervé GAUTIER.
-
COMME UN ROMAN - Daniel PENNAC - Editions FERYANE - BP 314 78003 VERSAILLES.
- Par hervegautier
- Le 30/03/2009
- Dans Daniel PENNAC
- 0 commentaire
NOVEMBRE 1999
N° 214
COMME UN ROMAN - Daniel PENNAC - Editions FERYANE - BP 314 78003 VERSAILLES.
*
Cela va peut-être faire plaisir à Daniel Pennac, j’ai lu son livre, son « témoignage » puisqu’il appelle cela ainsi. Cela tombe bien puisqu’il y est question de... la lecture!
Ce qu’il dit est intéressant et de bon sens, mais, qu’il me pardonne, ce n’est pas nouveau. L’étude comparée des mérites du livre et de la télévision par exemple. Quand j’étais au collège, il y a de cela bien des années, nous étions invités à comparer plutôt ceux du roman et du cinéma. Dans notre dissertation, lue et corrigée par un professeur « vieille France », il valait mieux, si nous voulions avoir une bonne note, préférer le livre à la facilité du film. Nous le savions et sans être outre mesure flagorneurs, cela nous permettait d’obtenir de lui une bonne note. Elle avait l’avantage de remonter la moyenne mensuelle!
Il reprend donc tout depuis le début, depuis notre histoire personnelle (et collective) avec la lecture. C’est tout d’abord l’enfance et les histoires lues ou racontées par les parents avant de s’endormir, l’adolescence où on lit en cachette sous les couvertures... (je ne suis pas très sûr qu’actuellement la lecture donne lieu à ce genre de débordement. Cela c’était pour les générations précédentes!), l’âge adulte où les relations qu’on peut avoir avec le livre sont, soit passionnées, soit carrément distantes voire oublieuses.
L’auteur en profite pour rendre un hommage appuyé à Georges Perros, poète mais aussi professeur qui a su transmettre à ses élèves le goût de la lecture et donc du savoir. Il nous parle aussi de ces improbables professeurs de Français qui savent faire passer le message... Pour ma part, et je ne suis sans doute pas le seul, tous ceux qui se sont invités pendant le cours de mes études m’en ont carrément dégoûté. Cela s’est arrangé plus tard mais je dois bien dire que ce n’est pas grâce à ceux que je continue d’appeler « mes maîtres » que je dois d’aimer la lecture et peut-être aussi l’écriture.
Daniel Pennac se livre dans cet ouvrage à une analyse très fine de ce phénomène, détaillant les droits inaliénables et imprescriptibles du lecteur par rapport au livre et à son auteur. Celui de lire, de s’arrêter, de ne pas reprendre, de sauter des pages, celui de contester et de commenter (J’en suis heureux puisque je le pratique depuis plus de vingt ans dans cette chronique), ce que refusent, à tort pourtant, bien des auteurs, celui de se taire quand l’indifférence est la plus forte et rejoint la déception, celui de relire aussi pour un supplément d’enchantement, celui de faire un choix puisque là aussi la liberté existe et qu’un auteur qu’on juge mauvais peut à la fois être dénoncé comme tel et soigneusement évité!
C’est une véritable charte du lecteur qui nous est ici détaillée.
Il nous rappelle opportunément puisque, paraît-il, la lecture est en diminution actuellement, qu’elle est avant tout un espace de liberté et un plaisir dont chacun aurait bien tort de se priver.
©Hervé GAUTIER
-
CHAGRIN D'ECOLE – Daniel PENNAC - Editions Gallimard.
- Par hervegautier
- Le 30/03/2009
- Dans Daniel PENNAC
- 0 commentaire
N°304 – Juillet 2008
CHAGRIN D'ECOLE – Daniel PENNAC - Editions Gallimard.
Quand une amie m'a confié ce livre en m'en recommandant la lecture, le titre m'a enthousiasmé. Enfin, me suis-je dit, quelqu'un qui va parler du déplaisir d'être en classe, qui va exprimer tout le désarroi de ces potaches qu'on inscrit, parce que c'est obligatoire, dans une école ou un collège où ils n'ont rien à faire et où ils s'ennuient à longueur d'années scolaires et qu'ils n'aspirent qu'à quitter! Et quand l'amie à ajouté qu'il y était question de la « cancrerie », je ne pouvais qu'être intéressé, parce que, moi-même des chagrins (au pluriel) d'école, j'en ai!
C'est donc avec un évident intérêt que j'ai ouvert le livre parce que, pendant de nombreuses années, j'ai été, moi aussi cet élève du fond de la classe qui collectionnait punitions et mauvaises notes et qui n'était capable de produire que de piètres bulletins de notes que ne rachetaient ni la gymnastique ni la musique. Enfin, me suis-je dit, quelqu'un qui ne va pas me faire rougir de mes authentiques quartiers de « cancritude ». C'est que j'en ai traîné pendant de si nombreuses années de ces pâtés sur mes cahiers d'écolier, de ces doigts éclaboussés d'encre, de ces annotations peu flatteuses et à l'encre rouge en marge de mes copies, de ces punitions pour un devoir mal fait...! Quelqu'un qui n'a pas honte de commencer ses phrases par « Donc, j'étais un mauvais élève », quelqu'un qui ose donner dans quelque chose qui ressemble à la solidarité des cancres, qui me rappelle Prévert et ses élèves dissipés qui préféraient la fenêtre ouverte au tableau noir. Quelqu'un qui dissèque avec bonheur celui que des générations de professeurs ont sciemment délaissé, l'abandonnant à son ignorance à son absence d'avenir, dénonçant quand même ces petites avanies, ces vengeances, ces flagorneries, ces coupables compromissions aussi mais également sa solitude, sa honte secrète. Alors après des années des bahut largement agrémentées de colles, de renvois au point que le département est soudain trop petit, on se décourage et face à l'échec irrécupérable, à ce naufrage qu'on pense définitif on se met à songer à l'armée [engagez-vous qu'ils disaient!], à un meilleur établissement, on trouve des excuses et parmi elles l'inévitable complot des professeurs... et du désespoir des parents. Enfin quelqu'un qui ose parler d'autre chose que de la réussite sociale, financière, personnelle dont les médias se font si souvent l'écho, bref de ceux qui ont réussi et qui laissent complaisamment parler d'eux, de leurs diplômes, de leurs titres, de leurs décorations...
Je me suis vite aperçu que l'auteur, également professeur, parle aussi, longuement et parfois sans complaisance, de son vécu professionnel, des élèves qu'il a eus, de l'expérience qu'il a bien dû, lui aussi, répéter dans sa classe, quand, du pupitre du potache il est passé à l'estrade de l'enseignant. Et lui de connaître à son tour les affres des cours bâclés ou des paroles prononcées devant une assemblée d'élèves dont l'apathie n'a d'égal que leur intérêt pour la fuite du temps et dont l'aspiration va plutôt vers les distractions du week-end à venir que vers Voltaire ou Diderot!
Voilà qu'il se met à parler de la classe, de la technique, de la maîtrise de ses élèves, de l'ambiance délétère qu'on rencontre parfois dans les classes... Puis viennent les considérations sur l'école, les programmes qui évoluent, les temps qui changent, les grandes idées qui restent, l'échec et sa permanence, le niveau qui baisse et les bases qui manquent, la société qui change... Et voilà que le prof reprend le dessus sur l'écrivain et surtout sur l'ancien cancre, fait sa leçon de grammaire, décortique le texte et son vocabulaire, en profite pour glisser des aphorismes et des remises en cause sur le corps enseignant lui-même, parle de sa méthode personnelle pour amener les plus réticents à s'intéresser à l'école. Puis vient l'inévitable apprentissage « par coeur », ses mérites et ses faiblesses, débat depuis longtemps mené et jamais convainquant! Le lecteur entend parler non plus du cancre que fut l'auteur, mais du professeur-écrivain qui a réussi et qui est parvenu à s'extraire de sa condition de cancre, grâce, dit-il, à la maturité et à quelques maîtres plus charismatiques ou pédagogues que les autres!
Franchement, il m'a semblé qu'on était loin du sujet, loin en tout cas de ce qui avait motivé mon appétit de lecture.
© Hervé GAUTIER – juillet 2008.http://monsite.orange.fr/lafeuillevolante.rvg
-
POUR VOS CADEAUX - Jean ROUAUD - Editions FERYANE-BP 314 78003 VERSAILLES.
- Par hervegautier
- Le 30/03/2009
- Dans Jean ROUAUD
- 0 commentaire
NOVEMBRE 1999
N° 215
POUR VOS CADEAUX - Jean ROUAUD - Editions FERYANE-BP 314 78003 VERSAILLES.
*
C’est vrai qu’ils sont rares les écrivains qui savent m’émouvoir. Jean Rouaud est de ceux là.
Et pourtant je n’aime pas beaucoup son style fait de phrases à n’en plus finir et dont j’ai du mal, parfois, à suivre le cours. Je goûte peu leur longueur excessive, leurs apartés... Cependant, je dois bien reconnaître que c’est un texte qui gagne à être lu à haute voix. On en apprécie davantage les nuances, l’humour, le sens de la formule qui font dire que, quand même c’est bien écrit!
Il reste cependant l’émotion, à cause de cette ambiance lentement tissée, cette histoire qui vous prend aux tripes à force d’être simple, presque banale, mais qui devient passionnante par le miracle de l’écriture.
Jean Rouaud à choisi de nous faire partager celle de sa parentèle, d’évoquer le passage sur terre de gens qui ne sont plus, mais dont, grâce à lui, le souvenir demeure.
Mais qu’y a-t-il de plus ordinaire que l’histoire de cette famille avec ses secrets, ses moments d’orgueil, ses soupçons et ces instants de joie? Les personnages, certains falots, d’autres écrasants par leur présence même sont évoqués ici à leur tour. Le lecteur à l’impression de les avoir croisés, connus! Il devient, malgré lui le témoin des grands moments de leur vie, complice de leurs actions, compatit à leurs malheurs et à leurs peines.
L’auteur a choisi celui de sa mère qu’il fait revivre au long de ces pages. C’est vrai que son vécu est simple, celui d’une épouse de commerçant en porcelaine d’un gros bourg du département de Loire Inférieure qui n’était pas encore Atlantique. Elle devient brutalement veuve à l’aube de la quarantaine et doit faire face au quotidien de trois enfants désormais à sa seule charge. Elle doit reprendre le commerce à son compte. Le lecteur partage son désarroi, son calvaire devant la solitude, le silence et les responsabilités auxquelles elle n’était pas préparée. Du même coup elle devient gardienne du foyer, chef de famille, chef d’entreprise, prend la place de ce mari dont elle devient le double malgré sa silhouette fragile.
C’est qu’elle doit faire tout cela malgré son envie inextinguible de rejoindre son époux dans la mort... Elle porte ostensiblement son deuil au point de faire teindre en noir la totalité de sa garde-robe qui jadis fut plus colorée et refuse tout ce qui peut ressembler à une nouvelle vie, avec un autre homme par exemple. C’est que la fidélité pour elle s’entend dans la mort comme dans la vie.
L’auteur nous décrit sa laborieuse remontée vers le monde des vivants pour pénétrer de nombreuses années plus tard, de l’autre côté de la vie aussi simplement qu’elle avait vécu, presque en silence.
Cette mort est omniprésente autours des personnages de Jean Rouaud qui nous rappelle d’ailleurs que lorsqu’il prend la plume pour évoquer cette mère, elle a déjà plongé dans le néant de l’au-delà : « Elle ne lira pas ces lignes, la petite silhouette ombreuse... »
Sa vaste démarche d’écriture ressemble à un long travail de deuil, comme si chaque livre consacré à un des membres de cette famille n’avait d’autre but que d’éponger ses larmes, d’exorciser son chagrin au rythme des mots. C’est un peu comme l’exploration d’un cimetière dont chaque tombe est le prétexte à un roman, une sorte de saga dont chaque livre compléterait le puzzle.
Jean Rouaud a été révélé par le Prix Goncourt qu’il obtint en 1990. Je m’en suis félicité au moment de cette distinction (La Feuille Volante n°55). Ce prix a souvent laissé un goût amer à ceux qui ont été ainsi distingués. Je suis heureux que, en ce qui le concerne, les jurés ne se soient pas fourvoyés.
©Hervé GAUTIER