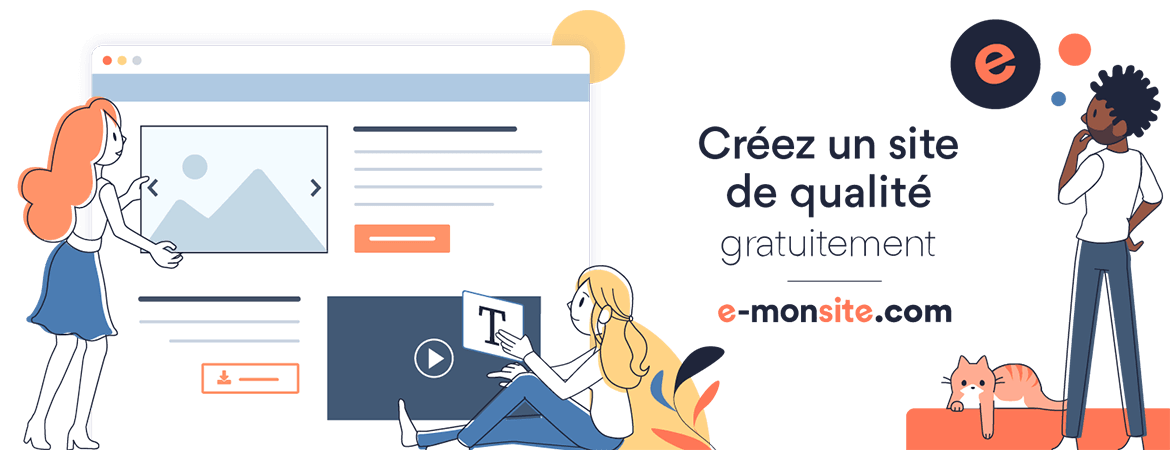Articles de hervegautier
-
La briscola à cinq
- Par hervegautier
- Le 26/03/2022
- Dans Marco Malvaldi
- 0 commentaire
N°1633 - Mars 2022
La bricscola à cinq – Marco Malvaldi- Christian Bourgois éditeur.
Traduit de l’italien par Nathalie Bauer.
Dans un petit village de Toscane, le cadavre d’une jeune fille, Aline, vient d’être découvert dans une poubelle et bien entendu l’enquête policière s’oriente vers ses amis. Ici tout le monde se connaît et bien entendu cet événement déclenche les commentaires, surtout dans le bar de Massimo, où un bande de papys s’y retrouvent régulièrement pour taper le carton, la briscola. Ils sont diserts sur tout ce qui concerne ce village et le patron de ce bistrot se trouve malgré lui impliqué dans ces investigations et se montrera plus efficace que « l’illustrissime commissaire Fusco », arrogant et suffisant, qui brille depuis longtemps par son incompétence et n’est capable que d’arrêter la mauvaise personne. Avec l’aide du Dr Carli, Massimo, simple barman, certes très au-dessus de la moyenne, se montre plus observateur et raisonneur et donc efficace que notre flic, même si son témoignage désigne une personne sans pouvoir apporter la moindre preuve ni le moindre alibi.
Dans cette enquête, il n’y a pas de commissaire emblématique comme dans les autres polars, on croise de jolies femmes aux appas avantageux, des vieillards radoteurs qui sont au bar dans le seul but de refaire le monde et d’échapper à leur femmes, des flics caricaturés à l’excès et un brave barman qui accepte de remettre en question les choses les mieux admises jusque et y compris en bouleversant ses certitudes. C’est plaisant, délassant, pas très sérieux mais d’une lecture agréable quand même.
-
La briscola à cinq
- Par hervegautier
- Le 26/03/2022
- Dans Marco Malvaldi
- 0 commentaire
N°1633 - Mars 2022
La bricscola à cinq – Marco Malvaldi- Christian Bourgois éditeur.
Traduit de l’italien par Nathalie Bauer.
Dans un petit village de Toscane, le cadavre d’une jeune fille, Aline, vient d’être découvert dans une poubelle et bien entendu l’enquête policière s’oriente vers ses amis. Ici tout le monde se connaît et bien entendu cet événement déclenche les commentaires, surtout dans le bar de Massimo, où un bande de papys s’y retrouvent régulièrement pour taper le carton, la briscola. Ils sont diserts sur tout ce qui concerne ce village et le patron de ce bistrot se trouve malgré lui impliqué dans ces investigations et se montrera plus efficace que « l’illustrissime commissaire Fusco », arrogant et suffisant, qui brille depuis longtemps par son incompétence et n’est capable que d’arrêter la mauvaise personne. Avec l’aide du Dr Carli, Massimo, simple barman, certes très au-dessus de la moyenne, se montre plus observateur et raisonneur et donc efficace que notre flic, même si son témoignage désigne une personne sans pouvoir apporter la moindre preuve ni le moindre alibi.
Dans cette enquête, il n’y a pas de commissaire emblématique comme dans les autres polars, on croise de jolies femmes aux appas avantageux, des vieillards radoteurs qui sont au bar dans le seul but de refaire le monde et d’échapper à leur femmes, des flics caricaturés à l’excès et un brave barman qui accepte de remettre en question les choses les mieux admises jusque et y compris en bouleversant ses certitudes. C’est plaisant, délassant, pas très sérieux mais d’une lecture agréable quand même.
-
L'intrusive
- Par hervegautier
- Le 25/03/2022
- Dans Claudine Dumont
- 0 commentaire
N°1632 - Mars 2022
l’intrusive – Claudine Dumont – Le mot et le reste.
Camille ne dort plus au point de devoir abandonner son travail et ni les médicaments ni les psychiatres ne peuvent rien pour elle. Elle est en permanence dans un état second au point d’en perdre l’appétit et d’être sujette à des hallucinations ce qui fait d’elle une inadaptée sociale au bord du gouffre. Elle est seule dans la vie et son uniques plaisir est de voir sa jeune filleule, Jeanne, mais son frère s’y oppose à cause d’une attitude jugée dangereuse qu’elle a eue à l’égard de la fillette. Elle fait ce qu’elle peut pour s’en sortir, mais en vain, malgré l’aide de son frère et sa belle-sœur l’oriente vers Gabriel qui peut, selon elle la libérer. Elle accepte avec hésitation mais elle se trouve en présence d’un être étrange, un ex-praticien radié et qui vit coupé du monde. Il prétend, grâce à une machine de son invention, visualiser les rêves de Camille et ainsi pouvoir peut-être comprendre ce qui la bloque au point de la priver de sommeil. Selon lui, le rêve ouvre les portes de l’inconscient et si elle parvient à dormir et donc à rêver, Camille, avec l’aide de Gabriel, pourra se libérer et ainsi reprendre une vie normale.
Ainsi commence cet étrange roman psychologique où la jeune femme, qui n’a cependant pas perdu la mémoire, va revisiter son enfance traumatisée par une mère dominatrice dont la nocivité lui a interdit d’exprimer ses sentiments, ses émotions et sa douleur et par un père transparent et sous influence de son épouse. Ces moments sont brièvement évoqués lors de flash-back où Camille revit douloureusement sa jeunesse avec sa mère. Pire peut-être, puisque la vie d’adulte dépend tellement de l’enfance , elle prend conscience que cette femme a pu faire d’elle un monstre semblable à elle suivant la règle non écrite qu’on reproduit l’exemple qu’on veut précisément éviter. Elle devint donc la copie conforme de cette femme honnie, au point de répéter, et ce malgré elle, avec sa filleule les sévices qu’elle avait subies avec sa mère. Cette éducation toxique l’a complètement détruite et ce n’est pas la mort de cette mère qui l’a libérée de ses obsessions et de son mal-être. Seule l’espoir de pouvoir revoir Jeanne la motive mais elle doit pour cela impérativement retrouver une vie normale et se défaire de ses obsessions.
L’intrigue est bien menée et le travail sur les rêves intéressant même s’il y a quelques longueurs. Que le sommeil soit un élément essentiel de la vie ne fait aucun doute mais le protocole de soins paraît assez étrange non seulement au niveau de la technique, mais aussi dans les relations entre patient et praticien qui prennent une dimension quasi-intime. C’est une démarche introspective basée sur la mémoire mais aussi sur la parole et sa dimension psychiatrique a pour but la reconstruction de Camille pour lui permettre de recouvrer une vie normale. Elle semble au départ assez réticente à ce traitement mais petit à petit elle l’accepte au point de se mettre sous la dépendance de Gabriel, un peu comme elle l’était jadis sous celle de sa mère. Gabriel est un mystère, il est médecin mais nous savons qu’il a été radié sans doute à la suite d’une erreur et vit d’une activité d’ébénisterie. Pourtant il accepte de s’occuper de Camille et au fil des séances, il prend son rôle très au sérieux et cela débouche pour elle sur une connaissance de soi plus approfondie et une remise en cause des idées qu’elle avait elle-même conçues à son égard et qui la libérera du monstre violent tapi en elle, une dépendance bénéfique qui annule celle maléfique de sa mère.
J’avoue que j’ai eu du mal à suivre cette histoire un peu oppressante mais pourtant bien réaliste.
-
Ode maritime
- Par hervegautier
- Le 14/03/2022
- Dans Fernando PESSOA
- 0 commentaire
N°1631 - Mars 2022
Ode maritime– Fernando Pessoa (Alvaro de Campos) – Éditions Fata Morgana.
Ce sont des poèmes parus en 1915 dans le deuxième et dernier numéro de l’éphémère revue « Orpheu » dirigée par Pessoa. Ils sont signés d’Alvaro de Campos, un hétéronyme proche du grand écrivain portugais. Ce personnage quelque peu anglo-saxon malgré sa naissance est une création de Pessoa a eu une vie (1890-1935), un horoscope, il est un ingénieur naval à monocle, a navigué, notamment en Orient puis est revenu à Lisbonne où il est mort. C’est un poète d’avant-garde qui est à la fois semblable et différent de son créateur, chantre du modernisme et un auteur pétri de fantasmes et de mystères. Dans ces poèmes Pessoa se cache et se dévoile alternativement comme il le fait également avec ses autres hétéronymes. C’est autant une manière de s’exprimer qu’une manière d’être, une façon de se dédoubler en s’analysant lui-même, en semant des interrogations dans l’esprit de ses lecteurs tout autant que de donner volontairement une réalité à son esprit multiforme, aussi original qu’inattendu.
C’est une poésie à la fois simple, complexe et tourmentée, avec des accents quasi surréalistes, quelque peu masochistes et parfois violents, qui ressemble à une longue litanie et parfois même à une épopée, tournée ici principalement vers le mystère que génèrent la distance, l’inconnu, le voyage avec ses départs et ses arrivées. C’est un long poème de plus de mille vers que j’ai eu plaisir à lire à haute voix pour partager la magie des mots. Il parle de la mer, du large, des navires et donc du port qui en est le point de démarrage. Voir le bateau qui quitte le quai est une invitation au rêve de découvertes et de rencontres pour celui qui part et de mélancolie pour celui qui reste à terre et se contente de voir le sillage et la fumée du navire qui disparaît. C’est une facette de cette « saudade » qui fait tellement partie de l’âme lusitanienne dont le destin est fait de voyages, d’exils et d’ailleurs.
Puis c’est le retour à la réalité, l’acceptation de l’existence anonyme et oubliée, celle des quidams qui sont condamnés à regarder partir les autres et à rester seuls avec leurs regrets et leurs remords. Il y a dans ces textes, les premiers vers qui évoquent le retour d’un bateau, une idée très portugaise du retour, celle du « sebastianisme », du nom de Sébastien 1° roi du Portugal (1554-1578) qui mourut au cours d’une bataille au Maroc et dont la tradition veut qu’il ait survécu et qu’il revienne un jour au Portugal.
La distance s’analyse aussi dans le temps, à travers la mémoire du passé, le souvenir de l’enfance heureuse et calme, accrochée aux murs d’une maison aimée .
De tout cela je retire un sentiment de solitude, de tragique, sans oublier le mystère qui réside dans le personnage même de Pessoa.
-
poèmes païens
- Par hervegautier
- Le 04/03/2022
- Dans Fernando PESSOA
- 0 commentaire
N°1630 - Mars 2022
Poèmes païens – Alberto Caeiro et Ricardo Reis - Christian Bourgois éditeur.
Pessoa est un cas à part dans l'histoire de la littérature. Il a passé sa vie dans un bureau comme un discret employé aux revenus modestes, n'a pratiquement rien publié de son vivant sous son nom propre et est mort pratiquement inconnu, laissant le soin à ceux qui le suivraient de découvrir ses poèmes écrits parfois au dos de vieilles factures et déposés dans une malle ou éparpillés sur des feuilles et de les publier, ce qu’ils firent. Il est pourtant considéré comme un des plus grands écrivains portugais, à l'égal de Camões
Ces deux auteurs n’ont jamais existé autrement que dans l’imagination et sous la plume de Fernando Pessoa (1888-1935). Ils sont parmi ses nombreux hétéronymes (on en dénombre 72) les plus importants. Ce terme n’est pas un simple pseudonyme, pas non plus un artifice littéraire ou une manière de se cacher, d’avancer masqué . Il y a ici une idée d’opposition entre tous ces personnages qui lui permet d’analyser et d’exprimer les arcanes de son « moi », une façon pour lui « d’être un autre sans cesser d’être lui-même » et peut-être aussi une forme de thérapie face à une vie solitaire d’écorché-vif. C’est l’occasion de révéler son style à la fois prolifique et protéiforme, sa modernité, son anti-conformisme, sa volonté de révolutionner l’art et de le marquer son empreinte comme il l’a fait dans son éphémère revue « Orpheu ». En effet, Pessoa les a crées, leur a prêté une vie, et parfois une mort, une sensibilité, une personnalité, un horoscope, a écrit pour eux une œuvre différente de la sienne et qui ne se ressemblent pas non plus à celle des autres hétéronymes.
Parmi tous ses nombreux hétéronymes, Ricardo Reis a une place de choix. Selon Pessoa lui-même, cet « auteur » se serait imposé de lui-même. Ricardo Reis est un lettré, éduqué chez les jésuites portugais, son style est emprunt d’une rigueur stoïcienne et d’un épicurisme sobre à la manière d’Horace, c’est un humaniste, un intellectuel au vocabulaire choisi (« les odes »), un poète de l’instant fugitif, respectueux de la stricte règle prosodique. Cela est dû à la formation classique où prédominait le latin, reçue par Pessoa lors de sa scolarité en Afrique du sud. Il est médecin, monarchiste, ce qui fera de lui un exilé au Brésil quand la république sera instaurée au Portugal. Il y a chez lui un certain fatalisme face à la vie et à la mort.
Alberto Caeiro(1889-1915) est une sorte de berger (« Le gardeur de troupeaux ») sans grande éducation dont la poésie est simple et spontanée, tournée vers la terre et les sens. Son écriture bucolique, sobre et dépouillée, et parfois même lourde, est à contre-courant du classicisme portugais de cette époque (1914) . On peut même y voir un certain humour. Il est le poète de la simplicité, de la nature, des choses vues et vécues. Il regarde le monde avec des yeux presque naïfs, se méfiant des intellectuels et de leur créations fantasques et éthérées, des mystiques et des espoirs fous qu'ils insinuent dans l'esprit des autres hommes. Il a conscience de n’être rien en ce monde, de n’être ici que de passage et évidemment voué à l’anonymat et à la disparition silencieuse. Il est celui qui prône l'indifférence face au monde des grandes idées qui le bouleversent et lui oppose un monde plus sensuel du quotidien.
Ces poèmes sont dits païens parce qu’ils sont tournés vers les sens, les sensations, l’inverse du mysticisme, peut-être aussi parce qu’ils sont écrits d‘une manière irrévérencieuse au regard de la religion chrétienne, qu’ils célèbrent la vie qui n’a pour issue que la mort.
C’est toujours un plaisir de relire Pessoa. Il reste pour moi un écrivain fascinant parce qu’il a été et parce ce qu’il a écrit.
-
Conquistadors
- Par hervegautier
- Le 01/03/2022
- Dans Eric Vuillard
- 0 commentaire
N°1629 - Mars 2022
Conquistadors – Eric Vuillard – Éditions Leo Scheer.
Avec un luxe de détails et un style poétique et érudit, Eric Vuillard renoue avec le roman épique historique en racontant l’histoire de la conquête du Pérou par Francisco Pizarro, enfant naturel et pauvre d’un noble espagnol qui décide de tenter sa chance dans le nouveau monde. Après deux expéditions désastreuses, il retourne au Pérou où il trouve l’or tant convoité au prix de trahisons et de la destruction de l’empire inca, un génocide perpétré avec la complicité et la bénédiction de l’Église catholique.
Chef d’une petite armée en guenille qui massacre, pille et viole, il ne fait que répandre la mort autour de lui et, un temps, jouant sur les oppositions entre les peuplades, la chance lui sourit, il est reconnu comme gouverneur du Pérou mais la violence qu’il a lui-même semée se retournera contre lui. Devant tant de richesses, de pouvoir et d’arrogance, ces conquistadors, notamment Almagro, qui n’étaient rien en Espagne que des analphabètes pauvres et souvent des batards, fomentent des luttes fratricides qui se se solderont par la mort de Pizarro.
C’est un roman dur, un peu long à lire mais qui est l’image d’une facette de la nature humaine dans ce qu’elle a de pire, fascinée par le pouvoir et l’argent et capable de tout pour les obtenir.
-
La guerre des pauvres
- Par hervegautier
- Le 24/02/2022
- Dans Eric Vuillard
- 0 commentaire
N°1628 - Février 2022
La guerre des pauvres – Eric Vuillard – Actes sud.
Ce petit livre passionnant refermé, j’ai à nouveau l’impression que Thomas Munster a été comme de nombreux prédicateurs religieux la victime de sa foi. Devant le spectacle de la société saxonne de cette fin du Moyen-Age, il s’est insurgé contre l’Église et les puissants, come d’autres avant lui en Europe. C’est vrai qu’il y avait de quoi tant la société était inégalitaire et les prélats beaucoup plus occupés à amasser des richesses et du pouvoir qu’à diffuser la parole de Dieu et à respecter les préceptes de l’Évangile. C’est donc de bonne foi, au nom des prophètes de la Bible et logiquement qu’il a sermonné ses fidèles, les incitant à la révolte.
Il y a été aidé par l’imprimerie qui vulgarisa ses écrits, se mit à la portée du peuple, des paysans, des ouvriers, des pauvres, traduisant la bible, disant la messe en allemand et replaçant le latin par la langue vulgaire, ce qui permet la compréhension et donc la contestation. Son appel à la révolte le fait expulser des villes où il officie, fait des émules et, paradoxalement, le transforme en chef de guerre. Mais un prêtre n’est pas un stratège militaire et il est facilement défait face aux puissants sans que Dieu pour qui pourtant il se battait ne fasse rien pour lui. Il terminera sur le gibet.
Eric Vuilllard reprend sa belle plume d’historien pour un épisode peu connu mais significatif de l’espèce humaine avec son hypocrisie, sa violence, son mysticisme, son utopie, le con servatisme face au progressisme.
-
Tristesse de la terre
- Par hervegautier
- Le 19/02/2022
- Dans Eric Vuillard
- 0 commentaire
N°1627 - Février 2022
Tristesse de la terre – Eric Vuillard – Actes sud.
Quel petit garçon de ma génération n’a pas rêvé d’incarner, le temps d’une récréation, Buffalo Bill ou un héros de bandes dessinées de cette époque vouée à la lutte cinématographique entre les cow-boys et les Indiens ou demandé une telle panoplie à ses parents? Ce personnage représentait le ranger blanc, incarnation du bien et du courage, citoyen d’un pays parfait et mythique qui luttait contre les sauvages et, bien entendu, était vainqueur. L’auteur choisit de nous révéler le vrai visage du véritable William Cody, ancien employé des chemins de fer en qualité de chasseur de bisons, d’où son surnom, puis héros de roman à quat’sous, devenu organisateur de spectacles populaires mettant en scène des Indiens que les États-Unis étaient par ailleurs en train d’exterminer sur leur propre territoire. Dans une ambiance de carton-pâte, il donne l’illusion aux spectateurs venus en masse pour assister à son Wild West show à partir de 1870, de revisiter en la falsifiant, avec la complicité temporaire de Sitting-Bull, un authentique chef de tribu et de quelques rescapés indiens ravalés au rang de figurants, l’histoire de ce massacre dans un pays qui se veut le chantre de la liberté. Tout cela n’était évidemment qu’une image de l’Ouest américain, le mythique Far West, que du grand spectacle qu’on donnera également en Europe et en Russie, que le décor de pacotille d’un triste épisode derrière lequel se cache ce mythomane devenu célèbre grâce à cette mise en scène grandiose. C’est un divertissement, une parodie qui falsifie l’Histoire, transformant sciemment la défaite américaine controversée de Little Bighorn (1876) en victoire de la cavalerie. Cela cache mal cette volonté de montrer la suprématie de l’homme blanc, sa supériorité sur les sauvages qu’il doit exterminer au nom de la civilisation. Pour les Américains, la vie n’est qu’un spectacle que rien ne peut interrompre et qui doit impérativement se poursuivre, comme le veut leur phrase emblématique « the show must go on ». Cette démarche était de nature à mettre en valeur Buffalo Bill et la recherche du profit mais répondait aussi à une demande d’exotisme de la part du public et illustrait aussi cette habitude de l’espèce humaine qui vit dans l’illusion et le mensonge permanent qu’elle choisit d’ignorer naïvement ou d’accepter par commodité.
L’auteur ajoute à un texte fort bien écrit, des photos d’époque. C’est précisément ici que tout bascule puisque derrière le grand spectacle ainsi donné aux spectateurs, qui se veut l’incarnation de la réconciliation de deux peuples, les visages fixés sur la pellicule trahissent ce qu’on voulait leur cacher. Derrière les coiffes emplumées, les stetsons et les bannières étoilées, on y lit la solitude et la résignation des indiens pour leur liberté perdue, leur humiliation de devoir rejouer leur propre destruction aux côtés de ceux qui en étaient les auteurs, la certitude des rangers d’avoir imposé l’ordre politique et militaire et d’avoir contribué à la marche du progrès, dans un pays qui se construisait sur l’élimination des indésirables.
Les temps et les goût du public changent et petit à petit on se désintéressa d’un spectacle dans lequel Buffalo Bill avait mis toute sa vie, avait joué inlassablement son propre rôle, avec lequel il avait connu un succès mondial, qui lui avait rapporté beaucoup d’argent et avait fait de lui un mythomane et un mégalomane. Dans l’indifférence générale, il redevint William Cody, pauvre et abandonné de tous, à l’image de ces indiens dont il s’était abondamment servi toute sa vie. Il avait 70 ans.
Est-ce pour souligner la relativité et la vanités des choses de ce monde que l’auteur évoque dans l’épilogue la figure de Wilson Bentley (1867-1931), le photographe des éphémères flocons de neige ?
J’avais déjà lu « L’ordre du jour » où Eric Vuillard s’était fait l’historien des débuts bluffeurs destructeurs du nazisme face aux atermoiements des démocraties et qui donneront ce qu’on sait.
-
Changer l'eau des fleurs
- Par hervegautier
- Le 13/02/2022
- Dans Valérie Perrin
- 0 commentaire
N°1626 - Février 2022
Changer l’eau des fleurs – Valérie Perrin – Albin Michel.
Violette Toussaint, après avoir été garde-barrière, a un nom plutôt prédestiné pour son nouveau métier, elle est gardienne de cimetière ! Sa maison est un peu comme un confessionnal, elle y reçoit les confidences et les larmes des vivants qui viennent ici et, même si son mari est parti vers d’autres aventures bien terrestres, elle forme une sorte de famille décalée avec l’équipe de fossoyeurs et le jeune curé de ce village bourguignon. Dans ce lieu dédié au souvenir, Violette est un peu une veilleuse qui offre généreusement aux visiteurs un café chaleureux, mais elle en est aussi le jardinier, la chroniqueuse, l’organisatrice… On y trouve des fleurs, bien sûr, mais aussi tous les chats perdus y ont leurs habitudes et sont un peu les passeurs d’un au-delà mystérieux. Dans ce lieu, elle est y apprend plus de choses que dans les livres sur l’espèce humaine, sur la mort, sur Dieu, sur l’éternité, sur l’amour conjugal, sur la fidélité et sur le souvenir, pourtant jurés à un conjoint devant son cercueil et parfois même gravés dans le marbre. Tout cela ne pèse rien face à la réalité quotidienne et le véritable culte des morts est surtout dédié aux amants et aux maîtresses disparus. Pourtant elle est seule, serviable et dévouée mais cassée définitivement par la vie, un peu comme si un destin funeste lui collait à la peau.
Tout cela aurait pu durer longtemps quand survient un policier, à la fois curieux et un peu amoureux d’elle qui est lui-même dépositaire des dernières volontés de sa mère et témoin de ses amours tumultueuses. Leur rencontre sera une parenthèse dans la vie de Violette et peut-être un nouveau cheminement vers ce bonheur qui semble lui échapper. Elle hésitera longtemps à cause de cette destinée qui la tient en marge, qui lui interdit de vivre et d’aimer pleinement. Sa vie d’avant n’a pas été belle mais elle l’a acceptée avec ses rares joies et ses peines profondes, se laissant porter par le temps en se disant sans doute que les choses pourraient s’arranger même si elle n’y croyait pas, en choisissant de ne pas réagir, en privilégiant les rares moments de paix, en continuant à vivre entre le passé et le présent, à en avoir le vertige.
J’avoue que je ne connaissais Valérie Perrin qu’à travers l’Italie où elle a été traduite et appréciée. Le roman, malgré ses 660 pages m’a paru bien court et je ne me suis pas ennuyé, bien au contraire, tant il est prenant et agréablement écrit. J’ai eu plaisir à faire la connaissance de Violette qui n’a pas vraiment connu l’amour ni même l’affection mais qui, malmenée, trahie par la vie, et surtout humiliée par ses proches qui se sont acharnés sur elle, a toujours voulu dispenser autour d’elle tout le bien qu’elle pouvait. Son histoire est émaillée d’anecdotes drôles et émouvantes, de chagrins, de regrets, de remords de trahisons et surtout d’un deuil impossible à apprivoiser, de certitudes destructrices contre lesquelles on ne peut rien. Ce que je retiens, c’est cette longue quête d’explications menée individuellement et secrètement par Violette et par son mari. Cela ressemble à une enquête un peu maladroite où se mêlent la culpabilité, la haine des gens au sein même de cette famille, les certitudes d’autant plus solides qu’elles sont infondées et le malheureux hasard. L’épilogue de cette triste histoire qui aurait pu être belle mais ne l’a pas été, favorisera la résilience de Violette et son acceptation des épreuves qu’elle a dû subir. Il reste de ces tranches de vie une impression d’impuissance, de solitude, de mal-être, de fatalité, d’injustices, d’amour impossible, un peu comme si elle voulait se laisser porter par le temps, comme si la mort qu’elle côtoie physiquement chaque jour était sa véritable compagne qui à la fois ressemble à une attente ou à un refus. Le cheminement intérieur de Violette est bouleversant entre passivité face à la fatalité et volonté de vivre selon son désir malgré sa désespérance, sa fragilité.
J’y ai lu à travers ces histoires entrecroisées dans le temps, où certains personnages vivent la vie et l’amour entre passion et abandon, une étude pertinente sur la relation entre les hommes et les femmes, sur leur vie commune ou séparée, leurs passades ou leur amour fou, la jouissance et le dégoût, l’attachement et le mépris, l’envie et la lassitude, la misère et l’espoir, le mensonge et les compromissions. C’est un peu l’image de notre vie à tous, de nos accidents de parcours, de nos deuils, de nos résignations, de nos espoirs, de nos doutes. Cela m’a incité à découvrir une autre facette du talent de cette auteure. Elle évoque une prochaine adaptation cinématographique de ce roman. J’y serai particulièrement attentif.
-
Le parfum des cendres
- Par hervegautier
- Le 27/01/2022
- Dans Marie Mangez
- 0 commentaire
N°1625 - Janvier 2022
Le parfum des cendres – Marie Mangez – Finitude.
C’est une rencontre entre Sylvain Bragonard, un embaumeur, taiseux et solitaire et Alice, une doctorante pétillante et curieuse de cette pratique professionnelle et qui veut faire de ce métier le sujet de sa thèse. Sylvain a accepté sa présence à ses côtés sans trop savoir pourquoi puisqu’il ne sait pas dire non. Avant de le rencontrer, elle a déjà pris beaucoup de notes auprès de différents thanatopracteurs. Cela a été une belle rencontre entre ces deux êtres exactement contraires, autant Alice est pleine de vie et lui qui ne vit que dans la mort et avec les morts au point d’être presque constamment en marge de la société. Il leur parle et les distingue uniquement par l’odeur qu’ils dégagent. Évidemment on pense à Jean-Baptiste Grenouille du roman de Patrick Suskin (« Le parfum ») à qui il est fait référence dans le roman et c’est d’autant plus d’actualité que le virus de la covid, non content de prendre sa moisson de vies, s’attaque, temporairement parfois, notamment à l’odorat de ses victimes.
Sauf que dans le roman de Suskin, Grenouille est un assassin. Alice en vient donc à penser, devant l’étrangeté de Sylvain qu’il pourrait bien lui cacher quelque chose ! C’est une pensée furtive et néanmoins gratuite, mais cela lui traverse l’esprit et s’y imprime durablement. Est-ce pour cela qu’elle prend son rôle tellement au sérieux, au point de lui faire prendre un cuite ou d’explorer sa vie familiale et personnelle ? En tout cas elle s’attachera à briser cette cuirasse pour révéler le secret de Sylvain qui prend lui aussi ses racines dans la mort, mais dans une mort qui lui est très personnelle.
Je suis assez peu entré dans cette histoire rédigée avec des mots simples sans fioriture littéraire.
-
D'un monde à l'autre
- Par hervegautier
- Le 25/01/2022
- Dans Georges-Léon Godeau
- 0 commentaire
N°1624 - Janvier 2022
D'un monde à l'autre – Georges-Leon Godeau – Édition Ipomée.
Depuis que je lis Georges Godeau (1921-1999) je suis étonné par l'acuité du regard qu'il porte sur le monde qui l'entoure. On a eu raison de dire de lui que son "œil écrit" et d'ajouter comme l'a précisé Georges Mounin "qu'il écrit pour tous, il peut être lu par tous". Il n'écrit en effet pas pour une élite mais s'adresse à tous ceux qui veulent bien consacrer un peu de leur temps à lire ce qu'il écrit. Chez lui pas d'ésotérisme, pas d'images ou d'idées énigmatiques qui se rattachent à une chapelle où vous plonge dans un univers abscons. Chez lui tout est transparence, quotidien, presque ordinaire si on considère que l'écriture poétique peut être ordinaire, mais ce sont ses mots qui sont empruntés au quotidien dans tout ce qu'il a de plus banal.
Son matériau, ce sont des mots simples, simplement, sobrement exprimés, économisés même, en dehors de toute prosodie classique. Ils expriment une sorte de vision furtive qui s'offre à lui et dont il choisit d’en conserver la mémoire. Dans cette recherche du souvenir, il veut graver l'émotion de l'instant, la couleur et les formes de cette image furtive, un peu comme l'a dit Victor Ségalen "Voir le monde et l'ayant vu, dire sa vision". C'est souvent le petit détail qui échappe au commun des mortels, qu'il ne peut ou ne veut pas voir (Georges Mounin parle à son sujet de celui qui voit « le non-vu », le « non-dit ») , un moment de la vie d’un quidam, la beauté d'une femme qui illumine son entourage, la transparence d'un paysage qui attirent son regard et l'invitent à jeter sur la feuille blanche l'émotion d'un instant, comme une fulgurance qui fige le temps. J'ai parfois le sentiment que derrière les gens qu'il voit et dont il nous fait partager une infime parcelle de leur vie, son regard perce d'enveloppe charnelle et, l'air de rien, lit en eux comme dans un livre, se faisant l'écho d'un sentiment supposé de leur part ou ressenti par lui de sorte qu’il en devient un peu, pour une miette de temps, l’interprète, le complice. Mais il n'est pas uniquement le spectateur passif du monde qui l'entoure, il en parle parce qu'il en fait également partie, ne se distingue en rien des autres hommes qui marchent dans les rues, la seule différence étant qu’il fait provision d’images, de fragrances et de sons qu’il tracera plus tard sur la feuille blanche, quand le temps sera venu et qu’il aura fait le vide sur tout cela. Comme il le dit lui-même dans un autre recueil « Les poèmes s’inventent au bord du monde, un pied sur la terre, l’autre dans le vide »
Ce recueil s'ouvre sur un aspect de sa démarche créatrice qu'est le voyage. Il fut en effet un grand voyageur attentif aux choses, parfois les plus inattendues, réceptif autant que possible à cet appel de l'inconnu du "coin toujours remis qu'il faut bien voir avant de mourir". Ainsi se multiplient les visions confidentielle d'une capitale connue avec ses foules et ses bruits ou du silence et de la solitude d'un modeste hameau oublié sur le cadastre du monde.
Il est aussi le poète de la nature, de ce Marais Poitevin qu’il aimait tant arpenter, cette Sèvre niortaise où il aimait tant aller pêcher . Ses recueils de poèmes, rares, ne se trouvent maintenant qu’en bibliothèque et sont bien peu souvent consultés plus de vingt années après sa mort. Poète injustement oublié, il mérite mieux qu’un discret hommage.
-
Premier sang
- Par hervegautier
- Le 22/01/2022
- Dans Amélie Nothomb
- 0 commentaire
N°1623 - Janvier 2022
Premier sang – Amélie Nothomb – Albin Michel.
Prix Renaudot 2021.
Le titre de ce roman peut susciter nombre d’explications mais on tarde un peu à comprendre qu’il évoque, non pas le duel qui doit être interrompu « au premier sang », c’est à dire lorsque l’un des deux adversaires est touché, mais cette désagréable habitude qu’à Patrick, le personnage principal, de s’évanouir « à la vue du sang frais, coulant et vivant ». C’est une sorte de rituel involontaire qui le poursuivra toute sa vie et à l’aune duquel va se dérouler une jeunesse où il va vivre ses amitiés d’adolescent, connaître ses premiers émois amoureux, les illusions et les trahisons qui vont avec.
Ce livre est un hommage à son père Patrick Nothomb (1936- 2020) diplomate belge, dont le premier poste en qualité de consul de Belgique à Stanleyville en 1964 débutera une longue carrière de représentant de son pays. Séquestré avec ses compatriotes dans l’ex Congo-belge occupé par les rebelles africains de l’ « armée populaire de libération », il profitera de ses fonctions pour servir de médiateur auprès des insurgés et tenter de sauver des vies humaines et ce malgré son aversion pour le sang qui coule. Cette épreuve à laquelle ne s’attendait pas ce jeune consul a été évoquée par lui dans un livre, « Dans Stanleyville », qui retrace cette période tragique et dont notre auteure s’est inspirée. Il y parle de ce qu’il appellera plus tard le « syndrome de Stockholm » mais je retiens surtout les remarques qu’elle lui prête face au peloton d’exécution. Ces moments qui précèdent une mort certaine ont cette dimension humaine qu’est l’acceptation de son destin sans aucune révolte : admettre que son parcours s’arrête là malgré son jeune âge, qu’on n’y peut rien, qu’on a fait ce qu’on a pu, avec toute sa bonne volonté et toute sa bonne foi mais que c’est fini et qu’on accepte son sort sans regret. Il en réchappera, permettant également à de nombreux autres prisonniers européens d’avoir la vie sauve pendant cette longue prise d’otages. Sa fille choisit cet épisode de sa vie pour imaginer que l’éminence de la mort provoque chez lui une envie d’écrire, comme pour laisser une trace de son passage sur terre.
Je reprends l’habitude de lire Amélie Nothomb, surtout à cette époque de la rentée littéraire où elle choisit de publier son traditionnel roman annuel. Jusque là je le faisais, moins par l’intérêt que suscitaient ses livres que parce que, faisant partie du paysage littéraire, il fallait l’avoir lue pour pouvoir en parler. D’ordinaire j’étais plutôt déçu et je cherchais chaque année vainement à retrouver le plaisir que j’avais eu à la lecture de son premier roman « Stupeurs et tremblements » qui évoque sa première expérience professionnelle et personnelle dans une entreprise japonaise. Ici c’est l’histoire de son père, Patrick Nothomb, ambassadeur, décédé en à 83 ans à qui elle adresse une sorte d’adieu. Ce n’est pas un hommage mélancolique comme on pourrait s’y attendre mais au contraire un témoignage solaire, humoristique même, où, s’effaçant derrière lui, elle lui donne directement la parole. Au départ, il évoque, dans les années 40, sa jeunesse d’orphelin de père entre une mère, veuve définitive et femme du monde, des grands parents maternels aristocrates et des vacances ardemment désirées, à la fois spartiates et rurales, chez un oncle, poète et chef d’une tribu d’un autre âge qui vaut son pesant d’originalité. J’avoue avoir été conquis par le récit, ce qui me fait dire qu’Amélie Nothomb n’est jamais aussi passionnante que lorsqu’elle parle d’elle ou de sa parentèle, c’est à dire qu’elle choisit le registre intimiste.
J’ai apprécié le style fluide et jubilatoire qui est le sien depuis le début et qui à l’avantage de générer une lecture agréable et, comme c’est le cas ici, émouvante.
-
Nid de vipères
- Par hervegautier
- Le 20/01/2022
- Dans Andrea Camilleri
- 0 commentaire
N°1622 - Janvier 2022
Nid de vipères – Andrea Camilleri - Fleuve Noir.
Traduit de l'italien par Serge Quadruppani.
Un matin, Barletta, un usurier affairiste doublé d’un Don Juan sans scrupule est retrouvé mort, assassiné deux fois, par le poison et par balle, comme si une mort ne suffisait pas, et apparemment donnée par deux mains différentes. Voilà bien une affaire pour le commissaire Montalbano qui trouve ainsi l’occasion de se libérer de l’obligation de signer cette satanée paperasserie qui encombre traditionnellement son bureau et ce même si son âge devrait le pousser vers la retraite, ce que ne se prive pas de lui rappeler le médecin légiste entre un plantureux repas et une partie de poker. Ça se présente plutôt mal, entre une jeune fille, Stella, dont la victime abusait sexuellement qu’il menaçait de chantage, un héritage dont Barletta semblait vouloir priver ses propres enfants et les nombreuses faillites provoquées par sa pratique de l’usure, mais l’intuition de notre commissaire, et bien entendu aussi son expérience, lui donnent à penser que cette affaire n’est pas liée à la seule vengeance et doit bien pouvoir s’expliquer par quelque chose de beaucoup plus complexe.
Pour corser le tout il reçoit la visite de Livia, son éternelle fiancée qui habite et travaille à Gênes et revient régulièrement à Vigàta... pour le plaisir de le rencontrer… et de l’engueuler. Ces deux là n’ont pas besoin de vivre ensemble, ni bien entendu de se marier, ils ont déjà tout d’un vieux couple et leur relation c’est plutôt « pas avec toi mais pas sans toi » ! Comme pour compliquer un peu les investigations et aussi la vie de Montalbano, tout cela se passe en la présence furtive d’un curieux clochard siffleur mais aussi qui se révélera providentiel à qui Lidia semble s’intéresser, lz tout sous les yeux de la très belle et très mystérieuse Giovanna, la fille de la victime, de photos compromettantes et de l’éventuelle disparition d’un testament. C’est que Montalbano est toujours égal à lui-même, pouvant difficilement résister à une femme et ici il se fera littéralement phagocyter par l’une d’elles
Son métier le met directement en situation de connaître tous les défauts et les vices de l’espèce humaine, même les moins avouables, mais le hasard veille qui viendra encore une fois bouleverser l’agencement hypocrite des choses et bouleverser les projets les mieux ficelés.
Bien entendu notre commissaire n’est pas seul à démêler l’écheveau compliqué de cette affaire. Il est aidé par ses deux compères Augello et surtout Fazio et il a un peu trop tendance à considérer ce dernier comme son larbin. Sans eux il ne serait rien.
Comme d’habitude ce fut un bon moment de lecturte.
-
Les Vilaines
- Par hervegautier
- Le 18/01/2022
- Dans Camila Sosa Villada
- 0 commentaire
N°1621 - Janvier 2022
Les vilaines – Camilla Sosa Villada - Métailié
Traduit de l'espagnol par Laura Alcoba
Dans le Parc Sarmiento de la petite ville de Cordoba (Argentine) où travaillent les trans, on vient de trouver un nourrisson. Aussitôt adopté par la communauté il sera donc arraché à une mort certaine et vivra dans ce milieu d'hommes devenus femmes. C'est l'occasion de faire connaissance avec un membres de ce groupe à la fois solidaires et agressifs dont Tante Encarna, un femme authentique et malheureuse, qui en est la figure tutélaire et une véritable mère pour elles. C'est elle qui prend cet enfant sous son aile, le défend, le protège pour qu’il conserve le plus longtemps possible sa joie de vivre dans un univers qui se veut festif mais qui est pourtant est fait de douleur et de rejet. Le but sera de l'en mettre à l’abri. C'est d'abord Camilla qui raconte sa vie quand elle s'appelait encore Cristian, un garçon efféminé qui vivait dans un petit village entre une mère soumise et un père alcoolique et violent. C'était alors un garçon qui voulait devenir une fille et en adoptait toutes les apparences, surtout en cachette de ses parents. Il était la honte de cette famille, stigmatisé par son père. Les circonstances de sa vie l'amènent à la prostitution qui lui permet une indépendance financière, une nouvelle vie par rapport à la pauvreté de ses parents et donc à plus de liberté, mais aussi qui lui fait connaître la pire facette de la société respectable de ses contemporains. Suivent une galerie de portraits plus désespérés et dévastés les uns que les autres, entre fantasmes et exubérances, tendresse et folies, des parcours d'êtres mal dans leur peau, qui aspirent à être autre chose que ce que la nature a fait d'eux, que la société en apparence honorable rejette, moque, bannit et éventuellement détruit tout en s'en servant pour assouvir des pulsions sexuelles les plus secrètes et violentes. Ceux qu'on appelle les "trans" sont cantonnés pour survivre dans la clandestinité et la solitude, dans cette frange sociale qui ressemble à un esclavage qui ne dit pas son nom. Ici plus qu'ailleurs la misère, la souffrance, le sida, l’alcool, la drogue et la mort font partie du décor, du quotidien et guettent leurs proies faciles. Cette volonté d'humiliation, c'est un peu comme si leur présence réveillait ce qu'il y a de pire dans l'être humain ordinaire, un peu comme si les trans étaient le catalyseur des refoulements et des peurs que les autres portent en eux.
J'avoue que je suis assez partagé face à ce premier livre de Camilla Sosa Villada qu'on présente comme un roman alors qu'il s'agit d'un témoignage. Il a la fougue d'une première œuvre, la volonté de dire les choses crûment, sans fard littéraire, avec des mots aussi bruts que les nombreuses anecdotes dont est fait ce livre mais cette lecture m’a paru un peu fastidieuse. Il montre une facette peu glorieuse de la société évoquée, faite surtout d’hypocrisies et de tabous mal assumés, mais qui est. Toutes choses égales par ailleurs, parfaitement transposable à la nôtre. Cette communauté qui est sans doute la plus mal connue, sert d'exutoire à la société officielle et respectable, tolérée par un morale officielle et une religion bien pensantes mais qui en profite en secret.
J'ai lu cet ouvrage jusqu'au bout à cause de sa sélection à un prix littéraire pour lequel il est en lice mais ces propos ont tissé un malaise qui met en exergue des tranches de vie partagées entre tendresse et terreur, peur et humiliation, rires et larmes, ivresse et culpabilité pour cacher, une autobiographie poignante qui bouscule l'univers ordinaire de l’écriture souvent inscrit dans l'imaginaire ou le merveilleux.
-
Lac (Roman)
- Par hervegautier
- Le 12/01/2022
- Dans Jean ECHENOZ
- 0 commentaire
N°1620 - Janvier 2022
Lac – Jean Echenoz. Les Éditions de Minuit.
D’emblée le décor est planté, une série de chiffres téléphonés, un échange sous le manteau dans l’anonymat parisien, des espions qui s’espionnent mutuellement, le décryptage d’un texte codé, un improbable colonel, des filatures échevelées, de mystérieuses disparitions, des mouches-espionnes qu’on leste d’un micro...On est en présence d’un roman d’espionnage.
Les personnages qui, au départ semblent nombreux se résument essentiellement à deux : Frank Chopin, célibataire solitaire est entomologiste au Musée d’histoire naturelle de Parais mais également agent de renseignements. Il rencontre Suzy Clair, une jeune femme qui a perdu la trace de son mari depuis six ans. Chopin est chargé de surveillé Vital Veber, un agent russe. Suit toute une série d’aventures qui se concluent comme un roman d’espionnage classique par un échange d’agents entre l’Est et l’Ouest.
Je ne suis pas un fan des romans d’espionnage, mais il me semble que dans celui-ci on est loin des classiques du genre, autant dans les personnages que dans l’intrigue, quant à l’épilogue il est des plus traditionnels. Du coup j’ai eu plutôt l’impression d’avoir lu une parodie qu’un authentique roman de ce type, mais je reconnais qu’il m’a fallu un peu de temps.
Ce que j’aime chez Etchenoz et que j’ai bien entendu retrouvé ici, c’est son humour et son style jubilatoire à souhait, sa manière si personnelle d’exprimer une idée, de préciser une description ou de faire un aparté souvent compliqué qui n’a qu’un très lointain rapport avec ce dont il nous parle. Le texte est plein de précisions techniques, riche de références qui sont parfaitement étrangères à l’histoire, de détails insignifiants mais qui, sous sa plume, non seulement ne sont pas déplacées mais en deviendraient quasiment indispensables s’ils n’étaient pas notés. Cela embrouille un peu la compréhension des choses, perturbe leur logique, mais a aussi l’avantage de tenir son lecteur en haleine qui se demande bien où l’auteur veut en venir et aussi quelle sera sa prochaine diversion. Il use à l’occasion d’un vocabulaire qualifié et même recherché et pour tout dire assez inattendu, de jeux sur les mots, voire de figures rhétoriques classiques qui valent leur pesant de dépaysement et maintiennent constante cette ambiance si particulière. Il balade ses personnages dans les rues de Paris avec la précision d’un guide touristique et ce qui pourrait être une banale description prend avec lui une dimension d’évasion. Quant au titre lui-même, « Lac », son laconisme porte en lui-même soit un message intimiste soit au contraire l’évocation de développements plus mouvementés. C’est comme on veut. En réalité il n’en est rien et ce lac ne sert que de décor comme l’est celui de l’hôtel où se situe une scène du roman. Quant à cette histoire de mouches espionnes, j’avoue bien volontiers qu’il fallait y penser, c’est aussi original qu’inattendu même si l’invention porte en elle-même sa part de hasard et d’approximation. Pour l’efficacité réelle, on n’est pas très sûr.
Ce qu’il y a de bien chez Etchenoz, c’est qu’il s’attache rapidement son lecteur et prend plaisir à le trimbaler dans une histoire qui pourrait tout aussi bien être différente de celle qu’il déroule sous ses yeux mais ne serait pas mois passionnante.
-
Envoyée spéciale
- Par hervegautier
- Le 08/01/2022
- Dans Jean ECHENOZ
- 0 commentaire
N°1619 - Janvier 2022
Envoyée spéciale – Jean Echenoz. Les Éditions de Minuit.
L'intrigue est à la fois simple et un peu loufoque. Un général au rencard, répondant au doux de Bourgeaud s'est mis dans la tête de charger une jeune femme de séduire un collaborateur de Kim Jong Un pour déstabiliser le régime du dictateur nord-Coréen. Pour cela il lui faut une jeune et jolie femme, mais pas une espionne professionnelle ; il choisit Constance pour sa naïveté,mais pas seulement, la fait enlever et séquestrer dans un coin perdu de la Creuse avant de l'envoyer à Pyongyang. Tout cela est bel est bon mais cette idée, pour être originale n'en est pas moins difficile à réaliser d'autant que les acolytes de Bourgeaud ressemblent plus à des "pieds nickelés" qu'à des agents secrets. Les épisodes du rapt et de la séquestration valent leur pesant d’absurdité entre syndrome de Stockholm et demande de rançon façon baron Empain, pour se poursuivre avec le personnage du mari, Lou Tauk, bizarrement nullement bouleversé par l'absence de sa femme. C'est que son passé "artistique" et celui de Clémence sont pour beaucoup dans le choix du général, comme le verra quelques dizaines de page plus loin le lecteur attentif. C'est qu'il faut l'être, attentif, pour suivre cette histoire un peu abracadabrantesque où les tranches de vie détaillées d'individus se succèdent sans qu'on sache très bien ce qu'ils viennent faire dans cette affaire et surtout le lien qui peut bien exister entre eux. Bref, la mission de la jeune femme en Corée peut commencer. Elle n'aura rien à envier à ce début un peu cahoteux.
Echenoz nous entraîne dans un roman d'espionnage un peu comme il l'avait fait dans "Lac", nous régale une nouvelle fois de sa faconde faite d'un verbe jubilatoire, de portraits improbables, d'un culte du détail parfois inutile et parfaitement anodin qui n'apporte rien au déroulé du récit mais qui a l'avantage de nous faire sourire de par son incongruité même. De fausses pistes en changements de noms, Echenoz égare le lecteur mais le rattrape ensuite, évoquant les situations les plus extravagantes aussi bien à Paris qu'à Pyongyang, le régalant de détails aussi improbables qu'inattendus sur la croissance des ongles d’orteils ou la vie sexuelle des poissons exotiques, bref il promène à l'envi le lecteur, témoin volontaire de ces invraisemblables tribulations. L’évocation du spectacle offert au quotidien par la Corée du Nord fourmille de détails où le décor de théâtre inspiré de l'architecture marxiste le dispute au rôle joué par des figurants à l'attitude plus loyale que spontanée. Le style et un brin compliqué mais bien dans le sens du thème, à la fois documentaire et déjanté, encombré de détails dont on se demande s'ils sont ici par un souci d'informations ou s'ils contribuent à soutenir l'attention normalement dissipée du lecteur.
J'ai pourtant lu ce roman jusqu'à la fin, à la fois friand des situations évoquées et de la façon de les faire partager et curieux de l'épilogue. Au moins ça a été un bon moment de lecture en ses périodes troublées par un virus aussi insaisissable que les gestes barrière pour le combattre sont étonnants et une campagne électorale à géométrie variable dont les sondages aussi quotidiens que contradictoires peinent à intéresser l'électeur potentiel.
-
Les choristes
- Par hervegautier
- Le 06/01/2022
- Dans Christophe Barratier
- 0 commentaire
N°1618 - Janvier 2022
Les choristes – Le journal de Clément Matthieu – Christophe Barratier.
Le lieu c’est un pensionnat perdu au fin fond de la campagne, pour élèves difficiles comme on en trouvait au sortir de la deuxième guerre, entre la maison de correction et l’internat, avec châtiments corporels, cachots, discipline quasi militaire instaurée par un directeur rétrograde et borné plus soucieux de son avancement que du bien-être de ses pensionnaires…
Un homme déjà âgé, Clément Mathieu, y débarque en qualité de simple surveillant, un pion comme on dit. Bien sûr, au début, pour l’éprouver, il ne coupe pas aux traditionnels chahuts et caricatures de sa personne de la part des élèves mais rapidement, parce qu’il a jadis donné des cours de musique et qu’il se met en tête de faire chanter les potaches dont il a la charge, et malgré la réticence de quelques uns, il transforme l’ambiance délétère au début en une atmosphère à la fois studieuse et festive qui fait évoluer petit à petit ce microcosme vers plus d’humanité. Il ne sera pas payé de retour, verra le directeur s’approprier ses mérites et sera renvoyé.
Je voudrais surtout revenir sur le film qui a été crée à partir de ce roman. Il est servi par de bons acteurs dont Gérard Jugnot est le principal. Il incarne fort bien la figure de ce pauvre pion célibataire qui a dû se faire pas mal d’illusions sur son avenir, désormais bien incertain et dont on voit très vite qu’il va être le souffre-douleurs du directeur comme des élèves. Il a raté sa vie, sentimentale comme professionnelle, il a obtenu ce poste dont sans doute personne ne voulait, mais il prend cependant son rôle très au sérieux. Il fait ce qu’il peut pour vivre et distribuer un peu de bonheur autour de lui, mais il est poursuivi par un destin implacable. Il ne sera reconnu ni pour son travail d’éducateur bénévole ni pour son talent de musicien, restera à jamais inconnu et mourra dans l’anonymat avec pour seule consolation la certitude d’avoir fait son devoir d’état. Il aura peut-être celle d’avoir fait naître une vocation, un de ses élèves dont il avait su reconnaître les dons musicaux et qu’il avait poussé dans la carrière de musicien deviendra chef d’orchestre. Il est resté célibataire parce qu’il n’avait croisé le regard d’aucune femme et celle qu’il a, un court moment, espérée dans ce rôle, s’éloignera presque naturellement de lui parce qu’il n’est rien dans cette société et que personne ne peut faire attention à lui.
C’est émouvant et on en oublierait presque la réalité. Le monde est plein de gens comme lui qui prennent leur travail et leur vie à cœur, le font avec conscience et espoir de faire avancer modestement les choses dans leur domaine, veulent rester eux-mêmes face à la flagornerie et à la volonté de réussir à tout prix de ses semblables qui ne reculent devant rien pour percer, même s’ils doivent pour cela écraser les autres... Gérard Jugnot incarne avec talent ce personnage malchanceux qui le restera toute sa vie sans qu’il y puisse rien. Il est reconnu depuis longtemps comme acteur comique et ses rôles l’ont longtemps cantonné dans ce registre. J’ai déjà fait cette remarque pour certains autres comédiens et quand il choisit le répertoire dramatique il est infiniment plus intéressant et talentueux.
-
Le collectionneur d'impostures
- Par hervegautier
- Le 03/01/2022
- Dans Frederic Rouvillois
- 0 commentaire
N°1617- Janvier 2022
Le collectionneur d’impostures – Frédéric Rouvillois – Flammarion.
Parmi tous les travers humains le mensonge est sans doute le plus usité et pour qu’il soit cru, il est recommandé à son auteur de l’imaginer énorme, à la limite de l’extravagant, tant il est vrai qu’une tromperie sophistiquée et minuscule a toutes les chances d’être découverte et bien entendu dénoncée alors que l’énormité est, en la matière, un gage de sérieux .
Le mensonge est tellement subtil qu’à la brutale définition de travestissement délibéré de la vérité, on lui préfère parfois la plus habile « contre-vérité », quand on ne l’affuble pas du qualificatif de « pieux » , ce qui lui donne une toute autre dimension. Traiter quelqu’un de menteur a quelque chose d’infamant, mais si lui préfère le terme d’affabulateur, de bonimenteur, de mystificateur, d’illusionniste... cela a davantage de chance d’être plus facilement accepté. Quant à la casuistique jésuite, elle apporte à la discussion des nuances subtiles.
Dans notre civilisation occidentale, le mensonge est régulièrement pratiqué, qu’il se décline en trahisons, adultères, hypocrisies, affabulations, mystifications, escroqueries..., la liste est longue qui traduit l’imagination humaine en cette matière. C’est une satisfaction personnelle de se dire qu’on a été assez malin pour abuser de la crédulité de son prochain, voire de ses proches, c’est même devenu une règle de vie, la marque d’une réussite sociale et financière que la justice des hommes a bien du mal à sanctionner. Quant à la religion et ses principes judeo-chrétiens, elle peine à les dénoncer au moment où ses ministres tâtent eux-mêmes des prétoires. Si on exclut tout ce qui concerne la vie privée, on ne compte plus les scandales politico-financiers qui ont éclaté justement parce que la confiance sur laquelle était basé le système est soudain venue à manquer, que les victimes ont osé parler, que le hasard s’est manifesté et qu’on n’espère surtout pas la manifestation de la Justice Immanente pour remettre les choses à leur place, elle n’existe pas ! Toutes ces impostures dont beaucoup sont historiques, laissent le témoin sans voix par l’étendue de l’imagination des faussaires mais c’est aussi oublier qu’elles ne réussissent que grâce à la naïveté des victimes. En effet l’imposture peut prendre une dimension collective surtout quand, s’agissant d’un personnage célèbre disparu, on attend son improbable retour. Il serait illusoire de les énumérer, les réunir tient de la gageure mais notre auteur, sur le mode ironique, en dresse une liste, évidemment non exhaustive mais bien réelles puisque les références sont mentionnées… C’est un regard pertinent porté sur l’espèce humaine, ça dure plus de trois cent pages et c’est édifiant!
Duper son prochain permet de se mettre en valeur ou manifeste une volonté plus ou moins consciente d’endosser une personnalité qu’on n’a pas ou une histoire qui n’est pas la sienne. Se prendre pour un autre, le plus souvent descendant d’une lignée prestigieuse, avec titres et patronymes à l’avenant, et surtout vouloir en convaincre ses contemporains pour son seul bénéfice, est devenu une chose quasi courante. On ne compte plus les tentatives le plus souvent réussies d’impostures, même si on s’aperçoit que c’est le plus souvent le fait de personnes fragiles qui pourtant on réussi grâce à l’empathie qu’elles ont suscitée, mais qui ont fini par avouer leur méfait, ont été convaincues de fraude ou sont opportunément passées de vie à trépas. Il n’empêche il y a eu dans le passé beaucoup de morts qui ont ressuscité, et également beaucoup de gens pour en attester ! (actuellement une telle manœuvre a moins de chance de réussir avec l’ADN). Que les politiques se croient obligés de s’indigner publiquement sans prendre la peine de vérifier la véracité des faits est aussi révélateur de leur volonté de faire parler d’eux, quand ils ne cèdent pas trop facilement à la paranoïa ambiante propre à une époque ! Tromper quelqu’un, surtout s’il se dit expert et plus particulièrement si l’université lui confère une aura de sérieuse honorabilité, est un jeu passionnant pour celui qui en est l’auteur. La découverte et la commercialisation de fossiles contrefaits en est l’illustration, sans compter les fausses œuvres d’art, les manuscrits authentifiés par de pseudo-spécialistes, voire la mise en cause abusive de ce qui est officiellement reconnu pour incontestable. Ici la mauvaise foi ajoutée aux manœuvres douteuses emportent souvent la conviction des plus crédules et on ne compte plus les tentatives (réussies) d’extorsions de fonds, le plus souvent aux dépens des plus pauvres à qui on fait miroiter la potentielle richesse, par l’achat de terres lointaines et évidemment fertiles. L’église catholique n’est pas en reste dans cette vaste entreprise de mystification notamment jadis avec la célébration (et la commercialisation) des morceaux de la vraie croix dont il n’est pas raisonnable de penser qu’ils ont pu être authentiques. Cette dernière institution a, en matière de témoignage de la vie du Christ, préféré une bonne fois pour toutes la Vulgate au détriment de tous les nombreux écrits apocryphes sur le sujet. En outre on n’omettra pas les tentatives de captations d’héritage par la rédaction de faux testaments ou codicilles...
Si l’imposture fait partie de l’espèce humaine il est en quelque sorte réconfortant de constater qu’elle-même sujette à contestation, « la fausse imposture prospérant elle-même sur les dénégations qu’elle suscite » ce qui est en quelque sorte un juste retour des choses.
-
La Bandera
- Par hervegautier
- Le 30/12/2021
- Dans Pierre Mac Orlan
- 0 commentaire
N°1616- Décembre 2021
La bandera – Pierre Mac Orlan. Éditions Rombaldi.
Parce qu’il a tué un homme à Rouen, Pierre Gilieth a fui la France et s’engage dans la Légion espagnole en espérant que l’uniforme et le cantonnement au Maroc le protégeront des éventuelles poursuites qu’il redoute. Il est aussi sans le sou et il pense que la solde, quoique modeste, lui permettra de ne pas mourir de faim. Lors de son engagement, il rencontre un autre français, Fernando Luca, qui est un policier à sa recherche et qui s’engage lui aussi. Sur place, les deux hommes s’amourachent d’Aïscha, une prostituée que Gilieth charge de surveiller Luca. L’opposition entre les deux hommes, affectés dans la même compagnie, est parfois violente. Lors d’un affrontement dans le Rif, Luca accepte de ne plus espionner Gilieth et de renoncer à la prime. Les deux hommes se réconcilient en une poignée de mains, Gilieth parce qu’il veut faire son devoir de légionnaire, Luca parce qu’il estime cet homme qui veut ainsi racheter l’erreur d’un moment ; et Pierre tombe, mortellement atteint. Plus tard, Luca retrouve Aïscha vieillie qui a gommé de sa mémoire jusqu’à sa passion pour cet homme.
Le style de ce roman est plus littéraire, précis et poétique dans ses descriptions que ce que j’avais noté dans « Le quai des brumes », un autre roman célèbre de cet auteur. Le quotidien du légionnaire y est évoqué depuis les exercices militaires, les gardes, l’ennui né de l’attente, jusqu’à l’ambiance des bordels arabes. Ce genre de roman qui prône la liberté et les grands espaces est révélateur de cette époque. Avec ceux d’Antoine de Saint-Exupéry, ils évoquent ces concepts mais aussi la solitude de l’homme face à la vie qui passe et parfois tue, mais aussi une sorte de fatalité qui s’attache à ses pas. Le légionnaire espagnol est « el novio de la muerte »(le fiancé de la mort), ce thème qui est le quotidien des soldats de la « Bandera »(le drapeau en espagnol, ici la « compagnie ») revient donc souvent dans ce roman avec celui de la virilité, de l’attente, de l’aventure, de la discipline, de l’abnégation, de l’obéissance aux ordres. Ce roman qui fourmille de détails sur la vie quotidienne du légionnaire a été. publié en 1931 et se déroule au Maroc espagnol où les légionnaires sont chargés de la pacification. Il met en lumière la Légion qui, à l’époque, était très en vogue non seulement à cause des guerres coloniales mais aussi était le symbole du dépaysement, du prestige de l’uniforme et d’une certaine virilité chantée notamment par Édith Piaf (« Mon légionnaire » – « Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud) »). La Légion, quand elle n’est pas un refuge pour les amoureux malheureux, est aussi le symbole d’une seconde chance pour le simple légionnaire, celle de faire carrière peut-être mais celle surtout dans l’immédiat, grâce au changement de nom, d’effacer un passé souvent douteux et de se fondre dans la masse des combattants en défendant la patrie qu’il a choisie.
Au-delà de l’histoire et du cadre il y a l’étude des caractères. Gilieth, obsédé par son meurtre tente de se racheter par une vie exemplaire de légionnaire, Luca, devenu agent d’une police où il n’a pas sa place va jusqu’à s’engager pour poursuivre Gilieth et le confondre mais la mort de ce dernier met fin à sa mission. Revenu à Madrid il redevient un pauvre hère qui vivote mais, obsédé par son camarade mort, retourne à la Légion pour s’y faire tuer, parce que la mort sera pour lui une délivrance.
Pierre Mac Orlan qui est un écrivain majeur du XX° siècle est aujourd’hui injustement oublié. Avec la lecture de cette œuvre j’ai renoué avec lui et mon plaisir de le lire a été renouvelé. Je note qu’il a largement inspiré le cinéma, ce qui a correspondu à une écriture cinématographique originale à cette époque dans le cinéma français. Il avait la fibre aventurière et ses œuvres sont largement autobiographiques mais celle-ci qui abonde en détails a sûrement dû être inspirée de l’expérience de son frère Jean qui s’engagea dans la Légion après une affaire qui aurait mal tourné.
Ce roman a été porté à l’écran par Julien Duvivier en 1935 et Jean Gabin qui incarne ici Jean Gilieth en est la vedette et Robert Le Vigan incarne Luca. Ce film a été tourné en décors naturels, c’est à dire au Maroc espagnol. J’ai lu que ce film est dédié au général Franco pour les autorisations qu’il accorda pour faciliter ce tournage. Duvivier nota également la grande connaissance du général de la culture française. Ce détail est évidemment étonnant de la part de celui qui allait devenir, quelques années plus tard, chef d’une rébellion qui ensanglantera son pays et y installera une dictature impitoyable de presque quarante ans.
-
Le quai des brumes
- Par hervegautier
- Le 27/12/2021
- Dans Pierre Mac Orlan
- 0 commentaire
N°1615- Décembre 2021
Le quai des brumes – Pierre Mac Orlan. Éditions Rombaldi.
Le roman est un peu compliqué et se déroule sur trois années. Un soir d'hiver au début du XX° siècle à Montmartre, au cabaret "le lapin agile", quatre hommes dans un café, le tenancier, puis Jean, un jeune homme pauvre et paumé, un militaire de la Coloniale qui disserte sur le cafard du soldat, déserte et après une vie civile misérable songe à se rengager dans la Légion sous un faux nom, un peintre allemand aux étranges pouvoirs de divination, et Nelly, une jeune fille, qui finit se lancer dans la prostitution. On assiste à une fusillade, à un assassinat pour une sordide histoire d’héritage... A travers Jean qu’on retrouve plus tard, on évoque la pauvreté puis la Légion étrangère, emblématique de cette époque à cause des guerres coloniales, et qui offrait une deuxième chance aux mauvais garçons qui à cette occasion changeaient de nom et ainsi disparaissaient ou à ceux qui, comme Jean, n’attendaient plus rien.
Il y a beaucoup de gens désespérés dans le roman, le déserteur qui sous un faux nom s’engage dans la Légion, un peintre qui se suicide, Nelly qui devient prostituée, Jean qui meurt. L'ambiance est assez sordide et le style brut. Ce qui ressort c'est une grande solitude des personnages avec la mort en arrière-plan.
Le roman ne ressemble que très peu au film de Marcel Carné avec Jean Gabin et Michèle Morgan. La réplique culte que tout le monde connaît (t’as d’beaux yeux tu sais) n'y figure même pas et Mac Orlan lui-même félicita le metteur en scène et Jacques Prévert, dialoguiste à la poésie désenchantée, pour l’adaptation qu'ils avaient faite de son roman. Soyons juste, si maintenant ce titre est en quelque sorte inscrit dans la mémoire collective, c'est davantage grâce au film, qui date quand même de 1938 (le roman avait été publié en 1927) et au visage des deux acteurs principaux, qu'au roman et à son auteur. Pourtant son nom résonne encore aujourd’hui entre l’inconnue et la notoriété. Marcel Carné a considérablement revisité l'intrigue, la concentrent sur la désertion du soldat, Nelly étant la seule, grâce à la prostitution dans laquelle elle s’est enfermée, à rêver un peu, parmi ces personnages marqués par la fatalité.
J'avais très envie de relire Pierre Mac Orlan (1882-1970) parce que son nom lui-même a toujours eu pour moi des relents de mystères. Il a été, de son vivant, un peu secret et de nos jours il est devenu lui-même carrément un personnage mais surtout un auteur injustement oublié. Pourtant il fait partie de ses écrivains dont le nom est régulièrement cité et qui sortent périodiquement d’un purgatoire littéraire où la mode les a enfermés. Sur son parcours, il a lui-même entretenu beaucoup de flou. Il aurait justifié l'origine de son pseudonyme - de son vrai nom Pierre Dumarchey– par l'existence d'une très improbable grand-mère écossaise. Pour accréditer cette certitude, on le voyait souvent coiffé d'un béret en tartan. Il y fut aidé par le hasard, des incendies qui, à cause des deux guerres, ont fait disparaître les registres d'état-civil (il était né à Peronne dans la Somme) et l’École normale de Rouen où il fut inscrit fut détruite par les bombardements. Il la quitta avant le terme de son cursus, la situation d'instituteur ne correspondant sans doute pas à son idéal de liberté. Apparemment il ne confessa de cette période que des souvenirs sportifs de rugby à XV! Son père lui-même brûla tous les documents personnels et familiaux. On est à peu près sûr d'une jeunesse faite d'une vie de bohème désargentée et montmartroise pendant laquelle il croisa Gaston Couté , Guillaume Apollinaire, Blaise Centrars, Roland Dorgeles... Jeune, il commit quelques écrits érotiques et les œuvres de François Villon l'éveillèrent à la poésie, il s'adonna à la peinture, à la chanson qui lui offrit quelques maigres moyens de subsistance. La guerre de 14-18 où il fut blessé marque sans doute ses débuts d'ailleurs assez discrets dans la littérature. Pour autant le jeune aventurier qu'il était est devenu un authentique écrivain au sortir de la 1° guerre mondiale grâce à la presse qui fit de lui un reporter. Il fut plus tard élu à l'Académie Goncourt, donna son nom à un Prix et son style peu conformiste et en marge des grands courants littéraires traditionnels, influença cependant beaucoup d'hommes de lettres contemporains.
-
La plus secrète mémoire des hommes
- Par hervegautier
- Le 14/12/2021
- Dans Mohamed Mbougar Sarr
- 0 commentaire
N°1613- Décembre 2021
La plus secrète mémoire des hommes – Mohamed Mbougar Sarr – Éditions Philippe Rey/Jimsaan.
Prix Goncourt 2021.
Au départ, c’est à dire en 2018, pour Diégan Latyr Faye, jeune auteur sénégalais, talentueux et ambitieux mais inconnu, il y a la rencontre à Paris avec un livre mythique paru en 1938 « Le labyrinthe de l’inhumain »de T.C. Elimane (en réalité de son nom africain Mbin Madag Diouf), un écrivain un peu mystérieux et controversé, connu pour avoir été le « Rimbaud nègre », dont le chef d’œuvre d’abord salué par la critique, déclencha un scandale à cause d’une accusation de plagiat, ce qui fit disparaître son créateur de la scène littéraire. Diegan vit à Paris en tant qu’étudiant, rencontre une foule de gens, des femmes surtout, et d’ailleurs parmi tous ceux qu’il croise, et ils sont nombreux, beaucoup veulent devenir écrivains et plus précisément écrivains de langue française.
Dans la première partie le « Journal estival » est consacrée notamment à différents commentaires sur ce roman ainsi que sur celui écrit par Diégan « L’anatomie du vide » qui n’a pas lui non plus connu un grand succès. J’avoue que je me suis un peu ennuyé à cette lecture malgré l’érudition du texte. En revanche, la partie qui traite de la vraie histoire d’Elimane, ou peut-être aussi de sa légende, racontée par Siga D. , qui est sa cousine, et aussi par d’autres personnes qui l’ont approché ou ont connu certains de ses amis, est bien plus passionnante. Chacun donne sa version mais on apprend ses ascendances, le « secret » de sa conception, le déroulé de son parcours, l’accusation de plagiat dont il a fait l’objet. C’est à mon sens là que commence véritablement le roman. La présence des femmes est dans cette œuvre des plus importantes, soit qu’elles sont sensuelles, amoureuses (elles font beaucoup l’amour) et même parfois porteuses d’une charge érotique certaine, soit qu’elles témoignent de l’itinéraire d’Elimane, mais ce qu’elles en disent épaissit en réalité le mystère autour de lui, suscitant ambiguïtés, interrogations et fantasmes. Il est l’homme d’un seul livre et sans doute quelqu’un dont St Thomas d’Aquin conseillait de se méfier. D’ailleurs la vie de tous ceux, et celles, qui l’ont approché a été bouleversée et Diégan n’y échappe pas qui, fasciné par ce livre, s’est mis dans la tête de le retrouver. Cet écrivain est d’autant plus inquiétant qu’au cours de ses investigations Diégan s’aperçoit que certains de ses lecteurs, dont la plupart étaient des lettrés, des critiques littéraires, souvent des détracteurs, se sont suicidés après avoir lu « Le labyrinthe de l’inhumain » ce qui n’est pas sans susciter des interrogations sur la responsabilité d’un écrivain sur le message qu’il délivre à ses lecteurs. Il faut se souvenir aussi qu’Elimane est l’héritier, de part ses origines, d’une culture africaine différente de la nôtre et empreinte de magie irrationnelle. Que ces suicides inexpliqués, mais qui sont peut-être de simples coïncidences, trouvent un commencement d’élucidation dans le pouvoir des mots et le désir de vengeance de l’auteur, pourquoi pas ? De là à penser que ce roman est maudit, il n’y a peut-être qu’un pas ! Je remarque néanmoins que si, parmi tous ceux qui ont lu ce livre beaucoup se sont suicidés, Diégan et Siga D . eux, sont restés en vie, peut-être pour témoigner de leur passage sur terre par l’écriture parce que c’est ce qui a des chances de survivre à l’auteur.
Cette recherche donne un voyage labyrinthique, à travers les luttes politiques, une véritable errance sur trois continents, l’Afrique, l’Europe, l’Amérique, évoquant le titre même du roman de T.C. Elimane et correspondant de la part de cet écrivain à une fuite, à la recherche de quelque chose ou de quelqu’un, peut-être de lui-même et de son destin? La quête menée par Diégan est frustrante au début puisqu’il ne rencontre que des gens qui ont connu directement ou indirectement Elimane et qu’il n’a jamais à sa disposition que des témoignages parfois contradictoires, c’est à dire qu’il ne le retrouve jamais. Cela donne un portrait assez flou mais dessiné comme on assemble les pièces d’un puzzle. En réalité Mohamed Mbougar Sarr fait de cet auteur un véritable personnage de roman, un homme mythique insaisissable et qui se dérobe sans cesse . En effet, ce texte est dédié à Yambo Ouologuem (1940-2017), un écrivain malien, bien réel celui-là, puisqu’il obtint le Prix Renaudot en 1968 pour « Le devoir de violence » mais qui fut, lui-aussi, accusé de plagiat et oublié de tous. Mohamed Mbougar Sarr s’inspira de sa vie sans pour autant la copier puisqu’il fait naître son héro au cours de la guerre de 1914, au moment où son père, un tirailleur sénégalais, meurt dans les tranchées de la Somme. Il a au moins l’intérêt d’évoquer cet auteur, c’est à dire de le faire revivre. Ce livre s’ouvre également sur une citation du poète chilien Robert Bolaňo qui donne son titre au roman de Mbougar Sarr et surtout qui évoque la vie d’une Œuvre, son parcours dans le temps et sa mort inévitable, comme meurent toutes les choses humaines.
A la fin de ce roman Diégan évoque, à travers l’écrivain congolais Musimbwa anéanti par son expérience parisienne, la mort, celle de l’Afrique, de sa culture, de ses traditions, de ses légendes, de ses mystères, qui a cédé devant la colonisation française en faisant d’Elimane à la fois le produit et l’aboutissement de cette colonisation puisqu’il a réussi à s’exprimer en français par l’écriture et qu’il souhaitait être reconnu comme un authentique écrivain, mais aussi le symbole de sa propre destruction puisqu’il n’a pas été reconnu pour ce qu’il voulait être et qu’on l’a précipité dans l’anonymat, la solitude et l’anéantissement. Finalement tout cela n’a été pour lui qu’un leurre et il estime qu’Elimane a été exclus de ce jeu, non à cause du plagiat mais parce qu’il incarnait cet espoir impossible. Il en tire des leçons pour ce peuple d’Afrique qui courre derrière l’Europe et qui évidemment connaîtra le même sort. Musimbwa ne se voit d’avenir qu’en Afrique et lance à Diégan un défi, celui de découvrir à sa manière le vrai message d’Elimane, d’être s’il le peut, un écrivain-témoin. Il revient chez lui comme le lui conseille son ami, retrouve les traces d’Elimane mort depuis un an et recueille son message. Il sera son témoin par l’écrit parce qu’il comprend enfin le sens de son livre, mais retourne à Paris parce que l’écriture est sa vie, qu’il se doit d’y obéir.
Je note la longueur de certaines phrases, parfois de plusieurs pages qui, même si elles sont fort bien écrites, ne facilitent pas la lecture. Personnellement je les préfère courtes et même si on peut y voir une référence à Marcel Proust et à Mathias Enard, il convient de remarquer que ces trois romanciers ont été couronnés par le prix Goncourt ! Cela n’empêche pas ce roman d’être fascinant tant par l’histoire qu’il déroule sous nos yeux que par le style de son auteur, par ses descriptions, par sa poésie, par son érudition et par l’intérêt qu’il suscite chez son lecteur. J’ai ressenti personnellement une impression de solitude, de déréliction et de désespérance dans ce texte, une sorte de malaise né d’une quête impossible, d’une impuissance, un peu à la manière de ce qu’on peut éprouver quand ce qu’on veut atteindre se révèle définitivement hors de notre portée et le demeurera.
Finalement Diegan achèvera sa quête mais pas exactement de la manière qu’il souhaitait et pas non plus en ayant trouvé ce qu’il recherchait, l’ombre d’Elimane n’ayant cessé de se dérober. Cet ouvrage est aussi une réflexion sur les écrivains, sur les critiques mais surtout sur la littérature, ses fondements, ses motivations, sur l’écriture et son alternative (écrire ou non, et même impossibilité d’écrire, c’est à dire exprimer vraiment ce qu’on veut dire), son importance comme des traces laissées après la mort de son auteur.
Cela dit, que le Jury Goncourt ait couronné un écrivain étranger d’expression française est toujours une excellente chose puisque cela conforte la francophonie qui est, malheureusement, bien en danger. Cela met également en lumière un romancier original et une voix africaine trop absente de notre littérature.
Je n’ai pas toujours été d’accord avec ce prestigieux prix et n’ai pas manqué de le dire dans cette chronique mais ici j‘ai plaisir à saluer ce roman.
-
Les enfants d'Ulysse
- Par hervegautier
- Le 06/12/2021
- Dans Carole Declerecq
- 0 commentaire
N°1614- Décembre 2021
Les enfants d’Ulysse – Carole Declerecq – Éditions La Trace.
Le titre évoque le voyage, mais un voyage plein de dangers. Effectivement Feriel, la sœur et Hamsa, le frère, des migrants originaires d’Afghanistan, cherchent à rejoindre Toraj, leur frère aîné installé en Autriche, malgré les autorités des pays traversés et les aléas du voyage. Ils sont pauvres et ont décidé de poursuivre seuls leur périple après le démantèlement du camp où il survivaient. Les barrières qui se dressent devant eux ne manquent pas mais ils continuent avec pour seul espoir l’Europe. Leurs pérégrinations les amènent en Grèce, dans un village inconnu, près de la maisonnette d’Elliniki, une vieille qui passe pour une sorcière jeteuse de sorts et qui survit comme elle peut avec ses chats, ses souvenirs et la vente de ses excellents gâteaux. Elle est fille de réfugiés, a, elle aussi, connu les affres de la guerre, les morts qui l’ont entourée et ce sont ses petites pâtisseries qui vont provoquer leur rencontre. Elle sera leur bonne fée dans un pays qui refuse les migrants et que l’Europe abandonne à son sort et mettra dans la confidence le jeune Milios, l’épicier-bistrot du village voisin qui vend ses gâteaux. Elle ne peut évidemment pas les garder, mais c’est grâce à elle qu’ ils rejoindront l’Autriche par l’Italie !
L’histoire de ces deux enfants migrants, avec toute l’horreur et l’intolérance qui s’attachent à cette situation a retenu mon attention mais je dois dire que j’ai été sensible au parcours d’Elliniki et à son attitude. C’est une vieille dame solitaire, elle aussi est un peu une « enfant d’Ulysse » qui a traversé la vie en en connaissant tout ce qu’elle pouvait lui apporter de mauvais. Elle s’est retirée du monde, est devenue misanthrope, au point d’habiter hors de ce bourg, c’est à dire loin de la communauté humaine. Elle aurait pu attendre la mort seule, parce qu’on est toujours seul face à la Camarde, sans se préoccuper des autres… Le hasard lui a fait rencontrer ces deux pauvres enfants traqués et affamés et elle aurait pu rejoindre l’indifférence voire la haine, elle aurait pu laisser faire les choses qui les aurait précipités dans l’errance voire dans la mort. Au contraire, elle prend prétexte de cette rencontre pour, une dernière fois peut-être et dans la discrétion, faire quelque chose pour cette partie de l’humanité abandonnée et même refoulée par le plus grand nombre, une façon comme une autre de ne pas manquer sa sortie. C’est un acte humanitaire désintéressé qui a transformé sa vie, un peu comme une renaissance.
Cette histoire du sauvetage des enfants, c’est grâce à elle qui bizarrement parle anglais, elle qui ne parle à personne et peut se faire comprendre d’eux. Et d’ailleurs ce roman est, avant tout celui des femmes, Elliniki, évidemment mais aussi Feriel qui malgré son jeune âge organise la vie des deux enfants en fuite, et aussi Irina, la compagne de Milios, qui sait prendre des initiatives et évidemment Korina, sa nièce, la fille de sa sœur Katia qu’elle n’a pas revue depuis soixante sept ans. Elle fera taire, un temps, de vieilles querelles de famille ! Ce rôle confié à des femmes, dans une société gouvernée par des hommes, m’a paru intéressant.
C’est vrai que ce livre bien écrit s’approprie un sujet bien actuel, celui des migrants. Il est également vrai qu’en de telles situations la solidarité humaine se manifeste pour sauver des vies. Je veux bien que nous soyons dans un roman, une fiction, pourtant, je n’ai pas vraiment cru à cette histoire, un peu trop idyllique, à ce « happy end », comme je n’ai pas cru non plus à se rabibochage familial un peu trop convenu après des dizaines d’années de brouille et de vieilles querelles recuites. Tout cela m’a paru un peu trop artificiel et bien loin de la réalité quotidienne où trop de gens meurent dans l’indifférence générale pour leur survie dans un monde qui ne veut pas d’eux.
-
encre sympathique
- Par hervegautier
- Le 04/12/2021
- Dans Patrick MODIANO
- 0 commentaire
N°1612- Décembre 2021
Encre sympathique – Patrick Modiano – Gallimard.
Jean Eyben, trentenaire, se remémore avoir été l’employé temporaire dans une agence de police privée, chargé de retrouver une disparue, Noëlle Lefebvre, pour qui les renseignements étaient bien minces seulement qu’elle était vendeuse de sacs dans le quartier de l’Opéra et qu’un bureau de « Poste restante » recevait son courrier. Ce travail ne lui plaisait pas du tout mais il l’a effectué dans l’espoir, un jour, de le traduire dans un roman. Au cours de ses recherches, il a croisé des gens qui l’ont connue, certains d’une grande banalité, d’autres peu recommandables, mais son enquête a tourné court et dix ans après, alors qu’il ne travaille plus dans cette agence, il se met à nouveau à la recherche de cette Noëlle Lefebvre, sollicite sa mémoire mais ses souvenirs se heurtent au vide, à des fantômes et apparemment ceux qui l’ont croisée cherchent à l’oublier. Le découragement finit par affecter sa quête tant le hasard ne l’aide guère et le passé commence à se mêler au présent, compliquant considérablement ses recherches.
Comme souvent chez Modiano, il y a des déambulations dans les rues de Paris où habitait Noëlle puis plus tard de Rome. La marche à pied, dans une ville, est souvent associée chez lui à l’écriture. Jean se sent perdu dans un labyrinthe changeant et imagine que l’agenda qui a appartenu à cette femme et qu’il a dérobé, qui se révèle pauvre en informations, recèle des annotations écrites à l’encre sympathique, cette encre transparente qui ne se révèle qu’en présence de certaines substances. Autant dire que les trous de mémoire qui sont incontournables dans une telle recherche ont probablement leur explication écrite quelque part avec cette substance. Dans le texte, le passage du « Je » au « il » peut ainsi matérialiser cette évolution. Le terme « sympathique » peut parfaitement être entendu dans son sens le plus commun, ces investigations faisant naître une certaine impression d’attachement à la personne de Noëlle.
Les détails ainsi glanés au fil du temps, qui souvent débouchent sur le néant, s’emboîtent soudain comme les pièces d’un puzzle mais lui en révéleront autant sur lui-même que sur cette femme.
On peut se demander pourquoi Jean, dix ans après, cherche à mener à bien cette recherche d’une femme qu’il n’a vue que sur une mauvaise photo et qui ne lui est rien. La solitude qui est la sienne peut sans doute expliquer cette longue quête qui ainsi donne un sens à sa vie. Il y a du fantasme dans cette recherche, cette espérance un peu folle de découvrir, derrière les annotations visibles de ce carnet, d’autres, secrètes, qui ne seraient seulement lisibles que par un initié. Il y a sans doute une volonté de suspendre le temps dans sa démarche, d’annihiler les années passées qui, personnellement, me donnent le vertige quand je me les remémore. Elle peut certes, surtout pour Eyben-Modiano, trouver son explication dans la volonté d’en tirer un roman, parce que, dans toute chose, il y a pour l’écrivain matière à l’écriture et que pour lui, même s’il ne l’avoue pas, la page blanche reste une invitation mais aussi un défi, une obsession même, avec tout son pesant de nostalgie. Il est vrai que c’est souvent la trame de ses créations qui parfois, par le biais de l’imagination, peuvent se prolonger au-delà de la dernière phrase d’un roman et ainsi déboucher sur le début d’une autre histoire. Il suffit pour cela de se laisser porter par le halo ainsi tissé par l’auteur. La dernière phrase du roman « Elle lui expliquerait tout »peut contenir en elle tout ce qu’il faut pour un nouveau voyage.
-
Les fruits tombent des arbres
- Par hervegautier
- Le 01/12/2021
- Dans Florent Oiseau
- 0 commentaire
N°1611- Décembre 2021
Les fruits tombent des arbres – Florent Oiseau- Allary Editions.
Paris à la période de Noël, près d’un arrêt de bus, un homme meurt subitement, c’est l’occasion pour Pierre, le narrateur, la cinquantaine, divorcé, vaguement écrivain et surtout solitaire, de se livrer à des réflexions sur la brièveté de la vie, sur son caractère transitoire, sur la soudaineté de la mort… C’était un de ses voisins, Jean-Luc, un inconnu comme le sont tous les voisins de palier dans les grandes villes. Puis viennent les réflexions sur le réveillon solitaire et la conversation avec des prostituées....
C’est aussi une déambulation dans les rues de la capitale et sur la ligne dans ce bus n°69, un compte rendu de tous les gens qu’il croise, ce qui inspire à Pierre des souvenirs personnels. Il participe d’une manière originale aux obsèques du mort de l’aubette, rencontre une jeune fille qui accompagne sa marche solitaire dans la nuit. Elle aussi écrit des livres et rencontre des hommes comme lui et il deviendra peut-être un personnage de son prochain roman. Lui-même prend conscience qu’il devient de plus en plus misanthrope, fantasme beaucoup sur son travail d’écrivain, collationne les petits détails de sa vie au quotidien et repense à son ex-femme qu’il aime encore.
C’est écrit avec une jubilation certaine et l’auteur manie fort bien l’aphorisme et les bons mots, ce qui m’a bien plu. Il décrit les situations avec un luxe de détails mais aussi avec une distanciation qui ne m’a finalement pas étonné.
Le livre refermé, il me reste une drôle d’impression, pas mauvaise d’ailleurs malgré l’apparente légèreté du texte, peut-être celle de m’être laissé embarqué dans un roman qui se voulait drôle par les descriptions et autres maximes définitives mais ne l’était pas tant que cela. Il y avait bien ces pérégrinations dans Paris, cette fille qui écrit des romans, cette ligne de bus et son aubette, la vie de Pierre en pointillés, mais le plus important sans doute, derrière la mise en scène des obsèques vélocipédiques de Jean-Luc, c’est la vie de ce dernier avec son épouse et le secret qu’il tisse autour de lui, les fantasmes de cette femme. A l’enterrement, elle donne hypocritement tous les signes du deuil puis plus tard du souvenir entretenu, mais se dépêche, le caveau à peine refermé, de changer de vie et de profiter du temps qui fuit. Ce sont ces années qu’on peut passer dans l’intimé de quelqu’un sans se douter de ce qu’il vous cache parce qu’il le fait naturellement, qu’on lui fait confiance ou qu’on s’attache à de fausses idées à son sujet. C’est la certitude qu’au sein même du couple où on est censé tout se dire, demeurent des secrets inavouables qui détruisent petits à petit une union parce que un doute un jour s’y est insinué. Le mensonge dans lequel on s’installe le dispute aux idées fausses qui s’incrustent et qu’on entretient. Il est aussi question de fidélité au-delà de la mort, un sorte de devoir de mémoire ou quelque chose qui ressemble à de l’amour pour un être disparu et la mise en scène qu’on se croit obligé d’assurer mais au-delà de tout cela il m’a semblé sentir une certaine lassitude de vivre, combattue sans conviction à coup de canettes de bière, de cigarettes ou de verres de lait glacé, et surtout une grande solitude, une volonté de vivre au jour le jour une existence sans grand intérêt.
-
Chevreuse
- Par hervegautier
- Le 28/11/2021
- Dans Patrick MODIANO
- 0 commentaire
N°1610- Novembre 2021
Chevreuse – Patrick Modiano – Gallimard.
Jean Bosmans esrt un romancier qui collationne des objets précis pour l’aider à écrire (il doit bien y avoir une parenté entre l’auteur et lui) et cette quête l’amène sur les traces de sa propre vie. Il va faire des rencontres, retrouver des lieux, des sensations, des noms, des souvenirs et créer un personnage, c’est en tout cas ce qu’il dit autour de lui. Avec une vieille carte d’état-major, il revient dans la vallée de Chevreuse où il a passé quelques années, dans une rue et une maison en particulier (38 rue du docteur Kursenne), croise des visages qui ont vieilli, vole au hasard un agenda, des photos jaunies et retisse une histoire qui ressemble à la sienne. Cette maison est énigmatique et tout se met à tourner autour d’elle et d’un secret qu’elle détiendrait. Les gens qu’il va croiser ne le sont pas moins, des femmes, Camille (dite tête de mort), Kim, Martine, l’image un peu flétrie de Rose-Marie Krawell, un enfant, des hommes, enfuis ou ayant fait de la prison, tous enveloppés d’un halo de mystère et peut-être aussi désireux de lui faire du mal, peut-être pour lui faire avouer quelque chose qu’il ne veut ou ne peut pas dire. A sa demande ils répondent à ses questions mais semblent ne pas dire tout ce qu’ils savent comme s‘il était important de lui cacher des choses, de brouiller les pistes. On se croirait presque sur une scène de théâtre où les personnages joueraient un rôle inquiétant, entre réalité et virtualité, comme dans un mauvais rêve. A l’occasion de cette quête, Jean Bosmans va à la rencontre de ses souvenirs, de ses obsessions, évoque ses fantômes, son parcours personnel, dans les limbes de la mémoire, tout en se méfiant des images qui lui reviennent, gommées par le temps, usées par l’amnésie, modifiées par le contour des choses et de leurs frontières. Il est un peu comme perdu dans ces réminiscences qui l’assaillent, s’imposent à lui sans qu’il le veuille et lui font revivre ces années passées avec leurs ruptures, leurs disparus, morts ou partis, leurs échecs… Il interroge sur tout ce qu’il voit, obtient des réponses évasives parce qu’elles ont trait au passé et finalement tout cela lui donne le vertige à cause du temps qu’il peine à remonter. Au fil des rencontres et des questions posées, il s’aperçoit que ceux qu’il questionne en savent plus que lui mais ne lui parlent qu’avec parcimonie. Devant leur mutisme il imagine même ce qu’ils pourraient lui dire, mais ce ne sont pas de vraies réponses, juste celles qu’il voudrait entendre. C’est pourtant lui qui est censé être détenteur de secrets, un peu comme si sa vie était composée de nombreux autres enfouis dans l’oubli.
C’est un récit labyrinthique, dynamique aussi en ce sens que Bosmans circule entre Paris et Chevreuse à la recherche de lui-même, plein de nostalgie aussi, une sorte de puzzle dont les pièces s’emboîtent petit à petit au rythme de la mémoire retrouvée et des protagonistes de ce récit. Chacun apporte quelque chose qui pour lui suscite un souvenir ou une interrogation. Cela distille un certain malaise, né d’une menace, sans doute parce que ce qu’il peut découvrir peut aussi déranger une ordonnance secrète tissée autours de ces choses passées, une menace sourde. L’épilogue est surprenant mais aussi presque prévisible, le livre qu’il portait en lui et qu’il a enfin terminé, correspond à une libération, comme si les mots tracées sur la page blanche avaient un fonction cathartique. Ils l’ont délivré de ses obsessions, de ses craintes, comme on tourne une page. J’ai ressenti une impression de vide à l’image de cet hôtel un peu délabré et abandonné de la vallée de Chevreuse appartenant au mari de Martine.
C’est le dernier roman de Patrick Modiano paru en septembre. Comme à chaque fois il revisite sa mémoire et à la lecture de ce texte j’ai toujours à l’esprit ce vers de Verlaine « Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire, elle est discrète, elle est légère, un frisson d’eau sur de la mousse ». Ses mots sont une musique mélancolique et leur lecture est pour moi apaisante. A titre personnel, il se produit, à chaque fois que je lis un de ses romans, toujours le même phénomène. Ses souvenirs personnels ainsi égrenés invitent les miens à prendre corps dans ma tête et avec eux vient cette envie de les coucher sur le papier pour mieux les fixer et faire échec à l’oubli ou peut-être transformer les choses néfastes par le miracle de l’imagination. Nous verrons !
Ma lecture est passionnée et attentive, mais quand je referme le livre j’ai l’impression que tout se brouille et qu’il ne reste rien qu’une impression fugace, des bribes d’émotions, mêlées à de la tristesse et de la solitude qui peu à peu se dissipent, comme si les mots ne laissaient derrière eux que peu ou pas d’empreinte et qu’il m’était difficile de parler de ce que je viens de lire.
-
Bel abîme
- Par hervegautier
- Le 23/11/2021
- Dans Yamen Manai
- 0 commentaire
N°1609- Novembre 2021
Bel abîme – Yamen Manai - Elysad.
Le narrateur n’a pas de prénom. De lui nous ne saurons qu’il n’a que quinze ans, que c’est un délinquant emprisonné à Tunis où il a grandi et qui, avant de passer en jugement, s’adresse au psychiatre chargé de l’examiner et à son avocat commis d’office dont il sait qu’ils ne feront rien pour lui. Il est musulman mais pas islamiste, pas terroriste non plus, comme on l’a craint pendant un temps, déteste les groupes, sa famille qui le rejette, pour la laquelle il n’est rien et qui ne le soutient pas, les gens à l’extérieur, mais refuse de confier sa vie à un passeur comme l’ont fait tant d’autres dans l’espoir d’une vie meilleure. Il appartient pourtant à une famille respectable et respectée, dont le père universitaire et l’autre fils sont violents avec lui et dont la mère est, sinon complice, à tout le moins passive. Il n’est en effet meilleur bourreau que les nôtres qui connaissent nos fêlures et savent où nous frapper. Son histoire est celle de ceux qui sont nés sous une mauvaise étoile, les malchanceux, celle de tous les malheureux oubliés par les leurs dont on ne soupçonne pas la situation de souffrance intime et qui tentent de vivre malgré des pulsions suicidaires et les envies de fuite. Il est de ces gens à qui la vie n’a pas fait de cadeaux, qui a trahi ses rêves et qui n’acceptent pas cette situation. A cause de ce contexte, il nourrit de la rancune contre sa famille mais aussi contre la société qui l’entoure, qu’il juge agressive et hypocrite et en conçoit une sourde révolte. De nos jours cette situation de refus s’accompagne d’ordinaire, dans la communauté maghrébine, d’une référence à Dieu, mais pour ce jeune homme ce n’est pas le cas et il ne croit à aucune divinité ni aux vaines promesses de la religion dont il ne respecte pas les interdits. Ce climat délétère est lourd à porter pour lui. Pourtant il aime lire et les livres sont son ultime consolation, et surtout il aime aussi Bella, une chienne débarquée dans sa vie par hasard et dont il s’occupe avec attention. Elle est devenue sa raison de s’accrocher à cette vie que pourtant il hait. Au fil des pages son amertume, la pertinence de ces propos, sa situation au sein de cette famille qui ne fait aucun effort pour le comprendre et le sort qui est fait à cette pauvre chienne tissent autour de lui un climat d’empathie. Il fait même figure du justicier en révolte contre les institutions et que le peuple protège même si on comprend également la position officielle du gouvernement dans la lutte contre la rage. Pourtant c’est une rage d’une autre nature qui le fait devenir ce délinquant qui désespère même de son propre pays à la dérive. Il ne fait aucun doute qu’il devra payer son attitude incompréhensible pour les autorités et inadmissible pour la justice, mais la sanction pénale ne sera jamais aussi lourde que la peine qu’il ressent pour Bella. Lui ne sera même pas hypocrite pour faire alléger sa punition et on imagine le désarroi de l’avocat et du psychiatre face à sa détermination.
Il est beaucoup question de mains dans ce long monologue, celles qui le frappent, celles qui lui donnent de l’argent pour qu’il s’éclipse, celles qui écrivent les textes officiels qui ont force de loi, celles qui caressent Bella, celles qui tiennent le fusil, enfin celles sur lesquelles il tire...
Le livre refermé, malgré une écriture brute, je ressens de la compassion pour ce jeune homme abandonné de tous, et d’abord de sa famille, qui s’éveille au monde et qui en conçoit un rejet. Je comprends toute l’importance d’un animal pour un enfant ainsi délaissé et sa révolte qui traduit une immense solitude.
-
Un été ardent
- Par hervegautier
- Le 20/11/2021
- Dans Andrea Camilleri
- 0 commentaire
N°1608- Novembre 2021
Un été ardent– Andrea Camilleri – Fleuve noir.
Traduit de l'italien par Serge Quadruppani et Maruzza Loria.
Il fait chaud, très chaud pendent cet été Sicilien. Alors qu’il était chez des amis qui venaient de louer une maison de vacances, Salvo Montalbano tombe par hasard, en recherchant l’enfant du couple, sur le cadavre caché d’une jeune fille morte quelques années auparavant. Comme il est malin, il va tout faire pour impliquer le constructeur de cet immeuble qui s’avère avoir été construit hors la loi, ce qui est malgré tout ici monnaie courante. Il s’implique tellement dans cette affaire qu’il en découvre une autre, un meurtre camouflé en accident du travail, qui n’a apparemment rien à voir mais qui sera traitée avec la même fougue. Ces deux enquêtes s’orientent vers le promoteur immobilier Spitaleri, prédateur sexuel mais aussi notable qui se sait protégé et qui a produit un solide alibi. Il est officier de police mais, quand il s’agit d’obtenir des renseignements il a allègrement tendance à l’oublier et à carrément agir comme un voyou. Il est même assez chanceux dans sa pratique du mensonge puisque, à la suite d’une intuition inattendue, il invente une sœur jumelle à la première victime qui se révèle effectivement dans la personne de la ravissante Adriana.
Montalbano enquête donc dans la touffeur hallucinante de ce mois d’août, non sans tomber sous le charme de cette jeune sœur aussi bluffeuse que lui, tout en tentant cependant de garder la tête froide. Il est aidé en cela par le whisky, la bonne nourriture italienne et les bains de mer mais aussi par. son fidèle Fazio, mais il finira par douter de lui, de la justice, de l’homme, ressentir une nouvelle fois de la culpabilité et surtout s’apercevoir qu’il a vieilli, bref un homme perturbé et cependant bien seul, finalement manipulé, et qui conclut d’une manière assez inattendue ces deux affaires, mais en toute conscience de ce qu’il est devenu.
J’ai retrouvé avec le même plaisir ici tous les ingrédients siciliens de ses traditionnelles affaires, la collusion entre la mafia et le pouvoir politique, le blanchiment de l’argent sale, la hiérarchie tatillonne, les hésitations du commissaire, son épicurisme et ses difficultés sentimentales avec son éternelle Livia.
-
Noli me tangere
- Par hervegautier
- Le 18/11/2021
- Dans Andrea Camilleri
- 0 commentaire
N°1607- Novembre 2021
Noli me tangere (Ne me touche pas) – Andrea Camilleri – Métailié.
Traduit de l'italien par Serge Quadruppani.
Ce titre en forme d’interdit exprimé en latin, c’est à la fois le nom d’une fresque de Fra Angelico, une phrase, évoquée dans l’Évangile, que dit le Christ à Marie-Madeleine pour lui signifier que, ressuscité, il n’appartient plus au monde des vivants et va donc lui échapper, c’est aussi le nom d’une fleur, la balsamine des bois, ou impatience, qui réagit au toucher en projetant ses graines.
Nous sommes en juin 2010 et la jeune et jolie Laura Garaudo, l’épouse du célèbre et vieux romancier Mattia Todini a disparu mystérieusement après une des périodes coutumières de déprime. Toutes les pistes sont envisagées, depuis une fugue amoureuse, un enlèvement crapuleux, jusqu’à un coup de pub pour la sortie de son prochain premier roman. Pas simple pour le très subtil et cultivé commissaire Maurizi (ce qui n’est pas le cas de son supérieur hiérarchique) même s’il peut compter sur la collaboration de Todini qui ne se fait guère d’illusions sur sa jeune épouse. Ainsi, au fil des pages on apprend qu’elle est toujours et malgré son mariage une séductrice itinérante, une froide calculatrice, une menteuse invétérée, bref une femme à la personnalité complexe et qui pendant ses études non seulement elle a analysé les œuvres de Fra Angelico mais elle portait le surnom évoquant cette fleur tant elle était belle. De plus ses amants actuels ou passés se se gênent pas pour médire d’elle, tant ils ont été considérés par elle comme de simples moments de distraction.
Entre lettre anonyme, mise en scène macabre, rideaux de fumée, découvertes inquiétantes, le mystère s’épaissit et l’enquête s’embourbe. Pourtant ce n’est pas vraiment un roman policier qui nous est proposé ici, malgré la présence d’une enquête souvent évoquée. C’est bien plutôt une étude passionnante de personnages. Laissons de côté les amants délaissés et médisants, atteints dans leur virilité autant que dans leur charme autoproclamé, ainsi que le questeur, un rustre sans doute à ce poste au terme de nombreuses flagorneries. Le notaire, le psychiatre et l’amie d’enfance se penchent avec compréhension sur le cas de Laura et son vieux mari, amoureux et d’autant plus compréhensif qu’il craint de perdre cette femme jeune et jolie qui est pour lui plus qu’une épouse. Reste le cas de Laura qui pourrait passer dans un premier temps comme l’archétype de la jeune femme volage qui a épousé un homme vieux, riche et influent pour en tirer avantage tout en conservant son entière liberté (les allusions au « toucher » des deux personnages de la fresque de Fra Angelico sont révélatrices de la recherche à la fois sexuelle, passionnée et désespérée menée par Laura qui ne trouve même pas une consolation dans l’exorcisme de l’écriture puisqu’elle brûle son roman). C’est sans doute un peu vrai mais je l’ai surtout ressentie comme le symbole de la solitude et du mal de vivre qu’elle cherche d’ailleurs vainement à combattre avec la foule de ses amants et la recherche d’un plaisir éphémère. Le tourbillon de la vie et son vernis ne lui suffisent plus. Sa rencontre avec Wilson est déterminante dans la mesure où elle fonctionne comme un déclic, la révélation d’une vérité qu’elle portait en elle depuis longtemps sans le savoir. Dès lors, celle qui avait coché toutes les cases de la réussite (financière, sociétale, sociale…) choisit de ne plus en cocher aucune et de se consacrer aux plus démunis, et ce dans l’humilité de l’anonymat quoiqu’il puisse lui en coûter et quoiqu’il puisse lui arriver. Notre société moderne qui met en avant la fortune et la notoriété ne peut cependant ignorer les rares personnages qui, malgré une carrière toute tracée, ont choisi une autre voie plus humble.
Le roman est construit à partir de messages et d’entrevues nombreuses qui dessinent la personnalité aussi fascinante que déroutante de Laura, des confettis d’informations savamment distillés et qui tiennent en haleine le lecteur jusqu’à la fin.
Camilleri ne s’est pas contenté d’être metteur en scène de théâtre, scénariste et auteur talentueux de romans policiers lus et traduits dans le monde entier, il se révèle ici, s’appropriant une authentique histoire de vie, être un exceptionnel auteur de roman psychologique.
-
Maruzza Musumeci
- Par hervegautier
- Le 17/11/2021
- Dans Andrea Camilleri
- 0 commentaire
N°1606- Novembre 2021
Maruzza Musumeci – Andrea Camilleri – Fayard.
Traduit de l'italien par Dominique Vittoz.
C'est une histoire bien banale au départ : en cette fin du XIX° siècle en Italie beaucoup d’ habitants pauvres s’embarquaient pour l’Amérique dans l’espoir d’y faire fortune. Ainsi Gnazio Manisco, jeune Sicilien miséreux d’à peine vingt ans, part pour cette grande aventure qui lui fait, à New York, croiser l’incontournable mafia. Cela durera trente ans. Il doit être né sous une bonne étoile puisque, selon ses vœux, il revient au pays avec un pécule qui lui permet de s’y installer. Nous sommes en 1895. Cela aurait pu être une biographie comme le chapitre final de ce court roman le laisse penser. Sauf que, entre le début et la fin, l’auteur distille un conte qui, et toutes choses égales par ailleurs, m’a fait un peu penser à la légende de la fée Mélusine, même si l’aventure est un peu différente. Il s’approprie en l’enrichissant, un histoire entendue dans son enfance et y entrelace son imagination géniale. Il y mêle le merveilleux d’une histoire d’amour entre un humain et une créature mystérieuse venue de la mer, leur descendance sera à la mesure de de cette création fantastique et sans doute aussi un peu fantasmatique, entre les étoiles et les vagues. Il intègre le merveilleux de la fiction à la réalité, introduisant la figure de Walter Gropius, architecte allemand fondateur du « bauhaus », la cruauté de la guerre, la violence et la bêtise du fascisme. Nous sommes tous mortels mais sous la plume de Camilleri la mort n’est pas triste, c’est un simple passage vers l’inconnu et d’ailleurs nous ne sommes que les simple usufruitiers de notre vie, rien de plus, quant à ce qu’il y a après, c’est du domaine de la croyance personnelle. Camilleri nous ayant quittés récemment, j’ai plaisir à imaginer qu’il est quelque part en Sicile, et sûrement du côté de Vigàta, peut-être sur les épaules d’un vent de mer ou dans l’ombre d’un olivier comme Gnazio…
C’est aussi un hymne à la beauté féminine puisque ce texte parle abondamment de Maruzza, sa merveilleuse épouse, et de son comportement à la fois énigmatique et émouvant, de l’amour qu’elle inspira à cet homme simple, attachant et déjà vieux dont elle transforma la vie. Je ne sais pas Dieu existe mais ce qu’il a fait de plus beau dans Sa Création ce sont assurément les femmes et les artistes sont heureusement là pour nous le rappeler.
Camilleri n’a pas seulement donné vie au célèbre Commissaire Montalbano, Dans ce roman, entre conte fantastique et récit romantique, il se révèle un extraordinaire conteur qui nous embarque avec lui, à grâce à son style sensuel, magique, grâce à une une langue aux mots inconnus mais joliment traduits et qui nous parle, dans un voyage intemporel.
-
Meurtre à Cape Cod
- Par hervegautier
- Le 14/11/2021
- Dans Mary Higgins Clark
- 0 commentaire
Meurtre à Cape Cod – Mary Higgin Clark – Albin Michel.
Traduit de l'américain par Anne Damour.
C'est un ensemble de huit nouvelles dont l'une d'elles donne son titre au recueil. Willy et Elvira forment un couple d'Américains moyens qui a eu la chance de gagner à la loterie nationale et qui maintenant fréquente la haute société. Ils sont cependant restés très simples et attentifs à leur prochain ce qui fait d'eux les heros de ces courtes aventures policières. Ce sont là des valeurs chrétiennes d'entr'aide qui se retrouvent dans l'écriture de Mary Higgins Clark (1927-2020) qui était une fervente catholique. Son oeuvre est également marquée par l'illustration de thèmes révélateurs de l'espèce humaine dans ce qu'elle a de moins attachant tels que la trahison, les rivalités familiales et amoureuses, la cupidité...L'auteure qui avait eu une autre vie avant d'entrer en littérature publia notamment une biographie romancée de Georges Washington qui ne connut pas le succès espéré. A partir de 1975, elle s'essaya au roman policier avec "La maison du guet" qui devint très vite un best-seller. et de nombreux autres romans suivirent, couronnés par des prix prestigieux, ce qui lui valut d'être reconnue comme "la reine du suspens" et connut un succès mondial .
Ce recueil est notamment marqué par la dernière nouvelle intitulée "La mort porte un masque de beauté" où il est question de la mort bien mytérieuse d'un top modèle et où le suspens est distillé par petites touches et maintient le lecteur en haleine jusqu'à la fin.
Je continue à explorer la culture nord-américaine à travers le cinéma, la litterature, la peinture...
-
Deux femmes et un jardin
- Par hervegautier
- Le 11/11/2021
- Dans Anne Guglielmetti
- 0 commentaire
N°1604 - Novembre 2021
Deux femmes et un jardin – Anne Guglielmetti – Éditions Interférences
Ces deux femmes c’est d’abord Mariette, une femme âgée, sans histoire, qui a passé sa vie à faire des ménages à Paris et qui hérite, par les hasards de la généalogie, d’une « bicoque » au fin fond de la Normandie et décide de s’y installer, une manière de changer de vie, de sortir de sa routine. Ce qu’elle découvre va d’abord l’étonner puis la séduire au point d’abandonner sans préavis son travail parisien et sa chambre sous les toits. Elle est seule dans ce paysage désolé, venteux et pluvieux, mais elle est pour la première foi chez elle, propriétaire de cette maison, avec un jardin. C’est aussi Louise, quatorze ans, en vacances scolaires, qui grandit dans un milieu familial hostile et se lie d’amitié avec elle, deux solitudes en exil qui s’observent, s’apprivoisent et finissent par focaliser leur centre d’intérêt commun sur le jardin. L’une achèvera seule son long chemin de vie quand l’autre verra la sienne transformée par ce lieu improbable que la chance a mis sur leur route.
J’ai apprécié le style subtilement poétique et d’une légèreté qui vous fait tourner les pages en aspirant à connaître la suite de l’histoire. Il est beaucoup question de hasard dans ce court roman et je tiens pour évident que, heureux ou malheureux, il joue dans nos vies un rôle bien plus grand que nous l’imaginons ou que nous voulons bien l’avouer, tant il est de bon ton d’affirmer que la volonté individuelle est la maîtresse du jeu. Hasards des rencontres, des départs, des retrouvailles, ou simplement cycle de la vie avec destin et liberté ? Il est aussi beaucoup question de nature, loin d’internet et de la société de consommation qui font maintenant partie du quotidien. Je l’ai lu comme une sorte de relais passé entre deux êtres au moyen de cette maison, Mariette en fin de vie et Louise au début de la sienne, une sorte de fable, une forme de rituel de passage...
-
Mon mari
- Par hervegautier
- Le 08/11/2021
- Dans Maud Ventura
- 0 commentaire
N°1603 – Novembre 2021
Mon mari - Maud Ventura – L’iconoclaste
Le seul titre de ce roman m’a donné à penser, avant même de l’ouvrir, qu’il allait être amplement question d’un homme dont l’histoire, sous la plume de son épouse, menaçait d’être obsessionnelle. Certes il est question de lui, même s’il n’a même pas de prénom (qui selon elle est assez courant dans le monde ango-saxon) ni de nom, mais il est surtout question d’elle. De lui, cadre supérieur, dévoué à son métier et à sa famille nous ne saurons presque rien sinon qu’il aime follement sa femme et le lui prouve au quotidien par de petites attentions. L’auteure ne nous donne de lui que des informations parcellaires : c’est un être idéalisé, mais elle dénonce d’une manière infantile ses petits manquements insignifiants mais qui deviennent obsessionnels au point de devenir à ses yeux des fautes graves. Elle s’érige en victime, s’octroie le droit de sanctionner, avec le choix de la peine qui peut aller de la rupture au divorce et même à la velléité de meurtre, ce qui est une drôle de manière de prouver son amour à un homme. Parce qu’elle le proclame elle-même, elle est très amoureuse de son mari. D’elle en revanche, professeur d’anglais et traductrice, nous aurons une image assez fidèle, plus attentive à son métier et à ses élèves qu’à ses propres enfants, superficielle et exigeante. Elle le fait d’ailleurs avec une certaine sincérité, comme un sorte de confession qu’on fait pour en obtenir peut-être une forme de contrition ou mieux pour une rédemption, allez savoir !
Sa vie à elle est parfaite et elle a tout ce qu’une femme peut désirer après quinze ans de vie commune et souhaite que cela dure ainsi longtemps. Ensemble ils font l’amour régulièrement, avec lui elle a eu deux enfants qu’elle ne souhaitait pas, plus par convenance que par amour et je la sens dépourvue d’instinct maternel. Pour son mari, elle accorde de l’importance au plus petit détail allant jusqu’à sa volonté de ressemblance avec certaines vedettes féminines sans doute dans le but d’entretenir le phénomène de la séduction. Certains pourraient y voir une forme de futilité pour une femme de la quarantaine. Pourquoi pas ? J’avoue avoir été agacé par cette femme, par son côté envieux et même curieux, un peu imbue de sa personne, par son égoïsme, sa jalousie, sa suffisance, par sa posture de « nouveau riche » qui se pose en modèle, fait des efforts pour tenir son rang et met en œuvre à l’occasion tous les codes traditionnels de la bourgeoisie à laquelle elle a accédé grâce à l’argent et la situation sociale de son mari, qui lui, reste naturel. Elle est persuadée que tout lui est dû et que tout lui est permis. Souvent ce vernis de respectabilité craque et elle se pose en victime, se transforme en censeur attentif au fautes bien vénielles de cet homme à son égard, se laisse aller à de petites mesquineries intimes mais révélatrices, se révèle être une pinailleuse maladive s’attachant exagérément à de petits détails anodins qu’elle interprète comme des preuves d’infidélités de cet homme, simplement parce qu’ils ne correspondent pas à sa manière de voir les choses et les note sur un petit carnet secret. Cet homme l’aime vraiment d’un amour simple et authentique, le même que celui qu’il porte à leurs enfants. Elle craint qu’il cesse un jour de l’aimer parce que l’amour est comme toutes les choses humaines, il s’use et elle projette sur lui les craintes qu’elle a à son propre propos. Elle attend de lui beaucoup d’amour, estime qu’il ne lui en donne pas assez alors qu’elle, et bien qu’elle s’en défende, ne l’aime pas autant qu’elle le devrait. Les démangeaisons dont elle souffre sont sans doute le signe qu’elle manque de quelque chose et c’est sans doute pour cela qu’elle le trompe avec une foule d’amants, prend plaisir autant à enfreindre un interdit matrimonial qu’à quérir de la jouissance. Certes elle ne s’attache pas à eux et c’est plutôt des amours de contrebande qu’elle recherche, mais ce n’est assurément pas la meilleure manière de prouver son attachement à son mari, la fidélité étant un des ciments du couple. Pour elle la recherche d’un amant est une quête constante, même si cela ne débouche que sur des passades, mais non seulement elle ne ressent aucune culpabilité mais au contraire trouve tout un tas de raisons pour se donner bonne conscience. Autrement dit elle proclame qu’elle adore son mari, en fait un être éthéré et idéal mais n’hésite pas à l’espionner, le soupçonnant de ses propres turpitudes, est en perpétuelle demande de l’amour de cet homme qu’elle n’hésite cependant pas à cocufier, surtout devant la grande naïveté de ce dernier qui lui fait une confiance aveugle. Elle se moque même un peu de lui en laissant en évidence un exemplaire de « l’amant » de Marguerite Duras mais rien n’y fait, il adore sa femme.
Il y a dans ce roman un indubitable côté judéo-chrétien avec le sigle « faute-sanction-pardon » et dans ce contexte elle se reconnaît tous les droits, l’adultère étant la chose la plus naturelle pour elle. Évidemment le hasard s’en mêle et vient en aide à ce malheureux mari trompé en lui révélant l’étendue des trahisons de son épouse face à ces manquements à lui, révélant une disproportion qui met surtout en évidence les fantasmes de son épouse, son côté nymphomane, son attirance pour la transgression. Dès lors elle envisage le pire, l’éclatement de cette famille à laquelle elle ne tient que très modérément, la disparition de tout ce qui faisait sa vie de petite bourgeoise et auquel elle était attachée.
. De toutes les raisons qui poussent les êtres humains à unir leurs vies, l’amour m’a toujours paru être la plus improbable. Quand la société a organisé la cohabitation entre deux êtres de sexe différent, elle l’a fait dans une optique de peuplement et le droit, les convenances sociales ou personnelles, la religion, les intérêts les plus divers se sont chargés de la faire perdurer alors même que l’indifférence, et parfois pire, ne gouvernait plus que leurs relations communes, l’hypocrisie, le mensonge, la trahison, l’adultère faisant partie de la panoplie largement utilisée par l’espèce humaine. On peut toujours pardonner ou prétendre oublier mais en réalité le passé s’impose et on a toute la vie pour digérer son mauvais choix. Je veux bien que « le coup de foudre » existe mais en faire durer toute une vie les effets, notamment sur l’attachement et la fidélité me paraît très exagéré. On a un peu trop tendance à confondre plaisir sexuel passager et véritable passion personnelle pour un être et je n’en veux pour preuve que le nombre croissant des divorces. Il n’est cependant pas nécessaire d’attendre quinze années comme ici pour que le mariage ait l’acre parfum de la solitude. L’épilogue qui donne enfin la parole à son mari ne m’a pas du tout convaincu et j’augure mal des prochaines années, ces adultères ne pouvant pas ne pas laisser de traces. L’autocritique du mari à quelque chose d’artificiellement culpabilisant, de faussement machiavélique, de fictivement angélique pour l’avenir. J’attache toujours du prix à l’exergue qui, même si elle n’est pas de la plume de l’auteur, et souvent révélatrice. Ici c’est le cas et « la porte fermée » dont il est question évoque à la fois le passé immédiat et le devenir de ce couple
Le livre refermé, j’éprouve un impression bizarre, pas seulement à cause de la 4° de couverture qui annonçe « un roman original plein d’une irrésistible drôlerie » que je n’ai pas ressentie, pas non plus à cause de ce découpage en sept jours de la semaine associés à une couleur (la couleur est une obsession récurrente pour elle), mais il en ressort une sorte de malaise, peut-être à cause du titre où l’auteure se propose d’évoquer son mari… mais nous parle surtout d’elle. Quant à l’originalité du roman, je ne l’ai pas vue non plus, une femme qui trompe son mari en lui jouant la comédie afin de rester avec lui pour conserver son rang social et son niveau de vie, c’est finalement assez banal. Tout au plus l’auteure nous rappelle que le mariage est une loterie, qu’à ce jeu bien peu sont chanceux et que sur tout cela flotte un parfum d’égoïsme, solitude et de gâchis.
J’ai pourtant poursuivi ma lecture jusqu’au bout parce c’est bien écrit et que cela se lit bien, par respect pour le travail de l’auteure aussi, puisque l’écriture est toujours un accouchement difficile et que le livre est souvent un univers douloureux, mais aussi parce que j’ai horreur d’abandonner un livre en cours de route et que celui-ci est en lice pour un prix littéraire où je me suis engagé comme lecteur.
-
Pirandello - Biographie de l'enfant échangé.
- Par hervegautier
- Le 06/11/2021
- Dans Andrea Camilleri
- 0 commentaire
N°1602 – Novembre 2021
Pirandello – Biographie de l’enfant échangé – Andrea Camilleri – Flammarion.
Traduit de l’italien par François Rosso.
Dans cet ouvrage, Andrea Camilleri nous montre une autre facette de son talent en se faisant biographe, pas de n’importe qui cependant puisqu’il choisit Luigi Pirandello (1867-1936) qui non seulement était un homme de plume, mais surtout peut-être, parce qu’il était né comme lui à Porto Empédocle, une sorte de double, un « demi-frère sicilien ». Mais en tant que dramaturge Camilleri fait de Pirandello le véritable personnage du roman qu’il écrit à cause des relations plus que tendues que ce dernier avait avec son père, absent, trop occupé par ses affaires, mais aussi violent, volage et colérique. Nous savons qu’une enfance difficile est souvent la source de la création littéraire et c’est donc ce registre que le père du commissaire Montalbano choisit pour nous le présenter. Pour cela, il part d’une légende sicilienne qui reprend le thème traditionnel de l’échange d’enfant au berceau, lequel devient roi à la place d’un autre. A la lumière de ce propos qui a été repris par Pirandello lui-même dans son œuvre, Luigi, qui se voit comme très différent de ses parents, en vient à penser qu’il n’est pas fils de son père. Il était donc normal que son biographe s’emparât de ce thème qui ne fut pas pour Piradello qu’un concept mais véritablement le fantasme et l’obsession de toute sa vie. Le jeune Luigi mettra tout en œuvre pour prendre ces distances avec cette famille où il pensait ne pas avoir sa place. Ce doute sur sa filiation ne l’a cependant pas empêché de vivre correctement, grâce aux subsides de cet homme, pendant toutes ses années d’études, menées parfois à l’étranger, ni d’ailleurs d’accepter un mariage arrangé par lui qui avait pour but de redorer le blason de l’entreprise familiale et d’augmenter son capital grâce à l’importante dot de la jeune fille. Cela lui a permis de se consacrer à sa vocation d’écrivain à laquelle il se destinait exclusivement mais qui ne lui rapportait quasiment rien au début. Ce doute sur sa filiation, cette idée du « double » baigneront tellement toute sa vie que Pirandello en concevra un problème d’identité sur lequel se penchera attentivement le célèbre écrivain italien Leonardo Sciscia. Cela ajouté au tempérament sicilien, à ses coutumes ancestrales, à un mariage malheureux et à l’inévitable culpabilité judéo-chrétienne, l’amèneront à supporter avec un certain stoïcisme la jalousie maladive et la folie paranoïaque de son épouse et même à pardonner à son père. C’est entre autre pour cela qu’il demeura avec son épouse, même s’il comprit très vite qu’elle serait incapable de l’accompagner « sur la voie de l’art », ce qui, pour lui dût être un véritable déchirement et c’est cette incompréhension qui justifia qu’il la cantonne dans son seul rôle de mère. Pour autant, il doit bien y avoir un peu de réalité dans sa filiation légitime puisque Pirandello père nous est présenté comme un être autoritaire, insupportable, imbu de sa personne. Luigi une fois marié et père de famille puis veuf, reproduisit, selon la règle non écrite selon laquelle on refait le mauvais exemple donné, et ce alors même qu’on a tout fait pour l’éviter, puisqu’il se brouilla avec ses propres enfants, devenant, mais dans un tout autre contexte, un aussi mauvais père que le sien. Il fit même quelques pas chez les fascistes avant de rendre sa carte, boudé par le pouvoir mussolinien malgré son prix Nobel.
Camilleri entreprend donc de narrer des épisodes de son parcours créatif dans cette biographie passionnante, fort bien écrite, richement documentée, citant de larges extraits de son œuvre, de sa correspondance privée, des réactions de la critique, des études biographiques et des lettres d’amis. On le sent même en empathie avec Pirandello tant les épreuves ont émaillé sa vie. De son enfance et de ses diverses expériences, de ses premières amours, de son mariage malheureux, de ses échecs, de la folie de sa sœur et de sa femme, non seulement il puisera les sources de ses créations, mais il trouvera dans l’écriture une forme d’exorcisme pour l’aider à les supporter. Ses personnages ne sont en effet pas exclusivement nés de son imagination créatrice mais empruntent beaucoup à la vie de leur auteur, illustrant ainsi l’effet cathartique des mots.
-
La pierre jaune
- Par hervegautier
- Le 02/11/2021
- Dans Geoffrey Le Guilcher
- 0 commentaire
N°1601 – Novembre 2021
La pierre jaune – Geoffrey Le Guilcher – Éditions Goutte d’or.
Jack Banks est un policier anglais est chargé d’infiltrer un groupe d’activistes anarchistes, les « Jauniens », des marginaux où se sont mêlés des individus recherchés pour terrorisme, trafic de drogue et divers délits ou crimes , retranchés dans un petit village breton, « La pierre jaune », situé sur la presqu’île de Rhuys. Il commence sa mission quand, à 300 kilomètres de là, deux avions percutent l’usine nucléaire de La Hague provoquant une catastrophe, avec incendies, nuage radioactif, pluies contaminées et l’ordre d’évacuation de la Bretagne est donné. On songe au terrorisme islamique mais c’est surtout la panique, l’improvisation, le sauve qui peut... Les « Jauniens » refusent de quitter leur campement malgré le dangers pluies et les morts qui n’épargnent pas la petite communauté qui organise son quotidien en zone contaminée. Les voilà coupés du monde, mais pas tout à fait cependant grâce aux réseaux sociaux. La vie s’organise dans ce contexte de confinement et l’ambiance est à la fois à la débrouille et aux pratiques divinatoires. Banks qui est suspecté par certains membres de la communauté doit, contre son gré, rester avec eux et finalement finit par prendre goût à ce genre de survie qui génère un microcosme de liberté et de relative paix quasi sectaire. Sa mission est compromise et sa vie même va basculer, mais il ne sortira pas indemne de cet épisode, et il ne sera pas le seul !
Toutes choses égales par ailleurs, un tel scénario n’est pas une simple fiction, évoque certains souvenirs et nous rappelle que nous sommes en danger permanent, otages de nos propres besoins et à la merci de n’importe quel illuminé qui a des intentions destructrices. Je ne connais rien dans ce domaine mais je peux toujours ajouter foi aux différentes solutions empiriques à mettre en œuvre en cas de contamination surtout qu’aucune solution ne paraît prévue en cas d’une telle éventualité. Notre monde est fragile et un rien peut le déstabiliser, ce que nous vivons actuellement avec la Covid en est l’illustration.
Il s’agit d’un premier roman bien documenté du point de vue technique et d’une lecture facile, les personnages sont attachants malgré leur côté marginal, l’intrigue bien menée. Il m’a cependant paru difficile de croire qu’une telle aventure puisse durer et échapper longtemps aux autorités. Le fait que cela se passe en 2024 n’en fait pas pour autant un roman d’anticipation .
-
La prise de Makalé
- Par hervegautier
- Le 27/10/2021
- Dans Andrea Camilleri
- 0 commentaire
N°1600 - Octobre 2021
La prise de Makalé – Andrea Camilleri
Traduit de l’italien par Marilène Raiola.
Camilleri (1925-2019) n’est pas seulement le Simenon sicilien comme on s’est plu à le nommer. Il est aussi, comme l’était également l’auteur de Maigret, un remarquable conteur et romancier traditionnel. Il s’intéresse ici au petit Michilino, six ans, très intelligent et doué d’un sexe d’homme adulte qui fait des envieux et des envieuses, qui vit à Vigatà, une bourgade imaginaire de Sicile, en 1935, c’est à dire sous de fascisme. A cette époque l’Italie était en guerre en Abyssinie, ce conflit armé étant l’instrument idéal d’un régime totalitaire. Sa famille, très favorable au pouvoir en place, lui inculque des valeurs catholiques, dans le respect du Duce et de sa politique. C’est un véritable lavage de cerveau à base de fanatisme et de culpabilité judéo-chrétienne, destiné à annihiler tout sens critique chez cet enfant, l’incitant à tuer à la baïonnette, notamment le fils d’un communiste. Cette période correspond pour le petit Michilino à la découverte du monde des adultes, plein de paradoxes, de violence, d’adultères, de vices, de tabous et d’hypocrisies, qui va connaître le viol, le mensonge, la manipulation, la propagande politique et militaire de la part de sa propre famille, des Institutions civiles et religieuses alors qu’il leur fait une confiance aveugle.(Le curé Burruano et du professeur Goergerino sont des personnages révélateurs face à l’innocence et à la crédulité de l’enfant qui peu à peu disparaît au rythme des péchés mortels ou véniels qu’il croit commettre, et la façon très personnelle qu’il a de les conjurer, tant la religion a d’emprise sur lui). Le régime politique dont ses parents sont partie prenante est évidemment coupable comme l’est le système éducatif mais aussi l’Église (le Duce est l’homme de la Providence) qui, dans la très catholique Italie s’allie, comme elle l’a toujours fait, à l’autorité, au pouvoir pour conforter son action et sa place dans la société et ce malgré des contradictions qui n’échappent pas à ce petit garçon. C’est d’autant plus inacceptable qu’elle est censée incarner une tutelle morale au nom d’un Évangile dont elle se recommande mais dont elle n’applique pas les préceptes. Cette caractéristique ressort également aujourd’hui et donne à penser que, malgré de grandes figures morales et charitables, incontestables et parfois anonymes qui l’ont honorée, elle reste une un pouvoir social et spirituel de référence mais qui a failli à sa tâche. Différentes expériences sexuelles et l’attitude compromettante des adultes entament un peu son innocence et sa dévotion autant à Mussolini qu’à Jésus mais Michilino reste un parfait petit fasciste, raciste, sanguinaire, intolérant, naïvement respectueux des préceptes religieux. Elles le font entrer de plain-pied dans ce monde inconnu qu’il ne comprend pas bien. Cela se manifeste lors de la célébration de la prise symbolique de la ville abyssine de Makalé où pour lui tout bascule. Non seulement cette mise en scène est ridiculement grotesque mais Michilino s’avère définitivement conquis par le système : il devient lui-même en même temps rebelle et un instrument de la violence, persuadé qu’il agit conformément aux idéaux fascistes et religieux qui lui ont été inculqués. Il finit par prendre conscience du jeu malsain des adultes entre eux (spécialement celui que jouent ensemble sa propre mère et le curé, son père avec sa filleule) et de celui qu’il faut tenir pour s’insérer dans une société. Il apprend à se forger une bonne conscience pour se justifier, autrement dit, il grandit. Il est juste de dire que nous avons plus ou moins tous fait ce cheminement.
C’est un roman triste et dur qui parle d’une période difficile pour ce petit garçon qui prend conscience tout seul des réalités qui régissent la société dans laquelle il sera amené à vivre, autant que du discours moralisateur du catéchisme et du gouffre qui sépare le message que lui dispensent les adultes et leur conduite. Il constate que font défaut tous ceux en qui il devrait avoir confiance, ses parents, les enseignants et les hommes d’Église, au profit d’une idéologie politique et religieuse destructrice.
L’épilogue symbolique est à la mesure de l’univers que les événements ont tissé autour du petit garçon, obsédé à la fois par les messages religieux et fanatiques qui ont gouverné sa jeune vie.
C’est sans doute le livre de Camilleri le plus boudé par la critique, non seulement parce qu’il dénonce l’attitude des adultes, l’enseignement politique et religieux qui bouleversent la naïveté d’un jeune enfant mais aussi parce qu’il correspond à une période que le pays désire effacer de sa mémoire.
-
Meurtre à l'anglaise
- Par hervegautier
- Le 24/10/2021
- Dans Didier DECOIN
- 0 commentaire
N°1599 - Octobre 2021
Meurtre à l’anglaise – Didier Decoin – Folio policier.
Je remercie les éditions Gallimard et Babelio de m’avoir permis de découvrir ce roman.
La richissime romancière Dune Benton, atteinte d’un cancer en phase terminale, est retrouvée morte au milieu de la nuit sur une plage désolée de la lointaine île écossaise de Greenhill près de son cottage. On s’interroge sur les circonstances de sa mort d’autant que le docteur Hadley refuse de signer le permis d’ inhumer. Le testament de cette célébrissime auteur de la série de livres pour enfants « Les aventures de Peggy », intéresse son fils, Sir Philip et sa belle-fille Lady Patricia, mais il plane un doute sur les éventuels autres bénéficiaires qui sont autant de suspects pour l’inspecteur principal John Sheen, fin limier dépêché par Scotland Yard pour faire lumière sur cette affaire, mais aussi Don Juan impénitent.
Et chacun d’exprimer son avis, forcément autorisé, à propos de vieille dame pas si digne et recommandable que cela et de sa mort étrange entre malheureux accident, suicide, confusion mentale et meurtre d’un rôdeur d’un proche ou, et c’est plus original, de Peggy, son personnage principal, mais aussi Barbara dans la vraie vie, qui ainsi se serait vengé des sévices infligées par son auteure ! L’affaire n’est pas simple puisque si tous les suspects de l’inspecteur auraient pu perpétrer ce crime, aucun n’y avait vraiment intérêt et il valait évidemment mieux attendre que la maladie fasse son œuvre. Est-ce la région qui veut cela, un autre meurtre y est commis, l’enquête qui s’enlise se dirigeant tout droit vers l’erreur judiciaire avec une lettre énigmatique, des détails apparemment insignifiants mais négligés par les enquêteurs mais pas par Sheen. Il est certes un policier un peu trop sensible à la beauté des femmes et si chez lui le séducteur n’est jamais loin de l’inspecteur, c’est à la manière d’Hercule Poirot qu’il va résoudre cette affaire en y apportant une conclusion, à mes yeux assez peu convaincante.
Didier Decoin, célèbre dans d’autres registres, explore ici le domaine du thriller en évoquant une enquête à la manière d’Agatha Christie pour le plaisir de son lecteur. J’ai en effet apprécié la la lecture aisée, le style agréable, le beau langage, les descriptions poétiques, les remarques personnelles d’écrivain, l’intrigue, l’humour subtil, la truculence de certains personnages et bien sûr le suspense même si l’épilogue m’a laissé un peu dubitatif.
-
Le champ du potier
- Par hervegautier
- Le 22/10/2021
- Dans Andrea Camilleri
- 0 commentaire
N°1598 - Octobre 2021
Le champ du potier – Andrea Camilleri – Fleuve Noir
Traduit de l’italien par Serge Quadruppani.
Près de Vigata on vient découvrir, dans un endroit riche en argile, le cadavre d’un homme coupé en morceaux et une très belle femme, Dolorès, vient déclarer la disparition de son mari, un officier de marine marchande. Il apparaît très tôt à Montalbano que ce meurtre évoque à la fois la Mafia de par son modus operandi et l’Évangile de Saint Matthieu pour les références à la mort de Judas qu’il évoque.
Comme d’habitude le commissaire doit faire face au mauvais caractère de Livia, sa fiancée éternelle et lointaine, à la suspicion de sa hiérarchie et à la modification du caractère de Mimi, son adjoint, pourtant d’ordinaire bien disposé à son égard mais dont les amours clandestine risquent de lui jouer un sale tour sans qu’il s’en rende compte. Ajouté à cela la vieillesse qui commence à tracasser le commissaire et cette enquête difficile qui semble vouloir l’emmener bien au-delà de la Sicile et mettre en cause son collaborateur. Il y a bien la gastronomie sicilienne pour le calmer, mais cela commence à devenir problématique pour lui parce qu’il va même jusqu’à perdre, temporairement, l’appétit à cause de l’attitude de Mimi qui a quelque chose d’incompréhensible.
Sans que ce soit une caractéristique très marquée de son personnage, il me semble qu’il y a un petit côté chrétien chez Montalbano. Il est souvent question de son ange gardien et « le champ du potier » (ou champ du sang) est, selon la tradition, l’endroit acquis par les prêtres ou par Judas Escariote lui-même avec les trente deniers de sa traîtrise et où il aurait été enterré. Il est vrai que nous sommes dans la très catholique Sicile. Cette référence évangélique évoque aussi le mensonge qui est un des travers ordinaires de l’espèce humaine, qu’il rencontre chez son adjoint qui ment effrontément à son épouse et qui sonne aussi comme la trahison de leur longue amitié. Cette enquête est pour lui l’occasion de se pencher également sur son cas et de cet examen de conscience il ne sort pas grandi, mais soulagé quand même.
Ici Camilleri est bien meilleur, ménage ses effets, confie un peu de ses obsessions personnelles avec une discrète allusion à un autre de ses romans consacré à la trahison de Juda et entretient le suspense jusqu’à la fin.
-
l'autre bout du fil
- Par hervegautier
- Le 19/10/2021
- Dans Andrea Camilleri
- 0 commentaire
N°1597 - Octobre 2021
L’autre bout du fil – Andrea Camilleri – Fleuve noir
Traduit de l’italien par Serge Quadruppani.
Lydia, l’éternelle fiancée de Salvo Montalbano, a trouvé que la garde-robe de son commissaire de compagnon n’était pas assez bien fournie et l’a convaincu de se faire confectionner un costume neuf par une couturière locale, la belle et aimable Elena. Pourtant il a bien d’autres préoccupations notamment les migrants qui arrivent de plus en plus sur la côte et dont il faut s’occuper. Pourtant, quelques jours plus tard on retrouve la belle couturière assassinée à coups de ciseaux dans son atelier. L’enquête dont se charge Salvo révèle rapidement que la victime avait montré, avant de mourir, un changement de caractère inhabituel et les personnes interrogées ne lui apportent pas vraiment des éclaircissements.
Notre commissaire vieillit de plus en plus et mène laborieusement cette enquête et ce n’est pas le médecin légiste avec qui il n’a que des rapports strictement professionnels qui va se priver de le lui rappeler. Pour résoudre cette enquête il devra pourtant remonter le temps et il le fera grâce à ses habituels soutiens, Mimi et sur Fazio. De plus il doit faire face chaque jour à une montagne de papiers à signer et également à la suspicion de sa hiérarchie. Heureusement qu’il a la compensation de la cuisine sicilienne et du whisky dont il abuse de plus en plus!
J‘ai été un peu déçu par ce roman paru en France en 2021 qui m’a paru partir dans différentes directions sans véritable lien avec ces investigations comme cette histoire de chat qui monopolise l’attention et l’affection de Catarella. En revanche j’ai bien aimé le discours humaniste de Montalbano, notamment sur les migrants qui a un singulier retentissement sur ce que nous vivons actuellement, j’ai été ému de savoir que ce roman était le premier que Camilleri, devenu aveugle, avait dû dicter à Valentina Alferj. J’ai apprécié aussi la lettre ouverte du traducteur, Serge Quadruppani au commissaire Montalbano, une sorte d’adieu à un personnage certes fictif mais devenu presque vivant mais qui devenait aussi plus qu’orphelin de son créateur disparu en 2019. Les lecteurs le Camilleri le sont aussi un peu.
-
La trotta ai tempi di Zorro
- Par hervegautier
- Le 18/10/2021
- Dans Michele Marziani
- 0 commentaire
N°1596 - Octobre 2021
La trota ai tempi di Zorro - Michele Marziani – Edizioni DeriveApprodi.
Contrairement à ce que son titre le laisse à penser, ce n'est pas exactement un roman sur la pêche à la truite (La truite au temps de Zorro). Certes ce court texte parle de la découverte de la photographie mais surtout de la passion grandissante de la pêche à la truite par Stefano Baldazzi Morra, 13 ans, un garçon un peu introverti, qui arrive avec ses parents au Piémont dans la petit commune de Gozzano sur les rives du lac d'Orta. C'est non seulement un passe-temps qui le distrait de ses périodes d'étude mais c'est surtout la marque d'un rite de passage d'une adolescence compliquée vers l'âge adulte vers la vraie vie cruelle et injuste. En effet ses parents vivent un passage difficile ce qui perturbe grandement Stefano qui va devoir se tisser lui-même sa propre personnalité et son propre équilibre au cours de ces années 70 mouvementées qui le dépassent et qui sont connues comme « Les années de plomb » . Il vit une adolescence perturbée, solitaire et mélancolique mais trouve dans cette activité de pêche à la truite un dérivatif bienvenu et une occasion d'affronter la vie. Petit à petit, le parfum de la révolte grandit dans la société, n'épargne ce petit coin d’Italie et explose en ce printemps 1977 à l'école où son père est professeur . Pour lui le père ne correspond pas pour lui à l'image qu'il s'en faisait d’autant qu'il se met à boire, quitte sa famille et devient SDF et ainsi la cellule familiale éclate. Stefano grandit, découvre la politique mais aussi l’amitié et l'amour mais gardera toujours comme refuge le souvenir de cette activité de pêche à la truite et sa proximité avec l'eau et de la nature comme un symbole à la fois de liberté et de renaissance personnelle.
Je ne connais pas Michele Marziani mais il m’apparaît que ce court texte à des connotations autobiographiques non seulement parce que l'auteur est un pêcheur passionné mais aussi à cause de la dédicace à Mario Albertarelli mise en exergue.
A travers les yeux de l'enfant reviennent des souvenirs peut-être un peu oubliés, des images furtives comme celles de la Fiat 850 , la machine à écrire « Lettera 32 », l'appareil photo Voigtlander... qui donnent une note de nostalgie à cette histoire.
Il s'agit du premier roman de Michele Marziani qui s'est longtemps occupé en qualité de journaliste, à la fois des problèmes de société, d'environnement, de culture qui se retrouveront dans son œuvre mais aussi de la gastronomie et de l’œnologie italiennes. C'est un texte bien écrit et qui m'a procuré une lecture assez facile, dans le texte, moi qui découvre l'italien.
J'ai été un peu surpris par l'épilogue qui a au mois l'avantage de solliciter notre imagination, mais cela reste un roman touchant.
J'ai déjà abordé l'univers créatif de Michele Marziani à travers deux de ces romans « La signora del Caviale » et « Umberto dei ». A ma connaissance les œuvres de cet auteur ne sont pas traduites en français. C'est peut-être dommage pour la découverte de cet écrivain.
-
il rasoio di Asimov
- Par hervegautier
- Le 16/10/2021
- Dans Nicola Fantani - Laura Pariani
- 0 commentaire
N°1595 - Octobre 2021
Il rasoio di Asimov (Le rasoir d’Asimov)– Nicola Fantini – Laura Pariani – Sellerio editore.
Il s’agit d’un texte tiré de l’anthologie « scuola in giallo » publié par Sellerio en 2014.
Une professeure de Milan, Mirella Cossatti, 60 ans, constate que ses élèves sont de plus en plus distraits, non attentifs à ses cours et se révèlent incapables d’écrire correctement des phrases simples. Dans le cadre de son enseignement elle propose comme thème de réflexion écrite « Une personne désagréable ». Les réponses qu’elle obtient sont édifiantes, de même que ce qu’elle découvre, pas vraiment au programme scolaire, caché dans les casiers, l’amène à mener son enquête pour en avoir une idée plus précise.
Avec l’aide de son mari, Beppe, peu intéressé au départ, et d’un collègue à lui, Arturo, elle essaie, durant quatre jours, de décrypter les références aux personnages de dessins animés ou de chansons de groupes qu’elle ne connaît pas. Elle va mener son enquête auprès de ses élèves, assembler une par une les pièces du puzzle et ce qu’elle découvrira va la bouleverser. C’est pour cela que cette nouvelle est classée dans la catégorie « policier ». Elle constate les effets de la poésie de Rimbaud sur les jeunes mais aussi, le racisme, des étranges CD, une sorte de secte d’intimidateurs cyberfantastiques dont l’action de harcèlement auprès des adolescents est dévastatrice, avec à la clé, un défi impossible à tenir pour un élève fragilisé qui ne trouve son issue que dans une tentative de suicide.
C’est vrai que l’école est un théâtre idéal pour observer le monde des adolescents, leurs problèmes,
Ce titre un peu sibyllin évoque le « rasoir d’Ockham » qui est un principe de raisonnement philosophique faisant appel à la raison et qui vient d’un philosophe anglais du XIV° siècle, le moine Guillaume Ockham. Le terme « raser » en philosophie, signifie « éliminer les explications improbables d’un phénomène » ; En termes contemporains cela pourrait se formaliser par l’expression « l’explication la plus simple est la bonne » ou plus simplement « Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ». Cette théorie ne répond cependant pas aux problèmes posés par le monde moderne très complexe. Quant à Asimov, c’est un célèbre auteur de science-fiction, discipline qui est également pratiquée par l’un des deux auteurs, Nicola Fantini. Asimov à imaginé le futur simplifié par les robots et les ordinateurs. Il a considéré que cette avancée technologique ne pouvait en aucun cas porter préjudice à l’homme qui l’a créée. Ici certains élèves se servent de l’informatique pour en harceler d’autres et ainsi les déstabiliser ce qui n’est pas dans la logique d’Asimov et complique au contraire la vie au lieu de la simplifier. Il me semble que l’expression « le rasoir d’Asimov » n’existe pas comme celle du « rasoir d’Okham » mais les auteurs l’ont créée pour exprimer une réalité d’aujourd’hui où tout est compliqué.
-
la pleurante des rues de Prague
- Par hervegautier
- Le 15/10/2021
- Dans Sylvie GERMAIN
- 0 commentaire
N°1594 - Octobre 2021
La pleurante des rues de Prague – Sylvie Germain – Folio.
Le livre refermé, que reste-il de ma lecture ? Une impression un peu triste que suscite dès l’abord le titre ; il est question d’une pleurante, c’est à dire d’une femme qui verse des larmes sur un tombeau. On ne voit pas son visage voilé, comme une sorte de fantôme immatériel, presque irréel mais pourtant bien présent. Elle parcourt sans presque les toucher le sol, les rues, les places et les ponts de Prague, une ville qui a un âme, qui porte en elle non seulement son histoire mouvementée, mais aussi une légende, une atmosphère qui suscite le rêve, le bouleversement intime et même le malaise. S’y mêlent la mémoire intime des lieux, les regrets et les remords qui débordent de l’âme, les projets inaboutis qui maintenant appartiennent inexorablement au passé, le vertige du temps qui fuit… Cette femme est fluide, inaccessible mais a une certaine réalité, boite parce qu’elle se déplace entre deux mondes, celui, quotidien, de cette ville et le vide du néant. Elle n’inspire pas l’amour comme pourrait le faire une femme, simplement parce qu’elle n’est pas belle mais sa présence est prégnante, envahissante même pour l’auteure qui est peut-être la seule à la voir puisqu’elle témoigne de son état d’âme qui semble bien ancré en elle.
Elle est pleurante et pas seulement pleureuse, parce que cette présence est liée à la mort des hommes, célèbres ou non, consacrés par les institutions ou quidams oubliés par l’Histoire, dont le sort commun est d’être éphémères en ce monde, seulement de passage et voués à la disparition. Elle pleure sur monde marqué par l’abandon et la trahison qui caractérisent bien l’espèce humaine. Cette femme m’évoque la Camarde qui frappe chacun dans son corps en lui arrachant le souffle vital mais dont le travail préalable impose aux vivants les douleurs du corps, l’oubli, gomme leurs souvenirs, les deuils qui ont hypothéqué leur futur en leur interdisant de vieillir en paix. Elle se dérobe aussi comme quelque chose d’inaccessible et qui le restera quoiqu’on fasse parce que le temps nous est compté ou que, quoiqu’on en dise, notre destin s’impose à nous et malgré nous, sans que nous puissions rien y faire. Pour illustrer cela l’auteur évoque quelques disparus et surtout la figure tutélaire de son père et des souffrance qui ont précédé sa mort .
Les apparitions de cette femme sont pesantes ou furtives selon l’âme de l’auteure qui tente de les saisir et de les emprisonner dans des mots qui peuvent être un baume sur ses plaies intimes, une compensation face aux cruautés de cette vie parce qu’elle est synonyme délaissement, de solitude, le manque d’amour. La silhouette de cette femme me suggère une création fantasmatique qu’on s’invente pour soi-même parce que la déréliction est trop pesante, une sorte de compensation aux aléas du quotidien. Ce sont douze apparitions, douze comme comme les heures du jour ou de la nuit, comme la ronde des mois de l’année, comme les signes du zodiaque ou pourquoi pas les douze tribus d’Israël ou les douze apôtres de l’Évangile, parce que Dieu est là présent en filigrane qui transcende l’homme, à la fois mortel et friand d’éternité. La claudication de la femme peut aussi s’entendre comme une pérégrination entre le monde de l’humain et celui du divin. Petit à petit cette femme s’estompe jusqu’à disparaître, mais ce n’est qu’une impression, elle reste ici, tapie dans l’ombre et le secret des murs. Vers la fin, il semble que le jour s’installe alors que jusque çà c’était plutôt une atmosphère nocturne qui prévalait, comme si tout cela s’éclairait avec éventualité du retour d’un homme en allé, d’un amant ou d’un enfant à venir, mais l’ambiance reste automnale et froide, le décor vague et même désordonné. Elle sort du récit comme pour symboliser la libération par les mots mais, à titre personnel je ne suis plus très sûr de leur effet cathartique face à l’obsession de la souffrance et de la mort que j’ai ressentie tout au long de cette histoire.
Le texte est sobre et poétique et j’ai eu envie d’en poursuivre la lecture jusqu’au bout, par curiosité, par intérêt pour l’intrigue de ce court livre qui n’est pas répertorié comme un roman mais qui y ressemble beaucoup. Je me suis laissé porté par ces pages qui m’ont quand même parlé, mais je n’ai peut-être rien compris !
-
Le tour de la bouée
- Par hervegautier
- Le 13/10/2021
- Dans Andrea Camilleri
- 0 commentaire
N°1593 - Octobre 2021
Le tour de la bouée – Andrea Camilleri – Fleuve noir
Traduit de l’italien par Serge Quadruppani et Maruzza Loria.
Ça ne va pas fort pour Montalbano. Devant le spectacle des violences policières injustifiées contre des manifestants pacifiques et la complicité de la hiérarchie et des politiciens, notre commissaire a tout simplement envie de démissionner. Son écœurement est à son comble quand, au cours d’un de ses bains traditionnels, il butte sur le cadavre en état avancé de décomposition d’un homme qui n’a rien d’un migrant qu’on rencontre trop souvent sur ces côtes. C’est vrai que ce monde est déprimant comme le sont ces foules d’immigrés qui débarquent en Sicile et s’évaporent dans la nature.comme l’a fait cet enfant qu’on a retrouvé écrasé sur une route. Bizarrement, il pense que ses deux morts sont liées même si tout lui donne tort. Mais quel est le lien entre ces deux cadavres, entre immigration clandestine, travail illégal, trafic d’enfants, délinquance et mafia ? Il peut compter sur sa fine équipe d’enquêteurs et pour une fois Catarela, d’ordinaire très approximatif, se révèle être une aide précieuse, même s’il ne le fait pas exprès.
Le métier de policier met notre commissaire en permanence en contact avec la face sombre de l’espèce humaine. Heureusement qu’il y a encore la beauté des femmes et la cuisine italienne pour racheter tout cela à ses yeux !
Avec ce roman Camilleri évoque une réalité bien actuelle en Italie.
-
La première enquête de Montalbano
- Par hervegautier
- Le 10/10/2021
- Dans Andrea Camilleri
- 0 commentaire
N°1592 - Octobre 2021
La première enquête de Montalbano – Andrea Camilleri – Fleuve noir
Traduit de l’italien par Serge Quadruppani et Maruzza Loria.
C’est un recueil de trois nouvelles policières écrites à des moments différents dont la deuxième donne son titre à l’ensemble. Elles ne comportent pas de sang, ce qui est exceptionnel.
Dans « Sept lundis », il s’agit d’une série de meurtres étranges puisqu’ils sont perpétrés non sur des hommes mais sur des animaux et accompagnés d’étranges messages. Pour enquêter Montalbano devra se référer à la Kabbale et à la Bible qui ne sont pas vraiment sa tasse de thé.
Dans la deuxième, nous rencontrons Montalbano qui fait ses premiers pas dans la vie, son entrée dans le monde du travail, c’est à dire de la police, sa nomination à Vigàta, sa ville natale, en qualité de commissaire, son adaptation rapide aux coutumes locales, son côté gourmet et, évidemment sa première enquête un peu compliquée où il croise l’incontournable mafia. Dans cette ville qu’il connaît déjà il se sent bien au point de constituer l’embryon de ce qui sera sa fine équipe de policiers et de se forger des amitiés durables qui l’aideront dans sa future tâche de commissaire. Il se révèle déjà bluffeur et, quand il le faut, peu regardant sur les procédures, mais toujours au service de la justice.
Dans la troisième nouvelle, son équipe est déjà opérationnelle depuis longtemps, il a vieilli et ses querelles avec Livia, son éternelle fiancée génoise, sont toujours aussi orageuses. Dans une ambiance de fêtes de Pâques, une petite fille a disparu puis est retrouvée mais il y a suspicion d’enlèvement. Ses méthodes peu orthodoxes au regard du code de procédure permettront de déjouer les manœuvres de deux familles mafieuses en lutte l’une contre l’autre.
-
Le sourire d'Angélica
- Par hervegautier
- Le 05/10/2021
- Dans Andrea Camilleri
- 0 commentaire
N°1591 - Octobre 2021
Le sourire d’Angélica – Andrea Camilleri – Fleuve noir
Traduit de l’italien par Serge Quadruppani.
On ne contrôle pas ses rêves et encore moins les paroles qui s’échappent de son sommeil. Tout commence par une phrase que Livia endormie prononce et qui laisse Salvo Montalbano perplexe au point de douter de sa fidélité. Il est vrai qu’en permanence ils ne vivent pas ensemble, l’une à Bologne et l’autre en Sicile et que cet éloignement peut favoriser l’adultère, mais il est également vrai qu’une vie commune n’empêche en rien les trahisons conjugales et que bien malin qui peut se targuer de connaître véritablement son conjoint.
Dans sa circonscription, des cambriolages ont été commis aux dépends de la riche bourgeoisie locale selon une même procédure particulière et l’une de ces affaires met Montabano en face d’Angélica, la jolie salariée d’une banque qui arrondit ses fins de mois en se prostituant mais qui aussi correspond à ses fantasmes d’enfant et au personnage du même nom dans le roman «Roland furieux » du poète L’Arioste. C’est peu dire que la beauté de la jeune femme fait de l’effet à Salvo et ce dernier, pour les besoins de l’enquête autant qu’à la demande pressante d’Angélica, passe avec elle un accord pour contrecarrer les cambriolages à venir tout en respectant la discrétion. Tout cela n’empêche pas les lettres anonymes qui nourrissent la suspicion ordinaire de sa hiérarchie et entravent l’enquête en même temps qu’elles lui pourrissent la vie.
Dans un roman de Camilleri, il y a certes le compte-rendu des investigations que Montalbano mène ordinairement entre bluff, hésitations et éclairs de génie, mais aussi l’équipe qui le seconde, Fazio à la fois fidèle et efficace, Catarella dont la présence ajoute une note de folklore malgré sa récente passion pour l’informatique. Mais l’intérêt du roman ne s’arrête pas là. Un tel épisode dans la vie de Montalbano peut certes le faire rajeunir, lui faisant pour un temps oublier ses 58 ans et perdre la tête pour cette jeune et jolie femme, croire peut-être à nouveau à son charme. Tout commence pour lui par ces quelques mots prononcés nuitamment par Livia et qui jettent le doute dans l’esprit de Salvo avec, sous-jacente, cette idée de vengeance. Dans le même temps il y a cette rencontre avec Angélica et tout ce qu’elle représente pour lui, entre l’attirance qu’il éprouve pour elle à cause de sa séduction naturelle de femme et les fantasmes qu’il porte en lui depuis longtemps et qui trouvent à ce moment précis leur concrétisation. Il y a l’ivresse d’avoir été choisi pour des moments de plaisirs intimes mais aussi, le moment d’extase passé, le sentiment de déception né de la banalité ordinaire qu’il n’imaginait pas, augmenté peut-être de la honte de lui-même pour avoir trahi Livia sur la seule éventualité d’une passade supposée. Ce genre de situation inspirée par le mensonge peut durer longtemps mais trouve parfois sa conclusion grâce au hasard ou à l’aveu. Ici c’est cette dernière manière que choisit Salvo mais Livia, trop attachée ou amoureuse, ne le croit pas.
C’est pourtant d’une autre sorte de vengeance dont il s’agit ici mais qui dérange Montalbano, autant parce qu’il prend conscience qu’il a été manipulé à cause de ce satané et peut-être tardif « démon de midi » que parce qu’il doit faire jusqu’au bout son métier de flic, quoi qu’il puisse lui en coûter.
Depuis que j’ai découvert Camilleri, c’est toujours le même plaisir de le lire d’autant qu’en plus de l’intrigue policière il y a souvent, comme ici, une dimension psychologique qui justifie bien qu’on ait donné à Camilleri le titre de Simenon italien.
-
La voix du violon
- Par hervegautier
- Le 04/10/2021
- Dans Andrea Camilleri
- 0 commentaire
N°1590 - Octobre 2021
La voix du violon – Andrea Camilleri – Fleuve noir
Traduit de l’italien par Serge Quadruppani et Maruzza Loria.
Montalbano vient de découvrir un peu par hasard le cadavre d’une jeune et jolie femme, Michela Licalzi, assassinée dans sa maison juste construite. Bizarrement elle était nue dans une mise en scène macabre et ses vêtements ont disparu, une manière comme une autre de brouiller les pistes. Son mari est chirurgien à Bologne et la victime, quand elle venait dans la région, logeait à l’hôtel.
L’enquête s’enlise et s’oriente bizarrement vers un malade mental, mais cette piste ne convient pas à notre commissaire, le mari de la victime révèle un couple bien étrange et Montalbano, cible ordinaire d’une hiérarchie tatillonne et d’un collègue envieux et flagorneur se trouve dessaisi puis à nouveau en charge de cette affaire, le tout dans le quotidien de la mafia et la mort opportune d’un présumé coupable. Pour notre commissaire, il y a de quoi en perdre son latin et ce d’autant qu’entre temps ses investigations l’amènent à tomber amoureux d’une jolie femme. Qu’importe, il n’aura pas trop de tout son talent et de sa patience d’enquêteur, et ce malgré les méprises et les fausses pistes, pour éclaircir cette affaire bien compliquée. Une enquête est l’occasion de faire des rencontres et pas forcément des meurtriers ; ici il va croiser notamment un maestro violoniste. De son propre aveu, Montalbano n’y connaît pas grand chose en musique et plus particulièrement en violon, mais c’est pourtant cet instrument qui va l’aider à rétablir les faits, découvrir le vrai assassin et rendre hommage à la mémoire de celui qui a été injustement accusé.
Il galère toujours avec Livia, sa lointaine fiancée génoise et ce d’autant qu’ils traversent une crise liée à l’adoption éventuelle d’un petit garçon. Le tout sur fond de recettes de cuisine sicilienne capables de faire saliver les plus accrocs au jeûne.
Cette enquête à la Simenon fut encore un bon moment de lecture.
-
L'excursion à Tindari
- Par hervegautier
- Le 01/10/2021
- Dans Andrea Camilleri
- 0 commentaire
N°1589 - Septembre 2021
L’excursion à Tindari – Andrea Camilleri – Fleuve noir
Traduit de l’italien par Serge Quadruppani et Maruzza Loria.
Montalbano a l’appétit coupé et ce n’est pas facile de lui faire passer l’envie de manger. Son adjoint, Mimi va se marier, ce qui est déjà une nouvelle étonnante mais surtout il va demander sa mutation dans un autre commissariat, sûrement sur le continent. C’en sera fini de cette belle équipe, Augello, Fazio et Catarella, qu’il a si patiemment constituée et à laquelle il est très attaché. Mais Mimi n’a pas dit son dernier mot et l’amour vous joue des tours pendables quelquefois! Apparemment cela plaît à sa hiérarchie qui verrait ce démantèlement d’un bon œil, ce qui n’enchante pas le commissaire tant il est en délicatesse avec elle. De plus tous ces anciens copains de 68 n’ont pas résisté à l’attrait de l’argent, de la réussite et il ne digère pas cet abandon des « idéaux révolutionnaires » de leur part. Ajouter à cela une Livia, son éternelle fiancée génoise, absente et parfois désagréable au téléphone, notre commissaire n’est pas dans ses meilleurs jours et ce n’est pas la lecture des romans policiers de Vasquez Montalbàn, l’auteur catalan qu’il affectionne, ni la rencontre de Beatrice, une belle jeune femme qui est aussi témoin et que Mimi trouve à son goût, qui vont apporter un remède à cette mauvaise passe. Il se console quand même avec les intuitions que lui inspirent un vieil olivier tordu !
A côté de cela, il se retrouve en charge de deux enquêtes qui ne le passionnent guère, la disparition d’un couple de retraités un peu bizarres, partis en excursion dans la ville de pèlerinage de Tindari, et qu’on retrouvera trucidés et l’assassinat d’un petit Don Juan de sous-préfecture qui habitait le même immeuble, deux affaires qui sont peut-être liées ? Ces laborieuses investigations autour de photos, de vidéos, d’un livret de caisse d’épargne, d’un curé, d’un médecin cupide, dans l’ombre de l’incontournable mafia, s’effectuent sous le regard d’un questeur de plus en plus tatillon et soupçonneux. Montalbano et son équipe mettront à jour un trafic délictueux d’organes qui confortera la solidité et la pérennité de cette équipe et peut-être aussi l’avenir amoureux de notre commissaire. Pour le moment il lui reste les plaisirs de la table.
D’une manière générale j’aime bien les romans de Camilleri, mais je dois avouer que celui-là m’a paru un peu moins attachant .
-
il mondo deve sapere
- Par hervegautier
- Le 28/09/2021
- Dans Michela Murgia
- 0 commentaire
N°1588 - Septembre 2021
Il mondo deve sapere – Michela Murgia - Einaudi editore
Il s’agit d’un roman tragi-comique, lu en italien, qui relate l’expérience d’un mois vécu par une télévendeuse précaire travaillant dans l’enfer d’un centre d’appel de Kirby, une multinationale américaine vendant des aspirateurs.
Elle avait déjà publié « l’Incontro » ( publié en français sous le titre « la guerre des saints ») qui a déjà fait l’objet d’un commentaire de ma part dans cette chronique.
Ici, elle décrit donc la technique de persuasion destinée a vendre par téléphone des aspirateurs aux ménagères mais elle évoque également les figures de ses collègues et de ses petits-chefs et surtout son expérience personnelle relatée comme une souffrance personnelle, vécue à travers la politique utilisée par l’entreprise qui va des récompenses aux humiliations publiques, les horaires, les punitions ce qui donne une image assez réaliste de ce qu’est le monde du travail dans cette entreprise. Ce que le monde doit savoir ( traduction littérale du titre) c’est précisément les manipulations dont sont victimes les salariés ( avec affiches aux messages subliminaux, présence d’un psychologue au discours surréaliste, le tout ayant pour seul but de motiver les salariés d’en faire encore plus avec création d’objectifs à atteindre et compétition entre collègues sous la férules des incontournables « petits-chefs ») autant que les acheteurs.
Le «call center » est ainsi devenu à la suite de cette publication le symbole de l’emploi précaire en Italie et elle-même, même si elle ne l’avait pas souhaité au départ, la dénonciatrice de ce ce mode de travail. Même si elle n’est pas vraiment la seule à mener ce combat, elle accepta cependant ce rôle de représentation ainsi que ses conséquences, donnant à son travail d’écrivain une dimension sociale de défense des travailleurs qui n’est plus vraiment réalisée par les syndicats dont c’est pourtant le rôle traditionnel. Le style volontairement simple, abordable et parfois ironique de ce roman le met à la portée et au service des classes sociales les plus défavorisées et correspond à une prise de conscience du monde du travail aujourd’hui où les « précaires » sont tellement exploités qu’ils ne constituent même plus un prolétariat.
Cet ouvrage, conçu à l’origine sous la forme d’un blog qui a retenu l’attention d’un éditeur, a eu un succès considérable en Italie ce qui a surpris l’auteure elle-même et a fait l’objet d‘une adaptation théâtrale. Cette forme de littérature est peut-être l’émergence d’une nouvelle expression de prise en compte du monde du travail d’aujourd’hui. Michela Murgia (née en 1972) est également une femme politique sarde qui a été candidate sur une liste indépendantiste aux élections régionales de sa province en 2014.
C’est en tout cas un étude édifiante sur l’espèce humaine à cent lieux de tout ce qu’on nous a dit sur la valeur supposé de l’homme et le respect dû à chacun en tant qu’être humain. S’il est un droit fondamental, s’il correspond parfois à une passion ou à une réalisation personnelle, le travail n’en reste pas moins une nécessité pour la plupart des gens. Ce qui nous est décrit ici est la précarité qui de plus en plus l’affecte et je m’interroge sur sa valeur et sur le respect accordé à ceux qui le font au moment des fusions-absorptions d’entreprises qui génèrent du chômage, considèrent les travailleurs comme des variables d’ajustement et les jettent souvent en marge de cette société au nom du seul profit.
-
chien de faïence
- Par hervegautier
- Le 27/09/2021
- Dans Andrea Camilleri
- 0 commentaire
N°1587 - Septembre 2021
Chien de faïence – Andrea Camilleri – Fleuve noir.
Traduit de l’italien par Serge Quadruppani.
Contrairement à la plupart ds gens, le commissaire Montalbano refuse la promotion qui le déplacerait, sans doute à cause de l’attachement à cette terre de Sicile, à cette ville et à sa gastronomie dont il fait un usage à peine raisonnable, à ses collègues, à ces fonctions de terrain, allez savoir... Pourtant l’arrestation spectaculaire de Tanou u Grecu, un mafieux en cavale depuis des années et qui contrôle la prostitution sur l’île , va sans doute précipiter sa nomination au grade de «vice-questeur ». Cette perspective ne l’enchante guère, pas plus d’ailleurs que l’incontournable conférence de presse télévisée qui suit. Par ailleurs, des informations lui permettent de mettre à jour un trafic d’armes avec la découverte de cadavres quasi momifiées depuis cinquante ans d’un homme et d’une femme, dans une grotte, en plein ébats amoureux figés dans la mort et dans une mise en scène étrange. Suicide romantique, assassinat ou rite funéraire? Il mènera son enquête entre découragement et volonté farouche de faire éclater la vérité.
Éternellement fiancé à la génoise et lointaine Livia avec qui les rapports sont parfois houleux, il n’en reste pas moins ébloui par les belles femmes et, comme il ne leur est pas indifférent, il sait, à l’occasion, les mettre à contribution, pour les besoins de l’enquête, évidemment ! Ici, la caverne tient à la fois du mythe et de la réalité et face à ce qui est un mystère, notre commissaire sait aussi solliciter des érudits qui explorent le Coran et autres textes anciens, le double sens de certains mots, sans oublier de faire appel à son imagination la plus créative et même la plus risquée.
-
L' odeur de la nuit
- Par hervegautier
- Le 25/09/2021
- Dans Andrea Camilleri
- 0 commentaire
N°1586 - Septembre 2021
L’odeur de la nuit – Andrea Camilleri – Fleuve noir.
Traduit de l’italien par Serge Quadruppani et Maruzza Loria.
Émoi dans Vigata. Le comptable Gargano, honnête et intègre comme il se doit, a disparu en emportant les économies de bien des gens, glanées grâce à un système vieux comme le monde, un énorme mensonge qui, bien entendu a fonctionné. Bref, il les a escroqués, même si sa secrétaire, follement amoureuse de son patron, refuse encore d’y croire. Ça occasionne à Montalbano des états d’âme à cause d’un éventuel dépôt de fonds effectués par un tiers chez ce malfaiteur. Il en fait une affaire personnelle !
Nous retrouvons un Montalbano toujours aussi bluffeur, qu’ils s’agisse de faire éclater la vérité ou d’affronter ses supérieurs. Cette fois c’est une veille histoire, vieille de quelques années que le Questeur exhume, évidemment averti par une lettre anonyme . Comme par hasard ces deux affaires sont peut-être liées ! Notre commissaire enquête donc, mais une enquête est toujours imprévisible et des rencontres qu’on y fait sont improbables. Comme si l’escroquerie ne suffisait pas, s’y ajoute un meurtre avec mise en scène. Grâce à ses deux habituels comparses Fazio et Augello, notre commissaire, même s’il n’est pas officiellement chargé de l’enquête, finit par comprendre les différentes phases de cette affaire et ensemble ils la reconstituent façon scénario de film. Nous sommes en Italie où le cinéma fait partie de la vie et en Sicile, si on ne comprend pas un assassinat on peut toujours en accuser la mafia. Cela a au moins l’intérêt de la vraisemblance.
Mais ce Montalbano doit bien être doté d’un sixième sens, à moins que ce ne soit sa connaissance de la nature humaine avec toutes ses nuances obscures, ses refus, ses fantasmes, ses blocages intimes, ses pulsions, ses folies, et sa version risque d’être sensiblement différente des conclusions officielles.
Montalbano vit ses éternelles et lointaines fiançailles, quant à Mimi, son adjoint, il va se marier même s’il hésite encore à sauter le pas, ce qui ne lui empêche pas de papillonner, mais quand même, il est un peu jaloux, notre commissaire. Il est toujours préoccupé par son âge mais ça ne l’empêche pas d’aimer les bonnes choses de la vie à commencer par la nourriture. C’est une forme de compensation, mais moins forte cependant que la lecture des romans de Simenon ou de Faulkner que pourtant il aime lire.
-
Du bon usage des cimetières parisiens
- Par hervegautier
- Le 24/09/2021
- Dans Lucien Clarini
- 0 commentaire
Du bon usage des cimetières parisiens – Lucien Clarini – Les cahiers d’Illador.
Je remercie Babelio et les cahiers d’Illador de m’avoir fait parvenir ce recueil de poèmes.
J’avoue que je ne m’attendais pas à cela, non que je n’aime pas la poésie, bien au contraire, mais le titre m’évoquait une balade dans des lieux si paisibles que bien des gens de ma génération y ont trouvé, enfants, leur terrain de jeux dominicaux parce que les squares et autres jardins publics manquaient dans leur décor urbain immédiat. Ils ne l’avaient évidemment pas choisi mais sous la férule de leurs parents ils pouvaient, sauf à respecter les tombes, y jouer à loisir et regarder les incontournables chats. Le lieu est généralement calme, apaisant, c’est bien le moins pour le dernier repos des pensionnaires, même si les occupants sont le plus souvent anonymes et délaissés, l’oubli étant une grande caractéristique de l’espèce humaine , cet endroit est bien souvent synonyme de « trou de mémoire’.
Il est bien fait une discrète allusion aux locataires célèbres de certains cimetières parisiens que j’aimerais bien moi aussi visiter avant de mourir, même si mon inclinaison naturelle va plutôt vers les sépultures de quidams sans fleurs ni prières. Leur stèle, visitée ou négligée, témoignent de l’image qu’ils sont laissée. Cela permet à l’auteur d’évoquer des célébrités et l’œuvre qui leur survit parfois mais aussi, et accessoirement, de justifier la présentation qui est faite de lui-même d’un homme cultivé. Mais ce que j’attends des poèmes c’est qu’ils m’émeuvent et là je suis resté sur ma faim. Je ne suis pas un fan de la prosodie, tant s’en faut, mais certaines rimes sont des plus faciles. Vous avez dit poèmes iconoclastes ? Pourquoi pas après tout et au moins ce n’est pas sinistre car il n’y a rien de plus triste que la mort.
La quatrième de couverture nous rappelle que « philosopher c’est apprendre à mourir » et nous convie à une promenade dans les cimetières, pour apprendre à philosopher. Pourquoi pas ? En tout cas, philosophes ou non, fatalistes ou croyants dans un monde meilleur, nous sommes tous mortels et un jour ou l’autre nous nous retrouveront dans ces endroits où nous serons tous égaux dans le néant.