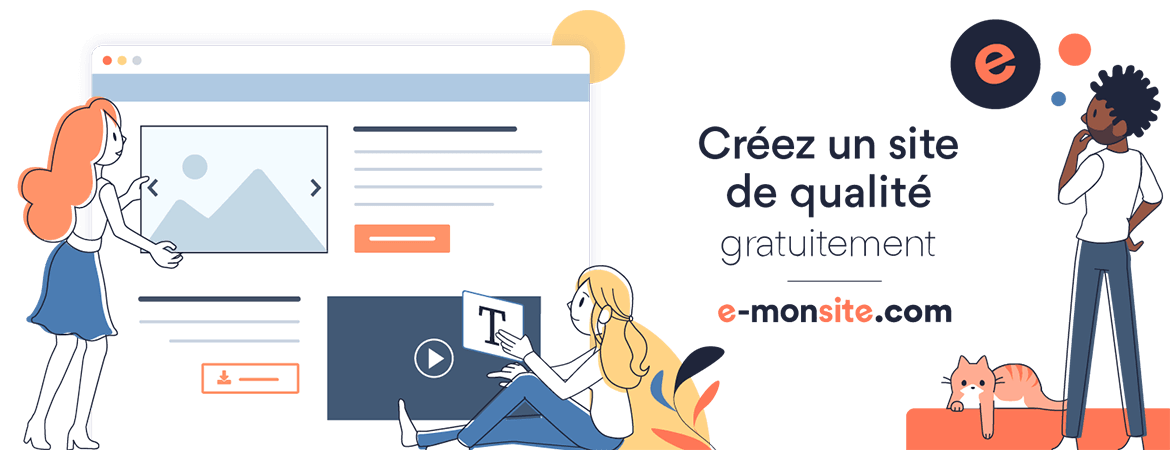Philippe Claudel
-
compromis
- Par ervian
- Le 12/05/2019
- Dans Philippe Claudel
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1349 – Mai 2019.
Compromis – Philippe Claudel – Stock.
Denis, la trentaine, comédien raté à tête patibulaire, veut vendre son vieil appartement et pour signer le compromis de vente, a demandé à son ami Martin, dramaturge sans succès, d'être présent pour rassurer l'acheteur. La conversation débute entre eux au sujet du débat Giscard-Mitterand avant les élections présidentielles de 1981 et les espoirs qu'elles suscitent, se poursuit sur eux-mêmes, sur leur métier, leurs petits travers, leurs difficultés et bien sûr leurs échecs. Avant l'arrivée de Duval, l'acquéreur, Martin passe l'appartement au peigne fin et donne son avis à Denis, sans lui faire beaucoup de cadeaux. En réalité, avant même que commence la visite des lieux, c'est à un véritable duel entre les deux « amis » auquel nous assistons, un de ces règlements de compte entre deux authentiques losers, deux « bobos » de gauche, où l'on déterre des vengeances accumulées et des haines recuites, et quand Duval arrive cela ne fait qu'empirer au point que ce dernier se demande ce qu'il est venu faire là. Quant à être rassuré, c'est autre chose ! Duval semble, au début, entrer dans ce jeu un peu bizarre et même prendre plaisir à cet étrange échange, mais cela ne dure qu'un temps et le lecteur n'est pas au bout de ses surprises …
Ici, Phillipe Claudel abandonne la poésie et l'émotion que j'ai tant appréciées dans certains de ses différents romans mais ne se départit pas d'un certain regard critique jeté autour de lui sur la société des hommes. Dans cette sorte de mise en abyme, c'est l'amitié, même vieille, qui en prend pour son grade et l'auteur, du moins en apparences, donne un coup de grâce à ces liens qu'on prétend artificiellement indestructibles. On se dit des vérités, on s'accuse mutuellement. A cette occasion il ne manque pas de dénoncer l'hypocrisie en général qui habille beaucoup de nos actes et pendant qu'il y est, le mariage, l'amour, y passent aussi sans oublier la solitude, le mensonge, l'imaginaire, le monde des écrivains, celui de l'édition (« Beaucoup d'immenses génies ont d'ailleurs un jour renoncé à publier. Toute publication engendre d'insupportables malentendus ») et même celui du public pourtant indispensable à qui fait profession d'écrire et qu'il traite bizarrement(« Le public, de roman ou de théâtre, est généralement idiot. »). Il n'oublie personne et logiquement ce pauvre Duval, franchement déstabilisé, a droit lui aussi aux critiques. Au long de cette histoire, d'ailleurs brève mais intensément électrique, le terme « compromis », d'emblée dédié à une vente immobilière, prend un tout autre sens et on se demande si tout cela ne parle pas tout simplement du quotidien, de la vie et surtout de la politique, de celle de Mitterrand en particulier.
C'est jubilatoire , humoristique mais aussi grinçant tant les protagonistes sont changeants et il n'y a pas que ce pauvre Duval qui est malmené, le lecteur-spectateur l'est également, les romans de Claudel ont toujours un petit côté dérangeant.
D'ordinaire, je suis peu friand de la lecture de pièces de théâtre, préférant de loin les voir mises en scène. Ici, les détails notés entre les phases du dialogue donnent une petite idée du jeu des acteurs et on imagine Pierre Arditi, Michel Leeb et Stéphane Pézerat se donnant la réplique avec gourmandise. Cette pièce a été créée en Janvier 2019 au « Théâtre des Nouveautés » dans une mise en scène de Bernard Murat.
©Hervé Gautier.
-
Le paquet
- Par ervian
- Le 03/11/2018
- Dans Philippe Claudel
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1288
Le paquet - Philippe Claudel - Stock .
Il est bizarre cet homme, on dirait une sorte de SDF. Nous le voyons assis sur un banc public, traînant derrière lui un lourd paquet, aussi gros que lui et tout au long de cette pièce en un acte et le spectateur-lecteur pourra toujours fantasmer sur son contenu au rythme des marques d'intérêt qu'il lui témoignera. Sur la scène où il est seul, il se laisse aller à la philosophie, mais à celle des halls de gare ou de comptoirs de bistrot, dans ces endroits où l'on refait le monde sans que quiconque ne vous ait demandé quelque chose. Bien sûr il va nous parler de ses amis, de ses voisins, de sa femme aujourd'hui décédée, de ses souvenirs de jeunesse, s'adonne volontiers au début, à sa passion pour l'alexandrin qui, à l'entendre, est naturelle chez lui bien que cette figure de style ne réapparaisse pas au cours de son intervention. Il se met à disserter, passant volontiers du coq à l'âne, sur l'amour, les slogans publicitaires, son psychiatre, le service militaire, le déclin de la France, la mort ...C'est un peu comme s'il vidait son sac, une ultime fois avant le grand saut. Le regard qu'il porte sur la société dans laquelle il vit donne lieu à des remarques pleines de bon sens et qu'il serait bon de méditer. Par exemple « L'imbécile donne de l'espoir. C'est sa mission sur terre. C'est d'ailleurs pour cela que dans les pays progressistes et démocrates nous en élisons un à la tête de l’État. ». On ne saurais être plus précis ! Pourtant, au fur et à mesure on voit bien qu'il est victime de tous les malheurs du monde. On ne sait vraiment pas trop qui il est, entre un modeste employé de banque ou un homme d'affaires important. On se perd autant dans ses confidences que dans ses remarques sur la société présentée alternativement comme dangereusement consumériste et menacée par la mondialisation. Pour s’exprimer, il choisit tour à tour le sérieux et l'humour et cela finit par ressembler à une sorte de délire verbal à la fois incohérent et décousu, et nous ne savons pas trop s'il faut en rire ou en pleurer !
Il s'agit d'un monologue, pire peut-être d'un soliloque pendant lequel il prend les spectateurs à témoin, leur parle du loto, de recettes de cuisine, des progrès techniques et de lui bien entendu et de ses malheurs et de ses failles. Finalement, il change de ton, abandonne son humeur un peu badine du début pour se concentrer sur une phrase tronquée, lue sur la vitre du métro parisien « Chacun mérite ce qu'il a, le riche sa fortune, le pauvre son... » . Cette interrogation va se transformer en un quête éperdue et définitivement vaine et se terminer par une sorte de confession un peu surréaliste. Cette pièce écrite et mise en scène par l'auteur a été créée en janvier 2010 au Petit Théâtre de Paris et interprétée par Gérard Jugnot.
J'aime bien Philippe Claudel quand il choisit d'écrire un roman où le dépaysement et la poésie sont au rendez-vous. Je l'ai assez dit au fil de cette chronique. Là j'avoue que j'ai un peu décroché, peut-être pas compris grand-chose et je suis peut-être passé à côté d'un chef-d’œuvre, à part que cet homme est bien seul, entre vide et angoisse, à l'image de nombre de nos contemporains et peut-être de nous-même. Le monologue qu'il mène souligne ce trait (Je note aussi que l’écriture est aussi une forme de soliloque) qui est à la fois une réalité et un lieu commun dans notre société. C'est évidemment bien écrit, mais d'une manière plus quelconque et ordinaire qu'à l'accoutumée mais je m'attendais à autre chose et, le livre refermé, je suis partagé et je dois bien avouer que, n'ayant pas retrouvé ici l'auteur que j'aime lire, je suis un peu déçu..
© Hervé Gautier – Octobre 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Quelques-uns des cent regrets
- Par ervian
- Le 30/10/2018
- Dans Philippe Claudel
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1286
Quelques-uns des cent regrets- Philippe Claudel – Stock.
Le narrateur revient dans son village natal, après seize longues années d'absence, pour assister aux obsèques de sa mère. C'est évidemment pour lui l'occasion d'explorer les souvenirs de son enfance qui lui reviennent à la mémoire. Il revoit l'image de cette trop jeune fille qui avait déjà donné la vie avant même d'entrer dans l'âge adulte, qui avait, pour son fils unique, tressé l'histoire d'un impossible amour avec un aviateur de passage que la guerre lui avait enlevé mais dont la seule photo trônait dans sa chambre comme la marque de la fatalité mais aussi celle d'un bonheur trop tôt envolé. L'enfant avait vécut toute sa jeunesse dans cette absence à la fois héroïque et vide, le corps de ce combattant n'ayant jamais été retrouvé.
Au cours de ses déambulations dans le village, le narrateur revoit cette jeunesse passée auprès de cette mère célibataire qui travaille durement pour élever son enfant. Il revoit ses tribulations de jeunesse, ses années de dur apprentissage de la vie où il l'aidait gauchement à gagner leur pain en servant de factotum d'occasion aux commerçants ambulants les jours de marché. Ainsi apprit-il, bien souvent à ses dépens, à connaître l'espèce humaine capable du pire comme du meilleur mais bien souvent du pire et à se tricoter une philosophie pour la future existence qui l'attendait. Leurs visages, leurs manies, leurs boniments resurgissent aussi et cela donne lieu sous la plume de notre auteur à une galerie de portraits originaux qui n'a d'égal que la description savoureuse de quelques habitants de ce coin perdu, coincés entre un comptoir de bistrot et un banc public, à attendre eux aussi une mort qui tarde à se manifester. Et puis il est parti pour découvrir le monde, comme le font tous les enfants, abandonnant cette femme à la pauvreté, au travail ingrat, au mépris et à la condescendance des riches, à la solitude aussi
Pour suivre le cercueil il est bien seul et accomplit le dernier geste d'un fils qui n'a même pas pu voir sa mère vivante une dernière fois. Ses souvenirs à la fois amers et sucrés de cette enfance ne sont pas les seuls à se réveiller. Ils sont accompagnés de fantômes qui eux aussi s'agitent dans sa mémoire. Refaire ainsi le chemin à l'envers donne le vertige avec son cortège de fantasmes, d'espoirs déçus, de regrets et de remords. Il a certes abandonné cette femme et cette famille étriquée mais il a surtout fuit l'hypocrisie et les mensonges qui y régnaient. C'est que cette femme part avec un secret qui a, il y a bien longtemps, provoqué la fuite de cet adolescent. Il y a des vérités qu'on ne veut pas voir tant elles sont difficiles à admettre et les ombres de ce passé et leur nombreux non-dits s'offrent maintenant à lui mais il refuse de les affronter parce que, sans doute, il les connaît déjà. Il ressent maintenant avec plus d'acuité peut-être la honte d'avoir ainsi abandonné sa mère à qui il ne peut même plus demander pardon, autant qu'il prend conscience, face à tous ces morts , de tout ce que cette famille lui avait si longtemps caché. Ce qui n'est pas autre chose qu'une trahison face aux secrets et aux souffrances inavouables d'une famille engluée dans le silence met en lumière sa propre naïveté, sa crédulité innocente d'enfant qui maintenant découvre les choses dans leur triste réalité. Ravaler sa haine l'a sans doute aidé, tout au long de son existence, à supporter l'injustice, le silence et même un certain mépris, surtout quand ils viennent de nos proches !
C'est toujours un plaisir de lire Philippe Claudel, quel que soit par ailleurs le sujet traité ; Le texte, toujours poétique, est une invitation au rêve pour le lecteur et l'épilogue est à la dimension de ce roman émouvant. Notre auteur parvient même à instiller quelque humour dans cette question difficile tant le secret est commun à beaucoup de familles.
© Hervé Gautier – Octobre 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Le bruit des trousseaux
- Par ervian
- Le 28/10/2018
- Dans Philippe Claudel
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1285
Le bruit des trousseaux- Philippe Claudel – Stock.
Ce petit livre d'à peine cent pages, au petit format, n'est pas un roman, c'est une sorte de recueil de pensées, une compilation de de remarques, de moments, de réflexions autour du thème de la prison et de ceux qui la peuplent, détenus et gardiens, le bruit des trousseaux évoquant évidemment les clés qui accompagnent l'univers carcéral. Philippe Claudel nous dévoile ici un pan de sa vie d'ailleurs assez long, onze années pendant lesquelles il a fréquenté la maison d'arrêt de Nancy, non comme pensionnaire mais comme professeur professionnel, une fonction différente de visiteur de prison qui serait chargé de cours. Il a été le « Prof » , le « Maître » pour une foule de gens, souvent peu intéressés, souvent même analphabètes et pour qui la culture ne représente rien, qui ne venaient à ses cours que pour passer le temps, échapper au rituel et à l'inaction du quotidien et avoir, à travers son enseignement, un semblant d'évasion temporaire. Il a donc été cet être différent qui passait régulièrement les portes du pénitencier pour apporter son savoir, c'est à dire faire entrer la littérature à l'intérieur de l'univers carcéral pour préparer peut-être à une meilleure réinsertion. Ses mots à lui sont différents de ceux qui hantent ces lieux, gardiens, avocats, visiteurs, policiers, aumôniers ou assistants sociaux. Il fait figure d'extraterrestre, celui qui ne juge pas qui n'a pas d’à priori non plus, parle d'autre chose que de code pénal ou de cours d'Assises, même s'il est en présence d'exclus temporaires de la société. A lui les détenus parlent différemment et pour notre auteur, le dialogue qu'il peut avoir avec eux est d'une autre nature plus humaine, plus accessible peut-être. Pour lui, ceux qui viennent l'écouter sont ses élèves, qu'ils aient tué, violé, dealé ou braqué une banque. C'est un peu comme s'il faisait semblant de rien, comme si rien ne s'était passé pour eux, un peu comme on fait dans la vie courante !
De la fréquentation de ces lieux, il a retiré une foule d'images, d'odeurs, de postures, de refus, de fantasmes, d'illusions et d'espoirs. Il y a des visages, des morceaux de vies… Cela l'a remis en face de ses certitudes sur l'espèce humaine, lui a peut-être donné la vraie valeur de la liberté, celle de chaque jour, celle d'aller et venir que la société, dès lors qu'elle condamne au nom de la loi et de l'ordre public, refuse aux prisonniers. Bizarrement, et contrairement sans doute à ce qu'on pourrait penser vu de l'extérieur, l'évasion,réservée à quelques caïds de la pègre, reste un fantasme pour la plupart et ne nourrit que la fiction du cinéma ou du roman. Ce sont des visions fugaces qui mettent, l'espace d'un moment, l'accent sur l'aspect contradictoire, humoristique, tragique que la vie peut chaque jour lui apporter dans cet espace qui est un microcosme où les choses les plus banales prennent des proportions différentes, comme si les hauts murs d'une prison, le côté punitif et privatif de liberté modifiaient jusqu'au sens des mots, jusqu'à la signification des choses. Cependant il considère son écrit comme un « faux-témoignage » dans la mesure où il n'a pas passé une seule nuit en prison et donc n'a pas pris la vraie mesure de cette vie de reclus. Il ne voit d'ailleurs de la prison que ce qu'il entend de la part des détenus… et les murs délavés des couloirs qu'il traverse. Il dit d'ailleurs volontiers à qui veut l'entendre, non pas qu'il « sort de prison » quand il quitte l'établissement, ce qui pour le commun des mortels que nous sommes , implique procès, condamnation, emprisonnement, inscription au casier judiciaire… c'est à dire quelqu'un qu'on classe définitivement dans la catégorie des délinquants voire des criminels, mais « qu'il sort de la prison » ce qui pour lui est bien différent. Cette expérience a dû le marquer, être un moment particulier dans sa vie, parce que, dans ce livre, il parle peu de lui, ce qui chez un écrivain est assez rare, le solipsisme guettant toujours celui qui tient la plume
L'écriture est sobre et sans fioriture, les paragraphes courts comme des flashs sont agréables à lire et j'ai retrouvé avec plaisir ce style poétique qui pour moi correspond toujours à un bon moment de lecture.. Sans vouloir faire de parallèles toujours difficiles et réducteurs, cette lecture m'a rappelé les poèmes en prose de Léon-Georges Godeau, pas le Godot de Samuel Becket qu'on attend désespérément, mais le poète du quotidien et du Marais Poitevin. Quand j'ai pris ce petit livre sur les rayonnages d'une bibliothèque, je me suis dit que j'en aurais vite terminé. Et pourtant, au fur et à mesure de ma lecture, j'ai eu l'impression que je n'avançais pas, que la dernière page s'éloignait, que retardait le moment où j'allais refermer ce livre ! Le signe sans doute de l'intérêt que ce petit ouvrage a suscité.
© Hervé Gautier – Octobre 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Parfums
- Par ervian
- Le 13/10/2018
- Dans Philippe Claudel
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1281
Parfums - Philippe Claudel – Stock.
Philippe Claudel égrène ses souvenirs d'enfance et d'adolescence mêlés à travers les fragrances qui les ont accompagnés. Ils sont attachés à son terroir lorrain , aux années difficiles et pauvres, Sa madeleine de Proust à lui c'est plutôt le charbon âcre qui prend à la gorge dans la rue des corons, les senteurs de moissons ou de pain chaud du matin. Il évoque la maigreur des jeunes années, les maladies infantiles, les cheveux portés ras et la phobie de choses inconnues qui plus tard le feront sourire, celle de l'hydrocution qu'on appelait pas encore comme cela, du respect du temps de la digestion avant de se baigner, l'odeur collante et grasse de la crème qui évitait les brûlures du soleil, les rituels des incontournables colonies de vacances, Plus tard se seront l'euphorie des terrains de foot, le recueillement craintif dans le mystère des églises, les messes servies dans l'odeur entêtante des cierges et de l'encens, une foi qui sera définitivement balayée par le raisonnement de la maturité, l'auteur dénonçant cette religion pas vraiment « en odeur de sainteté »! Puis viendront les tribulations du potache boutonneux qui fantasme sur les plus jolies filles de sa classe mais doit se contenter de la plus moche, les bals et les « surprise-party », les pantalons pattes d'éléphant et les minijupes, les cigarettes au goût mentholé, les « blousons noirs », les juke-box et les mobylettes pétaradantes et trafiquées… Il poursuit son chemin au rythme de sa vie et de ses souvenirs, Certains s'accrochent aux fragrances d'une eau de toilette, aux effluves qui suivent, comme une écharpe suave, la silhouette d'une passante, aux arômes d'alcool qui sortent d'un alambic de campagne ou qui embaument l'été de ses odeurs de foin coupé, à celles de la salle de « la communale » faites de craie et d'encre avec le crissement de la plume d'acier et ses calligraphies de pleins et de déliés, celles de colle blanche ou de l'eau de Javel... Quand il nous parle d'une chambres d'hôtel, ce n'est pas dans un palace, c'est pour évoquer des souvenirs de vacances d'été, c'est à dire pas ce que j'aurais pu imaginer avec mon mauvais esprit. Il n'oublie pas non plus l’effluve des vieux livres qui embaument les bibliothèques et qui, bien entendu, donne naissance à cette irrésistible envie d'écrire, celle de la résine des sapins et la fraîcheurs des sous-bois, « les parfums des corps qui s'aiment » dont le réveil nous fait l'obole quand la nuit n'est plus qu'un souvenir et le rêve des images qui s'effacent.
Il collige par ordre alphabétique, en commençant par « acacia » et terminant par « voyage » les différents parfums qui ont fait partie de son existence, qui n'est cependant pas terminée, et l'hédonisme prend souvent le dessus quand il s'agit de nourritures terrestres, Quant au sexe des femmes, il trouve, pour en parler, les mots du poète passionné et ému par leur corps, image de la beauté, de la tendresse et de la volupté.
Parfois les parfums se transforment en puanteur, l'haleine chargée d'apéritifs anisés des adultes, la fumée bleue de leurs cigarettes qui enroue la voix, le remugle des pièces jamais aérées à l'atmosphère moisie d'un air cent fois respiré… Il nous confie son attachement aux antiques pissotières et ses relents d'urine, à l'odeur du poisson juste pêché, à la sueur de l'effort ou des journées du dur labeur, mais aussi aux douces fragrances de torréfaction que les hasards d'une rue offrent au passant. Ce sont les marques de la vie, des senteurs évadées d'une géographie urbaine et rurale familières et qui s'attachent à un lieu-dit ou à un quartier, nommés ici par leur nom et les mots de notre si belle langue française sont convoqués pour exprimer ces émotions intimes et parfois fugaces. Ce ne sont plus vraiment des parfums mais les images et les odeurs qui jalonnent nos vies, nourrissent notre mémoire, maintiennent nos sens en éveil, s'attachent aux êtres et aux choses dont le destin est de disparaître parce qu'il en va ainsi de toutes les choses humaines. Malgré soi on embellit les moments passés, la nostalgie prend parfois le dessus et le temps lui-même s’abolit. C'est pourtant à l'aune de cela qu'on le mesure ce temps passé qui donne parfois le vertige, et aussi, le vieillissement, notre avancée vers la mort
Ce sont de courts textes baignés de poésie et j'ai retrouvé avec plaisir cette manière coutumière de l'auteur de faire chanter les mots et d'émouvoir son lecteur.
© Hervé Gautier – Octobre 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
L' archipel du chien
- Par ervian
- Le 21/09/2018
- Dans Philippe Claudel
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1277
L'ARCHIPEL DU CHIEN – Philippe Claudel – Stock.
Le Brau est un volcan qui domine l'île d'un archipel dont la forme générale rappelle celle d'un chien. Elle se caractérise par une terre généreuse, une mer poissonneuse et on envisage même d'y exploiter une source thermale. Tous les gens qui l' habitent sont nés ici et sans doute y mourront, de quoi cultiver l'envie de rester entre soi. Tout le monde, sauf l'Instituteur, un poète curieux de la science, égaré sur cette île, qui vient d'ailleurs, autant dire une étranger dont on se méfie, dont on épie les faits et gestes et qu'on évite autant que possible ! Il est l'archétype de celui qui vit différemment des autres et qui, bien entendu dérange par sa présence même. Il apprendra à ses dépends cette haine dont il est l'objet et prendra conscience de l'importance de cette intolérance. Un matin trois cadavres de migrants noirs s'échouent sur une plage et il faut s'en débarrasser en catimini, de quoi bousculer la routine de ce microcosme et le Maire intime l'ordre aux rares personnes qui sont dans la confidence de cet événement d'en garder le secret en évitant d'avertir les autorités. C'est la première fois qu'un tel événement à lieu sur cette île et il est bien de nature à contrecarrer tous les projets d'avenir et notamment celui des Thermes. Chacun réagit à sa manière et avec sa traditionnelle posture face à ce problème et Claudel choisit d'en dresser le catalogue à travers des types sociaux, tous affublés d'une majuscule pour plus de solennité. On s'en serait un peu douté, l'Instituteur est opposé au Curé, un vieil homme de plus en plus sceptique sur son ministère et même sur sa foi et qui s'intéresse davantage à l'apiculture qu'à ses ouailles, le Docteur qui ne se départit jamais de son masque souriant qui lui sert à la fois de bouclier et et de réponse à tout, la Vieille, une femme pleine de bon sens et qui pratique le franc-parler, le Maire, plus malin qu'il y paraît, soucieux de l'intérêt de sa commune mais qui profite de sa position pour imposer ses ordres à tous, « Amérique » et « Le Spadon » deux hommes du peuple qui obéissent sans sourciller aux diktats du premier magistrat. A l'extérieur, il y a la foule des anonymes, manipulable, réceptive aux peurs ancestrales comme aux images chocs et prompte à réagir avec aveuglement. La mise en scène quasi mystique des aveux de la petite Mila illustre à la fois le côté artificieux des choses et cette volonté de mystification. L'auteur dépeint sans concession le microcosme, ce « petit monde » qui est une illustration de l'espèce humaine.
L'air de rien, Claudel met le doigt sur un problème brûlant et qui ira s'amplifiant à cause de raisons sociologiques, politiques, climatiques, économiques, celui de la migration. C'est vieux comme le monde mais cela met chaque fois en évidence les mêmes réactions, égoïsme, peur et rejet de la part des populations établies, volonté de s'installer, de s'intégrer pour un avenir meilleur en étant le plus transparent possible, pour les migrants. Il dénonce aussi le désengagement de l’Église, l'hypocrisie de la société, ses mensonges... Il le fait avec humour qui, comme nous la savons est une arme bien plus efficace que la violence et les mots qu'il emploie mettent en évidence un sens de la formule de bon aloi qui traduit un regard aiguisé sur la marche du monde.Le style est fluide, pertinent et agréable à lire.
Tout serait allé pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles si un Commissaire, alcoolique, misanthrope, imprévisible mais surtout perspicace et grand connaisseur de la nature humaine,, précédé de l'ombre des satellites qui voient tout depuis le ciel , n'était venu perturber ce bel agencement. Pour autant sa présence ne suffit pas à transformer ce roman en thriller et d'ailleurs, là non plus, on est sûr de rien puisque le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une immense mascarade, qu'une vaste tartufferie. Pour que la fable soit parfaite on y ajoute une odeur pestilentielle qui s'installe sur l'île, des grondements intempestifs du volcan , une chaleur étouffante et la révélation d'un crime qui n 'a rien à voir avec la présence du policier et qui est bien entendu imputé à quelqu'un qui n'y est pour rien mais dont on veut se débarrasser, une sorte de version moderne du « bouc émissaire ».
L'épilogue est étonnant et toute cette affaire bien différente de ce qu'on pouvait imaginer même si au passage l'auteur dénonce cet instinct grégaire collectif au terme duquel on s'arroge le droit de juger et de détruire avec bonne conscience, en espérant que l'oubli recouvrira tout cela.
J'ai lu ce roman comme une fable sur l'espèce humaine capable du pire comme du meilleur mais bien souvent du pire et qui parvient tant bien que mal à vivre avec ses turpitudes. Je ne suis cependant pas sûr que la punition, sorte de justice immanente, soit toujours là pour sanctionner toutes les avanies des hommes.
© Hervé Gautier – Septembre 2018. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Les petites mécaniques
- Par ervian
- Le 12/11/2017
- Dans Philippe Claudel
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1185
Les petites mécaniques – Philippe Claudel- Mercure de France.
Un recueil de nouvelles est toujours un univers délicat. Ici tous les textes qui le composent sont liés à la mort et l'auteur nous transporte par les mots dans un Moyen-Age obscur où la camarde rôdait dans les villes et les campagnes parce que les guerres étaient fréquentes, l'insécurité quotidienne, la paix publique un vœu pieux et la santé un don de Dieu ou dans un espace indistinct où le temps se confond avec le rêve ou avec le cauchemar.
De nos jours, si les choses ont un peu changé (encore que) nous sommes toujours les usufruitiers de notre propre vie et elle peut-être interrompue à tout moment, surtout quand nous y attendons le moins. En occident, allez savoir pourquoi, on nous entretient dans cette ignorance de la mort ou à tout le moins dans l'oubli de sa réalité, comme si nous étions perpétuellement attachés à cette terre. Est-ce parce que la religion chrétienne nous assure de la réalité, mais dans un autre monde seulement, d'une vie qu'elle nous dit, avec cependant un évident abus de vocabulaire, éternelle, je ne sais pas, mais ce que je sais c'est que, dans d'autres cultures pourtant contemporaines on regarde davantage la mort comme une réalité et on célèbre les morts lors de manifestions festives quand notre Toussaint n'est que l'occasion de faire refleurir les cimetières même si les morts sont oubliés le reste de l'année.. Elle fait tout simplement partie de la vie dont elle est la fin naturelle parce que nous ne sommes sur cette terre que de passage. Ce n'est pas faute de lui avoir donné les traits effrayants d'un squelette armé d'une faux et habillé d'un suaire alors que dans l'Antiquité c'était trois femmes qui étaient chargées de filer puis de trancher le fil de la destiné.
Dans l’interruption de la vie, la mort a différents visages, l'accident, l'attentat, le meurtre la maladie… ceux qui choisissent le suicide n'ont pas la patience d’attendre le terme et nous invitent à nous interroger sur la liberté ou sur le destin. Nous sommes, à titre temporaire, titulaires d'un contrat à durée indéterminée que nous n'avons ni voulu ni signé, qui de plus en plus fait de nous des emphytéotes et nous devons à d'autres d'être ici. Ils nous chargent souvent d'assumer nous- mêmes le choix qu'ils ont fait pour nous, quand ils ne nous mettent pas eux-mêmes des bâtons dans les roues. Au cours de cette vie nous avons l'occasion de vérifier la fragilité des choses humaines, la jeunesse, la beauté que chassent l'oubli et le silence envahissant qui se marient si bien avec la vieillesse et la douleur. Les écrivains attentifs matérialisent par l'écriture tous ces parcours réels ou imaginaires, héroïques ou banals, ils manient les mots et transforment en chefs-d’œuvre ou en bluettes ces « bien petites mécaniques égarées dans l'infini » que sont nos vies. Avant la mort, il y a la vie, ce long combat mené le plus souvent pour rien parce qu'il est aussitôt oublié par ceux qui restent, avec, pour chacun d'entre nous une sorte d'étoile.à laquelle nous croyons et que nous voulons atteindre. Au bout du compte, c'est souvent un échec, un vrai combat dont nous sommes les victimes pourtant pleines de bonne foi et de bonne volonté. Ainsi, après un tel parcours marqué par des souvenirs, des échecs, des regrets et des remords, des espoirs déçus et des projets avortés, la mort devient-elle une délivrance salutaire d'une existence qui s'arrête enfin.
J'ai eu plaisir, une nouvelle fois, de retrouver le style poétique de Philippe Claudel, toujours aussi émouvant et plein de sensibilité, malgré le thème proposé..
© Hervé GAUTIER – Novembre 2017. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
L'arbre du pays Toraja
- Par ervian
- Le 21/10/2017
- Dans Philippe Claudel
- 1 commentaire
La Feuille Volante n° 1178
L'arbre du pays Toraja – Philippe Claudel – Éditions Stock.
Dès les premières lignes de ce roman il est question de la mort et de ce rituel observé au pays des Toraja en Indonésie où l'on confie la dépouille des jeunes enfants à un arbre particulier dont on creuse le tronc à cet effet et qui referme son écorce sur cette sépulture ainsi constituée et d'une certaine manière aussi se nourrit des défunts qu'on lui confie. Le ton est donné, Il sera donc question au cours de ces deux cents pages d'un thème tabou dans nos sociétés occidentales qu'on cherche à oublier toute notre vie et qui se rappelle cependant à nous périodiquement quand un de nos proches décède. Ce fut le cas du narrateur qui évoque le cancer de son ami Eugène, un producteur de cinéma, qui mourut peu après mais aussi la venue au monde de son enfant mort-né. Il réfléchit donc sur le sens de nos vies, des événements qui arrivent, voulus par nous ou gouvernés par le hasard, du temps qui passe et de ses ravages sur nous. Cette réflexion se décline à travers l'alpinisme, le vieillissement du corps qui débouche sur la douleur, la maladie et le trépas, comme un scénario écrit à l'avance et qui concerne chacun d'entre nous.
Bien entendu Philippe Claudel nous parle de lui, de ses origines modestes, de son travail d’écrivain et de cinéaste, de ses amours, de ses amis, cultivant le solipsisme, ce qui est normal pour un auteur qui puise dans sa vie la substance de son œuvre. Il évoque aussi cet Eugène, son ami, au moment où il ne fait plus partie du monde des vivants. C'est aussi pour lui l'occasion de méditer sur la mort, sur l'amitié, sur la vie, sur les vivants, ceux qui mangent, boivent, fument et font l'amour. Mais quid de notre corps qui nous accompagne durant cette période terrestre ? Quid des amours surtout quand ils unissent anachroniquement la vieillesse d'un homme et la jeune beauté d'une femme, qu'ils perpétuent ainsi un pieux mensonge qui construit un bonheur artificiel et bien entendu temporaire ? Nous ne sommes sur terre que de passage en espérant trouver pendant cet intermède un peu de bien-être et quand nous la quittons, la trace que nous y laissons, surtout si elle est artistique, est éphémère et confiée à la fragilité de la mémoire d'autrui, elle-même insérée dans la vie d'autres mortels. Le narrateur nous parle de son parcours professionnel, de cette femme plus jeune qu'il a rencontrée et qui partage désormais sa vie. Parfois, à l'occasion d'un mot ou d'un geste, sa première épouse s'invite entre eux, comme un fantôme discret et qui, malgré elle le convie à remonter le temps ce qui distille regrets et remords. Il parle de ses craintes pour l'avenir, de ses rides qui s'annoncent et de cette mort qui nous attend tous et dont nous voulons oublier la réalité.
Ces réflexions tissent ce roman qui devient au fil des pages et pour Eugène, cet arbre de Toraja qui garde son souvenir autant qu'il s'en nourrit. C'est aussi, non pas un devoir, mais un acte de mémoire pour cet ami disparu qui a joui de son séjour sur terre et qui, petit à petit se voit disparaître dans la maladie et la douleur. Et lui de rappeler Montaigne qui redoutait moins la mort que « le mourir », cette prise de conscience de ce passage de l'état d'être à celui de non-être, de cet abandon de quelque chose de connu et d'aimé, de ce saut dans le néant et qu'il était bon de s'y préparer car « philosophe c'est apprendre à mourir ». Les mots de Claudel portent le témoignage de cet ami, une manière aussi de dire à ses lecteurs que dans sa diversité la vie est unique et que l'amour que donnent les femmes l’illumine.
J'ai toujours plaisir à lire Philippe Claudel, de roman en roman. Ici, ce n'est pas un texte mortifère comme on aurait pu s'y attendre mais une réflexion bienvenue sur la vie, l'amour, l'amitié, le temps qui passe, tout ce qui concerne notre pauvre condition humaine.
© Hervé GAUTIER – Octobre 2017. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Au revoir Monsieur Friant
- Par ervian
- Le 13/10/2017
- Dans Philippe Claudel
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1175
Au revoir Monsieur Friant – Philippe Claudel - Stock
Émile Friant (1863-1932), peintre naturaliste français était lorrain, tout comme l'auteur. Philippe Claudel commence par évoquer l'image de son arrière-grand-père, fauché à 29 ans par les ravages de l'absinthe et du gros rouge, à cause sans doute de ce tableau où le peintre représenta des « buveurs ». Pourtant c'est de sa grand-mère qu'il choisit de nous parler, celle qui était déjà vieille quand il fit sa connaissance et qui perdit son mari trois mois avant l'armistice de la « Grande Guerre », fauché par la mitraille et un éclat d'obus. De lui ? il lui restait ce morceau d'acier meurtrier et une photo couleur sépia qui avait perdu son éclat à force de caresses et de baisers qu'elle déposait chaque soir après lui avoir parlé de sa journée. Elle était éclusière sur le canal de Dombasle où l'enfant voyait glisser les péniches et y passa sa jeunesse dans le froissis de l'eau et la pêche à la ligne. Elle s'invite dans ce roman, presque malgré lui, nous dit-il, mais dans « Le café de l'Excelsior » (La Feuille Volante n° 620), un précédent roman, où les femmes n'étaient évidemment pas admises, c'est bien son image virtuelle à elle qui se reflétait dans les miroirs de l'estaminet. Est-ce parce que ce peintre de l'école de Nancy choisit de montrer des scènes d'un quotidien bourgeois que Claudel souhaite l'évoquer ?. Peut-être mais sa grand-mère n'appartenait pas à cette classe sociale et tenait sans doute à ses quartiers d'authentique roture. Est-ce parce que certains tableaux évoquent des inaccessibles jeunes filles en fleur d'un autre temps et que, à la fois timide et inconscient, il poursuivit celles de sa jeunesse ? Plus tard, il jeta pourtant sa gourme entre les bas résille et le parfum bon marché de putes de son quartier et sa jeunesse étudiante rima avec une bohème littéraire qu'il voulait voir durer longtemps et se terminer peut-être sous les ors d'une quelconque académie, la consécration comme celle que connut le peintre? Est-ce parce que Friant peignit « la Toussaint » que notre auteur voulut y voir aussi, dans les brumes de novembre, la fin de ses années de jeunesse, comme la mort est la fin de la vie ?
A n'en pas douter Claudel s'interroge sur le parcours de Friant qui connut tôt le succès et l'entretint par une carrière qu'il juge quelque peu flagorneuse mais qui lui assura une aisance financière et une notoriété grandissante. Il fustige cette manière de monnayer son talent et pense qu'il cessera d'écrire, parce qu'écrire est épuisant, « un arrachement continue de viscères » et surtout pour ne pas tomber à son tour dans ce travers, dans ce qu'il nomme un malentendu. Voire ! Je pense et j'espère qu'il n'en fera rien parce que nous sommes nombreux sans doute à apprécier cet auteur, son style poétique et sa palette créatrice. Et d'ailleurs, il se ravise vite et précise « J'écris pour demander pardon » « pour le mal que j'ai fait autour de moi… ces petits riens, ces maigres trahisons… ces rendez-vous perdus que mes mots ne rachèteront jamais ». Nous avons tous, n'est-ce pas, quelque chose à nous reprocher ! Et puis, il y a quelque parenté lointaine entre le peintre et l'écrivain qui va au-delà de la toile blanche et de la page de la même couleur, qui sont une invitation mais surtout un défi à la création. Il y a sans doute cette envie de faire des ricochets sur l'eau d'un étang, de parler fort et de se rouler dans l'herbe, de brûler cette enfance qui s'attarde dans le rire des filles, les beignets d'acacia et la fragrance de l'eau de Cologne. La nostalgie est là qui fait partie de la vie et qu'on cultive dans l’image comme dans les mots, les souvenirs aussi, ceux qu'on regrette et qu'on ressasse même s'ils font mal.
Émile Friant ne peignit sans doute jamais la grand-mère de Philippe Claudel qui n'était pour lui que sa domestique et qui le saluait en le quittant d'un respectueux « Au revoir Monsieur Friant ». Ses dix-huit ans lui donnait l'illusion que sa vie serait belle, mais il y eut la guerre.. .
Je continue de lire avec un réel plaisir Philippe Claudel, rencontré un peu par hasard sur les rayonnages d'une bibliothèque parce que, ce jour-là, le hasard fit pour moi bien les choses .
© Hervé GAUTIER – Octobre 2017. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
La petite fille de Monsieur Linh
- Par ervian
- Le 03/08/2017
- Dans Philippe Claudel
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1161
La petite fille de Monsieur Linh – Philippe Claudel – Stock.
Depuis que le monde existe, il y a des guerres et avec elles des populations qui fuient les combats et arrivent dans des pays qu'elles ne connaissent pas, dont elles ne parlent pas la langue et ne supportent pas le climat. Ici aucune date, un pays qu'on devine au début, seulement l'hiver froid et humide, mais qu'importe. On peut supposer qu'il s'agit de la guerre du Vietnam et que M. Linh a quitté son pays après la mort de sa fille et de son gendre et emporte avec lui sa petite-fille encore bébé à qui il s'accroche parce qu'il n'a plus qu'elle. Après la peur de la mer, des bateaux, des passeurs, ils arrivent tous les deux en France et leur sort est celui de tous les réfugiés, plus ou moins bien accueillis, plus ou mois bien acceptés, étrangers dans un pays étranger. Il y a en qui s'adaptent parce qu'ils ont l'avenir devant eux et et la volonté de s'en sortir et d'autres qui se recroquevillent sur leur passé, à en devenir fous, mais pour M. Linh, il y a la peur qu'on lui vole sa petite-fille, la nostalgie de son pays qu'il ne reverra sûrement pas, les morts qu'il a laissés là-bas et dont il ne peut que se souvenir, cette langue nouvelle qu'il ne comprend pas et qu'il ne pourra pas apprendre.
Il est difficile de ne pas être bouleversé par ce roman qui met en scène ce pauvre homme ballotté dans un pays qu'il ne connaît pas, plus ou moins rejeté par les siens parce qu'il est pour eux une charge et ce malgré le sourire, l'amitié et la compassion de ce Français, M. Bark , aussi malheureux et solitaire que lui. Ces deux êtres ne parlent pas la même langue, n'ont pas le même parcours, mais ils se comprennent sans avoir besoin de mots et pour eux les larmes suffisent qui en disent plus longs que des discours. C'est un peu comme s'ils partageaient la même folie autour de la petite-fille de M. Linh. qui pourtant n'est présente dans ce roman qu'en pointillés dans le décor changeant de la vie de son grand-père. Chaque homme a une histoire cabossée et souvent tue parce qu'elle fait partie de lui-même, de sa mémoire intime qu'on ne peut partager parce que la douleur est forcément personnelle et que les mots, soit restent dans la gorge et ne peuvent sortir, soit sont impuissants à exprimer ce qu'on ressent. Le partage par la parole, le témoignage oral ou écrit n'est pas la chose la plus aisée et quand notre destin bascule, à cause du hasard ou par la faute d'autrui, le verbe n'est pas obligatoirement libérateur, surtout quand on se heurte, comme ici au barrage de la langue, les solutions apportées par le système de santé pas forcément adéquates et efficaces. Il y a la résilience, la folie, le temps qui gomme tout et le trépas qui efface tout, le souvenir, l'absence, les remords, la culpabilité, la mort sont là aussi et font partie de cette condition humaine à laquelle nul ne peut échapper et avec laquelle il faut vivre, le plus souvent dans le silence. Le drame de M. Linh c'est qu'il a habité un pays qui a toujours connu la guerre, même s'il avait la couleur et le goût du paradis et que la France ne sera jamais autre chose pour lui que le pays de l'exil. Il est surtout difficile de ne pas être ému par l'épilogue, à la fois poétique et dramatique, une sorte de happy-end qui n'est n'est pas vraiment un.
Ce court roman se lit bien et rapidement, le style est spontané, presque naïf et porte dans un rythme soutenu et pourtant assez lent cette histoire où l’empathie du lecteur pour ce pauvre M.Linh va grandissante.
© Hervé GAUTIER – Août 2017. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
L'enquête
- Par ervian
- Le 02/07/2017
- Dans Philippe Claudel
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1151
L'enquête– Philippe Claudel – Stock.
Imaginez un enquêteur missionné pour expliquer une vague de suicides intervenus récemment dans une entreprise. Jusque là, ça va, si on peut dire, sauf qu'il va être confronté à une série d'entraves qui vont retarder son travail, un policier pinailleur, une série de personnages plus falots et bornés les uns que les autres, bref tout une ambiance que n'auraient désapprouvée ni Frantz Kafka ni Georges Orwell tant elle est déshumanisée et pleine d'agressions et d'incompréhensions à l'égard de ce pauvre homme. Il y a heureusement quelques images dignes de Boris Vian. Chacun ne fait que son travail en évitant de prendre des initiatives et personne n'a d'autre nom que celui de la fonction pour laquelle il existe et agit. L'enquêteur dont nous ne connaîtrons pas le patronyme fait ce qu'il peut pour mener à bien sa tâche mais on le sent perdu dans ce monde de plus en plus absurde qui lui échappe et qu'il ne comprend pas. Il a constamment l'impression que quelqu'un derrière lui l'empêche de travailler et même d'exister, et il découvre à chaque instant ce monde insensé dans lequel il est soudain projeté et qui va le broyer. Ce décor impersonnel est souligné par l'absence de raison sociale dans l'entreprise, de toponymie, de nom de famille pour les différents personnages, comme si tout cela était à ce point déshumanisé qu'il n'était même pas utile de les nommer autrement. Le contexte général est aussi étrange et abandonné aux automatismes des machines, aux algorithmes, à l'informatique...On comprend que dans ces conditions que le personnage principal qu'est l'Enquêteur, ressente une sorte de malaise, celui de n'être personne et peut-être aussi de ne pas exister. Il n'est d'ailleurs pas le seul a être affecté par cette étrange atmosphère, chacun réagit différemment mais surtout bizarrement, à tout le moins au regard de la normalité généralement admise, mais en évitant surtout de sortir officiellement de son rôle pour ne pas se faire remarquer dans cette société aussi hiérarchisée qu'anonyme.
J'y vois une critique de la société compartimentée où chacun œuvre dans son coin sans chercher à comprendre autre chose que la tâche qui lui a été assignée. Je dois d'ailleurs dire que certaines descriptions m'ont rappelé des scènes de la vie ordinaire dans nos villes et ce qui est décrit dans cet ouvrage ressemble, par bien des côtés, au quotidien que nous vivons. J'ai lu aussi une vraie désespérance chez cet « Enquêteur », un désarroi, un abandon, un peu comme celui qui nous habite tous quand, nous étant fixé un but et ayant tout fait pour l'atteindre, nous prenons conscience que nous n'y parviendrons jamais. J'y ai vu une sorte d'allégorie de la vie présentée sous des dehors surréalistes et qui peuvent peut-être porter à sourire (encore que) mais que j'ai personnellement ressentie comme une volonté de mettre des mots sur une situation délétère, au moins pour ne pas avoir à en pleurer. De là à penser à la mort, et singulièrement par suicide, il n'y a qu'un pas aisément franchi dans ce contexte. Elle peut être considérée comme une délivrance, n'est plus que la seule solution face à ce combat solitaire et perdu d'avance symbolisé, à la fin, par cette forêt de containers étanches qui sont la manifestation d'échecs personnels. Cela peut être l'illustration de l'inutilité de cette vie dont nous ne sommes que les pauvres usufruitiers, de l'issue du parcours humain qui bien souvent n'ouvre que sur une vaine impasse malgré toute l'énergie et la vitalité qu'on met à atteindre son but. La mort, l'oubli, l'abandon viendront très vite les recouvrir. L'épilogue me semble être une allégorie du « jugement dernier » même si j'ai personnellement une notion diamétralement opposée à ce que la liturgie judéo-chrétienne tente depuis longtemps de nous enseigner non seulement dans le but de nous culpabiliser mais surtout d’instiller en nous la peur panique d'un dieu que par ailleurs on nous présente comme bon et miséricordieux. « C'est en ne cherchant pas que tu trouveras », cette citation quasi-biblique, à la fois sibylline et ouverte à toutes les interprétations, pleine de promesses et de contradictions, conclut ce roman.
A cette lecture j'ai eu aussi l'impression d'avoir affaire, en la personne de l'Enquêteur, au type même du malchanceux à qui rien ne réussit, qui est poursuivi par une sorte de guigne qui affecte son quotidien au point qu'à ce stade de sa vie il a le sentiment, comme l'aurait dit Fernando Pessoa, de n'être rien au regard des autres et à ses yeux mêmes. Il se sent le jouet de cette vie et c'est un peu comme si, ceux qu'il croise, et sans pour autant que se soient donné le mot, s’ingénient à lui pourrir l'existence, par nécessité professionnelle sans doute mais aussi souvent pour le plaisir de se faire ainsi, à eux-mêmes, la preuve qu'ils existent et qu'ils ont de l'importance et du pouvoir. Il devient leur jouet autant que celui de son destin néfaste et tout se ligue contre lui au point qu'il ne lui reste plus que le rêve et même le fantasme pour l'aider à supporter ce quotidien délétère. L'impression est telle que lui-même a l'impression d'être dans le rêve d'un autre.
Et l'enquête dans tout cela, c'est à dire la chose qui a motivé la présence de ce pauvre homme dans cet univers déjanté ? Elle était le vrai motif de sa présence dans cet microcosme mais disparaît vite. C'est un peu comme dans le roman de Boris Vian, « l'automne à Pékin » qui ne se passe ni en automne ni à Pékin et qui parle de tout autre chose.
Je viens de lire « Inhumaines » du même auteur (La Feuille Volante n°1150) et cela ne m'a guère enthousiasmé. Ici, le texte est mieux écrit, lu parfois à haute voix pour mieux goûter la faconde de l'auteur, plus attachant aussi malgré le contexte impersonnel très près de la science-fiction mais aussi d'une certaine réalité que je me suis appropriée. De Philippe Claudel j'avais bien aimé « Les âmes grises » ou « Le rapport de Brodeck ». J'avoue avoir ici renoué avec l'intérêt que je porte à cet auteur.
© Hervé GAUTIER – Juillet 2017. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
Inhumaines
- Par ervian
- Le 30/06/2017
- Dans Philippe Claudel
- 0 commentaire
La Feuille Volante n° 1150
Inhumaines – Philippe Claudel – Stock.
Quand j'ai pris ce livre sur une des étagères de ma bibliothèque préférée, le titre m'a fait penser à quelque chose qui restait de mes lointaines études. « L'inhumaine », c'était, dans le théâtre classique, la femme qui ne répondait pas à l'amour qu'on lui témoignait et la couverture pouvait, avec un peu d'imagination, abonder dans le sens de cette interprétation...
J'ai, dans cette chronique, largement commenté l’œuvre de Philippe Claudel que j'apprécie pour la qualité de son écriture et son souffle subtilement poétique (notamment « les âmes grises », « le café de l'Excelsior »- la Feuille Volante n ° 620- 621...). Ce roman est présenté comme une occasion de rire de tout, une sorte de poil à gratter, un pavé dans la marre, une plaisanterie de potache, une manière un peu bête et méchante de voir les choses qui nous entourent... Il est sans doute tout cela et ces vingt cinq courtes nouvelles ne m'ont pas laissé indifférent. Il y a les histoires un peu déjantées qui nous sont racontées par l'auteur, comme l'homme qui offre à sa femme trois hommes comme cadeau de Noël ou le galeriste qui vend des cadavres gelés de SDF comment illustration de l'art contemporain. Derrière tout cela j'ai choisi, un peu comme Rabelais qui invitait déjà son lecteur a briser l'os pour en retirer la substantifique moelle, de voir plutôt un critique de notre société. Le jeu cruel qui consiste à détruire des véhicules qui circulent sous un pont ne nous rappelle-t-il rien dans une société où la réussite personnelle, portée au pinacle, s’accompagne aussi de l'élimination de l'autre, considéré comme un concurrent, ou ces gens le plus souvent respectables qui aiment tant multiplier autour d'eux souffrances et désolations, souvent pour le seul plaisir d'affirmer leur existence ou leur importance, parce que leur position leur en donne le pouvoir, qu'ils aiment cela ou simplement qu'ils se croient tout permis ? Dans cette société, il ne faut pas hésiter à se vendre pour obtenir un peu de notoriété, de pouvoir... et pour cela on est prêt à tout.
Le sexe envahit chaque jour notre société (et bien souvent dans notre proche entourage) et bien des gens ne pensent qu'à cela et feraient tout, et bien souvent n'importe quoi, pour un petit moment de plaisir. Ici ça va carrément jusqu'à l'obsession, quant à l'adultère, il est devenu carrément banal. C'est peut-être une vue de mon esprit sans doute tordu, mais il me semble aussi que l'auteur règle quelques comptes avec les femmes notamment dans « mariage pour tous ». Par ailleurs, il les met souvent dans des situations où elles n'ont pas le meilleur rôle. J'ai peut-être trop d'imagination, mais dans certains textes, j'ai lu l’indifférence qui va croissante dans notre société et aussi l'hypocrisie qui va avec. J'ai vu aussi ces nouvelles une invitation à s'accepter soi-même, à admettre les ravages du temps sur notre propre corps parce que simplement les choses changent et n'évoluent pas dans le bon sens (« Transhumanisme »).
C'est vrai que tout cela est volontairement excessif et même agressif. Sur le principe, ça ne me dérange pas et rire de tout est plutôt salutaire, d'autant que notre société n'est évidemment pas exempte de critiques, mais quand même... J'avoue que plus j'avançais dans la lecture de ces courts textes, plus ma curiosité du début laissait place à l'agacement et même à la déception d'autant plus que je ne retrouvais pas l'auteur que d'ordinaire j'appréciais. Je me suis peut-être laissé porté par sa volonté de provocation, je n'ai peut-être pas retrouvé le style fluide que j'avais tant apprécié auparavant mais je dois dire que je me suis, pour une fois, un peu lassé à cette lecture. Franchement j'ai lu mieux sous sa plume, mon a priori favorable n'a pas résisté longtemps et je trouve dommage qu'il ait commis ce roman, à mes yeux sans grand intérêt, surtout au regard de ce qu'il a écrit par ailleurs.
© Hervé GAUTIER – Juin 2017. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
De quelques amoureux des livres...
- Par ervian
- Le 23/08/2016
- Dans Philippe Claudel
- 0 commentaire
La Feuille Volante n°1068– Août 2016
De quelques amoureux des livres... – Philippe Claudel – Finitude.
Si l'enfer est, paraît-il, pavé de bonnes intentions, le monde dans lequel nous vivons est assurément le tombeau de tentatives avortées pour devenir écrivain. Certes il y ceux qui ont réussi, dont le nom est inscrit sur une plaque de rue, l’œuvre étudiée par des générations de potaches endormis et les aphorismes qui donnent lieu à des commentaires souvent hors de propos… et puis il y a les autres. Ils sont nombreux, des cohortes, qui doivent leurs déboires littéraires à leurs proches qui se moquent d'eux, aux éditeurs qui n'ont pas été capables de découvrir leur talent, aux événements extérieurs qui ne les ont pas servi comme on dit, euphémisme subtil pour dire qu'ils n'ont pas eu de chance. Il y a les lecteurs qui n'ont pas été au rendez-vous, leur entourage qui les a boudé parce qu'ils n'étaient pas comme les autres, ou peut-être l'inflation d'hommes et de femmes de lettres qui se sont précipités sur leur feuille blanche, qui ont joué des coudes (et pas seulement) pour écraser ceux qui étaient sur leur passage et qui entendait prendre une place à laquelle ils croyaient avoir droit. Ces écrivains ratés, qui ne sont restés que des « écrivassiers » ont chanté la nature, mais elle s'en fout, les femmes qu'ils aimaient, souvent en secret, mais là aussi il ne faut craindre ni l'indifférence, ni les critiques acerbes et cruelles, de sorte qu'ils sont restés des inconnus, des incompris.
Il peuvent aussi s'en prendre à eux-mêmes parce qu'ils ont été parfois paresseux, ont hésité à se lever la nuit à l'écoute de cette inspiration fugace qui ne se manifeste pas deux fois, se sont dit qu'ils verraient plus tard, que rien ne pressait mais qui, une fois devant la feuille sont restés secs, ceux qui ont été victimes du syndrome de Bartelby, ceux qui se sont contentés d’être leurs propres lecteurs mais pas leurs critiques parce que, à leurs yeux, leur talent était manifeste, ceux qui sont morts d'attendre qu'on vienne les solliciter en oubliant que la vie est courte, ceux qui se sentaient indispensables à l'humanité et qui déploraient qu'on fasse ainsi fi de leur message, ceux qui prenaient Voltaire ou Rimbaud pour leurs collègues en littérature, ceux qui se sont pris pour des génies, qui se sont rassurés en disant qu'on les découvrirait… après leur mort, ceux qui se sont drapés dans la toge de l’écrivain en se disant que cela leur allait bien tout en s’extasiant sur la beauté de leur œuvre. Ceux aussi qui, désespérés de tant d’indifférences à leur endroit (ou peut-être victimes d'un sursaut de bon sens) se sont dit que, devant un tel monceau de publications depuis l'invention de l'imprimerie, il valait mieux garder le silence plutôt que de redire plus mal ce qui avait été déjà si bien exprimé par d'autres. Il y a bien sûr ceux qui ont entamé leur vie par l'alcool et la drogue parce qu'on leur avait dit qu'il y avait là une source d'inspiration inépuisable… et qui s'y sont épuisés et même en sont morts, ceux qui, paranoïaques depuis toujours, ont cru être victimes de complots ou ceux qui sont devenus fous à force de croire en leur talent auquel le monde extérieur était complètement indifférent.
L'auteur égrène le catalogue de ces malheureux que la notoriété, les honneurs, la vie ont oubliés. Il le fait avec un humour certain et surtout de bon aloi, preuve s'il en fallait encore qu’on peut rire de tout parce que, par les temps qui courent, c'est à peu près tout ce qui nous reste, que le temps passe vite, que le fatalisme fait partie de la vie et que la fiction est après tout une manière comme une autre de repeindre des jours de plus en plus gris. Et puis, un écrivain qui a réussi n'est peut-être pas autre chose qu'un simple « porte-plume » qui transcrit une inspiration qui vient on ne sait d'où et qui, à tout moment, peut le quitter, qui n'est bien souvent que le miroir de son temps et qui, après un brillant succès fait parfois des efforts désespérés pour durer et pour qu'on ne l'oublie pas. L'écrivain c'est avant un être habité par le solipsisme et trouve souvent cela plutôt bien. Il n'empêche, on dira ce qu'on voudra, mais j'ai bien aimé (et j'ai même bien ri) à cet inventaire à la Prévert des écrivains manqués qui ne sont finalement que des membres de cette espèce humaine à laquelle nous appartenons tous, même si, parmi nous, il y en a finalement peu que la muse chatouille, et c'est plutôt mieux ainsi.
© Hervé GAUTIER – Août 2016. [http://hervegautier.e-monsite.com]
-
BARRIO FLORES – Philippe Claudel
- Par ervian
- Le 10/02/2013
- Dans Philippe Claudel
- 0 commentaire
N°627– Février 2013.
BARRIO FLORES – Philippe Claudel – Éditions La Dragonne.
Dès la première ligne, l'auteur donne le ton : « Les habitants du Barrio Flores sont passés dans le monde et le monde ne les a pas remarqués. ». Pourtant lui choisit de porter sur eux un regard plein de tendresse et les photos en noir et blanc de Jean-Michel Marchetti leur donnent un relief tout particulier.
Le décor, une sorte de bidonville plein de soleil, de vie, de misère mais aussi de sourires, à l’écart d'une grande ville probablement située dans une Amérique hispanique où Juanito, un jeune enfant de huit ans confié à Pepe Andillano, a écrit cette « Petite chronique des oubliés » qui est plus qu'un hommage.à ses habitants Pour ce vieil homme à la jambe raide mais qui gagnait sa vie en jouant au billard, il sera « petite musique » parce qu'il est « plus léger qu'un violon et plus rieur qu’une flûte ». Ensemble ils rêvaient de partir sur le pont d'un navire, pas pour faire le tour du monde, mais « juste une bordée, le temps de dormir une nuit ou deux sur le pont du plus grand des paquebots... et, au matin ce sera l'Amérique, New-York ou Babylone, en tout cas un pays formidable où les bons joueurs de billard sont nommés généraux et où les jambes mortes peuvent ressusciter ». C'est à travers ses yeux que le lecteur découvre cet univers un peu à l'écart. Il était certes fait des traditionnels personnages incontournables, les putains, les cocus, les femmes infidèles mais il y avait surtout Flores Nubia, une petite fille espiègle et belle qui aimait tant jouer à la marelle et dont Juanito était évidemment amoureux. Il lui offrait « des bouquets de rien, des rubans défraîchis, des heures admirables ». Pourtant cette jeunesse insouciante a prématurément été interrompue et Flores est devenue silencieuse, vieille et absente mais elle a continué de hanter les rêves du garçon.
Juanito avait une petite sœur, si jeune qu'on n'avait pas eu le temps de lui donner un nom. Elle accompagnait son frère pour mendier dans le quartiers des riches parce qu'elle faisait pitié et qu'ainsi ils rapportaient de l'argent. Pourtant « son cœur qui se précipitait de vivre en quelques mois une vie entière » s'était arrêté.
Parmi ces habitants il y avait aussi Garrancho Mindo, « Petite tête simple » dont tout le monde se moquait, qui parlait à son âne et voulait l'épouser. Ce décor ne serait pas complet sans le cireur de chaussures, mais celui-là non seulement faisait reluire les souliers de ses clients mais servait surtout d'écrivain public. Tout le monde lui faisait confiance pour rédiger des lettres importantes ou futiles, des lettres d'affaires ou d'amour, sur du papier à en-tête d'une entreprise d'engrais qui avait fait faillite depuis longtemps. On les encadrait même sans jamais les envoyer et ainsi elles faisaient partie du paysage. Sauf que leur auteur ne savait pas plus lire et écrire que ses clients du quartier et qu'il se contentait de reproduire dans ses missives les mots des annonces publicitaires qui s'étalaient sur les murs autour de lui ! Plus tard, Juanito devenu grand et instruit parce qu'il avait appris à lire dans les livres et non plus dans les flaques d'eau et dans les étoiles comme au Barrio, a vu la supercherie mais l'a gardée pour lui et a su reconnaître dans cet homme « un grand poète », en tout cas un de ceux qui ont suscité chez lui cette envie d'écrire à son tour [« C'est sans doute grâce à lui que m'est venue aussi à moi l’idée d'écrire, de caresser les mots, de dire des histoires »].
Il y avait aussi le « docteur » ainsi appelé parce qu'il avait un jour « confessé » pendant trois heures un vrai médecin dépressif et qu'il avait décrété qu'il en savait autant que lui au terme de cette discussion. Il recevait ses patients, vêtu d'une blouse qui avait jadis été blanche, ne guérissait personne parce que ses remèdes tenaient uniquement de l'improvisation, mais tout le monde y croyait et le respectait.
Il y a dans ce « Barrio Flores » toute la poésie de « café de l'excelsior » qui m'avait tant plu (La Feuille Volante n° 620). Ce n'est pas exactement un roman, peut-être un recueil de nouvelles, une galerie de portraits, une chronique de ce quartier rebaptisé par l'auteur du nom de cette petite fille, un amour de jeunesse, celui qu'on n'oublie jamais.
©Hervé GAUTIER – Févrer 2013.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE RAPPORT DE BRODECK – Philippe Claudel
- Par ervian
- Le 28/01/2013
- Dans Philippe Claudel
- 0 commentaire
N°623– Janvier 2013.
LE RAPPORT DE BRODECK – Philippe Claudel - Stock
Prix Goncourt des Lycéens 2007 ;
C'est une bien curieuse histoire que celle de ce Brodeck. C'est un enfante trouvé, un enfant de la guerre, recueilli dans un village perdu en montagne par Fédorine, une vielle femme. Lui, c'est plutôt quelqu’un d'ouvert mais, même s'il est arrivé ici très jeune, il restera pour les gens d'ici un étranger, quelqu'un de peu d'importance. Pourtant on lui offrira des études au cours desquelles il rencontrera Emélia qu'il épousera et qui lui donnera la petite Poupchette. Elle est sa raison de vivre bien qu'elle soit née du viol de sa femme par des soldats. Il deviendra même un fonctionnaire chargé de rédiger des rapports sur la nature. Ses travaux n’intéressent personne mais lui permettent de survivre avec sa famille grâce à ses maigres appointements. Il n'a jamais été accepté au sein de ce microcosme villageois au point d'être livré par eux à l'ennemi, pendant la seconde guerre mondiale. Quand on leur a demandé de « purifier » le village, c'est à dire de dénoncer les indésirables, c'est son nom et celui d'un simple d'esprit qui ont été donnés. Pourtant il résistera à la déportation, aux humiliations et à la malnutrition grâce au seul espoir de retrouver Emélia. Quand il est revenu au village, son épouse n'est plus la même, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, brisée par un viol d'où naîtra une petite fille que pourtant Brodeck adore.
Quand il est revenu, à la fin de le guerre, un autre étranger, aussitôt baptisé « l'Autre », est arrivé au village. Il est délicat, cultivé, parle peu et a un réel talent de dessinateur. On l'observe comme une bête curieuse, tellement différent des autres habitants frustes de ce village. On commence par l'accueillir en grande pompe pour éviter de dire qu'on se méfie de lui mais rapidement on le marginalise, on l'ignore. Pas rancunier cependant, il décide de donner une petite fête pour remercier le village de l'avoir accueilli. Lors de cette fête, il expose les portraits des villageois qu'il a réalisés mais ceux-ci les trouvent tellement réalistes et surtout tellement mystérieux qu'ils les supposent accusateurs et s'en prennent à lui, déchirent ses cartons et tuent son cheval et son âne qu'il considérait comme des personnes. Ces portraits étaient comme des miroirs qui révélaient la face cachée de chacun. Certains y ont vu une allusion à peine voilée aux faits qui s'étaient déroulés pendant la guerre, le viol et le meurtre de trois jeunes filles, étrangères elles aussi, l'aventure fatale de Cathor, un villageois qui avait refusé de livrer un vieux fusil, et qui a été décapité devant tout le village ; c'est cet événement qui avait motivé la dénonciation et la déportation de Brodeck. Mais au lieu de quitter le village, « l'Autre » y erre pendant trois jours en criant sa souffrance. Il finira par en mourir au terme d'une sorte d’assassinat collectif. Ainsi, sous le masque de la respectabilité, de la bienséance et de l'hypocrisie, les habitants de ce village perdu sont-il devenus des meurtriers, révélant ainsi leur véritable image.
Un soir, Brodeck se rend au village pour acheter du beurre et se voit, lui le petit fonctionnaire sans importance, chargé de relater ces faits, c'est à dire d'en faire un rapport écrit. Il devient donc leur « scribe » pour que « celui qui lira le rapport comprenne et pardonne ». Obéissant, il s'exécutera, mais en réalité il n'y croit pas et les villageois non plus. Effectivement, le rapport une fois rédigé et lu par le maire est jeté au feu au motif que le passé appartient à la mort et qu'il faut aller de l'avant au nom de la vie.
A la suite de cela Brodeck décide de quitter enfin le village avec femme et enfant.
C'est étonnant le roman, les personnages tissent leur histoire et le lecteur en est le témoin, s'y identifie ou pas. Moi, je me suis senti très proche de ce Brodeck. Il est l'image de l'homme de bonne volonté aux prises avec les autres qui lui veulent du mal, gratuitement, pour se prouver sans doute qu'ils existent et qu'ils ont de l'importance. Il est assailli par la malchance mais tente de s'en sortir. Le malheur s'acharne sur lui sans qu'il y puisse rien et ne peut opposer à cela que sa seule vie minuscule et sans intérêt. Il est l'éternel guignon mais aussi le souffre-douleur de tous ces petits potentats qui certes le tiennent pour rien, ce dont il est persuadé, mais qui se croient tout permis. Ce roman est dérangeant parce qu'il traite de l’intolérance, de la noirceur de l'âme humaine, de la trahison, rappelle que la race des hommes n'est pas fréquentable, que « l'enfer c'est les autres »...et que tout cela est le quotidien de chacun d'entre nous. Le récit, même s'il est une fiction, est aussi là pour montrer les choses dans toute leur cruauté et l'eau de rose n'est pas ce qui l'irrigue forcément. Et d'ailleurs, ce Brodeck se révèle aussi mauvais que ceux qui l'ont persécuté, et la relation qu'il fait des événements dans son rapport entraîne une confession intime dont il ne sort pas grandi.
Un autre personnage ne m'a pas laissé indifférent, c'est le curé Peiper, un vieil ivrogne qui ne croit même plus en Dieu mais accepte, pour quelques bigotes, de rejouer inlassablement la même comédie du rituel religieux. Il ne trouve sa consolation que dans le vin qui l'aide à oublier toutes les fautes des villageois qu'au nom de Dieu il pardonne, mais aussi la folie destructrice des hommes, leur volonté de trahir avec la bonne conscience de ceux qui veulent se persuader qu'ils agissent justement. A cause de lui, de son message religieux d'un autre âge et des vieilles croyances populaires qui puisent leur existence dans une peur ancestrale, « l'Autre » prend une dimension diabolique qui justifie son élimination. Il symbolise lui aussi la solitude, la peur de l'homme face à ce qui ne lui ressemble pas, face à la mort aussi après laquelle il n'y a rien, ni paradis ni enfer, rien que le néant et que Dieu n'est peu-être rien d'autre que l’inspirateur des bassesses humaines.
C'est aussi un ouvrage sur la culpabilité « Je m'appelle Brodeck et je n'y suis pour rien ». Ce sont les premiers mots du narrateur, comme une excuse de tout ce qui va suivre et que va apprendre le lecteur. Pour tous ces gens qui le méprisent, il ne sera qu’un scribe, qu'un témoin, celui qu’ils ont chargé d'écrire ce meurtre dans son fameux rapport parce, ayant fait des études, il est seul à pouvoir le faire. Ils pensent sans doute qu'ils trouveront dans ses mots le pardon, pour ce qu'ils ont fait mais, devant son travail de tabellion méthodique, seules les flammes sont une réponse, comme si les phrases faisaient peur aux villageois, les désignant comme coupables pour l'avenir, pour l'Histoire peut-être ? Une des fonctions de l'écriture est de fixer le passé, d'en être la mémoire pour, peut-être, faire naître une certaine forme de compréhension voire de pardon. Ici, le rapport de Brodeck révèle la perfidie humaine et aux yeux du maire manque son but ce qui motive sa destruction. [« Il est temps d'oublier Brodeck, les hommes ont besoin d’oublier »]
J'ai déjà dit dans cette chronique que j'apprécie le style de Philippe Claudel, fluide et agréable à lire, plus spécialement peut-être dans les descriptions où l'attention portée aux détails les rend plus vraies encore. Même si ce roman est quelque peu dérangeant, il a représenté pour moi un bon moment de lecture.
©Hervé GAUTIER – Janvier 2013.http://hervegautier.e-monsite.com
-
J'ABANDONNE – Philippe Claudel
- Par ervian
- Le 25/01/2013
- Dans Philippe Claudel
- 0 commentaire
N°622– Janvier 2013.
J'ABANDONNE – Philippe Claudel - Éditions Balland.
L'auteur met en scène un homme simple, encore jeune mais veuf qui s'occupe comme il peut de sa fille de quelques mois. Pour vivre, il travaille à l'hôpital, mais par dans n'importe quel service. L'hypocrisie administrative lui donne le titre de psychologue mais, même si, pour exercer son emploi il faut une bonne dose de psychologie : Il est chargé d'annoncer aux familles la mort d'un proche à la suite d'un accident et d'obtenir leur accord pour prélever sur le cadavre des organes nécessaires à la vie des vivants. C'est sans doute pour cela qu'on les appelle « les hyènes », du nom de ces charognards qui attendent la mort de leurs proies pour se repaître de leurs restes.
Il a besoin de ce travail pour s'occuper de sa fille puisqu'elle n'a plus que lui au monde. Elle est toute sa vie et il voudrait qu'elle reste le plus longtemps possible dans le doux cocon de l'enfance ! Il la confie pourtant à cette baby-sitter un peu déjantée pour qui la vie se limite aux rave-parties, au piercing, à la drogue... Dans une société secouée par les difficultés économiques, avoir un travail de fonctionnaire, c'est à dire ne pas craindre le licenciement et le chômage est une sécurité à laquelle on tient. Après tout, même si, comme la plupart des gens, il n'a pas vraiment choisi ce métier, il est quand même plus sûr de le garder. Mais il vit mal ses fonctions et chaque chose dans son environnement, les mendiants dans la rue, les affiches publicitaires agressives, tout le bouleverse et son métier « lui fait mal ». Il est de plus en plus fragilisé par les événements et ce n'est pas ceux qui font son quotidien à l'hôpital qui vont lui rendre le moral.
Pourtant il n'est pas laid et pas non plus indifférent aux femmes. Il pourrait refaire sa vie, comme on dit, mais il perd de plus en plus les pédales et met en parallèle sa vie à lui et celle de cette femme encore jeune, veuve, qui vient de perdre la fille unique de 17 ans. Comme le dit son collègue, il prend peut-être trop sur lui. Apparemment, en ce qui concerne celui qui travaille avec lui, il est loin de tout cela. Il prend cet emploi comme un gagne-pain, loin des états d'âme. Il est même, d'une certain façon, très professionnel, c'est à dire froid et insensible dans l'exécution de sa tâche. Et puis, du côté personnel, il est plutôt superficiel, ne s'encombre pas de détails, pour lui son univers c'est les matchs de foot, les conversations salaces, les apparences hypocrites et la machine à café. C'est à peu près tout.
Et puis tout d'un coup, parce qu'il est en face de cette femme qui pleure, cette femme qui a perdu sa fille qu'elle ne reverra plus, qui est tout d'un coup l’image de tout ceux qui ont perdu un proche, il pète les plombs, porte le deuil de tous les morts, en veut à son collège d'être aussi primaire et obnubilé par ce sale métier, veut se donner la mort, revit à son tour le moment où on lui a annoncé qu'un drame s'était produit lors de la naissance de sa fille et qu'il fallait qu'il vienne à la clinique.... Celui qui lui a annoncé cela faisait le même métier que lui. La vie sera peut-être la plus forte ?
Comme pour beaucoup d'écrivains, j'ai rencontré Philippe Claudel par hasard. Après tout la publication, les librairies et les bibliothèques sont faites pour cela. J'apprécie chez lui le style fluide qui m'engage à poursuivre mon parcours de lecteur, même si ici je n’ai pas vraiment ressenti du plaisir à cette lecture, à cause du thème choisi peut-être ?.
©Hervé GAUTIER – Janvier 2013.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LES AMES GRISES – Philippe Claudel
- Par ervian
- Le 21/01/2013
- Dans Philippe Claudel
- 0 commentaire
N°621– Janvier 2013.
LES AMES GRISES – Philippe Claudel - Éditions Stock.
(Prix Renaudot 2003)
Nous sommes en 1917 dans un petite ville de province, assez loin du front pour que la guerre ne la dérange pas, assez près quand même pour qu'elle se rappelle à ses habitants à cause du son du canon et des convois de soldats qui vont vers la mort.
Ce microcosme est bouleversé par la mort d'une gamine de 10 ans, surnommée « Belle de jour », une des trois filles de Bourrache, le patron de l'auberge, découverte assassinée dans l'eau froide du canal, derrière le château du Procureur Destinat. Ce magistrat solitaire, veuf, notable et grand bourgeois est austère et même un peu bizarre, comme coupé de la réalité qu'il régentait partiellement à cause de son métier, envoyant avec un grand détachement les assassins à l'échafaud. Le tribunal était aussi hanté par le juge Mierck, vicieux et cynique, craint autant à cause de ses fonctions que de l’insensibilité avec laquelle il les exerçait. Il est secondé par son acolyte, le colonel Matziev, sorti de nulle part aussi inquiétant que dérangeant.
Or ces deux hommes, ces deux magistrats aussi dissemblables l'un de l'autre se haïssaient comme il était difficile de se haïr. La proximité des lieux du crime avec le château du procureur, un témoignage qui l'accable mais qui cependant est vite écarté par le juge vont pourtant lui donner l'occasion de mettre de côté ses rancœurs et d'épargner son collègue. Ils ne s'aiment gère mais appartiennent au même monde, celui des notables, des défenseurs de la loi et de l'Ordre Public. La guerre est là, heureusement, et deux pauvres déserteurs égarés dans cette petite ville vont être des bouc-émissaires idéals. On leur fait avouer n'importe quoi et « l'affaire » qui bouleversa cette petite ville, est officiellement close.
Le narrateur, qui est aussi un modeste policier, remonte le temps à propos de cette « affaire » bien mystérieuse dont il tente de dénouer les fils bien qu'elle soit close. Il croise les âmes grises de ses habitants qui veulent oublier.et nous raconte aussi une autre mort mystérieuse, celle de cette jolie institutrice venue au cœur du conflit enseigner dans cette petite ville. Il nous parle de sa pauvre vie à lui, celle d'un planqué dispensé de guerre mais qui pleure sa femme. Il se classe volontiers dans le camp des salaud, les « justes » sont ceux qui sont au front et qui se battent pour leur Patrie. Il n'est pas l'un d'eux, et pas seulement à cause de cette guerre qu'il n'a pas faite.
Après la mort du Procureur, torturé par le mystère de l'assassinat de « Belle de Jour » autant que par la justice qui n'a pas été correctement rendue, il choisit de narrer pour lui-même les faits, noircissant des cahiers qui lui font peut-être mieux accepter les choses et son âme à lui, tout aussi grise que celle des autres, tout en notant « C'est douloureux d'écrire, je m'en rends compte depuis des mois que je m'y suis mis. Ça fait mal à la main, et à l'âme ». Pourtant, il est admis que l'écriture est libératrice mais l'épilogue montre que dans son cas, il ne peut rien en être.
Tout au long de ce roman qui n'est pas un « policier » à proprement parlé, j'ai été séduit autant pas l'écriture fluide et agréable à lire de son auteur autant que par le suspens savamment entretenu jusqu'à la fin.
©Hervé GAUTIER – Janvier 2013.http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE CAFE DE L'EXCELSIOR – Philippe Claudel
- Par ervian
- Le 20/01/2013
- Dans Philippe Claudel
- 0 commentaire
N°620– Janvier 2013.
LE CAFE DE L'EXCELSIOR – Philippe Claudel- Éditions La Dragonne.
Photographie de Jean-Michel Marchetti.
Le bistro, en France, c'est une institution, presque un élément de culture populaire, en tout cas quelque chose dont on ne pourrait plus se passer et qui doit bien receler un peu de cet art de vivre que le monde entier nous envie. Celui du narrateur qui, à l'époque était encore enfant, ce n'était pas un café à la mode, il s'en fallait de beaucoup. C'était tout juste un estaminet un peu crasseux d'une banlieue ouvrière, près d'un canal. Il était tenu par son grand-père qui trônait, hiératique, derrière son zinc, versant des apéros et des verres de rouge, donnant la réplique aux clients habitués. C'était toujours les mêmes qui venaient là : le facteur, inénarrable fonctionnaire, Marcepie le chauffeur de bus qui devait consommer autant l’alcool que son véhicule de carburant. Il soliloquait comme le font les solitaires et les malheureux sur terre, et les autres piliers de comptoir qui fréquentaient ce débit de boissons au vague nom latin. On aurait presque imaginé autre chose au seul énoncé de ce titre qui impliquait presque le luxe. Ils s'y retrouvaient pour échapper au quotidien, à la routine, à l’éternelle ire d'une épouse ou simplement pour refaire le monde à coups de conversations qui ne risquaient pas de bouleverser les théories philosophiques. Tout cela tenait de l'habitude, du rituel, en tout cas de l'incontournable rendez-vous que personne parmi sa clientèle n'aurait osé manquer sauf à constituer une irréparable faute de lèse-patron.
Ce lieu était évidement exclusivement dédié aux hommes, et pas n'importe lesquels. Il fallait, pour y être admis avoir au moins ses quatre quartiers d'alcoolisme, et d'un alcoolisme militant évidemment, qui se voyait évidemment sur le visage (« la vie se lit sur l'usure d'un visage »), sur les gestes alentis avec lesquels on se portait réciproquement la santé. C'était toute une congrégation d'habitués à qui il ne serait pas venu à l'idée de bouleverser en quoi que ce soit l’ordonnancement des choses de cet antre où le temps passait avec « la lenteur d'un goutte à goutte », où l'apéro se consommait dès neuf heures du matin, dans le plus grand respect de la sieste méridienne du patron. On y tapait le carton, on y bouffait du curé, on appréciait en connaisseur la panier de girolles ou le gibier, évidemment de braconnage qui venait à s'y trouver, on y commentait le cours des choses de l'extérieur, et c'était tous les jours pareil. En bleus de chauffe les jours de la semaine ou dans leur unique costume du dimanche qui datait de leur mariage et qui fleurait bon la naphtaline, ils se retrouvaient dans ce décor un peu crasseux mais si coutumier qu'ils y seraient venus les yeux fermés. Ils y prenaient leur ration d’alcool et de gros rouge sans laquelle leur vie n'était pas concevable. Bien entendu, quand une femme s'y aventurait, par accident évidement, elle était poliment mais fermement reconduite à la porte. Il ne fallait pas mélanger les genres et surtout pas se tromper de lieu !
Ce bistro faisait aussi cantine, mais pour les clients seulement et le vieil homme confectionnait pour eux et, évidemment pour son petit fils, sa « corbeille d'eau douce », un infâme salmigondis de poissons et de légumes dont la couleur n'avait rien d'engageant mais qu'on consommait avec délectation (« cette affreuse soupe couleur de boue »). C'était en tout cas l'occasion de se rappeler son enfance d'école buissonnière !
Le dimanche, après la messe, ce grand-père accompagnait le narrateur le long du canal où il lui offrait une glace. Ils taquinaient le poisson et regardaient les péniches qui, pour l'enfant, avaient des ventres pleins de rêves et de voyages. L’aïeul lui parlait de ses parents, morts ensemble trois auparavant parce que la vie leur avait soudain semblé invivable. Le petit orphelin s'était ainsi retrouvé ici parce que vieillard était la seule famille qui lui restait.
Puis un jour tout cela s'est arrêté pour le narrateur parce que l'administration toute puissante avait décidé, dans son intérêt évidemment, que ce décor, ce microcosme n'étaient pas bon pour lui. Ce furent des familles d’accueil qui le tinrent éloigné longtemps de cet morceau d'enfance, avec seulement quelques lettres difficilement écrites de ce grand-père vieillissant. Puis, plus rien parce que le temps passe et que l'humaine condition reprend ses droits...
Tel est ce court roman émouvant, poétique et fort bien écrit, qui fut pour moi, certes un bon moment de lecture mais aussi un saut dans cette période dont on ne guérit jamais : l'enfance !
©Hervé GAUTIER – Janvier 2013.http://hervegautier.e-monsite.com