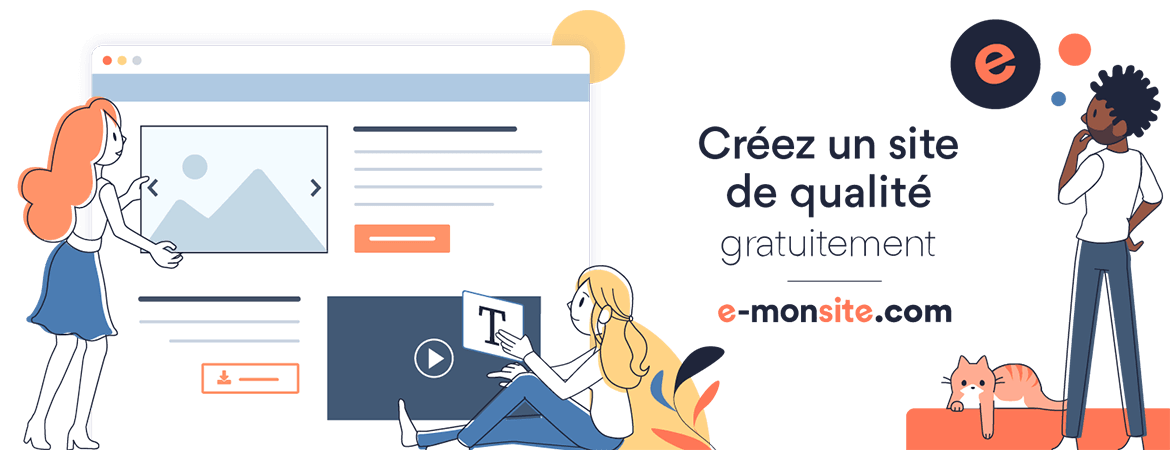Articles de ervian
-
CINQ JOURS
- Par ervian
- Le 25/08/2014
- Dans Douglas KENNEDY
- 0 commentaire
N°794 – Août 2014.
CINQ JOURS - Douglas Kennedy - Belfond .
Traduit de l'américain par Bernard Cohen.
Saint Augustin conseillait qu'on se méfiât de l'homme d'un seul livre. Je n'ai pas lu tout Douglas Kennedy, tant s'en faut, mais le thème du mariage est un de ceux qu'il affectionne particulièrement. Je dois bien avouer que, à l'heure où la pérennité de cette institution est de plus en plus malmenée par le divorce, c'est bien là un thème de société qui peut effectivement être abordé.
L'intrigue est simple, basée comme toujours sur le hasard qui fait bien plus souvent partie de notre vie que nous voulons bien l'admettre. Laura et Richard sont deux inconnus l'un pour l'autre, ils ne se sont jamais rencontrés. Elle est technicienne en radiologie, aime ce qu'elle fait mais un peu moins son contexte familial où elle ne s’épanouit guère avec un mari chômeur puis nanti d'un emploi précaire et dévalorisant, peu prévenant, avec qui elle n'a pas vraiment de points communs et deux enfants qui peinent à sortir de l’adolescence. Lui est assureur et ne trouve dans son métier comme dans son couple aucune vraie raison de vivre une vie heureuse. Une conférence à Boston va provoquer leur rencontre qui n'avait pourtant aucune chance de se produire. Bien sûr, cela va être coup de foudre entre eux, un peu comme s'ils s'y étaient déjà individuellement préparés sans même le savoir et cela va durer cinq jours pendant lesquels ils vont se découvrir mutuellement et s'aimer d'un amour passionnel. C'est une situation que nous avons tous connue, soit parce que nous l'avons vécue personnellement, soit parce que nous l’avons rencontrée dans notre entourage. Dès lors des questions se posent, peut-on s'échapper d'une vie qui, à la longue devient, sinon insupportable, à tout le moins difficile à vivre ? Que sera cette nouvelle existence, le moment de passion gommé ? Ne risque-t-elle pas, elle aussi, de devenir routinière, avec en prime, le regret d'avoir peut-être fait un nouveau mauvais choix ? A-t-on le droit, à l'occasion de cette poursuite du bonheur qui par ailleurs est légitime, de compromettre la vie de ceux qui dépendent de soi ? Doit-on forcément se sacrifier pour eux ? Peut-on faire durer artificiellement des situations sentimentalement délétères alors qu'on peut par ailleurs changer de vie et se donner une nouvelle chance ? Peut-on tout bouleverser au nom d'un amour qui ne durera peut-être pas et l'infidélité d'un moment, même si elle est tentante et forcément exaltante s’inscrira-t-elle dans la durée ? Mais peut-on réellement et définitivement répondre à ce questionnement sans fin dans un contexte forcément émotionnel, ce qui induit à terme assurément de la déception, de la détresse et des larmes comme seul rempart contre le malheur. C'est en tout cas une réflexion sur l'existence qui a le mérite d'être ainsi formulée, même si l’épilogue qu'il propose n'est pas de l'ordre du « happy-end » qui ne se rencontre que dans les livres et jamais dans la vraie vie. Il met en évidence, une nouvelle fois les compromissions de la condition humaine, les petits arrangements avec la vie qui nous la font accepter.
Ce texte écrit à la première personne par Laura elle-même est un témoignage émouvant, même s'il peut passer au départ pour une banale entreprise de séduction, une simple envie de profiter d'un moment de liberté. Au début j'y ai vu des longueurs, une première partie assez longue et hésitante puis, au fur et à mesure de ma lecture, le texte a imposé son rythme et l'approche entre Laura et Richard, faite nécessairement d’hésitations et de confidences parfois intimes sur leur parcours, s'est justifiée d'elle-même. Ils ont tous les deux la quarantaine, une expérience matrimoniale réelle, des espoirs déçus, des regrets et des remords mais quand même des plans d'avenir encore possibles, des enfants à épauler parce qu'il faut bien continuer à vivre. La lenteur des dialogues et des postures est devenue inhérente à cette passion naissante qui s'affirme de page en page. Il y a cette empathie réciproque des deux personnages qui n'est pas du tout surfaite telle qu'elle est présentée. Chacun écoute l'autre, comprend ses difficultés au sein du ménage et de la famille qu'il a créé, communie à ses projets et à ses échecs, s'unit à l'autre à travers sa propre connaissance du couple qui est le sien. Elle est faite, comme pour tout le monde, de déceptions, de mensonges et parfois de trahisons, de routine, d'espoirs d'autant plus utopiques que le temps y a imprimé définitivement sa marque. On est davantage dans la confidence mutuelle que dans la « drague » classique et cette période d'attente et même parfois de doute, imposée par le roman, non seulement distille une sorte de suspens mais aussi ajoute à l'intérêt que j'ai personnellement ressenti à cette lecture. Cela donne une dimension plus humaine et authentique à ce roman qui ressemble de plus en plus au fil des pages non plus à une fiction mais à un véritable témoignage. Cela passe par une complicité des instants passés ensemble, par les confessions de chacun, les retours à la réalité à travers les textos que Laura reçoit sur son portable, par la transformation physique de Richard sous l'impulsion de Laura qui n'aurait à l’évidence pas pu avoir lieu sans elle, des projets d'avenir un peu fous, des étreintes pleines de fougue. Dès lors non seulement une passade est possible mais sans doute aussi une décision définitive de changer de vie, à condition de le faire ensemble, malgré tout ce que cette décision peut avoir de bouleversant dans la vie de chacun, entre culpabilité et volonté d'être soi-même et de profiter de l'instant, entre renoncement à une certaine sécurité dans la routine et saut dans l'inconnu avec, en toile de fond, ce mythique « rêve américain » qui pourrait, dans leur cas, se révéler possible. Reste la question, à la fois pertinente et abrupte que pose Kennedy :« Sommes-nous libres de choisir le bonheur ? »
Cela donne l'occasion à l'auteur de livrer à son lecteur, outre ce roman émouvant, des aphorismes bien sentis qu'il puise assurément dans son expérience personnelle, l'écriture prenant ici sa véritable fonction cathartique. Je garde à la mémoire, le livre refermé, une de ses remarques puisée dans un autre ouvrage « Dans mes livres, je rôde toujours autour de l'idée que chaque homme est très doué pour construire sa propre prison, le mariage étant la prison la plus commune. Le couple, rongé par le sentiment confus de culpabilité est l'un de mes thèmes obsessionnels ». Je terminerai ce commentaire par une remarque personnelle. Je ne sais si je dois cela à la fascination qu'exerce sur moi le peintre américain Edward Hopper mais j'ai lu les dernières pages de ce roman avec, dans ma mémoire, certaines de ses toiles, à cause sans doute de la solitude qu'elles distillent et que j'ai ressentie sur la fin.
Dans cette chronique j'ai déjà eu l'occasion de parler de Douglas Kennedy dont je découvre l’œuvre avec curiosité et un réel plaisir. Autant par l'écriture et le style que par l'histoire mais aussi par la pertinente analyse psychologique des personnages, j'ai vraiment apprécié ce roman qui m'engage à poursuivre la découverte des autres ouvrages de cet auteur.
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA NOSTALGIE HEUREUSE
- Par ervian
- Le 23/08/2014
- Dans Amélie Nothomb
- 0 commentaire
N°793 – Août 2014.
LA NOSTALGIE HEUREUSE - Amélie Nothomb – Albin Michel .
D'emblée, le titre m'a interpellé. C'est sans doute pour cela que je l'ai ouvert, par simple curiosité. La nostalgie ne peut, à mes yeux, qu'être triste, simplement parce que, lorsqu'on éprouve ce sentiment, il se rattache à un passé heureux, définitivement révolu et qu'on ne connaîtra plus. Il est synonyme de spleen, de mélancolie, d'ennui, de tristesse. Elle se confond aussi avec le mal du pays et, même si je ne sais pas grand chose de l'auteur, je crois avoir retenu qu'elle a passé sa petite enfance au Japon et le fait qu'elle y revienne, ce livre étant la relation de ce retour, peut effectivement provoquer chez elle de la nostalgie. Mais, la nostalgie peut-elle être heureuse ?
Dans ce livre, baptisé roman, l'auteur nous raconte par le menu son retour au Japon après seize années d’absence à la suite de son départ un peu précipité pour l'occident, en fait une sorte de fuite. Elle a relaté cette période dans un roman intitulé « Ni d'Eve ni d'Adam » que j'avais moyennement apprécié (La Feuille Volante n°783). Elle s'y mettait en scène à l'âge de 20 ans auprès d'un jeune Japonais, beau, brillant et riche qui voulait l'épouser mais au dernier moment elle a préféré renoncer à ce mariage avec lui. Ici, nous sommes en 2012, l'auteure à 44 ans et elle revient, avec une équipe de la télévision française sur l'archipel. La camera la suivra un peu partout, le micro recevra ses remarques au fur et à mesure qu'elle refera ce chemin à l'envers, retrouvant à la fois sa vieille nourrisse qu'elle considère comme sa deuxième mère et ce fiancé maintenant marié et père de famille. Les lieux se sont modifiés, se sont urbanisés au point qu'elle ne les reconnaît pas [ seuls « Les caniveaux et les égouts n'ont pas changé » écrit-elle] avec en toile de fond Fukushima, son tremblement de terre et sa catastrophe nucléaire de mars 2011. Tout ce périple ne se fait évidemment pas sans émotion et lorsqu'on traduit ses propos, l'interprète emploie le mot « nostalgic » au lieu de «natsukashii » qui désigne la nostalgie heureuse, c'est à dire « l'instant où le beau souvenir revient à la mémoire et l'emplit de douceur » ; et lui d'ajouter pour justifier son choix de vocabulaire qu'à ce moment précis de l'évocation, les traits du visage et la voix de l'auteure signifiaient son chagrin. Il s'agissait donc d'une nostalgie triste, la nostalgie heureuse étant une notion essentiellement japonaise, inconnue en occident. Voilà donc l'explication du titre. J'ai au moins appris quelque chose.
Pour le reste, j'ai peu goûté la relation de ce voyage qui a surtout été le prétexte à un panégyrique de l'auteur et de son œuvre, les personnages de ses romans et ses romans eux-mêmes étant mentionnés tout au long du récit. De plus je n'ai pas bien vu l'intérêt de ce retour médiatisé, surtout auprès de son ex-fiancé. Je veux bien que ce voyage était fait pour la mettre en valeur, mais quand même ! D'ailleurs elle note elle-même que ce voyage l'a laissée « vide », c'est à dire passive et par moment, elle est presque absente, sauf peut-être lors de la rencontre avec sa vieille nourrisse. Elle a sans doute voulu pour des raisons d'ego ou de promotion, se mettre ainsi en valeur et on ne peut lui reprocher cette démarche. Elle aurait peut-être dû méditer cette pensée de Camus qui rappelait qu'il était vain, et bien souvent châtié, de vouloir revivre à quarante ans les plaisirs qu'on avait connus à vingt.
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
UN ETE 42
- Par ervian
- Le 23/08/2014
- Dans Herman Raucher
- 0 commentaire
N°792 – Août 2014.
UN ETE 42 - Herman Raucher. - (Traduit par Renée Rosenthal)
En cet été 1942, Pearl-Harbor a déjà eu lieu et les États-Unis sont en guerre, mais les opérations miliaires se déroulent loin du territoire national. Sur une petite île de la Nouvelle-Angleterre des familles viennent passer des vacances. Ici, trois copains, Orcy, Hermie et Benji, tous âgés d'une quinzaine d'années, s'y ennuient un peu et pour eux tous les jours se ressemblent. Cette période est sans doute comme les vacances de tous les garçons à peine sortis de l'enfance qui regardent le monde des adultes sans trop savoir ce qu'il leur réserve, avec envie et appréhension, en tuant maladroitement le temps. Pour jouer aux grands, ils commencent à regarder les filles mais les abordent gauchement. Orcy remarque une jeune femme dont le mari est à la guerre et en tombe amoureux... mais elle a à peu près le double de son âge ! Il l'aborde quand même, il n'est pour elle qu'un garçon serviable et sympathique, mais elle ne pense qu'à cet homme de sa vie qui se bat au loin. Quand elle apprend la nouvelle de sa mort, tué en opération, sa vie bascule et, une seule fois, accorde ses faveurs à Orcy pendant une seule nuit au terme de laquelle elle disparaîtra pour toujours, laissant à d’adolescent le souvenir indélébile d'un premier amour impossible, accompagnant ainsi son passage dans l'age adulte.
Je ne peux évoquer ce livre sans me souvenir du film qui a été réalisé par l’Américain Robert Mulligam en 1971. Je l'ai vu pour la première fois avec émotion il y a bien longtemps, à sa sortie sans doute, et il est resté dans ma mémoire avec précision malgré le temps. Est-ce à cause du sujet traité, de cette période de l'adolescence perturbée de trois garçons, de l’étonnante beauté de l'actrice Jennifer O'Neill, des images sobres et des paysages qui rappellent tellement les tableaux d'Edward Hopper pour qui j'ai, sans me l'expliquer, une véritable fascination ou pour la somptueuse musique de Michel Legrand (Oscar de la meilleure musique) ? Pour tout cela sans doute avec en plus la nostalgie qui s'attache aux souvenirs du temps passé, des choses qu'on aurait dû faire et qu'on a pas faites, par timidité, par peur, en me remémorant mes émois d'adolescent où, face à une jeune fille plus âgée, on souhaiterait avoir quelques années de plus...
A l'origine, ce roman a été écrit par Herman Raucher pour rendre hommage à son ami d'enfance, Orcy, tué pendant la guerre de Corée. Ils passaient ensemble des étés sur l'île de de Nantuket pendant la Seconde Guerre mondiale. Le narrateur s'en souvient longtemps après et évoque ce souvenir. La scène la plus marquante est sans doute celle où la jeune femme, bouleversée par la mort de son mari, entre désespoir et résignation, accorde une nuit d'amour à l'adolescent. Les images sont sobres, sans dialogue, avec seulement le bruit des vagues au loin et la merveilleuse musique de Michel Legrand, si discrètement distillée.
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
CAPRICE DE LA REINE
- Par ervian
- Le 22/08/2014
- Dans Jean ECHENOZ
- 0 commentaire
N°791 – Août 2014.
CAPRICE DE LA REINE - Jean Etchenoz - Les éditions de Minuit. (2014)
Si j'en crois la 4° de couverture, chacun de ces récits (qui ne sont pas à proprement parlé des nouvelles, sauf, peut-être « Génie Civil » ou « Trois sandwichs au Bourget ») est attaché à un lieu précis aussi inattendu que Babylone ou le Jardin du Luxembourg.
J'ai lu ce livre comme un recueil d'érudition ou plus exactement comme le remploi de notes techniques prises antérieurement ou de descriptions mises temporairement de côté pour l'écriture de quelque roman et qui ici sont recyclées si on peut le dire ainsi. Je connais maintenant un peu de la physionomie, du quotidien et de l’histoire de Babylone à travers la vision qu'en a donné Hérodote, même si son témoignage peut, selon l'auteur, parfois être contestable. De même Nelson apparaît ici comme un marin soucieux de l'avenir de la flotte anglaise, un peu comme l'était Colbert avec la forêt de la Navale et je ne serai sans doute pas dépaysé au jardin du Luxembourg en apercevant ces vingt statues de femmes.
J'ai fait un peu par hasard la connaissance de l’œuvre d'Etchenoz (La Feuille Volante n° 407 et les nombreux suivants...) J'avoue bien volontiers que cet auteur m’intéresse par ce qu'il dit, par son style simple, fluide et accessible, par l'émotion et l'humour qu'il fait passer dans ses mots même si ce livre diffère quelque peu de sa manière traditionnelle de s'exprimer. J'ai retrouvé cet humour dans l'écriture de ces textes. Il dit quelque part avoir eu du plaisir à écrire cette somme de récits qui, pour partie sans doute répondait à une demande ou à une commande, cette contrainte stimulant en quelque sorte l'inspiration et justifiant l'appropriation personnelle que l'auteur fait du thème imposé.
J'ai moi, eu du plaisir à les lire même si j'ai, en ce qui le concerne, une préférence pour ses romans.
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE PONT D'ARCUEIL
- Par ervian
- Le 21/08/2014
- Dans Christian Oster
- 0 commentaire
N°790 – Août 2014.
LE PONT D'ARCUEIL - Christian Oster- Les éditions de Minuit. (1994)
Le narrateur est abandonné par Laure qui le quitte sur le quai d'une gare et, de retour de son centre de Sécurité-Sociale pou une histoire de carte, il se rend dans l'appartement de France dont il possède les clés mais qui est absente. Ici, il rencontre une troisième femme, Catherine. Comme c'est, sans doute, l'anniversaire de France, il convient de lui faire un cadeau ce dont notre héro se met en devoir, déambulant dans Arcueil et Cachan, villes dominées par le fameux pont qui en fait est composé de deux aqueducs, imposant monument, omniprésent dans le roman, dont l'existence trompe un peu l'ennui du narrateur, France tardant à rentrer.
Il y a donc ce voyage dans les rues, de café-restaurant en boutiques mais notre narrateur se livre à un autre plus subtil et peut-être inattendu, dans sa propre tête, avec cette idée de cadeau pour l’improbable anniversaire de France dont on se demande si c'est la vraie raison de sa démarche vers elle. Il réfléchit, ergote avec lui-même, ratiocine à propos de tout et de rien, se triture les méninges, exprime avec une débauche de mots les plis et les replis d'une pensée baroque, bâtit des hypothèses avec une sorte de plaisir que j'ai personnellement du mal à saisir. Autour de lui, c'est à dire dans l'appartement de France, le téléphone sonne, les questions restent sans réponse, à l'extérieur un accident est évité qui n'a peut-être jamais existé que dans sa tête... Le narrateur évoque en effet, avec un grand souci de détails une succession d'événements anodins, de rencontres qui n'ajoutent rien à la compréhension du texte mais qui, au contraire peut-être égarent un peu plus le lecteur à moins qu'ils ne servent qu'à insister sur l'absence de France. Même une rapide passade entre lui et Catherine, sa voisine, n'atteint pas cet objectif et complique encore plus ce récit.
C'est en fait un roman dans lequel, comme souvent, il ne se passe rien si ce n'est dans la tête du narrateur, avec en prime l'attente, la solitude, l’obsédante abandon d'une compagne dont l'homme qui en est la victime a beaucoup de mal à se remettre. Le fantasme qu'il ressent pour d'autres femmes comme Catherine n'est là que pour souligner, en contre-champ, l'absence obsédante de France mais aussi la fuite de Laure. Lui-même n'est rien, un simple salarié sans importance, sans beaucoup d'amis et probablement sans vie sociale, pas grand chose dans ce monde où il est un peu perdu au point que le lecteur ne serait pas étonné qu’au détour d'une page, il le trouvât sombrant dans la folie ou simplement ayant attenté à sa vie. Pourtant, il se mêle un peu de tout et surtout de ce qui ne le regarde pas, pour se prouver sans doute qu'il existe, surtout après l'abandon de Laure. C'est que, dans ce roman comme dans bien d'autres que j'ai lus d'Oster, il y a quelque chose de déprimant, de surréaliste, une ambiance qui ressemble à un malaise même, ce qui, à force, devient communicatif et même un peu lassant.
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
UNE FEMME DE MENAGE
- Par ervian
- Le 19/08/2014
- Dans Christian Oster
- 1 commentaire
N°789 – Août 2014.
UNE FEMME DE MENAGE - Christian Oster- Les éditions de Minuit. (2001)
J'ai toujours été étonné par les décisions apparemment anodines que l'on prend et qui, bien longtemps après, quand on y repense, se révèlent bénéfiques ou catastrophiques pour le cours de notre vie.
Depuis six mois que Constance l'a quitté, Jacques, un quadragénaire un peu solitaire, a attendu qu'elle revienne, mais en vain. En fait c'est un homme ordinaire que le départ de cette compagne laisse complètement démuni et perdu, seul. Puisqu’il a laissé la poussière s'accumuler sur les meubles pendant tout ce temps, il lui faut donc une femme de ménage qu'il a embauchée sur une petite annonce croisée dans une pharmacie. Laura vient donc chez lui pour nettoyer son appartement comme leur accord non écrit le prévoyait, le travail au noir étant de règle. Avoir une femme étrangère chez lui, surtout pour s'occuper du ménage est une chose nouvelle pour lui et la propreté elle-même, autant que la manière dont elle l'obtient, deviennent une sorte d'obsession d'autant que maintenant il la paye pour cela. Il ne faut cependant pas longtemps à cet homme fragile pour être troublé par la présence de Laura au point qu'il est devant elle comme un adolescent boutonneux incapable de lui adresser la parole, entre prévenance et gaucherie jusqu’au jour où l'amant de Laura décide de la mettre à la porte. C’est donc tout naturellement qu'elle demande à Jacques de l'héberger... et qu'il accepte. Laura est de plus en plus attachante avec, en toile de fond, Constance qui se manifeste à nouveau et Claire toujours aussi fantomatique. Leur liaison un peu chaotique devient peu à peu une émouvante, lente et intime vie commune, avec entre eux, de plus en plus l'ombre portée du mariage...
L'auteur renoue dans ce roman avec son obsession des femmes, du quotidien, du hasard, de la solitude qui pèsent sur nos vies.
Je découvre petit à petit l’œuvre de Christian Oster et je dois dire que jusqu'à présent avec lui je suis passé de l’attention à l'ennui. Là au moins j'ai apprécié l'humour, l'écriture à la fois précise et délicieusement ratiocinante, rehaussée par l’emploi d'imparfaits du subjonctif pas du tout suranné à mes yeux. C'est vrai qu'au départ, j'ai été séduit par cette histoire qui mettait en présence un quadragénaire, un peu secoué par une récente séparation et une jeune femme qui manifestement savait ce qu'elle voulait et n'avait aucun mal à l'obtenir. Cette situation n'a d’ailleurs rien d’exceptionnel dans la vraie vie mais mérite bien cette mise en scène romanesque. Le caractère des deux protagonistes est bien marqué et le jeu sur la différence d'âge bien mené à travers les hésitations de Jacques et les décisions de Laura. Puis, au fil des pages, l'intérêt de cette mise en perspective du couple ainsi formé a diminué, s'est essoufflé et l'épilogue m'a paru artificiel, même s'il est logique. Je ne sais pas pourquoi mais je m'attendais à autre chose. Un peu déçu donc !
Ce roman a été adapté à l'écran par Claude Berri en 2002.
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE VIN DES MORTS
- Par ervian
- Le 17/08/2014
- Dans Romain Gary
- 0 commentaire
N°788 – Août 2014.
LE VIN DES MORTS - Romain Gary- Gallimard.
C'est un roman étonnant écrit par le jeune Roman Kacew, alors âgé de 20 ans qui deviendra plus tard Romain Gary. Nous sommes en 1934. Ce texte qui resta à l'état de manuscrit et qui portait pourtant tous les espoirs d'écrivain de son auteur, fut offert par le jeune homme à la journaliste suédoise Christel Söderlund avec qui il avait une liaison après qu'il eût maintes fois été refusé par les éditeurs. Le manuscrit fut ensuite mis en vente à l'Hôtel Drouot en 1992 et publié en 2014.
C'est un conte où il nous est dit qu'il y a une vie après la mort, une sorte de « monde à l'envers », « un autre côté du miroir » comme aurait pu le voir Lewis Caroll où la mort n'atténue pas les faiblesses humaines, bien au contraire. Contrairement au message religieux, ce monde de l'au-delà n'est pas meilleur que le nôtre, il en est le reflet exact. Tulipe, le héro de ce voyage sous terre qui commence dans un cimetière, y rencontre sous l'emprise de l'alcool des personnages disparus. Ce texte peut être interprété comme une critique de la société bourgeoise de l'entre-deux-guerres, de la guerre en générale, de l'autorité et de la crise des années trente. Des thèmes s'y entrecroisent sur la vie, la mort, l'enfance, les nombreuses turpitudes de l'homme, le sexe, le suicide qui sera bien plus tard le modus operandi choisi par l'auteur pour quitter ce monde. Le héro s'y déplace dans ce monde d'en bas, peuplé de morts-vivants, parfois accompagné d'un enfant, au gré de ses découvertes mais, dans la forme du moins, on est loin du cheminent de Dante aux enfers dans la Divine Comédie avec un cicérone. Tulipe marche dans un souterrain peuplé de squelettes et d'une faune à peu près analogue à celle du dessus, des sœurs maquerelles dans un bordel d'outre-tombe, des flics violents, des moines paillards, des soldats allemands grossiers et un Dieu ivre qui porte sur tout cela un regard absent. Quant à Tulipe qui cherche toujours la sortie, il y va de ses anecdotes égrillardes sur les clients qui habitent l'hôtel tenu par sa femme, sans doute puisées elle-mêmes dans le quotidien et les clients de la pension « Mermonts » dirigée par sa mère à Nice. Ici les dialogues sont orduriers, inspirés sans doute par Alfred Jarry et peut-être Edgard Poe pour l'atmosphère des « Histoires extraordinaires ».
On se souvient que Romain Gary avait obtenu le prix Goncourt en 1956 pour « Les racines du ciel ». Chose extraordinaire, qui est en fait un pied de nez au système, il l'obtint une deuxième fois, en 1975, avec « La vie devant soi », mais sous le nom d’Émile Ajar qui n'était que l'un des nombreux pseudonymes qui jalonnèrent son œuvre. Sous les dehors de diplomate et d'écrivain reconnu, Gary était un véritable anticonformiste.
Selon Philippe Brenot présente ce livre de jeunesse, « Le vin des morts », comme préfigurant et annonçant ce que sera l’œuvre future de Romain Gary. Mais si j'ai aimé, il y a très longtemps « Les racines du ciel » ou « la promesse de l'aube », ici, même si la mémoire peut me faire défaut, j'ai eu du mal à entrer dans cet univers surréaliste et même un peu pestilentiel de danse macabre où je n'ai pas vraiment retrouvé ce que j'ai ensuite apprécié chez Romain Gary.
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
MURMURER A L'OREILLE DES FEMMES
- Par ervian
- Le 15/08/2014
- Dans Douglas KENNEDY
- 0 commentaire
N°787 – Août 2014.
MURMURER A L'OREILLE DES FEMMES - Douglas Kennedy- Belfond.
Traduit de l'américain par Bernard Cohen.
Sacré Douglas Kennedy ! Je ne connais pas sa biographie et encore moins sa vie intime mais si ces douze nouvelles en sont le reflet, puisqu'elle sont écrites à la première personne, même sous le masque d'autres personnages, je me dis que soit c'est une sorte de don Juan, soit c'est un sacré vantard. Car qu'il se cache sous la masque d'un modeste comptable, d'une brillante avocate d'affaires ou d'un professeur respecté, il puise sans doute autant dans son imagination que dans son expérience les modèles qu'il met en scène, même s'il alterne, pour la crédibilité de la lecture sans doute, les hommes et les femmes, l'écriture permettant cette fiction. Ça l'aurait même pris de bonne heure, cette attirance pour l'autre sexe, dès l'âge de 7 ans, à l'entendre, à l’occasion d'une simple rencontre, puis ensuite il aurait connu le grand amour, à supposer bien sûr qu'il existe. Il pourrait même se dire qu'il a été « l’homme de la vie » d'une ou de plusieurs femmes, ce qui est plutôt flatteur et il est de bon ton pour un homme de se vanter de ses succès féminins ou de laisser planer un doute sur ses performances sexuelles! Pour un homme comme pour une femme, c’est tentant de pouvoir se dire « qu'ils sont faits l'un pour l'autre » et que par conséquent ils doivent passer leur vie ensemble. Alors on fait rimer « amour avec toujours », on parle de destin et si on y croit, de Dieu, cela ne coûte rien, mais finalement tout cela est bien artificiel et résiste bien rarement à l'épreuve des faits, du temps et de l'usure des choses, bien des mariages se concluent par un divorce... . Il a sûrement rencontré des femmes avides de se marier et ardemment désireuses de devenir mères mais l'amour est sans doute le domaine qui révèle le mieux la part d'ombre de chacun. Ici elle se nomme lâcheté, trahison, mensonge, adultère quand ce n'est pas, pour briser la routine matrimoniale destructrice ou l'illusion de la sécurité, pour accéder à cette envie de liberté, céder à l'espoir bien souvent déçu de faire fortune ou obtenir la notoriété, de satisfaire à ce désir inextinguible de tout jeter par-dessus les moulins et changer de vie pour l'inconnu ou les fantasme de la nouveauté, la folie quoi ! Le mariage, surtout s'il succède à une déception amoureuse antérieure ne peut que se conclure par un échec[je suis frappé dans ces nouvelles par la facilité avec laquelle les conjoints ou les amants se séparent, souvent pour des raisons sentimentales mais sans oublier la dimension financière cependant]. Sans doute le charge-t-on de trop d'espérances mais je ne suis pas sûr que l'écriture, dénonçant ce désastreux état de choses, en constitue le baume, pas plus d'ailleurs que tous les produits excitants extérieurs... Quant aux relations extra-conjugales, elles ne valent guère mieux et la déconvenue en est souvent l'issue. De quoi êtres vraiment désespéré ! [« Est-ce que ça se passe toujours comme ça ? Vouloir ce que l'on n'a pas, avoir ce que l'on ne veut pas. Pensez qu'il existe une autre vie « là-bas » et redouter de perdre celle qui est ici. Ne jamais être sûr de ce que l'on poursuit... » et puis aussi « Rappelle-toi, petit, on est seul, toujours seul »].
Il y a aussi cette certitude qu'ont certains de n'être pas faits pour être heureux, à côté de qui le bonheur passera toujours... sans s'arrêter et pour qui le choix dans cette matière sera toujours mauvais quoiqu’ils fassent.
C'est vrai que la condition humaine est un spectacle à la fois changeant et constant et quand on choisit l'aspect amoureux des relations entre les gens, le mariage qui épuise l'amour pourtant si ardemment promis et qui transforme les époux en véritables étrangers l'un pour l'autre, quand ce n'est pas pire, avec au bout du compte bien souvent la résignation... ou l'irréparable ; c'est là un sujet inépuisable pour qui veut en parler et je crois de Douglas Kennedy le fait bien. Il promène un regard désabusé sur les hommes et les femmes qui composent cette chose étrange qu'on appelle la société avec ses convenances, ses règles, son hypocrisie. Le fait que ce recueil se termine par un improbable conte de Noël veut-il il cependant dire que tout espoir n'est pas perdu ou au contraire que ce monde n'existe que parce que nous y instillons de temps en temps des choses qui n'arrivent que dans les livres ?
Si, dans ces textes, il fait simplement œuvre d’écrivain, non seulement c'est bien observé mais aussi c'est bien écrit. Je ne sais pas si c'est grâce à son style ou à la traduction mais le texte est agréable à lire.
J'ai déjà dans cette chronique l'intérêt que je porte aux romans de Kennedy. L'univers de la nouvelle est très particulier et j'avoue une attirance pour ce genre littéraire. Là je n'ai pas été déçu .
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
MON GRAND APPARTEMENT
- Par ervian
- Le 14/08/2014
- Dans Christian Oster
- 0 commentaire
N°786 – Août 2014.
MON GRAND APPARTEMENT - Christian Oster- Les éditions de Minuit.
En fait, c'est l'histoire un peu folle d'un homme qui possède un grand appartement dont il a perdu les clés, que son amie vient de quitter, qui donne rendrez-vous à la piscine à une autre qui ne vient pas mais qui en rencontre une troisième, enceinte, qu'il ne connaît pas mais il décide qu'il sera le père de cet enfant ! Luc Gavarine est un chômeur un peu paumé et qui ressent un grand vide dans son existence. Cet échec sentimental lui rappelle sa vie amoureuse un peu désordonnée, pleine de désillusions et ravive son côté dépressif qu'il combat en livrant au lecteur ses pensées même si celles-ci sont un peu brouillonnes et sans grande cohérence. En fait, il recherche une raison de vivre autrement qu'en égoïste et Flore se trouve là, alors pourquoi pas ? Pourtant elle ne l'aime pas mais a besoin du soutien qu'il lui offre et il accepte cette rencontre faite par hasard, se laisse porter par les événements. Il attendait Marge, une ancienne conquête, à la piscine et c'est Flore qui se présente, enceinte et c'est sans doute parce qu'elle est seule, il lui propose de vivre avec elle, oui mais voilà, il a perdu les clés de son appartement, cela devient compliqué. Pourtant il l'accompagne pour son accouchement et joue auprès de Maude, l'enfant, le rôle du père. Un drôle de père cependant qui n'a rencontré Flore que l'avant-veille, qui prend en charge un peu au hasard un enfant qui n'est pas le sien simplement parce qu'il a de l'amour à donner. Pourtant il est triste, un peu désaxé, a du mal à s'exprimer.
Je n'aime pas faire de parallèles mais cela m'évoque un peu Modiano, une sorte d'errance, de passivité mais en moins bien écrit quand même, avec une ambiance différente, une musique nostalgique mais moins harmonieuse cependant. En effet des centaines de phrases soit pour ne rien dire ou faire partager sa technique de drague, soit pour indiquer ses états d'âme sur les femmes qui le quittent, sa façon de nager, ses difficultés pour se rhabiller, tout cela a tissé un univers dans lequel j'ai eu du mal à entrer et à la fin cela est devenu un peu lassant. Les dialogues minimalistes contrastent avec les nombreuses ratiocinations de Luc autour de sa solitude et de l’avenir qu'il entrevoit avec Flore et Maude, cette enfant dont évidemment il n'est pas père. Pourtant il prend la place de ce dernier, sans raison apparente autre que son manque d'amour et que sa solitude, alors qu'on ne lui a rien demandé. Il est même accepté par Jean, le frère de Flore, quasiment comme quelqu'un de la famille. C'est un peu comme s'il s'était, tout d'un coup, trouvé un rôle à jouer dans un monde où il n'était rien [« J'ai besoin d’une place, d'une petite place sur cette terre, jusque de quoi tendre les bras »]. Pire peut-être il y croit complètement [« Cet enfant, j'en étais... le père depuis longtemps et depuis longtemps sa mère était ma femme. Je les attendais, ils étaient là »] et finalement on peut penser qu'il y restera. Quant à son appartement c'est peu dire qu'il passe au second plan. On en parle même plus !
Le style est fait de phrases courtes, l'intrigue a l'air de patauger un peu et l'ensemble se lit assez facilement. J'ai trouvé ce livre plutôt triste. Lors de mes précédentes lectures, je m'étais un peu vite enthousiasmé pour cet auteur, je change un peu d'avis avec ce roman.
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
L'ENFANT D'OCTOBRE
- Par ervian
- Le 13/08/2014
- Dans Philippe Besson
- 0 commentaire
N°785 – Août 2014.
L'ENFANT D'OCTOBRE - Philippe Besson-Grasset.(2006)
Les gens de ma génération ne peuvent oublier « l'affaire Grégory », ce petit garçon de 4 ans retrouvé noyé dans la Vologne au soir du 16 octobre 1984, qui est toujours et sans doute pour toujours inexpliquée et ce crime impuni. La photo de garçonnet, rieur et les cheveux bouclés est dans toutes les mémoires. Cette affaire qui a tenu la France entière en haleine n'est pas officiellement terminée puisque relancée en 2013, mais les chances d'aboutir sont de plus en plus minces. Il y a eu ce meurtre atroce puisqu'il a été commis sur la personne d'un enfant sans défense mais il y eu aussi des indices mal exploités ou effacés, l'amateurisme dans l'enquête de gendarmerie puis des hésitations dans celle de la police, un juge trop jeune, sans expérience, complètement dépassé, un dysfonctionnement de la justice, des coupables trop vite trouvés puis relâchés ou exécuté pour l'un d'entre eux, des rebondissements nombreux, des jalousies familiales, de vieilles querelles, la vie difficile dans cette contrée des Vosges, une parentèle qui se déchire, un « corbeau » menaçant mais invisible, la pression médiatique et au bout du compte un constat d'échec, l'impossibilité de connaître la vérité ! De reconstitutions en annulations de procédure, de dénonciations en rétractations, de trahisons en lynchage médiatique, d’incarcérations en libérations, d’expertises accusatoires en en conclusions contradictoires, de maladresses des enquêteurs en pièces à conviction, de « crime parfait » en absence de mobile, d'intime conviction du juge en absence de preuves, d'obligation de résultats en oubli des principes élémentaires du droit, de nominations successives de magistrats instructeurs en jugement de non-lieu, cette affaire va de plus en plus à vau-l'eau entre cadavres et enfants à naître.Tout et le contraire de tout !
C'est un roman et l'auteur imagine comment Jean-Marie et Christine se sont rencontrés, ont bâti leur vie. Il écrit sa fiction en y mêlant la réalité des informations qu'il détient. Il donne la parole à Christine, comme si elle était invitée à se confier à la feuille blanche, des pages imaginaires en quelque sorte. A travers son témoignage, le lecteur sent l'évolution de cette affaire où elle passe de la situation de mère éplorée ayant perdu son enfant unique à celle de coupable d'infanticide contre qui les experts et la presse vont se déchaîner pour enfin recouvrer la liberté. Elle doit maintenant faire face à l'opinion publique qui voit en elle une criminelle très présentable, d'autant que son mari vient de désigner et d'exécuter celui qui, à ses yeux, est le vrai coupable, et chacun de se faire sa propre opinion, subjective évidemment !
Je n'ai malheureusement pas retrouvé le style agréable que j'avais apprécié dans les précédents romans de Besson. Ce livre est écrit avec une certaine froideur, comme une chronique judiciaire, à cause sans doute du sujet choisi. Il apporte un éclairage personnel sur l'enquête ce qui, immanquablement, amène le lecteur à se faire sa propre opinion. Pourquoi Philippe Besson, qui est un bon romancier, s’est-il dédié à une affaire criminelle en s'en faisant le chroniqueur ? J'ai personnellement du mal à voir ici un roman ordinaire et j'ai ressenti un véritable malaise à sa lecture. D’ailleurs une plainte a été déposée par les époux Villemin et l'auteur et l'éditeur ont été condamnés pour diffamation à 40 000 € d'amende. Il a peut-être voulu mettre en lumière les travers de l'espèce humaine, mais pourquoi l'avoir fait dans ce cadre là et surtout de cette manière ?
Cette affaire est de celles qui ont bouleversé la France entière, de la même veine que d'affaire Dreyfus, toutes proportions gardées, ou que celle de Bruay en Artois. Ces deux crimes de sang, deux véritables tragédies modernes, resteront probablement à jamais non élucidés. Demeureront le chagrin des Villemin d'avoir perdu leur fils et le calvaire qu'ils ont dû subir, comme si la perte d'un enfant ne suffisait pas, un enfant assassiné mais sans assassin, une absence et une tombe pour le reste de leur vie.
Je n'ai pas aimé ce livre abusivement appelé « roman ».
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LES CATILINAIRES
- Par ervian
- Le 11/08/2014
- Dans Amélie Nothomb
- 0 commentaire
N°784 – Août 2014.
LES CATILINAIRES - Amélie Nothomb – Albin Michel.(1995)
D'emblée le titre m'évoque Cicéron qui prononça ses célèbres réquisitoires contre Catilina qui conspirait contre le république romaine. Ici, rien de tout cela. Le narrateur, Émile Hazel, 65 ans, ex-professeur de lettres classiques, vient de prendre sa retraite avec sa femme Juliette qu'il connaît depuis l'enfance dans une maison retirée dans la campagne. Leur entente est parfaite et ils veulent être seuls. Leur plus proche voisin, Palamène Bernardin, 70 ans, à « l'air d'un Bouddha triste », c'est un médecin qui vient ponctuellement chaque après-midi pendant deux heures leur faire une visite, mais sans rien leur dire, ne répondant à leurs questions que par oui ou par non et refuse obstinément que son épouse l'accompagne. Ils finissent par s'habituer à ce fâcheux qui pourtant en prend de plus en plus à son aise, entre désinvolture et incrustation, combattant ces intrusions par l'érudition, l'humour ou le silence. En fait ils sont affaire à un véritable emmerdeur. Palamène cède et leur présente sa femme, sorte de personnage fellinien, inintéressant et rustre comme lui, qui ne pense qu'à manger et qu'il veut cacher.
Ils réfléchissent à un moyen de se débarrasser de lui, Émile qui est plutôt satisfait de lui-même se remet en question, se révélant incapable de réagir face à ce voisin envahissant, prenant conscience que finalement c'était un faible qui avait passé toute sa vie comme un modeste professeur de langues mortes, ce qui n'était somme toute pas grand chose. N'y tenant plus, il parvient quand même par le mettre dehors, ce qui permet au lecteur de constater son vocabulaire fleuri, bien loin du classicisme qu'il enseignait jadis, mais peu de temps après Palamène tente de se suicider. C'est Émile qui le sauve d'une mort certaine. Cet épisode lézarde un peu la complicité traditionnelle de Juliette et de son mari autour de l'opportunité du sauvetage de leur voisin qui d'évidence n'a aucun goût à la vie. Il lui semble que le fait d'être environné d'horloges chez lui est le signe qu'il prend ainsi conscience de la fuite du temps et que l'unique but de sa vie est la mort puisque, prisonnier de lui-même, il ne trouve d'issue que dans le trépas. De là une certaine culpabilité ressentie par Émile, mais aussi la révélation du côté sombre de sa personnalité, le jour M. Hazel était un peu lâche mais la nuit il était capable des pires audaces. Il illustrait à sa manière le mythe de Pénélope qui le jour jouait le jeu de ses prétendants et la nuit redevenait une héroïne. Il illustrera ce paradoxe jusqu’au bout ! Prenant conscience de la situation de Palamène, Émile soutient, avec la fougue de Cicéron, qu'il comprend son voisin et sa prédilection pour son geste fatal.
Il y a beaucoup de longueurs dans ce roman. Il s'agit d'une fiction et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans cette chronique, Amélie Nothomb n'est jamais aussi intéressante et émouvante que lorsqu'elle livre à son lecteur son expérience personnelle [« Ni d'Eve ni d'Adam », « Stupeur et tremblements »]. Comme à chaque fois, l'auteure fait preuve d'originalité dans les prénoms de ses personnages, ici par exemple Palamène, et fait montre de son érudition, de ses remarques sur la vie et sur la mort, sur la condition humaine aussi qui n'est pas reluisante, mais cela nous le savions déjà. Pour autant, j'ai peu apprécié cette œuvre pourtant bien écrite.
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
NI D'EVE NI D'ADAM
- Par ervian
- Le 10/08/2014
- Dans Amélie Nothomb
- 0 commentaire
N°783 – Août 2014.
NI D'EVE NI D'ADAM - Amélie Nothomb – Albin Michel.
C'est un récit autobiographique où Amélie Nothomb, étudiante en japonais, décide de donner des cours de français à un jeune nippon énigmatique, Rinri. Elle relate par le menu cette expérience qui la conduit inévitablement à avoir une liaison avec lui. Il présente d'ailleurs comme « sa maîtresse », terme à la fois ambigu et révélateur compte tenu du contexte. Elle est de ce fait reçue dans sa famille et se demande quel rôle joue chacun de ses membres. C'est l'occasion pour elle de parler de la société japonaise, des rituels qui la gouvernent, de l'élitisme qui est en vigueur ici plus qu'ailleurs et qui affecte les enfants dès leur plus jeune âge, de l'homosexualité qui a longtemps été interdite par la loi, de l'addiction au travail des Japonais. On a ainsi droit à la cérémonie du thé, aux cerisiers en fleurs au printemps, au Mont Fuji, à la politesse traditionnelle, à la technologie avancée... Le garçon se révèle romantique, enfin version japonaise, tout comme est japonaise sa version de la cuisine occidentale, c'est à dire ratée malgré toute sa bonne volonté, alors qu'Amélie s'attendait à manger des sushis et des sashimis. Il est original, voyageur volontiers solitaire et surtout... sans appareil photo ! Quant à elle, elle devient la fiancée officielle de Rinri, ce qui lui vaut la curiosité des grand-parents, le respect poli de son père mais la haine tenace de sa mère. Non seulement elle lui prend son fils mais en plus elle est étrangère, pourtant elle a vécu très jeune au Japon, parle couramment la langue. Elle est presque déjà Japonaise !Pour autant la fin diffère quelque peu de ce qu'on peut imaginer. C'eût été un « happy end » un peu trop facile et que dans d'autres chroniques j'ai déploré. Et puis la liberté existe, même si elle ressemble à une impasse et si on veut à toute force refuser le chemin tracé ! C'est vrai que le mariage est une grave décision qui engage toute une vie, même si, à tout le moins en occident, le divorce vient souvent le conclure. Ce Rinri semblait non seulement très prévenant mais surtout très amoureux. Cela sentait non seulement le beau et riche mariage mais surtout le mariage d'amour, ce n'est pas si fréquent, cela faisait peut-être trop « prince charmant » ou trop « midinette », je ne sais pas ? Alors la fuite reste, dans ce domaine comme dans bien d'autres, une forme de solution, même après deux années d'apparent bonheur. Cela ressemble quand même à un gâchis, à une sorte d'échec qu'encore une fois l'écriture a réussi à exorciser.
Le livre refermé, j'avoue que j'ai ressenti de la sympathie pour ce jeune japonais qui méritait peut-être mieux que cela, mais c'est peut-être mon côté « fleur bleue » ? Pour moi qui dans le domaine de la civilisation et de la culture nippone n'y connaît rien, je confesse quand même que ce livre est intéressant sur le plan documentaire. On y apprend ainsi les us et coutumes du pays, les légendes, l'histoire, la géographie, l'art culinaire... Ce récit précède l'expérience professionnelle malheureuse de l'auteur dans une grande entreprise japonaise narrée dans « Stupeur et tremblements » (La Feuille Volante n° 771), il en est l’exact contraire, entre jubilation et culpabilité.
Je m'aperçois avec un certain étonnement que je lis les œuvres d'Amélie Nothomb dans le seul but de pouvoir m'en faire une idée et ainsi pouvoir en parler puisqu'elle est un auteur médiatique et, à ce titre, fait partie de la culture, mais en aucun cas par réel intérêt personnel ou par plaisir. Je dois cependant reconnaître que le texte est agréable à lire, sans fioriture excessive, d'une écriture agréable et que, lorsqu'elle choisit de relater une expérience personnelle, l'auteur est bien meilleure que dans le domaine de la fiction .
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
L'IMPREVU
- Par ervian
- Le 09/08/2014
- Dans Christian Oster
- 0 commentaire
N°782 – Août 2014.
L'IMPREVU - Christian Oster – Les Éditions de Minuit.(2005)
D'après le dictionnaire, l'imprévu c'est ce qui arrive quand on ne s'y attend pas. Dans cette histoire, d'ailleurs un peu compliquée c'est bien le cas. Le narrateur qui n'a pas de nom, mais qui se fait appelé Serge au cours du récit, doit aller à l’anniversaire de Philippe dans l' île de bretonne de Braz. Avec lui il emmène Laure dont il est follement amoureux. La particularité du narrateur c'est qu'il est perpétuellement enrhumé et que ses compagnes successives attrapent son rhume et quand elles guérissent, elles le quittent.
Au cours du voyage en voiture, ils s'arrêtent dans un hôtel en pleine campagne, Laure tombe malade, et finalement lui demande de se rendre chez Philippe, seul et par ses propres moyens puisqu'elle garde le véhicule. C'est le premier imprévu mais pas le seul et il obtempère. L’auto-stop l'amène dans une famille, les Traversière, où il est invité à l'anniversaire du mari. Lors de cette soirée, il rencontre des gens, des femmes en particulier à qui il est particulièrement attentif. Pourtant, depuis le début de ce récit, le narrateur ment et il continue quand il rencontre au cours de cette même soirée, Florence, une femme qui va elle-aussi dans l'île de Braz. On se rend bien compte que, de son côté Laure l'a quitté, guérie sans doute.
Contrairement à ce qu'on pouvait penser, il ne se passe rien entre lui et Florence, mais c'est aussi une manière d'imprévu mais en cette matière le lecteur n'est pas au bout de ses surprises.
Le récit fourmille de détails dont l'accumulation n'apporte rien à la compréhension et même à l'intérêt. C'est une sorte de tranche de la vie du narrateur où se dernier passe son temps à rechercher une femme à aimer et quand il l'a trouvée il la fuit soit parce qu'il ne se sent pas à la hauteur, soit parce qu'il a peur soit peut-être parce qu'il veut passer à autre chose, une sorte d'impossibilité de se fixer sans doute ? L’épilogue est étonnant et vraiment inattendu. Certes, cela analyse finement les états d'âme mais quand même, je me suis un peu ennuyé.
Je ne suis pas un spécialiste de l 'œuvre de Christian Oster que je découvre petit à petit (La Feuille Volante n° 779, 780, 781), mais je crois avoir lu bien mieux.
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LOIN D'ODILE
- Par ervian
- Le 08/08/2014
- Dans Christian Oster
- 0 commentaire
N°781 – Août 2014.
LOIN D'ODILE - Christian Oster – Les Éditions de Minuit.(1998)
J'avoue que j'aime assez les auteurs qui, dans un roman, m'interpellent dès la première ligne. Là, ça a été le cas, jugez plutôt « Exagérons. Disons qu'il fut un temps, pas si éloigné du reste, où je vivais avec une mouche ». Voilà, me suis-je dit, qui menace d'être intéressant ou à tout le moins original !
En effet, en plein mois de novembre, une mouche s’introduit dans l’appartement parisien du narrateur, ce dernier, Lucien, 45 ans semble ne rien avoir à faire d'autre que de rédiger son journal intime. Il l'y fait donc figurer tout en cherchant à la chasser, car, c'est bien connu, rien n'est plus agaçant qu'une mouche. Puis il se reprend et après l'avoir un peu étourdie choisit de partager son espace avec elle. Jusque là, ça va. Mais nous sommes dans un roman d'Oster et, bien que je n'ai pas vraiment exploré tout son univers, je n'ai pas l'impression qu'il accorde beaucoup d'importance aux diptères. Quoique ? Effectivement, cet homme solitaire qui confie à la feuille blanche ses états d’âme, fait rapidement mention d'une femme, Odile, qui a un temps partagé sa vie mais cela fait trois ans déjà qu'ils se sont quittés. Il nous narre par le menu le détail de leur rencontre, dans une soirée, un peu par hasard. Il ne savait pas trop s'il l'aimait, a fini sans doute par s'habituer à sa présence, mais ce ne fut pas un « coup de foudre ». C'est vrai que cette femme était fascinante, c'est en tout cas lui qui le dit mais on sent bien aussi que la solitude lui pesait et que cette rencontre a été la bienvenue. Pourtant leurs relations se révèlent à la fois ardentes et sans lendemain et c'est bizarrement lui qui choisit de les rompre, un peu comme s'il avait peur de l'avenir avec une femme et que la solitude était son véritable lot. Odile accepte sa décision avec regret quand même et cet acceptation un peu inattendue introduit en lui une sorte de fatalisme. Il note « Je crus alors réellement que j'allais mourir, puisque aussi bien le vide qui se creusait parut prendre toute la place que j'occupais jusqu'alors pour donner quelque forme à la vie que j'imaginais de vivre et révéler, derrière la fiction de mon être, la tranquille et blanche vérité de sa fin » . Il compense par l'écriture de ce journal ce qui est un moyen efficace de sublimer les épreuves les plus intimes. Puis il rencontre André, un ami de 21 ans son cadet qui lui présente sa compagne, Jeanne, dont il tombe évidemment amoureux. Du coup, depuis qu'il a rencontré Jeanne, ses rapport avec la mouche changent. Il se met à l’invectiver dans son journal et lui donne le nom d'Odile, celui de la femme qui, dit-il, avait précipité son destin! Il est amené à l'abandonner dans son appartement en souhaitant qu'à son retour elle serait simplement morte puisque ses amis le convient à une séjour d'une semaine aux sports d'hiver, ce qu'il accepte. Pendant cette période le couple se déchire mais se réunit, le laissant seul à la montagne. Il rencontre une autre femme Meije, dont il tombe amoureux...
La vie de Lucien est oisive mais encombrée de femmes qu'il aime, laisse partir ou ne peut toucher par timidité, par peur ou par volonté de ne pas s'engager. Cette histoire où finalement il ne se passe pas grand chose, surtout à propos de cette mouche, est une tranche de vie d'un homme ordinaire, frustré sans doute, qui fantasme beaucoup à propos des femmes. Il m'apparaît que les héros d'Oster sont ainsi. Ce n'est pas que cela m'ennuie, au contraire puisque finalement je m'y retrouve un peu et, au fond, je ne dois pas être le seul. Lucien est un homme qui aime les jolies femmes, ce qui prouve son goût, mais il se révèle incapable de les retenir. Il séduira peut-être Meije comme il a séduit Jeanne mais surtout elle ne restera pas avec lui soit parce qu'elle préféra son ami, soit parce que Lucien finira par se séparer d'elle comme il l'a fait avec Odile. En réalité, c'est un homme à qui le bonheur conjugal et peut-être le bonheur en général est tout simplement interdit. Il est sûrement séduisant, la femme qui est dans son lit est « belle comme la femme d'un autre » mais il ne s'y attachera pas et se retrouvera irrémédiablement seul face à la page blanche de son journal à laquelle il pourra confesser ses déboires. Je suis donc personnellement reconnaissant à l'auteur de ces romans intimistes d'être en phase avec la réalité, même si elle est un peu triste.
Le style est agréable, la phrase est, il est vrai est un peu longue parfois, mais l'émailler d’imparfaits du subjonctif ne me gêne guère, au contraire, cela lui donne un petit côté suranné qui me plaît bien.
La quatrième de couverture présente ce roman comme irrésistible et drôle. Je ne suis pas de cet avis et je dois dire que je n'ai pas beaucoup ri, peut-être au contraire. J'y ai trouvé quelque chose qui ressemble à la vraie vie et j'ai apprécié.
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LES RENDEZ-VOUS
- Par ervian
- Le 06/08/2014
- Dans Christian Oster
- 0 commentaire
N°780 – Août 2014.
LES RENDEZ-VOUS - Christian Oster – Les Éditions de Minuit.
Francis, le narrateur, donne à Clémence des rendez-vous dans un café sans l'en avertir... On comprend bien que dans ces conditions elle n'y vient pas. C'est qu'elle a fait partie de sa vie, mais depuis trois mois elle en est absente. Du coup, il se donne rendez-vous à lui-même, chez lui, mais l'autre lui-même qu'il a convié n'est pas là. Ainsi dîne-t-il seul et s’abandonne au sommeil puisqu'il est livré à lui-même et que tout le monde s'en fout ! Pourtant, il poursuit ses rendez-vous fictifs, un peu comme si toute sa journée se résumait à ces instants qui dès lors sont synonymes d'absence, de déception, de désespoir. Sa nouvelle vie articulée autour de ces fantasmatiques rendez-vous le coupe de la plupart de ses amis mais il convie quand même l'un d'eux, Simon, dont l'épouse, Audrey, vient de le quitter il y a trois jours lui laissant leurs deux enfants. Du coup ils sont deux à attendre leur femme et Francis part du principe que si Audrey peut revenir, il n'y a pas de raison pour que Clémence n'en fasse pas autant. Pour le soutenir dans son épreuve, Francis décide d'attendre lui aussi Audrey qui se manifeste d'ailleurs auprès de lui ce qui lui fait oublier ses problèmes personnels. Voila donc le lecteur devenu le témoin de deux chaos amoureux comme les affectionne Oster. Au vrai il n'y a rien d’extraordinaire, c'est plutôt deux drames minuscules avec une femme au centre de chacun d'eux. En fait Francis est comme les héros des romans d'Oster, un homme en manque d'amour et, malgré lui, grâce au hasard et un peu aussi à son ami, son destin va changer. Pourtant il ne s'attend pas du tout à ce qui va lui tomber dessus mais pour lui qui est toujours amoureux de Clémence et qui l'attend c'est assez étonnant et il y a de quoi être surpris. C'est un homme ordinaire, timide, sans relief et sans originalité, à qui il n'arrive rien d'habitude et le départ de sa femme est un événement qu'il a du mal à surmonter. On a beau se dire que cela peut arriver à tout le monde mais s'il est bien obligé de croire à l'absence de Clémence et ce qui lui arrive par ailleurs le bouleverse, le gêne, l'amène à se poser des questions, lui occasionne des états d'âme. L'instant de stupeur passé, il s'habitue, d'ailleurs très vite, se coule dans son nouveau rôle qui lui ouvre des horizons.
Le style est toujours le même, ce qui n’est pas forcément désagréable, le monologue accentue au début la sensation de solitude du narrateur et donne même une impression un peu labyrinthique, les situations ont un petit parfum de surréalisme (présence d'une panthère dans la salon de Simon qui est gardien d'un zoo), sont même un peu absurdes mais c'est là l'univers d'Oster. Dans la deuxième partie du roman les dialogues inverse cette sensation de solitude du début.
Je découvre l’œuvre de Christian Oster mais j'avoue que j'ai été un peu surpris par l'ambiance de cette histoire. Elle a beau vouloir être originale et l'est peut-être mais j'ai quand même été un peu déçu.
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
DANS LE TRAIN
- Par ervian
- Le 06/08/2014
- Dans Christian Oster
- 0 commentaire
N°779 – Août 2014.
DANS LE TRAIN - Christian Oster – Les Éditions de Minuit.
Les gares ont toujours été un lieu de rencontre privilégié. Quoi de plus étonnant qu'un homme y croise une femme et c'est peut-être le début d'une aventure amoureuse. Naturellement l'homme lui propose de porter son bagage, un sac plein de livres. Comme c'est un habitué des lieux et que cette femme lui plaît, il tente sa chance et l'accompagne dans le train et descend à la même station qu'elle, lui porte son sac jusque sur le quai. En principe quelqu'un l'attend dans cette ville et par curiosité, par envie ou par amour, il décide de la suivre de loin, prend un chambre à l'hôtel des voyageurs tout proche parce qu'il pense qu'elle y est descendue. Tel est le point de départ de cette histoire où cet homme, Franck, qui donne l’impression au début de savoir ce qu'il veut, est entreprenant et même carrément dragueur, pire peut-être, séducteur, puis au fil des pages devient hésitant, timide, maladroit. C'est le genre d'hommes à suivre de loin les femmes dans la rue mais sans les aborder sans leur adresser la parole. Finalement il a peur des femmes et se révèle être le jouet de cette Anne qui fait de lui ce qu'elle veut. Il en souffre mais aime cette souffrance puisque c'est elle qui la lui inflige. Il ne réagit guère et ne cherche même pas à profiter d'une situation qu'il a pourtant cherchée et dans laquelle maintenant il ne joue plus aucun rôle, ou si peu. Il se dit qu'il l'aime mais cet amour est platonique, idéalisé, intellectualisé, irréel même. Il subit cette crainte des femmes et quand il veut faire montre d'audace, cette dernière tombe à plat simplement parce qu'il ne va pas au bout de sa volonté. Finalement il est pathétique d'hésitations, il réfléchit, il ratiocine même et son embarras est maladif face à Anne qui se joue de lui et joue avec ses scrupules. Il est tellement fasciné par elle qu'il lui eût écrit des poèmes s'il avait su le faire mais elle lui aurait sans doute montré beaucoup d'indifférence.
Petit à petit il devient son ange-gardien, sa mascotte, un remplaçant mais si elle fait l’amour avec un homme dans cet hôtel, ce n’est pas avec lui. On a du mal à cerner cette femme, est-elle une allumeuse, une intellectuelle frigide, une hypocrite, une jouisseuse qui recherche l'extase dans les bras de n'importe qui et qui joue avec ce pauvre Franck ? Peut-être, mais lui, amoureux transi, ne peut que lui obéir et quand son tour vient de bénéficier de ses faveurs, il est aux anges. Dès lors son imagination est sans borne. Il veut l'aider , se sentir responsable d'elle et choisit de voir dans chacun des gestes qu'elle fait, même plus anodin, une confirmation de cette impression qui peu à peu s'installe dans son esprit et devient une certitude. C'est le signe de quelqu’un qui a longtemps attendu le grand amour, qui se persuade qu’il l'a enfin trouvé et qui fera tout pour le garder.
Il m'apparaît comme un grand sentimental qui idéalise les femmes parce qu'il en a peur et qui est parfaitement capable de tomber amoureux de chacun d'elles ; il est de ceux qui font rimer amour avec toujours et qui veulent surtout y croire, de ceux qui n'oublient jamais le nom de leurs conquêtes féminines simplement parce qu’elles ne sont pas si nombreuses. Pourtant, même s'il est sympathique, ce Franck, j'ai à son sujet un sentiment bizarre. Je pense que tout cela est bel et bon mais n'est finalement qu'une passade de plus pour Anne et que lui sera rapidement déçu parce qu'elle et lui n'ont pas la même approche et que ce qui est une belle histoire durable pour lui ne sera qu'une toquade de plus pour elle. Mais après tout il est peut-être bien qu'on lui laisse ses illusions !
Le texte est écrit à la première personne ce qui donne un monologue assez impersonnel. L'écriture d'Oster est descriptive, accordant une grande place aux détails du quotidien, donne à voir des scènes assez statiques avec une technique un peu bizarre marquée par une absence de dialogues directs mais qui sont rendus d'une manière indirecte. C'est orignal, pas forcément désagréable à lire, peut-être un peu moins fluide qu'un échange classique de paroles même si ce n'est pas sans instiller une certaine froideur dans le texte. D'aucuns pourront même y voir la marque d'une pudeur. Quand les dialogues reprennent leur place, ils le font une manière un peu gauche comme si tout cela n'était qu'un jeu sur la phrase et sur la langue pour donner une impression de malaise, d'inquiétude.
J'ai pris ce livre au hasard sur les rayonnages d'une bibliothèque. Je ne regrette pas.
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
COSMETIQUE DE L'ENNEMI
- Par ervian
- Le 04/08/2014
- Dans Amélie Nothomb
- 0 commentaire
N°778 – Août 2014.
COSMETIQUE DE L'ENNEMI - Amélie Nothomb – Albin Michel.
Cela commence d'une façon un peu bizarre dans un aéroport où un homme d'affaires, Jérôme Angust attend son avion et est interpellé par un Hollandais qu'il ne connaît pas, Textor Texel. Dans ce genre de lieu de passage les conversations qu'on y tient sont d'ordinaire d'une banalité affligeante. Là non et Texel confie à Angust avoir dans son enfance perpétrer par jalousie et avec la complicité de Dieu, le meurtre d'un élève plus brillant que lui. Il s'agit bien entendu d'un crime hypothétique qui pour lui est l'occasion de développements où se mêlent la culpabilité et les croyances religieuses et personnelles quelque peu naïves. Pour Angust, cet échange devient vite insupportable puisque Texel s'accroche à lui comme la moule à son rocher. Son véritable but est de le rendre malade sans qu'on sache très bien pourquoi il l'a choisi. L'épilogue peut fournir une réponse si on y veut en voir une.
Je poursuis sans grande conviction l’exploration de l’œuvre d'Amélie Nothomb, à cause sans doute de sa notoriété littéraire. Cela au moins me permet de me faire une idée de ses livres et peut-être de pouvoir en parler. Ce roman est certes facile à lire, son écriture est fluide et agréable mais je suis resté, un peu comme à chaque fois, sur ma faim. Les aphorismes sont parfois originaux, sur le hasard, sur Dieu, sur l'amour, sur la culpabilité, sur l'existence d'un ennemi intérieur qui nous pousse à tout détruire autour de nous. J'ai personnellement peu goûté l’évocation du viol ni les développements qui vont avec, quant aux meurtres, ils tiennent, à mon sens, davantage de l'acte gratuit que de la véritable illustration d'une pulsion. Quant aux propos sur le jansénisme et sur Pascal... ! La fascination que semble éprouver Texel pour la mort m'a paru assez superficielle et pour tout dire pas crédible du tout. Cette absence de crédibilité, qui ne peut à elle seule se justifier par le fait que nous sommes dans une fiction, revient souvent dans les romans d'Amélie Nothomb. J'y vois, en ce qui me concerne, une explication pour le manque d’intérêt que je ressens à chaque fois. Les dialogues, même si parfois ils ne manquent pas d'intérêt, débouchent souvent dans une impasse à cause de la passivité voire de l’énervement d'Angust plus préoccupé par le retard de son avion que par les propos de son interlocuteur. J'avoue que j'aurais été à sa place j'aurais ressenti ce même manque d'intérêt devant ce fâcheux. Quant à la conversation qui se déroule entre ces deux hommes, même après que Telex eut révélé la vraie raison de leur rencontre, j'ai du mal à en imaginer l'authenticité, entre injures, harcèlements, mystification et invitation au meurtre à cause du sentiment de culpabilité. Que le dédoublement de la personnalité existe et que chacun d'entre nous ait sa part d'ombre, cela ne fait pas de doute, que l'on porte en soi des pulsions criminelles, pourquoi pas, que l'inconscient soit un des moteurs de nos actes, sans doute, mais quand même les fantasmes sont du domaine de l'imaginaire, quant au suicide, même s'il reste un mystère pour les autres et même pour les proches, j’ai du mal à lui donner ce genre d’explication, mais après tout je laisse à l'auteur son point de vue. Cela donne, comme à chaque fois ou presque un livre qui n'a pas réussi à assouvir la passion que j'ai pour la lecture, et je trouve cela dommage. C'est peut-être tout simplement la marque de l'auteur que d'écrire ainsi. C’est peut-être la mienne, celle d'un simple lecteur, que de ne rien comprendre à sa démarche mais franchement je n'aime guère.
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
HYGIENE DE L'ASSASSIN
- Par ervian
- Le 04/08/2014
- Dans Amélie Nothomb
- 0 commentaire
N°777 – Août 2014.
HYGIENE DE L'ASSASSIN - Amélie Nothomb – Albin Michel.
Prétextat Tash, célèbre auteur a toujours fait dans l'originalité. Il a été Prix Nobel de littérature, ce qui n’est déjà pas banal mais encore, à l'age de 83 ans il se meurt d'un cancer des cartilages, une maladie orpheline au nom imprononçable, ce qui ajoute on ne conviendra un peu de lustre au personnage. C'est qu'il a toute sa vie joué un rôle, cachant sa générosité naturelle sous une agression de chaque jour. Mieux sans doute, se sentant mourir, il décide de mettre en scène cet ultime acte de sa vie. Non seulement la date en est prévue mais il convient de convoquer la presse qui bien entendu se fera un devoir de recueillir ses dernières paroles. Il avait même rédigé lui-même sa propre épitaphe !Au moins ne manquera-t-il pas sa sortie lui qui avait fait un parcours exceptionnel. Il se complet donc, lors de ces entrevues à détailler sa carrière littéraire, longue et à l'entendre fastueuse qui a fait de lui une écrivain précoce et célèbre. Il a même tissé sa propre légende de son vivant qu'il épelle pour les nombreux journalistes qui viennent l’interviewer. Cabotin, il en rajoute toujours un peu dans ses propos, maniant la contradiction et noircissant le trait ne serait-ce que pour se mettre lui-même en valeur mais donne à voir un homme acerbe, intolérant, misanthrope, misogyne et finit toujours par éconduire vertement le chroniqueur. C'est que, par un excès de nombrilisme il souhaite surtout parler de lui-même et attend de ses interlocuteurs d'occasion flagornerie et déférence.
Auparavant tous les reporters étaient des hommes. Arrive cependant une femme, Nina, dont il souhaite se débarrasser dès le début de l'entretien n'attendant même pas les questions. L'ambiance est tendue au début, lui est ignoble comme auparavant mais elle paradoxalement s'accroche et n'entend pas, comme ses autres collègues, être une flatteuse de plus. Est-ce à cause de sa virginité ou de sa peur des femelles comme il dit ? Est-il séduit ou mord-t-il malgré lui à l'hameçon de cette femme plus talentueuse que les autres ? Toujours est-il que les rôles s'inversent, qu'il la retient, refuse de parler de son œuvre, se livre un peu penaud , un peu honteux comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Pourtant, elle est la seule de tous les chroniqueurs a avoir lu son œuvre et un de ses romans inachevé celui-là précisément intitulé « L’hygiène de l'assassin », l'amène à être plus précis. Est-elle une talentueuse adepte de la maïeutique ou une enquêtrice hors pair mais Tash qui aimait tant parler de lui se retrouve face à lui-même et lui avoue... un crime. Il a effectivement assassiné sa cousine dans sa jeunesse.
J'ai lu ce roman, comme les autres, facile à parcourir. Comme je l'ai déjà dit dans cette chronique, les livres d'Amélie Nothomb se lient facilement et c'est au moins agréable à ce titre. Cela a été pour elle sans doute l'occasion de pas mal de poncifs sur l'écriture, l’érotisme, les femmes, la nourriture, Mai 68, la société et ses travers... une sorte de salmigondis pas vraiment passionnant ainsi que des avis sur Kant, Louis-Ferdinand Céline ou Sartes, pas non plus originaux. Cet sorte de huis-clos a, pour une fois l'avantage d'être crédible puisque ce roman met en évidence l'hypocrisie et la perversité de la condition humaine, et de donner une fin à un roman inachevé qui peut parfaitement évoquer Montaigne.
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA GRANDE VIE
- Par ervian
- Le 02/08/2014
- Dans Christian BOBIN
- 0 commentaire
N°776 – Août 2014.
LA GRANDE VIE - Christian Bobin - Gallimard
J'ai lu ce livre comme un long poème en plusieurs fragments, plusieurs tableaux qui donnent à voir des hasards de la vie, dans un bureau de tabac, une épicerie, dans les rues de la ville, dans un cimetière aussi parce que la mort fait partie de nous, conclut notre passage éphémère sur cette terre. Nous sommes mortels et notre mémoire se peuple des fantômes de ceux qu'on a aimés et qui ne sont plus. Écrire est peut-être participer à une comédie pour faire semblant d'être immortel [« Quand j'appuie la pointe du feutre sur le papier délicieusement froid, ma mort ne sait plus mon nom »]. Face à la mort, l'oubli guette et l'écriture, garde la mémoire, allège l'âme, panse les blessures, c'est un miracle, une sorte d'invitation à refaire ce monde avec des mots, si toutefois cela s'avère possible. C'est parfois une simple lettre, parfois un livre entier qu'importe, les mots qu'ils contiennent et dont ils sont faits sont une sorte de mystère qu'on disperse au vent ou qu'on conserve comme un souvenir. On les jette sur le papier où on les travaille comme le ferait un orfèvre et ils portent en eux le silence, l'angoisse ou une explosion de joie. Les livres sont un monde étrange, ils abolissent le temps et transportent le lecteur dans un ailleurs qu'il découvre et qu'il reconnaît à la fois puisque le monde dont il est question est aussi le sien et celui qui écrit possède en commun avec son lecteur sa condition d'homme qui certes est vouée à la mort mais aussi à une éternelle résurrection. [« Pourquoi ne nous dit-on jamais que la résurrection commence dès cette vie et que toute parole ivre est une rose de sang, éclatante reine du néant de nos jours ?»].
Le livre est un jalon vers ce qu'on voudra, paradis ou enfer mais il contient l'éternité [« L'éternel est là, sous nos yeux, sous nos pieds, dans une phrase »], un objet, un trésor qu'on tient entre ses mains. Avant, il y a la feuille vierge, la main qui tient le stylo et la nuit qui est à la fois une invitation à l'écriture et un moment fort de l'inspiration qui va faire naître des couleurs et des formes sur la blancheur du papier [« Les livres sont des secrets échangés dans la nuit »]. Les mots procurent l'ivresse pour ceux qui écrivent comme pour ceux qui lisent, ils portent en eux la poésie sortie du néant, née de la vision fugace de l'instant, comme un ange qui passe, sorti de l'éternité. Certains animaux, les chats par exemple, en sont les intermédiaires involontaires mais talentueux [« Tu t'allongeais sur une lettre en cours et c'était comme si Dieu en personne, lassé de me voir écrire, versait l'encre noire de ton pelage sur mes mots »].
Ceux qui ont fait partie du monde des vivants et qui nous ont quittés laissent une trace, même si cela ressemble à de la folie [«Marilyn suivait l'étoile désorientée de sa folie... La folie est un mécanisme d'horlogerie très fin »]. Malgré tout le mal que nous réserve la vie, malgré la mort qui l'interrompt et salit celle de ceux qui restent et souffrent de l'absence, la vie reste un bien inestimable, un poids aussi. [« Qu'on ne doute pas en m’entendant, que cette vie est le plus haut bien, même si elle nous broie »].
L'auteur convoque tous ceux qui, dans sa mémoire sont acteurs de cette vibration de vie Lewis Carroll, Kierkegaard ou Jean Grosjean, et lui de conclure « La poésie c'est la grande vie ».
Ce texte est une véritable magie, celle de l'instant et de la durée, de la légèreté et du poids des mots, de l'inestimable richesse de la vie.
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
MERCURE
- Par ervian
- Le 02/08/2014
- Dans Amélie Nothomb
- 0 commentaire
N°775 – Août 2014.
MERCURE- Amélie Nothomb – Albin Michel (1998)
Nous sommes en 1923 et une infirmière, Françoise Chavaigne, gagne l'île de Mortes-Frontières où elle doit soigner la pleurésie d'une jeune fille, Hazel, qui vit là avec un vieil homme, le capitaine Omer Loncours. Elle apprend de la bouche de ce dernier qu'il l'a recueillie à la suite d'un bombardement qui l'a laissée affreusement défigurée.D'emblée des relations de confiance s'installent entre les deux femmes ; pourtant, la consigne est de ne pas parler de cet événement ni évidemment de son aspect physique.. sous peine de mort ! Elle ne tarde pas à s'apercevoir que l'absence de miroirs, d'objets réfléchissants et la position des ouvertures vitrées lui interdissent de se voir. Elle apprend que le vieil homme couche avec Hazel et aussi l'existence d'une autre femme, Adèle, que le capitaine à sauvé de la mort quelques vingt ans auparavant, qu'il a séquestrée en lui faisant croire qu'elle avait été défigurée par un incendie et qui se serait suicidée. Dans les deux cas il s'agit d'un mensonge entretenu par le capitaine alors que les deux femmes sont d'une éclatante beauté.
J'ai eu l'impression de lire un roman policier mais ce n'en est pas un. En revanche j'ai bien eu le sentiment d'être en présence d'un roman à l'eau de rose, par ailleurs peu convaincant, avec ses développements sur l'amour, le bonheur, le consentement à l'acte sexuel, la jalousie, la volonté de demeurer incarcérée c'est à dire sous l'emprise de Loncours, la virginité et sur les personnages stendhaliens. La localisation sur une île, dans un manoir sombre ajoute un côté exotique et même un peu théâtral, du genre « unité de lieu », à moins que cela n'évoque le jardin d'Eden, au moins pour le capitaine. Le jeu de mots facile sur les noms des femmes et surtout sur celui du vieillard n'ont pas non plus retenu mon intérêt (O.Loncours pour « capitaine au long cours » qu'il était effectivement).
Je note cependant que le concept de résurrection que j'avais déjà remarqué dans « Le fait du prince » (La Feuille Volante n°772) revient sous sa plume. En effet l'auteure présente Hazel comme la réincarnation d'Adèle ce qui peut-être à mes yeux une piste intéressante, c'est peut-être aussi tout simplement un fantasme ou une obsession d'Amélie Nothomb ! L'arrivée dans la vie du capitaine d'Hazel est présentée comme un cadeau des dieux, un bienfait du hasard, Pourquoi pas après tout mais on peut parfaitement voir aussi dans cet homme vieillissant, un sadique et un vicelard ?
L'épilogue d'un roman est toujours attendu par le lecteur. J'ai déjà dit dans cette chronique que le « happy-end » ne me plaît pas du tout et la première version emprunte beaucoup au roman feuilleton pour midinettes. Ici, c'est peut-être un avantage puisqu'il est double, un peu comme si le lecteur avait le droit de choisir. Là aussi pourquoi pas ? Je choisis quand même d'y voir quelque chose qui, en tant qu'auteur, m'a toujours étonné, c'est la liberté de personnages dont j'ai pu vérifier personnellement qu'elle existe et pas seulement en tant que concept. Quand on écrit une fiction, on a une idée assez précise du scénario mais il arrive parfois qu'au cours des développements une histoire différente s'impose à vous, et vous vous laissez faire en vous demandant où tout cela va vous mener...Mais là aussi, c'est peut-être moi qui divague !
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE ROMAN DES ESPIONNES
- Par ervian
- Le 01/08/2014
- Dans Vladimir Fédorovski
- 0 commentaire
N°774 – Août
2014.
LE ROMAN DES ESPIONNES – Vladimir Fédorovsky- Éditions du Rocher.
Pour le commun des mortels, l'univers de l'espionnage est fascinant. Quand il s'agit d'espionnes, le sujet devient passionnant puisqu'elles ajoutent l'amour au mystère. Ces femmes sont nécessairement belles, intelligentes, vives, cultivées, parlant le plus souvent plusieurs langues, aimant le luxe et paradoxalement elles sont discrète, mais d'une discrétion déguisée qui donne facilement le change ; elles ont servi leur pays à l'égal des combattants du front en exploitant la vanité des hommes qui furent leur proie. Ce sont des séductrices mais ce qui les caractérise le plus c'est le génie de la vie puisqu'elles ont, pour la plupart exercé dans le contexte de la guerre froide et ont réussi à échappé « à cet instrument de souffrance de mort que fut le communisme ». C'est que l'activité d’espionnage s'est développée presque essentiellement au XX° siècle et évidemment à l'occasion des guerres, la 1° et la 2° guerre mondiales, la guerre d'Espagne puis la guerre froide et dans ce domaine l'importance de femmes a été déterminante. L'auteur distingue les professionnelles comme celle qui livra les secrets de la bombe atomique américaine à l'Union soviétique mais il y eut aussi des agents d'influence, des « idiotes utiles » qui étaient sûres de la justesse des idées soviétiques, telle Mme Romain Rolland qui convainquit son époux de prendre partie pour l'URSS ou Elsa Triolet qui de la même manière persuada Aragon parce qu'à l'époque le choix idéologique entre le nazisme et le communisme penchait pour ce dernier. Il y ajoute les vraies- fausses espionnes telle Mata Hari qui selon lui fut un fantasme collectif mais surtout un bouc-émissaire.
C'est que l'amour dans ce domaine interfère largement dans le travail d’espionne pour lequel elles ont un atout supplémentaire dans la collecte de renseignements : la séduction . Ainsi Olga Techekhova , intime d'Hitler et amie d'Eva Braun informa-t-elle Staline sur les secrets du III° Reich. De même les soviétiques réalisèrent-ils la bombe atomique grâce aux espionnes infiltrées aux États-Unis.
A travers des documents des témoignages et des documents d'archives, l'auteur nous livre une liste des plus emblématiques d'entre elles, en commençant par la période de la Grande Guerre. L'incontournable Mata Hari et, on s'y attend sûrement moins, Marthe Richard, qui a attaché son nom à la fermeture des maisons closes en 1946. La liste est longue de celles qui ont, par leur action, peser sur le destin du monde.
Outre les révélations passionnantes de ce livre, ce que je retiens c'est, comme toujours, l'hommage de l'auteur à notre langue française qu'il pratique avec bonheur. C'est toujours un plaisir de le lire !
©Hervé GAUTIER – Juillet 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LES VIEUX DE LA VIEILLE
- Par ervian
- Le 31/07/2014
- Dans René FALLET
- 0 commentaire
N°773 – Août 2014.
LES VIEUX DE LA VIEILLE – René FALLET – Denoël (1958)
Dans un village du Bourbonnais, deux septuagénaires, Jean-Maris Pejat, ancien réparateur de cycles, et Blaise Poulossière, ancien agriculteur, forts en gueule et amateur de chopines font la loi. Un troisième compère, Baptiste Talon, fraîchement retraité de la SNCF revient au village et apprend à ses amis son intention de se rendre à Gouyette, une maison de retraite dont un collègue lui a dit beaucoup de bien, tenue par les bonnes sœurs à quelques kilomètres de là. Après pas mal d'hésitations, ayant constaté qu'ils ne faisaient plus vraiment partie du village, qu'ils n'étaient finalement plus très jeunes, et qu'ils passaient le plus clair de leur temps au bistrot, les trois compères se décident à partir ensemble, mais à pied et en compagnie d'un âne cacochyme. Ils feront des rencontres non prévues avec leurs souvenirs de jeunesse mais aussi avec la maréchaussée qu'ils ne manqueront pas de ridiculiser. Ils ne partiront cependant du village sans un dernier salut aux copains du cimetière. Ils entament donc une pérégrination laborieuse et surtout arrosée jusqu'à cet hospice où ils se trouvent décidément trop vieux pour y vivre. Ainsi vont-ils refaire le chemin en sens inverse, le plus vite qu’ils pourront !
René Fallet signe là un roman d'humour repris en 1960 par Gilles Grangier. Certes il s'agit-là d'une adaptation, d'une recréation comme on dit. Les lieux sont un peu différents, les aventures aussi mais l'esprit est le même. Nous retrouvons nos trois compères toujours aussi vantards et prompts à la critique mais que rien ne retient plus au village. Leur temps est terminé et ils ne parlent plus que de la guerre de 14 qu'ils firent chacun sur des théâtres d'opérations différents et effectivement le temps a passer sans peut-être qu'ils s'en rendent compte. Grangier brode un peu avec cette histoire de pré appartenant à Talon et loué à Poulossière mais dont Baptiste n'a pas touché les loyers depuis quatre années. C'est que ledit pré a été cédé par le fils de Blaise à la commune pour en faire un terrain de football. Ce geste altruiste lui a permis de devenir conseiller municipal, autant dire notable. Le pauvre Poulossière, quoique hâbleur avec ses compères, file doux face à sa famille et n'ose s’opposer aux décisions de son fils. Pourtant, à l'aide de ses deux amis, il va se venger et empêcher autant qu'ils le peuvent les matchs de football.
Las, le temps a passé depuis leurs jeunes années et la fête annuelle des escargots va leur rappeler la triste réalité. Ils sont vieux ! Puisque Talon a refusé la voiture des bonnes sœurs, ses deux compères décident de l'accompagner à sa nouvelle résidence, mais il préfèrent faire le chemin a pied ce qui n’est pas sans mésaventures, des rencontres de vieilles connaissances, des souvenirs de guerre, de jeunesse et de conquêtes féminines, des disputes, des jurons bien sentis et surtout sans quelques arrêts-boissons.
Arrivés enfin au but, ils ne tardent pas à s'apercevoir que cet établissement austère dont on avait pourtant dit tant de bien à Talon se révèle effectivement être un « bagne pour vieux » dont ils décident de s’échapper non sans semer la panique sur leur passage. Le retour n'est pas moins épique que l'aller mais c'est entre deux gendarmes qu'ils reviennent au village. Le maire les sermonne comme il l'aurait fait à des garnements. Ils promettent de s’assagir, mais faut-il leur faire confiance ?
Cette adaptation cinématographique rablaisienne s'est faite avec la complicité de Michel Audiard dont les dialogues sont toujours aussi inimitables. Le scénario est servi par Noël Noël Pierre Fresnay et Jean Gabin, des acteurs d'exception capables avec le même talent de camper un aristocrate ou un prolétaire, un flic ou un truand.
Ce n'est pas pour donner l'impression que moi aussi je fais partie des vieux de la vieille, mais je revois toujours ce film avec le même plaisir. Il correspond à une écriture cinématographique particulière désormais révolue qui doit beaucoup aux dialogues à la mise en scène et aux acteurs.
©Hervé GAUTIER – Août 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE FAIT DU PRINCE
- Par ervian
- Le 30/07/2014
- Dans Amélie Nothomb
- 0 commentaire
N°772 – Juillet 2014.
LE FAIT DU PRINCE – Amélie Nothomb – Albin Michel.
Ce livre pris au hasard dans les rayonnages de la bibliothèque m'était parfaitement inconnu et je venais juste d'entamer l’œuvre d'Amélie Nothomb. D'autre part, le titre m'évoquait davantage une théorie juridique qu'une œuvre de fiction mais pourquoi pas ?
Dès les première pages, cela me semblait un peu loufoque mais après tout pourquoi pas me suis-je dit. Un parfait quidam, Baptiste Bordenave, la quarantaine triste, dont la vie est sans aucun fait marquant, voit débarquer chez lui un inconnu qui lui demande d’utiliser son téléphone à cause d'une panne de sa voiture. Jusque là rien d'extraordinaire sauf que cet homme meurt sous ses yeux. A cause d'une conversation qu'il a eue la veille, il craint d'être accusé de meurtre ce qui est assez inattendu. Ce qui l'est encore plus est qu'il décide de prendre sa place, son identité, de le ressusciter en quelque sorte alors même qu'il ne sait rien de lui. Du point de vue du code pénal c’est quand même assez risqué. Il sera donc Olaf Sildur, un suédois et comme le hasard fait bien les choses, surtout dans les romans, il s'aperçoit vite qu'il ne perd pas au change puisque qu'après avoir volé son identité et son argent au défunt, il lui prend sa jeune et jolie femme. De quotidienne et laborieuse, sa vie devient soudain oisive et surtout riche, consacrée au sommeil, au repas décalés et surtout à l’assèchement de la cave, ce qui donne un florilège de poncifs sur le savoir-boire, l’alcoolisme et l'ivresse. A ce moment on peut s'interroger sur l'activité réelle de cet Olaf, entre trafic de drogue et espionnage d'autant que notre « Baptiste-Olaf » est suivi par deux hommes ce qui l'oblige à fuir et donc à disparaître avec sa nouvelle maîtresse en direction de la Suède. Du coup ce roman bascule dans une sorte de thriller, mais ce n'est pas exactement cela puisque cela devient complètement surréaliste avec l'existence d'un tunnel entre l'appartement du défunt et la banque que, bien entendu et sans aucune difficulté, le nouvel Olaf dévalise. Le fait d'être dans une fiction n’autorise pas pour autant n'importe quelle facilité de scénario ni d'ailleurs des longueurs un peu trop fréquentes et on se perd en conjectures sur la véritable identité du vrai Olaf, sur sa vie, sur sa mort et sur ce qu'a amené Baptiste à prendre sa place. Quant à l'évocation finale du Cercle polaire, je n'ai pas vraiment compris, à moins que ce ne soit le sempiternel thème de la feuille blanche qui, ici, aurait bien dû le rester. Le récit n'est tout simplement pas crédible et j'ai trouvé cela dommage. Le seul intérêt que j'y ai perçu est qu'il se lit bien et vite, comme la plupart des romans d'Amélie Nothom, et procure une agréable lecture.
Et « le fait du Prince » la-dedans ? Je ne suis pas un spécialiste mais c'est soit un acte arbitraire du gouvernement soit, en droit administratif français, une décision de l'Administration qui pèse sur un contrat où elle est partie prenante et qui peut éventuellement lésé son cocontractant. Mais je ne vois pas très bien le lien entre ces notions juridiques et ce roman, l'explication finale ne m'ayant pas vraiment convaincu, à moins bien sûr que je ne sois, une nouvelle fois, passé à côté de quelque chose !
Je connais imparfaitement l’œuvre, par ailleurs abondante, de l’auteure (La Feuille Volante n°676 – 771) mais il m'apparaît de plus en plus qu'elle est capable du pire comme du meilleur. Là, j'ai été franchement déçu.
©Hervé GAUTIER – Juillet 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
STUPEUR ET TREMBLEMENTS
- Par ervian
- Le 29/07/2014
- Dans Amélie Nothomb
- 0 commentaire
N°771 – Juillet 2014.
STUPEUR ET TREMBLEMENTS – Amélie Nothomb – Albin Michel.
Grand prix du roman de l'Académie Française 1999.
C'est l'histoire d'une jeune Belge, pleine d'ambition et amoureuse de la culture japonaise. Elle entre donc comme interprète dans une multinationale nippone d'import-export, la société Yimimoto, mais ne tarde pas à déchanter. Elle se retrouve après pas mal d’humiliations... comme nettoyeuse de chiottes, une sorte de mise au placard un peu particulière, autant dire qu'on veut la pousser à la démission. Pourtant elle tient bon et va jusqu’au terme de son contrat de travail tout en choisissant de s'évader de cette « condition » par des expédients personnels ou même d'en rire ! C'est qu'elle apprend à ses dépends que les codes européens sont différents de ceux en usage au « pays du Soleil-Levant » et que le monde du travail n'y est pas non plus un havre de paix. Elle finit par se couler dans le moule, par prendre son mal en patience et par trouver son salut dans l’inversion des concepts ou, à tout le moins à en donner l'impression, faire en quelque sorte acte de soumission apparent, tel le respect du sens de l'honneur, fondamental dans la culture japonaise, tout en gardant intacts ses valeurs et en puisant dans cette expérience le sujet d'un livre, une manière aussi de se libérer par l'écriture.
L'auteure brosse un portait peu flatteur de la société nippone, décrivant la condition des hommes et surtout celle de femmes vouées à un avenir plutôt compromis sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. Apparemment il est difficile de s'y épanouir en dehors de l'entreprise. Dans ce roman autobiographique, l'auteure nous confie son expérience personnelle d'immersion dans la société mais surtout dans le monde du travail japonais. C’est vrai que l'état d'esprit y est moins contestataire, plus docile face au patronat et au pouvoir qu'en occident. Il y a une subordination naturelle de l'individu, inconnue chez nous, face à tout ce qui incarne l'autorité, l'oubli de son bonheur personnel au profit de la société commerciale. Tout ici se résume au travail, à l'entreprise et le reste peu ou prou ne compte guère. Ainsi la tradition de l’obéissance aveugle, de l’auto-culpabilisation est-elle respectée avec des formes appropriées proches de ce qui serait chez nous regardé comme une comédie ainsi qu'en témoigne l'attitude qu'on devait avoir face à l’empereur du Japon, considéré naguère comme un dieu, en s'adressant à lui « avec stupeur et tremblements »( ce qui donne son titre au roman).
Certes le contexte a quelque chose d'exotique et même d'anecdotique, certes en occident il y a des syndicats, des associations, des groupes de pression, des soutiens individuels et spontanés un arsenal juridique apparemment inconnus au Japon et qui garantissent contre ce genre de chose mais je me suis demandé si finalement ce monde du travail en tant que tel était vraiment si différent que cela chez nous. Ce qui est présenté comme « culturel » au Japon me semble transposable dans nos entreprises comme un moyen de culpabilisation, une manière de se débarrasser d'un collaborateur devenu encombrant, de favoriser une forme d'autoritarisme individuel avec parfois la bienveillance de la hiérarchie quand ce n'est pas tout simplement pour obtenir des faveurs sexuelles ! Mademoiselle Fubuki Mori qui se révèle être une femme magnifique et même fascinante sous la plume de l'auteure devient pourtant sa tortionnaire ; ne s'incarne-t-elle pas chez nous dans la multitude de petits chefs imbus de leur importance et qui entendent faire peser leur autorité sur leurs inférieurs ? Leur position intermédiaire dans l’entreprise, acquise certes par la patience, parfois par la compétence mais bien plus souvent par la flagornerie, la délation, le clabaudage, font d'eux des intermédiaires intéressants pour le patronat et ils attendent de leurs inférieurs la même vassalité que celle qui fut la leur pour obtenir leur poste. Conscients de leur importance, ils aiment la faire sentir à ceux qu'ils ont en leur pouvoir. La hiérarchie si pesante dans ce roman est-elle vraiment étrangère à notre système où, bien souvent, elle étouffe l'épanouissement, les initiatives, la simple liberté d'entreprendre ou d'innover. Le système japonais qui réclame la perfection chez les salariés d'une société est-il vraiment inconnu chez nous où on nous parle d'excellence et surtout par la comparaison avec les autres pays plus performants que le nôtre sur le plan économique ? Je ne parle pas du harcèlement, concept longtemps pratiqué, hypocritement ignoré chez nous mais cependant bien présent dans le monde du travail au point d'être enfin reconnu et poursuivi aujourd'hui jusque devant les tribunaux ! Je ne garderai bien de généraliser mais y a-t-il vraiment de la différence entre ce qu'a subi la narratrice, ravalée à des emplois subalternes voire dégradants, constamment maintenue dans un état d'infériorité et psychologiquement fragilisée et la volonté parfois mise en œuvre chez nous de se débarrasser d'un collaborateur en le laissant inactif, en lui confiant une fonction qui ne correspond pas à sa compétence ou simplement en mettant en avant le nécessaire rendement et ce sans se préoccuper des conséquences sur sa vie ?
Certes les mentalités sont différentes au Japon et en occident (singulièrement en France) et l'auteure a sûrement un peu noirci le trait en faisant de la compagnie Yumimoto un modèle qu'elle n'est peut-être pas partout, mais quand même ! L'auteur a été l'objet de nombre d'avanies qui l'ont rabaissée et précipitée vers sa « démission contractuelle ». J'ai vu dans ce roman une manière de remettre en question notre vision du Japon qui a, un temps, servi de modèle économique à notre pays.
Bien écrit et facile à lire, j'ai bien aimé ce livre pour son style, son témoignage et pour les questions qu'il soulève.
©Hervé GAUTIER – Juillet 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA CAMPAGNE DE FRANCE
- Par ervian
- Le 27/07/2014
- Dans Jean-Claude Lalumière
- 0 commentaire
N°770 – Juillet 2014.
LA CAMPAGNE DE FRANCE – Jean-Claude Lalumière – Le dilettante.
« Cultibus », c’est agence de voyages basée à Biarritz qu'ont créée Alexandre et Otto, deux jeunes professeurs de littéraire et d'histoire que le métier d'enseignant a rebuté et qui proposent, à titre de reconversion, des trajets culturels en car à travers l'Europe. On fait mieux pour motiver le client et attirer la clientèle mais au moins fait-on ainsi dans l’original puisque la but n'est ni le Mont-Saint Michel, ni Euro-Disney ni le Futuroscope ! D'ailleurs les comptes en font foi, ça sent le dépôt de bilan ! Il va falloir faire quelque chose pour sauver cette pourtant jeune entreprise et cette chose vient sous la forme d'un périple partant de chez eux pour rallier le nord de la France, une sorte de « Ch'ti tour », sur le thème de l'amitié franco-allemande mais version littéraire, ce qui, là non plus ne risquait pas de déplacer les foules. Miracle, une association de retraités de St Jean de Luz se présente mais ce voyage avait quelque chose d'expérimental puisque nos deux voyagistes ne tardent pas à s’apercevoir que leur clientèle s'intéresse davantage à la nourriture et au show-biz qu'à la culture. Malgré leur formation littéraire, nos deux compères peinent à passionner leur auditoire et leur programme originel est vite oublié et varie au gré de ses desiderata, des grèves sauvages avec barrages routiers et des pannes inopinées. Ils avaient prévu d'invoquer les œuvres complètes d'Alain Decaux et le manuel scolaire de Lagarde et Michard en plusieurs tomes mais les voici orientés vers les côtes de Vendée dévastées par la tempête Xynthia, une usine de friandises à Cholet puis contraints à un bivouac en pleine nature plus digne de boys-scouts que de gens du troisième âge !
En fait ce groupe hétéroclite de douze retraités, composé notamment d'un colonel en retraite, fervent gaulliste, d'un ancien combattant qui bouffe du boche, d'un professeur de français atteinte de la maladie d’Alzheimer et d'un ex-conducteur de car scolaire grincheux, est parfaitement ingérable et nos deux agents de voyage font ce qu'ils peuvent pour satisfaire cette clientèle parfois vindicative parfois étonnamment conciliante alors que leur entreprise ,au bord du gouffre financier, les contraint en permanence à négocier le prix des hôtels et des restaurants, d'inventer des activités, tout cela sous l’œil inquisiteur de leur comptable... Pendant toutes ces pérégrinations parfois hasardeuses Alexandre qui a un penchant pour Otto fait ce qu'il peut pour se rapprocher de lui malgré une indifférence affichée de l'intéressé, mais la hasard des rencontres va changer la donne.
Son premier roman,« Le front russe »(La Feuille Volante n° 508) m'avait bien plu. Ici, l'auteur ne se départit pas de son humour habituel mais celui-ci m'a beaucoup moins convaincu. Certes le texte se lit facilement et même vite mais j'ai noté quelques longueurs, des incongruités même, un épilogue un peu artificiel avec une « happy-end » digne d'un roman à l'eau de rose pour ces deux loosers reconvertis temporairement en agents de voyages qui ne tarderont sûrement pas à rejoindre l’Éducation Nationale qu'ils avaient soigneusement choisi d'éviter. A entendre ceux qui en font partie, c'est, malgré les grandeurs et les servitudes de la Fonction Publique, le plus beau métier, on y jouit au moins de la sécurité d’emploi et des vacances !
©Hervé GAUTIER – Juillet 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
UN SINGE EN HIVER
- Par ervian
- Le 26/07/2014
- Dans cinéma français
- 0 commentaire
N°769 – Juillet 2014.
UN SINGE EN HIVER – Antoine Blondin- Adaptation cinématographique d'Henri Verneuil (1962).
A quoi ça tient les serments d'ivrogne ! Albert Quentin, patron d'un hôtel-restaurant, ancien fusilier-marin en Chine pendant son service militaire a promis, pendant le bombardement de 1944 de Tigreville, une petite station balnéaire de la côte normande, de ne plus boire s'il en réchappait. C'était l'époque ou le service militaire était une période incontournable, un rituel initiatique. Si on ne l'avait pas fait on n'était pas un homme, c'est à tout le moins ce qu'on disait ! Quentin en a la nostalgie parce que ces années se confondaient avec l'alcool. Quentin est un homme de parole et il mène une vie tranquille aux côtés de Suzanne, sa femme, c'est à dire un quotidien dédié au régime sec, et ce pendant quinze ans. Il déserte même le café de son voisin. Mais voilà qu'un jeune publicitaire, Gabriel Fouquet, débarque un beau jour et s’installe dans l'hôtel de Quentin. Lui, il boit pour oublier l'échec de sa vie sentimentale avec Claire et l'alcool le transporte en Espagne où vit son amie, chacun son voyage ! Et d'ailleurs il vient à Tigreville voir sa fille, pensionnaire dans une institution. L'Espagne, il en rêve au point de parler aux incrédules clients du café de son soleil, de son flamenco, de ses taureaux et, joignant le geste à la parole va jusqu'à interrompre la circulation de cette petite ville en transformant la rue principale en arène. Sauf que, pour lui, les voitures sont autant de taureaux, ce qui déplaît à la maréchaussée. Pour Quentin, c'est le signal qu'il attendait depuis longtemps, il reconnaît en Fouquet un compagnon qui comme lui n'a « ni le vin petit ni la cuite mesquine », le délivre de la perspective d'une nuit passée en cellule de dégrisement et nos deux compères s'en vont arroser cela dans un bar un peu louche qui surplombe la ville « Les gastronomes disent que c'est une maison de passe et les vicelards un restaurant chinois. », indique-t-il en guide averti. Ils connaîtront ensemble deux jours d'ivresse conclus par un mémorable feux d'artifice improvisé sur la plage pour lequel Landru, un commerçant local, s'associe à eux pour lui aussi s'offrir son quart d'heure colonial.
Après cette « nuit d'ivresse » qu'ils illustrent en chantant la fameuse chanson « Nuit de Chine », ils reprendront chacun leur vie d'avant, Quentin en rentrant à l’hôtel et en allant, comme chaque année visiter la tombe de son père, Fouquet en emmenant avec lui sa fille. Dans le train qui les emmène vers leur destination respective, la petite demande à Quentin de lui raconter une histoire avant de prendre sa correspondance. Un peu tristement il conclut « En Chine, quand les grands froids arrivent, dans toutes les rues des villes, on trouve des tas de petits singes égarés sans père ni mère. On sait pas s'ils sont venus là par curiosité ou bien par peur de l'hiver, mais comme tous les gens là-bas croient que même les singes ont une âme, ils donnent tout ce qu'ils ont pour qu'on les ramène dans leur forêt, pour qu'ils trouvent leurs habitudes, leurs amis. C'est pour ça qu'on trouve des trains pleins de petits singes qui remontent vers la jungle ».
Je revois toujours ce film avec plaisir et émotion à cause du jeu des acteurs mais aussi des somptueux dialogues de Michel Audiard.
©Hervé GAUTIER – Juillet 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
SACRIFICES
- Par ervian
- Le 26/07/2014
- Dans Pierre Lemaître
- 0 commentaire
N°768 – Juillet 2014.
SACRIFICES – Pierre Lemaitre - Albin Michel.
Rien ne prédisposait Anne Forestier, en ce matin tranquille dans une galerie marchande des Champs-Élysées, à être témoin du braquage d'une bijouterie et, devenue gênante, à être sauvagement agressée et laissée pour morte par deux petits truands. C'est, comme on dit, se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Non seulement les braqueurs massacrent Anne à coups de crosse mais ils tirent sur elle et poursuivre leurs casses ailleurs. Malgré leur côté spectaculaire, ses blessures sont moins graves qu'il n'y paraît et elle est une femme de caractère et surtout volontaire ; elle survivra ! Elle a vu le visage de ses agresseurs et à ce titre doit être éliminée, c'est pourquoi l'un d'eux la poursuit jusqu'à l’hôpital. Il y est même venu avec un fusil à canon scié pour l'exécuter mais en vain !
Elle est aussi la compagne de Camille Verhoeven, commandant de police à la Criminelle qui se fait attribuer l'enquête en faisant un peu le forcing face à une hiérarchie qu'il prise peu, qu'il mystifie en permanence, une justice dont il semble se moquer et un code de procédures pénales dont il semble avoir oublié jusqu'à l'existence. C'est un véritable électron libre qui agit pour son propre compte, malgré la bienveillance du juge et l'amitié du contrôleur général, dans la plus parfaite illégalité au risque d'un dessaisissement, d'une enquête de l'IGS, d'une inculpation personnelle et d'une exclusion, comme les flics qui glissent sur la mauvaise pente. Il fait de cette enquête une affaire personnelle, à moins que ce ne soit le contraire, surtout depuis l'assassinat d'Irène, sa première femme. Anne est réellement en danger puisque celui qui l'a passée à tabac, Vincent Hafner, est un truand chevronné qui reste introuvable. Le commandant va donc mettre les moyens qui, pour lui, sont nécessairement entachés de marginalité voire d'illégalité. Pourtant l'enquête piétine et les ennuis pleuvent sur lui mais l'urgence est de protéger Anne à tout prix, même à celui de la rencontre avec les caïds du milieu et même l'assassin de sa propre épouse. Camille est un artiste, un délicat dessinateur qui, malgré son talent ne connaîtra jamais la notoriété, c'est un amoureux des chats et un être secret et c'est sans doute ce qui l'a rapproché d'Anne dont finalement il ne sait rien. Mais bizarrement plus il investigue, plus cette dernière devient un mystère pour lui, un véritable fantôme qui lui pose de nombreuses interrogations, de multiples états d'âme et il en vient à douter des apparences mêmes. Et pourtant il tient à elle.
C'est un thriller avec l’écriture, l’ambiance et les personnages qui conviennent à ce genre. Pendant ces trois jours, le découpage horaire, les actions haletantes, les mystérieux arcanes autant que les rebondissements entretiennent un suspense de bon aloi. J'en profite pour préciser qu'à mon avis le roman policier n'est pas seulement dédié à l'été ou associé au farniente au soleil ou à la plage. Par rapport à la littérature générale dont elle est une facette, la littérature policière à son originalité, ses auteurs talentueux et ceux qui le sont moins. Jusqu'à ce qu'il obtienne le Prix Goncourt pour « Au revoir là-haut », je ne connaissais pas Pierre Lemaitre (La Feuille Volante n°734). Il explore ici un genre différent qui m'a bien plu et je pense que je vais poursuivre la découverte de cette partie de son œuvre*.
* Ce roman est le dernier de la trilogie Verhoeven.
©Hervé GAUTIER – Juillet 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE TORT DU SOLDAT
- Par ervian
- Le 23/07/2014
- Dans Erri De Luca
- 0 commentaire
N°767 – Juillet 2014.
LE TORT DU SOLDAT – Erri De Luca - Gallimard.
Le narrateur se voit confier la traduction en italien de l’œuvre d'un écrivain juif inconnu en Italie. Il explique pourquoi le yiddish est une langue riche et l'attachement qui est le sien à sa littérature. Il parle d'une rencontre fortuite dans un restaurant des Dolomites avec un vieil homme et une jeune femme. Pour lui les livres ont peuplé son enfance et chacun était pour lui une fenêtre sur le monde. Plus tard l'extermination des Juifs par les nazis l'a bouleversé, il a visité certains camps pour s’imprégner de la souffrance et de la mort injustes de ces gens, a évoqué leur résistance héroïque dans le ghetto de Varsovie, les grandes figures qui l'inspirèrent et les écrivains survivants qui en portèrent témoignage.
Puis vient le récit plein de bon sens et parfois de naïveté de la jeune femme qui était en compagnie de l'homme à côté de la table du narrateur. Elle est allemande et l'homme qui l'accompagne est son père, un ancien tortionnaire nazi dont le seul tort, de son point de vue, est d'avoir été vaincu. Elle narre son histoire personnelle où ses parents lui ont sciemment caché la vérité, son père changeant de nom et de visage et se cachant sous le masque d'un aïeul pour ne pas avoir à lui avouer qu'ils était un criminel recherché. C'est le départ de sa mère qui provoque cette révélation et elle cherche à comprendre ce père qui campe toujours sur les certitudes de l’idéologie nazie. Il y a une sorte de complicité du silence entre elle et ce vieil homme qui finit par s'intéresser aux subtilités de la kabbale, aux mystères de l'alphabet et de la grammaire hébraïque et même y puiser les raisons de l'échec d'Hitler. Pourtant il est fier de ce qu'il a fait, redoute un éventuel procès et sa sentence et n'entend même pas se justifier en se cachant derrière les ordres reçus, sa seule faute ayant été la défaite de l'Allemagne. Dans son attitude il y a une sorte de défi. Il craint d'être pris puisqu'il est inscrit sur la liste des criminels recherchés, mais il quitte l'Amérique du Sud où il s'était réfugié, rejoint sa ville de Vienne et accepte pendant de nombreuses années un poste de facteur qui, dans sa tournée, a de centre Simon Wiesenthal ! Pourtant la compréhension de sa fille ne va pas jusqu'à porter le vrai nom de son père et elle se fait même stérilisée pour ne pas avoir d'enfant et ainsi ne pas transmettre les gènes de son père.
Ce récit évoque la rencontre avec le narrateur dans cette auberge des Dolomites et le vieil homme se croit découvert à cause des caractères yiddish des documents que le narrateur est en train de traduire à la table voisine. Pire peut-être, le côté paranoïaque qu'il a développé pendant toutes ces années de cavale reprend le dessus et il voit là un avertissement prélude à son arrestation puis à son exécution alors que, pour sa fille, l'image du narrateur lui évoque un agréable souvenir d'enfance. Ce quiproquo le délivre de la vie en même temps que sa fille est sauvée in-extremis dans l'accident de leur voiture, libérant cette dernière du contrat tacite qui la liait à son père.
Ce sont donc deux récits croisés offerts au lecteur avec une écriture simple, dépouillée et fluide, une évocation de l'angoisse de devoir, toute sa vie, supporter un mensonge pour la jeune femme et pour le vieil homme la certitude aveugle non seulement d'avoir fait son devoir en obéissant aux ordres mais, ce faisant, d'avoir bien agi.
©Hervé GAUTIER – Juillet 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
DEMAIN
- Par ervian
- Le 23/07/2014
- Dans Guillaume MUSSO
- 0 commentaire
N°766 – Juillet 2014.
DEMAIN – Guillaume Musso- XO Éditions.
Par hasard, à la période de Noël, Matthew achète d'occasion un ordinateur qui a appartenu à Emma et qui bizarrement contient encore ses références informatiques. Par cet intermédiaire ils correspondent mais ils ne se rencontrent pas au rendez-vous qu'ils se donnent. Même les courriels que Matthew lui envoie de son smartphone ne lui parviennent pas. Évidemment, elle vit en décembre 2010 et lui en décembre 2011, soit un décalage d’exactement une année... et elle est morte !
C'est que Matthew, jeune et séduisant professeur à Boston a, un an plus tôt , dans un banal accident de la circulation perdu la femme de sa vie qu'il adorait, Kate, et se remet difficilement de cette disparition. Il élève seul et comme il peut sa fille de quatre ans Emily. Avec cette histoire d'ordinateur et la certitude qu'Emma, une sommelière d'un grand restaurant new-yorkais, et lui sont « égarés dans les couloirs du temps », Matthew conçoit cette idée un peu folle de demander à cette jeune femme d'éviter l'accident qui a coûté la vie à Kate. En réalité il va lui envoyer des messages du futur. C'est ainsi une manière de réaliser un fantasme humain, celui de remonter le temps et ainsi de corriger ses propres erreurs et celles de la vie ! Pour cela il lui propose de l'argent en lui communiquant par exemple les numéros gagnants de la loterie puisqu'ils vivent tous les deux dans espaces temporels différents... Mais ce qu'elle veut, après de longues errances amoureuses, c'est un mari, une famille, c’est à dire quelque chose qui ne s'achète pas. Elle a évidemment la possibilité d'éviter la mort de Kate mais ne le fera pas puisqu'elle tombe amoureuse de Matthew et voit en lui la solution à tous ses problèmes. Mieux, elle ne répétera pas la énième tentative de suicide qui lui fut fatale et donc vivra avec lui. Sauf que, pour décider Emma, Matthew enlève son chien, son seul compagnon et menace de le tuer, la vie de l'animal contre celle de Kate en quelque sorte ! Mais bien sûr rien ne se passe comme prévu avec son lot de révélations, de remises en cause des certitudes qu'on croyait définitives, de trahisons, de mensonges et pourquoi pas de doute sur la paternité d'Emily... Le mystère s'épaissit autour de Kate qui ne correspond pas vraiment à l’image de l'épouse-modèle qu'elle veut donner d'elle-même et c'est à peine si on est étonné de se retrouver dans une sorte de roman policier avec piratage informatique, écoutes téléphoniques sauvages, filatures, transmissions de données par ordinateur ou par téléphone portable, à moins que ce ne soit une histoire crapuleuse avec versements de fonds, de sommes faramineuses en dollars, d'un assassinat programmé méthodiquement au terme d'un plan perfide exécuté par un tueur à gages ou simplement une histoire d'amour qui, comme toujours, se termine mal.
Dans ce roman digne d'une œuvre de science-fiction, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à suivre et à passer d'un personnage à l'autre puisqu'il y avait entre eux un décalage d'une année et que Musso a décidément beaucoup d’imagination. Je retiens surtout l'idée de solitude, de mal-être que cet homme et cette femme partagent chacun dans leur coin. Mais ce sont deux solitudes amoureuses, celle d'Emma qui lui colle à la peau et dont elle voudrait se défaire ; malgré une errance sentimentale de plusieurs années, elle retombe dans les bras de son ancien amant inconstant et manipulateur et cette situation aura raison d'elle. Matthew avait quitté sa première femme pour épouser Kate qu'il ne parvient pas à oublier depuis son décès. Son ombre plane encore sur lui malgré et il vit mal son veuvage, malgré son travail et sa fille. Cette situation surréaliste, dont on peut cependant imaginer une version plus ordinaire, va occasionner des révélations où l'incompréhension le disputent à l'irrationnel. Elle va accentuer cette solitude et même y ajouter de la révolte d'autant plus forte qu'une explication entre eux est désormais impossible. En choisissant Kate, Matthew avait non seulement privilégié l'amour mais aussi la stabilité d'une famille et la sérénité de la vie commune et n'imaginait pas que cela puisse être remis en cause. Il lui faisait tout simplement confiance et ce qui est évoqué ici c'est un problème humain, bien ordinaire et même banal mais qui caractérise notre condition, cette volonté de tout remettre en question pour un peu de plaisir furtif ou simplement pour le frisson de braver l'interdit, pour se dire qu'on ose et qu'on en a bien le droit, qu'on est libre et qu'on appartient à personne, même si, à l'occasion de cette comédie on joue simplement avec la vie des siens. On se dit qu'on ne sera pas pris et on s'enfonce de plus en plus dans l'hypocrisie et le mensonge... C'est bien normal après tout de faire rimer amour avec toujours et on se dit que, pour une femme le mariage, la maternité, la responsabilité d'un foyer ne peuvent que générer la robustesse du couple, que l'instabilité c'est pour les autres et que rien ne peut arriver. Las, il n'en est rien et en réalité tout cela a la résistance d'un château de cartes édifié dans un courant d'air mais ici le scénario se complique un peu avec un grand amour avec un autre homme, une maladie mortelle, un désir fou d'inverser le cours des choses et le projet machiavélique de tuer son mari pour sauver son amant. On prend soudain conscience « que rien n'est acquis à l'homme » comme le dit Aragon et que les faiblesses, les bassesses, les trahisons existent, qu'elles vont à l'encontre des sentiments les plus définitifs, que finalement les masques finissent par tomber. La solitude de Matthew a cette dimension mais elle a aussi celle de la révélation et de la désillusion. C'est sans doute un paradoxe que de vouloir à tout prix passer sa vie avec quelqu'un qu'on aime et dont on croit être aimé et donc de lui faire une confiance aveugle, c'est à dire faire échec à la solitude alors qu'au bout du compte c'est bien elle qui représente la tranquillité d'esprit, la meilleure solution si on ne veut pas être trahi ! Ce roman est , malgré ce contexte un peu farfelu, une étude de caractères qui m'a bien plu.
J'ai déjà dit dans cette chronique que Musso ne retenait pas vraiment mon attention (La Feuille Volante n° 760 à propos de « Central Park » et n°764 de« La fille de papier »)bien que ses romans se lisent facilement comme c'est aussi le cas ici. Est-ce le thème de temps et possibilité de le remonter et ainsi d'abolir les effets du hasard ou de nos propres erreurs, mais je dois dire que, même si c'est complètement invraisemblable, même si comme toujours Musso ne peut s'empêcher d'en rajouter au point d'agacer un peu son lecteur (quand il a trouvé une bonne idée, il la travaille au maximum et ne manque pas d'exploiter tout ce que l'humain a de détestable, entre mensonge, trahison et confiance abusée quitte à s'égarer dans des digressions un peu longues), j'ai été séduit par cette idée et je suis entré dans son jeu, lisant passionnément pour connaître la fin. Mais quand même, je dois dire que j'ai été un peu surpris à la lecture du dernier chapitre. On sort à ce moment là de la longue fiction qui a duré plus de quatre cents pages et dont on se demande si elle a réellement eu lieu, pour retourner aux premiers chapitres de ce roman, on ferme en quelque sorte une parenthèse pour retrouver Emma, son vieil ordinateur et sa rencontre avec Matthew qui se déroule apparemment sous les meilleurs auspices. Est-ce pour elle le commencement d'une nouvelle vie, le début d'un grand amour si longtemps recherché et dont l'histoire si particulière de Matthew nous a donné à penser qu'il était impossible ? Est-ce pour Matthew la fin de son deuil, le début de quelque chose de différent qui donnera peut-être une mère à la petite Emily, une page qui se tourne avec la volonté farouche d'oublier son expérience désastreuse avec Kate, une volonté de faire prévaloir la vie et l'espoir en prenant à nouveau le risque d'être déçu, avec un « happy-end » que semble beaucoup affectionner Musso et qui a ce côté artificiel qu'on ne retrouve que très rarement dans la vraie vie ? Pourquoi pas ?
©Hervé GAUTIER – Juillet 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
QUATRE MURS
- Par ervian
- Le 21/07/2014
- Dans Kéthévane Davrichewy
- 0 commentaire
N°765 – Juillet 2014.
QUATRE MURS – Kéthévane Davrichewy – Sabine Wespieser Éditeur.
La maison de leur enfance à Somanges vient d'être vendue et les quatre enfants de « la mère », Saul, Hélène, Élias et Réna, les jumeaux, y reviennent une ultime fois, sans leur conjoint ni leurs enfants. Mais un déménagement n'est pas seulement un simple changement de place, un simple transport de meubles, on laisse toujours un peu de soi, de ses souvenirs dans une maison qu'on a habitée. Vendre une maison de famille c'est un déchirement. En outre, le père est mort quelques années plus tôt, la mère ne peut supporter la solitude dans ces lieux et aucun de ses enfants ne peut venir habiter avec elle. Elle finit par aborder le toujours épineux problème du produit de la vente mais qu'il y a-t-il de pus normal qu'une mère souhaite aider ses enfants qui en ont le plus besoin et c'est justement la cas des jumeaux. Cela ne pose pas de problèmes pour Saul et Hélène qui n'ont besoin de rien. Pourtant ce n'est pas une question d'argent qui va secouer cette famille. En effet sa belle cohésion se lézarde très vite peut-être parce que l'histoire de chacun de ses membres est finalement différente derrière la façade affichée. Deux ans après cette vente, chacun se retrouve dans l'île de Saul et veulent jouer cette comédie de la famille réunie ; c'est à la fois hypocrite et ridicule.
Saul, c'est l'aîné mais aussi l'intello de la famille, celui qui a réussi, jadis directeur de journal et maintenant ébéniste dans une île grecque, une sorte d'hommage à ce père, simple ouvrier horloger, homme aussi renfermé que son épouse était expansive. Et puis il y a eut cet accident qui a laissé Réna handicapée, la mort aussi, celle du père et d'un cousin, et la réaction de chacun face à elle. Tout le poids de ce passé, cette culpabilisation peut-être de celui qui a réussi par rapport aux autres, qui n'a eu que de la chance dans sa vie suscitent une thérapie parce qu'il ne peut plus parler à personne. Hélène est une parfumeuse célèbre, célibataire et solitaire. Elle non plus ne parle plus à personne, quant aux jumeaux leurs souvenirs communs sont entachés de non-dits mais aussi de difficultés relatifs à la gémellité. Ce voyage dans l'île des Cyclades, lieu de substitution à Somanges et qui pourrait bien devenir leur nouveau point de ralliement, est pour chacun d'eux l'occasion de revivre leur passé intime, d'évoquer parfois douloureusement leurs relations plus ou moins incestueuses ou de parentèle, leurs secrets qui parfois provoquent des révélations. Il y a aussi ces relations conflictuelles autour de l'accident qui a failli coûter la vie à Réna mais l'a laissée handicapée. Quatre enfants, quatre vies face aux quatre murs de cette maison qui désormais va appartenir à d'autres, une page qui se tourne...
Cette évocation du passé est servie par une écriture fluide et un texte dense.
Un variante sur le thème de « famille je vous hais », les liens forts qui avec le temps et la vie s'effritent inexorablement, les choses qui changent, l'innocence de l'enfance qui laisse place à la désillusion, l'histoire de bien des familles qui souvent veulent masquer la réalité par l'hypocrisie et la comédie, une mise en perspective assez réussie de situations que nous avons tous connues. Quand même j'ai été un peu déçu, je m'attendais à autre chose.
©Hervé GAUTIER – Juillet 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA FILLE DE PAPIER
- Par ervian
- Le 19/07/2014
- Dans Guillaume MUSSO
- 0 commentaire
N°764 – Juillet 2014.
LA FILLE DE PAPIER – Guillaume Musso – XO Éditions.
Au départ, une rupture amoureuse entre un écrivain à succès, Tom Boyd et une pianiste célèbre Aurore Valancourt. Si cette dernière se console rapidement entre les bras d'un musicien, Tom peine à s'en remettre et bascule facilement dans l'alcool, la drogue, les anxiolytiques. Sa saga «La trilogie des anges » n'aura jamais de suite ! Calfeutré chez lui à Los Angeles pendant plusieurs mois, incapable d'écrire la moindre phrase et confronté durablement au syndrome de « la page blanche », il reçoit la visite de Milo Lombardo, son ami mais aussi son agent qui lui rappelle que les deux premiers tomes se vendent bien et qu'on pense même à en faire un film. Il faut donc qu'il s'attelle aux troisième tome d'autant que ses lecteurs n’attendent que cela. Pourtant, il est bel et bien incapable d'écrire et qui plus est complètement ruiné. Est-ce à cause de l'abus d'antidépresseurs, il voit arriver chez lui une femme complètement nue, Billie Donnely, qui n’est autre qu'un personnage secondaire de ses romans « qui enchaîne des histoires d’amour foireuses ». Il pense à une mauvaise blague mais c'est bien elle, « tombée d'un livre » et le doute n'est plus permis. Elle s'installe dans son quotidien au point de le sauver de l'internement et lui propose de retrouver Aurore ; elle veut bien sortir de sa vie à condition qu'il lui fasse rejoindre le monde de la fiction, avec accessoirement une vie moins minable, c'est à dire qu'il accepte de donner une suite à la saga et donc d'en reprendre l'écriture. Il s'ensuit une succession d'aventures échevelées, pas vraiment convaincantes et même plutôt empreintes de longueurs fastidieuses et même un peu forcées, telle la quête de ce livre devenu unique à cause du pilonnage de la dernière édition due à une erreur d’impression. On voudrait même nous faire croire que le rachat de cet unique exemplaire correspondrait au sauvetage de Billie, ce qui la ferait retourner dans son monde fictif alors que l'amour que lui porte Tom devrait au contraire s'y opposer. Je ne suis qu'un simple lecteur, pas vraiment spécialiste de Musso, mais j'ai été carrément agacé par cette succession de mésaventures dont je me suis demandé si elles auraient une fin. C'est à peine si j'ai eu envie de connaître l'épilogue !
C'est vrai que l'idée n'était pas mauvaise et que la création n'est jamais très loin de la folie, Maupassant, Hemingway ou Nerval en sont l'illustration, et si l’art existe parce que le réel est insuffisant, la mort volontaire finit par s'imposer à l'artiste.
Personnellement, en tant qu'auteur, j'ai toujours été intéressé par les relations qui peuvent exister entre entre un romancier et ses personnages. Ils sont fictifs certes mais ils vivent d'une vie propre, possèdent leur liberté et en profitent parfois au grand étonnement de leur créateur lui-même puisque la fin du roman est parfois bien différente de l'intrigue qu'il avait imaginée au départ. Alors, force de l’imagination, talent et même génie ou simple effet de la liberté des personnages ? Je ne le saurais jamais. Le thème pourtant avait tout pour me plaire et bâtir un roman sur cette idée de rencontre d' un auteur avec son personnage me semblait au départ intéressant, mais filer la métaphore au point de rendre Billie malade et de lui faire vomir de l'encre, de prétendre que son sang contient de la cellulose et que ses cheveux blanchissent à cause d'agents chimiques présents dans la papier, là je pense que Musso en fait un peu trop, d'autant d'ailleurs que tout cela se révèle être un canular. Je dois avoir de la fiction une idée assez restrictive mais s'il peut y avoir une dimension merveilleuse, extraordinaire voire idyllique dans les romans, cela n’autorise pas pour autant l’invraisemblance d'autant que, dans la vraie vie dont ils sont souvent le reflet, tout cela est bien différent, mais c'est là un autre débat.
Quant à cet artifice, sorte de mise en abyme, qui consiste à parler d'un roman impossible à écrire par l'auteur lui-même alors qu'il finit par conclure à sa réalisation sous les yeux mêmes de son lecteur, je trouve cela un peu artificiel. C'est sans doute plus fort que moi mais, en lisant ce roman, j'ai songé à de la littérature alimentaire, de celle dont on se sert pour durer dans le domaine culturel parce que c'est un métier lucratif mais qu'il faut entretenir par une production, fût-elle médiocre, parce que la notoriété est une chose fragile...
J'aimais bien aussi l'idée développée ici que, plus que l'alcool, la drogue ou les médicaments, l'écriture est pour un auteur déprimé une véritable planche de salut et que c'est véritablement grâce à elle qu'il peut se reconstruire. Nous savons tous qu'elle est une alchimie, un mystère, alors, illustrer ce thème par un roman ne pouvait que retenir mon attention. Là je souscris un peu plus à la démarche de l'auteur.
Je lui sais gré aussi de noter dans ce roman toute l'importance qu'il accorde au lecteur (« Un livre ne prend corps que par la lecture. C'est le lecteur qui lui donne vie, en composant des images qui vont créer ce monde imaginaire dans lequel évoluent les personnages ») J'espère que ce n'est pas une simple clause de style mais j'apprécie qu'un auteur aussi médiatique que lui note cette évidence selon laquelle un romancier n'est rien sans ses lecteurs. J'ai eu déjà l'occasion dans cette chronique de fustiger les auteurs qui oublient ce truisme.
L'écriture est simple, sans recherche, un peu comme le style d'un vulgaire polar et se lit facilement. C'est là un avantage. Je continue à explorer l’œuvre de Musso parce que c'est un auteur médiatique dont on ne peut valablement parler sans l'avoir lu, mais malgré ce deuxième livre (La Feuille Volante n°760 à propos de « Central Park »), l'intérêt n'est pas vraiment au rendez-vous. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose une nouvelle fois ?
©Hervé GAUTIER – Juillet 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
SI C'EST UN HOMME
- Par ervian
- Le 17/07/2014
- Dans Primo Levi
- 0 commentaire
N°763 – Juillet 2014.
SI C'EST UN HOMME – Primo Levi – Robert LAFFONT.
Traduit de l'italien par Martine Schruoffeneger.
L'auteur, âgé alors de 24 ans, a été arrêté en 1943 en Italie alors qu'il commençait sans grande expérience, à résister au nazisme. Déporté à Auschwitz en février 1944 et y demeurera jusqu'en janvier 1945, libéré par les troupes soviétiques. Par ce récit autobiographique, il témoigne de la vie dans ce camp d'extermination puisque, grâce à la chance, à sa formation de chimiste et peut-être aussi parce que la pénurie de main-d’œuvre se faisant sentir, l'administration allemande ayant décidé d'allonger la durée de vie des prisonniers, il réussit à échapper à la mort. En 1945, il sera chargé avec un autre déporté de fournir un rapport sur le fonctionnement des camps. Ce travail ainsi que les notes qu'il avait prises lui ont permis de rédiger ce récit qui, paru en 1947 passa complètement inaperçu. Il fallu attendre 1963 et la parution de son second livre « La Trêve » pour que « Si c'est un homme » soit enfin considéré comme un chef-d’œuvre. Cette édition est complétée et enrichie par des précisions que l'auteur a apportées à l'occasion des questions qui lui ont été posées lors des conférences qui ont suivi la parution de ce livre.
Il décrit l'arrestation, l'interminable voyage en wagon à bestiaux, l'incertitude sur la destination et sur leur avenir. D'emblée, dès l'arrivée au camp, il prend conscience que lui et ses compagnons d'infortune sont promis à la mort malgré les mises en scène des Allemands qui tendent à leur faire croire le contraire. Il y a la séparation d'avec les proches, les interdictions, les humiliations, les coups, l'abandon du nom au profit d'un numéro tatoué sur le bras, seule preuve crédible de ces épreuves, la faim, la soif, la douleur que les mots ont du mal à exprimer, les appels interminables dans le froid, le travail harassant et destructeur, la perte de toute dignité humaine qui n'ont d'autre but que « la démolition d’un homme ». Il évoque le désespoir et la résignation face à la mort quand, la procédure de « sélection » sur l'avis sommaire d'un SS, vous précipite à la chambre à gaz ou à l'exécution publique. Il décrit les « kapos », des prisonniers comme eux mais souvent des « droits communs » sélectionnés pour leur violence, maintenus dans un état de subordinations par les SS et chargés de la surveillance, il évoque le marché parallèle, de petits trafics, la débrouille dont chacun fait preuve pour rester en vie parce que le seul but pour tous ici est de survivre avec cette étonnante faculté d'adaptation aux circonstances les plus défavorables ! Être ravalé au rang de bêtes, d'esclaves, et devoir agir servilement parce que, grâce à cette servilité apparente on peut gagner encore quelque jours de vie mais conserver quand même la dignité de refuser son consentement à cette condition, c'est simplement refuser de commencer à mourir. Dans cet univers l'instinct de survie efface bien souvent l’élémentaire humanité et la peur, la haine, la méfiance de l'autre créent un équilibre surréaliste. Face à cela il y a des moments de fugace complicité, de compréhension, de solidarité entre détenus, des instants de liberté grappillés, dans les latrines où à l'infirmerie, à cause de la phobies des Allemands pour les maladies et les microbes. Primo Levi cite ce Lorenzo qui par sa seule présence lui a permis de rester en vie. L'auteur émaille son récit de citations de Dante, plus exactement de l'Enfer analogue à celui dans lequel Primo Levi s'enfonce de jour en jour dans ce camp. Ce microcosme concentrationnaire est un véritable laboratoire d'étude de l'espèce humaine et c'est sans doute en référence à la « Divine Comédie » que l'auteur classe cette société entre « les élus » et des « damnés », ceux qui survivront et ceux qui attireront sur eux la mort.
L'auteur a survécu à la dure vie du camp, aux mauvais traitements, à la « sélection » parfois aléatoire, aux pendaisons pour l'exemple qui précipitaient dans la mort et dans la cheminée de Birkenhau, aux bombardements alliés. Sur 96 Italiens du convoi initial, ils ne sont plus que 21 encore en vie à l'hiver 1944. Il a fait prévaloir l'instinct de survie, a eu la chance d'être affecté à une usine de fabrication de caoutchouc synthétique puis à l'infirmerie, mais il est brisé ! Il a pu aussi constater que la souffrance et la mort provoquaient de la part d'autres prisonniers des gestes indignes d'un homme.
Dès l'exergue, Primo Levi publie un de ses poèmes qui donne son titre à ce livre parce qu'il l'a écrit pour faire échec à l'oubli des hommes [« N'oubliez pas que cela fut non, ne l'oubliez pas : graver ces mots dans votre cœur »]. C'est bien en effet l'oubli qui caractérise la condition humaine qui est combattu ici. L'entretien de la mémoire collective peut paraître ringard mais le souvenir de la barbarie dont les hommes sont capables contre les autres hommes au seul motif qu'ils ne pensent pas ou qu'ils ne sont pas comme eux est aussi important que celui de ceux qui se sont battus et qui sont morts pour que nous soyons libres. Ce que je retiens aussi c'est que Primo Levi porte son témoignage, et non pas son jugement, sans haine contre les Allemands alors que ces derniers se sont déchaînés contre les juifs. Il redonne ainsi aux mots leur véritable force et les charge de conserver le souvenir de ce qui ne doit jamais plus se reproduire. Malgré lui pourtant, l'histoire se répète, bégaie...
En lisant ce récit, je n'ai pas eu l'intuition de la moindre « démoralisation intime » d'être encore en vie face à tous ces morts. Autant le dire tout de suite, cette culpabilisation judéo-chrétienne m'a toujours ulcéré. Elle a été instillée dès notre enfance et dans notre éducation par une instruction religieuse distillée à l'envi par des gens dogmatiques. Ce message, dont on se demande à quoi il sert réellement, n'a d'autre effet sur l'esprit de l'enfant qui le reçoit et sur l'adulte qui en est imprégné que de générer un mal de vivre inutile, bien différent du véritable message de l’Évangile.
C'est un livre bouleversant, un témoignage à l'époque inédit. Certes aujourd'hui ces faits nous sont connus, sont incontestables sauf pour une frange d'individus dangereusement dogmatiques mais il reste un texte, un élément du souvenir, comme un jalon dans la triste histoire de l'humanité qui se décline bien plus souvent en violences meurtrières qu'en manifestations humanitaires .
©Hervé GAUTIER – Juillet 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
INCONNU A CETTE ADRESSE
- Par ervian
- Le 14/07/2014
- Dans Katrine Kressmann Taylor
- 0 commentaire
N°762 – Juillet 2014.
INCONNU A CETTE ADRESSE – Katrine Kressmann Taylor – Éditions Autrement.
Traduit de l'américain par Michèle Lévy-Bram
Le titre ressemble à la mention qu'on peut lire sur une enveloppe qui n'a pas atteint son destinataire. Il ne s'agit en effet pas d'un roman au sens traditionnel du terme comme on peut le lire sur la couverture mais d'une succession de lettres, correspondance fictive échangée entre deux hommes, Martin Schulse, un Allemand et Max Eisenstein, un juif américain, propriétaires d'une galerie de tableaux à San Francisco. Ils sont liés par des liens amicaux, presque fraternels. Nous sommes en 1932 et Schulse décide de retourner à Munich pour y élever ses enfants laissant Max dans une solitude affligeante. Là commence cet échange de lettres qui fait allusion à la liquidation de leur société et la nouvelle vie de Martin. La République de Weimar vient d'expirer et le nazisme est en marche. Au départ, Martin se définit comme un libéral, favorable à la paix. D'amicaux au début, le termes de ces missives vont devenir enflammés de la part de Martin qui rapidement fait siennes les thèses du national-socialisme au point que cette amitié du départ se mue en haine viscérale, intense, destructrice. Bien entendu Martin devient antisémite, ce qui, dans le cadre de ce livre est révélateur et il renie l'amitié qui jadis le liait à Max.
C'est, certes l'illustration d'une manipulation des gens, un lavage de cerveau à grande échelle, l'endoctrinement des Allemands mais aussi des peuples conquis ce qui donne à penser que les thèses développées par ce régime sont sans doute latentes chez chacun d'entre nous et n'attendent pour se manifester et se développer que ce genre d'occasion. Les masses populaires sont dans l'attente d'un chef et si celui-ci manœuvre habillement, si les circonstances lui sont favorables ou le contexte politique et économique difficile comme s'était le cas dans l'entre-deux guerres tout devient possible et l'instinct grégaire fait le reste. Dans l'esprit de Martin, Hitler est un sauveur et il faut lui faire confiance, le suivre aveuglément.
J'ai lu passionnément ce livre non parce qu'il est une énième évocation (prémonitoire) du nazisme et de son action dévastatrice sur le monde mais surtout parce qu'il est l'illustration de la fragilité des relations qui existent entre les êtres humains. On les dit indestructibles et les serments ne manquent pas pour proclamer leur pérennité, leur indestructible solidité puis le hasard, la marche des choses, l'évolution des idées quand ce n'est pas simplement les intérêts gomment simplement tout cela. C'est une façon de rappeler que l’oubli, la trahison, l'opportunisme font partie de l'espèce humaine, la caractérise au même titre que l'humanité, la culture, la tolérance et autres qualités dont on se plaît à la parer et dont je suis de plus en plus sûr qu'elles ne peuvent s'appliquer qu'à un nombre infime d'individus et non au plus grand nombre.
C'est un texte bref(une vingtaine de lettres) mais d'une extrême intensité, une sorte de miroir qui nous renvoie une image de nous-mêmes sans complaisance à travers une fiction historique originale. C'est un texte très actuel.
L'auteure, écrivain américaine d'origine allemande (1903-1996) est principalement connue pour cette nouvelle écrite en 1938 et publiée sous le pseudonyme masculin de Kressmann Taylor en 1939, donnant à penser qu'un tel écrit ne pouvait émaner que d'un homme ! Interdite en Allemagne, elle fait l'objet d'une adaptation cinématographique en 1944. Rééditée en 1995 pour le 50° anniversaire de la libération des camps de concentration, cette nouvelle a été traduite en 20 langues.
©Hervé GAUTIER – Juillet 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA PISTE DE SABLE
- Par ervian
- Le 14/07/2014
- Dans Andrea Camilleri
- 0 commentaire
N°761 – Juillet 2014.
LA PISTE DE SABLE – Andrea Camilleri – Fleuve noir.
Traduit de l'italien par Serge Quadruppani
Le commissaire Montalbano a la chance d'avoir une maison avec vue sur la mer. Pourtant, un matin, il aperçoit sur la plage le cadavre d'un cheval mort. Cela ne l'étonne cependant pas puisqu'il vient de faire un rêve en quelque sorte prémonitoire peuplé d'une femme et d'un cheval mais, le temps de prévenir ses collègues, la carcasse a disparu, ne laissant comme trace de sa présence qu'un seul fer que le commissaire met machinalement dans sa poche. Il apparaît que l'animal a été massacré à coup de barre de fer, ce qui rappelle un peu le film « Le parrain »... Nous sommes en effet en Sicile, terre d’élection de la Mafia, d'autant que, venue signaler la disparition de son alezan, la troublante Rachele Esterman, révèle qu'elle avait confié l'animal à l'écurie de Saverio lo Duca, un notable local, en vue d'une course hippique privée. Cela est pour le commissaire la source de difficultés potentielles puisque la piste des paris clandestins ne peut être négligée d'autant que l’organisateur de cette réunion n'est autre que Prestia, soupçonné d'être lié à l'organisation criminelle. La disparition de l'alezan fait d'ailleurs suite à une précédente, ce qui augure mal de l'avenir pour le commissaire. D'ailleurs, son appartement est une nouvelle fois visité par des cambrioleurs, mais ces derniers ne volent rien et même lui rendent la montre de son père dérobée la première fois, ce qui peut représenter un avertissement bien dans la façon de la pègre locale puisqu'il doit témoigner au procès d'un second couteau de l'organisation criminelle. Il y a même une tentative d'incendie de sa maison et des coups de fil anonymes. Le voilà donc confronté à une enquête autour de ce cheval mort et qu'il devra mener entre intimidations mafieuses et pressions d'une hiérarchie frileuse qu’il ne prise guère.
Je ne suis que très peu entré dans cette histoire à cause des personnages peut-être et spécialement des policiers un peu trop caricaturés, un Montalbano enfermé dans un rôle de séducteur un peu sur le retour, toujours plus ou moins suivi par son amie Ingrid. La traduction volontairement originale si on en croit l'avertissement du traducteur, ne m'a pas convaincu non plus.
J'ai une prédilection pour les romans par rapport à leur adaptation au cinéma ou à la télévision. Cette dernière m’avait donné à voir un Montalbano, certes un peu cantonné dans les caractéristiques du genre mais acceptable. Je ne l'ai pas retrouvé ici et je le regrette !
©Hervé GAUTIER – Juillet 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
Deux Romans de Suzanne Prou.
- Par ervian
- Le 11/07/2014
- Dans Suzanne Prou
- 0 commentaire
N°40 – Mars 1990.
Deux Romans de Suzanne Prou.
J'ai déjà dit qu’un livre n'a pas d'âge et que seule compte l'émotion qu'il procure au lecteur.
Au début du « Voyage aux Seychelles » (Calman-Lévy), la simple vision d'un tee-shirt bariolé dans un bureau de poste et c'est le début du voyage pour Pauline, cette retraitée solitaire. C'est aussi la révélation d’une femme qui se prend d'amitié pour une jeune fille, Denise, en fait sa protégée, s'occupe d'elle, de sa vie matérielle, culturelle voire sentimentale. En fait elle exorcise son égoïsme.
Puis, par la magie du départ, de l'absence durable, de l'oubli peut-être de la part de Denise, le lecteur, témoin privilégié de cette histoire assiste au dédoublement du personnage de Pauline qui se met à se recomposer pour elle seule, une Denise bien différente de la vraie, sans qu'il sache vraiment où commence la vérité et où s'arrête l'inconscience. Puis c'est à nouveau le drame de la solitude qui amène Pauline aux marches de la folie . La vie cependant reprend sa réalité, avec ses habitudes et si les fantasmes finissent par se dissiper, reste l'invitation au voyage à cause peut-être de la musique et du mystère des îles Seychelles. A partie d'un mot, Suzanne Prou a su entraîné son lecteur dans un autre univers, le sortir de son quotidien pour son plus grand plaisir.
Dans « Le Pré aux narcisses », (Calman-Lévy) c'est la Provence avec ses senteurs et ses paysages qui sert de cadre au roman. L'auteur y campe deux villages et deux personnages que tout sépare, avec entre eux une plaine aux couleurs de narcisses et une jeune fille qu'on y trouva un matin assassinée. Suzanne Prou renoue ici avec l'intrigue policière et mène son lecteur dans les arcanes de cette histoire où, à la fin, les choses reprennent leur vraie place.
©Hervé GAUTIER – Mars 1990 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LES AMIS DE MONSIEUR PAUL
- Par ervian
- Le 11/07/2014
- Dans Suzanne Prou
- 0 commentaire
N°39 – février 1990.
LES AMIS DE MONSIEUR PAUL- Suzanne Prou – Mercure de France.
Il est toujours hasardeux de faire des comparaisons, des classifications, des rapprochements … c'est pourtant un réflexe normal. Ici, à la seule force des mots, d'emblée, le décor est planté et les personnages de cet étrange drame s'y meuvent comme dans une sorte de brouillard, de lueur d'aquarium où rien n'est vraiment clair ni vraiment trouble.
L'écheveau de l'intrigue se déroulera normalement et naturellement les choses prendront leur vrai place, mais, au cours de ce voyage dans le mystère, le lecteur attentif et heureux invité dans l'univers de ce port aura été le témoin d'exception de cette histoire et aura apprécié les personnages abstrus et parfois équivoques autant qu'il aura goûté le style de l'auteur, tantôt discret, tantôt précis.
Suzanne Prou distille au cours de ce roman non seulement le flou d'une intrigue policière, mais aussi un ton, une couleur, une ambiance forgés à touches successives.
©Hervé GAUTIER – Février 1990 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
CENTRAL PARK
- Par ervian
- Le 11/07/2014
- Dans Guillaume MUSSO
- 0 commentaire
N°760 – Juillet 2014.
CENTRAL PARK – Guillaume MUSSO – XO EDITIONS.
Un matin un peu froid et sur un banc dans une forêt, un homme et une femme endormis. Jusque-là rien de bien extraordinaire, sauf qu'ils sont menottés, qu'Alice est un flic parisien qui a passé une soirée un peu folle avec ses copines aux Champs-Élysées et Gabriel, pianiste de jazz a joué la veille à Dublin. Ils ne se connaissent pas, ne se sont jamais vus et sont à Central Park près du romantique Bow Bridge à New-York ! Le seul point qu’ils ont en commun est celui d'avoir pas mal picolé de sorte que ni lui ni elle n'ont aucun souvenir de cette nuit. Tel est le point de départ de ce roman policier assez improbable et même carrément impossible. Suivent tout un tas d'aventures aussi échevelées que violentes au terme desquelles ils finissent par se débarrasser des menottes et se procurer un peu d'argent. Ce qui suit n'est pas moins surréaliste que le début avec de nombreux analepses qui distillent l'histoire de chacun, surtout celle un peu cahoteuse d' Alice dont la vie est marquée par la mort. Le lecteur est entraîné dans des histoires parallèles, dans des arcanes compliqués et marche évidement dans le jeu, d'autant que l’auteur tisse autour de cette femme des anecdotes qui rendent les événements crédibles même si parfois ils frôlent l'invraisemblable.
Guillaume Musso entretient le suspense, rajoutant à l'envi des détails qui entretiennent l’énigme même si au début le rythme s'essouffle un peu. Il y a une étude de cratères : Elle, autoritaire, orgueilleuse, dominatrice, violente parfois, lui, passif au début qui se rebiffe, agit, imagine, et installe Alice en plein mystère. En réalité il maîtrise parfaitement la situation et, avec un peu de chance, attire sa partenaire là où il souhaite la mener. Il y a aussi cette idylle qui naît entre eux, qui ne se révélera qu'à la fin, mais pas dans le contexte ordinaire d'un thriller.
Mais, est-ce vraiment un thriller ? Il n'est d'ailleurs pas vraiment présenté de cette manière sur la 4° de couverture. Certes l'action se déroule aux USA où la société est marquée par la violence, certes il y a une ambiance et un souffle policiers et c'est seulement à la fin que Musso assemble les nombreuses pièces du puzzle qu'il a savamment éparpillées pendant 380 pages. Le texte se lit facilement comme un polar et le style, sans véritable recherche, est coulant comme celui qu'on attend d'un roman policier. Il y a des meurtres certes mais ils sont surtout évoqués au passé et le seul sang qu'on voit n'est que de l'hémoglobine sur le chemisier d'Alice. Tout cela, toutes ces situations rocambolesques pour introduire un peu rapidement quand même ce qui n'a rien à voir avec une intrigue policière. Je veux bien qu'elle trouve dans ces quelques paragraphes de la fin une explication logique mais c'est quand même une façon inattendue d'aborder une maladie qui nous guette tous, contre laquelle actuellement la médecine n'a pas d'armes efficaces. Cela me semble un peu rapide, un peu facile et même un peu léger d'aborder ainsi une maladie aussi grave. L'effet recherché est évidemment atteint mais cela me paraît un peu artificiel d'expliquer un roman à ce point compliqué par une maladie qui frappe des gens de plus en plus jeunes.
Je l'ai déjà dit dans cette chronique, la fiction n'excuse pas tout. Les romans peuvent parfaitement embellir la vie, cela ne coûte rien et l'imaginaire peut constituer un refuge. Je ne sais pas pourquoi mais je suis de moins en mois friand des « happy-end ». Ici, cela me paraît un peu facile de conclure ce roman en mettant en balance ce mal inexorable et l'amour qu'Alice inspire malgré elle à Gabriel. Je ne sais pas pourquoi, cette fin ne me paraît pas crédible, peut-être parce que dans la vraie vie cela sonne faux, peut-être parce que je dois avoir une perception différente de celle des autres ?
Ce livre est le premier que je lis de Guillaume Musso, un peu parce qu'il est un auteur médiatique qu'il faut avoir lu pour pouvoir en parler, un peu à cause des souvenirs personnels que j'ai de Central Park et de New-york. Pourtant ce roman m'a un peu déçu à cause du contexte publicitaire nécessairement déformant malgré aussi cette envie d'en savoir davantage sur cet écrivain dont l'intérêt n'est pas forcément au rendez-vous.
©Hervé GAUTIER – Juillet 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
UN BEAU CAPTIF
- Par ervian
- Le 04/07/2014
- Dans Frédéric LENORMAND
- 0 commentaire
N°759 – Juillet 2014.
UN BEAU CAPTIF - Frédéric Lenormand – Fayard.
Nous sommes sous le Directoire et un jeune homme d'environ treize ans vient d'être découvert, errant dans la ville. Nicolas-Joseph Lecacheur, commissaire de police de son état, tente de faire respecter l'ordre public dans Châlons-sur-Marne dans ces temps qui succèdent à la Terreur que chacun veut oublier. Il vient d'arrêter ce vagabond qui pour lui est suspect d'avoir des origines aristocratiques. Ce serait même le dauphin pourtant officiellement mort trois ans auparavant. Il est vrai que cet épisode avait nourri pas mal de supputations sur une éventuelle survie de ce personnage et la disparition violente et mystérieuse de familles célèbres, surtout quand il s’agit d'enfants, on pense aux Romanov, a toujours nourri les fantasmes les plus fous. Chacun en effet y va de son témoignage pas toujours de première main où l'imagination le dispute à la volonté de s'accrocher à un éventuel miracle, entre subterfuge, opportunisme, crédulité, délation et intolérance , un vrai miroir de la condition humaine ! De plus, avons-nous affaire à un imposteur ou au réel descendant royal ?
Il le met donc en prison et la présence de ce jeune homme provoque une émotion dans cette petite ville. Notre fonctionnaire se heurte à titre personnel à Rosalie, son ex-épouse qui non seulement a obtenu le divorce grâce à une loi récente mais aussi exerce la fonction de concierge dans ladite prison. Elle a trouvé là un bon moyen de s'opposer au commissaire et s'occupe maternellement de ce nouveau « pensionnaire ». C'est vrai qu'à en croire Lecacheur, à l'époque on voyait des rois partout et cette folie collective qui s'est emparée de Châlons se manifeste jusque chez les commerçants qui font à ce jeune homme un crédit illimité sur sa bonne mine c'est à dire sur sa ressemblance supposée et donc sur sa parenté avec le défunt roi. Il faut dire que le jeune homme se prend au jeu et que sa cellule a désormais des allures d'hôtel particulier, ce qui indispose notre commissaire et risque de nuire à son avancement. Au bout de huit mois de ce qu'on peut appeler une galéjade, les choses sont revenues à leur vraie place avec sanctions, avertissements, retour à l'anonymat pour le faux-roi, désappointements pour ceux qui se sont laissés berner. Beaucoup de bruit pour rien finalement et, comme à chaque fois, l'oubli est venu recouvrir tout cela.
A travers des échanges épistolaires, des dénonciations, des extraits de journaux intimes, des rapports et des notes de service, l'auteur nous fait partager cette histoire un peu folle. J'ai eu l'habitude dans cette chronique de dire tout le bien que je pense de l’œuvre de Frédéric Lenormand. J'ai certes retrouvé avec plaisir son habituelle érudition [Je salue ici une nouvelle fois sa culture et son travail d'archiviste],mais je dois dire qu'ici, je me suis un peu forcé pour poursuivre ma lecture, en raison peut-être de l'intérêt que d'ordinaire je lui porte, mais je n'ai pas retrouvé le souffle et le style que me plaisent tant chez lui. D'autre part, le parti-pris de la présentation, nécessairement différente d'un roman traditionnel, me paraît peut-être justifier cette opinion. J'ai donc été un peu déçu mais quand même reconnaissant pour son travail d'écrivain.
©Hervé GAUTIER – Juillet 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
ROMAIN GARY
- Par ervian
- Le 04/07/2014
- Dans Dominique BONA
- 0 commentaire
N°18 – Novembre 1987.
ROMAIN GARY – Dominique BONA- Le Mercure de France.
J'ai été de ceux qui ont apprécié le remarquable ouvrage que Dominique Bona a consacré à Romain Gary. Cette universitaire qui est aussi romancière nous fait découvrir l'homme, le résistant, le combattant de la France Libre, le consul de France, mais surtout, à travers sa vie mouvementée, l'écrivain deux fois Prix Goncourt grâce à l'épisode d’Émile Ajard.
Malgré tout, celui qui se cacha derrière ce pseudonyme ne sort pas grandi de cette aventure où la pantalonnade le dispute à la mystification. Pourtant cet homme tourmenté, comme le sont la plupart des écrivains, et pour qui les femmes ont joué un rôle de guides, d’inspiratrices ou simplement d'objets de séduction, mit fin à ses jours en hiver 1980. Chercher une explications à un suicide est une chose vaine. Dire ce qu'un écrivain porte en lui est une nécessité et une impossibilité, surtout face à la mort. Ce paradoxe est peut-être contenu dans sa lettre d'adieu « Je me suis enfin exprimé entièrement ».
©Hervé GAUTIER – Novembre 1987 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
MEURTRE DANS LE BOUDOIR
- Par ervian
- Le 01/07/2014
- Dans Frédéric LENORMAND
- 0 commentaire
N°758 – Juillet 2014.
MEURTRE DANS LE BOUDOIR (Voltaire mène l'enquête) - Frédéric Lenormand – Éditions du Masque.
Nous sommes en 1733, sous Louis XV, et « Les lettres philosophiques » ou « Lettres anglaises » de Voltaire sont interdites en France alors qu'elles sont publiées en Angleterre où il avait été accueilli quelques années plus tôt. L'auteur fait de ce pays celui de la liberté et condamne implicitement les institutions françaises, ce qui en fait un ouvrage subversif que le philosophe aimerait bien répandre dans le royaume de France. Pourtant il est paradoxalement le premier à jurer qu'il n'est pour rien dans tout cela ! Il est donc en délicatesse avec la police et redoute plus que tout autre sans doute les lettres... de cachet et l'ombre de la Bastille qu'il connaît déjà ! C'est à ce moment qu'un meurtre est commis dans une maison de plaisir parisienne et le lieutenant de police Hérault va inciter Voltaire à découvrir le coupable ce qui est aussi une manière de le détourner de son projet littéraire.
Pour se concilier les bonnes grâces des autorités autant que pour satisfaire sa curiosité naturelle, notre philosophe se lance donc à la poursuite du criminel, cela tombe bien, si on peut dire, puisque l’assassin semble s'inspirer d'un roman libertin dont l'auteur reste inconnu et qu'on le charge aussi de découvrir. Cela ne peut laisser notre enquêteur indifférent d'autant qu'il y va aussi de son intérêt personnel. La victime, un riche bourgeois de province a été empoisonné mais le livre licencieux, qu'on pourrait aussi bien attribuer à Voltaire lui-même, reste introuvable ! Dans cette entreprise un peu hasardeuse quand même, il s'adjoint la complicité de sa maîtresse, la marquise Émilie du Châtelet mais aussi son secrétaire Michel Linant, un abbé un peu marginal qui cherche sa vocation d’écrivain mais qui est aussi un peu obsédé, et pas seulement par la religion ! Leur aide lui sera précieuse surtout pour le garder en vie, lui qui est, en permanence et si on l'écoute, au seuil de la mort.
Dans ce roman, Voltaire est toujours égal à lui-même, hypocondriaque, jaloux, avare, virevoltant, fantasque, facétieux, âpre au gain (pour cette fois, il est « déguisé » en marchand de grains)mais surtout très conscient de sa valeur. Avec l'abbé et surtout Émilie qui est une femme de son temps, mondaine, cultivée, éclairée et curieuse de tout, ils forment une équipe à la fois drôle et efficace. Voila donc notre philosophe contraint de fréquenter, les églises mais aussi maisons de passe, les librairies clandestines et même... les bureaux de la censure ! A son âge, 39 ans, c'est encore possible d'autant que cette enquête laborieuse requiert ton son zèle et... qu'il y risque sa vie ! Pourtant il ne perd jamais de vue la diffusion de ses « Lettres ». Cela donne une comédie policière mais aussi burlesque et un peu sulfureuse où rien ne se passe comme prévu mais qui, comme à chaque fois que je lis un roman de Lenormand m'a enchanté. Le contexte historique est rendu avec précision et la vie parisienne est évoquée au quotidien dans l'ambiance de ce XVIII° siècle d'avant la Révolution.
On peut s'étonner que Voltaire soit ainsi transformé en enquêteur. En réalité, cela correspond non seulement au personnage des Lumières, soucieux de la liberté, de la réforme d'une société vieillissante et la justice ( on se souvient de les affaires Calas, Sirven, Montbailli... ), mais aussi parce qu'il a laissé une correspondance qui permet de le suivre presque pas à pas. Le lecteur ne peut qu'en être enchanté, pris qu'il est dès la première ligne de ce texte dans les arcanes de cette enquête échevelée.
L'improbable lecteur de cette chronique ne peut ignorer l'intérêt que je porte aux œuvres de Lenormand, et ce depuis de nombreuses années, tant elles sont documentées et fort plaisamment écrites. Ce n'est donc pas maintenant que je vais changer d'avis d'autant qu'il ne se départit pas de ce sens de la formule que j'apprécie tout particulièrement et qui fait naître un sourire sur le visage des plus sérieux ! Voltaire lui-même n'eût sûrement pas renié le style léger et humoristique et pas non plus les réflexions qui lui sont attribuées.
Après « La baronne meurt à cinq heures »(La Feuille Volante n° 534) et « Le diable s'habille en Voltaire » (La Feuille Volante n° 755) l'auteur renoue avec les enquêtes de Voltaire. Après nous avoir régalé des aventures du juge Ti (cette chronique s'en est largement fait l'écho), c'est maintenant Voltaire, personnage non moins passionnant qui retient son attention et est l'objet de sa verve. C'est un régal !
©Hervé GAUTIER – Juillet 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
L'AMOUR BEATRICE
- Par ervian
- Le 27/06/2014
- Dans Jeanine BOISSARD
- 0 commentaire
N°82 – Octobre 1991.
L'AMOUR BEATRICE- Jeanine BOISSARD -FAYARD
Que, de nos jours, deux êtres inconnus l'un de l'autre se mettent à s'écrire est déjà en soi exceptionnel (recevoir une lettre reste pour moi un plaisir rare que téléphone, courriel et autres fax ne sauraient remplacer) Le ton impersonnel de la première missive laisse rapidement la place à la confidence, à la complicité à l'amitié, à la tendresse et à l'amour... C'est étrange comme les mots couchés sur le papier qui ne sont que de simples signes conventionnels se révèlent rapidement être des éléments de dialogue, de découverte, tant il est vrai qu'écrire à quelqu'un s'est un peu s’écrire à soi-même. Pire, les mots sont un miroir révélateur qui, malgré eux trahissent leur auteur et tout un passé renaît à travers eux surtout si celui-ci est le véritable enjeu inavoué de cette correspondance. Le piège se referme lentement faisant ressurgir ce passé qui, autant que l'avenir aide à vivre quand on veut en exorcisé les échecs.
Le vécu de Béatrice et de Jean était demeuré suspendu quelque vingt ans auparavant à une lettre (encore une) non reçue. Ce passé tout entier voué à l'amour avait été entravé par le calcul, la cupidité d'autrui et les choses avaient déroulé leur quotidien qui semblait immuable, définitivement figé dans la réussite sociale, le foyer, la famille. C'était compter sans le hasard qui, paraît-il fait bien les choses et qui permet à cet homme et à cette femme, trop longtemps séparés, de se retrouver, de prendre place l’un à côté de l’autre et d'inverser le cours des choses.
Pour une fois c'est l'amour qui gagne !
©Hervé GAUTIER – Octobre 1991 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
PASSIONS PARTAGEES
- Par ervian
- Le 22/06/2014
- Dans Félicien Marceau -
- 0 commentaire
PASSIONS PARTAGEES – Félicien MARCEAU – Gallimard.
Il est des livres qui n'ont pas besoin d'être récents pour être passionnants tant il est vrai qu'à cette époque de l'année on s’enthousiasme beaucoup pour des romans nouveaux et on les couronne même de prix prestigieux qui certes attirent le lecteur mais encore plus souvent le déçoivent.
Ici rien de tout cela. Avec les yeux d'un témoin, ami de la famille, l'auteur nous narre l’histoire des Saint-Damien, nobles de vieille souche du sud de la France qu'il sait nous rendre sympathiques avec force descriptions et saillies du meilleur aloi … C'est que l'humour est présent à chaque page quand il évoque ces personnages, Cédric avec son sens des réalités, ses fredaines et son évasion inattendue de son oflag pendant la guerre, Émeline son épouse, non moins attachante et émouvante, Marianca, la secrète qui se révèle aussi femme de tête...Et combien d'autres. Ils vivent des événements de leur vie avec un détachement qui n'a d'égal que l'étonnement qui est le leur face au quotidien. Les membres de cette famille dont l'existence est rythmée par la transhumance ver le château de la Mahourgue seront tour à tour résistants et passeurs vers l'Espagne pendant la 2° guerre mondiale...
Dans un style déchaîné, Félicien Marceau nous fait découvrir cet univers et c'est exactement le genre de livre dont la lecture peut permettre de lutter efficacement contre le climat délétère que nous vivons actuellement. Franchement, c'est un régal !
©Hervé GAUTIER – Décembre 1991 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
MARIME
- Par ervian
- Le 21/06/2014
- Dans Anne Wiazemsky.
- 0 commentaire
N°89 – décembre 1991.
MARIME – Anne Wiazemsky. - GALLIMARD.
Instinctivement, on s'attache à un lieu, une maison qui fait partie de son enfance, de ses amours...Pour Catherine, photographe, Marimé est le nom de cette grande bâtisse bretonne où se déroulaient ses jeunes étés. Elle menace ruine et voila qu'elle est à vendre, avec ses souvenirs, ceux de Manon la grand-mère morte il y a peu et qui hante encore les lieux...Catherine s'accroche à ces murs, à ces odeurs et en ce début d’automne elle s' y retrouve parce que par hasard avec Anne, une jeune comédienne et Florence la directrice de son agence. Anne et Catherine vivent une vie mal assurée, quelque peu vagabonde mais Florence représente à leurs yeux la certitude, la solidité, la permanence … et avec elle la menace qui pèse sur Marimé s'éloignent...
En fait Catherine et Florence font un retour vers l'enfance et se retrouvent telles qu'en elles-mêmes mais l'apparente solidité de cette dernière cache fragilité et faiblesse.
-
RIMBAUD LE FILS-
- Par ervian
- Le 21/06/2014
- Dans Pierre Michon
- 0 commentaire
N°89 – décembre 1991.
RIMBAUD LE FILS- Pierre Michon – Gallimard.
Enfin quelque chose de différent sur Rimbaud, quelqu'un qui ne pontifie pas sur sa poésie, son écriture nouvelle, sa vie aventureuse, en un mot tout ce dont on nous rebat les oreilles depuis un an. Non, Michon explique, avec une bonne dose de subjectivité, mais qu’importe, la naissance de Rimbaud, coincé entre son capitaine de père, absent de surcroît, et son étouffante mère, avec pour seul phare Izambard... mais un phare qui sera vite abandonné !
Et puis il y a le monde, son décor, ses fantasmes, les espoirs qu'il suscite... C'est donc une antibiothérapie de Rimbaud, une vie revue et recréee par l'imagination, à travers la mémoire collective et la faconde mêlée au délire. Rien à voir avec la biographie officielle d'ailleurs difficile à suivre. Ici, le portrait qui est brossé est le résultat d'images diverses et contradictoires où les charmes du portrait le disputent au velléités de l’autoportrait.
Michon dissèque et dénonce, rappelant qu'il n'y a ni grands hommes ni grands poètes en ce monde mais un ramassis d'idées reçues, de clichés, de certitudes faussement acquises ou savamment tissée et tenues dès lors pour établies. Tout le monde y passe, de Banville dont la personnalité ne vaut sans doute que parce qu'un certain Rimbaud lui écrivit un jour, à Verlaine, astre pâlissant de la poésie au regard du soleil que son ami portait en lui, en passant par Paul Demy qu'on ne connaît que parce que ce même Rimbaud lui écrivit une lettre où il était question de « voyant » … Et par-dessus tout cela il y a l'intuition d'être à la charnière de deux mondes, l’ancien et le nouveau et la certitude de n'appartenir ni à l'un ni à l'autre, d'être d'une autre époque et en même temps de vouloir être à l'image de ce Parnasse vers lequel il lorgne et de ce Harar qui fut sa perte. Un monde à la fois trop étroit pour lui et ses ambitions littéraires comme Charleville et trop grand comme ce désert africain où il eut « son or ». Un monde où les enthousiasmes et les les espoirs les plus fous ne résistent pas à l'usure du temps et aux désillusions, un monde qu'on aime, qu'on désire, qu'on conteste et qu'on finit par épouser !
-
LES PARISIENS
- Par ervian
- Le 20/06/2014
- Dans Michel SCHIFRES
- 0 commentaire
N°80 – Septembre 1991.
LES PARISIENS - Michel SCHIFRES- JC LATTES
J'ai lu ce livre plein d'humour et de bons mots avec les yeux d'un provincial qui met, grâce aux billets de congés-payés, les pieds à Paris tous les deux ou trois ans ( et dans le métro encore moins), qui a la chance d'y avoir un beau-frère qui met à sa disposition le canapé du salon, qui doit beaucoup au Monopoly pour la connaissance des quartiers de la capitale et qui n'en connaît que les principaux monuments( d'ailleurs inconnus des Parisiens). Autant dire que mon étonnement n'a eu d'égal que mon appétit de découvrir les mœurs et coutumes jusque là ignorées de moi...
J'ai rectifié beaucoup de mes idées reçues mais la province a pour moi des charmes discrets et même secrets et je n'envie guère les Parisiens-banlieusards à la mine défaite et à l'haleine fétide qui hantent le métropolitain et à qui, faute de mieux je ne manquerai pas de ressembler si d'aventure mon destin m'y conduisait. Quant à la Jet-Set et aux autres castes, je n'ai vraiment rien de commun avec... Certes, selon l'expression consacrée, cela peut passer pour de l'anti-parisianisme primaire et ce malgré l'arrivée du beaujolais nouveau, la proclamation du dernier Prix Goncourt, le tournoi de Roland Garros et toutes les manifestations culturelles parisiennes, malgré aussi le « députe-énarque-parachuté-en-province-pour-y-acquérir-une-stature-d'élu-local » (en fait pour faire sa carrière en attendant mieux), malgré aussi les vedettes du show-biz qui viennent périodiquement troubler notre tranquillité et éponger nos sous. Non décidément, je l'aime bien ma province !
C'est vrai que j'ai apprécié ce livre. Il tient autant du pavé dans la mare que du document de référence indispensable à l'usage des Rastignac de tout poil qui rêvent de conquérir la capitale (et les parisiens!) On y trouve tout un lexique explicatif du vocabulaire étrange qu'on emploie dans cette contrée, un guide de ce qu'il faut faire, ne pas faire, dire, ne pas dire, comprendre ou ne pas comprendre, tout en évitant de s'en tenir aux perceptions primaires. C'est que le vocabulaire qui va s'appauvrissant chez le commun des mortels est ici réduit à quelques mots dont il faut connaître le sens et qui précisément ne tombe pas sous le sens. Pire, les mots prennent une signification différente que celle que nous leur connaissons et les expressions ont besoin d'être décryptées en permanence, une sorte de traduction simultanée de français en français : ainsi n'est-t-on jamais sûr de comprendre ce qu'on croit avoir compris ! C'est du grand art et cela contribue largement à l'accroissement des difficultés de la langue. C'est vraiment plus subtil qu'avant quand on s'attachait à apprendre l'argot dès lors qu'on connaissait l'exact sens des mots, mais ici ces mêmes mots ont la même consonance (c'est même carrément les mêmes), mais, tel un texte ésotérique ils ont une signification cachée qui ne manquera pas d'échapper au non-initié. Encore faut-il ne pas omettre que dans cette acception cabalistique il y a une hiérarchie de nuances riche et pleine de délicatesse, quand on n'entrelarde pas ses phrases de mots anglais, ce qui ajoute à la difficulté et augure mal de ce qui nous attend avec « le grand marché ». Je ne parle pas de l'élasticité des mots et des néologismes. Où est donc passé notre brave instituteur du certificat d'études qui traquait les barbarismes et fustigeait les onomatopées ? Maintenant c’est carrément la récréation permanente de notre langue qu'on n'ose plus appeler maternelle. On m'avait dit que notre civilisation de communication souffrait d'icelle... Je ne m'en étonne plus.
J'ai bien ri, c'est vrai, tant les expressions sont cocasses et les images bien rendues. L'écrit a cela de supérieur la la télévision qu'on peut l'emporter partout et en reprendre à l'envi. Un peu Tartuffe l'auteur... Et après ? N'avoue-t-il pas lui-même que l'envie des Parisiens (et des Français) d'aller à la soupe n'a d'égal que celle de cracher dedans et que celui d'entre nous qui n'a jamais péché lui jette la première cuiller !
Ce livre est aussi un regard réaliste et parfois cruel porté sur cette société et sa manière de vivre. Il nous livre l'envers du décor. Pas si drôle ! Il s'agit là d'une manière d'état des lieux où l'art de la peinture le dispute à celui de la dissection car qu'il parle de la Jet Set, de la banlieue, des bistrots et de leur faune, il transparaît, malgré l'humour, un peu d'angoisse et un certain mal de vivre. C'est une réflexion sur l'ensemble de la société parisienne, sa condition, ses hésitations, ses pulsions, ses fantasmes ; Bref, toute une psychologie en raccourci.
C'est vrai que j'ai quand même bien ri. J'y ai retrouvé un peu de cet esprit français et comme de toute manière ce qui se fait à Paris finit par s'exporter en province, nous aurons au moins été avertis. Cela m'a rappelé « Les carnets du major Thompson », mais en plus drôle.
©Hervé GAUTIER – Septembre 1991 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
CRIMES ET CONDIMENTS
- Par ervian
- Le 19/06/2014
- Dans Frédéric LENORMAND
- 0 commentaire
N°757 – Juin 2014.
CRIMES ET CONDIMENTS (Voltaire mène l'enquête)-
Frédéric Lenormand – JC Lattès.
C'était quand même une drôle d'idée que de confier à Voltaire une enquête sur la disparition des boucles d'oreilles en diamant de la princesse de Lixen, même si cela vient de René Hérault, lieutenant général de police. Pourtant, Voltaire a bien autre chose à faire, tout occupé qu'il est à être le banquier des aristocrates, à se faire munitionnaire ou à traficoter en fraude des produits venus des Amériques. C'est que lui qui a déjà tâté de la Bastille et craint les lettres de cachet a quelque intérêt à être au mieux avec les autorités qui l'ont toujours à l’œil. D'autre part il brûle d'envie d'être élu à l'Académie Française même si la parution de ses « Lettres philosophiques » imprimées à Rouen et en Angleterre, ne plaident pas vraiment en faveur de cette distinction. Jusque là, il a été un candidat malheureux mais il ne s'avoue pas vaincu et fait une cour assidue à tous ceux qui seraient susceptibles d'appuyer sa candidature. Il finira quand même par être « Immortel » en 1746, mais le restera plus sûrement par ses écrits (et par ceux des auteurs qui le font revivre) que par son titre !
S'il parvient, avec d'ailleurs un peu de chance, à retrouver l'objet du délit, il n'en prend pas moins conscience qu'on en veut à sa vie pour éviter, à tout le moins le pense-t-il, qu'il siège quai Conti, encore n'est-il pas lui-même capable de déterminer si on veut l'éliminer à cause de son commerce illicite ou de ses écrits subversifs ! Pour autant, il est consolidé dans son analyse des choses quand il apprend officieusement qu'on vient de faire sortir de la Bastille un spadassin pour qu'il fît son office, à son détriment ! C'est que, dans son entourage immédiat, se multiplient les attentats et les cadavres qui, dans cette période de débordements culinaires (et pas seulement) prennent la forme de tartes au cyanure et autres mets frelatés: il se sent effectivement menacé ! Il faut dire que Voltaire lui-même est entouré d'un mystérieux cuisinier fort inventif mais un peu mystificateur et d'un abbé goulafre, bien dans le style de l'époque. Ainsi la véritable enquête qu'il mène est-elle celle de démasquer son futur assassin… avant qu'il ne passe à l'acte.
La guerre fait rage aux frontières et l'un de ses débiteurs, le duc de Richelieu, ancien camarade de lycée mais également académicien et donc soutien potentiel , s'est mis en tête d'aller se battre et ainsi de risquer sa vie pour le roi. Dans cette éventualité, la créance de Voltaire ne pouvait être que compromise ! Elle ne serait, pense-t-il, consolidée et assurée que par le mariage du duc, une union avec un grand nom de l’aristocratie même si le petit-neveu de l’illustre cardinal est surtout connu pour ses frasques de séducteur impénitent ! Voilà donc notre philosophe transformé en un marieur qui ne perd cependant pas de vue son intérêt personnel. Il jette son dévolu sur la jeune Marie-Elisabeth D'Harcourt-Lorraine qui, même si elle est beaucoup plus jeune que son prétendant, aura au moins l'avantage de favoriser les vues voltairiennes. Mais comme toujours les choses ne se passeront pas aussi bien que prévu !
Sous le couvert d'un titre quasiment emprunté à Dostoïevski, l’auteur nous promène dans ce Paris du XVIII° siècle à la fois populaire et aristocratique, dans les bas-fonds comme dans les salons. Comme toujours, j'ai apprécié le personnage de Voltaire qui, sous la plume de Lenormand nous est restitué avec vérité. Nous le voyons à nouveau ici, tour à tour avare, moribond, flagorneur, industrieux, facétieux, valétudinaire, opportuniste suivant les circonstances. Lenormand ne manque jamais de lui prêter des propos qu'il n'aurait sûrement pas reniés lui-même sur l'écriture, ses contemporains et surtout ses collègues écrivains (« Il faut écrire des livres qu'on aurait soi-même envie de lire, déclara-t-il. Je suis sûr que la plupart de nos amis n'ouvriraient pas les leurs si leur nom ne figurait pas sur la couverture », «La vraie modestie d'un écrivain, c’est la lucidité. Elle n'est pas très répandue car, s'ils acceptaient d'être lucides, la plupart cesseraient d'écrire », « Tout le monde aime le sucre, il est à la cuisine ce qu'est à la religion la promesse d'une vie éternelle : un mensonge agréable qui dissimule l'amertume du reste »). Ce roman est aussi plein d'enseignements, sur la nature humaine, notamment qu'il faut se méfier de tout le monde, en particulier de sa parentèle, sur la marche du monde, sur la structure de la société de ce Siècle des Lumières, sur la conduite des guerres et l'organisation militaire de l'époque...
Flanqué de sa maîtresse, la marquise du Châtelet, ce trublion génial ne peut laisser le lecteur indifférent. J'ai aussi apprécié les détails historiques de ce roman et bien entendu le style de l’auteur, toujours aussi impertinent, délié et humoristique. En revanche, l’aspect culinaire, même s'il est important à mes yeux, m'a, pour cette fois, paru un peu indigeste, tout comme d'ailleurs l'enquête policière qui, au fil des pages, s'estompe quelque peu même si elle laisse place aux facéties voltairiennes.
J'ai cependant souvent souri et même parfois ri de bon cœur à la lecture de ce roman;l'écriture de Lenormand a ce pouvoir. J'y ai retrouvé avec plaisir ce Voltaire que j'aime et c'est quand même là l'essentiel !
©Hervé GAUTIER – Juin 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LA GRANDE EMBROUILLE-
- Par ervian
- Le 09/06/2014
- Dans Eduardo Mendoza
- 0 commentaire
N°756 – Juin 2014.
LA GRANDE EMBROUILLE- Eduardo Mendoza – Le Seuil.
Traduit de l'espagnol par François Maspero.
Le narrateur n'est autre qu'un ancien détective privé, reconverti en coiffeur pour dames, mais aussi l'ancien compagnon de cellule du beau Romulo du temps où ils étaient ensemble pensionnaires d'un asile psychiatrique. Ce genre de cohabitation crée des liens et c’est sans doute pour cela que lorsque la belle-fille, surnommée « Bout-de-fromage », de son ancien compagnon vient le solliciter pour retrouver son beau-père disparu, il n'hésite pas, laisse tomber ciseaux et peignes et se met en devoir de rechercher cet ami qui n'est en fait qu'un petit malfrat sans la moindre envergure. Il le fait d'autant plus volontiers qu’on évoque alors un enlèvement et pourquoi pas un assassinat, ce qui ne serait pas impossible dans les bas-fonds de cette Barcelone frappée par la crise ! Et d'ailleurs ce n’est pas clientèle de sa petite entreprise qui monopolise beaucoup son énergie ; ce local devient donc son quartier général.
Dans cette quête improbable et puisque toute bonne investigation passe par une surveillance constante, notre ex-détective, passablement désargenté va faire appel à une équipe un peu hétéroclite, une statue vivante des Ramblas, une famille chinoise, une fillette spécialiste des serrures, une accordéonistes de rues, un livreurs de pizzas, un mendiant africain, une famille chinoise...bref une bande de pieds-nickelés dont les aventures se révèlent sans grand intérêt d'autant que la recherche du beau Romulo s'éternise un peu pour déboucher sur un centre de yoga et aussi, et c'est plus inattendu, sur un hypothétique complot terroriste qu'il convient de faire échouer visant à assassiner Angela Merkel, la chancelière allemande ! Je passe sur l'erreur sur la personne et tout le décor de l'attentat manqué et les allusions à la crise économique. Telle est la trame rocambolesque de ce polar picaresque, baroque, loufoque et plein de rebondissements mais qui ne m'a guère passionné. Je suis peut-être encore un fois passé à côté de quelque chose mais je n'ai que très modérément apprécié cette lecture.
Pourtant, même si j'ai parfois un peu apprécié le style de Mendoza (La Feuille Volante n° 750-756), j'ai eu du mal à entrer dans ce roman qui, quoique désopilant et échevelé m'a laissé un goût bizarre, quelque chose qui ressemble à de la déception qui reste quand j'ai refermé ce livre.
©Hervé GAUTIER – Juin 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
LE DIABLE S'HABILLE EN VOLTAIRE
- Par ervian
- Le 07/06/2014
- Dans Frédéric LENORMAND
- 0 commentaire
N°755 – Juin 2014.
LE DIABLE S'HABILLE EN VOLTAIRE- Frédéric Lenormand – JC Lattès.
Or, en ce rigoureux hiver parisien de 1733, Voltaire, éternel valétudinaire, vient de décider qu'il ne mourrait pas dans les prochains jours. Cela tombe plutôt bien puisque, dans le séminaire de St Nicolas du Chardonnet où officie le révérend père Pollet, « confesseur du cardinal qui gouverne le France », ce qui fait de lui un personnage influent, on vient d'assassiner un ecclésiastique. Jusque là rien extraordinaire si ce n'est que cela ne contribuera pas à la renommée de cet établissement où se presse la jeunesse de la bonne société désireuse d'être instruite des bonnes pratiques religieuses. Pourtant les indices laissés par le meurtrier donnent à penser qu'il ne peut s'agir que du diable en personne !Circonstance aggravante, la victimes avait dans ses mains un exemplaire de l'édition clandestine des « Lettres philosophiques d'Angleterre » dudit Voltaire. Le père Pollet, comme s'il ne faisait que très peu confiance aux autorités officielles, charge donc notre philosophe qui lui ne croit ni en Dieu ni au diable, d'enquêter discrètement sur ce qui n'est rien d'autre qu'une énigme policière. Cela tombe plutôt bien pour lui car, même s'il peut paraître paradoxale que l’Église le sollicite dans cette affaire, il trouve enfin un adversaire à sa mesure que son surcroît temporaire de vitalité va nourrir. C'est que notre philosophe du Siècle des Lumières exerce non seulement son génie créateur mais également son esprit critique dans une société fortement marquée par les jansénistes et les jésuites mais aussi par la superstition qu'il s'emploie à combattre de toutes ses forces. C'est que, dans ce Paris du XVIII° siècle se croisent encore des vampires, des démons et des morts-vivants, autant de croyances irrationnelles marquées du sceau de Belzébuth qu'il ne va pas manquer de pourfendre. Si Voltaire qui est aussi soucieux de la promotion de son œuvre malmenée par la censure, accepte cette enquête c'est aussi avec la promesse que ses « Lettres philosophiques » seront publiées sans encombre.Mais rien ne va se passer comme et prévu et même pour Voltaire tout n'est pas toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes !
Notre écrivain ne manque d'ailleurs jamais de rappeler qu'il est génial, ce dont personne ne doute, mais pour que nul n'en ignore, il fait en permanence son propre panégyrique. On n'est jamais mieux servi que par soi-même ! Ses investigations vont mener notre penseur, qui pour l'occasion n'hésite pas à revêtir diverses apparences, au cimetière des Innocents ainsi que dans des quartiers de la capitale, lui faire découvrir un trafic de vêtements des détrousseurs de cadavres, des tripots clandestins et mêmes les entrailles souterraines de Paris quand ce ne sont pas des séances de dissections. A mesure qu'il mène ses investigations, notre enquêteur-philosophe va croiser d'autres cadavres avec toujours autour d'eux les mêmes indices diaboliques ce qui épaissit le mystère. Devant ce qui est souvent des impasses, il ne manque pas de dénoncer une sorte de complot permanent tramé contre lui, en accuse les jansénistes et ainsi ses propos prennent-ils des accents nono-thématiques... à tendance obsessionnelle (les gens pressés appellent cela de la paranoïa). Finalement cette énigme trouvera son explication.
Il peut paraître étonnant que Voltaire se transforme ainsi en Hercule Poirot du XVIII° siècle mais souvenons-nous que notre philosophe, à qui bien peu de choses échappaient, s'attaquera dans sa quête constante du respect du droit, et avec le succès qu'on connaît, à l'affaire Calas notamment.
Je l'ai souvent dit dans cette chronique, un ouvrage de Lenormand est toujours pour moi un moment d'exception, surtout quand c'est Voltaire qu’il met en scène. Il nous conte cette histoire échevelée et qui tient en haleine son lecteur jusqu'à la fin en nous en annonçant les différents chapitres à la manière des bateleurs. Non seulement ce roman regorge de détails sur la vie quotidienne dans ce Paris du XVIII° mais il montre aussi comment notre philosophe, également auteur de pièces de théâtre, se démène pour le réformer et faire évoluer le jeu des acteurs selon ses vues. Après tout, jouer du Voltaire c'est quand même autre chose que déclamer comme on le faisait à l'époque !
Lenormand parsème son texte de recettes de cuisine, de détails alimentaires mais surtout de remarques pertinentes et impertinentes, que l'auteur de Zadig n’aurait sûrement pas désavouées. Il aime tellement son Voltaire qu'il le persifle volontiers, l'affuble de sobriquets parfois peu flatteurs mais jamais irrespectueux. Il le fait toujours avec cet esprit, cet humour de bon aloi et ce style jubilatoire que nous lui connaissons si bien que je me suis surpris bien souvent à sourire à la lecture de ce roman qui est autant dépaysant et instructif que distrayant.
©Hervé GAUTIER – Juin 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
CONFITEOR-
- Par ervian
- Le 05/06/2014
- Dans Jaume CABRE
- 0 commentaire
N°754 – Juin 2014.
CONFITEOR- Jaume CABRE – Actes Sud.
Traduit du catalan par Edmond Raillard.
« Confiteor », premier mot latin de l'acte de contrition selon l'ancienne formule du rituel catholique où l'on s'accuse de ses fautes et on en implore le pardon devant Dieu. Le ton est donc donné, ce sera celui de la confession mais sous une forme particulière, celle de l'écriture et ce cérémonial qui allège l'âme est cependant labyrinthique et parfois cahoteux comme la démarche d'un pénitent qui, pressé de se libérer, sollicite ses souvenirs qui se manifestent avec un certain désordre, d'où, sans doute un style haché et quelque peu déconcertant. C'est vrai que les analepses ne manquent pas dans ce roman de près de 800 pages. Il y a non seulement l'histoire de sa famille, de son enfance sous la houlette d' Aigle Noir et du shérif Carson, Barcelone dans les années 50, mais aussi des évocation du nazisme, de l'inquisition, du franquisme, de la république espagnole et les espoirs qu'elle portait, la guerre civile, de l'Italie au XVII° siècle... Le lecteur est quelque peu ballotté d'un pays à l'autre, d'une période à une autre, croise des personnages attachants ( un bûcheron, un fabriquant de violons, Lola Xica ) mais aussi d'autres infiniment moins recommandables (Un colonel SS, un médecin allemand dévoyé, un inquisiteur) avec tout ce qui fait les grandeurs (amour pour Sara, amitié pour Bernat, obsession de l'esthétique, dissertation sur le beau, érudition) et les petitesses de la condition humaine (lutte du bien et du mal, guerre, horreur et haine, folie des hommes, les camps de la mort). Pendant que sa mémoire n'est pas encore mangée par la maladie d'Alzheimer ou par la vieillesse Adria Ardèvol refait à l'envers son parcours sur terre. Jeune, c'est un garçon solitaire brillant et plein de promesses dans qui ses parents, pourtant peu aimants, mettent beaucoup d'espoirs. C'est à cause de cet absence d'amour qu'il va se dédié à l'étude. Il sera un érudit polyglotte et un universitaire célèbre.
Mais, à la mort de son père, cherchant dans cette mémoire encore intacte, il va peu à peu découvrir les origines douteuses de la richesse cette famille qui avait prospéré dans le négoce des œuvres d'art. C'est justement un objet, un violon dont il a parfois joué, pièce unique qu'on convoite de générations en générations qui servira de fil d'Ariane à ce récit.
Dans ce salmigondis de personnages, de lieux et d'époque, je me suis un peu perdu. Que les règles classiques du discours et de la narration soient outrepassées et même parfois violentées pourquoi pas ? Que ce récit prenne parfois des allures de puzzle dont les pièces sont, sans la moindre transition, opportunément éparpillées par l'auteur, soit mais j'ai cependant été un peu déconcerté par ce processus d'écriture.
Ce récit est le théâtre de l'affrontement du bien et du mal autant dire une constante dans la condition humaine et la culpabilisation s'inscrit dans la logique judéo-chrétienne. Quant au pardon, il reste, il me semble, une impossibilité... Ce problème du pardon m’intéresse en tant que thème de réflexion même si j'en donne personnellement une acception assez personnelle et en complète contradiction avec le message du catholicisme.
Je suis peut-être passé à côté de quelque chose mais j'avoue que je ne suis pas du tout entré dans ce roman.
©Hervé GAUTIER – Juin 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com
-
VINGT-QUATRE HEURES DE LA VIE D'UNE FEMME-
- Par ervian
- Le 27/05/2014
- Dans Stefan Zweig
- 0 commentaire
N°753 – Mai 2014.
VINGT-QUATRE HEURES DE LA VIE D'UNE FEMME- Stefan ZWEIG - Stock.
Traduit de l'allemand par Olivier Bournac et Alzir Hella.
Nous sommes au début du XX° siècle dans un hôtel calme de la Riviera et parmi les clients une femme mariée, mère de famille choisit de quitter son mari et ses enfants et de s'enfuir avec un jeune homme. Aussitôt, chacun y va de son commentaire conventionnel, moralisateur ou bassement médisant, mais le narrateur prend la défense de cette femme. Parmi ces clients, une vieille veuve anglaise de la haute société, discrète et digne, Mrs C …, se confie à lui et lui avoue que, vingt ans auparavant, elle avait alors quarante deux ans, alors qu'elle venait de perdre son mari et que ses enfants n'avaient plus besoin d'elle, était elle aussi tombée sous le charme d'un homme jeune qui venait, à Monte-Carlo, de tout perdre au jeu et qui voulait pour cela se donner la mort. Cet épisode amoureux ne dura que vingt-quatre heures et bouleversa sa vie même s'il ne fut pas partagé. Ce qui n'était au départ qu'une volonté de faire prévaloir la vie sur la mort s'est transformé, sans peut-être qu'elle le veuille vraiment, en un exaltante passade avec cet inconnu qui aurait pu être son fils. Pour elle qui vivait retirée du monde et confite dans le deuil, cette rencontre est une renaissance, une redécouverte du bonheur. Pour celle qui avait voulu, dans un élan de générosité et d'humanité, éviter à cet inconnu de se laisser glisser vers le suicide, cette journée passée avec lui est une invitation à retrouver cette vie à laquelle elle se fermait volontairement jusque là. L’amour dévastateur du jeu chez le jeune homme a ici son pendant sentimental chez cette femme respectable pour qui cette rencontre est un véritable « coup de foudre » ! Cela prend même une dimension quasi religieuse lors de la scène de l'église et Mrs C...pense même l'avoir sauvé définitivement de son addiction au jeu. La passion de Mrs C... pour ce jeune étranger est au vrai à peu près semblable à celle que ce dernier vouait au jeu mais pour lui, elle dura plus longtemps et eut raison de lui.
Ce court roman est bouleversant non seulement à cause du style (j'ai particulièrement été sensible à la description des mains du jeune homme face à la table de jeu, elles préfigurent le début de ce fantasme féminin et je ne dirai jamais assez que la lecture à haute voix souligne la musique des mots) mais aussi de la sincérité de l'auteur qui analyse, suivant son habitude, finement les sentiments des personnages. Ce texte est dans la même veine de « la confusion des sentiments » (La Feuille Volante n°747) qui m'avait tant plu.
Il n'y a rien d'érotique dans cette passade mais bien plutôt l'analyse de deux formes de passions apparemment incompatibles l'une avec l'autre. Tout est dans l’exhalation des sentiments de cette femme, ses projets insensés pour appartenir à cet homme alors que lui ne lui témoigne qu'une ingratitude brutte. L'auteur excelle à guider son lecteur attentif et passionné dans cet univers qui est le sien. L' issue n'est pas celle qu'aurait souhaitée Mrs C... mais ces vingt-quatre heures de vie intense (au vrai un bref instant dans sa longue existence) ont laissé dans sa mémoire une trace indélébile.
J'avoue que, à titre personnel, je suis particulièrement attentif aux écrivains qui se penchent sur la condition humaine et l'histoire intime des hommes et des femmes (cette histoire est très actuelle et le sera tant que les humains existeront), sur ce qui fait notre quotidien ou ce qui le bouleverse, ce qui est raison ou déraison, folie ou routine.
Ce roman a fait l'objet adaptations cinématographiques notamment en 1968 et 2003.
©Hervé GAUTIER – Mai 2014 - http://hervegautier.e-monsite.com